- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Alfred de Vigny (1797-1863), "Poèmes antiques et modernes" (1822-1826), "Cinq-Mars" (1826), "Stello" (1832), "Chatterton" (1835), "Servitude et Grandeur militaires" (1835, "Les Destinées" (1843-1845) - ....
Last update: 02/02/2023

"Condamnés à la mort, condamnés à la vie, voilà deux y certitudes. Condamnés à perdre ceux que nous aimons et à les voir devenir cadavres, condamnés à ignorer le passe et l'avenir de l'humanité et à y penser toujours! Mais pourquoi cette condamnation? — Vous ne le saurez jamais" (Journal intime) - Au poète de cœur, Alfred de Musset, s'oppose traditionnellement le poète philosophe, Alfred de Vigny : épreuves de l'existence, fardeau de notre responsabilité, énigme de notre destinée, tels sont les sujets qui ont fait I'objet de ses réflexions anxieuses et de ses poèmes symboliques. Il est celui qui, à cette époque, a trouvé le moyen d'exprimer son pessimisme et son expérience de la solitude d'un homme à qui ne parlent plus ni la nature, ni les hommes, ni Dieu même. Seul de tous les Romantiques français, il a tenté de concevoir une oeuvre impersonnelle, la poésie n'est pas l'exutoire de vaines confidences mais un art sérieux qui puise dans l'histoire ses sujets pour en tirer une signification morale : un nombre restreint de poèmes à la beauté sévère dans lesquels Vigny n'espère ni en Dieu ("le silence éternel de la Divinité") ni en la Nature ("On met dit une mère et je suis une tombe"). L'Univers lui semble étreint par un déterminisme implacable, l'être humain gémit sous le poids d'une destinée aveugle, retiré dans tout d'ivoire que peut dire le poète, si ce n'est opposer une dignité, plus hautaine qu'orgueilleuse, "j'aime la majesté des souffrances humaines"...
Alfred de Vigny a laissé en prose "Servitude et Grandeur militaires", sorte de commentaire sur le métier des armes au temps de l'Empire et de la Restauration; un roman historique : "Cinq-Mars"; un drame pessimiste : "Chatterton"; et en vers, des "Poèmes antiques et modernes" (1822-1826), complétés par "Les Destinées" (écrites vers 1843-1845).
(Portrait d'Alfred de Vigny, 1836, Pierre Daubigny, Musée de la Vie romantique, Paris)

Alfred de Vigny (1797-1863)
"Personne n'est entré dans l'intimité de M. de Vigny, pas même lui" (Jules Sandeau) - Alfred de Vigny, né à Loches en 1797, fut élevé entre une mère sévère et un père vieillissant, ancien officier qui développa en son fils le sens de l'honneur et le regret de l'ancienne noblesse. Attiré par la carrière militaire, où il débute en 1814, il ne connaîtra guère que la monotonie et l'ennui de la vie de garnison. Pour tromper son oisiveté, il écrit des vers, publie en 1822 un recueil intitulé "Poèmes" - au même moment Victor Hugo publiait ses "Odes" - et en 1824 "Éloa". Après son mariage avec une jeune Anglaise (1825, Lydia Bunbury, très jeune encore, lorsque le poète la connut à Pau, elle promettait de la beauté, de l'esprit, une grande fortune, et elle fut royalement belle), il quitte l'armée et s'installe à Paris. Lié avec Victor Hugo, il fréquente les milieux littéraires romantiques, fait paraître en 1826 les "Poèmes antiques et modernes", ainsi que "Cinq-Mars", un roman historique. En 1827, coup sur coup, de Cromwell jusqu'à Notre-Dame de Paris, Hugo publia toute une série d' œuvres retentissantes et la jeunesse romantique l'acclama pour son chef : Vigny avait, semble-t-il, secrètement ambitionné ce rôle ...
"Alfred de Vigny, écrit Alexandre Dumas dans ses Mémoires, était un singulier homme, poli, affable, doux dans ses relations, mais affectant l'immatérialité la plus complète; cette immatérialité, au reste, allait parfaitement à son charmant visage aux traits fins et spirituels, encadré dans de longs cheveux blonds bouclés, comme un de ces chérubins dont il semblait le frère. De Vigny ne touchait jamais à la terre que par nécessité; quand il reployait ses ailes, et qu'il se posait, par hasard, sur la cime d'une montagne, c'était une concession qu'il faisait à l'humanité. Ce qui nous émerveillait surtout Hugo et moi, c'est que de Vigny ne paraissait pas soumis le moins du monde à ces grossiers besoins de notre nature que quelques-uns d'entre nous (et Hugo et moi étions de ceux-là) satisfaisaient non seulement sans honte, mais encore avec une certaine sensualité ..."
La Révolution de 1830 l'incline à quelque pitié pour les misères humaines. Il célèbre le poète incompris dans un roman : "Stello" (1832) et dans un drame, "Chatterton" (1835), porté par la comédienne Marie Dorval (1798-1849) ...
Les trois actes de "Chatterton" ne furent, nous rapporte-t-on, qu'un long triomphe. Lorsque, près de mourir, Chatterton brûlant ses papiers s'écrie : « Allez, nobles pensées écrites pour tous ces ingrats dédaigneux, purifiez-vous dans la flamme et remontez au ciel avec moi », à ces paroles, nous dit-on, la représentation fut presque suspendue par l'émotion de la salle, puis le dernier tableau porta plus haut encore le succès du drame. Dans cette scène, Kitty Bell, montée sur un palier, voit à travers une porte vitrée Chatterton se donner la mort : éperdue, elle s'affaisse, glisse demi-inanimée sur la rampe et mourante à son tour se laisse tomber sur la dernière marche. Ce dispositif matériel du décor inspira à Mme Dorval qui tenait le rôle un de ces mouvements hardis qui étaient le secret de son talent. Du haut des marches gravies par élans convulsifs, presque à genoux, elle roulait à terre, les bras tendus, foudroyée de douleur, et dans le cri qu'elle proférait, c'était plus qu'une créature aimante et souffrante exhalant son âme, c'était, suivant le mot de Théophile Gautier, « la jeunesse et la passion se réfugiant dans la mort comme dans le seul asile inviolable et libre ». Les spectateurs étaient en proie à un enthousiasme extraordinaire lorsque le rideau s'abaissa. Le lendemain, le nom d'Alfred de Vigny était illustre. Mais un succès sans lendemain, ne lui resta que son immense passion pour Marie Dorval (1798-1849), douée d'une sensibilité presque maladive, disait-on, elle vibrait tout entière au moindre émoi, et ce fut une passion de cinq années (1832 à 1837), à laquelle le poète répondit dans un élan quasiment mystique ...
Puis Vigny chante le soldat, "cet autre paria moderne", dans "Servitude et grandeur militaires" (1835). Sainte-Beuve, dans ses Pensées d'Août, esquisse le tableau de la poésie en ce XIXe siècle, et rsume ainsi l'histoire des trois poètes à qui elle devait son plus glorieux éclat : "Lamartine régna : chantre ailé qui soupire, Il planait sans effort. Hugo, dur partisan (Comme chez Dante on voit, Florentin ou Pisan, Un baron féodal), combattit sous l'armure Et tint haut sa bannière au milieu du murmure ; Il la maintient encore ; et Vigny, plus secret, Comme en sa tour d'ivoire avant midi rentrait." L'image fit fortune ...
Fin 1837, c'est la mort de sa mère (fin 1837) et la rupture de sa liaison avec la comédienne Marie Dorval : c'est à l'occasion de leur rupture qu'il écrivit "La colère de Samson" et ses fameux vers d'un orgueil blessé, d'une très profonde crise morale, ... "une lutte éternelle, en tout temps, en tout lieu, Se livre sur la terre en présence de Dieu, Entre la bonté d'Homme et la ruse de Femme, Car la femme est un être impur de corps et d'âme". Et pourtant son héros n'avait-il pas proclamé ... "L'Homme a toujours besoin de caresse et d'amour, / Sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour, / Et ce bras le premier l'engourdit, le balance / Et lui donne un désir d'amour et d'indolence. / Troublé dans l'action, troublé dans le dessein, / II rêvera partout à la chaleur du sein, / Aux chansons de la nuit, aux baisers de l'aurore, / A la lèvre de feu que sa lèvre dévore. / Aux cheveux dénoués qui roulent sur son front, / Et les regrets du lit, en marchant, le suivront" ..
Il s'enferme alors dans son manoir du Maine-Giraud en Charente et mène dès lors une vie très retirée. C'est l'époque des grands poèmes : "La Mort du Loup" (1838), "la Colère de Samson" (1839), "le Mont des Oliviers" (1839), "la Sauvage" (1842), "la Maison du Berger" (1844), "la Bouteille à la mer" (1847). Ses dernières années se passent à soigner sa femme devenue impotente. "L'Esprit pur" (mars 1863) est comme le testament spirituel du poète, qui meurt quelques mois plus tard. Il laissait des œuvres inédites : le poème "les Destinées", écrit en 1849, le roman "Daphné", et un ensemble de notes qui seront réunies sous le titre "journal d'un Poète".
L'œuvre de Vigny est souvent considérée comme celle d'un philosophe et d'un poète. Le monde est mené par des forces qui écrasent l'homme. De ce pessimisme métaphysique, exprimé dès 1823, Vigny ne guérira jamais. Mais à partir de 1840, il lui oppose un optimisme social : les hommes, par leur travail et leur esprit d'entraide, peuvent rendre la vie sur terre supportable. Un jour, triomphera "l'esprit pur". L'œuvre s'achève sur cette confiance. Poète, Vigny l'est surtout par la richesse exceptionnelle de ses images et la beauté de ses symboles.
Les poèmes de Vigny ont une signification plus morale que lyrique. Ce ne sont pas de simples compositions descriptives : Vigny cherche dans la nature ou surtout dans l'histoire des sujets dont il puisse tirer une conclusion morale, en faire des symboles. De telles pièces, à tendance objective et philosophique à la fois, ne sont romantiques que par le choix de sujets bibliques ou modernes et par le pessimisme de l'inspiration... Dans "Eloa", ange de la Pitié, séduite par Satan, il y a un essai brillant de merveilleux chrétien; dans "Le Cor", le poète s'est remémoré la fin héroïque de Roland. Les poèmes qui semblent le mieux exprimer la philosophie de Vigny sont : "Moise", "La Colère de Samson", et le célèbre "La Mort du Loup" ...

"Poèmes antiques et Modernes" (1822-1829)
C'est l'unique recueil poétique que Vigny publia de son vivant, il fut accueilli sans chaleur, le meilleur peut voisiner avec le moins bon, mais son influence fut importante, les symbolistes lui doivent beaucoup, Péguy lui reprendra certains thèmes. Aux premières publications de 1822 et de 1826, celle de 1829 ajouta des poèmes célèbres, "Le Déluge", "Moïse", "Le Cor". Mais le public préféra "Cinq-Mars" à ses Poèmes...
C'est dans l'Antiquité et surtout dans la Bible, que Vigny puisa la forme de son expression poétique : comme beaucoup des jeunes gens qui avaient grandi sous l`Empire, "Le Génie du christianisme" de Chateaubriand l'y avait conduit, mais aussi vers le Dieu très austère de Milton. Quant à l'Antiquité païenne, elle avait obsédé la génération précédente, sous la Révolution; et l`œuvre de Chénier, qui venait d'être publiée, la parait des prestiges d`un nouveau lyrisme qui enthousiasma Vigny. Mais la prédilection pour l'Antiquité a chez Vigny des causes plus profondes : poète, il est pourtant dépourvu des dons du visuel qui crée naturellement des images; il ne vit point comme les autres romantiques dans une continuelle émotion lyrique. Les légendes suppléent donc à ces défaillances, elles lui fournissent l`univers qu`il ne sait pas tirer de lui-même. Pourtant. et bien qu'il montre un grand souci de la couleur locale, bien qu`il vérifie l`exactitude historique des beaux mots qu'il a d'abord choisis pour leur sonorité pittoresque et exotique, il ne demande finalement à La Bible qu'un cadre, et place ensuite son âme dans celui-ci : Moïse, la fille de Jephté, Eloa ne sont pour lui que des figures éternelles au travers desquelles il s`expríme lui-même, et lui seul. Ainsi, sous des dehors antiques, ses personnages sont bien modernes. Le pessimisme de son Moïse n'a rien à voir avec le chef des Hébreux; la pitié d`Eloa pour Satan était inconnue du monde chrétien. Aussi bien la nature que les héros d'histoire ou de légende, tout est symbole pour Vigny : c`est tout le sens de son art. Ce qu'il veut d`abord dans ces Poèmes, c'est livrer sa pensée, une philosophie, et il n'use de toutes les ressources du lyrisme qu'en vue de ce but unique.
Le "Livre mystique" est ainsi considéré comme la plus parfaite expression de son génie poétique : avec son "Moïse", écrit à trente ans, il est déjà à la hauteur des Destinées.
Le sentiment de la solitude - "Moïse" dépeint la souffrance de l'homme supérieur, isolé dans sa gloire, "prophète centenaire", Moïse demande à Dieu de le décharger de sa tâche redoutable : "O Seigneur! j'ai vécu puissant et solitaire, / Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre!" ...
Le soleil prolongeait sur la cime des tentes
Ces obliques rayons, ces flammes éclatantes,
Ces larges traces d’or qu’il laisse dans les airs,
Lorsqu’en un lit de sable il se couche aux déserts.
La pourpre et l’or semblaient revêtir la campagne.
Du stérile Nébo gravissant la montagne,
Moïse, homme de Dieu, s’arrête, et, sans orgueil,
Sur le vaste horizon promène un long coup d’œil.
Il voit d’abord Phasga, que des figuiers entourent,
Puis, au-delà des monts que ses regards parcourent,
S’étend tout Galaad, Éphraïm, Manassé,
Dont le pays fertile à sa droite est placé ;
Vers le Midi, Juda, grand et stérile, étale
Ses sables où s’endort la mer occidentale ;
Plus loin, dans un vallon que le soir a pâli,
Couronné d’oliviers, se montre Nephtali ;
Dans des plaines de fleurs magnifiques et calmes,
Jéricho s’aperçoit, c’est la ville des palmes ;
Et, prolongeant ses bois, des plaines de Phogor
Le lentisque touffu s’étend jusqu’à Ségor.
Il voit tout Chanaan, et la terre promise,
Où sa tombe, il le sait, ne sera point admise.
Il voit ; sur les Hébreux étend sa grande main,
Puis vers le haut du mont il reprend son chemin.
Or, des champs de Moab couvrant la vaste enceinte,
Pressés au large pied de la montagne sainte,
Les enfants d’Israël s’agitaient au vallon
Comme les blés épais qu’agite l’aquilon.
Dès l’heure où la rosée humecte l’or des sables
Et balance sa perle au sommet des érables,
Prophète centenaire, environné d’honneur,
Moïse était parti pour trouver le Seigneur.
On le suivait des yeux aux flammes de sa tête,
Et, lorsque du grand mont il atteignit le faîte,
Lorsque son front perça le nuage de Dieu
Qui couronnait d’éclairs la cime du haut lieu,
L’encens brûla partout sur les autels de pierre,
Et six cent mille Hébreux, courbés dans la poussière,
À l’ombre du parfum par le soleil doré,
Chantèrent d’une voix le cantique sacré ;
Et les fils de Lévi, s’élevant sur la foule,
Tels qu’un bois de cyprès sur le sable qui roule,
Du peuple avec la harpe accompagnant les voix,
Dirigeaient vers le ciel l’hymne du Roi des Rois.
Et, debout devant Dieu, Moïse ayant pris place,
Dans le nuage obscur lui parlait face à face.
Il disait au Seigneur : « Ne finirai-je pas ?
Où voulez-vous encor que je porte mes pas ?
Je vivrai donc toujours puissant et solitaire ?
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre. —
Que vous ai-je donc fait pour être votre élu ?
J’ai conduit votre peuple où vous avez voulu.
Voilà que son pied touche à la terre promise,
De vous à lui qu’un autre accepte l’entremise,
Au coursier d’Israël qu’il attache le frein ;
Je lui lègue mon livre et la verge d’airain.
« Pourquoi vous fallut-il tarir mes espérances,
Ne pas me laisser homme avec mes ignorances,
Puisque du mont Horeb jusques au mont Nébo
Je n’ai pas pu trouver le lieu de mon tombeau ?
Hélas ! vous m’avez fait sage parmi les sages !
Mon doigt du peuple errant a guidé les passages.
J’ai fait pleuvoir le feu sur la tête des rois ;
L’avenir à genoux adorera mes lois ;
Des tombes des humains j’ouvre la plus antique,
La mort trouve à ma voix une voix prophétique,
Je suis très grand, mes pieds sont sur les nations,
Ma main fait et défait les générations. —
Hélas ! je suis, Seigneur, puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre !
« Hélas ! je sais aussi tous les secrets des cieux,
Et vous m’avez prêté la force de vos yeux.
Je commande à la nuit de déchirer ses voiles ;
Ma bouche par leur nom a compté les étoiles,
Et, dès qu’au firmament mon geste l’appela,
Chacune s’est hâtée en disant : Me voilà.
J’impose mes deux mains sur le front des nuages
Pour tarir dans leurs flancs la source des orages ;
J’engloutis les cités sous les sables mouvants ;
Je renverse les monts sous les ailes des vents ;
Mon pied infatigable est plus fort que l’espace ;
Le fleuve aux grandes eaux se range quand je passe,
Et la voix de la mer se tait devant ma voix.
Lorsque mon peuple souffre, ou qu’il lui faut des lois,
J’élève mes regards, votre esprit me visite ;
La terre alors chancelle et le soleil hésite,
Vos anges sont jaloux et m’admirent entre eux.
Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heureux ;
Vous m’avez fait vieillir puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.
(...)
C'est dans La Bible, telle qu`il l'interprète, que Vigny a trouvé le moyen d'exprimer son pessimisme, son expérience de la solitude de l'homme à qui ne parlent plus ni la nature, ni les hommes, ni Dieu même. Et l'austère tristesse de cette œuvre de jeunesse fait bien voir que l'amertume de Vigny tient bien moins aux événements douloureux de sa vie qu'à la nature même de sa personnalité. Mais un désespoir qui refuse de s'abandonner aux larmes romantiques. Son "Moïse" quittant les tentes des Hébreux pour gravir la montagne où il ne trouvera pas Dieu, mais le silence et la déréliction, illustre bien le thème romantique du génie prédestiné au malheur : "Hélas! je suis, Seigneur, puissant et solitaire / Laissez-moi m'endormir du sommeil de la Terre". S'il sait que le divin doit être révélé aux hommes, au prix inévitable du sacrifice de celui qui le révèle, il ne sait rien de cette force qui le possède, qui lui froide et indifférente aux préoccupations humaines. "Eloa", inspiré de la vieille légende de l'Ange né d'une larme du Christ pleurant sur Lazare, reprend en partie le thème de "Moïse", faisant paraître l`autre pôle de la pensée de Vigny, qui répond à son désespoir et le compense : Eloa, c'est en effet, le thème de la pitié qui ne recule devant rien, qui veut sauver à tout prix, même le Diable; l`amour qui voudrait, inutilement, racheter le monde, et qui périt de son audace, mais sans se plaindre. Prophétisme de Vigny? un Vigny de son siècle, qui doute si le Salut absolu ne serait pas en effet possible, si l'avènement d'un nouveau Dieu, réconciliant les deux principes, Satan et Dieu, ne viendra pas chasser le mal de la terre : c`est l`élan qui anime le sacrifice d'Eloa. Et Vigny s'interroge : « Ah! si dans ce moment la Vierge eût pu l'entendre, / Si la céleste main qu'elIe eût osé lui tendre / L'eût saisi repentant, docile à remonter... / Qui sait? le mal peut-être eût cessé d`exister." Eloa se sacrifie en vain pour racheter Satan..
"Éloa ou la Sœur des anges" est un poème épique philosophique en trois parties écrit par Alfred de Vigny en 1824, Éloa, ange innocente qui tombe éperdument amoureuse d'un étranger, contre les lois de Dieu, un étranger qui n'est autre que Lucifer ...
" .. Toute parée, aux yeux du Ciel qui la contemple,
Elle marche vers Dieu comme une épouse au Temple ;
Son beau front est serein et pur comme un beau lis,
Et d’un voile d’azur il soulève les plis ;
Ses cheveux, partagés comme des gerbes blondes,
Dans les vapeurs de l’air perdent leurs molles ondes,
Comme on voit la comète errante dans les cieux
Fondre au sein de la nuit ses rayons gracieux ;
Une rose aux lueurs de l’aube matinale
N’a pas de son teint frais la rougeur virginale ;
Et la lune, des bois éclairant l’épaisseur,
D’un de ses doux regards n’atteint pas la douceur.
Ses ailes sont d’argent ; sous une pâle robe,
Son pied blanc tour à tour se montre et se dérobe,
Et son sein agité, mais à peine aperçu,
Soulève les contours du céleste tissu.
C’est une femme aussi, c’est une Ange charmante ;
Car ce peuple d’Esprits, cette famille aimante,
Qui, pour nous, près de nous, prie et veille toujours,
Unit sa pure essence en de saintes amours ..."
Dans "Le Déluge", la protestation contre ce Dieu silencieux, qui exige le sacrifice de l'innocent (comme dans "La Fille de Jephté"), se fait plus violente, par opposition, avec la pureté, la bonté, la beauté du monde et de l`homme du premier matin, évoquées en des termes dont Péguy se souviendra dans son "Eve". Bien loin d`être une simple évocation historique, un jaillissement d'images étranges, de mots exotiques, ces "Poèmes mystiques et antiques" prennent donc la valeur d'une philosophie, sans doute assez sommaire, mais que Vigny sait exposer avec la grandeur d'un verbe qui s`adresse surtout à l`intelligence.
Ce fut le dernier cri du dernier des humains.
Longtemps, sur l’eau croissante élevant ses deux mains,
Il soutenait Sara par les flots poursuivie ;
Mais, quand il eut perdu sa force avec la vie,
Par le ciel et la mer le monde fut rempli,
Et l’arc-en-ciel brilla, tout étant accompli.
Protestation contre le Dieu chrétien que Vigny connaît surtout par Joseph de Maistre et le Lamennais terrible, intransigeant, d'avant les "Paroles d'un croyant", Dieu d'injustice, de colère et de vengeance; solitude de l'homme, mais qui pourrait être compensée par la pitié de certaines âmes d'élite, dont Eloa est le symbole. Ainsi, singulièrement, Vigny réussit à allier la plus extrême tristesse et un optimisme un peu facile. qui est bien du temps des utopistes sociaux, des saint-simoniens, évoqués dans "Paris".
La Terre était riante et dans sa fleur première ;
Le jour avait encor cette même lumière
Qui du Ciel embelli couronna les hauteurs
Quand Dieu la fit tomber de ses doigts créateurs.
Rien n’avait dans sa forme altéré la nature,
Et des monts réguliers l’immense architecture
S’élevait jusqu’aux Cieux par ses degrés égaux,
Sans que rien de leur chaîne eût brisé les anneaux.
La forêt, plus féconde, ombrageait, sous ses dômes,
Des plaines et des fleurs les gracieux royaumes
Et des fleuves aux mers le cours était réglé
Dans un ordre parfait qui n’était pas troublé.
Jamais un voyageur n’aurait, sous le feuillage,
Rencontré, loin des flots, l’émail du coquillage,
Et la perle habitait son palais de cristal :
Chaque trésor restait dans l’élément natal,
Sans enfreindre jamais la céleste défense ;
Et la beauté du monde attestait son enfance ;
Tout suivait sa loi douce et son premier penchant,
Tout était pur encor. Mais l’homme était méchant.
Les peuples déjà vieux, les races déjà mûres,
Avaient vu jusqu’au fond des sciences obscures ;
Les mortels savaient tout, et tout les affligeait ;
Le prince était sans joie ainsi que le sujet ;
Trente religions avaient eu leurs prophètes,
Leurs martyrs, leurs combats, leurs gloires, leurs défaites,
Leur temps d’indifférence et leur siècle d’oubli ;
Chaque peuple, à son tour dans l’ombre enseveli,
Chantait languissamment ses grandeurs effacées :
La mort régnait déjà dans les âmes glacées.
Même plus haut que l’homme atteignaient ses malheurs :
D’autres êtres cherchaient ses plaisirs et ses pleurs.
Souvent, fruit inconnu d’un orgueilleux mélange,
Au sein d’une mortelle on vit le fils d’un Ange.
Le crime universel s’élevait jusqu’aux cieux.
Dieu s’attrista lui-même et détourna les yeux.
Et cependant, un jour, au sommet solitaire
Du mont sacré d’Arar, le plus haut de la Terre,
Apparut une vierge et près d’elle un pasteur :
Tous deux nés dans les champs, loin d’un peuple imposteur,
Leur langage était doux, leurs mains étaient unies
Comme au jour fortuné des unions bénies ;
Ils semblaient, en passant sur ces monts inconnus,
Retourner vers le Ciel dont ils étaient venus ;
Et, sans l’air de douleur, signe que Dieu nous laisse,
Rien n’eût de leur nature indiqué la faiblesse,
Tant les traits primitifs et leur simple beauté
Avaient sur leur visage empreint de majesté.
Quand du mont orageux ils touchèrent la cime,
La campagne à leurs pieds s’ouvrit comme un abîme.
C’était l’heure où la nuit laisse le Ciel au jour :
Les constellations palissaient tour à tour ;
Et, jetant à la Terre un regard triste encore,
Couraient vers l’Orient se perdre dans l’aurore,
Comme si pour toujours elles quittaient les yeux
Qui lisaient leur destin sur elles dans les Cieux.
Le Soleil, dévoilant sa figure agrandie,
S’éleva sur les bois comme un vaste incendie,
Et la Terre aussitôt, s’agitant longuement,
Salua son retour par un gémissement.
Réunis sur les monts, d’immobiles nuages
Semblaient y préparer l’arsenal des orages ;
Et sur leurs fronts noircis qui partageaient les Cieux
Luisait incessamment l’éclair silencieux.
(....)
(...)
Ce fut alors qu’on vit des hôtes inconnus
Sur des bords étrangers tout à coup survenus ;
Le cèdre jusqu’au nord vint écraser le saule ;
Les ours noyés, flottants sur les glaçons du pôle,
Heurtèrent l’éléphant près du Nil endormi,
Et le monstre, que l’eau soulevait à demi,
S’étonna d’écraser, dans sa lutte contre elle,
Une vague où nageaient le tigre et la gazelle.
En vain des larges flots repoussant les premiers,
Sa trompe tournoyante arracha les palmiers ;
Il fut roulé comme eux dans les plaines torrides,
Regrettant ses roseaux et ses sables arides,
Et de ses hauts bambous le lit flexible et vert,
Et jusqu’au vent de flamme exilé du désert.
Dans l’effroi général de toute créature,
La plus féroce même oubliait sa nature ;
Les animaux n’osaient ni ramper ni courir,
Chacun d’eux résigné se coucha pour mourir.
En vain fuyant aux cieux l’eau sur ses rocs venue,
L’aigle tomba des airs, repoussé par la nue.
Le péril confondit tous les êtres tremblants.
L’homme seul se livrait à des projets sanglants.
Quelques rares vaisseaux qui se faisaient la guerre,
Se disputaient longtemps les restes de la terre :
Mais, pendant leurs combats, les flots non ralentis
Effaçaient à leurs yeux ces restes engloutis.
Alors un ennemi plus terrible que l’onde
Vint achever partout la défaite du monde ;
La faim de tous les cœurs chassa les passions :
Les malheureux, vivants après leurs nations,
N’avaient qu’une pensée, effroyable torture,
L’approche de la mort, la mort sans sépulture.
On vit sur un esquif, de mers en mers jeté,
L’oeil affamé du fort sur le faible arrêté ;
Des femmes, à grands cris insultant la nature,
Y réclamaient du sort leur humaine pâture ;
L’athée, épouvanté de voir Dieu triomphant,
Puisait un jour de vie aux veines d’un enfant ;
Des derniers réprouvés telle fut l’agonie.
L’amour survivait seul à la bonté bannie ;
Ceux qu’unissaient entre eux des serments mutuels,
Et que persécutait la haine des mortels,
S’offraient ensemble à l’onde avec un front tranquille,
Et contre leurs douleurs trouvaient un même asile.
Mais sur le mont Arar, encor loin du trépas,
Pour sauver ses enfants l’ange ne venait pas ;
En vain le cherchaient-ils, les vents et les orages
N’apportaient sur leurs fronts que de sombres nuages.
Cependant sous les flots montés également
Tout avait par degrés disparu lentement :
Les cités n’étaient plus, rien ne vivait, et l’onde
Ne donnait qu’un aspect à la face du monde.
Seulement quelquefois sur l’élément profond
Un palais englouti montrait l’or de son front ;
Quelques dômes, pareils à de magiques îles,
Restaient pour attester la splendeur de leurs villes.
Là parurent encore un moment deux mortels :
L’un la honte d’un trône, et l’autre des autels ;
L’un se tenant au bras de sa propre statue,
L’autre au temple élevé d’une idole abattue.
Tous deux jusqu’à la mort s’accusèrent en vain
De l’avoir attirée avec le flot divin.
Plus loin, et contemplant la solitude humide,
Mourait un autre roi, seul sur sa pyramide.
(...)
Les poèmes inspirés par l`Antiquité païenne sont plus anciens, mais jugés incontestablement moins bons, bien que proche d'un Chéníer ("Symétha") mais dépourvu de l'agilité de ce dernier. L'austérité des déserts d'Egypte, où l'âme est seule dans la nature, face à Dieu, lui convient mieux que la scène fleurie du départ d'une courtisane pour Lesbos.
Dans le "Livre moderne", la nostalgie du temps des anciens preux (dans la célèbre pièce du "Cor") trouve un écho dans la vision apocalyptique de "Paris" où le soldat en mal de gloire voit poindre un monde nouveau, heureux ou malheureux, mais où, de nouveau, régnera la grandeur. Vigny ouvrait les chemins au Victor Hugo de La Légende des Siècles et à Leconte de Lisle ..

"Chatterton" (1835)
Chatterton (1752-1770) est un poète anglais que la misère poussa à s'empoisonner à dix-huit ans, dans un grenier, après avoir détruit ses manuscrits. Drame en trois actes en prose que propose Vigny fut représenté à Paris le 12 février 1835. Thomas Chatterton, âgé de dix-huit ans, a composé de merveilleux ouvrages en langue anglaise ancienne, en les attribuant à un imaginaire Thomas Rowley, moine du XVe siècle. Plongé dans une extrême misère et désespéré, il vit à Londres, dans une chambre meublée, chez le riche marchand John Bell. La femme de celui-ci, Kitty Bell, aide le jeune homme et l'aime en secret. Un camarade d`école à Oxford reconnaît Chatterton, révèle son nom véritable aux Bell et croit qu'il demeure incognito dans cette maison dans l'intention de séduire Kitty. La jeune femme, scandalisée, doute du jeune homme et ne le lui cache pas ; le poète en souffre et songe déjà à la mort. Un vieux quaker, ami des Bell, ayant tout compris, pour le sauver lui révèle que Kitty l'aime aussi. Chatterton vivra si le lord-maire de Londres, auquel il s'est adressé, lui prête secours. Lorsque celui-ci arrive, il exprime son indulgence envers la poésie en général et envers l'œuvre de Chatterton en particulier, et lui offre la place de premier serviteur dans sa maison. Mais, au même moment, Chatterton reçoit un article de critique qui conteste l'authenticité de ses livres, en les attribuant à un certain Rowley ayant vraiment existé. Chatterton, au comble du désespoir, s'empoisonne après avoir brûlé ses manuscrits; Kitty meurt de douleur...
ACTE III - SCÈNE VIII. CHATTERTON, KITTY BELL.
Kitty Bell sort lentement de sa chambre, s’arrête, observe Chatterton, et va se placer entre la cheminée et lui. — Il cesse tout à coup de déchirer ses papiers.
KITTY BELL, à part. - Que fait-il donc ? Je n’oserai jamais lui parler. Que brûle-t-il ? Cette flamme me fait peur, et son visage éclairé par elle est lugubre.
À Chatterton. - N’allez-vous pas rejoindre milord ?
CHATTERTON laisse tomber ses papiers ; tout son corps frémit. - Déjà ! — Ah ! c’est vous ! — Ah ! madame ! à genoux ! par pitié ! oubliez-moi.
KITTY BELL. - Eh ! mon Dieu ! pourquoi cela ? qu’avez-vous fait ?
CHATTERTON. - Je vais partir. — Adieu ! — Tenez, madame, il ne faut pas que les femmes soient dupes de nous plus longtemps. Les passions des poètes n’existent qu’à peine. On ne doit pas aimer ces gens-là ; franchement, ils n’aiment rien ; ce sont tous des égoïstes. Le cerveau se nourrit aux dépens du cœur. Ne les lisez jamais et ne les voyez pas ; moi, j’ai été plus mauvais qu’eux tous.
KITTY BELL. Mon Dieu ! pourquoi dites-vous : « J’ai été ? »
CHATTERTON. - Parce que je ne veux plus être poète ; vous le voyez, j’ai déchiré tout. — Ce que je serai ne vaudra guère mieux, mais nous verrons. Adieu ! — Écoutez-moi ! Vous avez une famille charmante ; aimez-vous vos enfants ?
KITTY BELL. - Plus que ma vie, assurément.
CHATTERTON. - Aimez donc votre vie pour ceux à qui vous l’avez donnée.
KITTY BELL. - Hélas ! ce n’est que pour eux que je l’aime.
CHATTERTON. - Eh ! quoi de plus beau dans le monde, ô Kitty Bell ! Avec ces anges sur vos genoux, vous ressemblez à la divine Charité.
KITTY BELL. - Ils me quitteront un jour.
CHATTERTON. - Rien ne vaut cela pour vous ! — C’est là le vrai dans la vie ! Voilà un amour sans trouble et sans peur. En eux est le sang de votre sang, l’âme de votre âme : aimez-les, madame, uniquement et par-dessus tout. Promettez-le-moi !
KITTY BELL. - Mon Dieu ! vos yeux sont pleins de larmes, et vous souriez.
CHATTERTON. - Puissent vos beaux yeux ne jamais pleurer et vos lèvres sourire sans cesse ! Ô Kitty ! ne laissez entrer en vous aucun chagrin étranger à votre paisible famille.
KITTY BELL. - Hélas ! cela dépend-il de nous ?
CHATTERTON. - Oui ! oui !… Il y a des idées avec lesquelles on peut fermer son cœur. — Demandez au quaker, il vous en donnera. — Je n’ai pas le temps, moi ; laissez-moi sortir.
Il marche vers sa chambre.
KITTY BELL. - Mon Dieu ! comme vous souffrez !
CHATTERTON. - Au contraire. — Je suis guéri. — Seulement j’ai la tête brûlante. Ah ! bonté ! bonté ! tu me fais plus de mal que leurs noirceurs.
KITTY BELL. - De quelle bonté parlez-vous ? Est-ce de la vôtre ?
CHATTERTON. - Les femmes sont dupes de leur bonté. C’est par bonté que vous êtes venue. On vous attend là-haut j’en suis certain. Que faites-vous ici ?
KITTY BELL, émue profondément et l’œil hagard. - À présent, quand toute la terre m’attendrait, j’y resterais.
CHATTERTON. - Tout à l’heure je vous suivrai. — Adieu ! adieu !
KITTY BELL, l’arrêtant - Vous ne viendrez pas ?
CHATTERTON. - J’irai. — J’irai.
KITTY BELL. - Oh ! vous ne voulez pas venir.
CHATTERTON. - Madame, cette maison est à vous, mais cette heure m’appartient.
KITTY BELL. - Qu’en voulez-vous faire ?
CHATTERTON. - Laissez-moi, Kitty. Les hommes ont des moments où ils ne peuvent plus se courber à votre taille et s’adoucir la voix pour vous… Kitty Bell, laissez-moi.
KITTY BELL. - Jamais je ne serai heureuse si je vous laisse ainsi, monsieur.
CHATTERTON. - Venez-vous pour ma punition ? Quel mauvais génie vous envoie ?
KITTY BELL. - Une épouvante inexplicable.
CHATTERTON. - Vous serez plus épouvantée si vous restez.
KITTY BELL. - Avez-vous de mauvais desseins, grand Dieu ?
CHATTERTON. - Ne vous en ai-je pas dit assez ? Comment êtes-vous là ?
KITTY BELL. - Eh ! comment n’y serais-je plus ?
CHATTERTON. - Parce que je vous aime, Kitty.
KITTY BELL. - Ah ! monsieur, si vous me le dites, c’est que vous voulez mourir.
CHATTERTON. - J’en ai le droit, de mourir. — Je le jure devant vous, et je le soutiendrai devant Dieu !
KITTY BELL. - Et moi, je vous jure que c’est un crime ; ne le commettez pas.
CHATTERTON. - Il le faut, Kitty, je suis condamné.
KITTY BELL. - Attendez seulement un jour pour penser à votre âme.
CHATTERTON. - Il n’y a rien que je n’aie pensé, Kitty.
KITTY BELL. - Une heure seulement pour prier.
CHATTERTON. - Je ne peux plus prier.
KITTY BELL. - Et moi, je vous prie pour moi-même. Cela me tuera.
CHATTERTON. - Je vous ai avertie ! il n’est plus temps.
KITTY BELL. - Et si je vous aime, moi !
CHATTERTON. - Je l’ai vu, et c’est pour cela que j’ai bien fait de mourir ; c’est pour cela que Dieu peut me pardonner.
KITTY BELL. - Qu’avez-vous donc fait ?
CHATTERTON. - Il n’est plus temps, Kitty ; c’est un mort qui vous parle.
KITTY BELL, à genoux, les mains au ciel. - Puissances du ciel ! grâce pour lui.
CHATTERTON. - Allez-vous-en… Adieu !
KITTY BELL, tombant. - Je ne le puis plus…
Il s'agit d'un thème cher à Alfred de Vigny, et repris dans "Stello", la place que la société offre aux poètes et leur misère inévitable. L'auteur l'a porté à la scène dans le but de lui donner une plus grande audience. Ce drame impressionna profondément la jeunesse intellectuelle et le public. Il s'agit d'une des défenses romantiques les plus passionnées de la poésie contre le monde qui la repousse, et d'une des meilleures pièces du théâtre romantique franças. On y trouve une rhétorique naïve, une retenue pleine de finesse et de simplicité. Kitty Bell - dont le rôle fut admirablement interprété par Marie Dorval - est une création splendide et pleine d'émotion d'Alfred de Vigny.

"Cinq-Mars" (1826)
Roman historique, et le premier roman historique français traité à la manière de Walter Scott. Si le livre contient quelques scènes délicates, ce qui y domine c`est une couleur sombre, des personnages fourbes. des scènes d`horreur. L'auteur aurait voulu exprimer, dans cet ouvrage. une de ses idées les plus chères : la défense de l'ancienne noblesse sacrifiée par Richelieu à la monarchie absolue et unitaire; et, pour renforcer sa thèse, il sera, certes, amené à prendre bien des libertés avec la vérité historique...
En 1639, le jeune Henri d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, se rend à la Cour, avec une recommandation pour le cardinal de Richelieu qui devra le présenter au roi Louis XIII. S'étant fait remarquer au siège de Perpignan, il gagne l'estime et l`affection du roi, sans s'être adressé auparavant au Cardinal qui, déjà, lui est hostile.
Cinq-Mars deviendra bien vite un des ennemis de Richelieu, un de ceux qui détestent le Cardinal à cause de son pouvoir absolu. En 1642, Cinq-Mars est déjà devenu le favori du roi; il est premier écuyer et l`un des plus illustres personnages du parti opposé à Richelieu. La conspiration contre le Cardinal s'organise autour du frère du roi, Gaston d'Orléans, faible et craintif, et autour de la reine, au caractère indécis. Cinq-Mars au contraire est plein de fermeté; il sait qu`en acquérant la renommée il pourra conserver l`amour de Marie de Gonzague. Il ose donc exprimer à Louis l'angoisse de la France opprimée par le Cardinal, et le roi l'écoute, presque en l'approuvant; mais bien vite il retombe sous l`emprise de Richelieu. Cinq-Mars signe un traité avec l'Espagne; le père Joseph, l'éminence grise, l'âme damnée du Cardinal, l'apprend en remplaçant secrètement le confesseur habituel de Cinq-Mars et de Marie. Le danger est imminent; puisque Marie semble s'éloigner de lui. Cinq-Mars pense qu'il peut mourir. Gaston et les autres conspirateurs sortent du complot, en s'humiliant devant le Cardinal. Le roi lui-même, bien qu`à contre-cœur, abandonne Cinq-Mars à son sort. Richelieu triomphe; Cinq-Mars meurt avec son fidèle ami De Thou ; Marie. femme pleine d`ambition, épouse le roi de Pologne....

"Stello, les Consultations du docteur Noir" (1832)
Ouvrage en prose qui se compose presque entièrement d`études sur Chatterton, Gilbert et André Chénier, trois poètes morts jeunes et tragiquement avant d`avoir réalisé leurs espérances. Ce n'est ni un roman, ni une élégie, ni un drame, mais plutôt un "dialogue" entre l'esprit du narrateur, inclinant au rationalisme de son temps, et les facultés intuitives de son âme. Un duel entre l` "analyse", qui veut sonder tous les mystères où l'être humain est plongé, et la "synthèse" qui, à l'aide de l`intuition, arrive aux conclusions que l'analyse cherchera en vain. Le lien entre des digressions, des portraits satiriques, des scènes de tragédie, des descriptions et des discours, est réalisé par le symbole du docteur Noir guidant Stello à travers le dédale de sa pensée. Stello est l`homme romantique, un nouveau Werther, un nouveau Faust. Mais l'échafaudage des accessoires surnaturels dont l`avait entouré Goethe cède à l'absence de décor. C`est nonchalamment étendu sur un canapé que Stello poursuit sa rêverie et devise sur toutes choses. Ce type de personnage est n'est guère éloigné de certaine figuration de l'homme "moderne"...
"Pourquoi?" : tel est le développement de tout le livre. "Hélas!" : telle en est la conclusion, un cri d'interrogation anxieuse et presque satisfaite. ll y a deux révoltes en Stello : celle de la raison humaine contre les énigmes métaphysiques, et la révolte individuelle contre l'absurdité du monde social. L`idée centrale a de lointaines, mais profondes analogies avec celle du poème de "Moïse" (Poèmes antiques et modernes). Enfant perdu de l'humanité, Stello voit le thème de son désespoir illustré par les destins de ses prédécesseurs Chatterton, Chénier et Gilbert, trois figures mornes et solennelles. "L`analyse, dit le docteur Noir, est une sonde. Jetée profondément dans l'Océan - elle épouvante et désespère le faible ; mais elle rassure et conduit le fort qui la tient fermement en main". Suit le remède, l'ordonnance : séparer la vie poétique et la vie politique, pour accomplir seul et libre sa mission, sans rien attendre du monde. Stello néanmoins n'adopte pas le remède. ll se contente de relever les incompatibilités et de déclarer l'élu de la muse une victime. Il semble que Vigny, passant par le désabusement social, soit arrivé au désabusement poétique lui-même. Dégoûté des artifices de la composition, des ruses et des coquetteries du récit. Peut-être a-t-on écrit, la résonance de Stello eût-elle gagné en profondeur si, délaissant même l`élégance du langage, le poète se fût abandonné à l'expression spontanée de son désarroi : « Quel est ce Stello ? Quel est ce docteur Noir? Je ne le sais guère. Stello ne ressemble-t-il pas à quelque chose comme le “sentiment"? le docteur Noir à quelque chose comme le “`raisonnement"? Ce que je crois, c'est que, si mon cœur et ma tête avaient, entre eux. agité la même question, ils ne se seraient pas autrement parlé ..."
Alfred de Vigny - "Peu d'écrivains ont réalisé comme Alfred de Vigny l'idéal qu'on se forme du poète. De noble naissance, portant un nom mélodieux comme un frémissement de lyre, d'une beauté séraphique que même vers les derniers temps de sa vie, l'âge ni les souffrances, n'avaient pu altérer, doué d'assez de fortune pour qu'aucune nécessité vulgaire ne le forçât aux misérables besognes du jour, il garda pure, calme, poétique, sa physionomie littéraire. Il était bien le poète d'Eloa, cette vierge née d'une larme du Christ et descendant par pitié consoler Lucifer. Ce poème, le plus beau, le plus parfait peut-être de la langue française, de Vigny seul eût pu l'écrire, même parmi cette pléiade de grands poètes qui rayonnaient au ciel. Lui seul possédait ces gris nacrés, ces reflets de perle, ces transparences d'opale, ce bleu de clair de lune qui peuvent faire discerner l'immatériel sur le fond blanc de la lumière divine. Les générations présentes ont l'air d'avoir oublié Eloa. Il est rare qu'on en parle ou qu'on la cite. Ce n'en est pas moins un inestimable joyau à enchâsser dans les portes d'or du tabernacle. "Symeta", "Doldorida", "le Cor", "la Frégate la Sérieuse" montrent partout la proportion exquise de la forme avec l'idée; ce sont de précieux flacons qui contiennent dans leur cristal taillé avec un art de lapidaire des essences concentrées et dont le parfum ne s'évapore pas.
Comme tous les artistes de la nouvelle école, Alfred de Vigny écrivait aussi bien en prose qu'en vers. Il a fait "Cinq-Mars", le roman de notre littérature qui se rapproche le plus de Walter Scott; "Stéllo"; "Grandeur et Servitude militaire", où se trouve "le Cachet rouge", un chef-d'œuvre de narration, d'intérêt et de sensibilité qu'il est impossible de lire sans que les yeux se mouillent de larmes ; "Chatterton", son grand succès ; "la Maréchale d'Ancre", un drame demi-tombé; "Quitte pour la peur", un délicieux pastel, et une traduction du "Marchand de Venise" qu'on devrait bien louer comme hommage à sa mémoire, en ce temps où les chefs-d'œuvre n'encombrent pas les cartons.
Jamais le poète n'eut de défenseur plus ardent que de Vigny, et quoique Sainte-Beuve ait dit de lui en toute bienveillance et admiration du reste, en parlant des luttes de l'école romantique,
"... Et Vigny plus secret,
Comme en sa tour d'ivoire, avant midi, rentrait, "du fond de sa retraite il maintenait les droits sacrés de la pensée contre l'oppression des choses matérielles. Il réclamait à grands cris, lui qui avait l'un et l'autre, du temps et du pain pour le poète. Cette idée l'obsédait; il la développe sous toutes ses faces, dans "Stello" et dans "Chatterton", il lui donne l'éclatante consécration du théâtre. Il regarde avec raison le poète comme le paria de la civilisation moderne, qu'on repousse de son vivant et qu'on dépouille après sa mort, car lui seul ne peut léguer à sa postérité le fruit de ses œuvres.
Quand on pense à de Vigny, on se le représente involontairement comme un cygne nageant le col un peu replié en arrière, les ailes à demi gonflées par la brise, sur une de ces eaux transparentes et diamantées des parcs anglais : une "Virginia Water" égratignée d'un rayon de lune tombant à travers les chevelures glauques des saules. C'est une blancheur dans un rayon, un sillage d'argent sur un miroir limpide, un soupir parmi des fleurs d'eau et des feuillages pâles. On peut encore le comparer à une de ces nébuleuses, gouttes de lait sur le sein bleu du ciel, qui brillent moins que les autres étoiles parce qu'elles sont placées plus haut et plus loin."
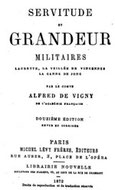
"Servitude et grandeur militaires" (1835)
".. Ce ne fut que très tard que je m’aperçus que mes services n’étaient qu’une longue méprise, et que j’avais porté dans une vie tout active une nature toute contemplative. Mais j’avais suivi la pente de cette génération de l’Empire, née avec le siècle, et de laquelle je suis. La guerre nous semblait si bien l’état naturel de notre pays, que lorsque, échappés des classes, nous nous jetâmes dans l’Armée, selon le cours accoutumé de notre torrent, nous ne pûmes croire au calme durable de la paix. Il nous parut que nous ne risquions rien en faisant semblant de nous reposer, et que l’immobilité n’était pas un mal sérieux en France. Cette impression nous dura autant qu’a duré la Restauration. Chaque année apportait l’espoir d’une guerre, et nous n’osions quitter l’épée, dans la crainte que le jour de la démission ne devînt la veille d’une campagne. Nous traînâmes et perdîmes ainsi des années précieuses, rêvant le champ de bataille dans le Champ-de-Mars, et épuisant dans des exercices de parade et dans des querelles particulières une puissante et inutile énergie.Accablé d’un ennui que je n’attendais pas dans cette vie si vivement désirée, ce fut alors pour moi une nécessité que de me dérober, dans les nuits, au tumulte fatigant et vain des journées militaires : de ces nuits, où j’agrandis en silence ce que j’avais reçu de savoir de nos études tumultueuses et publiques, sortirent mes poëmes et mes livres ; de ces journées, il me reste ces souvenirs dont je rassemble ici, autour d’une idée, les traits principaux. Car, ne comptant pour la gloire des armes ni sur le présent, ni sur l’avenir, je la cherchais dans les souvenirs de mes compagnons. Le peu qui m’est advenu ne servira que de cadre à ces tableaux de la vie militaire et des mœurs de nos armées, dont tous les traits ne sont pas connus."
Ouvrage en prose qui comprend trois nouvelles, œuvre d'un incroyant en matière politique et livre d'un poète qui exprime par des images son âme profonde. Tempérament sensitif et fermé, impropre à la vie sociale, Vigny dans cet écrit, qui passe pour l'un de ses plus grands, se retire, moins pour philosopher, que pour proclamer la seule "religion" encore possible, celle de l'honneur : "Laurette ou le Cachet rouge", "La Veillée de Vincennes" et "La Canne de jonc", chacune d`elles étant précédée et suivie de considérations sur le rôle du soldat et le caractère des armées ...
"Le Cachet rouge" retrace l`aventure d`un capitaine de frégate, grand héros de l'obéissance passive, qui, après avoir exécuté sa consigne, emploie le reste de sa vie à expier. On lui a donné, en effet, l'ordre de fusiller à bord un innocent. Cet ordre est contenu dans une lettre cachetée de rouge, dont il ignorait la teneur au départ. Il l'ouvre en pleine mer : il est obligé d'y obéir. Le condamné est un jeune poète avec lequel le capitaine, en cours de traversée, s'est lié d'une grande amitié . L`épouse du poète, Laure, qui s`était embarquée avec lui, assiste à l'exécution et en devient folle. Elle est adoptée par le marin, qui abandonne sa carrière et vagabonde sur les routes, hanté par le souvenir de la tragédie. Un récit sobre, lourd d`émotion, qui ouvre le triptyque sur un monde d`hommes frustes et rudes...
"La Veíllée de Vincennes" : un vieil adjudant, gardien du magasin à poudre du dépôt de Vincennes, commet une imprudence dans son service et est responsable d'une explosion qui lui coûte la vie. Avant la catastrophe. il s`est lié avec les deux jeunes officiers du dépôt, le narrateur lui-même et Timoléon d'Arc. ll leur a exposé l'histoire de sa carrière; Sa rencontre, étant enfant, avec la reine Marie-Antoinette qui lui avait prédit le métier des armes; puis son installation à Vincennes où il coule une vie heureuse en compagnie de sa fille... Toute mêlée de souvenirs personnels à Vigny, la nouvelle prend prétexte du drame final pour évoquer la vie de garnison et le fatalisme qui s`attache aux existences les plus humbles. Un cynisme hautain se dégage des dernières pages, où le narrateur fait un croquis de la tête du gardien, arrachée par l'explosion ..
"La Vie et la mort du capitaine Renaud ou la Canne de jonc" : ici, ce n'est plus l`histoire de deux âmes simples, mais celle d'un homme supérieur intellectuellement et de la destinée qui lui est faite. Héros obscur des guerres de Napoléon, il a, en 1814. transpercé de son épée un jeune officier russe. Las de la guerre, il quitte le service surtout "pour l'honneur". Aprés la mort de l'Empereur, le capitaine reprend du service et fait la guerre d`Espagne. Il mourra d`une bille d'agate partie du pistolet d`un gamin de treize ans, et acceptera avec sérénité cette fin sans gloire. Le récit contient des digressions remarquées, telle, sous le titre "Le Dialogue inconnu", l'entrevue de l`Empereur et du pape en 1804 à Fontainebleau. ll a, à l'instar des deux autres nouvelles, l'allure d`une page d`histoire. L'une des secrètes pensées du livre est de prononcer la condamnation de Napoléon; mais la satire n'est pas faite au bénéfice de Louis-Philippe et ne profite pas davantage aux Bourbons.
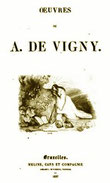
"Les Destinées"
Recueil posthume de poèmes philosophiques publié 1864. Il se compose de onze poèmes écrits entre 1839 et 1863, soit un quart de siècle, quelque deux mille alexandrins qui révèle
un aspect de ce pessimisme fondamental dont Vigny s'est fait le champion jusqu'à sa mort.
"Les Destinées"(1849) est la pièce qui ouvre le recueil du même nom, conçue d'un bout à l'autre en strophes de trois vers, elle évoquer ce rythme dont Dante use dans son "Enfer", si ce n'est que pour Vigny l'enfer n'est autre que ce monde même. "Depuis le premier jour de la création/ Les pieds lourds et puissants de chaque Destinée / Pesaient sur chaque tête et sur toute action". L'apparition du Christ a-t-elle pu faire naître chez l`être humain un immense espoir? Cet espoir-là ne fut qu'un leurre, et par la volonté du Créateur. Dieu n'a faitqu'élargir notre collier de misère. "Ô sujet d'épouvante à troubler le plus brave ! / Question sans réponse où vos saints se sont tus ! / Ô mystère! Ô tourment de l'âme forte et grave !". Ici, le philosophe semble étouffer le poète ...
Depuis le premier jour de la création,
Les pieds lourds et puissants de chaque Destinée
Pesaient sur chaque tête et sur toute action.
Chaque front se courbait et traçait sa journée,
Comme le front d’un boeuf creuse un sillon profond
Sans dépasser la pierre où sa ligne est bornée.
Ces froides déités liaient le joug de plomb
Sur le crâne et les yeux des Hommes leurs esclaves,
Tous errant, sans étoile, en un désert sans fond ;
Levant avec effort leurs pieds chargés d’entraves ;
Suivant le doigt d’airain dans le cercle fatal,
Le doigt des Volontés inflexibles et graves.
Tristes divinités du monde oriental,
Femmes au voile blanc, immuables statues,
Elles nous écrasaient de leur poids colossal.
Comme un vol de vautours sur le sol abattues,
Dans un ordre éternel, toujours en nombre égal
Aux têtes des mortels sur la terre épandues,
Elles avaient posé leur ongle sans pitié
Sur les cheveux dressés des races éperdues,
Traînant la femme en pleurs et l’homme humilié.
Un soir il arriva que l’antique planète
Secoua sa poussière. – Il se fit un grand cri :
» Le Sauveur est venu, voici le jeune athlète,
» Il a le front sanglant et le côté meurtri,
» Mais la Fatalité meurt au pied du Prophète,
» La Croix monte et s’étend sur nous comme un abri ! «
Avant l’heure où, jadis, ces choses arrivèrent,
Tout Homme allait courbé, le front pâle et flétri.
Quand ce cri fut jeté, tous ils se relevèrent.
Détachant les noeuds lourds du joug de plomb du Sort,
Toutes les Nations à la fois s’écrièrent :
» O Seigneur ! est-il vrai ? le Destin est-il mort ? «
Et l’on vit remonter vers le ciel, par volées,
Les filles du Destin, ouvrant avec effort
Leurs ongles qui pressaient nos races désolées ;
Sous leur robe aux longs plis voilant leurs pieds d’airain,
Leur main inexorable et leur face inflexible ;
Montant avec lenteur en innombrable essaim,
D’un vol inaperçu, sans ailes, insensible,
Comme apparaît au soir, vers l’horizon lointain,
D’un nuage orageux l’ascension paisible.
– Un soupir de bonheur sortit du coeur humain.
La terre frissonna dans son orbite immense,
Comme un cheval frémit délivré de son frein.
Tous les astres émus restèrent en silence,
Attendant avec l’Homme, en la même stupeur,
Le suprême décret de la Toute-Puissance,
Quand ces filles du Ciel, retournant au Seigneur,
Comme ayant retrouvé leurs régions natales,
Autour de Jéhovah se rangèrent en choeur,
D’un mouvement pareil levant leurs mains fatales,
Puis chantant d’une voix leur hymne de douleur
Et baissant à la fois leurs fronts calmes et pâles :
» Nous venons demander la Loi de l’avenir.
» Nous sommes, ô Seigneur, les froides Destinées
» Dont l’antique pouvoir ne devait point faillir.
» Nous roulions sous nos doigts les jours et les années ;
» Devons-nous vivre encore ou devons-nous finir,
» Des Puissances du ciel, nous, les fortes aînées ?
» Vous détruisez d’un coup le grand piège du Sort
» Où tombaient tour à tour les races consternées,
» Faut-il combler la fosse et briser le ressort ?
» Ne mènerons-nous plus ce troupeau faible et morne,
» Ces hommes d’un moment, ces condamnés à mort
» Jusqu’au bout du chemin dont nous posions la borne ?
(...)
"La Colère de Samson", longue suite d'alexandrins à rimes plates, aborde le mythe de l'éternel féminin, pour enseigner la défiance envers la femme traitresse, Dalila : "Une lutte éternelle, à toute heure, en tout lieu, / Se livre sur la terre en présence de Dieu, / Entre la bonté d'homme et la ruse de femme..." Par la bouche de Samson, le poète prophétise une vision particulièrement terrible ..
" .. — Donc, ce que j'ai voulu, Seigneur, n'existe pas !
Celle à qui va l'amour et de qui vient la vie,
Celle-là, par orgueil, se fait notre ennemie.
La Femme est, à présent, pire que dans ces temps
Où, voyant les humains. Dieu dit : « Je me repens ! »
Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
La Femme aura Gomorrhe et l'Homme aura Sodome ;
Et, se jetant, de loin, un regard irrité.
Les deux sexes mourront chacun de son côté.
« Eternel ! Dieu des forts ! vous savez que mon âme
N'avait pour aliment que l'amour d'une femme,
Puisant dans l'amour seul plus de sainte vigueur
Que mes cheveux divins n'en donnaient à mon cœur.
— Jugez-nous. — La voilà sur mes pieds endormie.
Trois fois elle a vendu mes secrets et ma vie,
Et trois fois a versé des pleurs fallacieux
Qui n'ont pu me cacher la rage de ses yeux.
Honteuse qu'elle était plus encor qu'étonnée,
De se voir découverte ensemble et pardonnée ;
Car la bonté de l'Homme est forte et sa douceur
Ecrase, en l'absolvant, l'être faible et menteur.
Moment de terrible égarement. Devant cette Dalila qu'il aimait naguère plus que tout au monde, Samson, le juste, se sent triste à mourir : "Toujours voir serpenter la vipère dorée / Qui se traîne en sa fange et s'y croit ignorée". Un réquisitoire que l'on peut discuter et que couronne le vers fameux : "La Femme, enfant malade et douze fois impur". Samson, soûl de colère, se vengera, secouant les colonnes du temple, il écrasera d'un seul coup ses ennemis, leurs dieux et leurs autels. Et ce qui fait le succès, discuté, de ce poème, c'est que l'invective, discutable, l'emporte sur l'argument philosophique...
La résignation stoïque - "La Mort du loup" (1843). Ce poème est célèbre, une leçon de stoïcisme, le loup sait mourir en silence : de même que le loup traqué par les chasseurs meurt "sans jeter un cri", le sage ne doit pas capituler bassement devant l'épreuve. Silence stoïque, mais aussi nécessité du devoir social. "Gémir, pleurer, prier est également lâche. / Fais énergiquement ta longue et lourde tâche / Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, / Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler."
I - Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le bois, ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les airs ; Seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent élevé bien au dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en-bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; Bientôt,
Lui que jamais ici on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçait la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ;
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II - J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
– Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au coeur !
Il disait : » Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
L'indifférence de la nature - C'est à Chateaubriand que Vigny doit l'idée première de "La Maison du Berger", publié pour la première fois en 1844, un long poème en strophes de sept vers qui nous montre que l'homme peut trouver quelque remède à ses maux dans l'amour de la créature, un amour fondé tout entier sur la tendresse et la mutuelle compassion, " Sur mon cœur déchiré, viens poser ta main pure, / Ne me laisse jamais seul avec la Nature / Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur", ...
Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie,
Se traîne et se débat comme un aigle blessé,
Portant comme le mien, sur son aile asservie,
Tout un monde fatal, écrasant et glacé ;
S’il ne bat qu’en saignant par sa plaie immortelle,
S’il ne voit plus l’amour, son étoile fidèle,
Éclairer pour lui seul l’horizon effacé ;
Si ton âme enchaînée, ainsi que l’est mon âme,
Lasse de son boulet et de son pain amer,
Sur sa galère en deuil laisse tomber la rame,
Penche sa tête pâle et pleure sur la mer,
Et cherchant dans les flots une route inconnue,
Y voit, en frissonnant, sur son épaule nue,
La lettre sociale écrite avec le fer ;
Si ton corps, frémissant des passions secrètes,
S’indigne des regards, timide et palpitant ;
S’il cherche à sa beauté de profondes retraites
Pour la mieux dérober au profane insultant ;
Si ta lèvre se sèche au poison des mensonges,
Si ton beau front rougit de passer dans les songes
D’un impur inconnu qui te voit et t’entend,
Pars courageusement, laisse toutes les villes ;
Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin,
Du haut de nos pensers vois les cités serviles
Comme les rocs fatals de l’esclavage humain.
Les grands bois et les champs sont de vastes asiles,
Libres comme la mer autour des sombres îles.
Marche à travers les champs une fleur à la main.
La Nature t’attend dans un silence austère ;
L’herbe élève à tes pieds son nuage des soirs,
Et le soupir d’adieu, du soleil à la terre,
Balance les beaux lys comme des encensoirs.
La forêt a voilé ses colonnes profondes,
La montagne se cache, et sur les pâles ondes
Le saule a suspendu ses chastes reposoirs.
Le crépuscule ami s’endort dans la vallée,
Sur l’herbe d’émeraude et sur l’or du gazon,
Sous les timides joncs de la source isolée
Et sous le bois rêveur qui tremble à l’horizon,
Se balance en fuyant, dans les grappes sauvages,
Jette son manteau gris sur le bord des rivages,
Et des fleurs de la nuit entr’ouvre la prison.
Il est sur ma montagne une épaisse bruyère
Où les pas du chasseur ont peine à se plonger,
Qui plus haut que nos fronts lève sa tête altière,
Et garde dans la nuit le pâtre et l’étranger.
Viens-y cacher l’amour et ta divine faute ;
Si l’herbe est agitée ou n’est pas assez haute,
J’y roulerai pour toi la Maison du Berger.
Elle va doucement avec ses quatre roues,
Son toit n’est pas plus haut que ton front et tes yeux ;
La couleur du corail et celle de tes joues
Teignent le char nocturne et ses muets essieux.
Le seuil, est parfumé, l’alcôve est large et sombre,
Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l’ombre,
Pour nos cheveux unis, un lit silencieux.
(...)
... Eva, la femme aimée qu'il invite à vivre avec lui loin du monde dans la maison du berger", une image de la femme qui s'oppose en tout point à celle qu'il avait dressée dans "La Colère de Samson", "Pleurant, comme Diane au bord de ses fontaines / Ton amour taciturne et toujours menacé." ...
... Éva, qui donc es-tu ? Sais-tu bien ta nature ?
Sais-tu quel est ici ton but et ton devoir ?
Sais-tu que pour punir l’homme, sa créature,
D’avoir porté la main sur l’arbre du savoir,
Dieu permit qu’avant tout, de l’amour de soi-même
En tout temps, à tout âge, il fît son bien suprême,
Tourmenté de s’aimer, tourmenté de se voir.
Mais si Dieu près de lui t’a voulu mettre, ô femme !
Compagne délicate ! Éva ! sais-tu pourquoi ?
C’est pour qu’il se regarde au miroir d’une autre âme,
Qu’il entende ce chant qui ne vient que de toi :
— L’enthousiasme pur dans une voix suave.
C’est afin que tu sois son juge et son esclave
Et règnes sur sa vie en vivant sous sa loi.
Ta parole joyeuse a des mots despotiques,
Tes yeux sont si puissants, ton aspect est si fort,
Que les rois d’Orient ont dit dans leurs cantiques
Ton regard redoutable à l’égal de la mort ;
Chacun cherche à fléchir tes jugements rapides…
— Mais ton cœur, qui dément tes formes intrépides,
Cède sans coup férir aux rudesses du sort.
Ta pensée a des bonds comme ceux des gazelles,
Mais ne saurait marcher sans guide et sans appui.
Le sol meurtrit ses pieds, l’air fatigue ses ailes,
Son œil se ferme au jour dès que le jour a lui ;
Parfois, sur les hauts lieux d’un seul élan posée,
Troublée au bruit des vents, ta mobile pensée
Ne peut seule y veiller sans crainte et sans ennui.
Mais aussi tu n’as rien de nos lâches prudences,
Ton cœur vibre et résonne au cri de l’opprimé,
Comme dans une église aux austères silences
L’orgue entend un soupir et soupire alarmé.
Tes paroles de feu meuvent les multitudes,
Tes pleurs lavent l’injure et les ingratitudes,
Tu pousses par le bras l’homme… il se lève armé.
C’est à toi qu’il convient d’ouïr les grandes plaintes
Que l’humanité triste exhale sourdement.
Quand le cœur est gonflé d’indignations saintes,
L’air des cités l’étouffe à chaque battement.
Mais de loin les soupirs des tourmentes civiles,
S’unissant au-dessus du charbon noir des villes,
Ne forment qu’un grand mot qu’on entend clairement
Viens donc, le ciel pour moi n’est plus qu’une auréole.
Qui t’entoure d’azur, t’éclaire et te défend ;
La montagne est ton temple et le bois sa coupole,
L’oiseau n’est sur la fleur balancé par le vent,
Et la fleur ne parfume et l’oiseau ne soupire
Que pour mieux enchanter l’air que ton sein respire ;
La terre est le tapis de tes beaux pieds d’enfant.
Eva, j’aimerai tout dans les choses créées,
Je les contemplerai dans ton regard rêveur
Qui partout répandra ses flammes colorées,
Son repos gracieux, sa magique saveur :
Sur mon cœur déchiré viens poser ta main pure,
Ne me laisse jamais seul avec la Nature ;
Car je la connais trop pour n’en pas avoir peur.
Elle me dit : « Je suis l’impassible théâtre
Que ne peut remuer le pied de ses acteurs ;
Mes marches d’émeraude et mes parvis d’albâtre,
Mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs.
Je n’entends ni vos cris ni vos soupirs ; à peine
Je sens passer sur moi la comédie humaine
Qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs.
« Je roule avec dédain sans voir et sans entendre,
À côté des fourmis les populations ;
Je ne distingue pas leur terrier de leur cendre,
J’ignore en les portant les noms des nations.
On me dit une mère et je suis une tombe.
Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe,
Mon printemps ne sent pas vos adorations. ....
La croyance au progrès - "La Bouteille à la mer" (1853) met en symbole la misère humaine: le monde de Vigny est un monde sans Dieu, qui n'exclure pas tout sentiment de fraternité, bien au contraire. Jetons l'oeuvre à la mer, la mer des multitudes: / - Dieu la prendra du doigt pour la conduire au port" - Vigny éprouve une réelle pitié pour ses compagnons d'infortune, il est toujours possible de travailler au progrès de l'humanité future, sans se soucier du résultat immédiat. Voyant que son navire est sur le point de couler, un capitaine refuse d'accepter la mort avant d'avoir légué aux hommes de l'avenir le fruit de son ultime expérience, au mépris de la tempête, consigne maintes observations et dresse le plan de son propre naufrage qu'il glisse dans une bouteille : "Il sourit en songeant que ce fragile verre / Portera sa pensée et son nom jusqu'au port ; / Que d'une île inconnue il agrandit la terre ; / Qu'il marque un nouvel astre et le confie au sort; / Que Dieu peut bien permettre à des eaux insensées / De perdre des vaisseaux, mais non point des pensées / Et qu'avec ce flacon, il a vaincu la mort".
"La Flûte" (non datée) met en scène un joueur de flûte réduit par la malchance à mendier son pain, et qui se croit le dernier des hommes. Mais "c''est assez de souffrir sans se juger coupable", pense Vigny qui entend lui montrer que, le plus souvent, notre échec relève moins de l'esprit que de la matière : "Du corps et non de l'âme accusons l'indigence. / Des organes mauvais servent l'intelligence...".
"La Sauvage" (1843) voit, quelque part, dans les solitudes du Nouveau Monde, une jeune Indienne, fuyant les horreurs de la guerre, demander asile à quelque sujet britannique, riche et puritain, tandis que "Wanda" (1847) évoque la Russie telle qu'on la pouvait voir quelques années avant la prise de Sébastopol avec un tsar dont l'énorme puissance se fonde uniquement sur l'esclavage. Rien ni personne n'est capable d'émouvoir ce cœur de pierre, à l'image du Dieu de Vigny. "Les Oracles" (1862), qui invective la démocratie, est jugé le moins réussi de ses poèmes.
"Le Mont des Oliviers" (1839-1851) relève d'un pessimisme absolu. Tandis que ses apôtres dorment à poings fermés, Jésus confie à Dieu, son père, l'angoisse dont son âme est rongée. Se sentant plus pauvre que jamais, il l'adjure de venir à son aide. En vain! Dieu élude toute réponse. On ne saurait vraiment être plus seul au monde. Un morceau de bravoure qui s'achève par ces simples mots : "Dans le bois, il entendit des pas / Et puis il vit rôder la torche de Judas".
I - Alors il était nuit et Jésus marchait seul,
Vêtu de blanc ainsi qu’un mort de son linceul ;
Les disciples dormaient au pied de la colline.
Parmi les oliviers qu’un vent sinistre incline
Jésus marche à grands pas en frissonnant comme eux ;
Triste jusqu’à la mort; l’oeil sombre et ténébreux,
Le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe
Comme un voleur de nuit cachant ce qu’il dérobe ;
Connaissant les rochers mieux qu’un sentier uni,
Il s’arrête en un lieu nommé Gethsémani :
Il se courbe, à genoux, le front contre la terre,
Puis regarde le ciel en appelant : Mon Père !
– Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas.
Il se lève étonné, marche encore à grands pas,
Froissant les oliviers qui tremblent. Froide et lente
Découle de sa tête une sueur sanglante.
Il recule, il descend, il crie avec effroi :
Ne pouviez-vous prier et veiller avec moi !
Mais un sommeil de mort accable les apôtres,
Pierre à la voix du maître est sourd comme les autres.
Le fils de l’homme alors remonte lentement.
Comme un pasteur d’Egypte il cherche au firmament
Si l’Ange ne luit pas au fond de quelque étoile.
Mais un nuage en deuil s’étend comme le voile
D’une veuve et ses plis entourent le désert.
Jésus, se rappelant ce qu’il avait souffert
Depuis trente-trois ans, devint homme, et la crainte
Serra son coeur mortel d’une invincible étreinte.
Il eut froid. Vainement il appela trois fois :
MON PÈRE ! – Le vent seul répondit à sa voix..
Il tomba sur le sable assis et, dans sa peine,
Eut sur le monde et l’homme une pensée humaine.
– Et la Terre trembla, sentant la pesanteur
Du Sauveur qui tombait aux pieds du créateur.
II - Jésus disait : » Ô Père, encor laisse-moi vivre !
Avant le dernier mot ne ferme pas mon livre !
Ne sens-tu pas le monde et tout le genre humain
Qui souffre avec ma chair et frémit dans ta main ?
C’est que la Terre a peur de rester seule et veuve,
Quand meurt celui qui dit une parole neuve ;
Et que tu n’as laissé dans son sein desséché
Tomber qu’un mot du ciel par ma bouche épanché.
Mais ce mot est si pur, et sa douceur est telle,
Qu’il a comme enivré la famille mortelle
D’une goutte de vie et de Divinité,
Lorsqu’en ouvrant les bras j’ai dit : FRATERNITE !
– Père, oh ! si j’ai rempli mon douloureux message,
Si j’ai caché le Dieu sous la face du Sage,
Du Sacrifice humain si j’ai changé le prix,
Pour l’offrande des corps recevant les esprits,
Substituant partout aux choses le Symbole,
La parole au combat, comme au trésor l’obole,
Aux flots rouges du Sang les flots vermeils du vin,
Aux membres de la chair le pain blanc sans levain ;
Si j’ai coupé les temps en deux parts, l’une esclave
Et l’autre libre ; – au nom du Passé que je lave
Par le sang de mon corps qui souffre et va finir :
Versons-en la moitié pour laver l’avenir !
Père Libérateur ! jette aujourd’hui, d’avance,
La moitié de ce Sang d’amour et d’innocence
Sur la tête de ceux qui viendront en disant :
« Il est permis pour tous de tuer l’innocent. »
Nous savons qu’il naîtra, dans le lointain des âges,
Des dominateurs durs escortés de faux Sages
Qui troubleront l’esprit de chaque nation
En donnant un faux sens à ma rédemption. –
Hélas ! je parle encor que déjà ma parole
Est tournée en poison dans chaque parabole ;
Eloigne ce calice impur et plus amer
Que le fiel, ou l’absinthe, ou les eaux de la mer.
(....)
(...)
Mal et Doute ! En un mot je puis les mettre en poudre ;
Vous les aviez prévus, laissez-moi vous absoudre
De les avoir permis. – C’est l’accusation
Qui pèse de partout sur la Création !
– Sur son tombeau désert faisons monter Lazare.
Du grand secret des morts qu’il ne soit plus avare
Et de ce qu’il a vu donnons-lui souvenir,
Qu’il parle. – Ce qui dure et ce qui doit finir ;
Ce qu’a mis le Seigneur au coeur de la Nature,
Ce qu’elle prend et donne à toute créature ;
Quels sont, avec le Ciel, ses muets entretiens,
Son amour ineffable et ses chastes liens ;
Comment tout s’y détruit et tout s’y renouvelle
Pourquoi ce qui s’y cache et ce qui s’y révèle ;
Si les astres des cieux tour à tour éprouvés
Sont comme celui-ci coupables et sauvés ;
Si la Terre est pour eux ou s’ils sont pour la Terre ;
Ce qu’a de vrai la fable et de clair le mystère,
D’ignorant le savoir et de faux la raison ;
Pourquoi l’âme est liée en sa faible prison ;
Et pourquoi nul sentier entre deux larges voies,
Entre l’ennui du calme et des paisibles joies
Et la rage sans fin des vagues passions,
Entre la Léthargie et les Convulsions ;
Et pourquoi pend la Mort comme une sombre épée
Attristant la Nature à tout moment frappée ;
– Si le Juste et le Bien, si l’Injuste et le Mal
Sont de vils accidents en un cercle fatal
Ou si de l’univers ils sont les deux grands pôles,
Soutenant Terre et Cieux sur leurs vastes épaules ;
Et pourquoi les Esprits du Mal sont triomphants
Des maux immérités, de la mort des enfants ;
– Et si les Nations sont des femmes guidées
Par les étoiles d’or des divines idées
Ou de folles enfants sans lampes dans la nuit,
Se heurtant et pleurant et que rien ne conduit ;
– Et si, lorsque des temps l’horloge périssable
Aura jusqu’au dernier versé ses grains de sable,
Un regard de vos yeux, un cri de votre voix,
Un soupir de mon coeur, un signe de ma croix,
Pourra faire ouvrir l’ongle aux Peines Eternelles,
Lâcher leur proie humaine et reployer leurs ailes ;
– Tout sera révélé dés que l’homme saura
De quels lieux il arrive et dans quels il ira. »
III - Ainsi le divin fils parlait au divin Père.
Il se prosterne encore, il attend, il espère,
Mais il renonce et dit : Que votre Volonté
Soit faite et non la mienne et pour l’Eternité.
Une terreur profonde, une angoisse infinie
Redoublent sa torture et sa lente agonie.
Il regarde longtemps, longtemps cherche sans voir.
Comme un marbre de deuil tout le ciel était noir.
La Terre sans clartés, sans astre et sans aurore,
Et sans clartés de l’âme ainsi qu’elle est encore,
Frémissait. – Dans le bois il entendit des pas,
Et puis il vit rôder la torche de Judas.
Le silence
S’il est vrai qu’au Jardin sacré des Ecritures,
Le Fils de l’Homme ait dit ce qu’on voit rapporté ;
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l’absence
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.
Dans "L'Esprit pur" (1863, Vigny chante le métier d'écrivain, ses ancêtres furent tous gens pleins de bravoure, chasseurs, guerriers, mais tous n'ont rien laissé de leurs exploits, en soi l'action n'est rien, seul l'esprit la sublime ...
"Journal d'un poète"
"Dès que tu es seul, descends au fond de ton âme, et tu trouveras en bas, assise sur la dernière marche, la Gravité qui t'attendait " - "Journal d'un poète", c'est le titre donné aux notes de l'écrivain Alfred de Vigny par Louis Ratisbonne, son exécuteur testamentaire, qui le publia, incomplet, en 1867 : par la suite, d'autres fragments furent ajoutés. Ce sont des confessions, des réflexions critiques et littéraires, des projets de poèmes et des souvenirs divers. Vigny, malgré sa réserve habituelle, nous livre ici le plus intime de lui-même : ses souffrances, ses doutes, ses angoisses (sans apporter d'ailleurs de révélations quant à sa vie privée). Il s`explique lui-même et il commente son œuvre. Il expose, en particulier, comment il conçoit un livre : "Je ne fais pas un livre, il se fait. Il mûrit et croît dans ma tête comme un fruit". On voit, dans ces pages, à combien d'œuvres il a travaillé sans les achever, combien sont restées à l'état de projet, combien enfin ont été détruites. Profondément sincère, et scrupuleux à l'extrême, ce dont il se préoccupe avant tout, c'est l'idée : "Auprès de la Psyché, que sont alors les amantes de chair ? ", "Le malheur des écrivains, note-t-il, c'est qu'ils s'embarrassent peu de dire le vrai, pourvu qu`ils disent... ll est temps de ne chercher les paroles que dans sa conscience"...
On a pu rapprocher le "Journal d'un poète" du "Zibaldone" (1817-1832) du poète italien (si ce n'est la taille de l'oeuvre) Giacomo Léopardi, en raison de l'affinité qui existe entre ces deux esprits. Tous deux, ils voient l'homme prisonnier en ce monde et ils ignorent la raison de sa condamnation et le destin qui fera suite à sa libération; tous deux ils concilient une stoïque et très consciente résignation, à un sentiment de profonde solidarité avec l`humanité, seule consolation de la vie humaine que la nature, dans son orgueilleuse beauté, entendit méconnaître depuis toujours.
Chez Vigny, cependant, on trouve une plus grande intransigeance encore et ce raidissement un peu forgée, qui est le propre de l'aristocrate et du soldat. S'y ajoutent les amères déceptions qui l`amenèrent à écrire "Servitude et grandeur militaires". C`est en 1832 que Vigny atteint le fond même de son pessimisme. Le "Journal" abonde alors en passages désespérés : la vie est une prison où "un geôlier adorable" nous punit "on ne sait de quoi" ; il y déclare "et salutaire" de n'avoir aucune espérance, qu'elle est "la plus grande de nos folies" ; enfin, il voudrait, pour le rendre moins misérable, "anéantir l'espérance dans le cœur de l`homme". En 1834, il ajoute : "La terre est révoltée des injustices de la création" et "la vérité sur la vie, c'est le désespoir". Vigny fut cependant toujours sauvé, au moment de se perdre, par son sentiment religieux de l'honneur, qu'il appelle la "poésie du devoir". S'il n'est jamais parvenu à l`idéal démocratique qui a guidé d'autres romantiques en leur donnant des raisons de vivre, il s'est guéri à la longue de son étroit légitimisme et de ses préjugés aristocratiques. Quant au grand drame de sa vie, qui demeurera toujours le malheur essentiel qu'implique pour tout poète l'obligation de vivre parmi les hommes (cf. Stello), il a pour contrepartie la joie qu'il a pu tirer de la poésie même, la passion de la pensée, voire les quelques encouragements qui ne manquent jamais à l`artiste le plus solitaire...
