- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Victor Hugo (1802-1885) - - Odes & Ballades (1822) - "Hernani" (1830) - "Notre-Dame de Paris" (1831) - "Les Rayons et les ombres" (1840) - ......
Last update : 09/09/2018

Pour Victor Hugo, la sonorité des mots recèle une extraordinaire puissance évocatrice et la poésie un formidable moyen de connaissance : la poésie possède en effet cette capacité de rendre réelle, tangible tant par sa forme, que par les évocations qu'elle fait surgir ou par le souffle épique qui l'anime, une nouvelle vision de l'existence, volontariste, passionnée,parfois démesurée, à l'image de la personnalité puissante d'un homme qui incarne totalement son siècle, qui se pensait "prophète", assumait avec orgueil ses "révélations" et sa vision d'un monde manichéen par essence. Romantique et classique, bien et mal, visible et invisible, Victor Hugo mélange les genres et les orchestre dans un rythme puissant mis au service de "grands sentiments", édulcorés pour certains, ampoulés pour d'autres, et d'une profonde croyance dans l'unicité du monde. Sa faculté première? L'imagination, imagination des yeux, disait Taine, plutôt qu'imagination du cœur comme celle de Michelet, sensations, surtout visuelles, extrêmement vives, don de voir, ajoutera-t-on, ce qu'il imaginait avec autant d'intensité que les objets réels, tel est sans doute le secret de Hugo poète épique : "le domaine de la poésie est illimité, écrira-t-il en 1822. Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux que des méditations graves ont accoutumés à voir dans les choses plus que les choses... La poésie n'est pas dans la forme des idées mais dans les idées elles-mêmes. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout". En 1824, Hugo définit sa vocation à venir de poète, une sentinelle laissée "par le Seigneur sur les tours de Jérusalem et qui ne se tairont ni jour ni nuit", une sentinelle qui "doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin... Il faut que toutes les fibres du cœur humain vibrent sous ses doigts comme les cordes d'une lyre. Il ne sera jamais l'écho d'aucune parole, si ce n'est de celle de Dieu..."

Victor Hugo (1802-1885)
(photographie de Félix Tournachon dit Nadar en 1874-1876)
Victor Hugo (1802-1885)
La première de ses Feuilles d'automne a rendu célèbre la date de sa naissance : 1802. C'est le 26 février de cette année-là que Victor Hugo naquit, à Besançon, d'un «père lorrain», le chef de bataillon et futur général Hugo, et d'une «mère vendéenne», Sophie Trébuchet, fille d'un armateur de Nantes. Ses parents, mariés en 1796, avaient eu avant lui deux fils : Abel en 1798, Eugène en 1800. Il a souvent parlé de ces deux frères, dont l'aîné fonda avec lui, en 1819, une revue bimensuelle, le Conservateur littéraire. Le second, qui avait donné des espérances comme poète, devint fou en 1822, et mourut en 1837. Abel mourut, lui, en 1855, laissant des ouvrages de littérature et d'histoire dont les titres mêmes sont oubliés depuis longtemps.
Presque autant que la date de sa naissance, Victor Hugo a rendu célèbre son enfance; cette «belle enfance de fils de soldat» (J.-J. Weiss), «la plus heureuse qu'on puisse rêver, la plus féconde pour un poète», puisqu'elle l'a «promené» jusqu'à sa dixième année «à travers la France, l'Italie et l'Espagne, parmi les gestes grandioses de l'épopée impériale». Et J.-J. Weiss oublie les deux séjours de l'enfant avec sa mère, à Paris, dans cet ancien couvent des Feuillantines dont le grand jardin à demi sauvage a inspiré de si beaux vers à l'auteur des Rayons et les Ombres. Le premier séjour (1808-1811) suivit les pérégrinations de la famille en Italie, le second (1812-1813) le voyage en Espagne...
En 1815 Victor Hugo est mis, avec son frère Eugène, à la pension Cordier, afin de se préparer à l'École polytechnique; mais, bien qu'il ne manquât pas d'aptitudes pour les sciences, il se passionne pour les lettres ; et, en 1818, il quitte la pension avec un véritable bagage littéraire : odes, satires, épîtres, élégies, idylles et pièces de théâtre. Du reste il avait déjà obtenu une mention de l'Académie pour une pièce de vers sur les Avantages de l'étude (1817). En 1819, deux odes ardemment royalistes lui valent, chacune, un prix aux Jeux floraux (Toulouse); et, en 1820, il est élu «maître es jeux floraux» à cause de son Moïse sur le Nil. En même temps, et jusqu'en mars 1821,mois où le Conservateur littéraire disparut, il publie dans cette revue non seulement des vers et un conte, Bug-Jargal, dont il fit, un peu plus tard, un roman, mais sous son nom et sous divers pseudonymes, de nombreux articles...

1802 - "Ce siècle avait deux ans..."
Phrase célèbre. Victor Hugo naquit à Besançon, où son père était officier d'infanterie, puis gagne Paris avec sa mère et ses frères de 1809 à 1813 ("J'eus dans ma blonde enfance, hélas ! trop éphémère, Trois maîtres : un jardin, un vieux prêtre et ma mère"), séjour interrompu par un voyage marquant d'un an en Espagne (1811-1812). Il est le troisième enfant d'un couple qui ne tarde pas à se séparer, il devient interne à la pension Cordier, suit les cours du lycée Louis-le-Grand (1815-1818), obtient des succès scolaires et compose ses premiers poèmes. Dès ce moment son ambition est immense, on cite souvent cette phrase écrite en 1816, "Je veux être Chateaubriand ou rien"...
Ecrite le 23 juin 1830, cette pièce célèbre ouvre le recueil des Feuilles d'automne (1831), précédée de l'épigraphe Data fata secutus, qui est la fin d'un vers de Virgile (Enéide) et par laquelle le poète entend exprimer qu'il a suivi son destin...
Data fata secutus. (Les Feuilles d’automne).
"Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte,
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,
Et du premier consul, déjà, par maint endroit,
Le front de l'empereur brisait le masque étroit.
Alors dans Besançon, vieille ville espagnole,
Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois
Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix;
Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère,
Abandonné de tous, excepté de sa mère,
Et que son cou ployé comme un frêle roseau
Fit faire en même temps sa bière et son berceau.
Cet enfant que la vie effaçait de son livre,
Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,
C'est moi.
Je vous dirai peut-être quelque jour
Quel lait pur, que de soins, que de voeux, que d'amour,
Prodigués pour ma vie en naissant condamnée,
M'ont fait deux fois l'enfant de ma mère obstinée,
Ange qui sur trois fils attachés à ses pas
Épandait son amour et ne mesurait pas!
Ô l'amour d'une mère! amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie!
Table toujours servie au paternel foyer!
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier!
Je pourrai dire un jour, lorsque la nuit douteuse
Fera parler les soirs ma vieillesse conteuse,
Comment ce haut destin de gloire et de terreur
Qui remuait le monde aux pas de l'empereur,
Dans son souffle orageux m'emportant sans défense
À tous les vents de l'air fit flotter mon enfance.
Car, lorsque l'aquilon bat ses flots palpitants,
L'océan convulsif tourmente en même temps
Le navire à trois ponts qui tonne avec l'orage,
Et la feuille échappée aux arbres du rivage!
Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé,
J'ai plus d'un souvenir profondément gravé,
Et l'on peut distinguer bien des choses passées
Dans ces plis de mon front que creusent mes pensées.
Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux,
Tombé de lassitude au bout de tous ses voeux,
Pâlirait s'il voyait, comme un gouffre dans l'onde,
Mon âme où ma pensée habite, comme un monde,
Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté,
Tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté,
Mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse,
Les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse,
Et quoi qu'encore à l'âge où l'avenir sourit,
Le livre de mon coeur à toute page écrit!
Si parfois de mon sein s'envolent mes pensées,
Mes chansons par le monde en lambeaux dispersées;
S'il me plaît de cacher l'amour et la douleur
Dans le coin d'un roman ironique et railleur;
Si j'ébranle la scène avec ma fantaisie,
Si j'entrechoque aux yeux d'une foule choisie
D'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois
De mon souffle et parlant au peuple avec ma voix;
Si ma tête, fournaise où mon esprit s'allume,
Jette le vers d'airain qui bouillonne et qui fume
Dans le rythme profond, moule mystérieux
D'où sort la strophe ouvrant ses ailes dans les cieux;
C'est que l'amour, la tombe, et la gloire, et la vie,
L'onde qui fuit, par l'onde incessamment suivie,
Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal,
Fait reluire et vibrer mon âme de cristal,
Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore
Mit au centre de tout comme un écho sonore!
D'ailleurs j'ai purement passé les jours mauvais,
Et je sais d'où je viens, si j'ignore où je vais.
L'orage des partis avec son vent de flamme
Sans en altérer l'onde a remué mon âme.
Rien d'immonde en mon coeur, pas de limon impur
Qui n'attendît qu'un vent pour en troubler l'azur!
Après avoir chanté, j'écoute et je contemple,
À l'empereur tombé dressant dans l'ombre un temple,
Aimant la liberté pour ses fruits, pour ses fleurs,
Le trône pour son droit, le roi pour ses malheurs;
Fidèle enfin au sang qu'ont versé dans ma veine
Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne!"

1822 - les "Odes et ballades"
Victor Hugo, catholique et monarchiste à 20 ans, tente d'obtenir l'appui de Chateaubriand, son "Ode sur la Mort du duc de Berry" constitue une première étape dans son ascension littéraire, et, alors qu'il épouse Adèle Foucher - qui lui donnera quatre enfants, Léopoldine (1824), Charles (1826), François (1828), Adèle (1830) -, paraît en 1822 son premier recueil de poèmes, les "Odes", qui deviendront en 1826 les "Odes et ballades" (édition définitive, 1828). Hugo débute également une carrière de romancier, avec "Han d'lslande" (1823), dont les critiques l'agacent quelque peu, et "Bug-Jargal" (1826, bref récit militaire et colonial de la révolte des Noirs à Saint-Domingue en 1791), collabore à la Muse française, fondée en 1823, et fréquente le salon de Charles Nodier à l'Arsenal, où il rencontre Alfred de Vigny et Lamartine. En 1823, Louis XVIII lui accorde une nouvelle pension, de 2.000 francs, et en 1825, Charles X le nomme chevalier de la Légion d'honneur, en même temps que Lamartine....
Les "Odes et Ballades" (1828), regroupe des pièces intimes et poèmes officiels datant de 1822 d'inspiration catholique et légitimiste, dans lesquels la critique discerne l'influence de Chateaubriand et de Lamartine. Dans sa Préface des Odes de 1824, Hugo se déclare par suite ni classique ni romantique. Les Ballades qu'il joint aux Odes en 1826 nous montrent l'extrême virtuosité rythmique dont "Le Pas d'armes du roi Jean", composé tout entier en vers de trois syllabes, est le plus connu...
LE PAS D’ARMES DU ROI JEAN
Çà, qu’on selle,
Écuyer,
Mon fidèle
Destrier.
Mon cœur ploie
Sous la joie,
Quand je broie
L’étrier.
Par saint-Gille,
Viens-nous-en,
Mon agile
Alezan ;
Viens, écoute,
Par la route,
Voir la joute
Du roi Jean.
Qu’un gros carme
Chartrier
Ait pour arme
L’encrier ;
Qu’une fille,
Sous la grille,
S’égosille
À prier ;
Nous qui sommes,
De par Dieu,
Gentilshommes
De haut lieu,
Il faut faire
Bruit sur terre,
Et la guerre
N’est qu’un jeu.
Ma vieille âme
Enrageait ;
Car ma lame,
Que rongeait
Cette rouille
Qui la souille,
En quenouille
Se changeait.
Cette ville,
Aux longs cris,
Qui profile
Son front gris,
Des toits frêles,
Cent tourelles,
Clochers grêles,
C’est Paris !
Octobre 1825, "La Ronde du Sabbat", dédié à Charles Nodier, ami du poète et auteur de Smarra ou les démons de la nuit (1821), rendue célèbre par une lithographie diabolique de Louis Boulanger, publiée en 1828, nous sommes en plein romantisme, Eugène Delacroix (1798-1863), Achille Devéria (1800-1857), Célestin Nanteuil (1813-1873), Louis Boulanger (1806-1867), Tony Johannot (1803-1852) dessinent et gravent nombre de frontispices et d'illustrations qui les immortalisent et rivalisent dans le fantastique, "Sorti des tombeaux / Que dans chaque stalle / Un faux moine étale / La robe fatale / Qui brûle ses os,/ Et qu’un noir lévite / Attache bien vite / La flamme maudite / Aux sacrés flambeaux ! .."

La Ronde du Sabbat
Voyez devant les murs de ce noir monastère
La lune se voiler, comme pour un mystère !
L’esprit de minuit passe, et, répandant l’effroi,
Douze fois se balance au battant du beffroi.
Le bruit ébranle l’air, roule, et longtemps encore
Gronde, comme enfermé sous la cloche sonore.
Le silence retombe avec l’ombre… Écoutez !
Qui pousse ces clameurs ? qui jette ces clartés ?
Dieu ! les voûtes, les tours, les portes découpées,
D’un long réseau de feu semblent enveloppées.
Et l’on entend l’eau sainte, où trempe un buis bénit,
Bouillonner à grands flots dans l’urne de granit !
À nos patrons du ciel recommandons nos âmes !
Parmi les rayons bleus, parmi les rouges flammes,
Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois,
Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois,
Les larves, les dragons, les vampires, les gnômes,
Des monstres dont l’enfer rêve seul les fantômes,
La sorcière, échappée aux sépulcres déserts,
Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs,
Les nécromants, parés de tiares mystiques
Où brillent flamboyants les mots cabalistiques,
Et les graves démons, et les lutins rusés,
Tous, par les toits rompus, par les portails brisés,
Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent,
Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent.
Debout au milieu d’eux, leur prince Lucifer
Cache un front de taureau sous la mître de fer ;
La chasuble a voilé son aile diaphane,
Et sur l’autel croulant il pose un pied profane.
Ô terreur ! Les voilà qui chantent dans ce lieu
Où veille incessamment l’œil éternel de Dieu.
Les mains cherchent les mains… Soudain la ronde immense,
Comme un ouragan sombre, en tournoyant commence.
À l’œil qui n’en pourrait embrasser le contour,
Chaque hideux convive apparaît à son tour ;
On croirait voir l’enter tourner dans les ténèbres
Son zodiaque affreux, plein de signes funèbres.
Tous volent, dans le cercle emportes à la fois.
Satan règle du pied les éclats de leur voix ;
Et leurs pas, ébranlant les arches colossales,
Troublent les morts couchés sous le pavé des salles.
....
1824, Nouvelles Odes, Mon Enfance ..
Dans les vingt-huit pièces qui qui composent les Nouvelles Odes, Victor Hugo s'inspire surtout de l'histoire, antiquité et moyen âge, ou des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse : "Mon Enfance" est une de ces pièces où le jeune poète revoit ses premières années entraînées par l'écho de l'épopée impériale. Les deux épisodes principaux de cette enfance errante et guerrière sont le séjour en Italie (1807-1808) où le père du poète, colonel du Royal Corse, avait été nommé gouverneur d'Avellino par Joseph Bonaparte, roi de Naples, et le séjour en Espagne (1811-1812), où le général Hugo était gouverneur de Ségovie, d'Avila et de Soria. Ces Nouvelles Odes, comme celles de 1822, furent fondues en 1828 dans le recueil des Odes et Ballades...
Mon Enfance
I.
J'ai des rêves de guerre en mon âme inquiète ;
J'aurais été soldat, si je n'étais poète.
Ne vous étonnez point que j'aime les guerriers !
Souvent, pleurant sur eux, dans ma douleur muette,
J'ai trouvé leur cyprès plus beau que nos lauriers.
Enfant, sur un tambour ma crèche fut posée.
Dans un casque pour moi l'eau sainte fut puisée.
Un soldat, m'ombrageant d'un belliqueux faisceau,
De quelque vieux lambeau d'une bannière usée
Fit les langes de mon berceau.
Parmi les chars poudreux, les armes éclatantes,
Une muse des camps m'emporta sous les tentes ;
Je dormis sur l'affût des canons meurtriers ;
J'aimai les fiers coursiers, aux crinières flottantes,
Et l'éperon froissant les rauques étriers.
J'aimai les forts tonnants, aux abords difficiles ;
Le glaive nu des chefs guidant les rangs dociles ;
La vedette, perdue en un bois isolé ;
Et les vieux bataillons qui passaient dans les villes,
Avec un drapeau mutilé.
Mon envie admirait et le hussard rapide,
Parant de gerbes d'or sa poitrine intrépide,
Et le panache blanc des agiles lanciers,
Et les dragons, mêlant sur leur casque gépide
Le poil taché du tigre aux crins noirs des coursiers.
Et j'accusais mon âge : « Ah ! dans une ombre obscure,
Grandir, vivre ! laisser refroidir sans murmure
Tout ce sang jeune et pur, bouillant chez mes pareils,
Qui dans un noir combat, sur l'acier d'une armure,
Coulerait à flots si vermeils !
Et j'invoquais la guerre, aux scènes effrayantes ;
Je voyais en espoir, dans les plaines bruyantes,
Avec mille rumeurs d'hommes et de chevaux,
Secouant à la fois leurs ailes foudroyantes,
L'un sur l'autre à grands cris fondre deux camps rivaux.
J'entendais le son clair des tremblantes cymbales,
Le roulement des chars, le sifflement des balles,
Et de monceaux de morts semant leurs pas sanglants,
Je voyais se heurter au loin, par intervalles,
Les escadrons étincelants !
II.
Avec nos camps vainqueurs, dans l'Europe asservie
J'errai, je parcourus la terre avant la vie ;
Et, tout enfant encor, les vieillards recueillis
M'écoutaient racontant, d'une bouche ravie,
Mes jours si peu nombreux et déjà si remplis !
Chez dix peuples vaincus je passai sans défense,
Et leur respect craintif étonnait mon enfance.
Dans l'âge où l'on est plaint, je semblais protéger.
Quand je balbutiais le nom chéri de France,
Je faisais pâlir l'étranger.
Je visitai cette île, en noirs débris féconde,
Plus tard, premier degré d'une chute profonde.
Le haut Cenis, dont l'aigle aime les rocs lointains,
Entendit, de son antre où l'avalanche gronde,
Ses vieux glaçons crier sous mes pas enfantins.
Vers l'Adige et l'Arno je vins des bords du Rhône.
Je vis de l'Occident l'auguste Babylone,
Rome, toujours vivante au fond de ses tombeaux,
Reine du monde encor sur un débris de trône,
Avec une pourpre en lambeaux.
Puis Turin, puis Florence aux plaisirs toujours prête,
Naples, aux bords embaumés, où le printemps s'arrête
Et que Vésuve en feu couvre d'un dais brûlant,
Comme un guerrier jaloux qui, témoin d'une fête,
Jette au milieu des fleurs son panache sanglant.
L'Espagne m'accueillit, livrée à la conquête.
Je franchis le Bergare, où mugit la tempête ;
De loin, pour un tombeau, je pris l'Escurial ;
Et le triple aqueduc vit s'incliner ma tête
Devant son front impérial.
Là, je voyais les feux des haltes militaires
Noircir les murs croulants des villes solitaires ;
La tente, de l'église envahissait le seuil ;
Les rires des soldats, dans les saints monastères,
Par l'écho répétés, semblaient des cris de deuil.
III.
Je revins, rapportant de mes courses lointaines
Comme un vague faisceau de lueurs incertaines.
Je rêvais, comme si j'avais, durant mes jours,
Rencontré sur mes pas les magiques fontaines
Dont l'onde enivre pour toujours.
L'Espagne me montrait ses couvents, ses bastilles ;
Burgos, sa cathédrale aux gothiques aiguilles ;
Irun, ses toits de bois ; Vittoria, ses tours ;
Et toi, Valadolid, tes palais de familles,
Fiers de laisser rouiller des chaînes dans leurs cours.
Mes souvenirs germaient dans mon âme échauffée ;
J'allais, chantant des vers d'une voix étouffée ;
Et ma mère, en secret observant tous mes pas,
Pleurait et souriait, disant : « C'est une fée
Qui lui parle, et qu'on ne voit pas ! »
Encore à toi,
(un hymne à Adèle Foucher...)
À toi ! toujours à toi ! Que chanterait ma lyre ?
À toi l’hymne d’amour ! à toi l’hymne d’hymen !
Quel autre nom pourrait éveiller mon délire ?
Ai-je appris d’autres chants ? sais-je un autre chemin ?
C’est toi, dont le regard éclaire ma nuit sombre ;
Toi, dont l’image luit sur mon sommeil joyeux ;
C’est toi qui tiens ma main quand je marche dans l’ombre,
Et les rayons du ciel me viennent de tes yeux !
Mon destin est gardé par ta douce prière ;
Elle veille sur moi quand mon ange s’endort ;
Lorsque mon cœur entend ta voix modeste et fière,
Au combat de la vie il provoque le sort.
N’est-il pas dans le ciel de voix qui te réclame ?
N’es-tu pas une fleur étrangère à nos champs ?
Sœur des vierges du ciel, ton âme est pour mon âme
Le reflet de leurs feux et l’écho de leurs chants !
Quand ton œil noir et doux me parle et me contemple,
Quand ta robe m’effleure avec un léger bruit,
Je crois avoir touché quelque voile du temple,
Je dis comme Tobie : Un ange est dans ma nuit !
Lorsque de mes douleurs tu chassas le nuage,
Je compris qu’à ton sort mon sort devait s’unir,
Pareil au saint pasteur, lassé d’un long voyage,
Qui vit vers la fontaine une vierge venir !
Je t’aime comme un être au-dessus de ma vie,
Comme une antique aïeule aux prévoyants discours,
Comme une sœur craintive, à mes maux asservie,
Comme un dernier enfant, qu’on a dans ses vieux jours.
Hélas ! je t’aime tant qu’à ton nom seul je pleure !
Je pleure, car la vie est si pleine de maux !
Dans ce morne désert tu n’as point de demeure,
Et l’arbre où l’on s’assied lève ailleurs ses rameaux.
Mon Dieu ! mettez la paix et la joie auprès d’elle.
Ne troublez pas ses jours, ils sont à vous, Seigneur !
Vous devez la bénir, car son âme fidèle
Demande à la vertu le secret du bonheur.


1827 - la "Préface de Cromwell"
En 1827, c'est le drame de "Cromwell", dont la Préface fut le manifeste du romantisme ; en 1828, l'édition définitive des Odes et Ballades; en 1829, ce sont "les Orientales" et un roman à tendances sociales, "le Dernier jour d'un condamné".
"Le genre humain dans son ensemble a grandi, s’est développé, a mûri comme un de nous. Il a été enfant, il a été homme ; nous assistons maintenant à son imposante vieillesse. Avant l'époque que la société moderne a nommée antique, il existe une autre ère, que les anciens appelaient fabuleuse, et qu'il serait plus exact d'appeler primitive. Voilà donc trois grands ordres de choses successifs dans la civilisation, depuis son origine jusqu’à nos jours. Or, comme la poésie se superpose toujours à la société, nous allons essayer de démêler, d’après la forme de celle-ci, quel a dû être le caractère de l’autre, à ces trois grands âges du monde : les temps primitifs, les temps antiques, les temps modernes..." - Si "Cromwell" s'avère un drame en vers difficilement jouable, sa Préface, qui revendique la liberté de l'art, va constituer le manifeste anticlassique le plus éclatant de l'époque et définir le drame romantique. Avant Hugo, Stendhal, dans son "Racine et Shakespeare" (1823), avait dénoncé l'usure des formules raciniennes et le conformisme démodé de Molière, sa défense de Shakespeare lui permettait de définir un théâtre du futur qu'incarnerait la tragédie historique et la comédie réaliste en prose. Aucun oeuvre en ce début du XIXe ne venait illustrer cette nouvelle orientation. Hugo, quant à lui, donne au drame la fonction d'exprimer les conflits internes de l'homme, ce qui se traduit formellement par la nécessité de mélanger "grotesque" et "sublime", renoncer aux unités, planter un décor historique qui paraisse vrai et libérer le style...
"..Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. L’art feuillette les siècles, feuillette la nature, interroge les chroniques, s’étudie à reproduire la réalité des faits, surtout celle des mœurs et des caractères, bien moins léguée au doute et à la contradiction que les faits, restaure ce que les annalistes ont tronqué, harmonise ce qu’ils ont dépouillé, devine leurs omissions et les répare, comble leurs lacunes par des imaginations qui aient la couleur du temps, groupe ce qu’ils ont laissé épars, rétablit le jeu des fils de la providence sous les marionnettes humaines, revêt le tout d’une forme poétique et naturelle à la fois, et lui donne cette vie de vérité et de saillie qui enfante l’illusion, ce prestige de réalité qui passionne le spectateur, et le poète le premier, car le poète est de bonne foi. Ainsi le but de l’art est presque divin : ressusciter, s’il fait de l’histoire ; créer, s’il fait de la poésie.
C’est une grande et belle chose que de voir se déployer avec cette largeur un drame où l’art développe puissamment la nature ; un drame où l’action marche à la conclusion d’une allure ferme et facile, sans diffusion et sans étranglement ; un drame enfin où le poète remplisse pleinement le but multiple de l’art, qui est d’ouvrir au spectateur un double horizon, d’illuminer à la fois l’intérieur et l’extérieur des hommes ; l’extérieur, par leurs discours et leurs actions ; l’intérieur, par les a parte et les monologues ; de croiser, en un mot, dans le même tableau, le drame de la vie et le drame de la conscience..."
1828, L'Enfant,
Datée de juin 1828, cette pièce des Orientales est inspirée comme Canaris et Navarin, par les évènements de 1821-1827, la guerre de l'indépendance hellénique. On sait que la France se passionna pour cette cause: la décisive victoire navale de Navarin (1827) remportée par les Anglais, les Français et les Russes sur la flotte ottomane, prépara la libération de la Grèce qui fut soustraite au joug de la Turquie par le traité d'Andrinople (1829). Le poète Byron était mort au siège de Missolonghi (1824) en combattant pour les Grecs. Victor Hugo, comme la plupart des poètes romantiques, a demandé à l'Orient un décor pittoresque, des visions colorées, des scènes passionnées. Ici, c'est surtout à travers Byron, dont Le Giaour, La Fiancée d'Abydos, Le Siège de Corinthe étaient traduits en français depuis 1820, qu'est imaginé ce tableau exotique. Au salon de 1824, un tableau bien connu d'Eugène Delacroix évoque Les Massacres de Chio..
Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil.
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil,
Chio, qu’ombrageaient les charmilles,
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois
Un chœur dansant de jeunes filles.
Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis,
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,
Courbait sa tête humiliée ;
Il avait pour asile, il avait pour appui
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui
Dans le grand ravage oubliée.
Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux !
Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus
Comme le ciel et comme l’onde,
Pour que dans leur azur, de larmes orageux,
Passe le vif éclair de la joie et des jeux,
Pour relever ta tête blonde,
Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener
En boucles sur ta blanche épaule
Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront,
Et qui pleurent épars autour de ton beau front,
Comme les feuilles sur le saule ?
Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ?
Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus,
Qui d’Iran borde le puits sombre ?
Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand,
Qu’un cheval au galop met, toujours en courant,
Cent ans à sortir de son ombre ?
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,
Plus éclatant que les cymbales ?
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ?
– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.

1829 - Les "Orientales"
Victor Hugo publie un nouveau roman, de tendance humanitaire, "Le Dernier jour d'un Condamné", et compose un second drame, "Marion de Larme", qui, arrêté par la censure de Charles X (la dénonciation de l'époque de Louis Xlll parut insultante) ne sera joué qu'en 1831. Mais surtout, le poète, publie deux recueils qui révèlent véritablement sa force imaginative, sa virtuosité rythmique, son sens de l'évocation (Hugo, le poète de l'universelle analogie, dira Baudelaire), une liberté d'inspiration peu commune. Hugo, qui n'a jamais vu l'Orient, révèle avec les "Orientales" (1829) qu'il fut tenté un temps par l'art pour l'art, le culte de la beauté pour la beauté ("Tout est sujet; tout relève de l'art ; tout a droit de cité en poésie), avant de se recentrer sur une vision foncièrement humanitaire voire religieuse de sa mission...
On cite le plus souvent "les Djinns" comme l'expression du rythme pur dans la première poésie de Victor Hugo...
"Murs, ville,
Et port,
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise,
Tout dort.
Dans la plaine
Naît un bruit.
C'est l'haleine
De la nuit.
Elle brame
Comme une âme
Qu'une flamme
Toujours suit.
La voix plus haute
Semble un grelot.
D'une main qui saute
C'est le galop.
Il fuit, s'élance,
Puis en cadence
Sur un pied danse
Au bout d'un flot.
La rumeur approche,
L'écho la redit.
C'est comme la cloche
D'un couvent maudit,
Comme un bruit de foule
Qui tonne et qui roule,
Et tantôt s'écroule,
Et tantôt grandit.
Dieu ! la voix sépulcrale
Des Djinns !... - Quel bruit ils font !
Fuyons sous la spirale
De l'escalier profond !
Déjà s'éteint ma lampe,
Et l'ombre de la rampe,
Qui le long du mur rampe,
Monte jusqu'au plafond.
C'est l'essaim des Djinns qui passe,
Et tourbillonne en sifflant.
Les ifs, que leur vol fracasse,
Craquent comme un pin brûlant.
Leur troupeau lourd et rapide,
Volant dans l'espace vide,
Semble un nuage livide
Qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout près ! - Tenons fermée
Cette salle où nous les narguons.
Quel bruit dehors ! Hideuse armée
De vampires et de dragons !
La poutre du toit descellée
Ploie ainsi qu'une herbe mouillée,
Et la vieille porte rouillée
Tremble à déraciner ses gonds. ..."
Le Feu du ciel - Alors le Seigneur fit descendre du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Et il perdit ces villes avec tous leurs habitant, tout le pays à l'entour avec ceux qui l'habitaient, et tout ce qui avait quelque verdeur sur la terre. (La Genèse)
La voyez-vous passer, la nuée au flanc noir?
Tantôt pâle, tantôt rouge et splendide à voir,
Morne comme un été stérile?
On croit voir à la fois, sur le vent de la nuit,
Fuir toute la fumée ardente et tout le bruit
De l'embrasement d'une ville.
D'où vient-elle? des cieux, de la mer ou des monts?
Est-ce le char de feu qui porte les démons
À quelque planète prochaine?
Ô terreur! de son sein, chaos mystérieux,
D'où vient que par moments un éclair furieux
Comme un long serpent se déchaîne?
La mer! partout la mer! des flots, des flots encor.
L'oiseau fatigue en vain son inégal essor.
Ici les flots, là-bas les ondes;
Toujours des flots sans fin par des flots repoussés;
L'oeil ne voit que des flots dans l'abîme entassés
Rouler sous les vagues profondes.
Parfois de grands poissons, à fleur d'eau voyageant,
Font reluire au soleil leurs nageoires d'argent,
Ou l'azur de leurs larges queues.
La mer semble un troupeau secouant sa toison:
Mais un cercle d'airain ferme au loin l'horizon;
Le ciel bleu se mêle aux eaux bleues.
– Faut-il sécher ces mers? dit le nuage en feu.
– Non! – Il reprit son vol sous le souffle de Dieu.
Mazeppa
(mai 1828)
Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure,
A vu ses bras, ses pieds, ses flancs qu'un sabre effleure,
Tous ses membres liés
Sur un fougueux cheval, nourri d'herbes marines,
Qui fume, et fait jaillir le feu de ses narines
Et le feu de ses pieds ;
Quand il s'est dans ses nœuds roulé comme un reptile,
Qu'il a bien réjoui de sa rage inutile
Ses bourreaux tout joyeux,
Et qu'il retombe enfin sur la croupe farouche,
La sueur sur le front, l'écume dans la bouche,
Et du sang dans les yeux,
Un cri part ; et soudain voilà que par la plaine
Et l'homme et le cheval, emportés, hors d'haleine,
Sur les sables mouvants,
Seuls, emplissant de bruit un tourbillon de poudre
Pareil au nuage noir où serpente la foudre,
Volent avec les vents !
Ils vont. Dans les vallons comme un orage ils passent,
Comme ces ouragans qui dans les monts s'entassent,
Comme un globe de feu ;
Puis déjà ne sont plus qu'un point noir dans la brume,
Puis s'effacent dans l'air comme un flocon d'écume
Au vaste océan bleu.
Ils vont. L'espace est grand. Dans le désert immense,
Dans l'horizon sans fin qui toujours recommence,
Ils se plongent tous deux.
Leur course comme un vol les emporte, et grands chênes,
Villes et tours, monts noirs liés en longues chaînes,
Tout chancelle autour d'eux.
Et si l'infortuné, dont la tête se brise,
Se débat, le cheval, qui devance la brise,
D'un bond plus effrayé,
S'enfonce au désert vaste, aride, infranchissable,
Qui devant eux s'étend, avec ses plis de sable,
Comme un manteau rayé.
Tout vacille et se peint de couleurs inconnues :
Il voit courir les bois, courir les larges nues,
Le vieux donjon détruit,
Les monts dont un rayon baigne les intervalles ;
Il voit ; et des troupeaux de fumantes cavales
Le suivent à grand bruit !
Et le ciel, où déjà les pas du soir s'allongent,
Avec ses océans de nuages où plongent
Des nuages encor,
Et son soleil qui fend leurs vagues de sa proue,
Sur son front ébloui tourne comme une roue
De marbre aux veines d'or !
Son oeil s'égare et luit, sa chevelure traîne,
Sa tête pend ; son sang rougit la jaune arène,
Les buissons épineux ;
Sur ses membres gonflés la corde se replie,
Et comme un long serpent resserre et multiplie
Sa morsure et ses nœuds.
Le cheval, qui ne sent ni le mors ni la selle,
Toujours fuit, et toujours son sang coule et ruisselle,
Sa chair tombe en lambeaux ;
Hélas ! voici déjà qu'aux cavales ardentes
Qui le suivaient, dressant leurs crinières pendantes,
Succèdent les corbeaux ! ......

1828, outre le Salon de l'Arsenal formé en 1823 autour de Charles Nodier, un second cénacle se constitua vers 1828 autour de Victor Hugo qui habitait alors rue Notre-Dame-des-Champs, un cénacle plus franchement romantique que le premier et qui comptait, à côté d'écrivains comme A. de Vigny, Sainte-Beuve, Charles Nodier, Alfred de Musset, Gérard de Nerval, A. Dumas, Emile et Antony Duchamp, Théophile Gautier, Jules de Rességuier, Ulric Guttinger, Adolphe de Saint-Valry, Alcide de Beauchesne, des peintres et des sculpteurs comme Louis Boulanger, Eugène Devéris, Eugène Delacroix, David d'Angers. Ce sont surtout les artistes qui contribuèrent au succès du romantismes et les ateliers qui fourniront la "claque" d'Hernani..
Victor Hugo - Les années 1830 - En 1830, c'est la représentation d'Hernani, suivie de celle de "Marion de Lorme" en 1831, - année mémorable où Victor Hugo commence par publier son premier grand roman, "Notre- Dame de Paris", et donne, après "Marion", ses "Feuilles d'automne". — L'année suivante, nouveau drame en vers, "le Roi s'amuse". En 1833, "Lucrèce Borgia", le premier et le meilleur de ses drames en prose ; les deux autres sont "Marie Tudor" (1833) et "Angelo" (1835). En 1834 avaient paru un recueil d'articles, "Littérature et Philosophie mêlées", et une sorte de conte social, "Claude Gueux". En 1835, après "Angelo", ce sont "les Chants du crépuscule", recueil de poésies suivi d'un autre, "les Voix intérieures", en 1837, et, en 1840, du dernier que Victor Hugo ait donné avant son exil : "les Rayons et les Ombres". En 1838, il était revenu au théâtre avec un drame en vers, "Ruy Blas"...

Les deux batailles d'Hernani
Ce sont les deux premières représentations d'Hernani (février 1830) qui mirent le plus violemment aux prises les romantiques et les partisans attardés du classicisme. Il faut lire dans "l'Histoire du romantisme", que Théophile Gautier écrivit d'ailleurs beaucoup plus tard (elle parut 2 ans après sa mort, en 1871), le compte rendu de la première bataille d'Hernani, å laquelle il avait assisté. A la deuxième représentation de la pièce, les classiques voulurent prendre leur revanche de l'échec qu'ils avaient subi à la première: c'est la seconde bataille d'Hernani, dont Mme V. Hugo nous a fait le récit dans "Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie". En 1867, alors que Victor Hugo était en exil, il y eut une reprise triomphale d'Hernani, on l'appelle parfois la troisième bataille d'Hernani.
LA PREMIÈRE BATAILLE D'HERNANI (Théophile Gautier)
"25 février 1830! 'Cette date reste écrite dans le fond de notre pensée en caractères flamboyants : la date de la première représentation d'Hernani !
Lejeune poète, avec sa fière audace et sa grandesse de génie, aimant mieux d'ailleurs la gloire que le succès, avait opiniâtrement refusé l'aide de ces cohortes stipendiées qui accompagnent les triomphes et soutiennent les déroutes. Les claqueurs ont leur goût comme les académiciens. Ils sont en général classiques.
On ne pouvait cependant pas, quelque brave qu'il fût, laisser Hernani se débattre tout seul contre un parterre mal disposé et tumultueux, contre des loges plus calmes en apparence mais non moins dangereuses dans leur hostilité polie. La jeunesse romantique pleine d'ardeur et fanatisée par la préface de Cromwell s'offrit au maître qui l'accepta. On s'enrégimenta par petites escouades dont chaque homme avait pour passe le carré de papier rouge timbré de la griffe Hierro (signature romantique de Hugo).
On s'est plu à représenter dans les petits journaux et les polémiques du temps ces jeunes hommes, tous de bonne famille, instruits, bien élevés, fous d'art et de poésie, ceux-ci écrivains, ceux-là peintres, les uns musiciens, les autres sculpteurs ou architectes, quelques-uns critiques et occupés à un titre quelconque de choses littéraires, comme un ramassis de truands sordides. Ce n'étaient pas les Huns d'Attila qui campaient devant le Théâtre-Français, malpropres, farouches, hérissés, stupides ; mais bien les chevaliers de l'avenir, les champions de l'idée, les défenseurs de l'art libre; et ils étaient beaux, libres et jeunes. Oui, ils avaient des cheveux, - on ne peut naître avec des perruques, - et ils en avaient beaucoup qui retombaient en boucles souples et brillantes, car ils étaient bien peignés. Leur costumes,
où régnaient la fantaisie du goût individuel et le juste sentiment de la couleur, prêtait davantage à la peinture.
Dans une intention perfide et dans l'espoir sans doute de quelque tumulte qui nécessitât ou prétextât l'intervention de la police, on fit ouvrir les portes à deux heures de l'après-midi.
Six ou sept heures d'attente dans l'obscurité ou tout au moins la pénombre d'une salle dont le lustre n'est pas allumé, c'est long, même lorsqu'au bout de cette nuit Hernani doit se lever comme un soleil radieux. La faim commençait à se faire sentir. Les plus prudents avaient emporté du chocolat et des petits pains, quelques-uns - proh pudor! - des cervelas, des classiques malveillants disent à l'ail. Cependant le lustre descendait lentement du plafond avec sa triple couronne de gaz et son scintillement prismatique; la rampe montait, traçant entre le monde idéal et le monde réel sa démarcation lumineuse. Les candélabres s'allumaient aux avant-scènes et la salle s'emplissait peu à peu. L'orchestre et le balcon étaient pavés de crânes académiques et classiques. Une rumeur d'orage grondait sourdement dans la salle, il était temps que la toile se levât : on en serait peut-être venu aux mains avant la pièce, tant l'animosité ,était grande de part et d autre. Enfin les trois coups retentirent.
Il suffisait de jeter les yeux sur ce public pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas là d'une représentation ordinaire; que deux systèmes, deux partis, deux armées, deux civilisations même - ce n'est pas trop dire - étaient en présence, se haïssant cordialement, comme on se hait dans les haines littéraires, ne demandant que la bataille, et prêts à fondre l'un sur l'autre. L'attitude générale était hostile, les coudes se faisaient anguleux, la querelle n'attendait pour jaillir que le moindre contact..."

1830 - "Hernani", la "bataille d'Hernani"
Avec les premières représentations d'Hernani (1830), Victor Hugo devient le chef de file incontesté du romantisme, soutenus par la jeune génération, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Alfred de Vigny, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, qui s'opposent aux tenants du "classique". Cette révolution littéraire précède de peu la révolution politique de juillet, - "le romantisme n'est, à tout prendre, que le libéralisme en littérature" (Préface d`Hernani, mars 1830), la méditation de Don Carlos au tombeau de Charlemagne (Hernani, IV, 2), ou l'invective de Ruy Blas aux ministres corrompus (Ruy Blas, III, 2) en constituent de parfaites illustrations. Le "Cénacle", rue Notre-Dame-des-Champs, devient dès 1827 le quartier général du mouvement. Le scandale de la "bataille d'Hernani" qui voit s'opposer lors de la représentation de la pièce, le 25 février 1830, les défenseurs de la tradition et les tenants des nouvelles doctrines, impose le drame pour longtemps : suppression de l'unité de lieu (la scène est tantôt à Saragosse, tantôt dans les montagnes d'Aragon, tantôt à Aix-la-Chapelle), abandon de l'unité de temps (le drame se déroule sur plusieurs mois), désintérêt pour la vraisemblance. Hernani est porté par une intrigue complexe et tragique qui mêle une affaire sentimentale - le roi Don Carlos et le proscrit Hernani aiment la même femme, doña Sol -, et un drame politique - une conspiration veut empêcher Don Carlos de devenir Charles Quint -...
Acte I - Le roi - Le roi d'Espagne Don Carlos et un proscrit chef de bande Hernani, qui veut venger son père jadis mis à mort par le père du roi, se trouvent face à face dans la chambre de Dona Sol, dont ils sont épris. La Jeune fille aime Hernani mais elle est fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva, qui s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour quelqu'un de sa suite... (Acte I scène II) ...
Dona Sol
Je vous suivrai.
Hernani
Parmi mes rudes compagnons,
Proscrits dont le bourreau sait d'avance les noms,
Gens dont jamais le fer ni le coeur ne s'émousse,
Ayant tous quelques sang à venger qui les pousse ?
Vous viendrez commander ma bande, comme on dit ?
Car, vous ne savez pas, moi je suis un bandit !
Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagne,
Seul, dans ses forêts, dans ses hautes montagnes,
Dans ses rocs, ou l'on n'est que de l'aigle aperçu,
La vieille Catalogne en mère m'a reçu.
Parmi ses montagnards, libres, pauvres et graves,
Je grandis, et demain, trois mille de ses braves,
Si ma voix dans leurs monts fait résonner ce cor.
Viendront... -Vous frissonnez ! Réfléchissez encor.
Me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves,
Chez des hommes pareils aux démons de vos rêves,
Soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit,
Dormir sur l'herbe, boire au torrent, et la nuit
Entendre, en allaitant quelque enfant qui s'éveille,
Les balles des mousquets siffler à votre oreille,
Etre errante avec moi, proscrite et s'il le faut
Me suivre ou je suivrai mon père, - à l'échafaud.
Dona Sol
Je vous suivrai.
Hernani
Le duc est riche, grand, prospère.
Le duc n'a pas de tache au vieux nom de son père.
Le duc peut tout. Le duc vous offre avec sa main
Trésors, titres, bonheur...
Dona Sol
Nous partirons demain.
Hernani, n'allez pas sur mon audace étrange
Me blâmer. Êtes-vous mon démon ou mon ange ?
Je ne sais, mais je suis votre esclave. Ecoutez.
Allez où vous voudrez, j'irai. Restez, partez.
Je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi ? je l`ignore.
J'ai besoin de vous voir et de vous voir encore
Et de vous voir toujours. Quand le bruit de vos pas
S`efface, alors je crois que mon cœur ne bat pas,
Vous me manquez, je suis absente de moi-même;
Mais dès qu”enfin ce pas que j`attends et que j'aime
Vient frapper mon oreille, alors il me souvient
Que je vis, et je sens mon âme qui revient!
Acte II - Le bandit
Don Carlos rode autour du palais de Silva. Il tombe sur Hernani qui est venu enlever Dona. Le roi refuse de se battre avec Hernani et laisse échapper son rival.
Acte III - Le vieillard
Le jour des noces de Dona Sol et de Ruy Gomez, un pèlerin frappe à la porte du château de Da Silva, c'est Hernani. Sa tête est mise à prix, mais le Duc défend qu'on le dénonce. Arrive Don Carlos. Après son départ Ruy Gomez et Hernani complote pour tuer le roi. Hernani promet à Don Ruy qu'en cas de victoire, il lui offrira sa tête.
Acte IV - Le tombeau - Don Carlos est averti du complot. Au moment de son élévation à l'empire sous le nom de Charles Quint, ses soldats s'empares des conjurés Hernani et Ruy Gomez. Le roi veut inaugurer son règne par une mesure de clémence et unit Dona Sol et Hernani qui est en réalité Juan d'Aragon, grand d'Espagne. La méditation de Don Carlos au tombeau de Charlemagne (Hernani, IV, 2)...
Le pape et l’empereur sont tout. Rien n’est sur terre
Que par eux et pour eux. Un suprême mystère
Vit en eux, et le ciel, dont ils ont tous les droits,
Leur fait un grand festin des peuples et des rois.
Le monde, au-dessous d’eux, s’échelonne et se groupe.
Ils font et défont. L’un délie et l’autre coupe.
L’un est la vérité, l’autre est la force. Ils ont
Leur raison en eux-même, et sont parce qu’ils sont.
Quand ils sortent, tous deux égaux, du sanctuaire,
L’un dans sa pourpre, et l’autre avec son blanc suaire,
L’univers ébloui contemple avec terreur
Ces deux moitiés de Dieu, le pape et l’empereur !
— L’empereur ! L’empereur ! être empereur ! — ô rage,
Ne pas l’être-et sentir son cœur plein de courage !
Qu’il fut heureux celui qui dort dans ce tombeau,
Qu’il fut grand ! De son temps c’était encor plus beau !
Ô quel destin ! — pourtant cette tombe est la sienne !
Tout est-il donc si peu que ce soit là qu’on vienne ?
Quoi donc, avoir été prince, empereur et roi !
Avoir été colosse et tout dépassé ! Quoi !
Vivant, pour piédestal avoir eu l’Allemagne !
Quoi ! Pour titre César et pour nom Charlemagne !
— Avoir été plus grand qu’Annibal, qu’Attila,
Aussi grand que le monde !… — et que tout tienne là !
Ah ! Briguez donc l’empire et voyez la poussière
Que fait un empereur ! Couvrez la terre entière
De bruit et de tumulte. — élevez, bâtissez
Votre empire, et jamais ne dites : « c’est assez ! »
Si haut que soit le but où votre orgueil aspire,
Voilà le dernier terme !… — oh ! L’empire ! L’empire !
Que m’importe ? J’y touche et le trouve à mon gré.
Quelque chose me dit : « tu l’auras ». Je l’aurai !
Si je l’avais !… — ô ciel ! être ce qui commence !
Seul, debout, au plus haut de la spirale immense !
Acte V - La noce
Au palais d'Aragon s'achève le mariage quand retentit le son d'un cor, c'est Don Ruy qui rappelle à Hernani sa promesse. Celui-ci s'empoisonne avec sa compagne et Don Ruy se poignarde sur leurs cadavres.

1833 - Juliette Drouet
"Hier, la nuit d’été, qui nous prêtait ses voiles, Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles ! Tant son calme était frais ! tant son souffle était doux ! Tant elle éteignait bien ses rumeurs apaisées ! Tant elle répandait d’amoureuses rosées Sur les fleurs et sur nous ! Moi, j’étais devant toi, plein de joie et de flamme, Car tu me regardais avec toute ton âme ! J’admirais la beauté dont ton front se revêt. Et sans même qu’un mot révélât ta pensée, La tendre rêverie en ton cœur commencée Dans mon cœur s’achevait !" - Victor Hugo a à peine trente ans, le voici accédant à la gloire, mais livré aux intrigues et trahison, au lendemain d'Hernaní, le cénacle commence à se disperser, mais surtout Sainte-Beuve et Mme Hugo noue une relation qui brise son bonheur conjugal. En février 1833, Hugo rencontre Juliette Drouet, qui interprète alors le rôle de la princesse Negroni dans Lucrèce Borgia, au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Commence une liaison de cinquante ans, entrecoupée de ruptures et de réconciliations, - entre autres femmes traversant sa vie, Louise Colet (qui sera liée à Flaubert), Judith Gautier (la fille de Théophile), Louise Michel (la Vierge Rouge), Sarah Bernhardt (la célèbre comédienne), nombreuses d'admiratrices, de femmes de chambres et de prostituées -, liaison mythique en raison de sa durée mais plus encore par la passion absolue éprouvée par Juliette Drouet qui écrira à Victor Hugo entre 15 000 et 20 000 lettres et abandonnera sa carrière d'actrice...

Dans "Les chants du crépuscule" (1835), Victor Hugo se souvient d'un rendez-vous clandestin en pleine forêt de la vallée de la Bièvre avec Juliette, lui séjournant en septembre 1834, avec sa famille dans domaine des Roches de leurs amis Bertin, elle installée non loin de là au hameau des Metz...
Oh ! pour remplir de moi ta rêveuse pensée,
Tandis que tu m'attends, par la marche lassée,
Sous l'arbre au bord du lac, loin des yeux importuns,
Tandis que sous tes pieds l'odorante vallée,
Toute pleine de brume au soleil envolée,
Fume comme un beau vase où brûlent des parfums ;
Que tout ce que tu vois, les coteaux et les plaines,
Les doux buissons de fleurs aux charmantes haleines,
La vitre au vif éclair,
Le pré vert, le sentier qui se noue aux villages,
Et le ravin profond débordant de feuillages
Comme d'ondes la mer,
Que le bois, le jardin, la maison, la nuée,
Dont midi ronge au loin l'ombre diminuée,
Que tous les points confus qu'on voit là-bas trembler,
Que la branche aux fruits mûrs ; que la feuille séchée,
Que l'automne, déjà par septembre ébauchée,
Que tout ce qu'on entend ramper, marcher, voler,
Que ce réseau d'objets qui t'entoure et te presse,
Et dont l'arbre amoureux qui sur ton front se dresse
Est le premier chaînon ;
Herbe et feuille, onde et terre, ombre, lumière et flamme,
Que tout prenne une voix, que tout devienne une âme,
Et te dise mon nom !

"Si mes vers avaient des ailes, Des ailes comme l’oiseau..." - "L'Âme en fleur", près de 900 vers du livre des "Contemplations" (1856) sont inspirés des amours de Victor Hugo pour Juliette Drouet, il y conte les premiers temps de leur union, leurs promenades en forêt de Bièvre, leurs joies, leurs extases, mais aussi les épreuves vécues en commun, les malentendus, les réconciliations...
"Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux.
Comme le soleil fait serein ou pluvieux
L’azur dont il est l’âme et que sa clarté dore,
Tu peux m’emplir de brume ou m’inonder d’aurore,
Du haut de ta splendeur, si pure qu’en ses plis,
Tu sembles une femme enfermée en un lis,
Et qu’à d’autres moments, l’œil qu’éblouit ton âme
Croit voir, en te voyant, un lis dans une femme.
Si tu m’as souri, Dieu ! tout mon être bondit !
Il lui disait : « Vois-tu, si tous deux nous pouvions,
« L’âme pleine de foi, le cœur plein de rayons,
« Ivres de douce extase et de mélancolie,
« Rompre les mille nœuds dont la ville nous lie ;
« Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou,
« Nous fuirions ; nous irions quelque part, n’importe où,
« Chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses,
« Un coin où aurions des arbres, des pelouses,
« Une maison petite avec des fleurs, un peu
« De solitude, un peu de silence, un ciel bleu,
« La chanson d’un oiseau qui sur le toit se pose,
« De l’ombre ; – et quel besoin avons-nous d’autre
chose ? »

Pendant le séjour à Étampes le 22 août 1834, Hugo écrit un poème mémorable célébrant ses amours avec Juliette Drouet, qui sera publié seulement en 1856 dans son recueil "Les Contemplations" et inspirera compositeurs et peintres ...
"Mon bras pressait ta taille frêle
Et souple comme le roseau;
Ton sein palpitait comme l’aile
D’un jeune oiseau.
Longtemps muets, nous contemplâmes
Le ciel où s’éteignait le jour.
Que se passait-il dans nos âmes?
Amour! amour!
Comme un ange qui se dévoile,
Tu me regardais dans ma nuit,
Avec ton beau regard d’étoile
Qui m’éblouit."

1831 - "Les Feuilles d'Automne"
Entre 1830 et 1840, Victor Hugo va publier quatre recueils lyriques, "Les Feuilles d`Automne" (1831), "Les Chants du Crépuscule" (1835), "Les Voix intérieures" (1837), "Les Rayons et les Ombres" (1840). Ecrites à vingt-huit ans, avant la révolution de Juillet, les 40 pièces des Feuilles d'automne sont une oeuvre de transition, des vers sereins et paisibles, dira Hugo, des vers portant sur son enfance (ce siècle avait deux ans), le foyer domestique (lorsque l'enfant parait), la vie privée, des vers puisés à l'intérieur de l'âme mais dominés par la mélancolie...
(Novembre 1829)
Parfois, lorsque tout dort, je m'assieds plein de joie
Sous le dôme étoilé qui sur nos fronts flamboie ;
J'écoute si d'en haut il tombe quelque bruit ;
Et l'heure vainement me frappe de son aile
Quand je contemple, ému, cette fête éternelle
Que le ciel rayonnant donne au monde la nuit.
Souvent alors j'ai cru que ces soleils de flamme
Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme ;
Qu'à les comprendre seul j'étais prédestiné ;
Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,
Le roi mystérieux de la pompe nocturne ;
Que le ciel pour moi seul s'était illuminé !
(Septembre 1831)
Contempler dans son bain sans voiles
Une fille aux yeux innocents ;
Suivre de loin de blanches voiles ;
Voir au ciel briller les étoiles
Et sous l'herbe les vers luisants ;
Voir autour des mornes idoles
Des sultanes danser en rond ;
D'un bal compter les girandoles ;
La nuit, voir sur l'eau les gondoles
Fuir avec une étoile au front ;
Regarder la lune sereine ;
Dormir sous l'arbre du chemin ;
Être le roi lorsque la reine,
Par son sceptre d'or souveraine,
L'est aussi par sa blanche main ;
Ouïr sur les harpes jalouses
Se plaindre la romance en pleurs ;
Errer, pensif, sur les pelouses,
Le soir, lorsque les andalouses
De leurs balcons jettent des fleurs ;
Rêver, tandis que les rosées
Pleuvent d'un beau ciel espagnol,
Et que les notes embrasées
S'épanouissent en fusées
Dans la chanson du rossignol ;
Ne plus se rappeler le nombre
De ses jours, songes oubliés ;
Suivre fuyant dans la nuit sombre
Un Esprit qui traîne dans l'ombre
Deux sillons de flamme à ses pieds ;
Des boutons d'or qu'avril étale
Dépouiller le riche gazon ;
Voir, après l'absence fatale,
Enfin, de sa ville natale
Grandir la flèche à l'horizon ;
Non, tout ce qu'a la destinée
De bien réels ou fabuleux
N'est rien pour mon âme enchaînée
Quand tu regardes inclinée
Mes yeux noirs avec tes yeux bleus !
Où donc est le bonheur ?
Le 28 mai 1830.
Où donc est le bonheur ? disais-je. - Infortuné !
Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné.
Naître, et ne pas savoir que l'enfance éphémère,
Ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère,
Est l'âge du bonheur, et le plus beau moment
Que l'homme, ombre qui passe, ait sous le firmament !
Plus tard, aimer, - garder dans son coeur de jeune homme
Un nom mystérieux que jamais on ne nomme,
Glisser un mot furtif dans une tendre main,
Aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen,
Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole,
Sentir son coeur se fondre au son d'une parole,
Connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit,
Rêver le jour, brûler et se tordre la nuit,
Pleurer surtout cet âge où sommeillent les âmes,
Toujours souffrir ; parmi tous les regards de femmes,
Tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil,
Ne chercher qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil !
Puis effeuiller en hâte et d'une main jalouse
Les boutons d'orangers sur le front de l'épouse ;
Tout sentir, être heureux, et pourtant, insensé
Se tourner presque en pleurs vers le malheur passé ;
Voir aux feux de midi, sans espoir qu'il renaisse,
Se faner son printemps, son matin, sa jeunesse,
Perdre l'illusion, l'espérance, et sentir
Qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir,
Effacer de son front des taches et des rides ;
S'éprendre d'art, de vers, de voyages arides,
De cieux lointains, de mers où s'égarent nos pas ;
Redemander cet âge où l'on ne dormait pas ;
Se dire qu'on était bien malheureux, bien triste,
Bien fou, que maintenant on respire, on existe,
Et, plus vieux de dix ans, s'enfermer tout un jour
Pour relire avec pleurs quelques lettres d'amour !
Vieillir enfin, vieillir ! comme des fleurs fanées
Voir blanchir nos cheveux et tomber nos années,
Rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris,
Boire le reste amer de ces parfums aigris,
Être sage, et railler l'amant et le poète,
Et, lorsque nous touchons à la tombe muette,
Suivre en les rappelant d'un oeil mouillé de pleurs
Nos enfants qui déjà sont tournés vers les leurs !
Ainsi l'homme, ô mon Dieu ! marche toujours plus sombre
Du berceau qui rayonne au sépulcre plein d'ombre.
C'est donc avoir vécu ! c'est donc avoir été !
Dans la joie et l'amour et la félicité
C'est avoir eu sa part ! et se plaindre est folie.
Voilà de quel nectar la coupe était remplie !
Hélas ! naître pour vivre en désirant la mort !
Grandir en regrettant l'enfance où le coeur dort,
Vieillir en regrettant la jeunesse ravie,
Mourir en regrettant la vieillesse et la vie !
Où donc est le bonheur, disais-je ? - Infortuné !
Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné !

Lorsque l'enfant paraît
(mai 1830)
Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre
Fasse autour d’un grand feu vacillant dans la chambre
Les chaises se toucher,
Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher.
Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme,
De patrie et de Dieu, des poètes, de l’âme
Qui s’élève en priant ;
L’enfant paraît, adieu le ciel et la patrie
Et les poètes saints ! la grave causerie
S’arrête en souriant.
La nuit, quand l’homme dort, quand l’esprit rêve, à l’heure
Où l’on entend gémir, comme une voix qui pleure,
L’onde entre les roseaux,
Si l’aube tout à coup là-bas luit comme un phare,
Sa clarté dans les champs éveille une fanfare
De cloches et d’oiseaux !
Enfant, vous êtes l’aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez ;
Mon âme est la forêt dont les sombres ramures
S’emplissent pour vous seul de suaves murmures
Et de rayons dorés !
Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies
N’ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas n’ont touché notre fange ;
Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange
À l’auréole d’or !
Vous êtes parmi nous la colombe de l’arche.
Vos pieds tendres et purs n’ont point l’âge où l’on marche ;
Vos ailes sont d’azur.
Sans le comprendre encor, vous regardez le monde.
Double virginité ! corps où rien n’est immonde,
Âme où rien n’est impur !
Il est si beau, l’enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers !
Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j’aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même
Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur ! l’été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants !

1831 - Un roman, "Notre-Dame de Paris"
Après le théâtre et le succès d'Hernani, Hugo apporte au romantisme une nouvelle contribution, dans le roman, avec "Notre-Dame de Paris" (1831) : le goût du temps est au Moyen Age, il nous donne ici, - un roman qui se situe en fin de règne de Louis XI (1482) au moment où le Moyen Âge bascule dans la Renaissance -, la mesure de son imagination et de sa puissance verbale pour nous relater comment la fatalité peut conduire des marginaux et des miséreux à l'échec et à la mort, comment la belle bohémienne Esmeralda, le hideux Quasimodo, l'archidiacre obsédé Frollo sont emportés par un même destin impitoyablement scellé....
LA COUR DES MIRACLES - Le poète Gringoire s'est égaré une nuit dans un quartier de Paris et découvre la Cour des Miracles...
"... Il se mit à courir. L’aveugle courut. Le boiteux courut. Le cul-de-jatte courut.
Et puis, à mesure qu’il s’enfonçait dans la rue, culs-dejatte, aveugles, boiteux, pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies, qui sortant des maisons, qui des petites rues adjacentes, qui des soupiraux des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopinclopant, cahin-caha, se ruant vers la lumière, et vautrés dans la fange comme des limaces après la pluie.
Gringoire, toujours suivi par ses trois persécuteurs, et ne sachant trop ce que cela allait devenir, marchait effaré au milieu des autres, tournant les boiteux, enjambant les culs-de-jatte, les pieds empêtrés dans cette fourmilière d’éclopés, comme ce capitaine anglais qui s’enlisa dans un troupeau de crabes.
L’idée lui vint d’essayer de retourner sur ses pas. Mais il était trop tard. Toute cette légion s’était refermée derrière lui, et ses trois mendiants le tenaient. Il continua donc, poussé à la fois par ce flot irrésistible, par la peur et par un vertige qui lui faisait de tout cela une sorte de rêve horrible.
Enfin, il atteignit l’extrémité de la rue. Elle débouchait sur une place immense, où mille lumières éparses vacillaient dans le brouillard confus de la nuit. Gringoire s’y jeta, espérant échapper par la vitesse de ses jambes aux trois spectres infirmes qui s’étaient cramponnés à lui.
« DOndè vas, hombre ! » cria le perclus jetant là ses béquilles, et courant après lui avec les deux meilleures jambes qui eussent jamais tracé un pas géométrique sur le pavé de Paris.
Cependant le cul-de-jatte, debout sur ses pieds, coiffait Gringoire de sa lourde jatte ferrée, et l’aveugle le regardait en face avec des yeux flamboyants.
« Où suis-je ? dit le poète terrifié.
– Dans la Cour des Miracles, répondit un quatrième spectre qui les avait accostés.
– Sur mon âme, reprit Gringoire, je vois bien les aveugles qui regardent et les boiteux qui courent ; mais où est le Sauveur ? »
Ils répondirent par un éclat de rire sinistre. Le pauvre poète jeta les yeux autour de lui. Il était en effet dans cette redoutable Cour des Miracles, où jamais honnête homme n’avait pénétré à pareille heure ; cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui s’y aventuraient disparaissaient en miettes ; cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris ; égout d’où s’échappait chaque matin, et où revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage toujours débordé dans les rues des capitales ; ruche monstrueuse où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de l’ordre social ; hôpital menteur où le bohémien, le moine défroqué, l’écolier perdu, les vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres, couverts de plaies fardées, mendiants le jour, se transfiguraient la nuit en brigands ; immense vestiaire, en un mot, où s’habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris.
C’était une vaste place, irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris alors. Des feux, autour desquels fourmillaient des groupes étranges, y brillaient çà et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements d’enfants, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule, noires sur le fond lumineux, y découpaient mille gestes bizarres. Par moments, sur le sol, où tremblait la clarté des feux, mêlée à de grandes ombres indéfinies, on pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme, un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces semblaient s’effacer dans cette cité comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie, tout semblait être en commun parmi ce peuple ; tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé ; chacun y participait de tout.
Le rayonnement chancelant et pauvre des feux permettait à Gringoire de distinguer, à travers son trouble, tout à l’entour de l’immense place, un hideux encadrement de vieilles maisons dont les façades vermoulues, ratatinées, rabougries, percées chacune d’une ou deux lucarnes éclairées, lui semblaient dans l’ombre d’énormes têtes de vieilles femmes, rangées en cercle, monstrueuses et rechignées, qui regardaient le sabbat en clignant des yeux.
C’était comme un nouveau monde, inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique...."
NOTRE-DAME A Paris, en 1482, le poète Gringaire s'égare dans la Cour des Miracles; menacé d'un mauvais sort, il doit son salut à une séduisante bohémienne, la ESMERALDA. L'archidiacre FROLLO éprouve pour celle-ci une sinistre passion et a chargé le sonneur de Notre-Dame, QUASIMODO, de s'emparer d'elle , mais le capitaine PHOEBUS délivre la jeune fille qui s`éprend de son sauveur. Pour sa tentative de rapt, Quasimodo, qui est un monstre difforme, a été condamné au pilori: émue de pitié, la Esmeralda lui donne à boire et le malheureux conçoit pour elle un attachement passionné. Cependant Frollo assassine Phœbus et laisse accuser la bohémienne. Elle est amenée devant Notre- Dame pour y faire amende honorable. Quasimodo l'entraîne dans la cathédrale où elle jouira du droit d`asile. Mais les truands attaquent Notre-Dame pour délivrer leur amie. Ils sont repoussés par le sonneur. La Esmeralda retrouve sa mère, qui ne peut l`arracher à son persécuteur. Rendue à la justice, la jeune fille est pendue. Comprenant enfin le rôle qu'a joué son maître Frollo, Quasimodo le précipite du haut de Notre-Dame et va lui-même mourir au charnier de Montfaucon où a été déposé le corps de la Esmeralda.
LES TRUANDS A L”ASSAUT DE NOTRE-DAME - Cette scène violente et grandiose résulte, à l`origine, d`un tragique malentendu : les truands veulent délivrer la ESMERALDA que QUASIMODO croit protéger, alors qu'à Notre-Dame elle est à la merci de son pire ennemi, l`odieux Claude Frollo (d'où le titre du chapitre : Un maladroit ami). Cependant, au point où en sont venues les choses, le sonneur ne se trompe qu`à demi en défendant avec une passion aveugle à la fois sa bien-aimée et sa cathédrale, car cette dernière est terriblement menacée par la convoitise des gueux...
"Qui eût pu voir Quasimodo en ce moment eût été effrayé. Indépendamment de ce qu’il avait empilé de projectiles sur la balustrade, il avait amoncelé un tas de pierres sur la plate-forme même. Dès que les moellons amassés sur le rebord extérieur furent épuisés, il prit au tas. Alors il se baissait, se relevait, se baissait et se relevait encore, avec une activité incroyable. Sa grosse tête de gnome se penchait par-dessus la balustrade, puis une pierre énorme tombait, puis une autre, puis une autre. De temps en temps il suivait une belle pierre de l’œil, et, quand elle tuait bien, il disait : « Hun ! »
Cependant les gueux ne se décourageaient pas. Déjà plus de vingt fois l’épaisse porte sur laquelle ils s’acharnaient avait tremblé sous la pesanteur de leur bélier de chêne multipliée par la force de cent hommes. Les panneaux craquaient, les ciselures volaient en éclats, les gonds à chaque secousse sautaient en sursaut sur leurs pitons, les ais se détraquaient, le bois tombait en poudre broyé entre les nervures de fer. Heureusement pour Quasimodo, il y avait plus de fer que de bois. Il sentait pourtant que la grande porte chancelait. Quoiqu’il n’entendît pas, chaque coup de bélier se répercutait à la fois dans les cavernes de l’église et dans ses entrailles. Il voyait d’en haut les truands, pleins de triomphe et de rage, montrer le poing à la ténébreuse façade, et il enviait, pour l’égyptienne et pour lui, les ailes des hiboux qui s’enfuyaient au-dessus de sa tête par volées. Sa pluie de moellons ne suffisait pas à repousser les assaillants.
En ce moment d’angoisse, il remarqua, un peu plus bas que la balustrade d’où il écrasait les argotiers, deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte. L’orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plate-forme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans son bouge de sonneur, posa sur ce fagot force bottes de lattes et force rouleaux de plomb, munitions dont il n’avait pas encore usé, et, ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières, il y mit le feu avec sa lanterne.
Pendant ce temps-là, les pierres ne tombant plus, les truands avaient cessé de regarder en l’air. Les bandits, haletant comme une meute qui force le sanglier dans sa bauge, se pressaient en tumulte autour de la grande porte, toute déformée par le bélier, mais debout encore. Ils attendaient avec un frémissement le grand coup, le coup qui allait l’éventrer. C’était à qui se tiendrait le plus près pour pouvoir s’élancer des premiers, quand elle s’ouvrirait, dans cette opulente cathédrale, vaste réservoir où étaient venues s’amonceler les richesses de trois siècles. Ils se rappelaient les uns aux autres, avec des rugissements de joie et d’appétit, les belles croix d’argent, les belles chapes de brocart, les belles tombes de vermeil, les grandes magnificences du chœur, les fêtes éblouissantes, les Noëls étincelantes de flambeaux, les Pâques éclatantes de soleil, toutes ces solennités splendides où châsses, chandeliers, ciboires, tabernacles, reliquaires, bosselaient les autels d’une croûte d’or et de diamants. Certes, en ce beau moment, cagoux et malingreux, archisuppôts et rifodés, songeaient beaucoup moins à la délivrance de l’égyptienne qu’au pillage de Notre-Dame. Nous croirions même volontiers que pour bon nombre d’entre eux la Esmeralda n’était qu’un prétexte, si des voleurs avaient besoin de prétextes.
Tout à coup, au moment où ils se groupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et roidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement, plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous le madrier, s’éleva au milieu d’eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. Deux jets de plomb fondu tombaient du haut de l’édifice au plus épais de la cohue. Cette mer d’hommes venait de s’affaisser sous le métal bouillant qui avait fait, aux deux points où il tombait, deux trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l’eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants à demi calcinés et mugissant de douleur. Autour de ces deux jets principaux, il y avait des gouttes de cette pluie horrible qui s’éparpillaient sur les assaillants et entraient dans les crânes comme des vrilles de flamme. C’était un feu pesant qui criblait ces misérables de mille grêlons. La clameur fut déchirante. Ils s’enfuirent pêle-mêle, jetant le madrier sur les cadavres, les plus hardis comme les plus timides, et le Parvis fut vide une seconde fois.
Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu’ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Sans doute ce phare étrange allait éveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l'ombre gigantesque des tours de Notre-Dame..." (Notre-Dame de Paris, Livre X, chapitre IV)

1835 - "Les Chants du Crépuscule"
Les Chants du Crépuscule reflète une période de difficultés intimes (rupture du bonheur conjugal, passion ardente et inquiète pour Juliette Drouet) et d'interrogations inquiètes sur la période politique et sociale à venir (la monarchie de juillet semble n'être qu'un régime transitoire), "c'est cet étrange état crépusculaire de l'âme et de la société dans le siècle où nous vivons : c'est cette brume au dehors, cette incertitude au dedans; c'est ce je ne sais quoi d'à demi éclairé qui nous environne", mais subsiste un espoir qui le fait célébrer la gloire de Napoléon...
Que nous avons le doute en nous
À mademoiselle Louise B.
De nos jours, — plaignez-nous, vous, douce et noble femme ! —
L'intérieur de l'homme offre un sombre tableau.
Un serpent est visible en la source de l'eau,
Et l'incrédulité rampe au fond de notre âme.
Vous qui n'avez jamais de sourire moqueur
Pour les accablements dont une âme est troublée,
Vous qui vivez sereine, attentive et voilée,
Homme par la pensée et femme par le cœur,
Si vous me demandez, vous muse, à moi poète,
D'où vient qu'un rêve obscur semble agiter mes jours,
Que mon front est couvert d'ombres, et que toujours,
Comme un rameau dans l'air, ma vie est inquiète ;
Pourquoi je cherche un sens au murmure des vents ;
Pourquoi souvent, morose et pensif dès la veille,
Quand l'horizon blanchit à peine, je m'éveille
Même avant les oiseaux, même avant les enfants ;
Et pourquoi, quand la brume a déchiré ses voiles,
Comme dans un palais dont je ferais le tour,
Je vais dans le vallon, contemplant tour-à-tour
Et le tapis de fleurs et le plafond d'étoiles ?
Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi,
Le doute, qui m'emmène errer dans le bois sombre,
Spectre myope et sourd, qui, fait de jour et d'ombre,
Montre et cache à la fois toute chose à demi !
Je vous dirai qu'en moi j'interroge à toute heure
Un instinct qui bégaie, en mes sens prisonnier,
Près du besoin de croire un désir de nier,
Et l'esprit qui ricane auprès du cœur qui pleure !
Aussi vous me voyez souvent parlant tout bas ;
Et comme un mendiant, à la bouche affamée,
Qui rêve assis devant une porte fermée,
On dirait que j'attends quelqu'un qui n'ouvre pas.
Le doute ! mot funèbre et qu'en lettres de flammes,
Je vois écrit partout, dans l'aube, dans l'éclair,
Dans l'azur de ce ciel, mystérieux et clair,
Transparent pour les yeux, impénétrable aux âmes !
C'est notre mal à nous, enfants des passions
Dont l'esprit n'atteint pas votre calme sublime ;
A nous dont le berceau, risqué sur un abîme,
Vogua sur le flot noir des révolutions.
Les superstitions, ces hideuses vipères,
Fourmillent sous nos fronts où tout germe est flétri.
Nous portons dans nos cœurs le cadavre pourri
De la religion qui vivait dans nos pères.
Voilà pourquoi je vais, triste et réfléchissant,
Pourquoi souvent, la nuit, je regarde et j'écoute.
Solitaire, et marchant au hasard sur la route
A l'heure où le passant semble étrange au passant.
Heureux qui peut aimer, et qui dans la nuit noire,
Tout en cherchant la foi, peut rencontrer l'amour !
Il a du moins la lampe en attendant le jour.
Heureux ce cœur ! Aimer, c'est la moitié de croire.
Octobre 1834.
1835, puisque mai tout en fleurs...
Datée de mai 1835, cette pièce appartient aux Chants du crépuscule, où se mêlent singulièrement deux inspirations différentes, le culte du passé, des civilisations éteintes, des efforts brisés, des personnalités éteintes (A la colonne, Hymne, Napoléon II), et dans ce crépuscule mélancolique, une joie sereine à revivre les heures passées...
ici c'est encore sa grande passion pour Juliette Drouet qui le fait évoquer le souvenir d'une promenade à la campagne, dans la vallée de la Bièvre...
Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,
Viens! ne te lasse pas de mêler à ton âme
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants,
Le sentier qui finit où le chemin commence,
Et l’air et le printemps et l’horizon immense,
L’horizon que ce monde attache humble et joyeux
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux!
Viens! et que le regard des pudiques étoiles
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
Que l’arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs,
Et l’ombre et le soleil et l’onde et la verdure,
Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir, comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l’amour dans ton cœur!

1837 - "Les Voix intérieures"
"Savoir, penser, rêver. Tout est là.." - Le poète se fait l'écho "de ce chant qui répond en nous au chant que nous entendons hors de nous", mémoire du père, du frère, de sa femme et ses enfants, à laquelle répond le mystère de la nature et les événements de ce monde, le "Poème de l`Homme" à concevoir est cette "grande épopée mystérieuse dont nous avons tous un chant en nous-mêmes..."
"La Porcia de Shakespeare parle quelque part de cette musique que tout homme à en soi. - Malheur, dit-elle, à qui ne l'entend pas! - Cette musique, la nature aussi l'a en elle. Si le livre qu'on va lire est quelque chose, il est l'écho, bien confus et bien affaibli sans doute, mais fidèle, l'auteur le croit, de ce chant qui répond en nous au chant que nous entendons hors de nous.
Au reste, cet écho intime et secret étant, aux yeux de l'auteur, la poésie même, ce volume, avec quelques nuances nouvelles peut-être et les développements que le temps a amenés, ne fait que continuer ceux qui l'ont précédé. Ce qu'il contient, les autres le contenaient; à cette différence près que dans les Orientales, par exemple, la fleur serait plus épanouie, dans les Voix intérieures, la goutte de rosée ou de pluie serait plus cachée. La poésie, en supposant que ce soit ici le lieu de prononcer un si grand mot, la poésie est comme Dieu: une et inépuisable.
Si l'homme a sa voix, si la nature a la sienne, les événements ont aussi la leur. L'auteur a toujours pensé que la mission du poète était de fondre dans un même groupe de chants cette triple parole qui renferme un triple enseignement, car la première s'adresse plus particulièrement au coeur, la seconde à l'âme, la troisième à l'esprit. Tres radios.
Et puis, dans l'époque où nous vivons, tout l'homme ne se retrouve-t-il pas là? N'est-il pas entièrement compris sous ce triple aspect de notre vie: Le foyer, le champ, la rue? Le foyer, qui est notre coeur même; le champ, où la nature nous parle; la rue, ou tempête, à travers les coups de fouet des partis, cet embarras de charrettes qu'on appelle les événements politiques.
Et, disons-le en passant, dans cette mêlée d'hommes, de doctrines et d'intérêts qui se ruent si violemment tous les jours sur chacune des oeuvres qu'il est donné à ce siècle de faire, le poète a une fonction sérieuse. Sans parler même ici de son influence civilisatrice, c'est à lui qu'il appartient d'élever, lorsqu'ils le méritent, les événements politiques à la dignité d'événements historiques. Il faut, pour cela, qu'il jette sur ses contemporains ce tranquille regard que l'histoire jette sur le passé; il faut que, sans se laisser tromper aux illusions d'optique, aux mirages menteurs, aux voisinages momentanés, il mette dès à présent tout en perspective, diminuant ceci, grandissant cela. Il faut qu'il ne trempe dans aucune voie de fait. Il faut qu'il sache se maintenir, au-dessus du tumulte, inébranlable, austère et bienveillant; indulgent quelquefois, chose difficile, impartial toujours, chose plus difficile encore; qu'il ait dans le coeur cette sympathique intelligence des révolutions qui implique le dédain de l'émeute, ce grave respect du peuple qui s'allie au mépris de la foule; que son esprit ne concède rien aux petites colères ni petites vanités; que son éloge comme son blâme prenne souvent à rebours, tantôt l'esprit de cour, tantôt l'esprit de faction. Il faut qu'il puisse saluer le drapeau tricolore sans insulter les fleur de lys; il faut qu'il puisse dans le même livre, presque à la même page, flétrir "l'homme qui a vendu une femme" et louer un noble jeune prince pour une bonne action bien faite, glorifier la haute idée sculptée sur l'arc de l'Etoile et consoler la triste pensée enfermée dans la tombe de Charles X. Il faut qu'il soit attentif à tout, sincère en tout, désintéressé sur tout, et que, nous l'avons déjà dit ailleurs, il ne dépende de rien, pas même de ses propres ressentiments, pas même de ses griefs personnels; sachant être, dans l'occasion, tout à la fois irrité comme homme et calme comme poète. Il faut enfin que, dans ces temps livrés à la lutte furieuse des opinions, au milieu des attractions violentes que sa raison devra subir sans dévier, il ait sans cesse présent à l'esprit ce but sévère: être de tous les partis par leur côté généreux, n'être d'aucun par leur côté mauvais.
La puissance du poète est faite d'indépendance...." (24 juin 1837)
Après une Lecture de Dante
(6 août 1836)
Quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie:
Sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivie;
Forêt mystérieuse où ses pas effrayés
S'égarent à tâtons hors des chemins frayés;
Noir voyage obstrué de rencontres difformes;
Spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes,
Dont les cercles hideux vont toujours plus avant
Dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant!
Cette rampe se perd dans la bruine indécise;
Au bas de chaque marche une plainte est assise,
Et l'on y voit passer avec un faible bruit
Des grincements de dents blancs dans la sombre nuit.
Le masque grimaçant de la Haine qui souffre!
Là sont les visions, les rêves, les chimères;
Les yeux que la douleur change en sources amères,
L'amour, couple enlacé, triste, et toujours brûlant,
Qui dans un tourbillon passe une plaie au flanc;
Dans un coin la vengeance et la faim, soeurs impies,
Sur un crâne rongé côte à côte accroupies;
Puis la pâle misère au sourire appauvri;
L'ambition, l'orgueil, de soi-même nourri,
Et la luxure immonde, et l'avarice infâme,
Tous les manteaux de plomb dont peut se charger l'âme!
Plus loin, la lâcheté, la peur, la trahison
Offrant des clefs à vendre et goûtant du poison;
Et puis, plus bas encore, et tout au fond du gouffre,
Oui, c'est bien là la vie, ô poète inspiré,
Et son chemin brumeux d'obstacles encombré.
Mais, pour que rien n'y manque, en cette route étroite
Vous nous montrez toujours debout à votre droite
Le génie au front calme, aux yeux pleins de rayons,
Le Virgile serein qui dit: Continuons!
Ce siècle est grand et fort...
(15 avril 1837)
"Ce siècle est grand et fort. Un noble instinct le mène.
Partout on voit marcher l'Idée en mission;
Et le bruit du travail, plein de parole humaine,
Se mêle au bruit divin de la création.
Partout, dans les cités et dans les solitudes,
L'homme est fidèle au lait dont nous le nourrissions;
Et dans l'informe bloc des sombres multitudes
La pensée en rêvant sculpte des nations.
L'échafaud vieilli croule, et la Grève se lave.
L'émeute se rendort. De meilleurs jours sont prêts.
Le peuple a sa colère et le volcan sa lave
Qui dévaste d'abord et qui féconde après.
Des poètes puissants, tête par Dieu touchées,
Nous jettent les rayons de leurs fronts inspirés.
L'art a de frais vallon où les âmes penchées
Boivent la poésie à des ruisseaux sacrés.
Pierre à pierre, en songeant aux vieilles moeurs éteintes,
Sous la société qui chancelle à tous vents,
Le penseur reconstruit ces deux colonnes saintes,
Le respect des vieillards et l'amour des enfants.
Le devoir, fils du droit, sous nos toits domestiques
Habite comme un hôte auguste et sérieux.
Les mendiants groupés dans l'ombre des portiques
Ont moins de haine au coeur et moins de flamme aux yeux.
L'austère vérité n'a plus de portes closes.
Tout verbe est déchiffré. Notre esprit éperdu,
Chaque jour, en lisant dans le livre des choses,
Découvre à l'univers un sens inattendu.
O poètes! le fer et la vapeur ardente
Effacent de la terre, à l'heure où vous rêvez,
L'antique pesanteur, à tout objet pendante,
Qui sous les lourds essieux broyait les durs pavés.
L'homme se fait servir par l'aveugle matière.
Il pense, il cherche, il crée! A son souffle vivant
Les germes dispersés dans la nature entière
Tremblent comme frissonne une forêt au vent!
Oui, tout va, tout s'accroît. Les heures fugitives
Laissent toutes leur trace. Un grand siècle a surgi.
Et, contemplant de loin de lumineuses rives,
L'homme voit son destin comme un fleuve élargi.
Mais parmi ces progrès dont notre âge se vante,
Dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant,
Une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante,
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant."
Pendant que la fenêtre était ouverte
26 février 1837
Poète, ta fenêtre était ouverte au vent,
Quand celle à qui tout bas ton coeur parle souvent
Sur ton fauteuil posait sa tête:
-"Oh! disait-elle, ami, ne vous y fiez pas!
Parce que maintenant, attachée à vos pas,
Ma vie à votre ombre s'arrête;
Parce que mon regard est fixé sur vos yeux;
Parce que je n'ai plus de sourire joyeux
Que pour votre grave sourire;
Parce que, de l'amour me faisant un linceul,
Je vous offre mon coeur comme un livre où vous seul
Avez encor le droit d'écrire;
Il n'est pas dit qu'enfin je n'aurai pas un jour
La curiosité de troubler votre amour
Et d'alarmer votre oeil sévère,
Et l'inquiet caprice et le désir moqueur
De renverser soudain la paix de votre coeur
Comme un enfant renverse un verre!
Hommes, vous voulez tous qu'une femme ait longtemps
Des fiertés, des hauteurs, puis vous êtes contents,
Dans votre orgueil que rien ne brise,
Quand, aux feux de l'amour qui rayonne sur nous,
Pareille à ces fruits verts que le soleil fait doux,
La hautaine devient soumise!
Aimez-moi d'être ainsi! - Ces hommes, ô mon roi,
Que vous voyez passer si froids autour de moi,
Empressés près des autres femmes,
Je n'y veux pas songer, car le repos vous plaît;
Mais mon oeil endormi ferait, s'il le voulait,
De tous ces fronts jaillir des flammes!"
Elle parlait, charmante et fière et tendre encor,
Laissant sur le dossier de velours à clous d'or
Déborder sa manche traînante;
Et toi tu croyais voir à ce beau front si doux
Sourire ton vieux livre ouvert sur tes genoux,
Ton Iliade rayonnante!
Beau livre que souvent vous lisez tous les deux!
Elle aime comme toi ces combats hasardeux
Où la guerre agite ses ailes.
Femme, elle ne hait pas, en t'y voyant rêver,
Le poète qui chante Hélène, et fait lever
Les plus vieux devant les plus belles.
Elle vient là, du haut de ses jeunes amours,
Regarder quelquefois dans le flot des vieux jours
Quelle ombre y fait cette chimère;
Car, ainsi que d'un mont tombe de vivent eaux,
Le passé murmurant sort et coule à ruisseaux
De ton flanc, ô géant Homère!
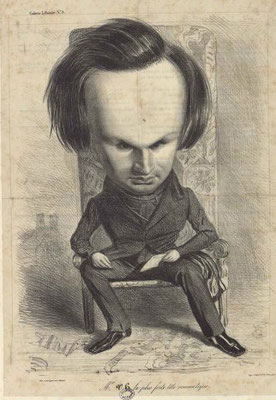

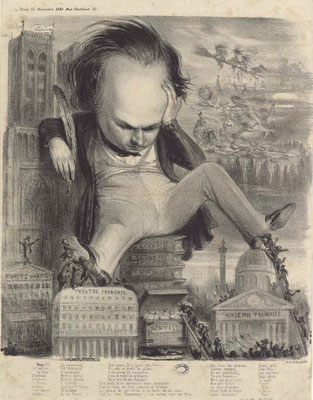
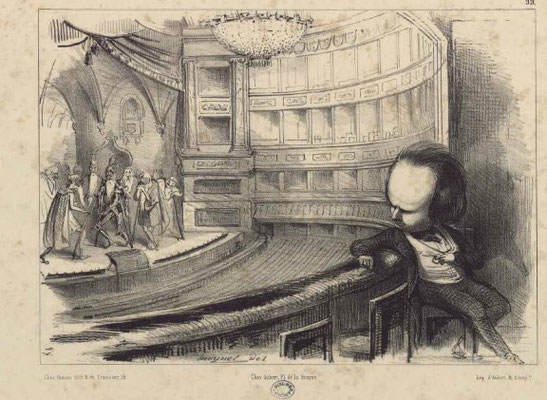
"Mr. V.H., la plus forte tête romantique" (Charivari, 12 octobre 1836) - "Panthéon charivarique" (La Mode, 24 décembre 1841) - "Les Bulos Graves" (La Caricature, avril 1843)...

1838 - Un drame romantique, "Ruy Blas"
Hugo fait jouer de nouveaux drames, "Le Roi s'amuse" (1832), "Lucrèce Borgia", "Marie Tudor" (1833), "Angela" (1835), puis en 1838, il quitte la prose pour la versification et donne son chef-d`œuvre, "Ruy Blas", période triomphale qui s'achèvera pourtant par l'échec de son dernier drame, "Les Burgraves" (1843) alors que le temps est à la tragédie néo-classique, telle la Lucrèce de Ponsard. L'intrigue de "Ruy Blas" - drame en 5 actes, nous sommes au XVIIe siècle, à la cour de Madrid -, est toute entière celle d'une obsession, l'obsession de Don Salluste de Bazan qui poursuit Maria de Neuborg, la Reine, responsable de sa disgrâce, d`une haine implacable. Don Salluste va utiliser le valet de Don César de Bazan, Ruy Blas, comme l'instrument de sa vengeance, un Ruy Blas désespérément amoureux de la reine : Don Salluste va présenter Ruy Blas à la cour sous le nom de Don César, alors disqualifié parce que livré aux mains des barbaresques, et lui ordonne de séduire une Reine étrangère qui s'ennuie loin des siens, cloîtrée dans son palais. Mais Ruy Blas s'impose au-delà de ce que pouvait espérer Don Salluste, mais au XIXe comme au XVIIe la relève du pouvoir d'État n'est pas possible par un héros sorti du peuple : le drame, qui connaît quelques scènes comiques - le fameux "mélange des genres" (incarnée par l'extraordinaire faconde de César de Bazan) -, s'achève avec la mort de Don Salluste, tué par un Ruy Blas qui avoue à la Reine toute la vérité et s'empoisonne pour mourir dans ses bras.... Le théâtre de Hugo est transfiguré par la poésie, il brosse de vastes fresques, la révolution d'Angleterre (Cromwell), la France sous Richelieu (Marion de Larme), l'Espagne de Charles Quint (Hernani), l'Espagne au bord de la décadence (Ruy Blas), le Moyen Age germanique, violent et grandiose (Les Burgraves), mais ses personnages ne connaissent pas le dilemme ou les conflits intérieurs, et l'on retient le plus souvent ses duos d'amour qui mêlent évocation de la nature et intimité des cœurs...
Acte III, Scène 2 : « Bon appétit » - Ruy Blas, premier ministre du roi d’Espagne, surprend les conseillers du roi en train de se partager les richesses du royaume. Il les écoute en silence, puis s’avance à pas lents et paraît au milieu d’eux au plus fort de la querelle...
"Bon appétit ! messieurs !
Tous se retournent. Silence de surprise et d’inquiétude. Ruy Blas se couvre, croise les bras, et poursuit en les regardant en face.
Ô ministres intègres !
Conseillers vertueux ! Voilà votre façon
De servir, serviteurs qui pillez la maison !
Donc vous n’avez pas honte et vous choisissez l’heure,
L’heure sombre où l’Espagne agonisante pleure !
Donc vous n’avez pas ici d’autres intérêts
Que remplir votre poche et vous enfuir après !
Soyez flétris, devant votre pays qui tombe,
Fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe !
— Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur.
L’Espagne et sa vertu, l’Espagne et sa grandeur,
Tout s’en va. — Nous avons, depuis Philippe Quatre,
Perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre ;
En Alsace Brisach, Steinfort en Luxembourg ;
et toute la Comté jusqu’au dernier faubourg ;
Le Roussillon, Ormuz, Goa, cinq mille lieues
De côte, et Fernambouc, et les Montagnes Bleues !
Mais voyez. — Du ponant jusques à l’orient,
L’Europe, qui vous hait, vous regarde en riant.
Comme si votre roi n’était plus qu’un fantôme,
La Hollande et l’Anglais partagent ce royaume ;
Rome vous trompe ; il faut ne risquer qu’à demi
Une armée en Piémont, quoique pays ami ;
La Savoie et son duc sont pleins de précipices ;
La France pour vous prendre, attend des jours propices ;
L’Autriche aussi vous guette. — Et l’infant bavarois
Se meurt, vous le savez. — Quant à vos vice-rois,
Médina, fou d’amour, emplit Naples d’esclandres,
Vaudémont vend Milan, Leganez perd les Flandres.
Quel remède à cela ? — L’état est indigent ;
L’état est épuisé de troupes et d’argent ;
Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères,
Perdu trois cents vaisseaux, sans compter les galères !
Et vous osez ! … — Messieurs, en vingt ans, songez-y,
Le peuple, — j’en ai fait le compte, et c’est ainsi ! —
Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie,
Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie,
Le peuple misérable, et qu’on pressure encor,
A sué quatre cent trente millions d’or !
Et ce n’est pas assez ! Et vous voulez, mes maîtres ! … —
Ah ! j’ai honte pour vous ! — Au dedans, routiers, reîtres,
Vont battant le pays et brûlant la moisson.
L’escopette est braquée au coin de tout buisson.
Comme si c’était peu de la guerre des princes,
Guerre entre les couvents, guerre entre les provinces,
Tous voulant dévorer leur voisin éperdu,
Morsures d’affamés sur un vaisseau perdu !
Notre église en ruine est pleine de couleuvres ;
L’herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d’œuvres.
Tout se fait par intrigue et rien par loyauté.
L’Espagne est un égout où vient l’impureté
De toute nation. — Tout seigneur à ses gages
A cent coupe-jarrets qui parlent cent langages.
Génois, Sardes, Flamands, Babel est dans Madrid.
L’alguazil, dur au pauvre, au riche s’attendrit.
La nuit on assassine et chacun crie : à l’aide !
— Hier on m’a volé, moi, près du pont de Tolède ! —
La moitié de Madrid pille l’autre moitié.
Tous les juges vendus ; pas un soldat payé.
Anciens vainqueurs du monde, Espagnols que nous sommes
Quelle armée avons-nous ? À peine six mille hommes.
Qui vont pieds nus. Des gueux, des juifs, des montagnards,
S’habillant d’une loque et s’armant de poignards.
Aussi d’un régiment toute bande se double.
Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble
Où le soldat douteux se transforme en larron.
Matalobos a plus de troupes qu’un baron.
Un voleur fait chez lui la guerre au roi d’Espagne.
Hélas ! Les paysans qui sont dans la campagne
Insultent en passant la voiture du roi ;
Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d’effroi,
Seul, dans l’Escurial, avec les morts qu’il foule,
Courbe son front pensif sur qui l’empire croule !
— Voilà ! — L’Europe, hélas ! écrase du talon
Ce pays qui fut pourpre et n’est plus que haillon !
L’État s’est ruiné dans ce siècle funeste,
Et vous vous disputez à qui prendra le reste !
Ce grand peuple espagnol aux membres énervés,
Qui s’est couché dans l’ombre et sur qui vous vivez,
Expire dans cet antre où son sort se termine,
Triste comme un lion mangé par la vermine !
— Charles-Quint, dans ces temps d’opprobre et de terreur,
Que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ?
Oh ! Lève-toi ! Viens voir ! — Les bons font place aux pires.
Ce royaume effrayant, fait d’un amas d’empires,
Penche… Il nous faut ton bras ! Au secours, Charles-Quint !
Car l’Espagne se meurt, car l’Espagne s’éteint !
Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde,
Soleil éblouissant qui faisait croire au monde
Que le jour désormais se levait à Madrid,
Maintenant, astre mort, dans l’ombre s’amoindrit,
Lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore,
Et que d’un autre peuple effacera l’aurore !
Hélas ! Ton héritage est en proie aux vendeurs.
Tes rayons, ils en font des piastres ! Tes splendeurs,
On les souille ! — ô géant ! Se peut-il que tu dormes ? —
On vend ton sceptre au poids ! Un tas de nains difformes
Se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi ;
Et l’aigle impérial, qui, jadis, sous ta loi,
Couvrait le monde entier de tonnerre et de flamme,
Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme !"

1840 - "Les Rayons et les Ombres"
Dernier recueil avant l'exil, Victor élargit ici sa vision méditant sur sa mission de poète et sur l'inspiration qui l'habite.
La fonction du poète...
Pourquoi t'exiler, ô poète,
Dans la foule où nous te voyons?
Que sont pour ton âme inquiète
Les partis, chaos sans rayons?
Dans leur atmosphère souillée
Meurt ta poésie effeuillée ;
Leur souffle égare ton encens.
Ton coeur, dans leurs luttes serviles,
Est comme ces gazons des villes
Rongés par les pieds des passants.
Dans les brumeuses capitales
N'entends−tu pas avec effroi,
Comme deux puissances fatales,
Se heurter le peuple et le roi?
De ces haines que tout réveille
À quoi bon emplir ton oreille,
Ô Poète, ô maître, ô semeur?
Tout entier au Dieu que tu nommes,
Ne te mêle pas à ces hommes
Qui vivent dans une rumeur!
Va résonner, âme épurée,
Dans le pacifique concert!
Va t'épanouir, fleur sacrée,
Sous les larges cieux du désert !
Ô rêveur, cherche les retraites,
Les abris, les grottes discrètes,
Et l'oubli pour trouver l'amour,
Et le silence, afin d'entendre
La voix d'en haut, sévère et tendre,
Et l'ombre, afin de voir le jour!
Va dans les bois! va sur les plages!
Compose tes chants inspirés
Avec la chanson des feuillages
Et l'hymne des flots azurés!
Dieu t'attend dans les solitudes ;
Dieu n'est pas dans les multitudes ;
L'homme est petit, ingrat et vain.
Dans les champs tout vibre et soupire.
La nature est la grande lyre,
Le poète est l'archet divin!
Sors de nos tempêtes, ô sage!
Que pour toi l'empire en travail,
Qui fait son périlleux passage
Sans boussole et sans gouvernail,
Soit comme un vaisseau qu'en décembre
Le pêcheur, du fond de sa chambre
Où pendent les filets séchés,
Entend la nuit passer dans l'ombre
Avec un bruit sinistre et sombre
De mâts frissonnants et penchés! ...
Tristesse d'Olympio...
En octobre 1837 HUGO retourne dans la vallée de la Bièvre, jusqu'à cette maison des Metz, près de Jouy, où il rejoignait Juliette Drouet durant l'automne de 1834 et 1835. Sa liaison avec Juliette se poursuit, heureuse et tendre, mais le poète pensait retrouver, grâce à ce pèlerinage d'amour, les tous premiers feux de la passion : mais c'est une poignante mélancolie qui l'étreint, ce retour sur les lieux des premiers émois souligne et la vanité des désirs de l'homme qui voudrait éterniser les instants de bonheur. Mais si la nature oublie, l'homme se souvient et ce frère intérieur du poète que campe le personnage d'OLYMPIO....
L'amour a réveillé en lui un personnage nouveau, un "demi-dieu, né dans la solitude, aux souffles confondus de l'orgueil, de la nature et de l'amour" qui s'en est venu méditer, un jour d'automne, les regrets s'opposent à la sereine indifférence de la nature, on retrouve le "Lac" de Lamartine, le "Souvenir" d'Alfred de Musset, "La Maison du berger" d'Alfred de Vigny...
"Les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas mornes.
Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes
Sur la terre étendu,
L'air était plein d'encens et les prés de verdures
Quand il revit ces lieux où par tant de blessures
Son coeur s'est répandu!
L'automne souriait ; les coteaux vers la plaine
Penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine ;
Le ciel était doré ;
Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme,
Disant peut−être à Dieu quelque chose de l'homme,
Chantaient leur chant sacré!
Il voulut tout revoir, l'étang près de la source,
La masure où l'aumône avait vidé leur bourse,
Le vieux frêne plié,
Les retraites d'amour au fond des bois perdues,
L'arbre où dans les baisers leurs âmes confondues
Avaient tout oublié!
Il chercha le jardin, la maison isolée,
La grille d'où l'oeil plonge en une oblique allée,
Les vergers en talus.
Pâle, il marchait. Au bruit de son pas grave et sombre,
Il voyait à chaque arbre, hélas! se dresser l'ombre
Des jours qui ne sont plus!
Il entendait frémir dans la forêt qu'il aime
Ce doux vent qui, faisant tout vibrer en nous−même,
Y réveille l'amour,
Et, remuant le chêne ou balançant la rose,
Semble l'âme de tout qui va sur chaque chose
Se poser tour à tour!
Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire,
S'efforçant sous ses pas de s'élever de terre,
Couraient dans le jardin ;
Ainsi, parfois, quand l'âme est triste, nos pensées
S'envolent un moment sur leurs ailes blessées,
Puis retombent soudain.
Il contempla longtemps les formes magnifiques
Que la nature prend dans les champs pacifiques ;
Il rêva jusqu'au soir ;
Tout le jour il erra le long de la ravine,
Admirant tour à tour le ciel, face divine,
Le lac, divin miroir!
Hélas! se rappelant ses douces aventures,
Regardant, sans entrer, par−dessus les clôtures,
Ainsi qu'un paria,
Il erra tout le jour. Vers l'heure où la nuit tombe,
Il se sentit le coeur triste comme une tombe,
Alors il s'écria :
" Ô douleur! j'ai voulu, moi dont l'âme est troublée,
Savoir si l'urne encor conservait la liqueur,
Et voir ce qu'avait fait cette heureuse vallée
De tout ce que j'avais laissé là de mon coeur!
" Que peu de temps suffit pour changer toutes choses!
Nature au front serein, comme vous oubliez!
Et comme vous brisez dans vos métamorphoses
Les fils mystérieux où nos coeurs sont liés!
" Nos chambres de feuillage en halliers sont changées!
L'arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé ;
Nos roses dans l'enclos ont été ravagées
Par les petits enfants qui sautent le fossé!
" Un mur clôt la fontaine où, par l'heure échauffée,
Folâtre, elle buvait en descendant des bois ;
Elle prenait de l'eau dans sa main, douce fée,
Et laissait retomber des perles de ses doigts!
On a pavé la route âpre et mal aplanie,
Où, dans le sable pur se dessinant si bien,
Et de sa petitesse étalant l'ironie,
Son pied charmant semblait rire à côté du mien!
" La borne du chemin, qui vit des jours sans nombre,
Où jadis pour m'attendre elle aimait à s'asseoir,
S'est usée en heurtant, lorsque la route est sombre,
Les grands chars gémissants qui reviennent le soir.
" La forêt ici manque et là s'est agrandie.
De tout ce qui fut nous presque rien n'est vivant ;
Et, comme un tas de cendre éteinte et refroidie,
L'amas des souvenirs se disperse à tout vent!
" N'existons−nous donc plus? Avons−nous eu notre heure?
Rien ne la rendra−t−il à nos cris superflus?
L'air joue avec la branche au moment où je pleure ;
Ma maison me regarde et ne me connaît plus.
" D'autres vont maintenant passer où nous passâmes.
Nous y sommes venus, d'autres vont y venir ;
Et le songe qu'avaient ébauché nos deux âmes,
Ils le continueront sans pouvoir le finir!
" Car personne ici−bas ne termine et n'achève ;
Les pires des humains sont comme les meilleurs ;
Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve.
Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs..."
Du 24 au 29 juin 1839, "Regard jeté dans une mansarde", Victor Hugo regarde, à travers la lucarne d'une mansarde, une jeune fille du peuple, une ouvrière, dont le mouchoir est pudiquement noué, dont le regard est timide ; il lui conseille d'être gaie, laborieuse, et trace d'elle ce portrait délicat, Sur son beau col, empreint de virginité pur....
I.
L’ÉGLISE est vaste et haute. À ses clochers superbes
L’ogive en fleur suspend ses trèfles et ses gerbes ;
Son portail resplendit, de sa rose pourvu ;
Le soir fait fourmiller sous la voussure énorme
Anges, vierges, le ciel, l’enfer sombre et difforme,
Tout un monde effrayant comme un rêve entrevu.
Mais ce n’est pas l’église, et ses voûtes, sublimes,
Ses porches, ses vitraux, ses lueurs, ses abîmes,
Sa façade et ses tours, qui fascinent mes yeux ;
Non ; c’est, tout près, dans l’ombre où l’âme aime à descendre
Cette chambre d’où sort un chant sonore et tendre,
Posée au bord d’un toit comme un oiseau joyeux.
Oui, l’édifice est beau, mais cette chambre est douce.
J’aime le chêne altier moins que le nid de mousse ;
J’aime le vent des prés plus que l’âpre ouragan ;
Mon cœur, quand il se perd vers les vagues béantes,
Préfère l’algue obscure aux falaises géantes.
Et l’heureuse hirondelle au splendide océan.
II.
Frais réduit ! à travers une claire feuillée
Sa fenêtre petite et comme émerveillée
S’épanouit auprès du gothique portail.
Sa verte jalousie à trois clous accrochée,
Par un bout s’échappant, par l’autre rattachée,
S’ouvre coquettement comme un grand éventail.
Au-dehors un beau lys, qu’un prestige environne,
Emplit de sa racine et de sa fleur couronne
– Tout près de la gouttière où dort un chat sournois –
Un vase à forme étrange en porcelaine bleue
Où brille, avec des paons ouvrant leur large queue,
Ce beau pays d’azur que rêvent les Chinois.
Et dans l’intérieur par moments luit et passe
Une ombre, une figure, une fée, une grâce,
Jeune fille du peuple au chant plein de bonheur,
Orpheline, dit-on, et seule en cet asile,
Mais qui parfois a l’air, tant son front est tranquille,
De voir distinctement la face du Seigneur.
On sent, rien qu’à la voir, sa dignité profonde.
De ce cœur sans limon nul vent n’a troublé l’onde.
Ce tendre oiseau qui jase ignore l’oiseleur.
L’aile du papillon a toute sa poussière.
L’âme de l’humble vierge a toute sa lumière.
La perle de l’aurore est encor dans la fleur.
À l’obscure mansarde il semble que l’œil voie
Aboutir doucement tout un monde de joie,
La place, les passants, les enfants, leurs ébats,
Les femmes sous l’église à pas lents disparues,
Des fronts épanouis par la chanson des rues,
Mille rayons d’en haut, mille reflets d’en bas.
Fille heureuse ! autour d’elle ainsi qu’autour d’un temple,
Tout est modeste et doux, tout donne un bon exemple.
L’abeille fait son miel, la fleur rit au ciel bleu,
La tour répand de l’ombre, et, devant la fenêtre,
Sans faute, chaque soir, pour obéir au maître,
L’astre allume humblement sa couronne de feu.
Sur son beau col, empreint de virginité pure,
Point d’altière dentelle ou de riche guipure ;
Mais un simple mouchoir noué pudiquement.
Pas de perle à son front, mais aussi pas de ride,
Mais un œil chaste et vif, mais un regard limpide.
Où brille le regard que sert le diamant ?
III.
L’angle de la cellule abrite un lit paisible.
Sur la table est ce livre où Dieu se fait visible,
La légende des saints, seul et vrai panthéon.
Et dans un coin obscur, près de la cheminée,
Entre la bonne Vierge et le buis de l’année,
Quatre épingles au mur fixent Napoléon.
Cet aigle en cette cage ! – et pourquoi non ? dans l’ombre
De cette chambre étroite et calme, où rien n’est sombre,
Où dort la belle enfant, douce comme son lys,
Où tant de paix, de grâce et de joie est versée,
Je ne hais pas d’entendre au fond de ma pensée
Le bruit des lourds canons roulant vers Austerlitz.
Et près de l’empereur devant qui tout s’incline,
– Ô légitime orgueil de la pauvre orpheline ! –
Brille une croix d’honneur, signe humble et triomphant,
Croix d’un soldat, tombé comme tout héros tombe,
Et qui, père endormi, fait du fond de sa tombe
Veiller un peu de gloire auprès de son enfant.
IV.
Croix de Napoléon ! joyau guerrier ! pensée !
Couronne de laurier de rayons traversée !
Quand il menait ses preux aux combats acharnés,
Il la laissait, afin de conquérir la terre,
Pendre sur tous les fronts durant toute la guerre ;
Puis, la grande œuvre faite, il leur disait : Venez !
Puis il donnait sa croix à ces hommes stoïques,
Et des larmes coulaient de leurs yeux héroïques ;
Muets, ils admiraient leur demi-dieu vainqueur ;
On eût dit qu’allumant leur âme avec son âme,
En touchant leur poitrine avec son doigt de flamme,
Il leur faisait jaillir cette étoile du cœur !
V.
Le matin elle chante et puis elle travaille,
Sérieuse, les pieds sur sa chaise de paille,
Cousant, taillant, brodant quelques dessins choisis ;
Et, tandis que, songeant à Dieu, simple et sans crainte,
Cette vierge accomplit sa tâche auguste et sainte,
Le silence rêveur à sa porte est assis.
Ainsi, Seigneur, vos mains couvrent cette demeure.
Dans cet asile obscur, qu’aucun souci n’effleure,
Rien qui ne soit sacré, rien qui ne soit charmant !
Cette âme, en vous priant pour ceux dont la nef sombre,
Peut monter chaque soir vers vous sans faire d’ombre
Dans la sérénité de votre firmament !
Nul danger ! nul écueil ! – Si ! l’aspic est dans l’herbe !
Hélas ! hélas ! le ver est dans le fruit superbe !
Pour troubler une vie il suffit d’un regard.
Le mal peut se montrer même aux clartés d’un cierge.
La curiosité qu’a l’esprit de la vierge
Fait une plaie au cœur de la femme plus tard.
Plein de ces chants honteux, dégoût de la mémoire,
Un vieux livre est là-haut sur une vieille armoire,
Par quelque vil passant dans cette ombre oublié ;
Roman du dernier siècle ! œuvre d’ignominie !
Voltaire alors régnait, ce singe de génie
Chez l’homme en mission par le diable envoyé.
VI.
Epoque qui gardas, de vin, de sang rougie,
Même en agonisant, l’allure de l’orgie !
Ô dix-huitième siècle, impie et châtié !
Société sans dieu, par qui Dieu fus frappée !
Qui, brisant sous la hache et le sceptre et l’épée,
Jeune offensas l’amour, et vieille la pitié !
....

Victor Hugo, les années 1840 - En 1841, il est élu membre de l'Académie française. En 1842, il publie "le Rhin", son premier récit de voyages; et, en 1843, c'est l'échec des "Burgraves", le dernier drame qu'il ait fait représenter. Cet échec, puis, quelques mois après, la mort tragique de sa fille Léopoldine qui se noya dans la Seine avec son mari Charles Vacquerie, enfin et surtout le désir qui lui était venu de jouer un rôle politique, interrompirent alors sa vie littéraire. Il n'était pas encore républicain, mais il était profondément libéral. Louis- Philippe le nomma pair de France en 1845, et à la Chambre des pairs il prononça trois ou quatre discours; mais ce n'est qu'après la révolution de 1845, et à partir du moment où il combattit pour les idées républicaines (fin 1849), qu'il réussit â se faire dans les luttes des partis (il était député) une place à peu près digne de ses aspirations....
(gravure: Victor Hugo et ses principaux partisans en 1842)
1840, La Fête chez Thérèse...
Le manuscrit est daté du 16 février 1840, cette pièce est la 22e du premier livre (Aurore) dans la première partie des "Contemplations", qui porte le titre général "Autrefois" (1830-1843). Thérèse est sans doute Mme Biard, amie du poète, qui avait une propriété près de Fontainebleau, les Plâteries, où elle recevait beaucoup. La fête dont il est question se situe en avril 1839, c'est un tableau à la manière de Watteau, une évocation de personnages de la comédie italienne, qu'on retrouvera chez Théophile Gautier...
La chose fut exquise et fort bien ordonnée.
C’était au mois d’avril, et dans une journée
Si douce, qu’on eût dit qu’amour l’eût faite exprès.
Thérèse la duchesse à qui je donnerais,
Si j’étais roi, Paris, si j’étais Dieu, le monde,
Quand elle ne serait que Thérèse la blonde ;
Cette belle Thérèse, aux yeux de diamant,
Nous avait conviés dans son jardin charmant.
On était peu nombreux. Le choix faisait la fête.
Nous étions tous ensemble et chacun tête à tête.
Des couples pas à pas erraient de tous côtés.
C’étaient les fiers seigneurs et les rares beautés,
Les Amyntas rêvant auprès des Léonores,
Les marquises riant avec les monsignores ;
Et l’on voyait rôder dans les grands escaliers
Un nain qui dérobait leur bourse aux cavaliers.
A midi, le spectacle avec la mélodie.
Pourquoi jouer Plautus la nuit ? La comédie
Est une belle fille, et rit mieux au grand jour.
Or, on avait bâti, comme un temple d’amour,
Près d’un bassin dans l’ombre habité par un cygne,
Un théâtre en treillage où grimpait une vigne.
Un cintre à claire-voie en anse de panier,
Cage verte où sifflait un bouvreuil prisonnier,
Couvrait toute la scène, et, sur leurs gorges blanches,
Les actrices sentaient errer l’ombre des branches.
On entendait au loin de magiques accords ;
Et, tout en haut, sortant de la frise à mi-corps,
Pour attirer la foule aux lazzis qu’il répète,
Le blanc Pulcinella sonnait de la trompette.
Deux faunes soutenaient le manteau d’Arlequin ;
Trivelin leur riait au nez comme un faquin.
Parmi les ornements sculptés dans le treillage,
Colombine dormait dans un gros coquillage,
Et, quand elle montrait son sein et ses bras nus,
On eût cru voir la conque, et l’on eût dit Vénus.
Le seigneur Pantalon, dans une niche, à droite,
Vendait des limons doux sur une table étroite,
Et criait par instants : » Seigneurs, l’homme est divin.
Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin ! »
Scaramouche en un coin harcelait de sa batte
Le tragique Alcantor, suivi du triste Arbate
Crispin, vêtu de noir, jouait de l’éventail ;
Perché, jambe pendante, au sommet du portail,
Carlino se penchait, écoutant les aubades,
Et son pied ébauchait de rêveuses gambades.
Le soleil tenait lieu de lustre ; la saison
Avait brodé de fleurs un immense gazon,
Vert tapis déroulé sous maint groupe folâtre.
Rangés des deux côtés de l’agreste théâtre,
Les vrais arbres du parc, les sorbiers, les lilas,
Les ébéniers qu’avril charge de falbalas,
De leur sève embaumée exhalant les délices,
Semblaient se divertir à faire les coulisses,
Et, pour nous voir, ouvrant leurs fleurs comme des yeux,
Joignaient aux violons leur murmure joyeux ;
Si bien qu’à ce concert gracieux et classique,
La nature mêlait un peu de sa musique.
Tout nous charmait, les bois, le jour serein, l’air pur,
Les femmes tout amour, et le ciel tout azur.
Pour la pièce, elle était fort bonne, quoique ancienne.
C’était, nonchalamment assis sur l’avant-scène,
Pierrot qui haranguait, dans un grave entretien,
Un singe timbalier à cheval sur un chien.
Rien de plus. C’était simple et beau. – Par intervalles,
Le singe faisait rage et cognait ses timbales ;
Puis Pierrot répliquait. – Ecoutait qui voulait.
L’un faisait apporter des glaces au valet ;
L’autre, galant drapé d’une cape fantasque,
Parlait bas à sa dame en lui nouant son masque ;
Trois marquis attablés chantaient une chanson ;
Thérèse était assise à l’ombre d’un buisson :
Les roses pâlissaient à côté de sa joue,
Et, la voyant si belle, un paon faisait la roue.
Moi, j’écoutais, pensif, un profane couplet
Que fredonnait dans l’ombre un abbé violet.
La nuit vint, tout se tut ; les flambeaux s’éteignirent ;
Dans les bois assombris les sources se plaignirent ;
Le rossignol, caché dans son nid ténébreux,
Chanta comme un poète et comme un amoureux.
Chacun se dispersa sous les profonds feuillages ;
Les folles en riant entraînèrent les sages ;
L’amante s’en alla dans l’ombre avec l’amant ;
Et, troublés comme on l’est en songe, vaguement,
Ils sentaient par degrés se mêler à leur âme,
A leurs discours secrets, à leurs regards de flamme,
A leur cœur, à leurs sens, à leur molle raison,
Le clair de lune bleu qui baignait l’horizon. »


1843 - La mort de Léopoldine
L'année 1843, le 4 septembre, sera pour Victor Hugo un tournant décisif et tragique : Léopoldine, sa fille aînée, 19 ans et mariée depuis quelques mois, se noie avec son mari, Charles Vacquerie, près de Rouen, au cours d'une promenade en barque. Pendant dix ans, Hugo plongera dans un silence douloureux, une douleur qu'il tentera d'exorciser dans quelques poèmes qu'il ne pourra publier que seize ans plus tard, dans Les Contemplations...
Le quatrième livre des Contemplations (Pauca meae) contient dix-sept poèmes écrits en souvenir de Léopoldine où s'expriment tour à tour les sentiments du père, l'abattement, le désespoir, la résignation (A Villequier), le souvenir de l'enfant ou de la jeune fille tant aimée, avec une simplicité du ton qui ne peut laisser indifférent ("L'heure est pour tous une chose incomplète; L'heure est une ombre, et notre vie, enfant, En est faite")....
"Ô souvenirs ! printemps ! aurore !
Doux rayon triste et réchauffant !
– Lorsqu’elle était petite encore,
Que sa sœur était tout enfant… –
Connaissez-vous sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu,
Une terrasse qui s’incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu ?
– C’est là que nous vivions. – Pénètre,
Mon cœur, dans ce passé charmant ! –
Je l’entendais sous ma fenêtre
Jouer le matin doucement.
Elle courait dans la rosée,
Sans bruit, de peur de m’éveiller ;
Moi, je n’ouvrais pas ma croisée,
De peur de la faire envoler.
Ses frères riaient… – Aube pure !
Tout chantait sous ces frais berceaux,
Ma famille avec la nature,
Mes enfants avec les oiseaux ! –
Je toussais, on devenait brave ;
Elle montait à petits pas,
Et me disait d’un air très grave :
« J’ai laissé les enfants en bas. »
Qu’elle fût bien ou mal coiffée,
Que mon cœur fût triste ou joyeux,
Je l’admirais. C’était ma fée,
Et le doux astre de mes yeux !
Nous jouions toute la journée.
Ô jeux charmants ! chers entretiens !
Le soir, comme elle était l’aînée,
Elle me disait : « Père, viens !
Nous allons t’apporter ta chaise,
Conte-nous une histoire, dis ! » –
Et je voyais rayonner d’aise
Tous ces regards du paradis.
Alors, prodiguant les carnages,
J’inventais un conte profond
Dont je trouvais les personnages
Parmi les ombres du plafond.
Toujours, ces quatre douces têtes
Riaient, comme à cet âge on rit,
De voir d’affreux géants très bêtes
Vaincus par des nains pleins d’esprit.
J’étais l’Arioste et l’Homère
D’un poème éclos d’un seul jet ;
Pendant que je parlais, leur mère
Les regardait rire, et songeait.
Leur aïeul, qui lisait dans l’ombre,
Sur eux parfois levait les yeux,
Et, moi, par la fenêtre sombre
J’entrevoyais un coin des cieux ! "
(Villequier, 4 septembre 1846)

1848 - Victor Hugo, élu député
"Les représentants représentés" (Charivari du 20 juillet 1849) - L'évolution de Victor Hugo du catholicisme et du monarchisme vers une pensée libérale et sociale (la compassion pour le petit peuple) est perceptible dans toute son œuvre, mais c'est dans ses romans qu'elle transparaît le plus clairement ("Notre-Dame de Paris", qui met en scène un couple devenu mythique, Quasimodo et Esmeralda, en porte nettement témoignage à partir de 1831). Quittant, après le drame de sa vie, pour un temps le monde littéraire pour le terrain politique, c'est toujours animé de la même énergie qu'il se tourne malgré ses réserves vers Louis-Philippe, sans doute conquis par la jeune duchesse d'Orléans, admiratrice enthousiaste de son œuvre. Victor Hugo soutient alors le prince hériter, mais la mort du duc d`Orléans (1842) met fin à cette première étape dans un parcours politique au cours duquel il est nommé pair de France en 1845, intervient à la chambre haute en faveur de la Pologne, s'oppose à la peine de mort et à l'injustice sociale, et tente, en vain, en 1848, de faire proclamer la régence de la duchesse d'Orléans. Député de Paris à l'Assemblée Constituante puis à l'Assemblée Législative, après avoir fait soutenir par le journal de ses fils, l'Événement, la candidature de Lamartine, Hugo se montre partisan résolu du prince Louis-Napoléon, fort d'une légende napoléonienne à la construction de laquelle il participe depuis les Chants du Crépuscule...
