- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Victor Hugo (1802-1885) - Victor Hugo (1802-1885) - "Les Châtiments" (1852) - "La légende des siècles" (1859) - "Les Misérables" (1862) - "Dieu" (1889)......
Last update : 09/09/2018

Victor Hugo, Choses vues - janvier 1849, 1849 désappointé tourne le dos à 1848, Les révolutions pâlissent et semblent partout s'éteindre à la surface, mais un souffle profond remue toujours les peuples ...
"Le premier mois de la présidence de Louis Bonaparte s'écoule. Voici quelle est la figure de ce moment : Il y a maintenant des bonapartistes de la veille. Mme la duchesse d'Orléans habite, à Ems, avec ses deux enfants, une petite maison où elle vit pauvrement et royalement.. MM. Jules Favre, Billault et Carteret font une cour - politique - à Mme la princesse Mathilde Demidoff. Toutes les idées de février sont remises en question les unes après les autres, 1849 désappointé tourne le dos à 1848. Les généreux veulent l'amnistie, les sages veulent le désarmement. L'Assemblée constituante est furieuse d'agoniser. M. Guizot publie son livre "de la Démocratie en France", Louis-Philippe est à Londres, Pie IX est à Gaëte, M. Barrot est au pouvoir, la bourgeoisie a perdu Paris, le catholicisme a perdu Rome. Le ciel est pluvieux et triste avec un rayon de soleil de temps en temps. Mlle Ozy se montre toute nue dans le rôle d'Eve à la Porte-Saint-Martin, Frederick Lemaître y joue l'Auberge des Adrets. Le cinq est à soixante-quatorze, les pommes de terre coûtent huit sous le boisseau, on a un brochet pour vingt sous à la Halle. M. Ledru-Rollin pousse à la guerre , M. Proudhon pousse à la banqueroute. Le général Cavaignac assiste en gilet gris aux séances de l'Assemblée et passe son temps à regarder les femmes des tribunes avec de grosses jumelles d'ivoire. M. de Lamartine reçoit vingt-cinq mille francs pour son Toussaint-Louverture. Louis Bonaparte donne de grands dîners à M.Thiers qui l'a fait prendre et à M. Mole qui l'a fait condamner. Vienne, Milan, Berlin se calment. Les révolutions pâlissent et semblent partout s'éteindre à la surface, mais un souffle profond remue toujours les peuples. Le roi de Prusse s'apprête à ressaisir son sceptre et l'empereur de Russie à tirer son épée. Il y a eu un tremblement de terre au Havre j le choléra est à Fécamp; Arnal quitte le Gymnase, et l'Académie nomme M. le duc de Noailles à la place de Chateaubriand...."
Est-ce que nous allons faire une république où l'on n'écrira plus, où l'on ne pensera plus...
"Un soir de la fin de février 1849 je sortais de l'Assemblée avec Paul Foucher. Il faisait nuit. Les réverbères étaient allumés place Louis XV. Comme nous passions devant l'obélisque, une voix cria derrière nous : - Foucher! Foucher!
Et quelqu'un nous rejoignit.
C'était un homme de petite taille, vêtu d'une redingote brune, chevelu, barbu, hérissé, noir. Cet homme prit le bras de Paul.
— Bonsoir, dit-il, vous sortez de la Chambre, moi aussi. Conçoit-on ces animaux? Ils ont crié : Vive la République! parce qu'on a voté l'amendement Leroux contre l'adultère. Qu'a de commun la République avec les cocus . Je ne blague pas, la loi veut qu'on respecte la République, la bible veut qu'on respecte les maris. Mais pourquoi crier Vive la République à propos de cela? Moi, je suis rouge, mais je ne suis pas bête. Ah! que tout ce monde-là est farce! Vrai, on est bête de tous les côtés. Croiriez-vous que le préfet de police, un être qui s'appelle Rébillot, m'a fait venir et m'a dit : - Vous êtes accusé d'avoir caché le 29 janvier deux cents mobiles dans les bureaux de la Réforme! - Un préfet de police, un mouchard en chef, qui devrait savoir les choses, dire des bêtises pareilles! Est-ce assez énorme! Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit : - Sachez que je suis rédacteur d'un journal qui a toujours conspiré avant le 24 février, jamais après! Et puis je suis un meilleur ami du président que vous, je veux la République, moi, et je conseille à Louis Bonaparte l'amnistie. Il ferait aimer son gouvernement, il se réconcilierait avec le peuple. Oui, je veux la République, j'aime la révolution de février. On se trompe si l'on croit qu'on nous la retirera des griffes. Nous la tenons, nous ne la lâcherons pas. Il y a une chose qui me fâche pourtant, c'est que la République jusqu'ici a nui aux arts et aux choses de l'intelligence. Nous avions un magnifique mouvement français, qui était devenu un mouvement européen, toutes les idées étaient en marche, la poésie en tête. Cela s'est arrêté. Je suis de ceux que ça désole. Pardi! on peut bien être une république et rester la France ! Est-ce que nous allons faire une république où l'on n'écrira plus, où l'on ne pensera plus, où l'on ne fera plus de vers, où l'on sera très bête! C'est l'idéal des crétins, ce n'est pas le mien. Je veux donc que la République soit lettrée, et je veux qu'elle soit clémente. Et puis il faut s'occuper du peuple. Savez-vous qu'ils ont faim dans les faubourgs . Savez-vous qu'ils ne sont pas contents par là. Ils grognent. Un beau matin ils se lèveront et ils recommenceront, savez-vous ça, et juin ne sera qu'une torgnolle en comparaison! Ils ont très faim et très froid, ces pauvres gens. Il faudrait gouverner de leur côté. Autrement on donnera raison au citoyen Proudhon. Je me fiche du citoyen Proudhon quant à moi. Il ne me mangera pas, mais si l'on n'y prend garde, il mangera les bourgeois! Je me résume, je veux que l'idée marche, sacrebleu!
Sur ce sacrebleu, tout aussi énergique que ceux de Caussidière, notre compagnon nous quitta. Pendant ce monologue que j'écoutais en silence et que Paul coupait de monosyllabes approbatifs, nous avions suivi la rue de Rivoli, traversé la place Vendôme, et nous étions arrivés au coin de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Notre homme prit la main de Paul, me salua, et s'en alla. C'était le citoyen Ribeyrolles, rédacteur en chef de la Réforme où il avait remplacé le citoyen Flocon...." (Choses vues)
26 avril 1849. Depuis quelques jours la situation redevient obscure...
"Il y a un an, M. Louis Blanc gouvernait la France, lui onzième, il entrait dans la salle des séances de la Chambre des pairs précédé des huissiers et du capitaine de la garde du Luxembourg l'épée nue, au milieu des applaudissements, des acclamations et des extases des six cents ouvriers qui siégeaient sur les bancs des législateurs, dans les rues, dans les cours, des hommes lui baisaient les mains; il s'asseyait dans la grande chaise de velours vert du chancelier, le fauteuil le plus élevé de France après le trône, et chaque mot qui tombait de sa bouche soulevait la foule et agitait l'Europe remise en question. Hier le nom de Louis Blanc, condamné contumace de la haute cour de Bourges, a été cloué en place publique par le bourreau sur le poteau du carcan.
Depuis quelques jours la situation redevient obscure, les faubourgs fermentent, les clubs électoraux font bouillir les masses, les fourmillements nocturnes recommencent porte Saint-Denis et porte Saint-Martin, on fait beaucoup d'arrestations; ce qui préoccupe les commissaires de police, c'est que tous les hommes arrêtés ont sur eux des armes cachées, poignards ou pistolets..."
Juin 1850.
"Le gouvernement a trouvé un moyen d'empêcher les révolutions. Il s'est dit : les révolutions naissent des barricades et les barricades naissent des pavés. - Il macadamise les boulevards et le faubourg Saint-Antoine.
Voilà donc à quoi se résout désormais la politique du gouvernement : une moitié de l'année en poussière et l'autre moitié en boue."
1850.
"Lois d'état de siège, lois de censure, lois de clôture, lois de compression, lois d'étouffement, lois pour l'ignorance publique, lois de déportation et de transportation, lois contre le suffrage universel, lois contre la presse. Ils disent : faisons de l'ordre.
Pour eux la camisole de force s'appelle le calme.."

Victor Hugo - les années 1850-1860 - Le coup d'Etat du 2 décembre 1851, qui le remplit d'une juste indignation, ou plutôt d'une de ces fureurs vengeresses qu'on rencontre de loin en loin dans l'histoire littéraire, l'exila ; mais «désastre pour son ambition, ce fut un coup de fortune pour son génie» (Fernand Gregh). Il se fût peut-être usé dans la politique. « Il fut haussé tout à coup sur un piédestal, qui le grandissait même à ses propres yeux, cloué sur un rocher comme Prométhée, confiné dans une île comme Napoléon...». Après un séjour de quelques mois à Bruxelles, c'est en effet, à Jersey, puis à Guernesey, qu'il passa les dix-huit années d'un exil devenu volontaire après l'amnistie impériale de 1859; années qui nous valurent d'ailleurs une suite d'incomparables oeuvres : "les Châtiments" (1853), recueil lyrique, qu'avait précédé le pamphlet de "Napoléon le Petit"; "les Contemplations" (1856), autre recueil lyrique et le plus considérable, comme le plus émouvant, de tous ceux qu'avait donnés Victor Hugo ; la première partie de "la Légende des. siècles" (1859), recueil épique, sans égal dans notre littérature ; le vaste et merveilleux roman social "les Misérables" (1862) ; "William Shakespeare, étude littéraire" (1864) ; "les Chansons des rues des bois" (1865); et, encore, deux romans : "les Travailleurs de la mer" (1866) et "l'Homme qui rit" (1869).

1852 - Le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte - "Les Châtiments"
Le coup d'État du 2 décembre 1852 et la confiscation du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, un homme que Victor Hugo a soutenu, le plongent dans une condamnation sans concession qui le force à l'exil. Exil à Bruxelles (1851-52) où il rédige un récit virulent, l'Histoire d'un crime (qui ne paraîtra qu'en 1877), et le chef d'oeuvre du pamphlet politique, "Napoléon le Petit"....
"Il est temps que la conscience humaine se réveille. Depuis le 2 décembre 1851, un guet-apens réussi, un crime odieux, repoussant, infâme, inouï, si l’on songe au siècle où il a été commis, triomphe et domine, s’érige en théorie, s’épanouit à la face du soleil, fait des lois, rend des décrets, prend la société, la religion et la famille sous sa protection, tend la main aux rois de l’Europe, qui l’acceptent, et leur dit : mon frère ou mon cousin. Ce crime, personne ne le conteste, pas même ceux qui en profitent et qui en vivent, ils disent seulement qu’il a été « nécessaire » ; pas même celui qui l’a commis, il dit seulement, que, lui criminel, il a été « absous ». Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la conception, le parjure dans l’exécution, le meurtre et l’assassinat dans la lutte, la spoliation, l’escroquerie et le vol dans le triomphe ; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes de lui-même, la suppression des lois, la violation des inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante mille familles ruinées et désespérées. Ces choses sont patentes. Eh bien ! ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime ; il est là, on le touche, on le voit, on passe outre et l’on va à ses affaires ; la boutique ouvre, la Bourse agiote, le commerce, assis sur son ballot, se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l’on va trouver cela tout simple...."

LE ROCHER DES PROSCRITS A JERSEY
Victor Hugo débarqua le 5 août 1852 à Jersey et fut reçu à son arrivée par le groupe des proscrits français qui l'attendaient sur le quai de Saint-Hélier. Il loua au bord de la mer une maison isolée connue sous le nom de Marine-Terrace, une sorte de cottage à toit plat; un seul étage, des balcons et des terrasses, un jardin; l'océan mugissait au pied de cette modeste demeure ...
"L'exil, c'est la nudité du droit. Rien de plus terrible. Pour qui ? Pour celui qui subit l'exil ? Non, pour celui qui l'inflige. Le supplice se retourne et mord le bourreau.
Un rêveur qui se promène seul sur une grève, un désert autour d'un songeur, une tête vieillie et tranquille autour de laquelle tournent des oiseaux de tempête, étonnés, l'assiduité d'un philosophe au lever rassurant du matin, Dieu pris à témoin de temps en temps en présence des rochers et des arbres, un roseau qui non seulement pense, mais médite, des cheveux qui de noirs deviennent gris et de gris deviennent blancs dans la solitude, un homme qui se sent de plus en plus devenir une ombre, le long passage des années sur celui qui est absent, mais qui n'est pas mort, la gravité de ce déshérite, la nostalgie de cet innocent, rien de plus redoutable pour les malfaiteurs couronnés.
Quoi que fassent les tout-puissants momentanés, l'éternel fond leur résiste. Ils n'ont que la surface de la certitude, le dessous appartient aux penseurs. Vous exilez un homme. Soit. Et après? Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n'arracherez pas le jour du ciel. Demain, l'aurore.
Pourtant, rendons cette justice aux proscripteurs ; ils sont logiques, parfaits, abominables. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour anéantir le proscrit. Parviennent-ils à leur but ? réussissent-ils ? sans doute. Un homme tellement ruiné qu'il n'a plus que son honneur, tellement dépouillé qu'il n'a plus que sa conscience, tellement isolé qu'il n'a plus près de lui que l'équité, tellement renié qu'il n'a plus avec lui que la vérité, tellement jeté aux ténèbres qu'il ne lui reste plus que le soleil, voilà ce que c'est qu'un proscrit.
L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tous les coins de terre se valent. Angulus ridet. Tout lieu de rêverie est bon, pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. En particulier l'archipel de la Manche est attrayant ; il n'a pas de peine à ressembler à la patrie, étant la France. Jersey et Guernesey sont des morceaux de la Gaule, cassée au huitième siècle par la mer. Jersey a eu plus de coquetterie que Guernesey; elle y a gagné d'être plus jolie et moins belle. A Jersey la forêt s'est faite jardin ; à Guernesey le rocher est resté colosse..." (Actes et Paroles, Pendant l'Exil)

En août 1852, il a donc gagné Jersey et s'est installé avec les siens à Marine-Terrace, période difficile (la folie des sa fille, le soutien de Juliette, l'exaltation de la création) pour y composer le célèbre "Les Châtiments" (1853), satire ironique et enflammée de 6200 vers, tantôt gouailleur, tantôt pathétique, où il clame son mépris et sa haine pour Napoléon III, - les titres des six premiers Livres reprennent ironiquement les formules officielles par lesquelles Napoléon III prétend légitimer le coup d'Etat (La Société est sauvée, L`Ordre est rétabli, ..) -, son amour de la liberté et son espoir en des temps meilleurs...
La satire est d'autant plus vive que les envolées épiques ou lyriques ne cessent d'affleurer, il y eu avant Napoléon le petit, Napoléon le grand, pour s'élargir à l'épopée biblique ou révolutionnaire, image toujours présente d'une régénération possible de notre monde, la lutte du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres,
Ô soldats de l'an deux ! ô guerres ! épopées !
Contre les rois tirant ensemble leurs épées,
Prussiens, Autrichiens,
Contre toutes les Tyrs et toutes les Sodomes,
Contre le czar du nord, contre ce chasseur d'hommes
Suivi de tous ses chiens,
Contre toute l'Europe avec ses capitaines,
Avec ses fantassins couvrant au loin les plaines,
Avec ses cavaliers,
Tout entière debout comme une hydre vivante,
Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante
Et les pieds sans souliers !
Au levant, au couchant, partout, au sud, au pôle,
Avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule,
Passant torrents et monts,
Sans repos, sans sommeil, coudes percés, sans vivres,
Ils allaient, fiers, joyeux, et soufflant dans des cuivres
Ainsi que des démons !
La Liberté sublime emplissait leurs pensées.
Flottes prises d'assaut, frontières effacées
Sous leur pas souverain,
Ô France, tous les jours, c'était quelque prodige,
Chocs, rencontres, combats ; et Joubert sur l'Adige,
Et Marceau sur le Rhin !
On battait l'avant-garde, on culbutait le centre ;
Dans la pluie et la neige et de l'eau jusqu'au ventre,
On allait ! en avant !
Et l'un offrait la paix, et l'autre ouvrait ses portes,
Et les trônes, roulant comme des feuilles mortes,
Se dispersaient au vent !
Oh ! que vous étiez grands au milieu des mêlées, Soldats !
L'oeil plein d'éclairs, faces échevelées
Dans le noir tourbillon,
Ils rayonnaient, debout, ardents, dressant la tête ;
Et comme les lions aspirent la tempête
Quand souffle l'aquilon,
Eux, dans l'emportement de leurs luttes épiques,
Ivres, ils savouraient tous les bruits héroïques,
Le fer heurtant le fer,
La Marseillaise ailée et volant dans les balles,
Les tambours, les obus, les bombes, les cymbales,
Et ton rire, ô Kléber !
La Révolution leur criait : - Volontaires,
Mourez pour délivrer tous les peuples vos frères ! -
Contents, ils disaient oui.
- Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes !
Et l'on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes
Sur le monde ébloui !
La tristesse et la peur leur étaient inconnues.
Ils eussent, sans nul doute, escaladé les nues
Si ces audacieux,
En retournant les yeux dans leur course olympique,
Avaient vu derrière eux la grande République
Montrant du doigt les cieux ! ..
L’expiation ...
Victor Hugo retrace avec un extraordinaire lyrisme et sens de la formule toutes les étapes de la glorieuse déchéance de Napoléon après son Coup d'État du 18 Brumaire,
25-30 novembre 1852. Jersey....
I
Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête.
Sombres jours! l’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.
Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.
Après la plaine blanche une autre plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni le centre.
Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre
Des chevaux morts; au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons à leur poste gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,
Pleuvaient; les grenadiers, surpris d’être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours! La froide bise
Sifflait; sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.
Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre:
C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d’ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir,
Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Et chacun se sentant mourir, on était seul.
– Sortira-t-on jamais de ce funeste empire?
Deux ennemis! le czar, le nord. Le nord est pire.
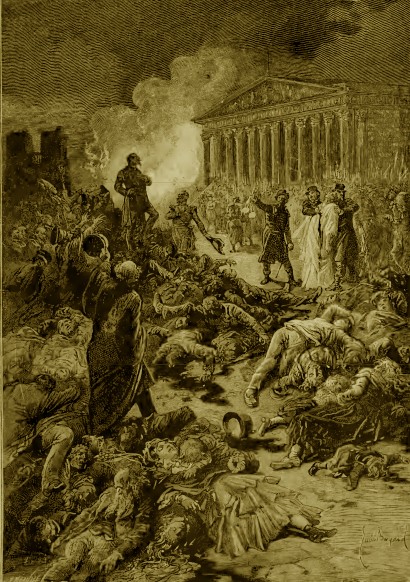

On jetait les canons pour brûler les affûts.
Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus,
Ils fuyaient; le désert dévorait le cortège.
On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige,
Voir que des régiments s’étaient endormis là.
Ô chutes d’Annibal! lendemains d’Attila!
Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières,
On s’écrasait aux ponts pour passer les rivières,
On s’endormait dix mille, on se réveillait cent.
Ney, que suivait naguère une armée, à présent
S’évadait, disputant sa montre à trois cosaques.
Toutes les nuits, qui vive! alerte, assauts! attaques!
Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur eux
Ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux,
Avec des cris pareils aux voix des vautours chauves,
D’horribles escadrons, tourbillons d’hommes fauves.
Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait.
L’empereur était là, debout, qui regardait.
Il était comme un arbre en proie à la cognée.
Sur ce géant, grandeur jusqu’alors épargnée,
Le malheur, bûcheron sinistre, était monté;
Et lui, chêne vivant, par la hache insulté,
Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches,
Il regardait tomber autour de lui ses branches.
Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour.
Tandis qu’environnant sa tente avec amour,
Voyant son ombre aller et venir sur la toile,
Ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile,
Accusaient le destin de lèse-majesté,
Lui se sentit soudain dans l’âme épouvanté.
Stupéfait du désastre et ne sachant que croire,
L’empereur se tourna vers Dieu; l’homme de gloire
Trembla; Napoléon comprit qu’il expiait
Quelque chose peut-être, et, livide, inquiet,
Devant ses légions sur la neige semées:
«Est-ce le châtiment, dit-il. Dieu des armées?»
Alors il s’entendit appeler par son nom
Et quelqu’un qui parlait dans l’ombre lui dit: Non.


II
Waterloo! Waterloo! Waterloo! morne plaine!
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,
Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,
La pâle mort mêlait les sombres bataillons.
D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France.
Choc sanglant! des héros Dieu trompait l’espérance;
Tu désertais, victoire, et le sort était las.
O Waterloo! je pleure et je m’arrête, hélas!
Car ces derniers soldats de la dernière guerre
Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre,
Chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin,
Et leur âme chantait dans les clairons d’airain!
Le soir tombait; la lutte était ardente et noire.
Il avait l’offensive et presque la victoire;
Il tenait Wellington acculé sur un bois.
Sa lunette à la main, il observait parfois
Le centre du combat, point obscur où tressaille
La mêlée, effroyable et vivante broussaille,
Et parfois l’horizon, sombre comme la mer.
Soudain, joyeux, il dit: Grouchy! – C’était Blücher.
L’espoir changea de camp, le combat changea d’âme,
La mêlée en hurlant grandit comme une flamme.
La batterie anglaise écrasa nos carrés.
La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés,
Ne fut plus, dans les cris des mourants qu’on égorge,
Qu’un gouffre flamboyant, rouge comme une forge;
Gouffre où les régiments comme des pans de murs
Tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs
Les hauts tambours-majors aux panaches énormes,
Où l’on entrevoyait des blessures difformes!

Carnage affreux! moment fatal! L’homme inquiet
Sentit que la bataille entre ses mains pliait.
Derrière un mamelon la garde était massée.
La garde, espoir suprême et suprême pensée!
«Allons! faites donner la garde!» cria-t-il.
Et, lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil,
Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires,
Cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres,
Portant le noir colback ou le casque poli,
Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli,
Comprenant qu’ils allaient mourir dans cette fête,
Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.
Leur bouche, d’un seul cri, dit: vive l’empereur!
Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur,
Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,
La garde impériale entra dans la fournaise.
Hélas! Napoléon, sur sa garde penché,
Regardait, et, sitôt qu’ils avaient débouché
Sous les sombres canons crachant des jets de soufre,
Voyait, l’un après l’autre, en cet horrible gouffre,
Fondre ces régiments de granit et d’acier
Comme fond une cire au souffle d’un brasier.
Ils allaient, l’arme au bras, front haut, graves, stoïques.
Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques!
Le reste de l’armée hésitait sur leurs corps
Et regardait mourir la garde. – C’est alors
Qu’élevant tout à coup sa voix désespérée,
La Déroute, géante à la face effarée
Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons,
Changeant subitement les drapeaux en haillons,
A de certains moments, spectre fait de fumées,
Se lève grandissante au milieu des armées,
La Déroute apparut au soldat qui s’émeut,
Et, se tordant les bras, cria: Sauve qui peut!
Sauve qui peut! – affront! horreur! – toutes les bouches
Criaient; à travers champs, fous, éperdus, farouches,
Comme si quelque souffle avait passé sur eux.
Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux,
Roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles,
Jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles,
Sous les sabres prussiens, ces vétérans, ô deuil!
Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient! – En un clin d’œil,
Comme s’envole au vent une paille enflammée,
S’évanouit ce bruit qui fut la grande armée,
Et cette plaine, hélas, où l’on rêve aujourd’hui,
Vit fuir ceux devant qui l’univers avait fui!
Quarante ans sont passés, et ce coin de la terre,
Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire,
Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néants,
Tremble encor d’avoir vu la fuite des géants!
Napoléon les vit s’écouler comme un fleuve;
Hommes, chevaux, tambours, drapeaux; – et dans l’épreuve
Sentant confusément revenir son remords,
Levant les mains au ciel, il dit: «Mes soldats morts,
Moi vaincu! mon empire est brisé comme verre.
Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère?»
Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon,
Il entendit la voix qui lui répondait: Non!
III
Il croula. Dieu changea la chaîne de l’Europe.
Il est, au fond des mers que la brume enveloppe,
Un roc hideux, débris des antiques volcans.
Le Destin prit des clous, un marteau, des carcans,
Saisit, pâle et vivant, ce voleur du tonnerre,
Et, joyeux, s’en alla sur le pic centenaire
Le clouer, excitant par son rire moqueur
Le vautour Angleterre à lui ronger le coeur.
Évanouissement d’une splendeur immense!
Du soleil qui se lève à la nuit qui commence,
Toujours l’isolement, l’abandon, la prison;
Un soldat rouge au seuil, la mer à l’horizon.
Des rochers nus, des bois affreux, l’ennui, l’espace,
Des voiles s’enfuyant comme l’espoir qui passe,
Toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents!
Adieu, tente de pourpre aux panaches mouvants,
Adieu, le cheval blanc que César éperonne!
Plus de tambours battant aux champs, plus de couronne,
Plus de rois prosternés dans l’ombre avec terreur,
Plus de manteau traînant sur eux, plus d’empereur!
Napoléon était retombé Bonaparte.
Comme un romain blessé par la flèche du parthe,
Saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla.
Un caporal anglais lui disait: halte-là!
Son fils aux mains des rois, sa femme au bras d’un autre!
Plus vil que le pourceau qui dans l’égout se vautre,
Son sénat, qui l’avait adoré, l’insultait.
Au bord des mers, à l’heure où la bise se tait,
Sur les escarpements croulant en noirs décombres,
Il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres.
Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier,
L’oeil encore ébloui des batailles d’hier,
Il laissait sa pensée errer à l’aventure.
Grandeur, gloire, ô néant! calme de la nature!
Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas.
.....

Les Châtiments ne sont pas seulement considéré comme un exercice extraordinaire de violence verbale dans lequel tous les registres, grotesques ou sublimes, argotiques compris, sont utilisés, mais laisse s'exprimer une nouvelle poétique, un nouveau langage poétique centré sur la "voyance", l'Apocalypse, la Passion du Peuple, la Délivrance attendue, le combat du Bien et du Mal, autant de thèmes qui désormais habitent progressivement l'oeuvre de Victor Hugo, la Fin de Satan et Dieu, inachevés, l'Âne, les différentes étapes de l'écriture de la Légende des siècles qui s'achèvera en 1883...
"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front,
Ceux qui d'un haut. destin gravissent l'âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,
C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche,
Ceux dont le coeur est bon, ceux dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d'être en ne pensant pas.
Ils s'appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule.
Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,
Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,
N'a jamais de figure et n'a jamais de nom ;
Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère,
Détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère,
Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus,
Pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus.
Ils sont les passants froids sans but, sans noeud, sans âge ;
Le bas du genre humain qui s'écroule en nuage ;
Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas,
Ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas.
L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule
Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule,
Car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit,
Ils errent près du bord sinistre de la nuit..."
1863, Stella, Je m'étais endormi la nuit près de la grève...
Ce poème est daté de Jersey, 31 août 1853. Entre la nuit sinistre (Nox), qui ouvre ce livre de feu, et l'aube radieuse (Lux), qui la termine, Stella (l'étoile) oppose aux crimes de l'injustice et de la violence, la sereine nature qui console et purifie. Cette méditation cosmique est un thème familier de la poésie romantique; mais l'Infini dans les cieux de Lamartine, l'Etoile du soir, d'Alfred de Musset, et Stella de Victor Hugo ont chacun leur inspiration propre. Ce que Victor Hugo cherche au ciel, c'est une anticipation de l'avenir, la route où s'engage le vieux rêve de l'humanité vers une destinée meilleure, plus heureuse et plus libre....
Je m'étais endormi la nuit près de la grève.
Un vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve,
J'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin.
Elle resplendissait au fond du ciel lointain
Dans une blancheur molle, infinie et charmante.
Aquilon s'enfuyait emportant la tourmente.
L'astre éclatant changeait la nuée en duvet.
C'était une clarté qui pensait, qui vivait ;
Elle apaisait l'écueil où la vague déferle ;
On croyait voir une âme à travers une perle.
Il faisait nuit encor, l'ombre régnait en vain,
Le ciel s'illuminait d'un sourire divin.
La lueur argentait le haut du mât qui penche ;
Le navire était noir, mais la voile était blanche ;
Des goëlands debout sur un escarpement,
Attentifs, contemplaient l'étoile gravement
Comme un oiseau céleste et fait d'une étincelle ;
L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle,
Et, rugissant tout bas, la regardait briller,
Et semblait avoir peur de la faire envoler.
Un ineffable amour emplissait l'étendue.
L'herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue,
Les oiseaux se parlaient dans les nids ; une fleur
Qui s'éveillait me dit : c'est l'étoile ma soeur.
Et pendant qu'à longs plis l'ombre levait son voile,
J'entendis une voix qui venait de l'étoile
Et qui disait : - Je suis l'astre qui vient d'abord.
Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort.
J'ai lui sur le Sina, j'ai lui sur le Taygète ;
Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette,
Comme avec une fronde, au front noir de la nuit.
Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit.
Ô nations ! je suis la poésie ardente.
J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante.
Le lion océan est amoureux de moi.
J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi !
Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles !
Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles,
Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,
Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit,
Car celui qui m'envoie en avant la première,
C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière !
1854, L'immense être inconnu sourit..
Publiés en 1881, "Les Quatre Vents de l'Esprit", un des derniers recueils de Victor Hugo, comprennent des poésies composées à des époques très différentes. Cette pièce, datée du 22 juillet 1854, écrite pendant l'exil à Jersey, est une des pages où s'exprime le mieux la philosophie religieuse de Victor Hugo. L'Immense Être inconnu, c'est Dieu, le souverain Bien, l'Eternel, que les erreurs, mensonges et crimes de l'humanité ne peuvent supprimer...
L’immense Être inconnu sourit. L’aube réveille
Le ciron, la fourmi, la fleur des prés, l’abeille,
Les nids chuchotants, les hameaux,
La forêt aux profonds branchages, les campagnes,
L’océan, le soleil derrière les montagnes,
Mon âme derrière les maux.
L’Être rêve. Il construit le lys dans le mystère ;
Son doigt aide la taupe à faire un trou sous terre ;
Il peint les beaux rosiers vermeils ;
Et la création, sur son travail courbée,
Contemple ; il fait, avec l’aile d’un scarabée,
L’admiration des soleils.
Hommes, vos grands vaisseaux qui vont sous les étoiles,
Embarrassant les vents dans leurs gouffres de voiles,
Monstres qui s’imposent aux mers,
Fatiguant de leur poids la brise exténuée,
Et traînant dans leurs flancs chacun une nuée
Pleine de foudres et d’éclairs,
Vos canons, vos soldats, dont la marche olympique
D’un coin de terre obscur fait une plaine épique,
Vos drapeaux aux plis arrogants,
Vos batailles broyant les moissons, vos tueries,
Vos carnages, vos chocs, et vos cavaleries,
Aigles de ces noirs ouragans,
Vos régiments, pareils à l’hydre qui serpente,
Vos Austerlitz tonnants, vos Lutzen, vos Lépante,
Vos Iéna sonnant du clairon,
Vos camps pleins de tambours que la mort pâle éveille,
Passent pendant qu’il songe, et font à son oreille
Le même bruit qu’un moucheron.

1856 - "Les Contemplations"
Hugo doit quitter Jersey pour Guernesey (octobre 1855), y acquiert une maison, Hauteville-House, où son imagination se nourrira du spectacle de la mer et des côtes françaises qui marquent l'horizon, mais aussi d'une initiation au spiritisme effectuée en septembre 1853 auprès de Delphine de Girardin : Hugo semble alors libérer en lui des interrogations sur la mort, le mystère de l'âme, le problème du mal qui l'obsède tant et inspire la vocation pour le poète d'élever l'humanité entière et donner sens tant à la vie qu'à son Histoire...
Hugo a traversé l'immense chagrin provoqué par la mort de Léopoldine, l'abattement et la tentation du renoncement, l'exil et la fureur des Châtiments, "Les Contemplations" retracent en 12000 vers cet itinéraire, de 1830 à 1855. Le premier volume, que domine la mort de Léopoldine, s'intitule "Autrefois, Aujourd'hui - 1830-1843" et regroupe Aurore (29 poèmes-1600 vers, le livre de la jeunesse), L'Âme en fleur (28 poèmes-900 vers, le livre des amours), Les Luttes et les Rêves (30 poèmes, 2300 vers, le livre de la misère). Le second volume révèle à quel point Hugo a profondément intégré les souffrances de ce monde ("Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous..), s'intitule "Aujourd'hui - 1843-1856" et contient Pauca meae (17 poèmes et 800 vers, le livre du deuil), En marche (26 poèmes et 1700 vers qui marquent une énergie retrouvée), Au bord de l'lnfini (26 poèmes et 2800 vers qui apportent révélations et certitudes)...
"A Villequier" est considéré comme le sommet de "Pauca meae" et du drame humain qui s'exprime dans les Contemplations. Hugo étend sa propre douleur à l'humanité entière, on y retrouve les accents pathétiques d'une tradition qui, depuis le Livre de Job, dans la Bible, ont exprimé le malheur incompréhensible de l'homme qui n'a d'autre choix que d'accepter sa soumission à la volonté de Dieu....
"Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,
Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux ;
Maintenant que je suis sous les branches des arbres,
Et que je puis songer à la beauté des cieux ;
Maintenant que du deuil qui m’a fait l’âme obscure
Je sors, pâle et vainqueur,
Et que je sens la paix de la grande nature
Qui m’entre dans le cœur ;
Maintenant que je puis, assis au bord des ondes,
Emu par ce superbe et tranquille horizon,
Examiner en moi les vérités profondes
Et regarder les fleurs qui sont dans le gazon ;
Maintenant, ô mon Dieu ! que j’ai ce calme sombre
De pouvoir désormais
Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre
Elle dort pour jamais ;
Maintenant qu’attendri par ces divins spectacles,
Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté,
Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,
Je reprends ma raison devant l’immensité ;
Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire ;
Je vous porte, apaisé,
Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire
Que vous avez brisé ;
Je viens à vous, Seigneur ! confessant que vous êtes
Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant !
Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,
Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent ;
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament ;
Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement ;
Je conviens à genoux que vous seul, père auguste,
Possédez l’infini, le réel, l’absolu ;
Je conviens qu’il est bon, je conviens qu’il est juste
Que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l’a voulu !
Je ne résiste plus à tout ce qui m’arrive
Par votre volonté.
L’âme de deuils en deuils, l’homme de rive en rive,
Roule à l’éternité.
Nous ne voyons jamais qu’un seul côté des choses ;
L’autre plonge en la nuit d’un mystère effrayant.
L’homme subit le joug sans connaître les causes.
Tout ce qu’il voit est court, inutile et fuyant.
Vous faites revenir toujours la solitude
Autour de tous ses pas.
Vous n’avez pas voulu qu’il eût la certitude
Ni la joie ici-bas !
Dès qu’il possède un bien, le sort le lui retire.
Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours,
Pour qu’il s’en puisse faire une demeure, et dire :
C’est ici ma maison, mon champ et mes amours !
Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient ;
Il vieillit sans soutiens.
Puisque ces choses sont, c’est qu’il faut qu’elles soient ;
J’en conviens, j’en conviens !
Le monde est sombre, ô Dieu ! l’immuable harmonie
Se compose des pleurs aussi bien que des chants ;
L’homme n’est qu’un atome en cette ombre infinie,
Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.
Je sais que vous avez bien autre chose à faire
Que de nous plaindre tous,
Et qu’un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,
Ne vous fait rien, à vous !
Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue ;
Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum ;
Que la création est une grande roue
Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un ;
Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent,
Passent sous le ciel bleu ;
Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent ;
Je le sais, ô mon Dieu !
Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues,
Au fond de cet azur immobile et dormant,
Peut-être faites-vous des choses inconnues
Où la douleur de l’homme entre comme élément.
Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre
Que des êtres charmants
S’en aillent, emportés par le tourbillon sombre
Des noirs événements.
Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses
Que rien ne déconcerte et que rien n’attendrit.
Vous ne pouvez avoir de subites clémences
Qui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit !
Je vous supplie, ô Dieu ! de regarder mon âme,
Et de considérer
Qu’humble comme un enfant et doux comme une femme,
Je viens vous adorer !
("A Villequier", suite... ) Je regarde toujours ce moment de ma vie Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler ! ....
Considérez encor que j’avais, dès l’aurore,
Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté,
Expliquant la nature à l’homme qui l’ignore,
Éclairant toute chose avec votre clarté ;
Que j’avais, affrontant la haine et la colère,
Fait ma tâche ici-bas,
Que je ne pouvais pas m’attendre à ce salaire,
Que je ne pouvais pas
Prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie,
Vous appesantiriez votre bras triomphant,
Et que, vous qui voyiez comme j’ai peu de joie,
Vous me reprendriez si vite mon enfant !
Qu’une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette,
Que j’ai pu blasphémer,
Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette
Une pierre à la mer !
Considérez qu’on doute, ô mon Dieu ! quand on souffre,
Que l’œil qui pleure trop finit par s’aveugler,
Qu’un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre,
Quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler,
Et qu’il ne se peut pas que l’homme, lorsqu’il sombre
Dans les afflictions,
Ait présente à l’esprit la sérénité sombre
Des constellations !
Aujourd’hui, moi qui fus faible comme une mère,
Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts.
Je me sens éclairé dans ma douleur amère
Par un meilleur regard jeté sur l’univers.
Seigneur, je reconnais que l’homme est en délire,
S’il ose murmurer ;
Je cesse d’accuser, je cesse de maudire,
Mais laissez-moi pleurer !
Hélas ! laissez les pleurs couler de ma paupière,
Puisque vous avez fait les hommes pour cela !
Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre
Et dire à mon enfant : Sens-tu que je suis là ?
Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,
Le soir, quand tout se tait,
Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,
Cet ange m’écoutait !
Hélas ! vers le passé tournant un œil d’envie,
Sans que rien ici-bas puisse m’en consoler,
Je regarde toujours ce moment de ma vie
Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler !
Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure,
L’instant, pleurs superflus !
Où je criai : L’enfant que j’avais tout à l’heure,
Quoi donc ! je ne l’ai plus !
Ne vous irritez pas que je sois de la sorte,
Ô mon Dieu ! cette plaie a si longtemps saigné !
L’angoisse dans mon âme est toujours la plus forte,
Et mon cœur est soumis, mais n’est pas résigné.
Ne vous irritez pas ! fronts que le deuil réclame,
Mortels sujets aux pleurs,
Il nous est malaisé de retirer notre âme
De ces grandes douleurs.
Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires,
Seigneur ; quand on a vu dans sa vie, un matin,
Au milieu des ennuis, des peines, des misères,
Et de l’ombre que fait sur nous notre destin,
Apparaître un enfant, tête chère et sacrée,
Petit être joyeux,
Si beau, qu’on a cru voir s’ouvrir à son entrée
Une porte des cieux ;
Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même
Croître la grâce aimable et la douce raison,
Lorsqu’on a reconnu que cet enfant qu’on aime
Fait le jour dans notre âme et dans notre maison,
Que c’est la seule joie ici-bas qui persiste
De tout ce qu’on rêva,
Considérez que c’est une chose bien triste
De le voir qui s’en va ! "
(Villequier, 4 septembre 1847)
"Demain, dès l'aube..." est une courte pièce, composée le 4 octobre 1847, longtemps reprise dans nos manuels de littérature française tant est bouleversante sa sobriété et la simplicité d'une présence au-delà de sa disparition matérielle...
"Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur."

"Paroles sur la dune", composé le 5 août 1854, anniversaire de son arrivée à Jersey, montre toute la lassitude du poète en exil, ses doutes sur le sens de la vie, sur celui de la mort, avant de reprendre son chemin (En Marche) vers l'Infini....
"Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau,
Que mes tâches sont terminées ;
Maintenant que voici que je touche au tombeau
Par les deuils et par les années,
Et qu’au fond de ce ciel que mon essor rêva,
Je vois fuir, vers l’ombre entraînées,
Comme le tourbillon du passé qui s’en va,
Tant de belles heures sonnées ;
Maintenant que je dis : – Un jour, nous triomphons ;
Le lendemain, tout est mensonge ! –
Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds,
Courbé comme celui qui songe.
Je regarde, au-dessus du mont et du vallon,
Et des mers sans fin remuées,
S’envoler sous le bec du vautour aquilon,
Toute la toison des nuées ;
J’entends le vent dans l’air, la mer sur le récif,
L’homme liant la gerbe mûre ;
J’écoute, et je confronte en mon esprit pensif
Ce qui parle à ce qui murmure ;
Et je reste parfois couché sans me lever
Sur l’herbe rare de la dune,
Jusqu’à l’heure où l’on voit apparaître et rêver
Les yeux sinistres de la lune.
Elle monte, elle jette un long rayon dormant
À l’espace, au mystère, au gouffre ;
Et nous nous regardons tous les deux fixement,
Elle qui brille et moi qui souffre.
Où donc s’en sont allés mes jours évanouis ?
Est-il quelqu’un qui me connaisse ?
Ai-je encor quelque chose en mes yeux éblouis,
De la clarté de ma jeunesse ?
Tout s’est-il envolé ? Je suis seul, je suis las ;
J’appelle sans qu’on me réponde ;
Ô vents ! ô flots ! ne suis-je aussi qu’un souffle, hélas !
Hélas ! ne suis-je aussi qu’une onde ?
Ne verrai-je plus rien de tout ce que j’aimais ?
Au dedans de moi le soir tombe.
Ô terre, dont la brume efface les sommets,
Suis-je le spectre, et toi la tombe ?
Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir ?
J’attends, je demande, j’implore ;
Je penche tour à tour mes urnes pour avoir
De chacune une goutte encore !
Comme le souvenir est voisin du remord !
Comme à pleurer tout nous ramène !
Et que je te sens froide en te touchant, ô mort,
Noir verrou de la porte humaine !
Et je pense, écoutant gémir le vent amer,
Et l’onde aux plis infranchissables ;
L’été rit, et l’on voit sur le bord de la mer
Fleurir le chardon bleu des sables."
"Veni, Vidi, Vixi"...
pièce 13 du livre IV des Contemplations, une pièce écrite le 11 avril 1848, avant les élections à l'Assemblée constituante du 23 avril, la cruelle douleur qui a brisé sa vie personnelle se mêle aux déceptions de sa vie publique. Victor Hugo prévoyait son échec et il ne fut en effet élu qu'aux élections complémentaires du 4 juin. Accablé par les attaques de ses adversaires, dégoûté de l'ingratitude des hommes, il exprime sa lassitude de la vue en reprenant le mot célèbre de César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, mais en modifiant le dernier terme, j'ai vécu...
J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs
Je marche sans trouver de bras qui me secourent,
Puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent,
Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs ;
Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête,
J'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour ;
Puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour,
Hélas ! et sent de tout la tristesse secrète ;
Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu ;
Puisqu'en cette saison des parfums et des roses,
O ma fille ! j'aspire à l'ombre où tu reposes,
Puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu.
Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre.
Mon sillon ? Le voilà. Ma gerbe ? La voici.
J'ai vécu souriant, toujours plus adouci,
Debout, mais incliné du côté du mystère.
J'ai fait ce que j'ai pu ; j'ai servi, j'ai veillé,
Et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine.
Je me suis étonné d'être un objet de haine,
Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.
Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile,
Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les mains,
Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,
J'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.
Maintenant, mon regard ne s'ouvre qu'à demi ;
Je ne me tourne plus même quand on me nomme ;
Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme
Qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi.
Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,
Répondre à l'envieux dont la bouche me nuit.
O Seigneur ! ouvrez-moi les portes de la nuit,
Afin que je m'en aille et que je disparaisse !
Aux Feuillantines ...
Ecrite le 10 août 1846, appartenant au 5e livre des Contemplations (En marche) et qui contient plusieurs souvenirs de la jeunesse du poète. Ici, son enfance, il avait six ans quand il vint habiter avec sa mère et ses deux frères les Feuillantines, le rez-de-chaussée d'un ancien couvent de religieuses, près du Val-de-Grâce. L'épisode principal, la découverte de la Bible...
Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants.
Notre mère disait: jouez, mais je défends
Qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles.
Abel était l'aîné, j'étais le plus petit.
Nous mangions notre pain de si bon appétit,
Que les femmes riaient quand nous passions près d'elles.
Nous montions pour jouer au grenier du couvent.
Et là, tout en jouant, nous regardions souvent
Sur le haut d'une armoire un livre inaccessible.
Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir ;
Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir,
Mais je me souviens bien que c'était une Bible.
Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir.
Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir.
Des estampes partout ! quel bonheur ! quel délire!
Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux,
Et dès le premier mot il nous parut si doux
Qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire.
Nous lûmes tous les trois ainsi, tout le matin,
Joseph, Ruth et Booz, le bon Samaritain,
Et, toujours plus charmés, le soir nous le relûmes.
Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux,
S'appellent en riant et s'étonnent, joyeux,
De sentir dans leur main la douceur de ses plumes.
1865-1866 - "La Chanson des Rues et des Bois" est la chanson des midis et du parfum des fleurs. Il s'en dégage une douce philosophie. Intermède de 1859, à l'époque où il composait la Légende des siècles, on y chante le plaisir, mais il reste entendu que le plaisir ne doit avoir qu'un temps et que le devoir reprendra bientôt la grande place dans la vie. Mais, en attendant, le poète a vingt ans, et ses duos d'amoureux sont emplis de fraîcheur et de belle jeunesse : " Elle disait cent autres choses, / Et sa douce main me battait. / Ô mois de juin ! rayons et roses ! / L'azur chante et l'ombre se tait. / J'essuyai, sans trop lui déplaire, / Tout en la laissant m'accuser, / Avec des fleurs sa main colère, Et sa bouche avec un baiser..."
"Les Complications de l'idéal"...
C'est vrai, pour un instant je laisse
Tous nos grands problèmes profonds ;
Je menais des monstres en laisse,
J'errais sur le char des griffons.
J'en descends ; je mets pied à terre ;
Plus tard, demain, je pousserai
Plus loin encor dans le mystère
Les strophes au vol effaré...."

1859 - "La légende des siècles"
La Légende des Siècles, "c'est l'épopée humaine, âpre, de l'humanité immense", c'est "exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique; la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science...; faire apparaître... cette grande figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée, l'homme", mais c'est aussi faire revivre un surnaturel qui ordonne le sens de ce monde, exprimer en "un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière", la maturation de l'homme vers la liberté, "de l'histoire écoutée aux portes de la légende..."
Une succession donc de tableaux déroulant toute l'histoire humaine, en commençant par les temps bibliques (La conscience, Booz endormi...), en traversant - rapidement - l'antiquité gréco-latine (Les Trois cents, Le détroit de l'Euripe, Le lion d'Androclès..,), en s'attardant au contraire longuement sur le moyen âge (Le mariage de Roland, Aymerillot, Le petit roi de Galice, Eviradnus, Le parricide, L'aigle du casque...), en faisant une simple halte au XVIe siècle (La rose de l'infante), en négligeant presque complètement le XVIIe et le XVIIIe siècle, pour arriver enfin au XIXe, dont il évoque à peine les souvenirs guerriers ("La Légende des siècles" est, il est vrai, complétée, pour les guerres de l'Empire, par "Les Chants du crépuscule" et "Les Châtiments", et, pour la guerre de 1870-71, par "L'Année terrible"), mais qui lui fournit en revanche l'occasion d'exprimer sa compassion pour les humbles et les faibles. Et, après avoir parcouru en, de multiples étapes, la longue route du passé, il se tourne vers l'avenir, qu'il entr'ouvre à nos yeux en de prophétiques échappées (Pleine mer, Plein ciel), et, pour finir, nous transporte même hors des temps (La trompette du Jugement) et dans l'infini de l'espace (Abîme). C'est ainsi que V. Hugo va réalisé le vaste dessein, qu'avait déjà conçu Lamartine, celui de faire l'épopée de l'humanité. On a pu écrire qu'il n'avait pas la profondeur de sensibilité de Lamartine ou l'originalité de pensée d'un Alfred de Vigny, mais Victor Hugo est supérieur par son imagination et une acuité visuelle qui transparaît dans ses descriptions poétiques...
"La vision d'où est sorti ce livre....
J'eus un rêve, le mur des siècles m'apparut.
C'était de la chair vive avec du granit brut,
Une immobilité faite d'inquiétude,
Un édifice ayant un bruit de multitude,
Des trous noirs étoilés par de farouches yeux,
Des évolutions de groupes monstrueux,
De vastes bas-reliefs, des fresques colossales ;
Parfois le mur s'ouvrait et laissait voir des salles,
Des antres où siégeaient des heureux, des puissants,
Des vainqueurs abrutis de crime, ivres d'encens,
Des intérieurs d'or, de jaspe et de porphyre ;
Et ce mur frissonnait comme un arbre au zéphyre ;
Tous les siècles, le front ceint de tours ou d'épis,
Etaient là, mornes sphinx sur l'énigme accroupis ;
Chaque assise avait l'air vaguement animée ;
Cela montait dans l'ombre ; on eût dit une armée
Pétrifiée avec le chef qui la conduit
Au moment qu'elle osait escalader la Nuit ;
Ce bloc flottait ainsi qu'un nuage qui roule ;
C'était une muraille et c'était une foule ;
Le marbre avait le sceptre et le glaive au poignet,
La poussière pleurait et l'argile saignait,
Les pierres qui tombaient avaient la forme humaine.
Tout l'homme, avec le souffle inconnu qui le mène,
Ève ondoyante, Adam flottant, un et divers,
Palpitaient sur ce mur, et l'être, et l'univers,
Et le destin, fil noir que la tombe dévide.
Parfois l'éclair faisait sur la paroi livide
Luire des millions de faces tout à coup.
Je voyais là ce Rien que nous appelons Tout ;
Les rois, les dieux, la gloire et la loi, les passages
Des générations à vau-l'eau dans les âges ;
Et devant mon regard se prolongeaient sans fin
Les fléaux, les douleurs, l'ignorance, la faim,
La superstition, la science, l'histoire,
Comme à perte de vue une façade noire.
Et ce mur, composé de tout ce qui croula,
Se dressait, escarpé, triste, informe. Où cela ?
Je ne sais. Dans un lieu quelconque des ténèbres...."

Écrits par intermittences entre 1855 et 1876, les différents poèmes de La légende des Siècles furent publiés en trois séries, en 1859, en 1877 et en 1883, dans la droite ligne du nouveau langage poétique que Victor Hugo avait conçu en écrivant "Les Châtiments" et puis "Les Contemplations". Quelques vingt-cinq mille vers expriment en une immense épopée visionnaire, au centre de laquelle se meuvent les figures les plus obscures, la lutte du Bien et du Mal, lutte incontournable et nécessaire au sein d'une aventure humaine qui tente inexorablement de progresser vers sa future libération. Nombre de passages sont restés à jamais gravés dans la mémoire de générations successives ...
D'Ève à Jésus - Le Sacre de la Femme
"L'aurore apparaissait; quelle aurore? Un abîme
D'éblouissement, vaste, insondable, sublime;
Une ardente lueur de paix et de bonté.
C'était au premiers temps du globe; et la clarté
Brillait sereine au front du ciel inaccessible,
Étant tout ce que Dieu peut avoir de visible;
Tout s'illuminait, l'ombre et le brouillard obscur;
Des avalanches d'or s'écroulaient dans l'azur;
Le jour en flamme, au fond de la terre ravie,
Embrasait les lointains splendides de la vie;
Les horizons pleins d'ombre et de rocs chevelus,
Et d'arbres effrayants que l'homme ne voit plus,
Luisaient comme le songe et comme le vertige,
Dans une profondeur d'éclair et de prodige;
L'Éden pudique et nu s'éveillait mollement;
Les oiseaux gazouillaient un hymne si charmant,
Si frais, si gracieux, si suave et si tendre,
Que les anges distraits se penchaient pour l'entendre;
Le seul rugissement du tigre était plus doux;
Les halliers où l'agneau paissait avec les loups,
Les mers où l'hydre aimait l'alcyon, et les plaines
Où les ours et les daims confondaient leurs haleines,
Hésitaient, dans le choeur des concerts infinis,
Entre le cri de l'antre et la chanson des nids.
La prière semblait à la clarté mêlée;
Et sur cette nature encore immaculée,
Qui du verbe éternel avait gardé l'accent,
Sur ce monde céleste, angélique, innocent,
Le matin, murmurant une sainte parole,
Souriait, et l'aurore était une auréole.
Tout avait la figure intègre du bonheur;
Pas de bouche d'où vint un souffle empoisonneur;
Pas un être qui n'eût sa majesté première;
Tout ce que l'infini peut jeter de lumière
Éclatait pêle-mêle à la fois dans les airs;
Le vent jouait avec cette gerbe d'éclairs
Dans le tourbillon libre et fuyant des nuées;
L'enfer balbutiait quelques vagues huées
Qui s'évanouissaient dans le grand cri joyeux
Des eaux, des monts, des bois, de la terre et des cieux!
Les vents et les rayons semaient de tels délires,
Que les forêts vibraient comme de grandes lyres;
De l'ombre à la clarté, de la base au sommet,
Une fraternité vénérable germait;
L'astre était sans orgueil et le ver sans envie;
On s'adorait d'un bout à l'autre de la vie;
Une harmonie égale à la clarté, versant
Une extase divine au globe adolescent,
Semblait sortir du coeur mystérieux du monde;
L'herbe en était émue, et le nuage, et l'onde,
Et même le rocher qui songe et qui se tait;
L'arbre, tout pénétré de lumière, chantait;
Chaque fleur, échangeant son souffle et sa pensée
Avec le ciel serein d'où tombe la rosée,
Recevait une perle et donnait un parfum;
L'Être resplendissait, Un dans Tout, Tout dans Un;
Le paradis brillait sous les sombres ramures
De la vie ivre d'ombre et pleine de murmures,
Et la lumière était faite de vérité;
Et tout avait la grâce, ayant la pureté;
Tout était flamme, hymen, bonheur, douceur, clémence,
Tant ces immenses jours avaient une aube immense!
Ineffable lever du premier rayon d'or!
Du jour éclairant tout sans rien savoir encor!
O matin des matins! amour! joie effrénée
De commencer le temps, l'heure, le mois, l'année!
Ouverture du monde! instant prodigieux!
La nuit se dissolvait dans les énormes cieux
Où rien ne tremble, où rien ne pleure, où rien ne souffre;
Autant que le chaos la lumière était gouffre;
Dieu se manifestait dans sa calme grandeur,
Certitude pour l'âme et pour les yeux splendeur;
De faîte en faîte, au ciel et sur terre, et dans toutes
Les épaisseurs de l'être aux innombrables voûtes,
On voyait l'évidence adorable éclater;
Le monde s'ébauchait, tout semblait méditer;
Les types primitifs, offrant dans leur mélange
Presque la brute informe et rude et presque l'ange,
Surgissaient, orageux, gigantesques, touffus;
On sentait tressaillir sous leurs groupes confus
La terre, inépuisable et suprême matrice;
La création sainte, à son tour créatrice,
Modelait vaguement des aspects merveilleux,
Faisait sortir l'essaim des êtres fabuleux
Tantôt des bois, tantôt des mers, tantôt des nues,
Et proposait à Dieu des formes inconnues
Que le temps, moissonneur pensif, plus tard changea;
On sentait sourdre, et vivre, et végéter déjà
Tous les arbres futurs, pins, érables, yeuses,
Dans des verdissements de feuilles monstrueuses;
Une sorte de vie excessive gonflait
La mamelle du monde au mystérieux lait;
Tout semblait presque hors de la mesure éclore;
Comme si la nature, en étant proche encore,
Eût pris pour ses essais sur la terre et les eaux
Une difformité splendide au noir chaos.
Les divins paradis, pleins d'une étrange sève,
Semblent au fond des temps reluire dans le rêve,
Et pour nos yeux obscurs, sans idéal, sans foi,
Leur extase aujourd'hui serait presque l'effroi;
Mais qu'importe à l'abîme, à l'âme universelle
Qui dépense un soleil au lieu d'une étincelle,
Et qui, pour y pouvoir poser l'ange azuré,
Fait croître jusqu'aux cieux l'Éden démesuré!
Jours inouïs! le bien, le beau, le vrai, le juste,
Coulaient dans le torrent, frissonnaient dans l'arbuste;
L'aquilon louait Dieu de sagesse vêtu;
L'arbre était bon; la fleur était une vertu;
C'est trop peu d'être blanc, le lis était candide;
Rien n'avait de souillure et rien n'avait de ride;
Jours purs! rien ne saignait sous l'ongle et sous la dent;
La bête heureuse était l'innocence rôdant;
Le mal n'avait encor rien mis de son mystère
Dans le serpent, dans l'aigle altier, dans la panthère;
Le précipice ouvert dans l'animal sacré
N'avait pas d'ombre, étant jusqu'au fond éclairé;
La montagne était jeune et la vague était vierge;
Le globe, hors des mers dont le flot le submerge,
Sortait beau, magnifique, aimant, fier, triomphant,
Et rien n'était petit quoique tout fût enfant;
La terre avait, parmi ses hymnes d'innocence,
Un étourdissement de sève et de croissance;
L'instinct fécond faisait rêver l'instinct vivant;
Et, répandu partout, sur les eaux, dans le vent,
L'amour épars flottait comme un parfum s'exhale;
La nature riait, naïve et colossale;
L'espace vagissait ainsi qu'un nouveau-né.
L'aube était le regard du soleil étonné.
"Booz endormi" est l'un des poèmes les plus connus de La Légende des Siècles, un poème tout entier inspiré par l'histoire de Ruth et de Booz, dans une Bible qui l'émerveilla tout enfant...
"Booz s'était couché de fatigue accablé ;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire,
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.
Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge ;
Il était, quoique riche, à la justice enclin ;
Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin,
Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.
Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril.
Sa gerbe n'était point avare ni haineuse ;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse :
- Laissez tomber exprès des épis, disait-il.
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.
Booz était bon maître et fidèle parent ;
Il était généreux, quoiqu'il fût économe ;
Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme,
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Le vieillard, qui revient vers la source première,
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;
Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,
Mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière.
Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens ;
Près des meules, qu'on eût prises pour des décombres,
Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;
Et ceci se passait dans des temps très anciens.
Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge ;
La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet
Des empreintes de pieds de géant qu'il voyait,
Etait encor mouillée et molle du déluge.
Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,
Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;
Or, la porte du ciel s'étant entre-bâillée
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu ;
Une race y montait comme une longue chaîne ;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.
Et Booz murmurait avec la voix de l'âme :
" Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?
Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt,
Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme.
"Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi,
Ô Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;
Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre,
Elle à demi vivante et moi mort à demi.
" Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?
Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ?
Quand on est jeune, on a des matins triomphants,
Le jour sort de la nuit comme d'une victoire ;
" Mais, vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau.
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe,
Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe
Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau.
Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase,
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.
Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite,
S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu,
Quand viendrait du réveil la lumière subite.
Booz ne savait point qu'une femme était là,
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle,
Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.
L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément,
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
La respiration de Booz qui dormait,
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.
Ruth songeait et Booz dormait ; l'herbe était noire ;
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;
Une immense bonté tombait du firmament ;
C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre
Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,
Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été
Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles."
"L'œil était dans la tombe et regardait Caïn..." (La Conscience, 1ere série)
"Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Échevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva
Au bas d'une montagne en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine
Lui dirent : - Couchons-nous sur la terre, et dormons. -
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres
Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l'ombre fixement.
- Je suis trop près, dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l'espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
- Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.
Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. -
Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes
L'œil à la même place au fond de l'horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
- Cachez-moi, cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont
Sous des tentes de poil dans le désert profond :
- Étends de ce côté la toile de la tente. -
Et l'on développa la muraille flottante ;
Et, quand on l'eut fixée avec des poids de plomb
Vous ne voyez plus rien ? dit Tsilla, l'enfant blond,
La fille de ses fils, douce comme l'aurore ;
Et Caïn répondit : - Je vois cet œil encore ! -
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Cria : - Je saurai bien construire une barrière. -
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.
Et Caïn dit : - Cet œil me regarde toujours !
Hénoch dit : - Il faut faire une enceinte de tours
Si terrible, que rien ne puisse approcher d'elle.
Bâtissons une ville avec sa citadelle.
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. -
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth ;
Et l'on crevait les yeux à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,
Et la ville semblait une ville d'enfer ;
L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes ;
Sur la porte on grava : " Défense à Dieu d'entrer.
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l'aïeul au centre en une tour de pierre.
Et lui restait lugubre et hagard. - Ô mon père !
L'œil a-t-il disparu ? dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit : - Non, il est toujours là.
Alors il dit : Je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. -
On fit donc une fosse, et Caïn dit : C'est bien !
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre
Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain,
L'œil était dans la tombe et regardait Caïn."
"Mon père, ce héros au sourire si doux" (Après la bataille, 2e série)
"Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d'une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit.
C'était un espagnol de l'armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié,
Et qui disait : - À boire, à boire par pitié ! -
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit : - Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. -
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de maure,
Saisit un pistolet qu'il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant : Caramba !
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
- Donne-lui tout de même à boire, dit mon père."
L'Aigle du casque (La Légende des siècles) - La scène se passe en Ecosse. Vengeur d'une vieille querelle de famille, le comte Angus, âgé de seize ans, pour tenir sa promesse faite à son grand-père mourant, a provoqué en duel le cruel lord Tiphaine. Mais quand les deux combattants se retrouvent dans le champ clos choisi pour la lutte, Angus, pris de frayeur devant son terrible adversaire, jette sa lance et s'enfuit, poursuivi par Tiphaine...
La nuit vient, et toujours, tremblant, pleurant, fuyant,
L'enfant effaré court devant l'homme effrayant.
C'est l'heure où l'horizon semble un rêve, et recule.
Clair de lune, halliers, bruyères, crépuscule.
La poursuite s'acharne, et, plus qu'auparavant
Forcenée, à travers les arbres et le vent,
Fait peur à l'ombre même, et donne le vertige
Aux sapins sur les monts, aux roses sur leur tige.
L'enfant sans armes, l'homme avec son couperet,
Courent dans la noirceur des bois, et l'on dirait
Que dans la forêt spectre ils deviennent fantômes.
Une femme, d'un groupe obscur de toits de chaumes,
Sort, et ne peut parler, les larmes l'étouffant ;
C'est une mère, elle a dans les bras son enfant,
Et c'est une nourrice, elle a le sein nu. — Grâce !
Dit-elle, en bégayant ; et dans le vaste espace
Angus s'enfuit. — Jamais ! dit Tiphaine inhumain.
Mais la femme à genoux lui barre le chemin.
— Arrête ! sois clément, afin que Dieu t'exauce !
Grâce ! Au nom du berceau, n'ouvre pas une fosse !
Sois vainqueur, c'est assez ; ne sois pas assassin.
Fais grâce. Cet enfant que j'ai là sur mon sein
T'implore pour l'enfant que cherche ton épée.
Entends-moi ; laisse fuir cette proie échappée.
Ah ! tu ne tueras point, et tu m'écouteras,
Chevalier, puisque j'ai l'aurore dans mes bras.
Songe à ta mère. Eh bien, je suis mère comme elle.
Homme, respecte en moi la femme. — À bas, femelle !
Dit Tiphaine, et du pied il frappe ce sein nu.
Ce fut dans on ne sait quel ravin inconnu
Que Tiphaine atteignit le pauvre enfant farouche ;
L'enfant pris n'eut pas même un râle dans la bouche ;
Il tomba de cheval, et morne, épuisé, las,
Il dressa ses deux mains suppliantes, hélas !
Sa mère morte était dans le fond de la tombe,
Et regardait.
Tiphaine accourt, s'élance, tombe
Sur l'enfant, comme un loup dans les cirques romains,
Et d'un revers de hache il abat ces deux mains
Qui dans l'ombre élevaient vers les cieux la prière ;
Puis, par ses blonds cheveux dans une fondrière
Il le traîne.
Et riant de fureur, haletant,
Il tua l'orphelin et dit : Je suis content !
Ainsi rit dans son antre infâme la tarasque.
Alors l'aigle d'airain qu'il avait sur son casque,
Et qui, calme, immobile et sombre, l'observait,
Cria : Cieux étoilés, montagnes que revêt
L'innocente blancheur des neiges vénérables,
Ô fleuves, ô forêts, cèdres, sapins, érables,
Je vous prends à témoin que cet homme est méchant !
Et cela dit, ainsi qu'un piocheur fouille un champ,
Comme avec sa cognée un pâtre brise un chêne,
Il se mit à frapper à coups de bec Tiphaine ;
Il lui creva les yeux ; il lui broya les dents ;
Il lui pétrit le crâne en ses ongles ardents
Sous l'armet d'où le sang sortait comme d'un crible,
Le jeta mort à terre, et s'envola terrible.
"La Fin de Satan" - Dans la préface de la Légende des Siècles, Hugo fait référence aux trois composantes qui fondent nos interrogations sur l'Être, trois composantes d'une même problématique, l'Humanité, le Mal, l'Infini. La puissance du Mal n'est pas éternelle. La Légende des Siècles était ainsi dans sa pensée rattachée «à deux autres poèmes presque terminés, qui en étaient, l'un le dénouement, l'autre le commencement, la Fin de Satan, Dieu». Dès 1854, Victor Hugo s'était mis, en effet, à la Fin de Satan et en avait écrit presque tout le drame extra-humain, "Hors de la terre", et tout le premier livre, "la Guerre". En 1860, il avait repris son œuvre et avait écrit le second livre, "le Gibet". Le temps a manqué au poète pour écrire le troisième livre, "la Prison", qui comprenait trois parties, les Squelettes, Camille et Lucile, la Prise de la Bastille.
La gravure est de Jean-Paul Laurens (1838-1921). C'est une oeuvre catholique dont le premier morceau figure dans la Légende sous le titre "Première rencontre du Christ avec le tombeau". L'anti-clérical Victor Hugo a composé ses plus beaux vers dans l'hallucinant cauchemar de "Ténèbres" et dans "Satyre"...
Hors de la Terre - I - ET NOX FACTA EST

I - Depuis quatre mille ans il tombait dans l'abîme.
Il n'avait pas encor pu saisir une cime,
Ni lever une fois son front démesuré.
Il s'enfonçait dans l'ombre et la brume, effaré,
Seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles,
Tombaient plus lentement les plumes de ses ailes.
Il tombait foudroyé, morne, silencieux,
Triste, la bouche ouverte et les pieds vers les cieux,
L'horreur du gouffre empreinte à sa face livide.
Il cria : Mort ! - les poings tendus vers l'ombre vide.
Ce mot plus tard fut homme et s'appela Caïn.
Il tombait. Tout à coup un roc heurta sa main ;
Il l'étreignit, ainsi qu'un mort étreint sa tombe
Et s'arrêta. Quelqu'un d'en haut lui cria : - Tombe !
Les soleils s'éteindront autour de toi, maudit !
Et la voix dans l'horreur immense se perdit.
Et pâle, il regarda vers l'éternelle aurore.
Les soleils étaient loin, mais ils brillaient encore.
Satan dressa la tête et dit, levant ses bras :
- Tu mens ! - Ce mot plus tard fut l'âme de judas.
Pareil aux dieux d'airain debout sur leurs pilastres
Il attendit mille ans, l'oeil fixé sur les astres.
Les soleils étaient loin, mais ils brillaient toujours.
La foudre alors gronda dans les cieux froids et sourds,
Satan rit, et cracha du côté du tonnerre
L'immensité qu'emplit l'ombre visionnaire,
Frissonna. Ce crachat fut plus tard Barabbas.
Un souffle qui passait le fit tomber plus bas ...
L'anti-clérical Victor Hugo a composé ses plus beaux vers dans l'hallucinant cauchemar de "Ténèbres" ("Une main écrivait au fond de l'invisible : Responsabilité de l'homme devant Dieu", Le Gibet, Jésus-Christ) ...
"... Tout en marchant, il heurte un obstacle ; il le touche ;
- Quel est cet arbre? Où donc suis-je? dit Barrabas. -
Le long de l'arbre obscur il lève ses deux bras
Si longtemps enchaînés qu'il les dresse avec peine.
- Cet arbre est un poteau, dit-il. Il y promène
Ses doigts par la torture atroce estropiés ;
Et tout à coup, hagard, pâle, ii tâte des pieds.
Comme un hibou surpris rentre sous la feuillée.
Il retire sa main ; elle est toute mouillée.
Ces pieds sont froids, un clou les traverse ; et de sang
Et de fange et de fiel tout le bois est glissant.
Barrabas éperdu recule ; son œil s'ouvre.
Épouvanté, dans l'ombre épaisse qui le couvre,
Et, par degrés, un blême et noir linéament
S'ébauche à son regard sous le noir firmament;
C'est une croix.
En bas on voit un vase où plonge
Une touffe d'hysope entourant une éponge ;
Et, sur l'affreux poteau, nu, sanglant, les yeux morts.
Le front penché, les bras portant le poids du corps,
Ceint de cordes de chanvre autour des reins nouées,
Le flanc percé, les pieds cloués, les mains clouées.
Meurtri, ployé, pendant, rompu, défiguré.
Un cadavre apparaît, blanc, et comme éclairé
De la lividité sépulcrale du rêve ;
Et cette croix au fond du silence s'élève.
Barrabas, comme un homme en sursaut réveillé,
Tressaillit. C'était bien un gibet, vil, souillé,
Effroyable, fixé par des coins dans le sable.
Il regarda. L'horreur était inexprimable ;
Le ciel était dissous dans une âcre vapeur
Où l'on ne sentait rien, sinon qu'on avait peur;
Partout la cécité, la stupeur, une fuite
De la vie, éclipsée, effrayée, ou détruite;
Linceul sur Josaphat, suaire sur Sion ;
L'ombre immense avait l'air d'une accusation;
Le monde était couvert d'une nuit infamante;
C'était l'accablement plus noir que la tourmente,
La morne extinction de l'haleine et du bruit.
Pour l'œil de l'âme, avec ces lettres de la nuit
Qui rendent la pensée insondable lisible.
Une main écrivait au fond de l'invisible :
Responsabilité de l'homme devant Dieu.
Le silence, l'espace obscur, l'heure, le lieu,
Le roc, le sang, la croix, les clous, semblaient des juges;
Et Barrabas, devant cette ombre sans refuges,
Frémit comme devant la face de la loi,
Et, regardant le ciel, lui dit : - Ce n'est pas moi !
Puis, fantôme lui-même en cette nuit stagnante,
Larve tout effarée et toute frissonnante.
Pâle, il se rapprocha lentement du gibet;
Et, tout en y marchant, craintif, il se courbait.
Plus chancelant qu'un mât sur la vague mouvante,
Fauve, et comme attiré, malgré son épouvante.
Par l'espèce de jour qui sortait de ce mort.
Spectre, il montait, avec une sorte d'effort,
Vers l'autre spectre, vague ainsi qu'un crépuscule;
Et cet homme avançait de l'air dont on recule,
Inquiet, hérissé, comme agité du vent,
Et prêt à fuir après chaque pas en avant.
Jésus mort répandait un rayonnement blême;
La mort, comme n'osant s'achever elle-même,
Laissait flotter, au trou morne et sanglant des yeux,
Le reste d'un regard tendre et mystérieux.
Son front penché semblait s'éclairer à mesure
Que cet homme approchait d'une marche mal sûre;
Quand Barrabas fut près, la prunelle brilla;
Si quelque ange, venu des cieux, eût été là.
Il eût cru voir ramper, dans l'horreur d'une tombe.
Un serpent fasciné par l'œil d'une colombe....
Et le bandit, courbé sous l'épaississement
De la brume croissant de moment en moment,
Contemplait ; et la terre avait l'air orpheline ;
L'ombre songeait.
Alors, sur cette âpre colline,
Et sous les vastes cieux désolés et ternis.
Comme si le frisson des pensers infinis
Tombait de cette croix ouvrant ses bras funèbres.
On ne sait quel esprit entra dans les ténèbres
De cet homme, et le fit devenir effrayant.
Un feu profond jaillit de son œil foudroyant.
L'âme immense d'Adam, couché sous le Calvaire,
Sembla soudain monter dans ce voleur sévère.
Il éleva la voix tout à coup, du côté
Où les monts s'enfonçaient dans plus d'obscurité,
Cachant Jérusalem sous le brouillard perdue.
Et pendant qu'il parlait, jetant dans l'étendue
L'anathème, les cris, les courroux, les affronts,
Quelque chose qu'on vit plus tard sur d'autres fronts.
Une langue de flamme, au-dessus de sa tête
Brillait et volait, comme en un vent de tempête ;
Et Barrabas debout, transfiguré, tremblant.
Terrible, cria :
« - Peuple, affreux peuple sanglant,
Qu'as-tu fait? Gain, Dathan, Nemrod, vous autres.
Quel est ce crime-ci qui passe tous les nôtres? ..."


1862 - "Les Misérables"
Victor Hugo acquiert cette renommée de voix de la justice, de la fraternité, voix proscrite, isolée, tournée vers la condition des plus humbles, c'est alors, après "Le Dernier Jour d'un Condamné" (1829, autobiographie des dernières heures d'un homme avant son exécution), "Claude Gueux" (1834, inspiré d'un authentique procès), le temps de trois romans, "les Misérables" (1862), "Les Travailleurs de la mer" (1866, méditation sur l'abîme de l'Océan et du cœur humain, par ailleurs livré à l'éditeur avec 30 dessins originaux) et "L'Homme qui rit" (1869, livre de cauchemar et de fantasmes qu'admireront les surréalistes). Des oeuvres plus légères voient aussi le jour, "Les Chansons des Rues et des Bois" (recueil lyrique, 1865), "Le Théâtre en Liberté" (publié en 1886)...
Publié le même jour, à Paris, Bruxelles, Leipzig, Londres, Milan, Madrid, Rotterdam, Vienne, Rio-de-Janeiro, "Les Misérables" est un énorme roman, peut-être inégal et surchargé, mais riche et puissant, dominé par une inspiration épique, la Bible de l'Humanité, toute la philosophie humaine orientée vers le pardon, et qui peut se résumer ainsi : "Il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, les misérables; de qui est-ce la faute ?" (III). La misère, l'injustice, l'indifférence, un système social répressif, comment l'infortuné peut-il éviter de tomber dans l'infamie, si ce n'est par l`instruction, la justice sociale et la charité évangélique, mais à quel prix? Cette épopée de l'âme, celle du forçat Jean Valjean, qui se rachète par l'abnégation et le travail, se déroule sur fond de fresques historiques (la bataille de Waterloo, l'émeute de juin 1832) et géographiques (les égouts de Paris)...
"Il y a dans notre civilisation des heures redoutables ; ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage..." - "Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l’Église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu’il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passé à travers un trou fait d’un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l’emporta. Isabeau sortit en hâte ; le voleur s’enfuyait à toutes jambes ; Isabeau courut après lui et l’arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C’était Jean Valjean.
Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps « pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée ». Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde, il était quelque peu braconnier ; ce qui lui nuisit. Il y a contre les braconniers un préjugé légitime. Le braconnier, de même que le contrebandier, côtoie de fort près le brigand. Pourtant, disons-le en passant, il y a encore un abîme entre ces races d’hommes et le hideux assassin des villes. Le braconnier vit dans la forêt ; le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer. Les villes font des hommes féroces parce qu’elles font des hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt, font des hommes sauvages. Elles développent le côté farouche, mais souvent sans détruire le côté humain.
Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables ; ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s’éloigne et consomme l’irréparable abandon d’un être pensant ! Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères.
Le 22 avril 1796, on cria dans Paris la victoire de Montenotte remportée par le général en chef de l’armée d’Italie, que le message du Directoire aux Cinq-Cents, du 2 floréal an IV, appelle Buona-Parte ; ce même jour une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. Un ancien guichetier de la prison, qui a près de quatre-vingt-dix ans aujourd’hui, se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l’extrémité du quatrième cordon dans l’angle nord de la cour. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu’elle était horrible. Il est probable qu’il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d’un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d’excessif. Pendant qu’on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait, les larmes l’étouffaient, elles l’empêchaient de parler, il parvenait seulement à dire de temps en temps : J’étais émondeur à Faverolles. Puis, tout en sanglotant, il élevait sa main droite et l’abaissait graduellement sept fois comme s’il touchait successivement sept têtes inégales, et par ce geste on devinait que la chose quelconque qu’il avait faite, il l’avait faite pour vêtir et nourrir sept petits enfants.
Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de vingt-sept jours, sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s’effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu’à son nom ; il ne fut même plus Jean Valjean ; il fut le numéro 24601. ..."
Jean Valjean a été envoyé au bagne pour avoir volé du pain. A sa libération, son passeport jaune d'ancien forçat le rend partout suspect, le voici réduit à errer come une bête traquée et sur le point de devenir un véritable criminel. Recueilli par l'évêque de Digne, Mgr Myriel, Jean Valjean lui vole de l'argenterie. Arrêté par les gendarmes, le saint homme le disculpe, ce qui proque chez Jean Valjean remords et désir de se réhabiliter. INstallé sous le nom de M.Madeleine dans le Pas-de-Calais, il s`enrichit honnêtement et multiplie les actes charitables, devient maire de Montreuil-sur-Mer et reçoit la Légion d'honneur. Mais un policier, Javert, croit reconnaitre en lui un ancien forçat. Un individu que tout le monde prend pour Jean Valjean est arrêté et, au terme d'un terrible débat de conscience, le pseudo M. Madeleine se rend aux Assises, à Saint-Omer, et se dénonce au moment où l`innocent va être condamné. Evadé du bagne et prend sous sa protection une petite fille exploitée par un couple de malfaiteurs, les Thénardier. Cependant il doit se cacher sans cesse car Javert persévère à le poursuivre. A Paris, un étudiant Marius Pontmercy s'éprend de Cosette devenue une jeune femme. Au cours d`une émeute, Jean Valjean sauve les vies de Javert et de Marius et porte ce dernier à travers les égouts de Paris. Javert ne pourra se résoudre à arrêter l'homme qui l'a sauvé et se se jettera dans la Seine. Jean Valjean mourra comme un saint, .."Sans doute, dans l'ombre, quelque ange immense était debout, les ailes déployées, attendant l'âme..."
Chapitre III - Une tempête sous un crâne - Apprenant qu'un nommé Champmathieu, qu`on prend pour lui, va comparaître aux Assises, Jean Valjean se trouve placé devant un épouvantable dilemme: doit-il retourner au bagne ou laisser condamner un innocent à sa place ?
"Faire le poème de la conscience humaine, ne fût-ce qu’à propos d’un seul homme, ne fût-ce qu’à propos du plus infime des hommes, ce serait fondre toutes les épopées dans une épopée supérieure et définitive. La conscience, c’est le chaos des chimères, des convoitises et des tentatives, la fournaise des rêves, l’antre des idées dont on a honte ; c’est le pandémonium des sophismes, c’est le champ de bataille des passions. À de certaines heures, pénétrez à travers la face livide d’un être humain qui réfléchit, et regardez derrière, regardez dans cette âme, regardez dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats de géants comme dans Homère, des mêlées de dragons et d’hydres et des nuées de fantômes comme dans Milton, des spirales visionnaires comme chez Dante. Chose sombre que cet infini que tout homme porte en soi et auquel il mesure avec désespoir les volontés de son cerveau et les actions de sa vie...
Il reculait maintenant avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu’il avait prises tour à tour. Les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestes l’une que l’autre.
– Quelle fatalité ! quelle rencontre que ce Champmathieu pris pour lui ! Être précipité justement par le moyen que la providence paraissait d’abord avoir employé pour l’affermir !
Il y eut un moment où il considéra l’avenir. Se dénoncer, grand Dieu ! se livrer ! Il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu’il faudrait quitter, tout ce qu’il faudrait reprendre. Il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de tous, à l’honneur, à la liberté ! Il n’irait plus se promener dans les champs, il n’entendrait plus chanter les oiseaux au mois de mai, il ne ferait plus l’aumône aux petits enfants ! Il ne sentirait plus la douceur des regards de reconnaissance et d’amour fixés sur lui ! Il quitterait cette maison qu’il avait bâtie, cette chambre, cette petite chambre ! Tout lui paraissait charmant à cette heure. Il ne lirait plus dans ces livres, il n’écrirait plus sur cette petite table de bois blanc ! Sa vieille portière, la seule servante qu’il eût, ne lui monterait plus son café le matin. Grand Dieu ! au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne au pied, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues ! À son âge, après avoir été ce qu’il était ! Si encore il était jeune ! Mais, vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par le garde-chiourme, recevoir le coup de bâton de l’argousin ! avoir les pieds nus dans des souliers ferrés ! tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille ! subir la curiosité des étrangers auxquels on dirait : Celui-là, c’est le fameux Jean Valjean, qui a été maire à Montreuil-sur-mer ! Le soir, ruisselant de sueur, accablé de lassitude, le bonnet vert sur les yeux, remonter deux à deux, sous le fouet du sergent, l’escalier-échelle du bagne flottant ! Oh ! quelle misère ! La destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain ! Et, quoi qu’il fît, il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie : – rester dans le paradis, et y devenir démon ! rentrer dans l’enfer, et y devenir ange !
Que faire, grand Dieu ! que faire ?
La tourmente dont il était sorti avec tant de peine se déchaîna de nouveau en lui. Ses idées recommencèrent à se mêler. Elles prirent ce je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre au désespoir. Ce nom de Romainville lui revenait sans cesse à l’esprit avec deux vers d’une chanson qu’il avait entendue autrefois. Il songeait que Romainville est un petit bois près Paris où les jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d’avril.
Il chancelait au dehors comme au dedans. Il marchait comme un petit enfant qu’on laisse aller seul. À de certains moments, luttant contre sa lassitude, il faisait effort pour ressaisir son intelligence. Il tâchait de se poser une dernière fois, et définitivement, le problème sur lequel il était en quelque sorte tombé d’épuisement. Faut-il se dénoncer ? Faut-il se taire ? – Il ne réussissait à rien voir de distinct. Les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se dissipaient l’un après l’autre en fumée. Seulement il sentait que, à quelque parti qu’il s’arrêtât, nécessairement, et sans qu’il fût possible d’y échapper, quelque chose de lui allait mourir ; qu’il entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche ; qu’il accomplissait une agonie, l’agonie de son bonheur ou l’agonie de sa vertu.
Hélas ! toutes ses irrésolutions l’avaient repris. Il n’était pas plus avancé qu’au commencement.
Ainsi se débattait sous l’angoisse cette malheureuse âme. Dix-huit cents ans avant cet homme infortuné, l’être mystérieux, en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l’humanité, avait aussi lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l’infini, longtemps écarté de la main l’effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d’ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d’étoiles..."
La charge des cuirassiers à Waterloo - Le lien de cet épisode avec l'intrigue ne s'impose pas immédiatement, mais pour Hugo ce qui l'emporte c'est l'importance historique de cette journée, "Waterloo n'est point une bataille : c'est le changement de front de l'univers", Hugo visita longuement le site et en termina l'écriture en juin 1861...
"Ils étaient trois mille cinq cents. Ils faisaient un front d’un quart de lieue. C’étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient vingt-six escadrons ; et ils avaient derrière eux, pour les appuyer, la division de Lefebvre-Desnouettes, les cent six gendarmes d’élite, les chasseurs de la garde, onze cent quatrevingt-dix-sept hommes, et les lanciers de la garde, huit cent quatre-vingts lances. Ils portaient le casque sans crins et la cuirasse de fer battu, avec les pistolets d’arçon dans les fontes et le long sabre-épée. Le matin toute l’armée les avait admirés quand, à neuf heures, les clairons sonnant, toutes les musiques chantant Veillons au salut de l’Empire, ils étaient venus, colonne épaisse, une de leurs batteries à leur flanc, l’autre à leur centre, se déployer sur deux rangs entre la chaussée de Genappe et Frischemont, et prendre leur place de bataille dans cette puissante deuxième ligne, si savamment composée par Napoléon, laquelle, ayant à son extrémité de gauche les cuirassiers de Kellermann et à son extrémité de droite les cuirassiers de Milhaud, avait, pour ainsi dire, deux ailes de fer. L’aide de camp Bernard leur porta l’ordre de l’empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s’ébranlèrent.
Alors on vit un spectacle formidable.
Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonne par division, descendit, d’un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d’un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle-Alliance, s’enfonça dans le fond redoutable où tant d’hommes déjà étaient tombés, y disparut dans la fumée, puis, sortant de cette ombre, reparut de l’autre côté du vallon, toujours compacte et serrée, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille crevant sur elle, l’épouvantable pente de boue du plateau de Mont-Saint-Jean. Ils montaient, graves, menaçants, imperturbables ; dans les intervalles de la mousqueterie et de l’artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant deux divisions, ils étaient deux colonnes ; la division Wathier avait la droite, la division Delord avait la gauche. On croyait voir de loin s’allonger vers la crête du plateau deux immenses couleuvres d’acier. Cela traversa la bataille comme un prodige.
Rien de semblable ne s’était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moskowa par la grosse cavalerie ; Murat y manquait, mais Ney s’y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n’eût qu’une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée çà et là. Pêle-mêle de casques, de cris, de sabres, bondissement orageux des croupes des chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible ; là-dessus les cuirasses, comme les écailles sur l’hydre.
Ces récits semblent d’un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant les hommes-chevaux, les antiques hippanthropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalada l’Olympe, horribles, invulnérables, sublimes ; dieux et bêtes. Bizarre coïncidence numérique, vingt-six bataillons allaient recevoir ces vingt-six escadrons. Derrière la crête du plateau, à l’ombre de la batterie masquée, l’infanterie anglaise, formée en treize carrés, deux bataillons par carré, et sur deux lignes, sept sur la première, six sur la seconde, la crosse à l’épaule, couchant en joue ce qui allait venir, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d’hommes. Elle entendait le grossissement du bruit des trois mille chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres, et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable, puis, subitement, une longue file de bras levés brandissant des sabres apparut au-dessus de la crête, et les casques, et les trompettes, et les étendards, et trois mille têtes à moustaches grises criant : vive l’empereur ! toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l’entrée d’un tremblement de terre. Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d’extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d’apercevoir entre eux et les Anglais un fossé, une fosse. C’était le chemin creux d’Ohain.
L’instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds des chevaux, profond de deux toises entre son double talus ; le second rang y poussa le premier, et le troisième y poussa le second ; les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient les quatre pieds en l’air, pilant et bouleversant les cavaliers, aucun moyen de reculer, toute la colonne n’était plus qu’un projectile, la force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français, le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé, cavaliers et chevaux y roulèrent pêle-mêle se broyant les uns sur les autres, ne faisant qu’une chair dans ce gouffre, et, quand cette fosse fut pleine d’hommes vivants, on marcha dessus et le reste passa. Presque un tiers de la brigade Dubois croula dans cet abîme.
Ceci commença la perte de la bataille.
Une tradition locale, qui exagère évidemment, dit que deux mille chevaux et quinze cents hommes furent ensevelis dans le chemin creux d’Ohain. Ce chiffre vraisemblablement comprend tous les autres cadavres qu’on jeta dans ce ravin le lendemain du combat.
Notons en passant que c’était cette brigade Dubois, si funestement éprouvée, qui, une heure auparavant, chargeant à part, avait enlevé le drapeau du bataillon de Lunebourg.
Napoléon, avant d’ordonner cette charge des cuirassiers de Milhaud, avait scruté le terrain, mais n’avait pu voir ce chemin creux qui ne faisait pas même une ride à la surface du plateau.
Averti pourtant et mis en éveil par la petite chapelle blanche qui en marque l’angle sur la chaussée de Nivelles, il avait fait, probablement sur l’éventualité d’un obstacle, une question au guide Lacoste. Le guide avait répondu non. On pourrait presque dire que de ce signe de tête d’un paysan est sortie la catastrophe de Napoléon.
D’autres fatalités encore devaient surgir.
Était-il possible que Napoléon gagnât cette bataille ? Nous répondons non. Pourquoi ? À cause de Wellington ? à cause de Blücher ? Non. À cause de Dieu.
Bonaparte vainqueur à Waterloo, ceci n’était plus dans la loi du dix-neuvième siècle. Une autre série de faits se préparait, où Napoléon n’avait plus de place. La mauvaise volonté des événements s’était annoncée de longue date..." (chap IX)
La mort de Gavroche - le 5 juin 1832, une manifestation républicaine organisée à l'occasion des funérailles du général Lamarque se termine en émeute, Victor Hugo va ainsi regrouper derrière la barricade de la rue de la Chanvrerie, dans le quartier des Halles, les principaux personnages du roman, Jean Valjean, Marius, Javert et le petit Gavroche, fils des Thénardier, qui va mourir en chantant...
"Une vingtaine de morts gisaient çà et là dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tombé dans une gorge de montagnes entre deux escarpements à pic, peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de hautes maisons. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse ; de là un obscurcissement graduel qui blêmissait même le plein jour. C’est à peine si, d’un bout à l’autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s’apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l’assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s’avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibernes sans grand danger.
Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d’un mort à l’autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on n’osait
lui crier de revenir, de peur d’appeler l’attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre.
– Pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche.
À force d’aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent.
Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l’affût derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l’angle de la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d’une borne, une balle frappa le cadavre.
– Fichtre ! fit Gavroche. Voilà qu’on me tue mes morts.
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier.
Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta :
On est laid à Nanterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C’est la faute à Rousseau
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta :
Je ne suis pas notaire,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.
Une cinquième balle ne réussit qu’à tirer de lui un troisième couplet :
Joie est mon caractère,
C’est la faute à Voltaire,
Misère est mon trousseau,
C’est la faute à Rousseau.
Cela continua ainsi quelque temps.
Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l’air de s’amuser beaucoup. C’était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l’ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s’effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplis-sait son panier. Les insurgés, haletants d’anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait ; lui, il chantait. Ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un homme ; c’était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu’elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort ; chaque fois que la face camarde du spectre s’approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l’enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s’affaissa. Toute la barricade poussa un cri ; mais il y avait de l’Antée dans ce pygmée ; pour le gamin toucher le pavé, c’est comme pour le géant toucher la terre ; Gavroche n’était tombé que pour se redresser ; il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l’air, regarda du côté d’où était venu le coup, et se mit à chanter.
Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à…
Il n’acheva point. Une seconde balle du même tireur l’arrêta court. Cette fois il s’abattit la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s’envoler..." (Chap.XV)

Victor Hugo - les années 1870-1880 - Rentré en France le 5 septembre 1870, Victor Hugo reste à Paris pendant le siège. Il publie, en 1872, un recueil de vers inférieur aux "Châtiments", mais qui les rappelle, "l'Année terrible", puis un dernier roman, "Quatre-vingt-treize" (1873); les premiers volumes d'Actes et Paroles (1875); la deuxième série de "la Légende des siècles" (1877), que suivra la dernière en 1883 ; "L'Histoire d'un crime" (1877), - ce crime est le coup d'Etat de 1851 — et divers poèmes ou recueils de vers : "l'Art d'être grand-père" (1877), "le Pape" (1878), "la Pitié suprême" (1879), "l'Âne" (1880), "Religions et Religion" (1880), les "Quatre vents de l'esprit" (1881) et le drame de "Torquemada" (1882).
Député de la Seine à l'Assemblée nationale de 1871-1875, laquelle siégea d'abord à Bordeaux, il y avait donné sa démission dès mars 1871, pour protester contre les insultes adressées par la droite, monarchiste et cléricale, à Garibaldi, qu'avaient élu quatre départements. Il fut nommé sénateur en 1876; mais il ne pouvait plus aspirer à être effectivement un des chefs du parti républicain : il en était la gloire, et en fut, dans certaines solennités, la grande voix choisie.
"La patrie a cela de poignant qu'en sortir est triste, et qu'y rentrer est quelquefois plus triste encore. Quel proscrit romain n'eût mieux aimé mourir comme Brutus que voir l'invasion d'Attila ? Quel proscrit français n'eût préféré l'exil éternel à l'effondrement de la France sous la Prusse, et à l'arrachement de Metz et de Strasbourg ?
Revenir dans son foyer natal le jour des catastrophes, être ramené par des événements qui vous indignent ; avoir longtemps appelé la patrie dans sa nostalgie et se sentir insulté par la complaisance du destin qui vous exauce en vous humiliant; être tenté de souffleter la fortune qui mêle un vol à une restitution ; retrouver son pays, dulces Argos, sous les pieds de deux empires, l'un en triomphe, l'autre en déroute ; franchir la frontière sacrée à l'heure où l'étranger la viole ; ne pouvoir que baiser la terre en pleurant ; avoir à peine la force de crier : France ! dans, un étouffement de sanglots ; assister à l'écrasement des braves ; voir monter à l'horizon de hideuses fumées, gloire de l'ennemi faite de votre honte ; passer où le carnage vient de passer ; traverser des champs sinistres où l'herbe sera plus épaisse l'année prochaine ; voir se prolonger à perte de vue, à mesure qu'on avance, dans les prés, dans les bois, dans les vallons, dans les collines, cette chose que la France n'aime pas, la fuite ; rencontrer des dispersions farouches de soldats accablés ; puis rentrer dans l'immense ville héroïque qui va subir un monstrueux siège de cinq mois ; retrouver la France, mais gisante et sanglante, revoir Paris, mais affamé et bombardé, certes, c'est là une inexprimable douleur.
C'est l'arrivée des barbares ; eh bien, il y a une autre attaque non moins funeste, c'est l'arrivée des ténèbres...." (Actes & Paroles, Depuis l'Exil)

1870 - La chute de l'Empire
Victor Hugo ne rentrera en France que dix-huit ans plus tard, le 5 septembre 1870, après la chute de l'Empire et la proclamation de la République, et à son retour, le peuple de Paris l'acclame avec enthousiasme, il est désormais cette personnalité tutélaire, un visage de grand-père à barbe blanche robuste et vigoureux, qui publie en 1872 et 1883 la deuxième et troisième série de la Légende des siècles. Mme Hugo est morte en 1868, son fils Charles en 1871. Député de Paris à l`Assemblée Nationale, Hugo vote contre la paix, puis démissionne. Pendant la Commune, il séjourne à Bruxelles, puis au Luxembourg. De retour à Paris, il échoue aux élections législatives, mais devient sénateur inamovible en 1876. Il est alors au summun de de sa gloire, idole de la gauche républicaine et écrivain populaire par excellence....
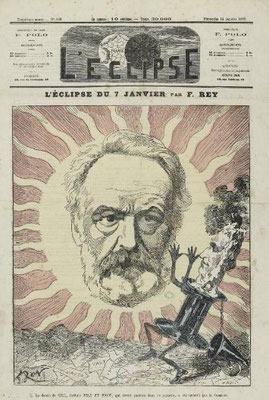
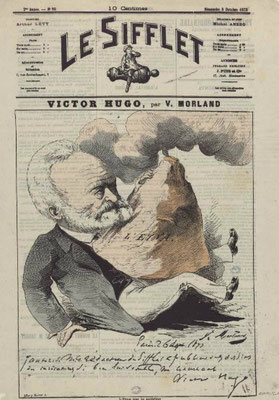
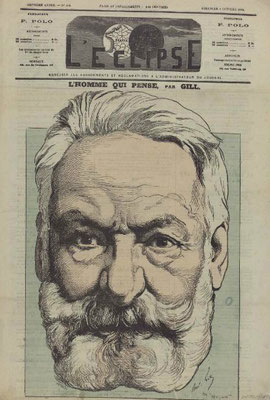
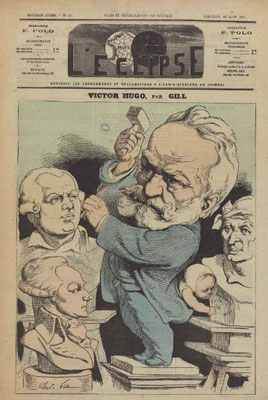
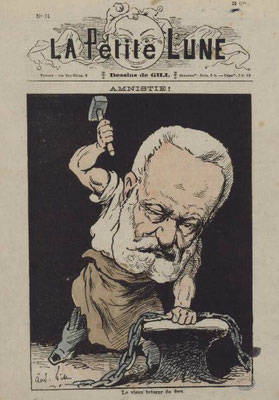
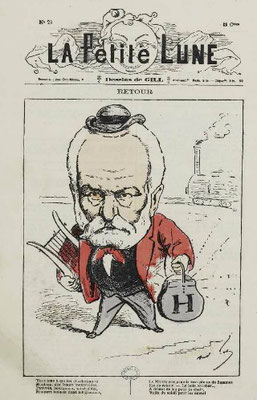

"L'Etna sur la poitrine" (Le Sifflet, 5 octobre 1873) - "L'homme qui pense" (L'Eclipse du 4 octobre 1874) - L'Eclipse du 29 août 1875 - "Les sénateurs de Paris" (Le Journal illustré", n° 7, du 13 février 1876) - "En Classe" - (Le Carillon, 9 novembre 1878) - "Amnistie" (La Petite Lune, 31 juin 1879) - "Salon de 1879" (La Vie Moderne, 15 mai 1879) - "Victor Hugo et ses oeuvres" (Supplément au Journal Illustré, 31 mai 1885)
1870, Peuples, Demain n'est pas un monstre qui nous guette ...
Cette pièce, datée du 20 avril 1870, appartient à la 4e partie des Quatre Vents de l'Esprit, le Livre épique. C'est une sorte de complément à La Légende ses Siècles, "le drame de la Création éclairée par le visage du Créateur" constituait le sujet de cette Légende, ici le poète veut montrer "l'homme montant des ténèbres à l'idéal", à quarante ans d'intervalle, on y trouve l'inspiration de la pièce de Lamartine, Les Révolutions. Une conclusion écrite à Guernesey, à la fin de l'exil...
Peuples, Demain n’est pas un monstre qui nous guette ;
Ni la flèche qu’Hier en s’enfuyant nous jette.
Ô peuples ! l’avenir est déjà parmi nous.
Il veut le droit de tous comme le pain pour tous ;
Calme, invincible, au champ de bataille suprême,
Il lutte ; à voir comment il frappe, on sent qu’il aime ;
Regardez-le passer, ce grand soldat masqué !
Il se dévoilera, peuples, au jour marqué ;
En attendant il fait son œuvre ; la pensée
Sort, lumière, à travers sa visière baissée ;
Il lutte pour la femme, il lutte pour l’enfant,
Pour le peuple qu’il sert, pour l’âme qu’il défend,
Pour l’idéal splendide et libre ; et la mêlée,
Sombre, de ses deux yeux de flamme est étoilée.
Son bouclier, où luit ce grand mot : Essayons !
Est fait d’une poignée énorme de rayons.
Il ébauche l’Europe, il achève la France ;
Il chasse devant lui, terrible, l’ignorance,
Les superstitions où les cœurs sont plongés,
Et tout le tourbillon des pâles préjugés.
Oh ! ne le craignez pas, peuples ! son nom immense,
C’est aujourd’hui Combat et c’est demain Clémence.
À qui te cherche, ô Vrai, jamais tu n’échappas.
Une étape après l’autre. Après un pas, un pas.
Dans sa course qui met en feu son auréole,
Le Progrès n’a pas peur d’entrer, lui qui s’envole,
Chez ce monstre divin, la Révolution.
Il lui prend un éclair et lui donne un rayon ;
Car il le peut, ses yeux étant faits de lumière ;
Puis il sort de la haute et grondante tanière ;
Et son attention est toute désormais
Sur ce grand but, plus pur que les plus blancs sommets,
Plus lointain que la nue à l’horizon perdue :
La Paix, clarté visible à travers l’étendue,
L’Harmonie, attirant vers elle l’élément,
L’Amour, prodigieux et chaud rayonnement.
L’aigle de la montagne est rentré dans son aire ;
Il a fait en passant sa visite au tonnerre ;
Maintenant, l’œil fixé sur l’abîme vermeil,
Calme, il rêve au moyen d’atteindre le soleil.
L'Année terrible, l'année de la guerre de 1870-1871 et de la Commune : elle débute en août 1870 et finit en 1871...
1871, Sur une barricade...
Episode de la Commune, emprunté à "L'Année terrible", publié en 1872, éloquente et vengeresse protestation contre les malheurs et hontes de la défaite et de la guerre civile. Le 21 mars 1871, Victor Hugo quitte la capitale en proie à la Commune, s'établit à Bruxelles, en est expulsé en juin, à la suite d'un article sur le droit d'exil, et se réfugie dans le Luxembourg, à Vianden. C'est de cette ville, le 25 juin 1871, qu'est datée cette pièce...
Sur une barricade, au milieu des pavés
Souillés d’un sang coupable et d’un sang pur lavés,
Un enfant de douze ans est pris avec des hommes.
Es-tu de ceux-là, toi ? L’enfant dit : Nous en sommes.
C’est bon, dit l’officier, on va te fusiller.
Attends ton tour. L’enfant voit des éclairs briller,
Et tous ses compagnons tomber sous la muraille.
Il dit à l’officier : Permettez-vous que j’aille
Rapporter cette montre à ma mère chez nous ?
Tu veux t’enfuir ? Je vais revenir. Ces voyous
Ont peur ! où loges-tu ? Là, près de la fontaine.
Et je vais revenir, monsieur le capitaine.
Va t’en, drôle ! L’enfant s’en va. Piège grossier !
Et les soldats riaient avec leur officier,
Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle ;
Mais le rire cessa, car soudain l’enfant pâle,
Brusquement reparu, fier comme Viala,
Vint s’adosser au mur et leur dit : Me voilà.
La mort stupide eut honte et l’officier fit grâce.
Enfant, je ne sais point, dans l'ouragan qui passe
Et confond tout, le bien, le mal, héros, bandits,
Ce qui dans ce combat te poussait, mais je dis
Que ton âme ignorante est une âme sublime.
Bon et brave, tu fais, dans le fond de l'abîme,
Deux pas, l'un vers ta mère et l'autre vers la mort ;
L'enfant a la candeur et l'homme a le remord,
Et tu ne réponds point de ce qu'on te fit faire ;
Mais l'enfant est superbe et vaillant qui préfère
A la fuite, à la vie, à l'aube, aux jours permis,
Au printemps, le mur sombre où sont morts ses amis.
La gloire au front te baise, ô toi si jeune encore !
Doux ami, dans la Grèce antique, Stésichore
T'eût chargé de défendre une porte d'Argos ;
Cinégyre t'eût dit : Nous sommes deux égaux !
Et tu serais admis au rang des purs éphèbes
Par Tyrtée à Messène et par Eschyle à Thèbes.
On graverait ton nom sur des disques d'airain ;
Et tu serais de ceux qui, sous le ciel serein,
S'ils passent près du puits ombragé par le saule,
Font que la jeune fille ayant sur son épaule
L'urne où s'abreuveront les buffles haletants,
Pensive, se retourne et regarde longtemps.
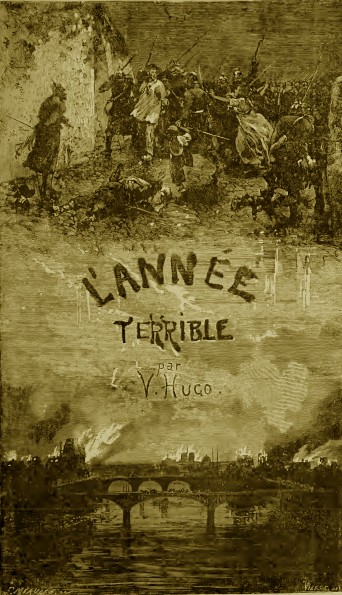
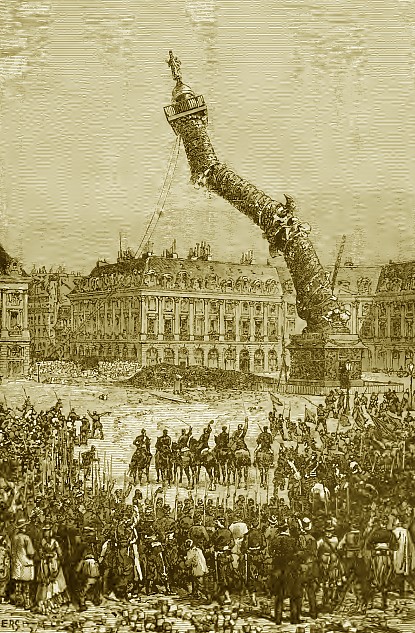
"Le penseur frémit, pareil au vieux roi Lear
Qui parle à la tempête et lui fait des reproches.
Quels signes effrayants! d'affreux jours sont−ils proches ?
Est−ce que l'avenir peut être assassiné ?
Est−ce qu'un siècle meurt quand l'autre n'est pas né ?
Vertige! de qui donc Paris est−il la proie ?
Un pouvoir le mutile, un autre le foudroie.
Ainsi deux ouragans luttent au Sahara.
C'est à qui frappera, c'est à qui détruira.
Peuple, ces deux chaos ont tort; je blâme ensemble
Le firmament qui tonne et la terre qui tremble.
Soit. De ces deux pouvoirs, dont la colère croît,
L'un a pour lui la loi, l'autre a pour lui le droit;
Versailles a la paroisse et Paris la commune;
Mais sur eux, au−dessus de tous, la France est une;
Et d'ailleurs, quand il faut l'un sur l'autre pleurer,
Est−ce bien le moment de s'entre−dévorer,
Et l'heure choisie pour la lutte est−elle bien choisie ?
O fratricide! Ici toute la frénésie
Des canons, des mortiers, des mitrailles; et là
Le vandalisme; ici Charybde, et là Scylla.
Peuple, ils sont deux. Broyant tes splendeurs étouffées,
Chacun ôte à ta gloire un de tes deux trophées;
Nous vivons dans des temps sinistres et nouveaux,
Et de ces deux pouvoirs étrangement rivaux
Par qui le marteau frappe et l'obus tourbillonne,
L'un prend l'Arc de Triomphe et l'autre la Colonne!
Mais c'est la France! Quoi, Français, nous renversons
Ce qui reste debout sur les noirs horizons!
La grande France est là! Qu'importe Bonaparte!
Est−ce qu'on voit un roi quand on regarde Sparte ?
Otez Napoléon, le peuple reparaît....."
Écrit après la visite d'un bagne
Les quatre vents de l'esprit (1881).
Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à l'école une fois,
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix.
C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.
Où rampe la raison, l'honnêteté périt.
Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit,
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,
Les ailes des esprits dans les pages des livres.
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut
Planer là-haut où l'âme en liberté se meut.
L'école est sanctuaire autant que la chapelle.
L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle
Contient sous chaque lettre une vertu ; le coeur
S'éclaire doucement à cette humble lueur.
Donc au petit enfant donnez le petit livre.
Marchez, la lampe en main, pour qu'il puisse vous suivre.
La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat.
Faute d'enseignement, on jette dans l'état
Des hommes animaux, têtes inachevées,
Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,
Aveugles effrayants, au regard sépulcral,
Qui marchent à tâtons dans le monde moral.
Allumons les esprits, c'est notre loi première,
Et du suif le plus vil faisons une lumière.
L'intelligence veut être ouverte ici-bas ;
Le germe a droit d'éclore ; et qui ne pense pas
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre.
Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre,
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or.
Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire ;
Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère,
De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,
Et de vous demander compte de leur esprit ;
Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute ;
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute ;
Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés ;
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés
Ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute ;
Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte ?
Ils sont les malheureux et non les ennemis.
Le premier crime fut sur eux-mêmes commis ;
On a de la pensée éteint en eux la flamme :
Et la société leur a volé leur âme.

1885 - La mort de Victor Hugo
Lorsqu'il entre dans sa quatre-vingtième année, le peuple de Paris l'acclame (février 1881, cf Programme de la Fête de Victor Hugo) et lorsqu'il meurt le 22 mai 1885, ses funérailles nationales, de l`Arc de Triomphe au Panthéon, prennent l'ampleur d'une apothéose (cf. "Victor Hugo après sa mort", peint par M. Bonnat le 22 mai 1885, "Les derniers moments de Victor Hugo", L'Illustration, 30 mai 1885, Portrait mortuaire de Victor Hugo sur son lit de mort figurant en 1ère page de journal hebdomadaire "Le Monde Illustré" du 30 mai 1885, Exposition du corps de Victor Hugo à l'Arc de Triomphe dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1885...).
Ce fut, jusqu'à la fin du siècle, et au delà, une prodigieuse publication d' œuvres inédites : "le Théâtre en liberté" (1886), "la Fin de Satan", poème (1886), "Choses vues, première série" (1887), "Toute la lyre", énorme recueil de vers {1888), "Alpes et Pyrénées", voyages (1890), "Dieu", poème (1891), " France et Belgique", autres voyages (1892), "les Années funestes", poésies (1898), "Choses vues", deuxième série (1899), "Lettres à la Fiancée" (1900), "Post-scriptum de ma vie", ouvrage en prose (1901), la "Dernière gerbe" (1902), et sa Correspondance...

DIEU (1889)
Ce vaste poème philosophique, trop peu connu, annoncé avec "la Fin de Satan", dans la Légende des siècles, fut écrit à Jersey, de 1853 à 1855. Mais c'est bien volontairement que l'auteur le garda manuscrit. Il n'y avait pas mis la dernière main , des vers manquaient... Dans ce poème se manifeste avec plus de force et d'éclat encore que dans la "Fin de Satan" une des facultés maîtresses de Victor Hugo, la plus originale peut-être, cette imagination symbolique et apocalyptique à laquelle il s'abandonna tant de fois, et qui n'a pas seulement émerveillé des poètes comme Baudelaire, des critiques comme Brunetière et des philosophes comme Renouvier. "Dieu" comprend trois parties, "Ascension dans les ténèbres", "Dieu", "le Jour". Le poète, s' élevant dans «l'abîme», à la recherche de l'infini, est arrêté par l'Esprit humain, qui lui offre de lui dévoiler les mystères de la nature : Dis, veux-tu dans la nuit, veux-tu dans le destin Voir quelque lueur d'astre ou quelque lever d'âme ? Tu peux choisir. . .
I. ASCENSION DANS LES TÉNÈBRES
I. L'ESPRIT HUMAIN
Je voyais au loin sur ma tête un point noir.
Comme on voit une mouche au plafond se mouvoir,
Ce point allait, venait, et l'ombre était sublime.
Et, l'homme quand il pense étant ailé, l'abîme
M'attirant dans sa nuit toujours de plus en plus
Comme une algue qu'entraîne un ténébreux reflux,
Vers ce point noir planant dans la profondeur blême
Je me sentais déjà m'envoler de moi-même
Quand je fus arrêté par quelqu'un qui me dit :
— Demeure.
En même temps une main s'étendit.
J'étais déjà très haut dans la nuée obscure.
Et je vis apparaître une étrange figure;
Un être tout semé de bouches, d'ailes, d'yeux.
Vivant, presque lugubre et presque radieux;
Vaste, il volait; plusieurs des ailes étaient chauves.
En s'agitant, les cils de ses prunelles fauves
Jetaient plus de rumeur qu'une troupe d'oiseaux.
Et ses plumes faisaient un bruit de grandes eaux.
Cauchemar de la chair ou vision d'apôtre,
Selon qu'il se montrait d'une face ou de l'autre,
Il semblait une bête ou semblait un esprit.
Il paraissait, dans l'air où mon vol le surprit,
Faire de la lumière et faire des ténèbres.
Calme, il me regardait dans les brouillards funèbres.
Et je sentais en lui quelque chose d'humain.
— Qu'es-tu donc, toi qui viens me barrer le chemin,
Être obscur, frissonnant au souffle de ces brumes? Lui dis-je.
Il répondit :
— Je suis une des plumes
De la nuit, sombre oiseau d'ombres et de rayons,
Noir paon épanoui des constellations.
— Ton nom? dis-je.
II reprit :
- Pour toi qui, loin des causes
Va flottant et ne peux voir qu'un côté des choses,
Je suis l'Esprit humain.
Mon nom est Légion.
Je suis l'essaim des bruits et la contagion
Des mots vivants allant et venant d'âme en âme.
Je suis souffle. Je suis cendre, fumée et flamme.
Tantôt l'instinct brutal, tantôt l'élan divin.
Je suis ce grand passant, vaste, invincible et vain,
Qu'on nomme vent; et j'ai l'étoile et l'étincelle
Dans ma parole, étant l'haleine universelle ;
L'haleine et non la bouche ; un zéphir me grandit
Et m'abat ; et, quand j'ai respiré, j'ai tout dit.
Je suis géant et nain, faux, vrai, sourd et sonore,
Populace dans l'ombre et peuple dans l'aurore;
Je dis moi, je dis nous; j'affirme, nous nions.
Je suis le flux des voix et des opinions,
Le fantôme de l'an, du mois, de la semaine,
Fait du groupe fuyant de la nuée humaine.
Homme, toujours en moi la contradiction
Tourne sa roue obscure et j'en suis l'Ixion.
Démos, c'est moi. C'est moi ce qui marche, attend, roule,
Pleure et rit, nie et croit; je suis le démon Foule.
Je suis comme la trombe, ouragan et pilier.
En même temps je vis dans l'âtre familier.
Oui, j'arrache au tison la soudaine étincelle
Qui heurte un germe obscur que le crâne recèle,
Et qui, des fronts courbés perçant les épaisseurs.
Fait faire explosion à l'esprit des penseurs.
Je vis près d'eux, veilleur intime ; je combine
Le vieux houblon de Flandre et la vigne sabine,
La franche joie attique et le rire gaulois;
L'antique insouciance avec ses douces lois,
Paix, liberté, gaîté, bon sens, est mon breuvage ;
J'en grise Érasme et Sterne, et même mon sauvage
Diderot ; et j'en fais couler quelques filets
De l'amphore d'Horace au broc de Rabelais.
Que suis-je encor?
Je crie à quiconque commence :
Assez! finis! Je suis le médiocre immense,
Toutes les fois qu'on parle et qu'on dit : mitoyen.
Mode, médiateur, méridien, moyen,
Par chacun de ces mots on m'évoque, on m'adjure,
Et tantôt c'est louange, et tantôt c'est injure.
Je suis l'esprit Milieu : l'être neutre, qui va
Bas sans trouver Iblis, haut sans voir Jéhovah ;
Dans le nombre, je suis Multitude; dans l'être,
Borne. Je m'oppose, homme, à l'excès de connaître,
De chercher, de trouver, d'errer, d'aller au bout ;
Je suis Tous, l'ennemi mystérieux de Tout.
Je suis la loi d'arrêt, d'enceinte, de ceinture
Et d'horizon, qui sort de toute la nature;
L'éther irrespirable et bleu sur la hauteur,
Dans le gouffre implacable et sourd la pesanteur.
C'est moi qui dis : « Voici ta sphère. Attends, arrête.
Tout être a sa frontière, homme ou pierre, ange ou bête,
Et doit, sans dilater sa forme d'aujourd'hui,
Subir le nœud des lois qui se croisent en lui.
Je me nomme Limite et je me nomme Centre.
Je garde tous les seuils de tous les mondes. Rentre. »
Tout est par moi saisi, pris, circonscrit, dompté.
Je me défie, ayant peur de l'extrémité,
De la folie un peu, beaucoup de la sagesse.
Je tiens l'enthousiasme et l'appétit en laisse;
Pour qu'il aille au réel sans s'écarter du bien.
J'attelle au genre humain ce lion et ce chien.
Et, comme je suis souffle et poids, nul ne m'évite.
Car tout, comme esprit, flotte et, comme corps, gravite.
Et l'explication, je te l'ai dit, vivant.
C'est que je suis l'esprit matériel, le vent.
Et je suis la matière impalpable, la force.
Je contrains toute sève à couler sous l'écorce.
Tout miroir, étant piège, à mon souffle est terni.
Contre l'enivrement du splendide infini
Je garde les penseurs, ces pauvres mouches frêles.
Je tiens les pieds de ceux dont l'azur prend les ailes.
Je suis parfum, poison, bien, mal, silence, bruit;
Je suis en haut midi, je suis en bas minuit;
Je vais, je viens, je suis l'alternative sombre ;
Je suis l'heure qui fait sortir, en frappant l'ombre.
Douze apôtres le jour, la nuit douze césars.
Du beau donnant sa forme au grand je fais les arts.
Dans les milieux humains, dans les brumes charnelles,
J'erre et je vois ; je suis le troupeau des prunelles.
Je suis l'universel, je suis le partiel.
Je nais de la vapeur ainsi que l'eau du ciel,
Et j'éclos du rocher comme le saxifrage.
Je sors du sentier vert, du foyer, du naufrage,
Du pavé du chemin, de la borne du champ.
Des haillons du noyé sur la grève séchant.
Du flambeau qui s'éteint, de la fleur qui se fane.
ie me suis appelé Pyrrhon, Aristophane,
Démocrite, Aristote, Ésope, Lucien,
Diogène, Timon, Plante, Pline l'Ancien,
Cervantes, Bacon, Swift, Locke, Rousseau, Voltaire.
Je suis la résultante énorme de la terre :
La raison. —
J'étais là, pensif, troublé, muet.
Pendant que j'écoutais, l'être continuait ...
La révélation des mystères de la nature ne saurait lui suffire. Il refuse. Ce qu'il veut, c'est Dieu, ou, comme il dit, Lui... Rires sarcastiques dans les ténèbres....
— Hein? dit l'esprit.
Et tout disparut, et l'espèce
De jour qui blêmissait dans la nuée épaisse
Sombra dans l'air plus noir qu'un ciel cimmérien.
J'entendis un éclat de rire, et ne vis rien.
Hélas! n'étant qu'un homme, une chair misérable,
Dans cette obscurité fauve, âpre, impénétrable,
Dans ces brumes sans fond, sans bords, sous ce linceul,
Je songeai qu'il était horrible d'être seul.
Puis mon esprit revint à son but : — voir, connaître,
Savoir! — pendant que l'ombre affreuse, louche, traître,
Roulant dans ses échos ce noir rire moqueur,
Grandissait dans l'espace ainsi que dans mon cœur.
Alors il me sembla qu'en un sombre mirage,
Comme des tourbillons que chasse un vent d'orage,
Je voyais devant moi pêle-mêle passer
Et croître et frissonner et fuir et s'effacer
Ces cryptes du vertige et ces villes du rêve,
Rome, sur ses frontons changeant en croix son glaive,
Thèbe?, Jérusalem, Mecque, Médine, Hébron;
Des figures tenant à la main un clairon,
Et des arbres hagards, des cavernes, des baumes
Où priaient, barbe au vent, de ténébreux Jérômes,
Et, parmi des babels, des tours, des temples grecs,
D'horribles fronts d'écueils aux cheveux de varechs;
Et tout cela, Ninive, Éphèse, Delphe, Abdère,
Tombeau de saint Grégoire où veille un lampadaire,
Marches de Bénarès, pagodes de Ceylan,
Monts d'où l'aigle de mer le soir prend son élan,
Minarets, parthénons, wigwams, temple d'Aglaure
Où l'on voit l'aube, fleur vertigineuse, éclore,
Et grotte de Calvin, et chambre de Luther,
Passages d'anges bleus dans le liquide éther,
Trépieds où flamboyaient des âmes, yeux de braise
De la chienne Scylla sur la mer calabraise,
Dodone, Horeb, rochers effarés, bois troublants,
Couvent d'Eschmladzin aux quatre clochers blancs,
Noir cromlech de Bretagne, affreux cruack d'Irlande,
Pœstum où les rosiers suspendent leur guirlande,
Temples des fils de Cham, temples des fils de Seth,
Tout lentement flottait et s'évanouissait
Dans une sorte d'âpre et vague perspective;
Et ce n'était, devant ma prunelle attentive.
Que de la vision qui ne fait pas de bruit
Et de la forme obscure éparse dans la nuit.
Et pâle et frissonnant je fis cet appel sombre,
Sans oser élever la voix, de peur de l'ombre :
— Êtres ! lieux! choses! nuit! nuit froide qui te tais!
Cèdres de Salomon, chênes de Teutatès;
O plongeurs de nuée, ô rapporteurs de tables,
Devins, mages, voyants, hommes épouvantables;
Thébaïdes, forêts, solitudes; ombos
Où les docteurs, vivant dans des creux de tombeaux.
S'emplissent d'infini comme d'eau les éponges;
O croisements obscurs des gouffres et des songes,
Sommeil, blanc soupirail des apparitions;
Germes, avatars, nuit des incarnations
Où l'archange s'envole, où le monstre se vautre;
Mort, noir pont naturel entre une étoile et l'autre,
Communication entre l'homme et le ciel;
Colosse de Minerve Aptère, aux pieds duquel
Le vent respectueux fait tomber ceux qui passent;
Flots revenant toujours que les rocs toujours chassent;
Chauve Apollonius, vieux rêveur sidéral ;
O scribes, qui du bout du bâton augural
Tracez de l'alphabet les ténébreux jambages;
Époptes grecs, fakirs, voghis, bonzes, cubages;
Isthme de Suez fermant l'Inde comme un verrou ;
O voûtes d'Ellora, croupes du mont Mérou;
Jean, interlocuteur de l'oiseau Chéroubime;
Et vous, poètes; Dante, homme effrayant d'abîme,
Grand front tragique ombré de feuilles de laurier,
Qui t'en reviens, laissant l'obscurité crier,
Rapportant sous tes cils la lueur des avernes;
Dompteurs qui sans pâlir allez dans les cavernes
Forcer le hurlement jusque dans son chenil;
Pilotes nubiens qui remontez le Nil ;
O prodigieux cerf aux rameaux noirs qui brames
Dans la forêt des djinns, des pandits et des brames;
Hommes enterrés vifs, songeant dans vos cercueils;
O pâtres accoudés, ô bruyères; écueils
Où rêve au crépuscule une forme sinistre;
Pythie assise au front du hideux cap Canistre ;
Angle de lasyringe où les songeurs entrés
Distinguent vaguement des satrapes mitres;
Vous que la lune enivre et trouble, sélénites;
Vous, bénitiers sanglants des seules eaux bénites,
Yeux en pleurs des martyrs; vous, savants indécis;
Merlin, sous l'escarboucle inexprimable assis;
Job, qui contemples; toi, Jérôme, qui médites;
Est-ce qu'on ne peut pas voir un peu de jour, dites?
On éclata de rire une seconde fois.
Et ce rire était plus un rictus qu'une voix;
Il remua longtemps l'ombre visionnaire
Et, s'évanouissant, roula comme un tonnerre,
De nuage en nuage, au fond du ciel grondant.
Et je restai muet, grave, et me demandant
Ce que ma question avait de si risible.
Cependant par degrés l'ombre devint visible;
Et l'être qui m'avait parlé précédemment
Reparut, mais grandi jusqu'à l'effarement...
Néanmoins, le fantôme, qui avait disparu, reparaît, immense, et se répand en une multitude de voix. Les unes veulent décourager le poète, en lui rappelant les efforts inutiles des plus grands penseurs de tous temps ; une autre fait défiler devant lui les différents dieux que l'homme inventés ; une autre lui assure qu'il suffit de connaître les forces naturelles, pour le lui prouver, elle décrit le travail de la goutte d'eau qui a creusé le cirque de Gavarnie. Mais rien ne peut rebuter ni égarer l'ardent chercheur mystique...
— Quoi ! l'homme tomberait, hagard, exténué,
Comme le moucheron qui bat la vitre blême!
Quoi ! tout aboutirait à du néant suprême !
Tout l'effort des chercheurs frémissants se perdrait!
L'homme habiterait l'ombre et serait au secret!
Marcher serait errer! l'aile serait punie !
L'aurore, ô cieux profonds, serait une ironie ! —
Alors, debout, levant la voix, levant les bras,
Éperdu, je criai :
— Cela ne se peut pas!
Grand Inconnu, méchant ou bon ! grand Invisible!
Je te le dis en face, Être : C'est impossible !
(II-Dieu) Après un nouvel éclat de rire dans l'effrayant ciel noir, lui apparaissent successivement les principaux systèmes métaphysiques, représentés par des oiseaux-symboles : l'athéisme, par la chauve-souris ; le scepticisme, par le hibou ; le manichéisme, par le corbeau ; le paganisme, par le vautour ; le mosaïsme, par l'aigle; le christianisme, par le griffon. Puis, «l'Ange» expose le "rationalisme" ; et «la lumière», «ce qui n'a pas encore de nom», c'est-à-dire Dieu.
Mais au moment où le héros-poète, dont le regard, «d'ombre en ombre, et d'étage en étage», a vu «plus d'horizon», va pouvoir contempler enfin : l'invisible, L'innomé, l'idéal, le réel, l'inouï, un spectre le touche du doigt, et il meurt.....
Et ce point prit bientôt la forme d'un suaire.
Les plis vagues jetaient une odeur d'ossuaire ;
Et sous le drap hideux et livide on sentait
Un de ces êtres noirs sur qui la nuit se tait.
C'était de ce linceul qu'était sorti le rire
Qui m'avait par trois fois troublé jusqu'au délire.
Sans que l'Être le dît, je le compris. Mon sang
Se glaça; je frémis.
L'Être parla :
— Passant,
Écoute. — Tu n'as vu jusqu'ici que des songes,
Que de vagues lueurs flottant sur des mensonges,
Que des aspects confus qui passent dans les vents
Ou tremblent dans la nuit pour vous autres vivants.
Mais maintenant veux-tu, d'une volonté forte,
Entrer dans l'infini, quelle que soit la porte?
Ce que l'homme endormi peut savoir, tu le sais.
Mais, esprit, trouves-tu que ce n'est pas assez?
Ton regard, d'ombre en ombre et d'étage en étage,
A vu plus d'horizon... — en veux-tu davantage?
Veux-tu, perçant le morne et ténébreux réseau,
T'envoler dans le vrai comme un sinistre oiseau?
Veux-tu derrière toi laisser tous les décombres,
Temps, espace, et, hagard, sortir des branches sombres?
Veux-tu, réponds, aller plus loin qu'Amos n'alla,
Et, plus avant qu'Esdras et qu'Élie, au delà
Des prophètes pensifs et des blancs cénobites.
Percer l'ombre, emporté par des ailes subites?
O semeur du sillon nébuleux, laboureur
Perdu dans la fumée horrible de l'erreur,
Front où s'abat l'essaim tumultueux des rêves,
Doutes, systèmes vains, effrois, luttes sans trêves.
Te plaît-il de savoir comment s'évanouit
En adoration toute cette âpre nuit?
Veux-tu, flèche tremblante, atteindre enfin ta cible?
Veux-tu toucher le but, regarder l'invisible,
L'innomé, l'idéal, le réel, l'inouï?
Comprendre, déchiffrer, lire? être un ébloui?
Veux-tu planer plus haut que la sombre nature?
Veux-tu dans la lumière inconcevable et pure
Ouvrir tes yeux, par l'ombre affreuse appesantis?
Le veux-tu? Réponds.
— Oui! criai-je.
Et je sentis
Que la création tremblait comme une toile.
Alors, levant un bras et, d'un pan de son voile,
Couvrant tous les objets terrestres disparus,
Il me toucha le front du doigt.
Et je mourus.
