- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Romantisme - Alfred de Musset (1810-1857), "Lorenzaccio" (1834), "Nuits" (1835-1837) - "La Confession d’un enfant du siècle" (1836) - ...
Last update : 07/07/2018

Musset, quoiqu'on en dise, figure parmi les quatre grands romantiques français, après Hugo, avec Lamartine et Vigny, "La Nuit de mai" et "La Nuit de décembre" marquèrent son époque, révélant toute la pathétique de l'amour, de la souffrance et de la poésie, malgré un Baudelaire qui n'a jamais compris sa poétique, ou n'a jamais vraiment essayé ...
"Je ne fais pas grand cas pour moi de la critique.
Toute mouche qu'elle est, c'est rare qu'elle pique.
On m'a dit l'an passé que j'imitais Byron :
Vous qui me connaissez, vous savez bien que non.
Je hais comme la mort l'état de plagiaire;
Mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre.
C'est bien peu, je le sais, que d'être homme de bien,
Mais toujours est-il vrai que je n'exhume rien...
Vous me demanderez si j'aime la nature.
Oui, - j'aime fort aussi les arts et la peinture...
Mais je hais les pleurards, les rêveurs à nacelles,
Les amants de la nuit, des lacs, des cascatelles,
Cette engeance sans nom qui ne peut faire un pas
Sans s'inonder de vers, de pleurs et d'agendas.
La nature sans doute est comme on la veut prendre.
Il se peut, après tout, qu'ils sachent la comprendre
Mais eux certainement je ne les comprends pas...
Vous trouverez, mon cher, mes rimes bien mauvaises,
Quant à ces choses-là, je suis un réformé,
Je n'ai plus de système et j'aime mieux mes aises;
Mais j'ai toujours trouvé honteux de cheviller :
Je vois chez quelques-uns, en ce genre d'escrime,
Des rapports trop exacts avec un menuisier,
Gloire aux auteurs nouveaux qui veulent à la rime
Une lettre de plus qu'il n'en fallait jadis!
Bravo! c'est un bon clou de plus à la pensée.
La vieille liberté par Voltaire laissée
Etait bonne autrefois pour les petits esprits.
(Musset. La Coupe et les Lèvres. Dédicace. Être original)
... mais à peine trente ans, il portait déjà les marques d'un épuisement physique et moral, effet d'une névrose, dont George Sand, dans "Elle et Lui" (1859), récit de leurs amours légendaires, décrit dans le détail les symptômes. Un peu avant d'entrer dans sa trentième année, Musset ébauchera un roman, vite abandonné, dont il ne demeure que de courts fragments, et un titre, Le Poète déchu. Ce qui avait fait la gloire de Musset semble avoir passé, mais "Lorenzaccio" reste au rang des classiques de la scène, sans doute à jamais...
(Portrait réalisé par Charles Landelle en 1854 (musée du Louvre), trois ans avant la mort de Musset)
1836 - "Lettre à M. de Lamartine" (Alfred de Musset, Poésies nouvelles)
En 1831, "Mais je hais les pleurards, les rêveurs à nacelles, Les amants de la nuit, des lacs, des cascatelles", se rit ainsi Musset des imitateurs de Lamartine (La Coupe et les Lèvres). Et, en 1836, à 26 ans, Alfred de Musset écrit à Lamartine, son aîné de vingt ans, un poème dont le thème et l’inspiration sont ceux des "Nuits", rapprochant Elvire et George Sand, s'en remettant à la la volonté mystérieuse de la Providence, "Créature d'un jour qui t'agites une heure, De quoi viens-tu te plaindre et qui te fait gémir?" Lamartine n'apprécia pas...
"Lorsque le grand Byron allait quitter Ravenne,
Et chercher sur les mers quelque plage lointaine
Où finir en héros son immortel ennui,
Comme il était assis aux pieds de sa maîtresse,
Pâle, et déjà tourné du côté de la Grèce,
Celle qu'il appelait alors sa Guiccioli
Ouvrit un soir un livre où l'on parlait de lui.
Avez-vous de ce temps conservé la mémoire,
Lamartine, et ces vers au prince des proscrits,
Vous souvient-il encor qui les avait écrits ?
Vous étiez jeune alors, vous, notre chère gloire.
Vous veniez d'essayer pour la première fois
Ce beau luth éploré qui vibre sous vos doigts. ..."
Musset avait en effet pour Lamartine une fervente admiration qu'il a souvent manifestée et que le poète des Méditations ne lui a pas toujours rendue. Musset aimait en Lamartine la délicate et fière sensibilité d'une âme qui a traversé toutes les passions et tous les orages de la vie sans en garder d'autre trace que le sillon du feu purificateur. Lamartine méprisait, chez le chantre de Rolla et de Mardoche, cette "ironie du coeur", › ce scepticisme impertinent qui glace parfois ses accents les plus sincères. Mais dans le Cours de Littérature, Lamartine fera, en termes magnifiques, amende honorable à Musset, quand il parle des "musiciens du Temple qui se virent surpassés par un ménétrier du plaisir". La Lettre à Lamartine a été écrite en 1836, à l'époque où Musset souffrait encore de la blessure que lui avait laissée son aventure avec George Sand, entre "La Nuit de décembre" et "La Confession d'un enfant du siècle", où s'exhalent éloquemment son angoisse et son désespoir.
Un soir de février 1836, le cœur meurtri et désemparé, il relut les "Méditations", trouva un apaisement dans cette poésie harmonieuse et mélancolique, et éprouva le besoin, par reconnaissance, de se confier au poète du "Lac". La lettre, publiée par la Revue des Deux Mondes, prit place dans les Poésies nouvelles. Musset évoque d'abord le souvenir de Byron; il rappelle que le poète, errant et malheureux, fut console un jour par la lecture du beau poème que Lamartine lui avait dédié dans les Méditations. A son tour, Musset a entendu chez le même poète une voix qui berce sa souffrance.
....
Lamartine, c'est là, dans cette rue obscure,
Assis sur une borne, au fond d'un carrefour,
Les deux mains sur mon coeur, et serrant ma blessure,
Et sentant y saigner un invincible amour ;
C'est là, dans cette nuit d'horreur et de détresse,
Au milieu des transports d'un peuple furieux
Qui semblait en passant crier à ma jeunesse,
« Toi qui pleures ce soir, n'as-tu pas ri comme eux ? »
C'est là, devant ce mur, où j'ai frappé ma tête,
Où j'ai posé deux fois le fer sur mon sein nu ;
C'est là, le croiras-tu ? chaste et noble poète,
Que de tes chants divins je me suis souvenu.
Ô toi qui sais aimer, réponds, amant d'Elvire,
Comprends-tu que l'on parte et qu'on se dise adieu ?
Comprends-tu que ce mot la main puisse l'écrire,
Et le coeur le signer, et les lèvres le dire,
Les lèvres, qu'un baiser vient d'unir devant Dieu ? ..."
Comprends-tu qu'un lien qui, dans l'âme immortelle,
Chaque jour plus profond, se forme à notre insu ;
Qui déracine en nous la volonté rebelle,
Et nous attache au coeur son merveilleux tissu ;
Un lien tout-puissant dont les noeuds et la trame
Sont plus durs que la roche et que les diamants ;
Qui ne craint ni le temps, ni le fer, ni la flamme,
Ni la mort elle-même, et qui fait des amants
Jusque dans le tombeau s'aimer les ossements ;
Comprends-tu que dix ans ce lien nous enlace,
Qu'il ne fasse dix ans qu'un seul être de deux,
Puis tout à coup se brise, et, perdu dans l'espace,
Nous laisse épouvantés d'avoir cru vivre heureux ?
Ô poète ! il est dur que la nature humaine,
Qui marche à pas comptés vers une fin certaine,
Doive encor s'y traîner en portant une croix,
Et qu'il faille ici-bas mourir plus d'une fois.
Car de quel autre nom peut s'appeler sur terre
Cette nécessité de changer de misère,
Qui nous fait, jour et nuit, tout prendre et tout quitter.
Si bien que notre temps se passe à convoiter ?
Ne sont-ce pas des morts, et des morts effroyables,
Que tant de changements d'êtres si variables,
Qui se disent toujours fatigués d'espérer,
Et qui sont toujours prêts à se transfigurer ?
Quel tombeau que le coeur, et quelle solitude !
Comment la passion devient-elle habitude,
Et comment se fait-il que, sans y trébucher,
Sur ses propres débris l'homme puisse marcher ?
Il y marche pourtant ; c'est Dieu qui l'y convie.
Il va semant partout et prodiguant sa vie :
Désir, crainte, colère, inquiétude, ennui,
Tout passe et disparaît, tout est fantôme en lui.
Son misérable coeur est fait de telle sorte
Qu'il fuit incessamment qu'une ruine en sorte ;
Que la mort soit son terme, il ne l'ignore pas,
Et, marchant à la mort, il meurt à chaque pas.
Il meurt dans ses amis, dans son fils, dans son père,
Il meurt dans ce qu'il pleure et dans ce qu'il espère ;
Et, sans parler des corps qu'il faut ensevelir,
Qu'est-ce donc qu'oublier, si ce n'est pas mourir ?
Ah ! c'est plus que mourir, c'est survivre à soi-même.
L'âme remonte au ciel quand on perd ce qu'on aime.
Il ne reste de nous qu'un cadavre vivant ;
Le désespoir l'habite, et le néant l'attend.
Eh bien ! bon ou mauvais, inflexible ou fragile,
Humble ou fier, triste ou gai, mais toujours gémissant,
Cet homme, tel qu'il est, cet être fait d'argile,
Tu l'as vu, Lamartine, et son sang est ton sang.
Son bonheur est le tien, sa douleur est la tienne ;
Et des maux qu'ici-bas il lui faut endurer
Pas un qui ne te touche et qui ne t'appartienne ;
Puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer.
Dis-moi, qu'en penses-tu dans tes jours de tristesse ?
Que t'a dit le malheur, quand tu l'as consulté ?
Trompé par tes amis, trahi par ta maîtresse,
Du ciel et de toi-même as-tu jamais douté ?
Non, Alphonse, jamais. La triste expérience
Nous apporte la cendre, et n'éteint pas le feu.
Tu respectes le mal fait par la Providence,
Tu le laisses passer, et tu crois à ton Dieu.
Quel qu'il soit, c'est le mien ; il n'est pas deux croyances
Je ne sais pas son nom, j'ai regardé les cieux ;
Je sais qu'ils sont à Lui, je sais qu'ils sont immenses,
Et que l'immensité ne peut pas être à deux.
J'ai connu, jeune encore, de sévères souffrances,
J'ai vu verdir les bois, et j'ai tenté d'aimer.
Je sais ce que la terre engloutit d'espérances,
Et, pour y recueillir, ce qu'il y faut semer.
Mais ce que j'ai senti, ce que je veux t'écrire,
C'est ce que m'ont appris les anges de douleur ;
Je le sais mieux encore et puis mieux te le dire,
Car leur glaive, en entrant, l'a gravé dans mon coeur :
Créature d'un jour qui t'agites une heure,
De quoi viens-tu te plaindre et qui te fait gémir ?
Ton âme t'inquiète, et tu crois qu'elle pleure :
Ton âme est immortelle, et tes pleurs vont tarir.
Tu te sens le coeur pris d'un caprice de femme,
Et tu dis qu'il se brise à force de souffrir.
Tu demandes à Dieu de soulager ton âme :
Ton âme est immortelle, et ton coeur va guérir.
Le regret d'un instant te trouble et te dévore ;
Tu dis que le passé te voile l'avenir.
Ne te plains pas d'hier ; laisse venir l'aurore :
Ton âme est immortelle, et le temps va s'enfuir
Ton corps est abattu du mal de ta pensée ;
Tu sens ton front peser et tes genoux fléchir.
Tombe, agenouille-toi, créature insensée :
Ton âme est immortelle, et la mort va venir.
Tes os dans le cercueil vont tomber en poussière
Ta mémoire, ton nom, ta gloire vont périr,
Mais non pas ton amour, si ton amour t'est chère :
Ton âme est immortelle, et va s'en souvenir.

Alfred de Musset (1810-1857)
Né à Paris, après une enfance heureuse et des études brillantes, est admirablement reçu dans les milieux littéraires parisiens, acquiert rapidement la réputation d'enfant prodige du romantisme : il est introduit en 1828, à dix-huit ans, dans le Cénacle romantique, - le Cénacle qui, de 1827 à 1830, du «manifeste» de la préface de Cromwell à l'apothéose d'Hernani, fut au cœur de la révolution romantique, où règne Sainte-Beuve mais surtout Victor Hugo -, et le salon de Charles Nodier à l'Arsenal (Alfred de Vigny, Lamartine). Mais son premier recueil, "Contes d'Espagne et d'Italie" (1830) révèle une fantaisie railleuse par trop éloignée de ses amis romantiques. La mort de son père en 1832 l'affecte particulièrement et le contraint à gagner sa vie, il tente le théâtre mais son échec lors de "La Nuit vénitienne" (1830) l'incite à écrire des pièces sans les faire jouer : "La Coupe et les lèvres", "A quoi rêvent les jeunes filles" (1832), "Les Caprices de Marianne" (1833), "Fantasio" (1834).
Sa passion pour George Sand, de six ans plus âgée, vécue en partie dans le cadre romantique de Venise, - voyage mouvementé, Sand est atteinte de dysenterie, Musset passe son temps dans les cabarets avant d'être la proie d'une fièvre cérébrale, le jeune docteur Pagello devient l'amant de Sand -, est traversée d'orages et ne durera que de 1833 à 1835. Et si George Sand fit de Musset, "un homme d'un enfant" pour reprendre ses termes, on peut comprendre l'impact sur Musset de cette brève et intense liaison, un Musset connu pour son extrême sensibilité, impatient de jouir ou dévorer le temps et tombant dans l'ennui aussi brutalement (Cabanès en fait un portrait conséquent, comme à son habitude, dans ses "Grands Névropathes"). Et en 1834 Eugène Delacroix recevait commande d’un portrait de George Sand ("George Sand habillé en homme"), une amitié amoureuse de trente ans allait ainsi naître..
Jusqu'en 1840, Musset connaît une période de grande activité littéraire et l'écho de ses amours se retrouve dans ses recueils de poèmes, "Les Nuits" (1835-37), "Lettre à Lamartine" (1836), "Souvenir" (1841), ses pièces de théâtre, "On ne badine pas avec l'amour" (1834), "Lorenzaccio" (1835), "Il ne faut jurer de rien" (1836), "Un Caprice" (1837), ainsi que des essais de critique littéraire et des nouvelles.
A 30 ans, sa verve créatrice se tarit, sa santé décline et il meurt le 2 mai 1857, à l'âge de quarante-sept ans, usé par l'alcool, miné par la dépression et la tuberculose, et dans l'obscurité : "Dieu parle, il faut qu'on lui réponde, - Le seul bien qui me reste au monde Est d'avoir quelques fois pleuré..." Nombre de ses successeurs n'auront que mépris pour sa poésie (Baudelaire, Flaubert, Rimbaud), frivolité, dilettantisme, peu travaillée, mais Musset entend s'exprimer tel quel, en être pétri de sensibilité et de contradictions, et c'est dans son théâtre qu'il trouvera par suite la forme littéraire de sa reconnaissance, un théâtre au centre duquel l'amour est omniprésent. Jugé comme un "enfant gâté" dans une vie qui ressemblait à une comédie voluptueuse et mélancolique, Musset ne fut jamais dupe de sa virtuosité, et sans doute d'une grande lucidité..
1829 - Né à Paris en 1810, d'une famille mi-aristocratique, mi-bourgeoise, Alfred de Musset avait reçu d'études excellentes une forte empreinte classique. Mais ses amitiés, ses goûts, sa façon de vivre, tout l'attire vers cette jeunesse dorée, dont il était le héros le plus fêté et que dévorait la fièvre romantique. Il adore le bal, la musique, les chevaux et les vers, surtout le plaisir de vivre. De 1829 à 1833 il publie les pièces réunies sous le titre de "Premières poésies" tandis qu'Achille Devéria réalise cette célèbre gravure de Musset en adolescent désinvolte qui lui restera dès lors associée...
VENISE - Quand Musset a écrit cette chanson (1828), il ne connaissait pas encore l'Italie; c'est en 1834 que se place le voyage à Venise avec George Sand. Mais l`ltalie, surtout celle de Venise, était la grande inspiratrice des romantiques, comme l'Espagne, comme l'Orient grec ou turc; la plupart ont vu à travers les rêves de leur imagination ou les souvenirs de leurs lectures ces terres privilégiées, avant de les avoir visitées ou sans même les avoir jamais visitées. Musset s`abandonne ici au caprice de sa fantaisie, sur les traces de Byron (Marino Faliero, Childe-Harold) et de Shakespeare (Le Marchand de Venise, Othello). Cette pièce prit place dans les Contes d'Espagne et d'Italie (1830), parmi un ensemble de Chansons et fragments où l'on trouve aussi des poésies intitulées Barcelone, Madrid....
Dans Venise la rouge,
Pas un bateau qui bouge,
Pas un pêcheur dans l’eau,
Pas un falot.
Seul, assis à la grève,
Le grand lion soulève,
Sur l’horizon serein,
Son pied d’airain.
Autour de lui, par groupes,
Navires et chaloupes,
Pareils à des hérons
Couchés en ronds,
Dorment sur l’eau qui fume,
Et croisent dans la brume,
En légers tourbillons,
Leurs pavillons.
La lune qui s’efface
Couvre son front qui passe
D’un nuage étoilé
Demi-voilé.
Ainsi, la dame abbesse
De Sainte-Croix rabaisse
Sa cape aux larges plis
Sur son surplis.
Et les palais antiques,
Et les graves portiques,
Et les blancs escaliers
Des chevaliers,
Et les ponts, et les rues,
Et les mornes statues,
Et le golfe mouvant
Qui tremble au vent,
Tout se tait, fors les gardes
Aux longues hallebardes,
Qui veillent aux créneaux
Des arsenaux.
Ah ! maintenant plus d’une
Attend, au clair de lune,
Quelque jeune muguet,
L’oreille au guet.
Pour le bal qu’on prépare,
Plus d’une qui se pare,
Met devant son miroir
Le masque noir.
Sur sa couche embaumée,
La Vanina pâmée
Presse encor son amant,
En s’endormant ;
Et Narcissa, la folle,
Au fond de sa gondole,
S’oublie en un festin
Jusqu’au matin.
Et qui, dans l’Italie,
N’a son grain de folie ?
Qui ne garde aux amours
Ses plus beaux jours ?
Laissons la vieille horloge,
Au palais du vieux doge,
Lui compter de ses nuits
Les longs ennuis.
Comptons plutôt, ma belle,
Sur ta bouche rebelle
Tant de baisers donnés…
Ou pardonnés.
Comptons plutôt tes charmes,
Comptons les douces larmes,
Qu’à nos yeux a coûté
La volupté !

1829 - PORTIA - Conte lyrique, où le poète s'inspire de Byron, mais en évoquant I'Italie galante et pittoresque que les Mémoires de Casanova, publiés à cette époque, avaient mise à la mode. Fils d'un pêcheur vénitien, lui-même gondolier, le jeune Dalti a été jeté dans une vie aventureuse et désordonnée par une passion fatale. Il a enlevé Portia, la jeune femme du vieux comte Onorio Luigi, qu'il a tué, et s'est enfui à Venise avec sa conquête.
"Les premières clartés du jour avaient rougi
L'Orient, quand le comte Onorio Luigi
Rentra du bal masqué. Fatigue ou nonchalance,
La comtesse à son bras s'appuyait en silence,
Et d'une main distraite écartait ses cheveux
Qui tombaient en désordre, et voilaient ses beaux yeux.
Elle s'alla jeter, en entrant dans la chambre,
Sur le bord de son lit. — On était en décembre,
Et déjà l'air glacé des longs soirs de janvier
Soulevait par instants la cendre du foyer..."
Un soir de sincérité, Dalti fait à Portia la confidence de sa vie qu'elle ignore. C'est le fragment que nous donnons ici. "Portía", composé en 1829, publié dans les Contes d'Espagne et d'Italíe (1830) a été écrit avant que Musset ait lui-même vécu son aventure vénitienne; mais il a mis dans le personnage de Dalti un peu de sa jeunesse frivole et capricieuse, et notamment ici sa passion du jeu....
"Venise ! ô perfide cité,
A qui le ciel donna la fatale beauté,
Je respirai cet air dont l'âme est amollie,
Et dont ton souffle impur empesta l'Italie!
Pauvre et pieds nus, la nuit, j'errais sous tes palais.
Je regardais tes grands, qu'un peuple de valets
Entoure, et rend pareils à des paralytiques,
Tes nobles arrogants, et tous tes magnifiques
Dont l'ombre est saluée, et dont aucun ne dort
Que sous un toit de marbre et sur un pavé d'or.
Je n'étais cependant qu'un pêcheur; mais, aux fêtes,
Quand j'allais au théâtre écouter les poètes,
Je revenais le cœur plein de haine, et navré.
Je lisais, je cherchais; c'est ainsi, par degré,
Que je chassai, Portia, comme une ombre légère,
L'amour de l'Océan, ma richesse première.
Je vous vis, — je vendis ma barque et mes filets.
Je ne sais pas pourquoi, ni ce que je voulais,
Pourtant je les vendis. C'était ce que sur terre
J'avais pour tout trésor, ou pour toute misère.
Je me mis à courir, emportant en chemin
Tout mon bien qui tenait dans le creux de ma main.
Las de marcher bientôt, je m'assis, triste et morne,
Au fond d'un carrefour, sur le coin d'une borne.
J'avais vu par hasard, auprès d'un mauvais lieu
De la place Saint-Marc, une maison de jeu.
J'y courus. Je vidai ma main sur une table,
Puis, muet, attendant l'arrêt inévitable,
Je demeurai debout. Ayant gagné d'abord,
Je résolus de suivre et de tenter le sort.
Mais pourquoi vous parler de cette nuit terrible?
Toute une nuit, Portia, le démon invincible
Me cloua sur la place, et je vis devant moi
Pièce à pièce tomber la fortune d'un roi.
Ainsi je demeurai, songeant au fond de l'âme,
Chaque fois qu'en criant tournait la roue infâme,
Que la mer était proche, et qu'à me recevoir
Serait toujours tout prêt ce lit profond et noir.
Le banquier cependant, voyant son coffre vide,
Me dit que c'était tout. Chacun d'un œil avide
Suivait mes mouvements; je tendis mon manteau.
On me jeta dedans la valeur d'un château,
Et la corruption de trente courtisanes.
Je sortis. — Je restai trois jours sous les platanes
Où je vous avais vue, ayant pour tout espoir,
Quand vous y passeriez, d'attendre et de vous voir.
Tout le reste est connu de vous..."

"Contes d'Espagne et d'Italie" (1830)
Les thèmes et l'écriture sont dans ce recueil d'un poète de dix-neuf ans foncièrement romantiques, couleur, exotisme, passions violentes, rimes provocantes, sombre drame de la jalousie en Espagne, "Don Paez", amour et triomphe de la jalousie en Italie (Portia), les contextes attendus des passions romantiques, auxquels il ajouta des pièces qui devinrent célèbres, "Venise", "L'Andalousie", "La ballade de la lune", c'est bien tout le romantisme alors à la mode, passions débridées, dandysme, fashion, orgies de toute nature et particulièrement de style, qui se trouve dans ce volume. Mais dès cette oeuvre s'affirmait un ton singulier. "Ballade à la lune" est le chef d'oeuvre du recueil, outrance romantique pour les uns, parodie du romantisme, pour les autres, c'est ici que l'on trouve la célèbre strophe : "C'était, dans la nuit brune, Sur le clocher jauni, La lune Comme un point sur un i"...
"C'était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La lune
Comme un point sur un i.
Lune, quel esprit sombre
Promène au bout d'un fil,
Dans l'ombre,
Ta face et ton profil ?
Es-tu l'œil du ciel borgne ?
Quel chérubin cafard
Nous lorgne
Sous ton masque blafard '?
N'es-tu rien qu'une boule,
Qu”un grand faucheux bien gras
Qui roule
Sans pattes et sans bras ?
Es-tu, je t'en soupçonne,
Le vieux cadran de fer
Qui sonne
L`heure aux damnés d'enfer ?
Sur ton front qui voyage.
Ce soir ont-ils compté
Quel âge
A leur éternité ?
Est-ce .un ver qui te ronge
Quand ton disque noirci
S'allonge
En croissant rétréci ?
Qui t`avait éborgnée,
L`autre nuit ? T'étais-tu
Cognée
A quelque arbre pointu ?
Car tu vins, pâle et morne,
Coller sur mes carreaux
Ta corne
A travers les barreaux.
Va, lune moribonde,
Le beau corps de Phébé
La blonde
Dans la mer est tombé.
Tu n`en es que la face
Et déjà, tout ridé,
S'efface
Ton front dépossédé...
Lune, en notre mémoire,
De tes belles amours
L'histoire
T'embellira toujours.
Et toujours rajeunie,
Tu seras du passant
Bénie,
Pleine lune ou croissant.
T'aimera le vieux pâtre,
Seul, tandis qu'à ton front
D'albâtre,
Ses dogues aboieront.
T`aimera le pilote,
Dans son grand bâtiment
Qui flotte
Sous le clair firmament.
Et la fillette preste
Qui passe le buisson,
Pied leste,
En chantant sa chanson...
Et qu`il vente ou qu'il neige,
Moi-même, chaque soir,
Que fais-je
Venant ici m`asseoir ?
Je viens voir à la brune,
Sur le clocher jauni,
La lune
Comme un point sur un i.

1833 - Entre son premier recueil et les "Poésies nouvelles" de 1833-1852, la vie de Musset et son inspiration ont été complètement bouleversées par la fatale passion qui achèvera de ruiner une santé que les excès de sa jeunesse avaient déjà gravement compromise. Sa liaison avec George Sand, qui débute en 1833 par le voyage à Venise, durera trois ans, trois cruelles années de luttes et de querelles, de trahisons et de douloureuses réconciliations. La souffrance...
"Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.. quelque goutte de sang" - En 1830, Lamartine, Hugo ou Vigny se veulent poètes et hommes d'action, et le public, plus globalement, s'intéresse plus à la vie politique qu'à la poésie. A contre-courant, Musset ne veut être que poète, apparemment loin du romantisme, c'est pourtant dans ses émotions profondes qu'il va puiser sa matière, et avec le désir de renouer avec une forme régulière plus traditionnelle (Les Secrètes pensées de Rafael, 1830, Namouna, 1832). C'est après six années de cette course au bonheur où l'on voit George Sand en principale protagoniste, mais pas que, qu'il publie avec son recueil des "Poésies nouvelles", ses chefs d'oeuvre lyriques : "Nuit de Mai" (1835), dialogue entre Muse et Poète qui porte à nouveau Musset à la poésie, "Nuit de Décembre" (1835), singulier pour son dédoublement de personnalité, "Lettre à Lamartine" (1835), "Nuit d'Août" (1836), le Poète y défend son ardeur amoureuse face à la Muse, "Nuit d'Octobre" (1837), qui voit le réveil de la douleur "Souvenir" (1841), qui suit une rencontre fortuite avec George Sand. La grande passion de sa vie lui a donné une intensité douloureuse, "mon premier point sera qu'il faut déraisonner", et sa poésie va ainsi se constituer en saisissant, en traduisant dans l'immédiateté, les moments de crises, de déchirement, d'interrogation, c'est la singularité de la poésie de Musset.
Invocation
Aimer, boire et chasser, voilà la vie humaine
Chez les fils du Tyrol, - peuple héroïque et fier!
Montagnard comme l'aigle, et libre comme l'air!
Beau ciel, où le soleil a dédaigné la plaine,
Ce paisible océan dont les monts sont les flots!
Beau ciel tout sympathique, et tout peuplé d'échos!
Là, siffle autour des puits l'écumeur des montagnes,
Qui jette au vent son coeur, sa flèche et sa chanson.
Venise vient au loin dorer son horizon.
La robuste Helvétie abrite ses campagnes.
Ainsi les vents du sud t'apportent la beauté,
Mon Tyrol, et les vents du nord la liberté.
Salut, terre de glace, amante des nuages,
Terre d'hommes errants et de daims en voyages,
Terre sans oliviers, sans vigne et sans moissons.
Ils sucent un sein dur, mère, tes nourrissons;
Mais ils t'aiment ainsi, - sous la neige bleuâtre
De leurs lacs vaporeux, sous ce pâle soleil
Qui respecte les bras de leurs femmes d'albâtre,
Sous la ronce des champs qui mord leur pied vermeil.
Noble terre, salut! Terre simple et naïve,
Tu n'aimes pas les arts, toi qui n'es pas oisive.
D'efféminés rêveurs tu n'es pas le séjour;
On ne fait sous ton ciel que la guerre et l'amour.
On ne se vieillit pas dans tes longues veillées.
Si parfois tes enfants, dans l'écho des vallées,
Mêlent un doux refrain aux soupirs des roseaux,
C'est qu'ils sont nés chanteurs, comme de gais oiseaux.
Tu n'as rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse,
Ni poètes, ni dieux; - tu n'as rien, chasseresse!
Mais l'amour de ton coeur s'appelle d'un beau nom:
La liberté! - Qu'importe au fils de la montagne
Pour quel despote obscur envoyé d'Allemagne
L'homme de la prairie écorche le sillon?
Ce n'est pas son métier de traîner la charrue;
Il couche sur la neige, il soupe quand il tue;
Il vit dans l'air du ciel, qui n'appartient qu'à Dieu.
- L'air du ciel! l'air de tous! vierge comme le feu!
Oui, la liberté meurt sur le fumier des villes.
Oui, vous qui la plantez sur vos guerres civiles,
Vous la semez en vain, même sur vos tombeaux;
Il ne croît pas si bas, cet arbre aux verts rameaux.
Il meurt dans l'air humain, plein de râles immondes,
Il respire celui que respirent les mondes.
Montez, voilà l'échelle, et Dieu qui tend les bras.
Montez à lui, rêveurs, il ne descendra pas!
Prenez-moi la sandale, et la pique ferrée:
Elle est là sur les monts, la liberté sacrée.
C'est là qu'à chaque pas l'homme la voit venir,
Ou, s'il l'a dans le coeur, qu'il l'y sent tressaillir.
Tyrol, nul barde encor n'a chanté tes contrées.
Il faut des citronniers à nos muses dorées,
Et tu n'es pas banal, toi dont la pauvreté
Tend une maigre main à l'hospitalité.
- Pauvre hôtesse, ouvre-moi! tu vaux bien l'Italie,
Messaline en haillons, sous les baisers pâlie,
Que tout père à son fils paye à sa puberté.
Moi, je te trouve vierge, et c'est une beauté;
C'est la mienne; - il me faut, pour que ma soif s'étanche,
Que le flot soit sans tache, et clair comme un miroir.
Ce sont les chiens errants qui vont à l'abreuvoir.
Je t'aime. - Ils ne t'ont pas levé ta robe blanche.
Tu n'as pas, comme Naples, un tas de visiteurs,
Et des ciceroni pour tes entremetteurs.
La neige tombe en paix sur tes épaules nues. -
Je t'aime, sois à moi. Quand la virginité
Disparaîtra du ciel, j'aimerai des statues.
Le marbre me va mieux que l'impure Phryné
Chez qui les affamés vont chercher leur pâture,
Qui fait passer la rue au travers de son lit,
Et qui n'a pas le temps de nouer sa ceinture
Entre l'amant du jour et celui de la nuit.

En 1832, Musset publie "Un spectacle dans un fauteuil", un recueil comprenant deux pièces de théâtre en vers, "La Coupe et les lèvres" et "A quoi rêvent les jeunes filles", et un poème, "Namouna". Cet ensemble est précédé d'une dédicace en vers qui révèle la teneur de l'inspiration de Musset à cette époque : "on n'écrit pas un vers sans que tout l'être ne vibre", écrit-il . Aucun auteur avant lui n'avait ainsi introduit son lecteur dans le processus de sa création poétique avec autant de précision,
".. Au moment du travail , chaque nerf, chaque fibre
Tressaille comme un luth que l'on vient d'accorder.
On n'écrit pas un mot que tout l'être ne vibre.
(Soit dit sans vanité , c'est ce que l'on ressent.)
On ne travaille pas , — on écoute , — on attend.
C'est comme un inconnu qui vous parle à voix basse.
On reste quelquefois une nuit sur la place,
Sans faire un mouvement et sans se retourner.
On est comme un enfant dans ses habits de fête ,
Qui craint de se salir et de se profaner ; —
Et puis , — et puis — enfin ! — on a mal à la tête.
Quel étrange réveil ! comme on se sent boiteux !
Comme on voit que Vulcain vient de tomber des cieux!
C'est l'effet que produit une prostituée ,
Quand , le corps assouvi , l'âme s'est réveillée ,
Et que , comme un vivant qu'on vient d'ensevelir ,
L'esprit lève en pleurant le linceul du plaisir.
Pourtant c'est l'opposé — c'est le corps, c'est l'argile.
C'est le cercueil humain, un moment entr'ouvert,
Si tout finissait là ! voilà le mot terrible.
C'est Jésus , couronné d'une flamme invisible ,
Venant du Pharisien partager le repas.
Le Pharisien parfois voit luire une auréole
Sur son hôte divin ; — puis quand elle s'envole ,
Il dit au fils de Dieu : Si tu ne l'étais pas ?
Je suis le Pharisien , et je dis à mon hôte :
Si ton démon céleste était un imposteur?
Il ne s'agit pas là de reprendre une faute ,
De retourner un vers comme un commentateur ,
Ni de se remâcher comme un bœuf qui rumine.
Il est assez de mains chercheuses de vermine ,
Qui savent éplucher un écrit malheureux ,
Comme un pâtre espagnol épluche un chien lépreux.
Mais croire que l'on tient les pommes d'Hespérides
Et presser tendrement un navet sur son cœur !
Voilà , mon cher ami , ce qui porte un auteur
A des auto-da-fés, — à des infanticides. —
Les rimeurs, vous voyez , sont comme les amans.
Tant qu'on n'a rien écrit , il en est d'une idée ,
Comme d'une beauté qu'on n'a pas possédée.
On l'adore, on la suit , — ses détours sont charmants.
Pendant que l'on tisonne en regardant la cendre,
On la voit voltiger ainsi qu'un salamandre ;
Chaque mot fait pour elle est comme un billet doux ; —
On lui donne à souper, — qui le sait mieux que vous?
(Vous pourriez au besoin traiter une princesse)
Mais dès qu'elle se rend , bonsoir , le charme cesse.
On sent dans sa prison l'hirondelle mourir.
Si tout cela du moins vous laissait quelque chose !
On garde le parfum en effeuillant la rose ;
Il n'est si triste amour qui n'ait son souvenir. ..."
Et l'on y découvre à quel point Musset se distingue de ses contemporains. Au lendemain de 1830, alors que triomphe le mouvement romantique, Musset se livre à une protestation d'indépendance absolue en faveur de l'art pur, loin des engagements politiques et des préoccupations religieuses qui absorbèrent parfois un Hugo ou un Lamartine....
"Un mot pourtant encore avant de vous quitter.
Un artiste est un homme, — il écrit pour des hommes ,
Pour prêtresse du temple il a la liberté ;
Pour trépied , l'univers ; — pour éléments , la vie ;
Pour encens , la douleur , l'amour et l'harmonie ;
Pour victime, son cœur; — pour dieu, lu vérité.
L'artiste est un soldat , qui des rangs d'une armée
Sort et marche en avant — ou chef, — ou déserteur ,
Par deux chemins divers il peut sortir vainqueur.
L'un , comme Calderon et comme Mérimée,
Incruste un plomb brûlant sur la réalité ;
Découpe à son flambeau la silhouette humaine ,
En emporte le moule , et jette sur la scène
Le plâtre de la vie avec sa nudité.
Pas un coup de ciseau sur la sombre effigie ,
Rien qu'un masque d'airain , tel que Dieu l'a fondu.
Cherchez-vous la morale et la philosophie ?
Rêvez , si vous voulez , — voilà ce qu'il a vu.
L'autre , comme Racine et le divin Shakespeare ,
Descend dans le Vésuve , une lampe à la main ,
Et de sa plume d'or ouvre le cœur humain .
C'est pour vous qu'il y fouille , afin de vous redire
Ce qu'il aura senti , ce qu'il aura trouvé ;
Surtout , en le trouvant , ce qu'il aura rêvé.
L'action n'est pour lui qu'un moule à sa pensée.
Hamlet tuera Clodius , — Joad tuera Mathan , —
Qu'importe le combat , si l'éclair de l'épée
Peut nous servir dans l'ombre à voir les combattants? .."
LA COUPE ET LES LÈVRES - "Entre la coupe et les lèvres, il y a place pour un malheur". De ce proverbe, Musset a fait le titre et le sujet de ce poème dramatique, en cinq actes. Cette pièce, faîte pour la lecture, n'a rien de commun avec les Comédies et Proverbes que Musset écrivit plus tard. Le héros du poème, Frank, est un chasseur tyrolíen, individualiste passionné, révolté contre toutes les contraintes sociales. Une figure romantique et un double de l'auteur, tout entier livré au désespoir, par quoi s`exprime la protestation de son hérédité profonde et saine contre une société qui l`emprisonne et le corrompt, et qui tente de vivre en communion avec les puissances les plus obscures et les plus instinctives de la nature humaine.
Mais au hasard d'une vie tourmentée, dévorée par la fièvre de l'action et par les passions, le voici riche et couvert de gloire, regrettant la pureté et l'indépendance de ses jeunes années; c'est alors qu'il retrouve par hasard une humble paysanne tyrolienne, Deïdamia, qu'il a déjà rencontrée. Mais lorsque le héros va rejoindre Deidamia et boire la coupe du bonheur, reparaît l'ignoble Belcolore, symbole du vice dont il est prisonnier. figure d'un destin fatal qui brise la coupe et emporte Frank avec elle.
"Namouna" - Enfin, dans , "Namouna", Hassan. le héros du poème, est partagé entre la plus noble figure de l'amour et son besoin de plaisirs immédiats et faciles. C'est une nouvelle incarnation de Don Juan, jeune homme aux figures multiples comme Musset lui-même. Hassan, dans la pire débauche, traîne le désir d'un attachement absolu, de l'amour total, l'image d'une femme irréelle et pourtant espérée par toute sa chair, qui serait la "femme de son âme". Sainte-Beuve voyait dans "Un spectacle dans un fauteuil", un sommet de l`art de Musset.
C'EST LE COEUR QUI EST POETE
J'aime surtout les vers, cette langue immortelle.
C`est peut-être un blasphème et je le dis tout bas;
Mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas,
Qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle,
Que le monde l'entend et ne la parle pas.
Sachez-le : c'est le cœur qui parle et qui soupire.
Lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond;
C'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire,
Comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont.
Et puissiez-vous trouver, quand vous en voudrez rire
A dépecer nos vers, le plaisir qu'ils nous font!
Qu'importe leur valeur? La muse est toujours belle.
Même pour l'insensé, même pour l'impuissant;
Car sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle.
Mordez et croassez, corbeaux, battez de l'aile;
Le poète est au ciel, et lorsqu'en vous poussant
Il vous y fait monter, c'est qu'il en redescend.
(Namouna)
IL FAUT DERAISONNER
Et j`en dirais bien plus si je me laissais faire.
Ma poétique, un jour, si je puis la donner,
Sera bien autrement savante et salutaire.
C'est trop peu que d'aimer, c'est trop peu que de plaire
Le jour où l'Hélicon m'entendra sermonner,
Mon premier point sera qu'il faut déraisonner.
Celui qui ne sait pas, quand la brise étouffée
Soupire au fond du bois son tendre et long chagrin
Sortir seul, au hasard, chantant quelque refrain,
Plus fou qu'Ophélia de romarin coiffée,
Plus étourdi qu'un page amoureux d'une fée,
Sur son chapeau cassé jouant du tambourin,
Celui qui ne sait pas, durant les nuits brûlantes
Qui font pâlir d'amour l'étoile de Vénus,
Se lever en sursaut, sans raison, les pieds nus.
Marcher, prier, pleurer des larmes ruisselantes.
Et devant l'infini joindre des mains tremblantes,
Le cœur plein de pitié pour des maux inconnus:
Que celui-la rature et barbouille à son aise,
Il peut, tant qu'il voudra, rimer à tour de bras,
Ravauder l'oripeau qu'on appelle antithèse,
Et s'en aller ainsi jusqu'au Père Lachaise,
Traînant à ses talons tous les sots d'ici-bas;
Grand homme, si l'on veut; mais poète non pas ...
(Après une lecture)

"À quoi rêvent les jeunes filles" - Toute autre atmosphère pour la comédie, imitée de Shakespeare, "A quoi rêvent les jeunes filles", mais l'élément théâtral y disparaît, comme dans l`œuvre précédente, dans une évocation lyrique qui efface presque complètement les limites du rêve et de la réalité. Les personnages ont une transparence qui les rend à peine terrestres, Silvio, jeune homme chaste et idéaliste, le vieux duc Laërte qui. ayant décidé de marier une de ses filles à Silvio, s'arrange cependant pour qu'avant leur mariage Ninon et Ninette, - deux jeunes filles naïves et romanesques dont la pensée vagabonde sans cesse vers ce monde sentimental qui les intrigue, les affole et les enchante -, connaissent un petit roman d'amour et ces douces rêveries au clair de lune tant recherchée par les romantiques : "Ecoutez donc, alors, ce qu'il vous faudra faire...."
ACTE I, SCÈNE IV.
FLORA.
Vous lirez mieux, et plus commodément.
(Elles sortent. Entrent Laërte et Silvio)
SILVIO.
Je crois que notre abord met ces dames en fuite.
Ah! monseigneur, j'ai peur de leur avoir déplu.
LAERTE.
Bon, bon, laissez-les fuir, vous leur plairez bien vite.
Dites-moi, mon ami, dans voire temps perdu,
N'avez-vous jamais fait la cour à quelques belles?
Quel moyen preniez-vous pour dompter les cruelles?
SILVIO.
Père, ne raillez pas, je me défendrais mal.
Bien que je sois sorti d'un sang méridional,
Jamais les imbroglios, ni les galanteries,
Ni l'art mystérieux des douces flatteries,
Ce bel art d'être aimé, ne m'ont appartenu;
Je vivrai sous le ciel comme j'y suis venu.
Un serrement de main, un regard de clémence,
Une larme, un soupir, voilà pour moi l'amour;
Et j'aimerai dix ans comme le premier jour.
J'ai de la passion, et n'ai point d'éloquence.
Mes rivaux, sous mes yeux, sauront plaire et charmer.
Je resterai muet; — moi, je ne sais qu'aimer.
LAERTE.
Les femmes cependant demandent autre chose.
Bien plus, sans les aimer, du moment que l'on ose,
On leur plaît. La faiblesse est si chère à leur cœur,
Qu'il leur faut un combat pour avoir un vainqueur.
Croyez-moi, j'ai connu ces êtres variables.
Il n'existe, dit-on, ni deux feuilles semblables,
Ni deux cœurs faits de même, et moi, je vous promets
Qu'en en séduisant une, on séduit tout un monde.
L'une aura les pieds plats, l'autre la jambe ronde,
Mais la communauté ne changera jamais.
Avez-vous jamais vu les courses d'Angleterre?
On prend quatre coureurs, — quatre chevaux sellés;
On leur montre un clocher, puis on leur dit :
Allez! Il s'agit d'arriver, n'importe la manière.
L'un choisit un ravin, — l'autre un chemin battu.
Celui-ci gagnera, s'il ne rencontre un fleuve;
Celui-là fera mieux, s'il n'a le cou rompu.
Tel est l'amour, Silvio; l'amour est une épreuve;
Il faut aller au but, — la femme est le clocher.
Prenez garde au torrent, prenez garde au rocher;
Faites ce qui vous plaît, le but est immobile.
Mais croyez que c'est prendre une peine inutile
Que de rester en place et de crier bien fort :
Clocher! clocher! je l'aime, arrive ou je suis mort.
SILVIO.
Je sens la vérité de votre parabole.
Mais si je ne puis rien trouver, même en parole,
Que pourrai-je valoir, seigneur, en action?
Tout le réel pour moi n'est qu'une fiction;
Je suis dans un salon comme une mandoline
Oubliée en passant sur le bord d'un coussin.
Elle renferme en elle une langue divine,
Mais si son maître dort, tout reste dans son sein.
LAERTE.
Ecoutez donc, alors, ce qu'il vous faudra faire.
Recevoir un mari de la main de son père.
Pour une jeune fille est un pauvre régal.
C'est un serpent doré qu'un anneau conjugal.
C'est dans les nuits d'été, sur une mince échelle,
Une épée à la main, un manteau sur les yeux,
Qu'une enfant de quinze ans rêve ses amoureux.
Avant de se montrer, il faut leur apparaître.
Le père ouvre la porte au matériel époux,
Mais toujours l'idéal entre par la fenêtre.
Voilà, mon cher Silvio, ce que j'attends de vous.
Connaissez-vous l'escrime?
SILVIO.
Oui, je tire l'épée.
LAERTE.
Et pour le pistolet, vous tuez la poupée,
N'est-ce pas? C'est très bien; vous tuerez mes valets.
Mes filles tout à l'heure ont reçu deux billets;
Ne cherchez pas, c'est moi qui les ai fait remettre.
Ah! si vous compreniez ce que c'est qu'une lettre!
Une lettre d'amour lorsque l'on a quinze ans!
Quelle charmante place elle occupe longtemps!
D'abord auprès du cœur, ensuite à la ceinture.
La poche vient après, le tiroir vient enfin.
Mais comme on la promène, en traîneau, en voilure!
Comme on la mène au bal! que de fois en chemin,
Dans le fond de la poche on la presse, on la serre;
Et comme on rit tout bas du bonhomme de père
Qui ne voit jamais rien, de temps immémorial!
Quel travail il se fait dans ces petites têtes!
Voulez-vous, mon ami, savoir ce que vous êtes?
Vous, à l'heure qu'il est? — Vous êtes l'idéal.
Le prince Galaor, le berger d'Arcadie.
Vous êtes un Lara; — j'ai signé votre nom.
Le vieux duc vous prenait pour son gendre, — mais non,
Non! Vous tombez du ciel comme une tragédie;
Vous rossez mes valets; vous forcez mes verrous,
Vous caressez le chien; vous séduisez la fille;
Vous faites le malheur de toute la famille.
Voilà ce que l'on veut trouver dans un époux.
SILVIO.
Quelle mélancolique et déchirante idée!
Elle est juste pourtant; — qu'elle me fait de mal!
LAERTE.
Ah! jeune homme, avez-vous aussi votre idéal?
SILVIO.
Pourquoi pas comme tous? Leur étoile est guidée
Vers un astre inconnu qu'ils ont toujours rêvé;
Et la plupart de nous meurt sans l'avoir trouvé.
LAERTE.
Attachez-vous du prix à des enfantillages?
Cela n'empêche pas les femmes d'être sages,
Bonnes, franches de cœur; c'est un goût seulement;
Cela leur va, leur plaît, — tout cela, c'est charmant.
Écoutez-moi, Silvio : — ce soir, à la veillée,
Vous vous cuirasserez d'un large manteau noir.
Flora dormira bien, c'est moi qui l'ai payée.
Ces dames, pour leur part, descendront en peignoir.
Or, vous vous doutez bien, par cette double lettre,
Que ce que vous vouliez, c'était un rendez-vous.
Car, excepté cela, que veut un billet doux?
Vous pénétrerez donc par la chère fenêtre.
On vous introiluira comme un conspirateur.
Que ferez-vous alors, vous, double séducteur?
Vous entendrez des cris. — C'est alors que le père,
Semblable au commandeur dans le Festin de Pierre,
Dans sa robe de chambre apparaîtra soudain.
Il vous provoquera, sa chandelle à la main.
Vous la lui soufflerez du vent de votre épée.
S'il ne reste par terre une tête coupée,
Il y pourra du moins rester un grand seau d'eau,
Que Flora lestement nous versera d'en haut.
Ce sera tout le sang que nous devrons répandre.
Les valets aussitôt le couvriront de cendre;
On ne saura jamais où vous serez passé,
Et mes filles crieront : « ciel! il est blessé! »
SILVIO.
Je n'achèverai pas cette plaisanterie.
Calculez, mon cher duc, où cela mènera.
Savez-vous, puisqu'il faut enfin qu'on nous marie,
Si je me fais aimer, laquelle m'aimera?
LAERTE.
Peut-être toutes deux, n'est-il pas vrai, mon gendre?
Si je le trouve bon, qu'avez-vous à reprendre?
O mon fils bien aimé! laissons parler les sots.
SILVIO.
On a bouleversé la terre avec des mots.
LAERTE.
Eh! que m'importe à moi! — Je n'ai que vous au monde
Après mes deux enfants. Que me fait un brocard?
Vous êtes assez mûr, sous votre tête blonde,
Pour porter du respect à l'honneur d'un vieillard.
SILVIO.
Ah! je mourrais plutôt. Ce n'est pas ma pensée.
LAERTE.
Supposons que des deux vous vous fassiez aimer.
Celle qui restera voudra vous pardonner.
Votre image, Silvio, sera bientôt chassée
Par un rêve nouveau, par le premier venu.
Croyez-moi, les enfants n'aiment que l'inconnu.
Dès que vous deviendrez le bourgeois respectable
Qui viendra tous les jours s'asseoir à déjeuner,
Qu'on verra se lever, aller et retourner,
Mettre après le café ses coudes sur la table.
On ne cherchera plus l'être mystérieux,
On aimera le frère, et c'est ce que je veux.
Si mon sot de neveu parle de mariage,
On l'en détestera quatre fois davantage,
C'est encor mon souhait. Mes enfants ont du cœur,
L'une soit votre femme, et l'autre votre sœur.
Je me confie à vous, — à vous, fils de mon frère,
Qui serez le mari d'une de mes enfants,
Qui ne souillerez pas la maison de leur père.
Et qui ne jouerez pas avec ses cheveux blancs.
Qui sait? peut-être un jour ma pauvre délaissée
Trouvera quelque part le mari qu'il lui faut.
Mais l'importante affaire est d'éviter ce sot.
(Irus entre)
IRUS
A souper! à souper! messieurs, l'heure est passée.
LAERTE.
Vous avez, Dieu me damne, encor changé d'habit.
IRUS
Oui, celui-là va mieux; l'autre était trop petit.

"Rolla" (1833), publié dans la Revue des Deux Mondes, réimprimé dans les "Poésies nouvelles", à cette époque Musset et George Sand n'ont pas débuté leur relation : Rolla est une figure de l' "enfant du siècle" qui trouvera sa parfaite incarnation avec Octave dans la "Confession". Musset s'est inspiré d'un fait divers assez banal : le suicide d'un jeune dandy très riche, qui avait fait serment, par bravade, de dissiper sa fortune en folles orgies, puis de se tuer. L'histoire de ce sceptique et de révolté, qui s'empoisonne après une nuit de plaisir, sert de prétexte à plusieurs tirades lyriques, d'une éloquence émouvante, ou la rhétorique ne tue pas le lyrisme, et dont la plus célèbre est cette invocation aux religions disparues, qui commence le poème...
"Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre
Marchait et respirait dans un peuple de dieux ;
Où Vénus Astarté, fille de Tonde amère.
Secouait, vierge encor, les larmes de sa mère.
Et fécondait le monde en tordant ses cheveux?
Regrettez-vous le temps où les Nymphes lascives
Ondoyaient au soleil parmi les fleurs des eaux.
Et d un éclat de lire agaçaient sur les rives
Les Faunes indolents couchés dans les roseaux ;
Où les sources tremblaient des baisers de Narcisse ;
Où du nord au midi, sur la création.
Hercule promenait l'éternelle justice,
Sous son manteau sanglant taillé dans un lion :
Où les Sylvains moqueurs, dans l'écorce des chênes
Avec les rameaux verts se balançaient au vent,
Et sifflaient dans l'écho !a chanson du passant ;
Où tout était divin, jusqu'aux douleurs humaines ;
Où le monde adorait ce qu'il tue aujourd'hui ;
Où quatre mille dieux n avaient pas un athée ;
Où tout était heureux, excepté Prométhée ;
Frère aîné de Satan qui tomba comme lui?
— Et quand tout fut changé, le ciel, la terre et l’homme.
Quand le berceau du monde en devint le cercueil,
Quand l’ouragan du Nord sur les débris de Rome
De sa sombre avalanche étendit le linceul, —
Regrettez-vous le temps où d'un siècle barbare
Naquit un siècle d’or plus fertile et plus beau?
Où le vieil univers fendit avec Lazare
De son front rajeuni la pierre du tombeau?
Regrettez-vous le temps où nos vieilles romances
Ouvraient leurs ailes d'or vers le monde enchanté
Où tous nos monuments et toutes nos croyances
Portaient le manteau blanc de leur virginité ;
Où, sous la main du Christ, tout venait de renaître ;
Où le palais du prince et la maison du prêtre.
Portant la même croix sur leur front radieux.
Sortaient de la montagne en regardant les deux ;
Où Cologne et Strasbourg, Notre-Dame et Saint-Pierre,
S’agenouillant au loin dans leurs robes de pierre.
Sur l'orgue universel des peuples prosternés
Entonnaient l'hosanna des siècles nouveau-nés ;
Le temps où se faisait tout ce qu'a dit l'histoire ;
Où sur les saints autels les crucifix d’ivoire
Ouvraient des bras sans tache et blancs comme le lait ;
Où la Vie était jeune, — où la mort espérait?
O Christ ! j’e ne suis pas de ceux que la prière
Dans tes temples muets amène à pas tremblants ;
Je ne suis pas de ceux qui vont à ton Calvaire,
En se frappant le cœur, baiser tes pieds sanglants;
Et je reste debout sous tes sacrés portiques...."
A 19 ans, nanti d'une certaine fortune, Rolla gaspille son bien en quelques années et, malgré sa vie de débauche, rêve de pureté et fuit par-dessous l'ennui : il s'empoisonnera après une dernière nuit d'orgie, comme il se l'était promis. Poésie déclamatoire pour nos contemporains, mais toute une génération se reconnut en lui, partageant un "mal du siècle" dont Musset attribue la cause à l'impossibilité à son époque de croire en quelque noble idéal : "Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire Voltige-t-il encor sur tes os décharnés? Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire; Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés.." La pureté originaire semble perdue, et lorsque la débauche finit d'altérer la pureté de l'âme, au fond ne reste plus qu'un être désemparé... A la dernière minute, Rolla, qui n'avait jamais aimé, est touché par Marion qui lui offre son collier d'or pour le sauver...
....De tous les débauchés de la ville du monde
Où le libertinage est à meilleur marché,
De la plus vieille en vice et de la plus féconde,
Je veux dire Paris, — le plus grand débauché
Était Jacques Rolla. — Jamais, dans les tavernes,
Sous les rayons tremblants des blafardes lanternes,
Plus indocile enfant ne s’était accoudé
Sur une table chaude ou sur un coup de dé.
Ce n’était pas Rolla qui gouvernait sa vie,
C’étaient ses passions ; — il les laissait aller
Comme un pâtre assoupi regarde l’eau couler.
Elles vivaient ; — son corps était l’hôtellerie
Où s’étaient attablés ces pâles voyageurs ;
Tantôt pour y briser les lits et les murailles,
Pour s’y chercher dans l’ombre, et s’ouvrir les entrailles
Comme des cerfs en rut et des gladiateurs ;
Tantôt pour y chanter, en s’enivrant ensemble,
Comme de gais oiseaux qu’un coup de vent rassemble,
Et qui, pour vingt amours, n’ont qu’un arbuste en fleurs.
Le père de Rolla, gentillâtre imbécile,
L’avait fait élever comme un riche héritier,
Sans songer que lui-même, à sa petite ville,
Il avait de son bien mangé plus de moitié.
En sorte que Rolla, par un beau soir d’automne,
Se vit à dix-neuf ans maître de sa personne, —
Et n’ayant dans la main ni talent ni métier.
Il eût trouvé d’ailleurs tout travail impossible ;
Un gagne-pain quelconque, un métier de valet,
Soulevait sur sa lèvre un rire inextinguible.
Ainsi, mordant à même au peu qu’il possédait,
Il resta grand seigneur tel que Dieu l’avait fait.
Hercule, fatigué de sa tâche éternelle,
S’assit un jour, dit-on, entre un double chemin.
Il vit la Volupté qui lui tendait la main :
Il suivit la Vertu, qui lui sembla plus belle.
Aujourd’hui rien n’est beau, ni le mal ni le bien.
Ce n’est pas notre temps qui s’arrête et qui doute ;
Les siècles, en passant, ont fait leur grande route
Entre les deux sentiers, dont il ne reste rien.
Rolla fit à vingt ans ce qu’avaient fait ses pères.
Ce qu’on voit aux abords d’une grande cité,
Ce sont des abattoirs, des murs, des cimetières ;
C’est ainsi qu’en entrant dans la société
On trouve ses égouts. — La virginité sainte
S’y cache à tous les yeux sous une triple enceinte ;
On voile la pudeur, mais la corruption
Y baise en plein soleil la prostitution.
Les hommes dans leur sein n’accueillent leur semblable
Que lorsqu’il a trempé dans le fleuve fangeux
L’acier chaste et brûlant du glaive redoutable
Qu’il a reçu du ciel pour se défendre d’eux.
...C’est ainsi qu’aujourd’hui s’éveillent tes pensées,
Ô Rolla ! c’est ainsi que bondissent tes fers,
Et que devant tes yeux des torches insensées
Courent à l’infini, traversant des déserts.
Écrase maintenant les débris de ta vie ;
Écorche tes pieds nus sur tes flacons brisés ;
Et, dans le dernier toast de ta dernière orgie,
Étouffe le néant dans tes bras épuisés.
Le néant ! le néant ! vois-tu son ombre immense
Qui ronge le soleil sur son axe enflammé ?
L’ombre gagne ! il s’éteint, — l’éternité commence.
Tu n’aimeras jamais, toi qui n’as point aimé.
Rolla, pâle et tremblant, referma la croisée.
Il brisa sur sa tige un pauvre dahlia.
« J’aime, lui dit la fleur, et je meurs embrasée
Des baisers du zéphyr, qui me relèvera.
J’ai jeté loin de moi, quand je me suis parée,
Les éléments impurs qui souillaient ma fraîcheur.
Il m’a baisée au front dans ma robe dorée ;
Tu peux m’épanouir, et me briser le cœur. »
J’aime ! — voilà le mot que la nature entière
Crie au vent qui l’emporte, à l’oiseau qui le suit !
Sombre et dernier soupir que poussera la terre
Quand elle tombera dans l’éternelle nuit !
Oh ! vous le murmurez dans vos sphères sacrées,
Étoiles du matin, ce mot triste et charmant !
La plus faible de vous, quand Dieu vous a créées,
A voulu traverser les plaines éthérées,
Pour chercher le soleil, son immortel amant.
Elle s’est élancée au sein des nuits profondes.
Mais une autre l’aimait elle-même ; — et les mondes
Se sont mis en voyage autour du firmament.
Jacque était immobile, et regardait Marie.
Je ne sais ce qu’avait cette femme endormie
D’étrange dans ses traits, de grand, de déjà vu.
Il se sentait frémir d’un frisson inconnu.
N’était-ce pas sa sœur, cette prostituée ?
Les murs de cette chambre obscure et délabrée
N’étaient-ils pas aussi faits pour l’ensevelir ?
Ne la sentait-il pas souffrir de sa torture,
Et saigner des douleurs dont il allait mourir ?
Oui, dans cette chétive et douce créature
La Résignation marche à pas languissants.
La souffrance est ma sœur, — oui, voilà la statue
Que je devais trouver sur ma tombe étendue,
Dormant d’un doux sommeil tandis que j’y descends.
Oh ! ne t’éveille pas ! ta vie est à la terre,
Mais ton sommeil est pur, — ton sommeil est à Dieu !
Laisse-moi le baiser sur ta longue paupière ;
C’est à lui, pauvre enfant, que je veux dire adieu ;
Lui qui n’a pas vendu sa robe d’innocence,
Lui que je puis aimer, et n’ai point acheté ;
Lui qui se croit encore aux jours de ton enfance,
Lui qui rêve ! — et qui n’a de toi que la beauté....

Les Comédies constituent le domaine de prédilection de Musset, il y peut dérouler toutes les facettes de l'amour, sentiments à peine éclos ou passion vibrante, caprice ou douleur, l'amour est ici spontané, rêve et réalité s'équilibrent avec subtilité, le badinage jamais très loin du tragique, opposant des personnalités grotesques à des personnages attentifs aux problèmes du coeur, Musset nous donne parfois l'impression de vivre en pleine incohérence. Une véritable intensité dramatique, librement écrite et exprimée, parcourt "On ne badine avec l'amour" (1834), - Rosette, la paysanne, succombe victime innocente des jeux amour-orgueil qu'entretiennent Perdican et Camille, -, et "Les Caprices de Marianne" (1833) - Coelio succombera d'amour pour Marianne suite à l'intervention de son ambigu ami, Octave....
1834 - "On ne badine pas avec l’amour"
Au terme de ses études, Perdican rentre au château paternel accompagné de son gouverneur Maître Blazius. Le même jour, escortée de Dame Pluche, arrive aussi sa cousine Camille qui sort du couvent. C'est le Baron, père de Perdican qui a combiné cette rencontre : il veut marier ces enfants qui "s'aimaient" d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. La première entrevue est plutôt décevante : Camille, très réservée, refuse d'embrasser son cousin. Elle a entendu dire tellement de mal des hommes qu'elle a peur de l'amour et préfère revenir au couvent. Cette résistance va rendre Perdican amoureux de sa cousine. De dépit, il descend au village et fait la cour à la naïve paysanne Rosette, sœur de lait de Camille.

"Lorenzaccio" (1834) - Chef d'oeuvre du drame romantique qui campe l'histoire du meurtre du duc Alexandre de Médicis, duc sanguinaire régnant sur une Florence du XVIe siècle partagée peuples et grandes familles républicaines, par son jeune cousin, Lorenzo de Médicis. Compagnon de débauche du duc, personnage sans scrupules et parfaitement cynique, Lorenzo finit par tuer le tyran en sachant que ce meurtre est de toute façon inutile : il périra lui-même assassiné.
L'acte III, scène 3, voit Lorenzo se confier à Philippe Strozzi, un vieux républicain idéaliste qui vient de voir arrêter ses deux fils et veut conspirer contre le duc..
ACTE III, Scène 3
Une rue. Un officier allemand et des soldats ; Thomas Strozzi, au milieu d’eux.
L’OFFICIER - Si nous ne le trouvons pas chez lui, nous le trouverons chez les Pazzi.
THOMAS - Va ton train, et ne sois pas en peine ; tu sauras ce qu’il en coûte.
L’OFFICIER - Pas de menace ; j’exécute les ordres du duc, et n’ai rien à souffrir de personne.
THOMAS - Imbécile ! Qui arrête un Strozzi sur la parole d’un Médicis ! (Il se forme un groupe autour d’eux.)
UN BOURGEOIS - Pourquoi arrêtez-vous ce seigneur ? Nous le connaissons bien ; c’est le fils de Philippe.
UN AUTRE - Lâchez-le ; nous répondons pour lui.
LE PREMIER - Oui, Oui, nous répondons pour les Strozzi. Laisse-le aller, ou prends garde à tes oreilles.
L’OFFICIER - Hors de là, canaille ! Laissez passer la justice du duc, si vous n’aimez pas les coups de hallebardes. (Pierre et Philippe arrivent.)
PIERRE - Qu’y a-t-il ? Quel est ce tapage ? Que fais-tu là, Thomas ?
LE BOURGEOIS - Empêche-le, Philippe, il veut emmener ton fils en prison.
PHILIPPE - En prison ? Et sur quel ordre ?
PIERRE - En prison ? Sais-tu à qui tu as affaire ?
L’OFFICIER - Qu’on saisisse cet homme. (Les soldats arrêtent Pierre.)
PIERRE - Lâchez-moi, misérables, ou je vous éventre comme des pourceaux !
PHILIPPE - Sur quel ordre agissez-vous, monsieur ?
L’OFFICIER, montrant l’ordre du duc. - Voilà mon mandat, j’ai ordre d’arrêter Pierre et Thomas Strozzi. (Les soldats repoussent le peuple, qui leur jette des cailloux.)
PIERRE - De quoi nous accuse-t-on ? Qu’avons-nous fait ? Aidez-moi, mes amis ; rossons cette canaille. (Il tire son épée. Un autre détachement de soldats arrive.)
L’OFFICIER - Venez ici ; prêtez-moi main-forte. (Pierre est désarmé.) En marche ! Et le premier qui approche de trop près, un coup de pique ans le ventre ! Cela leur apprendra à se mêler de leurs affaires.
PIERRE - On n’a pas le droit de m’arrêter sans un ordre des Huit. Je me soucie bien des ordres d’Alexandre ! Où est l’ordre des Huit ?
L’OFFICIER - C’est devant eux que nous vous menons.
PIERRE - Si c’est devant eux, je n’ai rien à dire. De quoi suis-je accusé ?
UN HOMME DU PEUPLE - Comment, Philippe, tu laisses emmener tes enfants au tribunal des Huit !
PIERRE - Répondez donc, de quoi suis-je accusé ?
L’OFFICIER - Cela ne me regarde pas. (Les soldats sortent avec Pierre et Thomas.)
PIERRE, en sortant. - N’ayez aucune inquiétude, mon père ; les Huit me renverront souper à la maison, et le bâtard en sera pour ses frais de justice.
PHILIPPE, seul, s’asseyant sur un banc - J’ai beaucoup d’enfants, mais pas pour longtemps, si cela va si vite. Où en sommes-nous donc si une vengeance aussi juste que le ciel que voilà est clair, est punie comme un crime ! Eh quoi ! Les deux aînés d’une famille vieille comme la ville, emprisonnés comme des voleurs de grand chemin ! La plus grossière insulte châtiée, un Salviati frappé, seulement frappé, et des hallebardes en jeu ! Sors donc du fourreau, mon épée. Si le saint appareil des exécutions judiciaires devient la cuirasse es ruffians et des ivrognes, que la hache et le poignard, cette arme des assassins, protègent l’homme de bien. Ô Christ ! La justice devenue une entremetteuse ! L’honneur des Strozzi souffleté en place publique, et un tribunal répondant des quolibets d’un rustre ! Un Salviati jetant à la plus noble famille de Florence son gant taché de vin et de sang, et, lorsqu’on le châtie, tirant pour se défendre le coupe-tête du bourreau ! Lumière du soleil ! J’ai parlé, il n’y a pas un quart d’heure, contre les idées de révolte, et voilà le pain qu’on me donne à manger, avec mes paroles de paix sur les lèvres ! Allons, mes bras, remuez ; et toi, vieux corps courbé par l’âge et par l’étude, redresse-toi pour l’action ! (Entre Lorenzo.)
LORENZO - Demandes-tu l’aumône, Philippe, assis au coin de cette rue ?
PHILIPPE. Je demande l'aumône à la justice des hommes ; je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillons.
LORENZO. Quel changement va donc s'opérer dans le monde, et quelle nouvelle robe va revêtir la nature, si le masque de la colère s'est posé sur le visage auguste et paisible du vieux Philippe ? ô mon père, quelles sont ces plaintes ? pour qui répands-tu sur la terre les joyaux les plus précieux qu'il y ait sous le soleil, les larmes d'un homme sans peur et sans reproche?
PHILIPPE. Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Tu es un Médicis toi-même, mais seulement par ton nom ; si je t'ai bien connu, si la hideuse comédie que tu joues m'a trouvé impassible et fidèle spectateur, que l'homme sorte de l'histrion. Si tu as jamais été quelque chose d'honnête, sois-le aujourd'hui. Pierre et Thomas sont en prison.
LORENZO. Oui, oui, je sais Cela.
PHILIPPE. Est-ce là ta réponse? Est-ce là ton visage, homme sans épée?
LORENZO. Que veux-tu? dis-le, et tu auras alors ma réponse.
PHILIPPE. Agir! Comment, je n'en sais rien. Quel moyen employer, quel levier mettre sous cette citadelle de mort, pour la soulever et la pousser dans le fleuve ; quoi faire, que résoudre, quels hommes aller prouver, je ne puis le savoir encore. Mais agir, agir, agir ! ô Lorenzo, le temps est venu. N'es-tu pas diffamé, traité de chien et de sans coeur? Si j'ai tenu en dépit de tout ma porte ouverte, ma main ouverte, mon coeur ouvert, parle, et que je voie si je me suis trompé. Ne m'as-tu pas parlé d'un homme qui s'appelle aussi Lorenzo, et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà? Cet homme n'aime-t-il pas sa patrie, n'est-il pas dévoué à ses amis ? Tu le disais, et je l'ai cru. Parle, parle, le temps est venu.
LORENZO. Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me tombe sur la tête.
PHILIPPE. Ami, rire d'un vieillard désespéré, cela porte malheur; si tu dis vrai, à l'action ! j'ai de toi des promesses qui engageraient Dieu lui-même, et c'est sur ces promesses que je j'ai reçu. Le rôle que tu joues est un rôle de boue et de lèpre, tel que l'enfant prodigue ne l'aurait pas joué dans un jour de démence ; et cependant je t'ai reçu. Quand les pierres criaient à ton passage, quand chacun de tes pas faisait jaillir des mares de sang humain, je t'ai appelé du nom sacré d'ami ; je me suis fait sourd pour te croire, aveugle pour t'aimer ; j'ai laissé l'ombre de ta mauvaise réputation passer sur mon honneur, et mes enfants ont douté de moi en trouvant sur ma main la trace hideuse du contact de la tienne. Sois honnête, car je l'ai été ; agis, car tu es jeune, et je suis vieux.
LORENZO. Pierre et Thomas sont en prison ; est-ce là tout?
PHILIPPE. ô Ciel et terre, oui ! C'est là tout. Presque rien, deux enfants de mes entrailles qui vont s'asseoir au banc des voleurs. Deux têtes que j'ai baisées autant de lois que j'ai de cheveux gris, et que je vais trouver demain matin clouées sur la porte de la forteresse ; oui, c'est là tout, rien de plus, en vérité.
LORENZO. Ne me parle pas sur ce ton ; je suis rongé d'une tristesse auprès de laquelle la nuit la plus sombre est une lumière éblouissante, (Il s'assoit près de Philippe. )
PHILIPPE. Que je laisse mourir mes enfants, cela est impossible, vois-tu! on m'arracherait les bras et les jambes, que, comme le serpent, les morceaux mutilés de Philippe se rejoindraient encore et se lèveraient pour la vengeance. je connais si bien tout cela! Les Huit! un tribunal d'hommes de marbre ! une forêt de spectres, sur laquelle passe de temps en temps le vent lugubre du doute qui les agite pendant une minute, pour se résoudre en un mot sans appel. Un mot, un mot, à conscience! Ces hommes-là mangent, ils dorment, ils ont des femmes et des filles ! Ah ! qu'ils tuent et qu'ils égorgent; mais pas mes enfants, pas mes enfants !
LORENZO. Pierre est un homme ; il parlera, et il sera mis en liberté.
PHILIPPE. ô mon Pierre, mon premier né !
LORENZO. Rentrez chez vous, tenez-vous tranquille, ou faites mieux, quittez Florence. je vous réponds de tout, si vous quittez Florence.
PHILIPPE. Moi, un banni! moi dans un lit d'auberge à mon heure dernière! ô Dieu! tout cela pour une parole d'un Salviati !
LORENZO. Sachez-le, Salviati voulait séduire votre fille, mais non pas pour lui seul. Alexandre a un pied dans le lit de cet homme ; il y exerce le droit du seigneur sur la prostitution.
PHILIPPE. Et nous n'agirions pas ! ô Lorenzo, Lorenzo, tu es un homme ferme, toi ; parle-moi, je suis faible, et mon coeur est trop intéressé dans tout cela. je m'épuise, vois-tu ; j'ai trop réfléchi ici-bas ; j'ai trop tourné sur moi-même, comme un cheval de pressoir; je ne vaux plus rien pour la bataille. Dis-moi ce que tu penses, je le ferai.
LORENZ0. Rentrez chez vous, mon bon monsieur.
PHILIPPE. Voilà qui est certain, je vais aller chez les Pazzi; là sont cinquante jeunes gens, tous déterminés. Ils ont juré d'agir ; je leur parlerai noblement, comme un Strozzi et comme un père, et ils m'entendront. Ce soir, j'inviterai à souper les quarante membres de ma famille ; je leur raconterai ce qui m'arrive. Nous verrons! nous verrons ! rien n'est encore fait. Que les Médicis prennent garde à eux ! Adieu, je vais chez les Pazzi ; aussi bien, j'y allais avec Pierre, quand on l'a arrêté.
LORENZO. Il y a plusieurs démons, Philippe ; celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous.
PHILIPPE. Que veux-tu dire ?
LORENZO. Prends-y garde ; c'est un démon plus beau que Gabriel : la liberté, la patrie, le bonheur des hommes, tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre, c'est le bruit des écailles d'argent de ses ailes flamboyantes. Les larmes de ses yeux fécondent la terre, et il tient à la main la palme des martyrs. Ses paroles épurent
l'air autour de ses lèvres; son vol est si rapide, que nul ne peut dire où il va. Prends-y garde ! une lois, dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. j'étais courbé sur mes livres; le toucher de sa main a fait frémir mes cheveux comme une plume légère. Que je l'aie écouté ou non, n'en parlons pas.
PHILIPPE. Je ne te comprends qu'avec peine, et je ne sais pourquoi j'ai peur de te comprendre.
LORENZO. N'avez-vous dans la tête que cela : délivrer vos fils ? Mettez la main sur la conscience ; quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse?
PHILIPPE. Eh bien! oui, que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. Pour moi, et pour tous, j'irai !
LORENZO. Prends garde à toi, Philippe, tu as pensé au bonheur de l'humanité.
PHILIPPE. Que veut dire ceci? Es-tu dedans comme dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes?
LORENZO. Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre.
PHILIPPE. Toi ?
LORENZO. Moi, demain ou après-demain. Rentrez chez vous, tâchez de délivrer vos enfants ; si vous ne le pouvez pas, laissez-leur subir une légère punition; je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'autres dangers pour eux, et je vous répète que d'ici à quelques jours il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit.
PHILIPPE. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais?
LORENZO. Philippe, Philippe, prends garde à toi. Tu as soixante ans de vertu sur ta tête grise ; c'est un enjeu trop cher pour le jouer aux dés.
PHILIPPE. Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle; tu m'irrites singulièrement.
LORENZO. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. j'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son dieu. J'ai Versé plus de larmes sur la pauvre Italie, que Niohé sur ses filles.
PHILIPPE. Eh bien, Lorenzo ?
LORENZO. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant vingt ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine, et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre, car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai, je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de la patrie mourrait de ma main. j'étais un étudiant paisible, je ne m'occupais alors que des arts et des sciences, et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux.
PHILIPPE. J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant je crois rêver.
LORENZO. Et moi aussi, j'étais heureux alors ; j'avais le coeur et les mains tranquilles ; mon nom m'appelait au trône, et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal ; mais j'étais bon, et, pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue ; si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran, quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus.
PHILIPPE. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu ?
LORENZO. Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui a enfanté en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée : il faut que je sois un Brutus.
PHILIPPE. Tu m'étonnes de plus en plus.
LORENZO, J'ai voulu d'abord tuer Clément VII ; je n'ai pas pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. j'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours aucun homme, je travaillais pour l'humanité ; mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron ; je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à Corps avec la tyrannie vivante, la tuer, et après cela porter mon épée sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs, pour réchauffer leur cervelle ampoulée.
PHILIPPE. Quelle tête de fer as-tu, ami ! quelle tête de fer !
LORENZO. La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était, comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon boucher. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles ( pour devenir son ami, et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. j'étais pur comme un lis, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre ce que j'ai souffert, et il y a des blessures dont on ne lève pas l'appareil impunément, je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre ; qu'importe ? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
PHILIPPE. Tu baisses la tête ; tes yeux sont humides.
LORENZO. Non, je ne rougis point; les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. je suis au terme de ma peine, et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier l'abat sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de noeuds coulants que je n'en ai tissus autour de mon bâtard. Ce coeur, jusque auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main ; je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive, et ce dont je veux t'avertir ?
PHILIPPE. - Tu es notre Brutus, si tu dis vrai.
LORENZO. - Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe; je me suis souvenu du bâton d'or couvert d'écorce. Maintenant, je connais les hommes, et je te conseille de ne pas t'en mêler.
PHILIPPE - Pourquoi ?
LORENZO - Ah ! Vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l’océan des hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière ; du fond de votre solitude, vous trouviez l’océan magnifique sous le dais splendide des cieux ; vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde ; vous étiez plein de confiance dans l’ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j’ai plongé ; je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie ; j’en ai parcouru toutes les profondeurs, couvert de ma cloche de verre ; tandis que vous admiriez la surface, j’ai vu les débris des naufrages, les ossements et les Léviathans.
PHILIPPE - Ta tristesse me fend le cœur.
LORENZO - C’est parce que je vous vois tel que j’ai été, et sur le point de faire ce que j’ai fait, que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes ; le tort des livres et des historiens est de nous les montrer différents de ce qu’ils sont. La vie est comme une cité ; on peut y rester cinquante ou soixante ans sans voir autre chose que des promenades et des palais ; mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s’arrêter, en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers. Voilà mon avis, Philippe ; s’il s’agit de sauver tes enfants, je te dis de rester tranquille ; c’est le meilleur moyen pour qu’on te les renvoie après une petite semonce. S’il s’agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à t’apercevoir qu’il n’y a que toi qui en aies.
PHILIPPE - Je conçois que le rôle que tu joues t’ait donné de pareilles idées. Si je te comprends bien, tu as pris, dans un but sublime, une route hideuse, et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu.
LORENZO - Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d’en faire. Je connais la vie, et c’est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Ne mets pas la main là-dedans, si tu respectes quelque chose.
PHILIPPE - Arrête ; ne brise pas comme un roseau mon bâton de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves ; je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté.
LORENZO - Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio ? Et les enfants ne me jettent pas de la boue ? Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas, quand je passe, leurs couteaux et leurs balais pour m’assommer ! Au fond de ces dix mille maisons que voilà, la septième génération parlera encore de la nuit où j’y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fende en deux comme une bûche pourrie ? L’air que vous respirez, Philippe, je le respire ; mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable lin des promenades ; pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat ; que dis-je ? Ô Philippe ! Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m’arrête au seuil de leurs portes ; elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de judas, tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre les poings de rage en remuant dans ma poche quatre ou cinq méchantes pièces d’or.
PHILIPPE - Que le tentateur ne méprise pas le faible ; pourquoi tenter, lorsque l’on doute ?
LORENZO - Suis-je un Satan ? Lumière du ciel ! Je m’en souviens encore ; j’aurais pleuré avec la première fille que j’ai séduite, si elle ne s’était mise à rire. Quand j’ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice comme un enfant de dix ans dans l’armure d’un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate, et que les monstres seuls le portaient au front. J’avais commencé à dire tout haut que mes vingt années de vertu étaient un masque étouffant ; à Philippe ! J’entrai alors dans la vie, et je vis qu’à mon approche tout le monde en faisait autant que moi ; tous les masques tombaient devant mon regard ; l’humanité souleva sa robe et me montra, comme à un adepte digne d’elle, sa monstrueuse nudité. J’ai vu les hommes tels qu’ils sont, et je me suis dit : Pour qui est-ce donc que je travaille ? Lorsque je parcourais les rues de Florence, avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur, et me demandais : Quand j’aurai fait mon coup, celui-là en profitera-t-il ? J’ai vu les républicains dans leurs cabinets ; je suis entré dans les boutiques, j’ai écouté et j’ai guetté, j’ai recueilli les discours des gens du peuple ; j’ai vu l’effet que produisait sur eux la tyrannie ; j’ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée ; j’ai avalé entre deux baisers les armes les plus vertueuses ; j’attendais toujours que l’humanité me laissât voir sur sa face quelque chose d’honnête. J’observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces.
PHILIPPE - Si tu n’as vu que le mal, je te plains, mais je ne puis te croire. Le mal existe, mais non pas sans le bien ; comme l’ombre existe, mais non sans la lumière.
LORENZO - Tu ne veux voir en moi qu’un mépriseur d’hommes, c’est me faire injure, je sais parfaitement qu’il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils ? Que font-ils ? Comment agissent-ils ? Qu’importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort ? Il y a de certains côtés par où tout devient bon : un chien est un ami fidèle ; on peut trouver en lui le meilleur des serviteurs, comme on peut voir aussi qu’il se roule sur ses cadavres, et que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d’une lieue. Tout ce que j’ai à voir, moi, c’est que je suis perdu, et que les hommes n’en profiteront pas plus qu’ils ne me comprendront.
PHILIPPE - Pauvre enfant, tu me navres le cœur ! Mais si tu es honnête, quand tu auras délivré ta patrie, tu le redeviendras. Cela réjouit mon vieux cœur, Lorenzo, de penser que tu es honnête ; alors tu jetteras ce déguisement hideux qui te défigure, et tu redeviendras d’un métal aussi pur que les statues de bronze d’Harmodius et d’Aristogiton.
LORENZO - Philippe, Philippe, j’ai été honnête. La main qui a soulevé une fois le voile de la vérité ne peut plus le laisser retomber ; elle reste immobile jusqu’à la mort, tenant toujours ce voile terrible, et l’élevant de plus en plus au-dessus de la tête de l’homme, jusqu’à ce que l’ange du sommeil éternel lui bouche les yeux.
PHILIPPE - Toutes les maladies se guérissent ; et le vice est aussi une maladie.
LORENZO - Il est trop tard, je me suis fait à mon métier. Le vice a été pour moi un vêtement ; maintenant il est collé à ma peau. Je suis vraiment un ruffian, et quand je plaisante sur mes pareils, je me sens sérieux comme la mort au milieu de la gaieté. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin, et ce qui m’étonne en lui, c’est qu’il n’y ait pas laissé sa raison. Profite de moi, Philippe, voilà ce que j’ai à te dire : ne travaille pas pour ta patrie.
PHILIPPE - Si je te croyais, il me semble que le ciel s’obscurcirait pour toujours, et que ma vieillesse serait condamnée à marcher à tâtons. Que tu aies pris une route dangereuse, cela peut être ; pourquoi ne pourrais-je en prendre une autre qui me mènerait au même point ? Mon intention est d’en appeler au peuple, et d’agir ouvertement.
LORENZO - Prends garde à toi, Philippe, celui qui te le dit sait pourquoi il le dit. Prends le chemin que tu voudras, tu auras toujours affaire aux hommes.
PHILIPPE - Je crois à l’honnêteté des républicains.
LORENZO - Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre ; une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d’établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Qu’ils aient pour eux le peuple, et tout est dit. Je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien. Tout ce que je te demande, c’est de ne pas t’en mêler ; parle, si tu le veux, mais prends garde à tes paroles ; et encore plus à tes actions. Laisse-moi faire mon coup ; tu as les mains pures, et moi, je n’ai rien à perdre.
PHILIPPE - Fais-le, et tu verras.
LORENZO - Soit, – mais souviens-toi de ceci. Vois-tu dans cette petite maison cette famille assemblée autour d’une table ? Ne dirait-on pas des hommes ? Ils ont un corps, et une âme dans ce corps. Cependant, s’il me prenait envie d’entrer chez eux, tout seul, comme me voilà, et de poignarder leur fils aîné au milieu d’eux, il n’y aurait pas un couteau de levé sur moi.
PHILIPPE - Tu me fais horreur. Comment le cœur peut-il rester grand avec des mains comme les tiennes ?
LORENZO - Viens, rentrons à ton palais, et tâchons de délivrer tes enfants.
PHILIPPE - Mais pourquoi tueras-tu le duc, si tu as des idées pareilles ?
LORENZO - Pourquoi ? Tu le demandes ?
PHILIPPE - Si tu crois que c’est un meurtre inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu ?
LORENZO - Tu me demandes cela en face ? Regarde-moi un peu. J’ai été beau, tranquille et vertueux.
PHILIPPE - Quel abîme ! Quel abîme tu m’ouvres !
LORENZO - Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Veux-tu donc que je m’empoisonne, ou que je saute dans l’Arno ? Veux-tu donc que je sois un spectre, et qu’en frappant sur ce squelette (Il frappe sa poitrine), il n’en sorte aucun son ? Si je suis l’ombre de moi-même, veux-tu donc que je m’arrache le seul fil qui rattache aujourd’hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d’autrefois ? Songes-tu que ce meurtre, c’est tout ce qui me reste de ma vertu ? Songes-tu que je glisse depuis deux ans sur un mur taillé à pic, et que ce meurtre est le seul brin d’herbe où j’aie pu cramponner mes ongles ? Crois-tu donc que je n’aie plus d’orgueil, parce que je n’ai plus de honte ? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l’énigme de ma vie ? Oui, cela est certain, si je pouvais revenir à la vertu, si mon apprentissage du vice pouvait s’évanouir, j’épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. Mais j’aime le vin, le jeu et les filles ; comprends-tu cela ? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c’est mon meurtre que tu honores, peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d’infamie ; voilà assez longtemps que les oreilles me tintent, et que l’exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche ; j’en ai assez de me voir conspué par des lâches sans nom qui m’accablent d’injures pour se dispenser de m’assommer, comme ils le devraient, j’en ai assez d’entendre brailler en plein vent le bavardage humain ; il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci, c’est peut-être demain que je tue Alexandre ; dans deux jours j’aurai fini. Ceux qui tournent autour de moi avec des yeux louches, comme autour d’une curiosité monstrueuse apportée d’Amérique, pourront satisfaire leur gosier et vider leur sac à paroles. Que les hommes me comprennent ou non, qu’ils agissent ou n’agissent pas, j’aurai dit aussi ce que j’ai à dire ; je leur ferai tailler leurs plumes si je ne leur fais pas nettoyer leurs piques, et l’humanité gardera sur sa joue le soufflet de mon épée marqué en traits de sang. Qu’ils m’appellent comme ils voudront, Brutus ou Érostrate, il ne me plaît pas qu’ils m’oublient. Ma vie entière est au bout de ma dague, et que la Providence retourne ou non la tête, en m’entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d’Alexandre ; dans deux jours les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté.
PHILIPPE - Tout cela m’étonne, et il y a dans tout ce que tu m’as dit des choses qui me l’ont peine, et d’autres qui me font plaisir. Mais Pierre et Thomas sont en prison, et je ne saurais là-dessus m’en lier à personne qu’à moi-même. C’est en vain que ma colère voudrait ronger son frein ; mes entrailles sont émues trop vivement ; tu peux avoir raison, mais il faut que j’agisse ; je vais rassembler mes parents.
LORENZO - Comme tu voudras ; mais prends garde à toi. Garde-moi le secret, même avec tes amis, c’est tout ce que je demande.
(Ils sortent)
Acte IV, scène XI - (Florence, 1537. Le duc Alexandre de Médicis fait régner la débauche et la tyrannie. Son cousin Lorenzo, que le peuple appelle avec mépris Lorenzaccio, a joué depuis deux ans le rôle du compagnon de débauche pour l'assassiner. Ainsi il a ménagé pour le duc un faux rendez-vous avec sa tante Catherine dans sa propre chambre, où il a pris soin, avec son valet Scoronconcolo, d'habituer les voisins au tapage. Voici le duc pris au piège de Lorenzo malgré les avertissements du cardinal Cibo ("Lorenzo aurait fait demander des chevaux de poste pour s'enfuir dans la nuit même".)....
La chambre de Lorenzo. Entrent le Duc et Lorenzo.
LE DUC. - Je suis transi, - il fait vraiment froid. (Il ôte son épée). Eh bien, mignon, qu'est-ce que tu fais donc ?
LORENZO. - Je roule votre baudrier autour de votre épée, et je la mets sous votre chevet. Il est bon d'avoir toujours une arme sous la main. (Il entortille le baudrier de manière à empêcher l'épée de sortir du fourreau.)
LE DUC. - Tu sais que je n'aime pas les bavardages, et il m'est revenu que la Catherine était une belle parleuse. Pour éviter les conversations, je vais me mettre au lit. - A propos, pourquoi donc as-tu fait demander des chevaux de poste à l'évêque de Marzi ?
LORENZO. - Pour aller voir mon frère, qui est très malade, à ce qu'il m'écrit.
LE DUC. - Va donc chercher ta tante.
LORENZO. - Dans un instant. (Il sort.)
LE DUC, seul. - Faire la cour à une femme qui vous répond "oui" lorsqu'on lui demande "oui ou non", cela m'a toujours paru très sot, et tout à fait digne d'un Français. Aujourd'hui, surtout que j'ai soupé comme trois moines, je serais incapable de dire seulement : "Mon cœur, ou mes chères entrailles", à l'infante d'Espagne. Je veux faire semblant de dormir ; ce sera peut-être cavalier, mais ce sera commode. (Il se couche. - Lorenzo rentre l'épée à la main.)
LORENZO. - Dormez-vous, seigneur ? (Il le frappe.)
LE DUC. - C'est toi, Renzo ?
LORENZO. - Seigneur, n'en doutez pas. (Il le frappe de nouveau. - Entre Scoronconcolo).
SCORONCONCOLO. - Est-ce fait ?
LORENZO. - Regarde, il m' a mordu au doigt. Je garderai jusqu'à la mort cette bague sanglante, inestimable diamant.
SCORONCONCOLO. - Ah ! mon Dieu ! c'est le duc de Florence !
LORENZO, s'asseyant sur le bord de la fenêtre. - Que la nuit est belle ! Que l'air du ciel est pur ! Respire, respire, cœur navré de joie !
SCORONCONCOLO. - Viens, Maître, nous en avons trop fait ; sauvons-nous.
LORENZO. Que le vent du soir est doux et embaumé ! Comme les fleurs des prairies s'entrouvrent ! O nature magnifique, ô éternel repos !
SCORONCONCOLO. - Le vent va glacer sur votre visage la sueur qui en découle. Venez, seigneur.
LORENZO. - Ah ! Dieu de bonté ! quel moment !
SCORONCONCOLO, à part. - Son âme se dilate singulièrement. Quant à moi, je prendrai les devants.
LORENZO. - Attends ! Tire ces rideaux. Maintenant, donne-moi la clef de cette chambre.
SCORONCONCOLO. - Pourvu que les voisins n'aient rien entendu !
LORENZO. - Ne te souviens-tu pas qu'ils sont habitués à notre tapage ? Viens, partons.
(Ils sortent.)

1833 - "Les Caprices de Marianne" - Comédie en deux actes, publiée en 1833 et représentée en 1851, une des perles les plus fines du théâtre de Musset. Librement écrite, sans souci de la scène, c'est une des pièces les meilleures et les plus typiques du théâtre romantique.
Dans une Naples shakespearienne du XVIe siècle se déroule le jeu tragique de l'amour et de la mort, et pour exprimer le drame, Musset a mis au point une prose intense. Marianne est la femme prompte à vouloir celui qui ne se soucie pas d'elle. Musset a peint deux aspects de son âme dans Coelio passionné et dans le sceptique Octave. Coelio aime sans espoir Marianne, épouse du vieux juge Claudio. Il se confie à son ami Octave, cousin de la dame, personnage subtil, sceptique et capricieux, qui lui offre ses services : Coelio, bien que légèrement soupçonneux, accepte. Octave a des difficultés, car Marianne avertit son mari qui la fait surveiller; lorsque le jeune homme lui confie qu'il en aime une autre, Marianne paraît contrariée. Son mari lui a interdit de s'entretenir avec son cousin, mais elle le fait chercher et lui promet de ne plus être sévère pour ses admirateurs et même lui laisse entendre qu'elle le préférerait à Coelio. Averti par Octave, Coelio se rend la nuit sous le balcon de Marianne pour lui déclarer son amour. Ayant appris entre-temps que son mari a fait placer deux spadassins aux aguets, elle s'écrie, dans la nuit : "Fuyez, Octave". Coelio se croit alors trahi par son ami et il meurt, le cœur déchiré. Quand Marianne apprend qu'Octave n'est pas mort, elle voudrait se donner à lui, mais celui-ci ne pense qu'à son ami et la repousse.

1833 - "Fantasio", comédie en deux actes de Musset publiée en 1834, considérée comme la plus brillante des comédies de Musset, le personnage du prince de Mantoue, fantoche ridicule, ajoute à une pièce d'esprit et de poésie. Musset n'avait que vingt-trois ans.
Fantasio, jeune bourgeois de Munich. explique à ses amis qu'à force d`analyser son plaisir il a perdu toute illusion et s'ennuie. Passe un enterrement, c'est celui du bouffon de la cour de Bavière, Saint-Jean. Afin d`échapper à ses créanciers. Fantasio imagine de prendre la place laissée vacante par la mort de Saint-Jean. Il s'introduit au palais où il assiste aux préparatifs du mariage de la princesse Elsbeth, à qui le roi son père fait épouser pour raison d`Etat. le prince de Mantoue. Celui-ci, personnage grotesque, arrive ; mais, pour observer à son aise sa fiancée. il se fait passer pour son propre aide de camp; Fantasio, qui a déjà su gagner la confiance d`Elsbeth, surprend sa tristesse, montre qu'il en a compris les causes et lui fait savoir la compassion qu'il a pour elle. A l'aide d`un hameçon, il enlève dans les airs la perruque du faux aide de camp. Le prince de Mantoue se révèle et le bouffon est emprisonné. Alors, apprenant le travestissement du fiancé, la gouvernante d'Elsbeth, vieille femme pleine d`extravagances, s'imagine que le vrai fiancé est le nouveau bouffon ; et elle emmène la princesse le visiter dans sa prison, Fantasio avoue qu`il ne s`est réfugié auprès du trône que pour échapper à ses créanciers. Mais le prince de Mantoue ne se contente pas du châtiment du bouffon offensé dans la personne de son représentant, il quitte le palais et déclare la guerre au roi de Bavière. Elsbeth est sauvée. Elle fait un riche cadeau à Fantasio et organise son évasion...
SCÈNE VII. Une prison.
Fantasio, seul. - Je ne sais s'il y a une Providence, mais c'est amusant d'y croire. Voilà pourtant une pauvre petite princesse qui allait épouser à son corps défendant un animal immonde, un cuistre de province, à qui le hasard a laissé tomber une couronne sur la tête, comme l'aigle d'Eschyle sa tortue. Tout était préparé; . les chandelles allumées, le prétendu poudré, la pauvre petite confessée. Elle avait essuyé les deux charmantes larmes que j'ai vues couler ce matin. Rien ne manquait que deux ou trois capucinades pour que le malheur de sa vie fût en règle. Il y avait dans tout cela la fortune de deux royaumes, la tranquillité de deux peuples ; et il faut que j'imagine de me déguiser en bossu, pour venir me griser derechef dans l'office de notre bon roi, et pour pêcher au bout d'une ficelle la perruque de son cher allié! Bn vérité, lorsque je suis gris, je crois que j'ai quelque chose de surhumain. Voilà le mariage manqué et tout remis en question. Le prince de Mantoue a demandé ma tête en échange de sa perruque. Le roi de Bavière a trouvé la peine un peu forte, et a'a consenti qu'à la prison. Le prince de Mantoue, grâce à Dieu, est si bête, qu'il se ferait plutôt couper en morceaux que d'en démordre; ainsi la princesse reste fille, du moins pour cette fois. S'il n'y a pas là le sujet d'un poème épique en douze chants, je ne m'y connais pas. Pope et Boileau ont fait des vers admirables sur des sujets bien moins importants. Ah! si j'étais poète, comme je peindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs! IMais celui qui est capable de faire de pareilles choses dédaigne de les écrire. Ainsi, la postérité s'en passera.
(Il s'endort. — Entrent Elsbeth et sa gouvernante, une lampe à la main.)
Elsbeth. - Il dort; ferme la porte doucement.
La Gouvernante. - Voyez ; cela n'est pas douteux. Il a ôté sa perruque postiche, sa difformité a disparu en même temps ; le voilà tel qu'il est, tel que ses peuples le voient sur son char de triomphe; c'est le noble prince de Mantoue.
ËLSBETH. - Oui, c'est lui; voilà ma curiosité satisfaite; je voulais voir son visage, et rien de plus; laisse-moi me pencher sur lui. (Elle prend la lampe.) Psyché, prends garde à ta goutte d'huile.
La Gouvernante. - Il est beau comme un vrai Jésus.
Elsbeth. - Pourquoi m'as-tu donné à lire tant de romans et de contes de fées? Pourquoi as-tu semé dans ma pauvre tète tant de fleurs étranges et mystérieuses !
La Gouvernante. - Comme vous voilà émue sur la pointe de vos petits pieds !
Elsbeth. - Il s'éveille; allons-nous-en.
Fantasio, s'éveillant. - Est-ce un rêve? Je tiens le coin d'une robe blanche.
Elsbeth. - Lâchez-moi; laissez-moi partir.
Fantasio. - C'est vous, princesse! Si c'est la grâce du bouffon du roi que vous m'apportez si divinement, laissez-moi remettre ma bosse et ma perruque; ce sera fait dans un instant.
La Gouvernante. - Ah! prince, qu'il vous, sied mal de nous tromper ainsi! Ne reprenez pas ce costume; nous savons tout.
Fantasio. - Prince? Où en voyez-vous un?
Là Gouvernante. - A quoi sert-il de dissimuler?
Fantasio. - Je ne dissimule pas le moins du monde; par quel hasard m'appelez-vous prince?
La Gouvernante. - Je connais mes devoirs envers votre altesse.
Fantasio. - Madame, je vous supplie de m'expliquer les paroles de cette honnête dame. Y a-t-il réellement quelque méprise extravagante, ou suis-je l'objet d'une raillerie?
Elsbeth. - Pourquoi le demander, lorsque c'est vous- même qui raillez?
Fantasio. - Suis-je donc un prince, par hasard? Concevrait-on quelque soupçon sur l'honneur de ma mère?
Elsbeth. - Qui êtes-vous, si vous n'êtes pas le prince de Mantoue?
Fantasio. - Mon nom est Fantasio; je suis un bourgeois de Munich. (Il lui montre une lettre.)
Elsbeth. - Un bourgeois de Munich? Et pourquoi êtes-vous déguisé? Que faites-vous ici?
Fantasio. - Madame, je vous supplie de me pardonner. (Il se jette à genoux.)
Elsbeth. - Que veut dire cela? Relevez-vous, homme, et sortez d'ici! Je vous fais grâce d'une punition que vous mériteriez peut-être. Qui vous a poussé à cette action !
Fantasio. - Je ne puis dire le motif qui m'a conduit ici.
Elsbeth. - Vous ne pouvez le dire? et cependant je veux le savoir.
Fantasio. - Excusez-moi, je n'ose l'avouer.
La Gouvernante. - Sortons, Elsbeth; ne vous exposez pas à entendre des discours indignes de vous. Cet homme est un voleur, ou un insolent qui va vous parler d'amour.
Elsbeth. - Je veux savoir la raison qui vous a fait prendre ce costume.
Fantasio. - Je vous supplie, épargnez-moi.
Elsbeth. - Non, non! parlez, ou je ferme cette porte sur vous pour dix ans.
Fantasio. - Madame, je suis criblé de dettes; mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi ; à l'heure où je vous parle, mes meubles sont vendus, et si je n'étais dans cette prison, je serais dans une autre. On a dû venir m'arrêter hier au soir; ne sachant où passer la nuit, ni comment me soustraire aux poursuites des huissiers, j'ai imaginé de prendre ce costume et de venir me réfugier aux pieds du roi; si vous me rendez la liberté, on va me prendre au collet ; mon oncle est un avare qui vit de pommes de terre et de radis, et qui me laisse mourir de faim dans tous les cabarets du royaume. Puisque vous voulez le savoir, je dois vingt mille écus.
Elsbeth. - Tout cela est-il vrai?
Fantasio. - Sî je mens, je consens à les payer. (On entend un bruit de chevaux.)
La Gouvernante. - Voilà des chevaux qui passent; c'est le roi en personne. Si je pouvais faire signe à un page ! (Elle appelle par la fenêtre.) Holà ! Flamel, où allez-vous donc?
Le Page, en dehors. - Le prince de Mantoue va partir.
La Gouvernante. - Le prince de Mantoue!
Le Page. - Oui, la guerre est déclarée. Il y a eu entre lui et le roi une scène épouvantable devant toute la cour, et le mariage de la princesse est rompu.
Elsbeth. - Entendez-vous cela, monsieur Fantasio? vous avez fait manquer mon mariage.
La Gouvernante. - Seigneur mon Dieu! le prince de Mantoue s'en va, et je ne l'aurai pas vu !
Elsbeth. - Si la guerre est déclarée, quel malheur!
Fantasio. - Vous appelez cela un malheur, altesse? Aimeriez-vous mieux un mari qui prend fait et cause pour sa perruque? Eh! madame, si la guerre est déclarée, nous saurons quoi faire de nos bras; les oisifs de nos promenades mettront leurs uniformes; moi-même je prendrai mon fusil de chasse, s'il n'est pas encore vendu. Nous irons faire un tour d'Italie, et si vous entrez jamais à Mantoue, ce sera comme une véritable reine, sans qu'il y ait besoin pour cela d'autres cierges que nos épées.
Elsbeth. - Fantasio veux-tu rester le bouffon de mon père? Je te paye tes vingt mille écus.
Fantasio. - Je le voudrais de grand cœur; mais en vérité, si j'y étais forcé, je sauterais par la fenêtre pour me sauver un de ces jours.
Elsbeth. - Pourquoi? Tu vois que Saint-Jean est mort; il nous faut absolument un bouffon.
Fantasio. - J'aime ce métier plus que tout autre ; mais je ne puis faire aucun métier. Si vous trouvez que cela vaille vingt mille écus de vous avoir débarrassée du prince de Mantoue, donnez-les-moi et ne payez pas mes dettes. Un gentilhomme sans dettes ne saurait où se présenter. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de me trouver sans dettes.
Elsbeth. - Eh bien! je te les donne! mais prends les clefs de mon jardin : le jour où tu t'ennuieras d'être poursuivi par tes créanciers, viens te cacher dans les bluets où je t'ai trouvé ce matin; aie soin de prendre ta perruque et ton habit bariolé; ne parais jamais devant moi sans cette taille contrefaite et ces grelots d'argent, car c'est ainsi que tu m'as plu : tu redeviendras mon bouffon pour le temps qu'il te plaira de l'être, et puis tu iras à tes affaires. Maintenant tu peux t'en aller la porte est ouverte.
La Gouvernante. - Est-il possible que le prince de Mantoue soit parti sans que je l'aie vu!

1833 - George Sand et Alfred de Musset se rencontrent au mois de juin 1833, Musset n'a pas vingt-trois ans, c'est déjà l'auteur des Contes d'Espagne et d'Italie et du Spectacle dans un fauteuil, le poète de Don Paez et de Mardoche, de la Coupe et les Lèvres et de Naniouna, il vient de donner les Caprices de Marianne et achève d'écrire Rolla, Musset n'avait eu jusque-là que des amours de soupers et de mascarades. Georges Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, touche à la trentaine, elle a aussi sa légende, elle est célèbre pour sa vie indépendante dans un mariage qu'elle n'a pas rompu - avec le Baron Dudevant en 1822 -, pour ses allures d'androgyne, son goût des paradoxes sociaux, sa liaison avec Jules Sandeau, leur livre {Rose et Blanche, signé Jules Sand), ses livres surtout, "Indiana", sa première confession romancée et débordante de passion (1832), et "Valentine" (1832). Elle achève "Lélia" (1833-1839) qui va mettre le sceau à sa gloire future, pendant que Sainte- Beuve écrit "Volupté". Tous deux se consultaient sur leurs romans, et lorsqu'elle rompt avec Jules Sandeau, Sainte-Beuve devient le confident de sa vie sentimentale...
George Sand, le 20 août 1833, à Sainte-Beuve : "... Je me suis énamourée, et cette fois très sérieusement, d'Alfred de Musset. Ceci n'est plus un caprice; c'est un attachement senti... Il ne m'appartient pas de promettre à cette affection une durée qui vous la fasse paraître aussi sacrée que les affections dont vous êtes susceptible. J'ai aimé une fois pendant six ans, une autre fois pendant trois, et maintenant je ne sais pas ce dont je suis capable. Beaucoup de fantaisies ont traversé mon cerveau, mais mon cœur n'a pas été aussi usé que je m'en effrayais : je le dis maintenant parce que je le sens. Je l'ai senti quand j'ai aimé P (rosper) M (érimée). Il m'a repoussée, j'ai dû me guérir vite. Mais ici, bien loin d'être affligée et méconnue, je trouve une candeur, une loyauté, une tendresse qui m'enivrent. C'est un amour de jeune homme et une amitié de camarade. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'idée, que je ne croyais rencontrer nulle part et surtout là. Je l'ai niée, cette affection, je l'ai repoussée, je l'ai refusée d'abord, et puis je me suis rendue, et je suis heureuse de l'avoir fait. Je m'y suis rendue par amitié plus que par amour, et l'amour que je ne connaissais pas s'est révélé à moi sans aucune des douleurs que je croyais accepter. Je suis heureuse, remerciez Dieu pour moi. Il y a bien en moi des heures de tristesse et de vague souffrance : cela est en moi et vient de moi... Je suis dans les conditions les plus vraies de régénération et de consolation. Ne m'en dissuadez pas."
Dans "Elle et Lui", George Sand revient sur cette fameuse liaison de l'auteur avec Alfred de Musset. Publié en 1859, le livre suscita les protestations des amis du défunt poète, et surtout de son frère Paul, qui répondit par le roman "Lui et Elle". On sait qu'en 1833, la romancière affranchie de tout préjugé se prit de passion pour le poète, éloigna ses autres amants et s'enivra d'un sentiment qui semblait donner un sens à sa vie sentimentale. Le voyage en Italie (par Gênes, Pise, Livourne et Florence) en novembre 1833 marque le triomphe de cette passion mais aussi son déclin, décembre, janvier, février, mars 1834. Musset est décrit comme absolument insupportable, névropathe, capricieux, débraillé, toujours sorti, bohème incorrigible, infidèle envers une maîtresse, dont l'amour calme et peut-être un peu réservé n'était pas de son goût. Un homme enfin tout enivré de son voyage en Italie, mais désespéré de ne pas le faire seul. Puis à Venise, Musset tomba assez gravement malade, une fièvre cérébrale, et fut soigné par un certain docteur Pagello qui devint l'amant de cette femme passionnée, ce furent alors souffrances, scènes de jalousie et de folie, puis la rupture.
Guéri, Musset rentre à Paris, la rupture semble consommée, mais très le trio se lie, se fait et se défait, la correspondance entre Musset et Sand ne cesse jamais, témoin de leur passion, jusqu'à la rupture de 1835. Dans son roman, George Sand présente la situation d'une façon qui est bien éloignée de la vérité et fait intervenir des protagonistes et reproches continuels par lesquels George Sand accuse Musset, d'une façon voilée, de folie et de vices. La publication de la correspondance de Musset et George Sand permettra de mesurer l'exactitude des deux romans de George Sand et de Paul de Musset.

Les quatre Nuits sont le chef-d'œuvre poétique de Musset. Toutes les quatre se rapportent à la grande aventure passionnelle de sa vie, dont elles évoquent toutes les péripéties. Elles ont été composées après la rupture avec George Sand (1835), son infidélité, l'abandonnant pour Pagello, la réconciliation et la rupture définitive, - et forment avec la Lettre à Lamartine, L'Espoir en Dieu et Souvenir, un ensemble incomparable de lyrisme frémissant et désespéré. Sous la forme dramatique, le poète se met lui-même en scène, prenant la Muse pour confidente de sa détresse ou écoutant ses consolations. Cependant, depuis Verlaine, ce lyrisme et éloquence rythmique sont passés de mode, et l'on préfèrera plus tard le théâtre de Musset à sa poésie, des pièces de théâtre plus simples, plus légères, qui se moque de lui-même et du monde pour éviter de se lamenter....
Dans "La Nuit de mai" (mai 1835), la Muse printanière invite en vain le poète à chanter sa souffrance, au milieu de la nature sans cesse renouvelée. "La Nuit de décembre" (novembre 1835) nous montre près de lui un frère mystérieux qui l'accompagne à travers toutes les douloureuses étapes de sa vie : c`est l'image de la solitude, confidente du triste souvenir et de la tenace espérance. "La Nuit d`août" (août 1836) est un hymne presque joyeux aux forces de la vie qui promettent à l'homme la revanche de toutes ses défaites. Mais dans La Nuit d'octobre (octobre 1837), toute l'angoisse de la douleur injuste, la colère de la passion trompée, le désir de la vengeance torturent de nouveau ce faible cœur qui se croyait guéri. Comme dans "La Nuit de mai", dont celle-ci est, à deux ans de distance, l'éloquente réplique, la Muse oppose aux plaintes du poète, à ses cris de révolte, l'apaisante douceur de sa raison et de sa bonté. Elle lui enseigne quelle leçon il peut tirer de ses souffrances, quel bien il peut faire naître de ses souvenirs, quelle consolation il doit trouver dans le pardon ou dans l'oubli....
LA MUSE
Poète, prends ton luth et me donne un baiser ;
La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore,
Le printemps naît ce soir ; les vents vont s'embraser ;
Et la bergeronnette, en attendant l'aurore,
Aux premiers buissons verts commence à se poser.
Poète, prends ton luth, et me donne un baiser.
LE POÈTE
Comme il fait noir dans la vallée !
J'ai cru qu'une forme voilée
Flottait là-bas sur la forêt.
Elle sortait de la prairie ;
Son pied rasait l'herbe fleurie ;
C'est une étrange rêverie ;
Elle s'efface et disparaît.
LA MUSE
Poète, prends ton luth ; la nuit, sur la pelouse,
Balance le zéphyr dans son voile odorant.
La rose, vierge encor, se referme jalouse
Sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant.
Écoute ! tout se tait ; songe à ta bien-aimée.
Ce soir, sous les tilleuls, à la sombre ramée
Le rayon du couchant laisse un adieu plus doux.
Ce soir, tout va fleurir : l'immortelle nature
Se remplit de parfums, d'amour et de murmure,
Comme le lit joyeux de deux jeunes époux.
LE POÈTE
Pourquoi mon coeur bat-il si vite ?
Qu'ai-je donc en moi qui s'agite
Dont je me sens épouvanté ?
Ne frappe-t-on pas à ma porte ?
Pourquoi ma lampe à demi morte
M'éblouit-elle de clarté ?
Dieu puissant ! tout mon corps frissonne.
Qui vient ? qui m'appelle ? - Personne.
Je suis seul ; c'est l'heure qui sonne ;
Ô solitude ! ô pauvreté !
LA MUSE
Poète, prends ton luth ; le vin de la jeunesse
Fermente cette nuit dans les veines de Dieu.
Mon sein est inquiet ; la volupté l'oppresse,
Et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu.
Ô paresseux enfant ! regarde, je suis belle.
Notre premier baiser, ne t'en souviens-tu pas,
Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile,
Et que, les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras ?
Ah ! je t'ai consolé d'une amère souffrance !
Hélas ! bien jeune encor, tu te mourais d'amour.
Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance ;
J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour.
LE POÈTE
Est-ce toi dont la voix m'appelle,
Ô ma pauvre Muse ! est-ce toi ?
Ô ma fleur ! ô mon immortelle !
Seul être pudique et fidèle
Où vive encor l'amour de moi !
Oui, te voilà, c'est toi, ma blonde,
C'est toi, ma maîtresse et ma soeur !
Et je sens, dans la nuit profonde,
De ta robe d'or qui m'inonde
Les rayons glisser dans mon coeur.
LA MUSE
Poète, prends ton luth ; c'est moi, ton immortelle,
Qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux,
Et qui, comme un oiseau que sa couvée appelle,
Pour pleurer avec toi descends du haut des cieux.
Viens, tu souffres, ami. Quelque ennui solitaire
Te ronge, quelque chose a gémi dans ton coeur ;
Quelque amour t'est venu, comme on en voit sur terre,
Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur.
Viens, chantons devant Dieu ; chantons dans tes pensées,
Dans tes plaisirs perdus, dans tes peines passées ;
Partons, dans un baiser, pour un monde inconnu,
Éveillons au hasard les échos de ta vie,
Parlons-nous de bonheur, de gloire et de folie,
Et que ce soit un rêve, et le premier venu.
Inventons quelque part des lieux où l'on oublie ;
Partons, nous sommes seuls, l'univers est à nous.
Voici la verte Écosse et la brune Italie,
Et la Grèce, ma mère, où le miel est si doux,
Argos, et Ptéléon, ville des hécatombes,
Et Messa la divine, agréable aux colombes,
Et le front chevelu du Pélion changeant ;
Et le bleu Titarèse, et le golfe d'argent
Qui montre dans ses eaux, où le cygne se mire,
La blanche Oloossone à la blanche Camyre.
Dis-moi, quel songe d'or nos chants vont-ils bercer ?
D'où vont venir les pleurs que nous allons verser ?
Ce matin, quand le jour a frappé ta paupière,
Quel séraphin pensif, courbé sur ton chevet,
Secouait des lilas dans sa robe légère,
Et te contait tout bas les amours qu'il rêvait ?
Chanterons-nous l'espoir, la tristesse ou la joie ?
Tremperons-nous de sang les bataillons d'acier ?
Suspendrons-nous l'amant sur l'échelle de soie ?
Jetterons-nous au vent l'écume du coursier ?
Dirons-nous quelle main, dans les lampes sans nombre
De la maison céleste, allume nuit et jour
L'huile sainte de vie et d'éternel amour ?
Crierons-nous à Tarquin : " Il est temps, voici l'ombre ! "
Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers ?
Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers ?
Montrerons-nous le ciel à la Mélancolie ?
Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés ?
La biche le regarde ; elle pleure et supplie ;
Sa bruyère l'attend ; ses faons sont nouveau-nés ;
Il se baisse, il l'égorge, il jette à la curée
Sur les chiens en sueur son coeur encor vivant.
Peindrons-nous une vierge à la joue empourprée,
S'en allant à la messe, un page la suivant,
Et d'un regard distrait, à côté de sa mère,
Sur sa lèvre entr'ouverte oubliant sa prière ?
Elle écoute en tremblant, dans l'écho du pilier,
Résonner l'éperon d'un hardi cavalier.
Dirons-nous aux héros des vieux temps de la France
De monter tout armés aux créneaux de leurs tours,
Et de ressusciter la naïve romance
Que leur gloire oubliée apprit aux troubadours ?
Vêtirons-nous de blanc une molle élégie ?
L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie,
Et ce qu'il a fauché du troupeau des humains
Avant que l'envoyé de la nuit éternelle
Vînt sur son tertre vert l'abattre d'un coup d'aile,
Et sur son coeur de fer lui croiser les deux mains ?
Clouerons-nous au poteau d'une satire altière
Le nom sept fois vendu d'un pâle pamphlétaire,
Qui, poussé par la faim, du fond de son oubli,
S'en vient, tout grelottant d'envie et d'impuissance,
Sur le front du génie insulter l'espérance,
Et mordre le laurier que son souffle a sali ?
Prends ton luth ! prends ton luth ! je ne peux plus me taire ;
Mon aile me soulève au souffle du printemps.
Le vent va m'emporter ; je vais quitter la terre.
Une larme de toi ! Dieu m'écoute ; il est temps.
LE POÈTE
S'il ne te faut, ma soeur chérie,
Qu'un baiser d'une lèvre amie
Et qu'une larme de mes yeux,
Je te les donnerai sans peine ;
De nos amours qu'il te souvienne,
Si tu remontes dans les cieux.
Je ne chante ni l'espérance,
Ni la gloire, ni le bonheur,
Hélas ! pas même la souffrance.
La bouche garde le silence
Pour écouter parler le coeur.

"La Nuit de Mai" (15 juin 1835) - Après sa rupture avec George Sand, il faudra attendre 1835 pour que renaisse chez Musset l'inspiration poétique, en deux nuits et un jour il écrit "un des plus touchants et des plus sublimes cris d'un jeune coeur qui déborde" (Sainte-Beuve) : le vers est immortel, "Les plus désespérés sont les chants les plus beaux"...
LA MUSE
Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne,
Qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau,
Et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau ?
Ô poète ! un baiser, c'est moi qui te le donne.
L'herbe que je voulais arracher de ce lieu,
C'est ton oisiveté ; ta douleur est à Dieu.
Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,
Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure
Que les noirs séraphins t'ont faite au fond du coeur :
Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur.
Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète,
Que ta voix ici-bas doive rester muette.
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.
Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage,
Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux,
Ses petits affamés courent sur le rivage
En le voyant au loin s'abattre sur les eaux.
Déjà, croyant saisir et partager leur proie,
Ils courent à leur père avec des cris de joie
En secouant leurs becs sur leurs goitres hideux.
Lui, gagnant à pas lents une roche élevée,
De son aile pendante abritant sa couvée,
Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux.
Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte ;
En vain il a des mers fouillé la profondeur ;
L'Océan était vide et la plage déserte ;
Pour toute nourriture il apporte son coeur.
Sombre et silencieux, étendu sur la pierre
Partageant à ses fils ses entrailles de père,
Dans son amour sublime il berce sa douleur,
Et, regardant couler sa sanglante mamelle,
Sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle,
Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur.
Mais parfois, au milieu du divin sacrifice,
Fatigué de mourir dans un trop long supplice,
Il craint que ses enfants ne le laissent vivant ;
Alors il se soulève, ouvre son aile au vent,
Et, se frappant le coeur avec un cri sauvage,
Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu,
Que les oiseaux des mers désertent le rivage,
Et que le voyageur attardé sur la plage,
Sentant passer la mort, se recommande à Dieu.
Poète, c'est ainsi que font les grands poètes.
Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps ;
Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes
Ressemblent la plupart à ceux des pélicans.
Quand ils parlent ainsi d'espérances trompées,
De tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur,
Ce n'est pas un concert à dilater le coeur.
Leurs déclamations sont comme des épées :
Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant,
Mais il y pend toujours quelque goutte de sang.
LE POÈTE
Ô Muse ! spectre insatiable,
Ne m'en demande pas si long.
L'homme n'écrit rien sur le sable
À l'heure où passe l'aquilon.
J'ai vu le temps où ma jeunesse
Sur mes lèvres était sans cesse
Prête à chanter comme un oiseau ;
Mais j'ai souffert un dur martyre,
Et le moins que j'en pourrais dire,
Si je l'essayais sur ma lyre,
La briserait comme un roseau.

"La Nuit de Décembre" (1er décembre 1835) repose sur une étrange hallucination, que l'on retrouvera dans le personnage de Lorenzo (Lorenzaccio), un dédoublement de personnalité qui fait entrevoir au poète le sentiment douloureux de sa solitude... "Je ne suis ni dieu ni démon, Et tu m'as nommé par mon nom Quand tu m'as appelé ton frère ; Où tu vas, j'y serai toujours, Jusques au dernier de tes jours, Où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton coeur. Quand tu seras dans la douleur, Viens à moi sans inquiétude. Je te suivrai sur le chemin ; Mais je ne puis toucher ta main, Ami, je suis la Solitude."
Du temps que j'étais écolier,
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire.
Devant ma table vint s'asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Son visage était triste et beau :
A la lueur de mon flambeau,
Dans mon livre ouvert il vint lire.
Il pencha son front sur sa main,
Et resta jusqu'au lendemain,
Pensif, avec un doux sourire.
Comme j'allais avoir quinze ans
Je marchais un jour, à pas lents,
Dans un bois, sur une bruyère.
Au pied d'un arbre vint s'asseoir
Un jeune homme vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Je lui demandai mon chemin ;
Il tenait un luth d'une main,
De l'autre un bouquet d'églantine.
Il me fit un salut d'ami,
Et, se détournant à demi,
Me montra du doigt la colline.
A l'âge où l'on croit à l'amour,
J'étais seul dans ma chambre un jour,
Pleurant ma première misère.
Au coin de mon feu vint s'asseoir
Un étranger vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Il était morne et soucieux ;
D'une main il montrait les cieux,
Et de l'autre il tenait un glaive.
De ma peine il semblait souffrir,
Mais il ne poussa qu'un soupir,
Et s'évanouit comme un rêve.
A l'âge où l'on est libertin,
Pour boire un toast en un festin,
Un jour je soulevais mon verre.
En face de moi vint s'asseoir
Un convive vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Il secouait sous son manteau
Un haillon de pourpre en lambeau,
Sur sa tête un myrte stérile.
Son bras maigre cherchait le mien,
Et mon verre, en touchant le sien,
Se brisa dans ma main débile...."
Un an après, il était nuit ;
J'étais à genoux près du lit
Où venait de mourir mon père.
Au chevet du lit vint s'asseoir
Un orphelin vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Ses yeux étaient noyés de pleurs ;
Comme les anges de douleurs,
Il était couronné d'épine ;
Son luth à terre était gisant,
Sa pourpre de couleur de sang,
Et son glaive dans sa poitrine.
Je m'en suis si bien souvenu,
Que je l'ai toujours reconnu
A tous les instants de ma vie.
C'est une étrange vision,
Et cependant, ange ou démon,
J'ai vu partout cette ombre amie.
Lorsque plus tard, las de souffrir,
Pour renaître ou pour en finir,
J'ai voulu m'exiler de France ;
Lorsqu'impatient de marcher,
J'ai voulu partir, et chercher
Les vestiges d'une espérance ;
A Pise, au pied de l'Apennin ;
A Cologne, en face du Rhin ;
A Nice, au penchant des vallées ;
A Florence, au fond des palais ;
A Brigues, dans les vieux chalets ;
Au sein des Alpes désolées ;
A Gênes, sous les citronniers ;
A Vevey, sous les verts pommiers ;
Au Havre, devant l'Atlantique ;
A Venise, à l'affreux Lido,
Où vient sur l'herbe d'un tombeau
Mourir la pâle Adriatique ;
Partout où, sous ces vastes cieux,
J'ai lassé mon coeur et mes yeux,
Saignant d'une éternelle plaie ;
Partout où le boiteux Ennui,
Traînant ma fatigue après lui,
M'a promené sur une claie ;
Partout où, sans cesse altéré
De la soif d'un monde ignoré,
J'ai suivi l'ombre de mes songes ;
Partout où, sans avoir vécu,
J'ai revu ce que j'avais vu,
La face humaine et ses mensonges ;
Partout où, le long des chemins,
J'ai posé mon front dans mes mains,
Et sangloté comme une femme ;
Partout où j'ai, comme un mouton,
Qui laisse sa laine au buisson,
Senti se dénuder mon âme ;
Partout où j'ai voulu dormir,
Partout où j'ai voulu mourir,
Partout où j'ai touché la terre,
Sur ma route est venu s'asseoir
Un malheureux vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Qui donc es-tu, toi que dans cette vie
Je vois toujours sur mon chemin ?
Je ne puis croire, à ta mélancolie,
Que tu sois mon mauvais Destin.
Ton doux sourire a trop de patience,
Tes larmes ont trop de pitié.
En te voyant, j'aime la Providence.
Ta douleur même est soeur de ma souffrance ;
Elle ressemble à l'Amitié.
Qui donc es-tu ? - Tu n'es pas mon bon ange,
Jamais tu ne viens m'avertir.
Tu vois mes maux (c'est une chose étrange !)
Et tu me regardes souffrir.
Depuis vingt ans tu marches dans ma voie,
Et je ne saurais t'appeler.
Qui donc es-tu, si c'est Dieu qui t'envoie ?
Tu me souris sans partager ma joie,
Tu me plains sans me consoler !
Ce soir encor je t'ai vu m'apparaître.
C'était par une triste nuit.
L'aile des vents battait à ma fenêtre ;
J'étais seul, courbé sur mon lit.
J'y regardais une place chérie,
Tiède encor d'un baiser brûlant ;
Et je songeais comme la femme oublie,
Et je sentais un lambeau de ma vie
Qui se déchirait lentement.
Je rassemblais des lettres de la veille,
Des cheveux, des débris d'amour.
Tout ce passé me criait à l'oreille
Ses éternels serments d'un jour.
Je contemplais ces reliques sacrées,
Qui me faisaient trembler la main :
Larmes du coeur par le coeur dévorées,
Et que les yeux qui les avaient pleurées
Ne reconnaîtront plus demain !
J'enveloppais dans un morceau de bure
Ces ruines des jours heureux.
Je me disais qu'ici-bas ce qui dure,
C'est une mèche de cheveux.
Comme un plongeur dans une mer profonde,
Je me perdais dans tant d'oubli.
De tous côtés j'y retournais la sonde,
Et je pleurais, seul, loin des yeux du monde,
Mon pauvre amour enseveli.
J'allais poser le sceau de cire noire
Sur ce fragile et cher trésor.
J'allais le rendre, et, n'y pouvant pas croire,
En pleurant j'en doutais encor.
Ah ! faible femme, orgueilleuse insensée,
Malgré toi, tu t'en souviendras !
Pourquoi, grand Dieu ! mentir à sa pensée ?
Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée,
Ces sanglots, si tu n'aimais pas ?
Oui, tu languis, tu souffres, et tu pleures ;
Mais ta chimère est entre nous.
Eh bien ! adieu ! Vous compterez les heures
Qui me sépareront de vous.
Partez, partez, et dans ce coeur de glace
Emportez l'orgueil satisfait.
Je sens encor le mien jeune et vivace,
Et bien des maux pourront y trouver place
Sur le mal que vous m'avez fait.
Partez, partez ! la Nature immortelle
N'a pas tout voulu vous donner.
Ah ! pauvre enfant, qui voulez être belle,
Et ne savez pas pardonner !
Allez, allez, suivez la destinée ;
Qui vous perd n'a pas tout perdu.
Jetez au vent notre amour consumée ; -
Eternel Dieu ! toi que j'ai tant aimée,
Si tu pars, pourquoi m'aimes-tu ?
Mais tout à coup j'ai vu dans la nuit sombre
Une forme glisser sans bruit.
Sur mon rideau j'ai vu passer une ombre ;
Elle vient s'asseoir sur mon lit.
Qui donc es-tu, morne et pâle visage,
Sombre portrait vêtu de noir ?
Que me veux-tu, triste oiseau de passage ?
Est-ce un vain rêve ? est-ce ma propre image
Que j'aperçois dans ce miroir ?
Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse,
Pèlerin que rien n'a lassé ?
Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse
Assis dans l'ombre où j'ai passé.
Qui donc es-tu, visiteur solitaire,
Hôte assidu de mes douleurs ?
Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre ?
Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frère,
Qui n'apparais qu'au jour des pleurs ?

"La Nuit d'août" (15 août 1836)- De La Nuit de Décembre à La Nuit d'Août, Musset renoue avec le plaisir, c'est l'époque où il écrit "Il ne faut jurer de rien", mais l'inquiétude demeure...
La muse
Depuis que le soleil, dans l'horizon immense,
A franchi le Cancer sur son axe enflammé,
Le bonheur m'a quittée, et j'attends en silence
L'heure où m'appellera mon ami bien-aimé.
Hélas ! depuis longtemps sa demeure est déserte ;
Des beaux jours d'autrefois rien n'y semble vivant.
Seule, je viens encor, de mon voile couverte,
Poser mon front brûlant sur sa porte entr'ouverte,
Comme une veuve en pleurs au tombeau d'un enfant.
Le poète
Salut à ma fidèle amie !
Salut, ma gloire et mon amour !
La meilleure et la plus chérie
Est celle qu'on trouve au retour.
L'opinion et l'avarice
Viennent un temps de m'emporter.
Salut, ma mère et ma nourrice !
Salut, salut consolatrice !
Ouvre tes bras, je viens chanter.
La muse
Pourquoi, coeur altéré, coeur lassé d'espérance,
T'enfuis-tu si souvent pour revenir si tard ?
Que t'en vas-tu chercher, sinon quelque hasard ?
Et que rapportes-tu, sinon quelque souffrance ?
Que fais-tu loin de moi, quand j'attends jusqu'au jour ?
Tu suis un pâle éclair dans une nuit profonde.
Il ne te restera de tes plaisirs du monde
Qu'un impuissant mépris pour notre honnête amour.
Ton cabinet d'étude est vide quand j'arrive ;
Tandis qu'à ce balcon, inquiète et pensive,
Je regarde en rêvant les murs de ton jardin,
Tu te livres dans l'ombre à ton mauvais destin.
Quelque fière beauté te retient dans sa chaîne,
Et tu laisses mourir cette pauvre verveine
Dont les derniers rameaux, en des temps plus heureux,
Devaient être arrosés des larmes de tes yeux.
Cette triste verdure est mon vivant symbole ;
Ami, de ton oubli nous mourrons toutes deux,
Et son parfum léger, comme l'oiseau qui vole,
Avec mon souvenir s'enfuira dans les cieux.
Le poète
Quand j'ai passé par la prairie,
J'ai vu, ce soir, dans le sentier,
Une fleur tremblante et flétrie,
Une pâle fleur d'églantier.
Un bourgeon vert à côté d'elle
Se balançait sur l'arbrisseau ;
Je vis poindre une fleur nouvelle ;
La plus jeune était la plus belle :
L'homme est ainsi, toujours nouveau.
La muse
Hélas ! toujours un homme, hélas ! toujours des larmes !
Toujours les pieds poudreux et la sueur au front !
Toujours d'affreux combats et de sanglantes armes ;
Le coeur a beau mentir, la blessure est au fond.
Hélas ! par tous pays, toujours la même vie :
Convoiter, regretter, prendre et tendre la main ;
Toujours mêmes acteurs et même comédie,
Et, quoi qu'ait inventé l'humaine hypocrisie,
Rien de vrai là-dessous que le squelette humain.
Hélas ! mon bien-aimé, vous n'êtes plus poète.
Rien ne réveille plus votre lyre muette ;
Vous vous noyez le coeur dans un rêve inconstant ;
Et vous ne savez pas que l'amour de la femme
Change et dissipe en pleurs les trésors de votre âme,
Et que Dieu compte plus les larmes que le sang.
Le poète
Quand j'ai traversé la vallée,
Un oiseau chantait sur son nid.
Ses petits, sa chère couvée,
Venaient de mourir dans la nuit.
Cependant il chantait l'aurore ;
Ô ma Muse, ne pleurez pas !
À qui perd tout, Dieu reste encore,
Dieu là-haut, l'espoir ici-bas.
La muse
Et que trouveras-tu, le jour où la misère
Te ramènera seul au paternel foyer ?
Quand tes tremblantes mains essuieront la poussière
De ce pauvre réduit que tu crois oublier,
De quel front viendras-tu, dans ta propre demeure,
Chercher un peu de calme et d'hospitalité ?
Une voix sera là pour crier à toute heure :
Qu'as-tu fait de ta vie et de ta liberté ?
Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite ?
Crois-tu qu'en te cherchant tu te retrouveras ?
De ton coeur ou de toi lequel est Le poète ?
C'est ton coeur, et ton coeur ne te répondra pas.
L'amour l'aura brisé ; les passions funestes
L'auront rendu de pierre au contact des méchants ;
Tu n'en sentiras plus que d'effroyables restes,
Qui remueront encor, comme ceux des serpents.
Ô ciel ! qui t'aidera ? que ferai-je moi-même,
Quand celui qui peut tout défendra que je t'aime,
Et quand mes ailes d'or, frémissant malgré moi,
M'emporteront à lui pour me sauver de toi ?
Pauvre enfant ! nos amours n'étaient pas menacées,
Quand dans les bois d'Auteuil, perdu dans tes pensées,
Sous les verts marronniers et les peupliers blancs,
Je t'agaçais le soir en détours nonchalants.
Ah ! j'étais jeune alors et nymphe, et les dryades
Entr'ouvraient pour me voir l'écorce des bouleaux,
Et les pleurs qui coulaient durant nos promenades
Tombaient, purs comme l'or, dans le cristal des eaux.
Qu'as-tu fait, mon amant, des jours de ta jeunesse ?
Qui m'a cueilli mon fruit sur mon arbre enchanté ?
Hélas ! ta joue en fleur plaisait à la déesse
Qui porte dans ses mains la force et la santé.
De tes yeux insensés les larmes l'ont pâlie ;
Ainsi que ta beauté, tu perdras ta vertu.
Et moi qui t'aimerai comme une unique amie,
Quand les dieux irrités m'ôteront ton génie,
Si je tombe des cieux, que me répondras-tu ?
Le poète
Puisque l'oiseau des bois voltige et chante encore
Sur la branche où ses oeufs sont brisés dans le nid ;
Puisque la fleur des champs entr'ouverte à l'aurore,
Voyant sur la pelouse une autre fleur éclore,
S'incline sans murmure et tombe avec la nuit,
Puisqu'au fond des forêts, sous les toits de verdure,
On entend le bois mort craquer dans le sentier,
Et puisqu'en traversant l'immortelle nature,
L'homme n'a su trouver de science qui dure,
Que de marcher toujours et toujours oublier ;
Puisque, jusqu'aux rochers tout se change en poussière ;
Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain ;
Puisque c'est un engrais que le meurtre et la guerre ;
Puisque sur une tombe on voit sortir de terre
Le brin d'herbe sacré qui nous donne le pain ;
Ô Muse ! que m'importe ou la mort ou la vie ?
J'aime, et je veux pâlir ; j'aime et je veux souffrir ;
J'aime, et pour un baiser je donne mon génie ;
J'aime, et je veux sentir sur ma joue amaigrie
Ruisseler une source impossible à tarir.
J'aime, et je veux chanter la joie et la paresse,
Ma folle expérience et mes soucis d'un jour,
Et je veux raconter et répéter sans cesse
Qu'après avoir juré de vivre sans maîtresse,
J'ai fait serment de vivre et de mourir d'amour.
Dépouille devant tous l'orgueil qui te dévore,
Coeur gonflé d'amertume et qui t'es cru fermé.
Aime, et tu renaîtras ; fais-toi fleur pour éclore.
Après avoir souffert, il faut souffrir encore ;
Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé.

"La Nuit d'Octobre" (15 octobre 1837), , le Poète évoque devant la Muse une trahison qui semble récente mais qui réveille la douleur plus ancienne de son amour perdu, la souffrance revécue agite en lui bien des émotions, malgré les efforts de la Muse pour l'apaiser, pourtant depuis la Nui de Mai, son expérience semble s'être enrichie, il faut pardonner, s'en remettre à la Providence, "Par la puissance de la vie, Par la sève de l'univers, Je te bannis de ma mémoire, Reste d'un amour insensé.."...
Le Poète
Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve.
Je n'en puis comparer le lointain souvenir
Qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève,
Et qu'avec la rosée on voit s'évanouir.
La Muse
Qu'aviez-vous donc, ô mon poète !
Et quelle est la peine secrète
Qui de moi vous a séparé ?
Hélas ! je m'en ressens encore.
Quel est donc ce mal que j'ignore
Et dont j'ai si longtemps pleuré ?
Le Poète
C'était un mal vulgaire et bien connu des hommes ;
Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans le coeur,
Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes,
Que personne avant nous n'a senti la douleur.
La Muse
Il n'est de vulgaire chagrin
Que celui d'une âme vulgaire.
Ami, que ce triste mystère
S'échappe aujourd'hui de ton sein.
Crois-moi, parle avec confiance ;
Le sévère dieu du silence
Est un des frères de la Mort ;
En se plaignant on se console,
Et quelquefois une parole
Nous a délivrés d'un remord.
Le Poète
S'il fallait maintenant parler de ma souffrance,
Je ne sais trop quel nom elle devrait porter,
Si c'est amour, folie, orgueil, expérience,
Ni si personne au monde en pourrait profiter.
Je veux bien toutefois t'en raconter l'histoire,
Puisque nous voilà seuls, assis près du foyer.
Prends cette lyre, approche, et laisse ma mémoire
Au son de tes accords doucement s'éveiller.
La Muse
Avant de me dire ta peine,
Ô poète ! en es-tu guéri ?
Songe qu'il t'en faut aujourd'hui
Parler sans amour et sans haine.
S'il te souvient que j'ai reçu
Le doux nom de consolatrice,
Ne fais pas de moi la complice
Des passions qui t'ont perdu,
Le Poète
Je suis si bien guéri de cette maladie,
Que j'en doute parfois lorsque j'y veux songer ;
Et quand je pense aux lieux où j'ai risqué ma vie,
J'y crois voir à ma place un visage étranger.
Muse, sois donc sans crainte ; au souffle qui t'inspire
Nous pouvons sans péril tous deux nous confier.
Il est doux de pleurer, il est doux de sourire
Au souvenir des maux qu'on pourrait oublier.
1836 - "Lettres de Dupuis et Cotonet"
Il s'agit de quatre lettres prétendument écrites par deux bourgeois de province, Dupuis et Cotonet, au Directeur de la Revue des deux Mondes, dont la première, la plus connue, s'étonne avec un bon sens subtil, des extravagances du Romantisme. Le Cénacle, qu'il avait rejoint à 18 ans (1828), l'accusa de trahison, en réalité il n'était coupable que d'indépendance et de sincérité. Il aimait Racine, et il osa le dire, et il ne se gênait pas non plus pour railler les désespérés à la Byron, les pleureurs et les bavards de toute espèce. ...
PREMIÈRE LETTRE - La Ferté-sous-Jouarre, 8 septembre 1836.
Mon cher monsieur,
Que les dieux immortels vous assistent et vous préservent des romans nouveaux! Nous sommes deux abonnés de votre Revue, mon ami Cotonet et moi, qui avons résolu de vous écrire touchant une remarque que nous avons faite : c'est que, dans les livres d'aujourd'hui, on emploie beaucoup d'adjectifs, et que nous croyons que les auteurs se font par là un tort considérable.
Nous savons, monsieur, que ce n'est pas la mode de parler de littérature, et vous trouverez peut-être que, dans ce moment-ci, nous nous inquiétons de bien peu de chose. Nous en conviendrons volontiers, car nous recevons le Constitutionnel, et nous avons des fonds espagnols qui nous démangent terriblement. Mais, mieux qu'un autre, vous comprendrez sans doute toute la douceur que deux âmes bien nées trouvent à s'occuper des beaux-arts, qui font le charme de la vie, au milieu des tourmentes sociales; nous ne sommes point Béotiens, monsieur, vous le voyez par ces paroles.
Pour que vous goûtiez notre remarque simple en apparence, mais . qui nous a coûté douze ans de réflexions, il faut que vous nous permettiez de vous raconter, posément et graduellement, de quelle manière elle nous est venue. Bien que les lettres soient maintenant avilies, il fut un temps, monsieur, où elles florissaient; il fut un temps où on lisait les livres, et, dans nos théâtres, naguère encore, il fut un temps où l'on sifflait. C'était, si notre mémoire est bonne, de 1824 à 1829. Le roi d'alors, le clergé aidant, se préparait à renverser la charte, et à priver le peuple de ses droits; et vous n'êtes pas sans vous souvenir que, à cette époque, il a été grandement question d'une méthode toute nouvelle qu'on venait d'inventer pour faire des pièces de théâtre, des romans, et même des sonnets. On s'en est fort occupé ici; mais nous n'avons jamais pu comprendre, ni mon ami Cotonet ni moi, ce que c'était que le romantisme, et cependant nous avons beaucoup lu, notamment des préfaces, car nous ne sommes pas de Falaise, nous savons bien que c'est le principal, et que le reste n'est que pour enfler la chose ; mais il ne faut pas anticiper.
A vous dire vrai, dans ce pays-ci, on est badaud jusqu'aux oreilles, et, sans compter le tapage des journaux, nous sommes bien aises de jaser sur les quatre ou cinq heures. Nous avons dans la rue Marchande un gros cabinet de lecture, où il nous vient des cloyères de livres. Deux sous le volume, c'est comme partout, et il n'y aurait pas à se plaindre si les portières se lavaient les mains, mais depuis qu'il n'y a plus de loterie, elles dévorent les romans, que Dieu leur pardonne ! c'est à ne pas savoir par où y toucher. Mais peu importe; nous autres Français, nous ne regardons pas à la marge. En Angleterre, les gens qui sont propres aiment à lire dans des livres propres. En France, on lit à la gamelle; c'est notre manière d'encourager les arts.
Nos petites maîtresses ne souffriraient pas une mouche de crotte sur un bas qui n'a affaire qu'à leur pied; mais elles ouvrent très délicatemeat, de leur main blanche, un volume banal qui sent la cuisine, et porte la marque du pouce de leur cocher... Je reviens à mon sujet.
Je vous disais que nous ne comprenions pas ce que signifiait ce mot de romantisme. Si ce que je vous raconte vous paraît un peu usé et connu au premier abord, il ne faut pas vous effrayer, mais seulement me laisser faire; j'ai intention d'en venir à mes fins. C'était donc vers 1824, ou un peu plus tard, je l'ai oublié; on se battait dans le Journal des Débats. Il était question de pittoresque, de grotesque, du paysage introduit dans la poésie, de l'histoire dramatisée, du drame blasonné, de l'art pur, du rythme brisé, du tragique fondu avec le comique, et du moyen âge ressuscité. .Mon ami Cotonet et moi, nous nous promenions devant le jeu de boules. Il faut savoir qu'à la Ferté-sous-Jouarre, nous avions alors un grand clerc d'avoué qui venait de Paris, fier et fort impertinent, ne doutant de rien, tranchant sur tout, et qui avait l'air de comprendre tout ce qu'il lisait. Il nous aborda, le journal à la main, en nous demandant ce que nous pensions de toutes ces querelles littéraires. Cotonet est fort à son aise, il a cheval et cabriolet; nous ne sommes plus jeunes ni l'un ni l'autre, et, de mon côté, j'ai quelque poids; ces questions nous révoltèrent, et toute la ville fut pour nous. Mais, à dater de ce jour, on ne parla chez nous que de romantique et de classique; Mme Dupuis seule n'a rien voulu entendre; elle dit que c'est jus vert, ou vert jus. Nous lûmes tout ce qui paraissait, et nous reçûmes la Muse au cercle. Quelques-uns de nous (je fus du nombre) vinrent à Paris et virent les Vêpres; le sous-préfet acheta la pièce, et, à une quête pour les Grecs, mon fils récita Parthénope et l'Étrangère, septième messénienne. D'une autre part, M. Ducoudray, magistrat distingué, au retour des vacances rapporta les Méditations, parfaitement reliées, qu'il donna à sa femme. Mme Javart en fut choquée; elle déteste les novateurs; ma nièce y allait, nous cessâmes de nous yoir. Le receveur fut de notre bord : c'était un habile caustique et mordant, il travaillait sous main à la Pandore ; quatre ans après, il fut destitué, leva le masque, et fit un pamphlet qu'imprima le. fameux Firmin Didot.
M. Ducoudray nous donna, vers la mi-septembre, un dîner qui fut des plus orageux; ce fut là qu'éclata la guerre; voici comment l'affaire arriva. Mme Javart, qui porte perruque et qui s'imaginait qu'on n'en savait rien, ayant fait ce jour-là de grands frais de toilette, avait fiché dans sa coiffure une petite poignée de marabouts; elle était à la droite du receveur, et ils causaient de littérature; peu à peu la discussion s'échauffa, Mme Javart, classique entêtée, se prononça pour l'abbé Delille; le receveur l'appela perruque et, par une fatalité déplorable, au moment où il prononçait ce mot, d'un ton de voix passablement violent, les marabouts de Mme Javart prirent feu à une bougie placée auprès d'elle : elle n'en sentait rien et continuait de s'agiter, quand le receveur, la voyant tout en flammes, saisit les marabouts et les arracha; malheureusement le toupet tout entier quitta la tête de la pauvre femme, qui se trouva tout à coup exposée aux regards, le chef complètement dégarni; Mme Javart, ignorant le danger qu'elle avait couru, crut que le receveur la décoiffait pour ajouter le geste à la parole, et comme elle était en train de manger un œuf à la coque, elle le lui lança au visage; le receveur en fut aveuglé; le jaune couvrait sa chemise et son gilet, et n'ayant voulu que rendre un service, il fut impossible de l'apaiser, quelque effort qu'on fit pour cela. Mme Javart, de son côté, se leva et sortit en fureur ; elle traversa toute la ville sa perruque à la main, malgré les prières de sa servante, et perdit connaissance en rentrant chez elle. Jamais elle n'a voulu croire que le feu eût pris à ses marabouts; elle soutient encore qu'on l'a outragée de la manière la plus inconvenante, et vous pensez le bruit qu'elle en a fait. Voilà, monsieur, comment nous devînmes romantiques à la Ferté-sous-Jouarre.
Cependant, Cotonet et moi, nous résolûmes d'approfondir la question, et de nous rendre compte des querelles qui divisaient tant d'esprits habiles. Nous avons fait de bonnes études. Cotonet surtout, qui est notaire, et qui s'occupe d'ornithologie. Nous crûmes d'abord, pendant deux ans, que le romantisme , en matière d'écriture, ne s'appliquait qu'au théâtre, et qu'il se distinguait du classique parce qu'il se passait des unités, c'est clair; Shakspeare, par exemple, fait voyager les gens de Rome à Londres, et d'Athènes à Alexandrie, en un quart d'heure; ses héros vivent dix ou vingt ans dans un entr'acte. Voilà, disions-nous, le romantique. Sophocle, au contraire, fait asseoir Œdipe, encore est-ce à grand'peîne, sur un rocher, dès le commencement de sa tragédie; tous les personnages viennent le trouver là, l'un après l'autre; peut-être se lève-t-il, mais j'en doute, à moins que ce ne soit par respect pour Thésée, qui, durant toute la pièce, court sur le grand chemin pour l'obliger, rentrant en scène, et sortant sans cesse. Le chœur est là, et si quelque chose cloche, s'il y a un geste obscur, il l'explique; ce qui s'est passé, il le raconte; ce qui se passe, il le commente; ce qui va se passer, il le prédit; bref, il est dans la tragédie grecque comme une note de M. Aimé Martin au bas d'une page de Molière. Voilà, disions-nous, le classique; il n'y avait point de quoi disputer, et les choses allaient sans dire.
Mais on nous apprend tout à coup (c'était, je crois, en 1828) qu'il y avait poésie romantique et poésie classique,, roman romantique et roman classique, ode romantique et ode classique; que dis-je? un seul vers, mon cher monsieur, un seul et unique vers pouvait être romantique ou classique, selon que l'envie lui en prenait.
Quand nous reçûmes cette nouvelle, nous ne pûmes fermer l'œil de la nuit. Deux ans de paisible conviction venaient de s'évanouir comme un songe. Toutes nos idées étaient bouleversées ; car, si les règles d'Aristote n'étaient plus la ligne de démarcation qui séparait les camps littéraires, où se retrouver et sur quoi s'appuyer? Par quel moyen, en lisant un ouvrage, savoir à quelle école il appartenait? Nous pensions bien que les initiés de Paris devaient avoir une espèce de mot d'ordre qui les tirait d'abord d'embarras; mais, en province, comment faire? Et il faut vous dire, monsieur, qu'en province, le mot romantique a, en général, une signification facile à retenir, il est syno- nyme d'absurde, et on ne s'en inquiète pas autrement.
Heureusement, dans la même année, parut une illustre préface que nous dévorâmes aussitôt, et qui faillit nous convaincre à jamais. Il y respirait un air d'assurance qui était fait pour tranquilliser, et les principes de la nouvelle école s'y trouvaient détaillés au long. On y disait très nettement que le romantisme n'était autre chose que l'alliance du fou et du sérieux, du grotesque et du terrible, du bouffon et de l'horrible, autrement dit, si vous l'aimez mieux, de la comédie et de la tragédie. Nous le crûmes, Cotonet et moi, pendant l'espace d'une année entière. Le drame fut notre passion, car on avait baptisé de ce nom de drame, non seulement les ouvrages dialogués, mais toutes les inventions modernes de l'imagination, sous le prétexte qu'elles étaient dramatiques. Il y avait bien là quelque galimatias, mais enfin c'était quelque chose. Le drame nous apparaissait comme un prêtre respectable qui avait marié, après tant de siècles, le comique avec le tragique; nous le voyions vêtu de blanc et de noir, riant d'un œil et pleurant de l'autre, agiter d'une main un poignard, et de l'autre une marotte; à la rigueur cela se comprenait, les poètes du jour proclamaient ce genre une découverte toute, moderne : "La mélancolie, disaient-ils, était inconnue aux anciens : c'est elle qui, jointe à l'esprit d'analyse et de controverse, a créé la religion nouvelle, la société nouvelle, et introduit dans l'art un type nouveau".
A parler franc, nous croyions tout cela un peu sur parole, et cette mélancolie inconnue aux anciens ne nous fût pas d'une digestion facile. Quoi! disions- nous, Sapho expirante, Platon regardant le ciel, n'ont pas ressenti quelque tristesse? Le vieux Priam redemandant son fils mort, à genoux devant le meurtrier, et s'écriant : "Souviens-toi de ton père, ô Achille!" n'éprouvait point quelque mélancolie? Le beau Narcisse, couché dans les roseaux, n'était point malade de quelque dégoût des choses de la terre?... D'autre part, dans la susdite préface, écrite d'ailleurs avec un grand talent, l'antiquité nous semblait comprise d'une assez étrange façon. On y comparait, entre autres choses, les Furies avec les sorcières, et on disait que les Furies s'appelaient Euménides, c'est-à-dire douées et bienfaisantes, ce qui prouvait, ajoutait-on, qu'elles n'étaient que médiocrement difformes, par conséquent à peine grotesques. Il nous étonnait que l'auteur pût ignorer que l'antiphrase est au nombre des tropes, bien que Sanctius ne veuille pas l'admettre. Mais passons; l'important pour nous était de répondre aux questionneurs : "Le romantisme est l'alliance de la comédie et de la tragédie, ou, de quelque genre d'ouvrage qu-il s'agisse, le mélange du bouffon et du sérieux". Voilà qui allait encore à merveille, et nous dormions tranquilles là-dessus.
Mais que pensai-je, monsieur, lorsqu'un matin je vis Cotonet entrer dans ma chambre avec six petits volumes sous le bras! Aristophane, vous le savez, est, de tous les génies de la Grèce antique, le plus noble à la fois et le plus grotesque, le plus sérieux et le plus bouffon, le plus lyrique et le plus satirique. Il n'est pas seulement tragique et comique, il est tendre et terrible, pur et obscène, honnête et corrompu, noble et trivial, et au fond de tout cela, pour qui sait comprendre, assurément il est mélancolique. Hélas! monsieur, si on le lisait davantage, on se dispenserait de beaucoup parler, et on pourrait savoir au juste d'où viennent bien des inventions nouvelles qui se font donner des brevets. Il n'est pas jusqu'aux saint-simoniens qui ne se trouvent dans Aristophane; que lui avaient fait ces pauvres gens? La comédie des Harangueuses est pourtant leur complète satire, comme les Chevaliers, à plus d'un égard, pourraient passer pour celle du gouvernement représentatif.
Nous voilà donc, Cotonet et moi, retombés dans l'incertitude. Le romantisme devait, avant tout, être une découverte, sinon récente, du moins moderne. Ce n'était donc pas plus l'alliance du comique et du tragique que l'infraction permise aux règles d'Aristote (j'ai oublié de vous dire qu'Aristophane ne tient lui- même aucun compte des unités). Nous fîmes donc ce raisonnement très simple : « Puisqu'on se bat à Paris dans les théâtres, dans les préfaces et dans les journaux, il faut que ce soit pour quelque chose ; puisque les auteurs proclament une trouvaille, un art nouveau et une foi nouvelle, il faut que ce quelque chose soit autre chose qu'une chose renouvelée des Grecs ; puis- que nous n'avons rien de mieux à faire nous allons chercher ce que c'est. »
Mais, me direz-vous, mon cher monsieur, Aristophane est romantique: voilà tout ce que prouvent vos discours; la différence des genres n'en subsiste pas moins, et l'art moderne, l'art humanitaire, l'art social, l'art pur, l'art moyen âge... »
Patience, monsieur; que Dieu vous garde d'être si vif! Je ne discute pas, je vous raconte un événement qui m'est arrivé...."
1836 - "Il ne faut jurer de rien"
Van Buck, riche négociant, venu tancer son neveu Valentin pour ses dettes, le somme de se marier. Le jeune homme ne consent à épouser la jeune fille qu'il lui propose, Mlle de Mantes, que si elle résiste à sa stratégie de séduction. Il se rendra donc incognito au château. La Baronne discute à bâtons rompus avec son abbé et sa fille, Cécile, qui prend une leçon de danse, quand Van Buck apparaît pour lui glisser à l'oreille que le mariage est rompu. On annonce qu'un jeune homme vient de verser devant la grille...
Cette petite pièce, dont le comique est léger et spirituel, s'apparente au genre du proverbe: maximes et sentences abondent, tout comme lieux communs emphatiques ou triviaux dont se moque l'auteur par le biais de Valentin. Valentin qui finira pourtant par abdiquer devant leur bon sens comme l'indique la réplique finale: «Mon oncle, il ne faut jurer de rien».

"La Confession d’un enfant du siècle" (1836)
«Pour écrire l’histoire de sa vie, il faut d’abord avoir vécu ; aussi n’est-ce pas la mienne que j’écris.» Souvent considéré comme un document fondamental sur le mal de vivre d'une certaine génération, c’est en février 1836, au lendemain de sa rupture avec George Sand, qu’Alfred de Musset publie ce roman qui comporte certains éléments autobiographiques, quoique les personnages soient fictifs. S'il est reconnu, c'est principalement pour son deuxième chapitre qui fait le portrait de la génération romantique et analyse des causes du fameux «mal du siècle»,
"Pendant les guerres de l’empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçus entre deux batailles, élevés dans les collèges aux roulements de tambours, des milliers d’enfants se regardaient entre eux d’un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leurs poitrines chamarrées d’or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval. Un seul homme était en vie alors en Europe ; le reste des êtres tâchait de se remplir les poumons de l’air qu’il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de trois cent mille jeunes gens ; et lui, prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l’humanité, il la tordait entre ses mains, et en faisait une corde neuve à son arc ; puis il posait sur cet arc une de ces flèches qui traversèrent le monde, et s’en furent tomber dans une petite vallée d’une île déserte, sous un saule pleureur. Jamais il n’y eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme ; jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées ; jamais il n’y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant jamais il n’y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs ; jamais il n’y eut de soleils si purs que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ses soleils d’Austerlitz. Mais il les faisait bien lui-même avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient de nuages qu’aux lendemains de ses batailles. C’était l’air de ce ciel sans tache, où brillait tant de gloire, où resplendissait tant d’acier, que les enfants respiraient alors. Ils savaient bien qu’ils étaient destinés aux hécatombes ; mais ils croyaient Murat invulnérable, et on avait vu passer l’empereur sur un pont où sifflaient tant de balles, qu’on ne savait s’il pouvait mourir. Et quand même on aurait dû mourir, qu’était-ce que cela ? La mort elle-même était si belle alors, si grande, si magnifique, dans sa pourpre fumante ! Elle ressemblait si bien à l’espérance, elle fauchait de si verts épis qu’elle en était comme devenue jeune, et qu’on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers ; tous les cercueils en étaient aussi ; il n’y avait vraiment plus de vieillards ; il n’y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Cependant l’immortel empereur était un jour sur une colline à regarder sept peuples s’égorger ; comme il ne savait pas encore s’il serait le maître du monde ou seulement de la moitié, Azraël passa sur la route ; il l’effleura du bout de l’aile, et le poussa dans l’Océan. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leurs lits de douleur, et, avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l’Europe, et de la pourpre de César se firent un habit d’Arlequin. De même qu’un voyageur, tant qu’il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil, sans s’apercevoir de ses veilles ni des dangers ; mais dès qu’il est arrivé au milieu de sa famille et qu’il s’assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit ; ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance, et s’endormit d’un si profond sommeil que ses vieux rois, la croyant morte, l’enveloppèrent d’un linceul blanc. La vieille armée en cheveux gris rentra épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement. Alors ces hommes de l’Empire, qui avaient tant couru et tant égorgé, embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leurs premières amours ; ils se regardèrent dans les fontaines de leurs prairies natales, et ils s’y virent si vieux, si mutilés, qu’ils se souvinrent de leurs fils, afin qu’on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient ; les enfants sortirent des collèges, et ne voyant plus ni sabres, ni cuirasses, ni fantassins, ni cavaliers, ils demandèrent à leur tour où étaient leurs pères. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort, et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades, avec ces deux mots au bas : Salvatoribus mundi. Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d’un sang brûlant qui avait inondé la terre ; ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des neiges de Moscou et du soleil des Pyramides ; on les avait trempés dans le mépris de la vie comme de jeunes épées. Ils n’étaient pas sortis de leurs villes, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes on allait à une capitale d’Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde ; ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins ; tout cela était vide, et les cloches de leurs paroisses résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes, couverts de robes noires, traversaient lentement les campagnes ; d’autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu’on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés, avec lesquels ils chassaient les habitants.
De tous côtés arrivaient des hommes encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ, vingt ans auparavant. Tous réclamaient, disputaient et criaient ; on s’étonnait qu’une seule mort pût appeler tant de corbeaux. Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s’il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, et il leur donnait de l’argent ; les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait ; d’autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à ceux-là d’aller dans sa grand-salle, que les échos en étaient sonores ; d’autres encore lui montraient leurs vieux manteaux, comme ils en avaient bien effacé les abeilles, et à ceux-là il donnait un habit neuf. Les enfants regardaient tout cela, pensant toujours que l’ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ces larves ; mais le silence continuait toujours, et l’on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lis. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait : Faites-vous prêtres ; quand ils parlaient d’ambition : Faites-vous prêtres ; d’espérance, d’amour, de force, de vie : Faites-vous prêtres. Cependant, il monta à la tribune aux harangues un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple ; il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l’ambition et la guerre aussi ; mais qu’il y en avait une plus belle, qui s’appelait la liberté.
Les enfants relevèrent la tête et se souvinrent de leurs grands-pères, qui en avaient aussi parlé. Ils se souvinrent d’avoir rencontré, dans les coins obscurs de la maison paternelle, des bustes mystérieux avec de longs cheveux de marbre et une inscription romaine ; ils se souvinrent d’avoir vu le soir, à la veillée, leurs aïeules branler la tête et parler d’un fleuve de sang bien plus terrible encore que celui de l’empereur. Il y avait pour eux dans ce mot de liberté quelque chose qui leur faisait battre le cœur à la fois comme un lointain et terrible souvenir et comme une chère espérance, plus lointaine encore. Ils tressaillirent en l’entendant ; mais, en rentrant au logis, ils virent trois paniers qu’on portait à Clamart : c’étaient trois jeunes gens qui avaient prononcé trop haut ce mot de liberté.
Un étrange sourire leur passa sur les lèvres à cette triste vue ; mais d’autres harangueurs, montant à la tribune, commencèrent à calculer publiquement ce que coûtait l’ambition, et que la gloire était bien chère ; ils firent voir l’horreur de la guerre et appelèrent boucherie les hécatombes. Et ils parlèrent tant et si longtemps que toutes les illusions humaines, comme des arbres en automne, tombaient feuille à feuille autour d’eux, et que ceux qui les écoutaient passaient leur main sur leur front, comme des fiévreux qui s’éveillent. Les uns disaient : Ce qui a causé la chute de l’empereur, c’est que le peuple n’en voulait plus ; les autres : Le peuple voulait le roi ; non, la liberté ; non, la raison ; non, la religion ; non, la constitution anglaise ; non, l’absolutisme ; un dernier ajouta : Non ! rien de tout cela, mais le repos. Et ils continuèrent ainsi, tantôt raillant, tantôt disputant, pendant nombre d’années, et, sous prétexte de bâtir, démolissant tout pierre à pierre, si bien qu’il ne passait plus rien de vivant dans l’atmosphère de leurs paroles, et que les hommes de la veille devenaient tout à coup des vieillards. Trois éléments partageaient donc la vie qui s’offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit, s’agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l’absolutisme ; devant eux l’aurore d’un immense horizon, les premières clartés de l’avenir ; et encore ces deux mondes… quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde vapeur ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors ; voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d’audace, fils de l’empire et petits-fils de la révolution...."

Suit alors la Confession proprement dite au cours de laquelle, Octave, jeune homme insouciant de dix-neuf ans, vient d’être trahi par la femme qu’il aime : humilié et désabusé, il plonge dans l’alcool, la débauche, et se réfugie dans le cynisme. À la mort de son père, il s’installe dans la maison de ce dernier, à la campagne, et rencontre une jeune veuve, Brigitte Pierson, plus âgée que lui et austère, dont il s’éprend et devient l’amant. Mais Octave, qui a perdu sa pureté avec ses illusions, est devenu incapable d’aimer, pire, rongé par des pulsions autodestructrices, il s’applique à torturer mentalement la jeune femme. Survient un troisième personnage, Smith, qui aime Brigitte et parvient à se faire aimer d'elle : ne parvenant pas à la tuer, Octave les laisse partir tous deux ..
"...Tu es femme ; ce corps, cette gorge d’albâtre, tu sais ce qu’ils valent, on te l’a dit ; quand tu les caches sous ta robe, tu ne crois pas, comme les vierges, que tout le monde te ressemble, et tu sais le prix de ta pudeur. Comment la femme qui a été vantée peut-elle se résoudre à ne l’être plus ? se croit-elle vivante si elle reste à l’ombre, et s’il y a silence autour de sa beauté ? Sa beauté même, c’est l’éloge et le regard de son amant. Non, non, il n’en faut pas douter ; qui a aimé ne vit plus sans amour ; qui apprend une mort se rattache à la vie. Brigitte m’aime et en mourrait peut-être ; je me tuerai, et un autre l’aura. Un autre ! un autre ! répétai-je en m’inclinant, appuyé sur le lit, et mon front effleurait son épaule. N’est-elle pas veuve ? pensai-je ; n’a-t-elle pas déjà vu la mort ? ces petites mains délicates n’ont-elles pas soigné et enseveli ? Ses larmes savent combien elles durent, et les secondes durent moins. Ah ! Dieu me préserve ! pendant qu’elle dort, à quoi tient-il que je ne la tue ? Si je l’éveillais maintenant, et si je lui disais que son heure est venue et que nous allons mourir dans un dernier baiser, elle accepterait. Que m’importe ? Est-il donc sûr que tout ne finisse pas là ? J’avais trouvé un couteau sur la table, et je le tenais dans ma main Peur, lâcheté, superstition ! qu’en savent-ils, ceux qui le disent ? C’est pour le peuple et les ignorants qu’on nous parle d’une autre vie ; mais qui y croit au fond du cœur ? Quel gardien de nos cimetières a vu un mort quitter son tombeau et aller frapper chez le prêtre ? C’est autrefois qu’on voyait des fantômes ; la police les interdit à nos villes civilisées, et il n’y crie plus du sein de la terre que des vivants enterrés à la hâte. Qui eût rendu la mort muette, si elle avait jamais parlé ? Est-ce parce que les processions n’ont plus le droit d’encombrer nos rues, que l’esprit céleste se laisse oublier ? Mourir, voilà la fin, le but. Dieu l’a posé, les hommes le discutent ; mais chacun porte écrit au front : « Fais ce que tu veux, tu mourras. » Qu’en dirait-on, si je tuais Brigitte ? ni elle ni moi n’en entendrions rien.
Il y aurait demain dans un journal qu’Octave de T *** a tué sa maîtresse, et après-demain on n’en parlerait plus. Qui nous suivrait au dernier cortège ? Personne qui, en rentrant chez soi, ne déjeunât tranquillement ; et nous, étendus côte à côte dans les entrailles de cette fange d’un jour, le monde pourrait marcher sur nous sans que le bruit des pas nous éveille. N’est-il pas vrai, ma bien-aimée, n’est-il pas vrai que nous y serions bien ? C’est un lit moelleux que la terre ; aucune souffrance ne nous y atteindrait ; on ne jaserait pas dans les tombes voisines de notre union devant Dieu ; nos ossements s’embrasseraient en paix et sans orgueil ; la mort est conciliatrice, et ce qu’elle noue ne se délie pas. Pourquoi le néant t’effraierait-il, pauvre corps qui lui es promis ? Chaque heure qui sonne t’y entraîne, chaque pas que tu fais brise l’échelon où tu viens de t’appuyer ; tu ne te nourris que de morts ; l’air du ciel te pèse et t’écrase, la terre que tu foules te tire à elle par la plante des pieds. Descends, descends ! pourquoi tant d’épouvante ? est-ce un mot qui te fait horreur ? Dis seulement : Nous ne vivrons plus. N’est-ce pas là une grande fatigue dont il est doux de se reposer ? Comment se fait-il qu’on hésite, s’il n’y a que la différence d’un peu plus tôt à un peu plus tard ? La matière est impérissable, et les physiciens, nous diton, tourmentent à l’infini le plus petit grain de poussière sans pouvoir jamais l’anéantir. Si la matière est la propriété du hasard, quel mal faitelle en changeant de torture, puisqu’elle ne peut changer de maître ? Qu’importe à Dieu la forme que j’ai reçue et quelle livrée porte ma douleur ? La souffrance vit dans mon crâne ; elle m’appartient, je la tue ; mais l’ossement ne m’appartient pas, et je le rends à qui me l’a prêté ; qu’un poète en fasse une coupe où il boira son vin nouveau ! Quel reproche puis-je encourir ? et ce reproche, qui me le ferait ? quel ordonnateur inflexible viendra me dire que j’ai mésusé ? Qu’en sait-il ? était-il en moi ? Si chaque créature a sa tâche à remplir, et si c’est un crime de la secouer, quels grands coupables sont donc les enfants qui meurent sur le sein de la nourrice ? pourquoi ceux-là sont-ils épargnés ? De comptes rendus après la mort, à qui servirait la leçon ? Il faudrait bien que le ciel fût désert pour que l’homme fût puni d’avoir vécu, car c’est assez qu’il ait à vivre et je ne sais qui l’a demandé, sinon Voltaire au lit de mort ; digne et dernier cri d’impuissance d’un vieil athée désespéré.
À quoi bon ? pourquoi tant de luttes ? qui donc est là haut qui regarde, et qui se plait à tant d’agonies ? qui donc s’égaie et se désœuvre à ce spectacle d’une création toujours naissante et toujours moribonde ? à voir bâtir, et l’herbe pousse ; à voir planter, et la foudre tombe ; à voir marcher, et la mort crie « holà» ; à voir pleurer, et les larmes sèchent ; à voir aimer, et le visage se ride ; à voir prier, se prosterner, supplier et tendre les bras, et les moissons n’en ont pas un brin de froment de plus ! Qui est-ce donc qui a tant fait, pour le plaisir de savoir tout seul que ce qu’il a fait, ce n’est rien ? La terre se meurt ; Herschell dit que c’est de froid ; qui donc tient dans sa main cette goutte de vapeurs condensées, et la regarde s’y dessécher, comme un pêcheur un peu d’eau de mer, pour en avoir un grain de sel ?
Cette grande loi d’attraction qui suspend le monde à sa place, l’use et le ronge dans un désir sans fin ; chaque planète charrie ses misères en gémissant sur son essieu ; elles s’appellent d’un bout du ciel à l’autre, et, inquiètes du repos, cherchent qui s’arrêtera la première. Dieu les retient ; elles accomplissent assidûment et éternellement leur labeur vide et inutile ; elles tournent, elles souffrent, elles brûlent, elles s’éteignent et s’allument, elles descendent et remontent, elles se suivent et s’évitent, elles s’enlacent comme des anneaux ; elles portent à leur surface des milliers d’êtres renouvelés sans cesse ; ces êtres s’agitent, se croisent aussi, se serrent une heure les uns contre les autres, puis tombent, et d’autres se lèvent ; là où la vie manque, elle accourt ; là où l’air sent le vide, il se précipite ; pas un désordre, tout est réglé, marqué, écrit en lignes d’or et en paraboles de feu ; tout marche au son de la musique céleste sur des sentiers impitoyables, et pour toujours ; et tout cela n’est rien ! Et nous, pauvres rêves sans nom, pâles et douloureuses apparences, imperceptibles éphémères, nous qu’on anime d’un souffle d’une seconde pour que la mort puisse exister, nous nous épuisons de fatigue pour nous prouver que nous jouons un rôle et que je ne sais quoi s’aperçoit de nous.
Nous hésitons à nous tirer sur la poitrine un petit instrument de fer, et à nous faire sauter la tête avec un haussement d’épaules ; il semble que, si nous nous tuons, le chaos va se rétablir ; nous avons écrit et rédigé les lois divines et humaines, et nous avons peur de nos catéchismes ; nous souffrons trente ans sans murmurer, et nous croyons que nous luttons ; enfin la souffrance est la plus forte, nous envoyons une pincée de poudre dans le sanctuaire de l’intelligence, et il pousse une fleur sur notre tombeau. Comme j’achevais ces paroles, j’avais approché le couteau que je tenais de la poitrine de Brigitte. Je n’étais plus maître de moi, et je ne sais, dans mon délire, ce qui en serait arrivé ; je rejetai le drap pour découvrir le cœur, et j’aperçus entre les deux seins blancs un petit crucifix d’ébène. Je reculai, frappé de crainte ; ma main s’ouvrit, et l’arme tomba. C’était la tante de Brigitte qui lui avait, au lit de mort, donné ce petit crucifix. Je ne me souvenais pourtant pas de le lui avoir jamais vu ; sans doute, au moment de partir, elle l’avait suspendu à son cou, comme une relique préservatrice des dangers du voyage. Je joignis les mains tout à coup et me sentis fléchir vers la terre. – Seigneur mon Dieu ! dis je en tremblant, Seigneur mon Dieu, vous étiez là ! Que ceux qui ne croient pas au Christ lisent cette page ; je n’y croyais pas non plus..."
1838 - "L'espoir en Dieu"
Cette pièce est une méditation lyrique analogue à celles de Lamartine. Elle a été écrite pour la pieuse marquise de Castries, amie du poète. Par les idées qui l'inspirent et par la forme, elle rappelle, d'ailleurs, la lettre que Musset avait adressée, deux ans auparavant, au poète du Lac. En 1838, encore sous le coup de la grave crise morale qui avait bouleversé sa vie, il demandait à la lecture des philosophes anciens et modernes le secret de la destinée humaine, le sens de la souffrance et le but de la vie. "L'Espoír en Dieu", publié le 15 février 1838 dans la Revue des Deuz Mondes, s'inspire de ces hautes préoccupations. Nous donnons la première partie de cette longue méditation qui se termine par une prière en strophes d'octosyllabes. Après avoir posé l'anxieuse énigme de son doute et de son ignorance, le poète passe en revue les différentes réponses des philosophies humaines aux problèmes du mal, du scepticisme et de la mort; il montre qu'aucune ne satisfait le cœur ni la raison, et qu'il n'y a de recours pour l'homme que dans la Divinité.
"Tant que mon faible cœur, encor plein de jeunesse,
A ses illusions n'aura pas dit adieu,
Je voudrais m'en tenir à l'antique sagesse,
Qui du sobre Épicure a fait un demi-dieu
Je voudrais vivre, aimer, m'accoutumer aux hommes
Chercher un peu de joie et n'y pas trop compter,
Faire ce qu'on a fait, être ce que nous sommes,
Et regarder le ciel sans m'en inquiéter.
Je ne puis ; — malgré moi l'infini me tourmente.
Je n'y saurais songer sans crainte et sans espoir ;
Et, quoi qu'on en ait dit, ma raison s'épouvante
De ne pas le comprendre et pourtant de le voir.
Qu'est-ce donc que ce monde, et qu'y venons-nous faire,
Si pour qu'on vive en paix, il faut voiler les cieux ?
Passer comme un troupeau les yeux fixés à terre,
Et renier le reste, est-ce donc être heureux ?
Non, c'est cesser d'être homme et dégrader son âme.
Dans la création le hasard m'a jeté ;
Heureux ou malheureux, je suis né d'une femme,
Et je ne puis m'enfuir hors de l'humanité.
Que faire donc ? « Jouis, dit la raison païenne ;
Jouis et meurs ; les dieux ne songent qu'à dormir.
— Espère seulement, répond la foi chrétienne ;
Le ciel veille sans cesse, et tu ne peux mourir. »
Entre ces deux chemins j'hésite et je m'arrête.
Je voudrais, à l'écart, suivre un plus doux sentier.
Il n'en existe pas, dit une voix secrète ;
En présence du ciel, il faut croire ou nier.
Je le pense en effet ; les âmes tourmentées
Dans l'un et l'autre excès se jettent tour à tour,
Mais les indifférents ne sont que des athées ;
Ils ne dormiraient plus s'ils doutaient un seul jour.
Je me résigne donc, et, puisque la matière
Me laisse dans le cœur un désir plein d'effroi,
Mes genoux fléchiront ; je veux croire et j'espère.
Que vais-je devenir, et que veut-on de moi ?
Me voilà dans les mains d'un Dieu plus redoutable
Que ne sont à la fois tous les maux d'ici-bas ;
Me voilà seul, errant, fragile et misérable,
Sous les yeux d'un témoin qui ne me quitte pas...."
1839 - JAMAIS - Ce sonnet, écrit en 1839, et qui fait partie des Poésies nouvelles, est une pièce de circonstance, inspirée à Musset par une rencontre de sa vie mondaine. Il s'agit d'une jeune veuve, qu'il voyait dans le salon de sa marraine, Mme Jaubert, et à qui il avait dit un jour qu'elle était trop jeune et trop belle pour demeurer veuve. Sur sa réponse : Jamais! le poète écrivit ce sonnet...
Jamais, avez-vous dit, tandis qu’autour de nous
Résonnait de Schubert la plaintive musique ;
Jamais, avez-vous dit, tandis que, malgré vous,
Brillait de vos grands yeux l’azur mélancolique.
Jamais, répétiez-vous, pâle et d’un air si doux
Qu’on eût cru voir sourire une médaille antique.
Mais des trésors secrets l’instinct fier et pudique
Vous couvrit de rougeur, comme un voile jaloux.
Quel mot vous prononcez, marquise, et quel dommage !
Hélas ! je ne voyais ni ce charmant visage,
Ni ce divin sourire, en vous parlant d’aimer.
Vos yeux bleus sont moins doux que votre âme n’est belle.
Même en les regardant, je ne regrettais qu’elle,
Et de voir dans sa fleur un tel coeur se fermer.
1840 - UNE SOIRÉE PERDUE - Comme beaucoup de poésies de Musset, celle-ci se rattache à une circonstance précise de sa vie : ici, c'est une représentation du Misanthrope à la Comédie-Française, pendant l'été de 1840. Deux thèmes s'y croisent en un harmonieux mélange, un thème satirique, inspiré par Molière (v. 11-22, 37-68), un thème élégiaque, inspire par André Chénier (V. 23-36, 69-84). La gloire de Molière avait subi une éclipse depuis le XVIIIe siècle et le romantisme ne lui avait pas été favorable. On ne le jouait plus volontiers, même au Théâtre-Français, et on ne savait plus guère le jouer, témoin une représentation solennelle du Misanthrope, précisément, donnée au palais de Versailles, le 10 juin 1837, pour l'inauguration du Musée, et dont la médiocrité avait fait scandale. ll n'est pas impossible que ce souvenir ait aussi inspiré Musset dans "Une soirée perdue". La pièce parut dans la Revue des Deux Mondes en août 1840.
J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français,
Ou presque seul ; l’auteur n’avait pas grand succès.
Ce n’était que Molière, et nous savons de reste
Que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste,
Ignora le bel art de chatouiller l’esprit
Et de servir à point un dénouement bien cuit.
Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode,
Et nous aimons bien mieux quelque drame à la mode
Où l’intrigue, enlacée et roulée en feston,
Tourne comme un rébus autour d’un mirliton.
J’écoutais cependant cette simple harmonie,
Et comme le bon sens fait parler le génie.
J’admirais quel amour pour l’âpre vérité
Eut cet homme si fier en sa naïveté,
Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde,
Quelle mâle gaieté, si triste et si profonde
Que, lorsqu’on vient d’en rire, on devrait en pleurer !
Et je me demandais : Est-ce assez d’admirer ?
Est-ce assez de venir, un soir, par aventure,
D’entendre au fond de l’âme un cri de la nature,
D’essuyer une larme, et de partir ainsi,
Quoi qu’on fasse d’ailleurs, sans en prendre souci ?
Enfoncé que j’étais dans cette rêverie,
Çà et là, toutefois, lorgnant la galerie,
Je vis que, devant moi, se balançait gaiement
Sous une tresse noire un cou svelte et charmant ;
Et, voyant cet ébène enchâssé dans l’ivoire,
Un vers d’André Chénier chanta dans ma mémoire,
Un vers presque inconnu, refrain inachevé,
Frais comme le hasard, moins écrit que rêvé.
J’osai m’en souvenir, même devant Molière ;
Sa grande ombre, à coup sûr, ne s’en offensa pas ;
Et, tout en écoutant, je murmurais tout bas,
Regardant cette enfant, qui ne s’en doutait guère :
» Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat,
Se plie, et de la neige effacerait l’éclat. »
Puis je songeais encore (ainsi va la pensée)
Que l’antique franchise, à ce point délaissée,
Avec notre finesse et notre esprit moqueur,
Ferait croire, après tout, que nous manquons de coeur ;
Que c’était une triste et honteuse misère
Que cette solitude à l’entour de Molière,
Et qu’il est pourtant temps, comme dit la chanson,
De sortir de ce siècle ou d’en avoir raison ;
Car à quoi comparer cette scène embourbée,
Et l’effroyable honte où la muse est tombée ?
La lâcheté nous bride, et les sots vont disant
Que, sous ce vieux soleil, tout est fait à présent ;
Comme si les travers de la famille humaine
Ne rajeunissaient pas chaque an, chaque semaine.
Notre siècle a ses moeurs, partant, sa vérité ;
Celui qui l’ose dire est toujours écouté.
Ah ! j’oserais parler, si je croyais bien dire,
J’oserais ramasser le fouet de la satire,
Et l’habiller de noir, cet homme aux rubans verts,
Qui se fâchait jadis pour quelques mauvais vers.
S’il rentrait aujourd’hui dans Paris, la grand’ville,
Il y trouverait mieux pour émouvoir sa bile
Qu’une méchante femme et qu’un méchant sonnet ;
Nous avons autre chose à mettre au cabinet.
Ô notre maître à tous, si ta tombe est fermée,
Laisse-moi dans ta cendre, un instant ranimée,
Trouver une étincelle, et je vais t’imiter !
J’en aurai fait assez si je puis le tenter.
Apprends-moi de quel ton, dans ta bouche hardie,
Parlait la vérité, ta seule passion,
Et, pour me faire entendre, à défaut du génie,
J’en aurai le courage et l’indignation !
Ainsi je caressais une folle chimère.
Devant moi cependant, à côté de sa mère,
L’enfant restait toujours, et le cou svelte et blanc
Sous les longs cheveux noirs se berçait mollement.
Le spectacle fini, la charmante inconnue
Se leva. Le beau cou, l’épaule à demi nue,
Se voilèrent ; la main glissa dans le manchon ;
Et, lorsque je la vis au seuil de sa maison
S’enfuir, je m’aperçus que je l’avais suivie.
Hélas ! mon cher ami, c’est là toute ma vie.
Pendant que mon esprit cherchait sa volonté,
Mon corps savait la sienne et suivait la beauté ;
Et, quand je m’éveillai de cette rêverie,
Il ne m’en restait plus que l’image chérie :
» Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat,
Se plie, et de la neige effacerait l’éclat.

"Souvenir" - En septembre 1840, traversant la forêt de Fontainebleau resurgit le souvenir de George Sand aux premiers temps de leur liaison. Ces dix strophes forment la première partie d'un poème qui l`on peut comparer, pour l'inspiration, à La Tristesse d'Olympio de Victor Hugo.
Le "Souvenir" peut être considéré comme l'épilogue des "Nuits". Il marque la fin de ces huit années de passion, d'exaltation, de colère et de souffrance qui bouleverseront la vie de Musset et auxquelles il dut les plus beaux accents de sa poésie. Au mois de septembre 1840, le poète, en allant visiter des amis au château d'Angerville, traversa la forêt de Fontainebleau. La vue des sites qui avaient été témoins de son bonheur réveilla en lui le souvenir encore douloureux, mais apaisé, de la femme qu'il avait aimée et perdue. Rentré à Paris, un soir au théâtre, il aperçut George Sand, et quelques jours après, en février 1841, écrivit le Souvenir, sous la forme et avec le rythme des Méditations de Lamartine, dédiées elles aussi (Le Lac, Le Crucifix) à l'ombre d'un amour défunt. Le sens de cette plainte harmonieuse est tout entier dans les doux vers célèbres : "Un souvenir heureux est peut-être sur terre Plus vrai que le bonheur", qui répond au vers de Dante, "Il n'est pire misère qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur"...
J'espérais bien pleurer, mais je croyais souffrir
En osant te revoir, place à jamais sacrée,
O la plus chère tombe et la plus ignorée
Où dorme un souvenir !
Que redoutiez-vous donc de cette solitude,
Et pourquoi, mes amis, me preniez-vous la main,
Alors qu'une si douce et si vieille habitude
Me montrait ce chemin ?
Les voilà, ces coteaux, ces bruyères fleuries,
Et ces pas argentins sur le sable muet,
Ces sentiers amoureux, remplis de causeries,
Où son bras m'enlaçait.
Les voilà, ces sapins à la sombre verdure,
Cette gorge profonde aux nonchalants détours,
Ces sauvages amis, dont l'antique murmure
A bercé mes beaux jours.
Les voilà, ces buissons où toute ma jeunesse,
Comme un essaim d'oiseaux, chante au bruit de mes pas.
Lieux charmants, beau désert où passa ma maîtresse,
Ne m'attendiez-vous pas ?
Ah ! laissez-les couler, elles me sont bien chères,
Ces larmes que soulève un coeur encor blessé !
Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières
Ce voile du passé !
Je ne viens point jeter un regret inutile
Dans l'écho de ces bois témoins de mon bonheur.
Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille,
Et fier aussi mon coeur.
Que celui-là se livre à des plaintes amères,
Qui s'agenouille et prie au tombeau d'un ami.
Tout respire en ces lieux ; les fleurs des cimetières
Ne poussent point ici.
Voyez ! la lune monte à travers ces ombrages.
Ton regard tremble encor, belle reine des nuits ;
Mais du sombre horizon déjà tu te dégages,
Et tu t'épanouis.
Ainsi de cette terre, humide encor de pluie,
Sortent, sous tes rayons, tous les parfums du jour :
Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie
Sort mon ancien amour.
Que sont-ils devenus, les chagrins de ma vie ?
Tout ce qui m'a fait vieux est bien loin maintenant ;
Et rien qu'en regardant cette vallée amie
Je redeviens enfant.
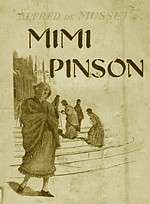
1845 - MIMI PINSON. Musset a fait entièrement tenir son conte dans une ronde célèbre : "Mimi Pinson est une blonde, Une blonde que l`on connaît..." - Nouvelle d'Alfred de Musset publiée en 1845. Eugène Aubert est un étudiant en médecine. Studieux, solitaire et rêveur. ll ne fait guère la noce, ce qui lui vaut les railleries de ses camarades. L'un d`eux, Marcel, l'engage à faire la cour à une grisette, Mimi Pinson. Le hasard fait qu'Eugene vient à connaître toute la générosité de Mimi : celle-ci n`a-t-elle pas engagé son unique robe pour acheter de la nourriture à l`une de ses amies. malade, et ensuite ne s`en est-elle pas allée prier à l'église? Attendri, Eugène fait un don anonyme et décide d'aller voir le lendemain la malade et son amie. Mais, tout plein de ces bonnes intentions. il rencontre les deux grisettes consommant force glaces à la terrasse du Tortoni, grâce à l'argent qu'il leur a fait parvenir la veille. Marcel, son ami, le taquine, mais lui demande d`être indulgent pour Mimi Pinson....
"Tant qu’il n’était question que de travail, il était le premier à l’œuvre; mais, s’il s’agissait d'une partie de plaisir, d’un dîner au Moulin de beurre, ou d’une contredanse à la Chaumière, "la Petite Fille" secouait la tête et regagnait sa chambrette garnie. Chose presque monstrueuse parmi les étudiants, non seulement Eugène n’avait pas de maîtresse, quoique son âge et sa figure eussent pu lui valoir des succès, mais on ne l’avait jamais vu faire le galant au comptoir d'une grisette, usage immémorial au quartier Latin. Les beautés qui peuplent la Montagne-Sainte- Geneviève, et se partageât les amours des écoles, lui inspiraient une sorte de répugnance qui allait jusqu’à l’aversion. Il les regardait comme une espèce à part, dangereuse, ingrate et dépravée, née pour laisser partout le mal et le malheur en échange de quelques plaisirs. «Gardez-vous de ces femmes-là, disait-il : ce sont des poupées de fer rouge.» Et il ne trouvait malheureusement que trop d’exemples pour justifier la haine qu’elles lui inspiraient. Les querelles, les désordres, quelquefois même la ruine qu’entraînent ces liaisons passagères , dont les dehors ressemblent au bonheur, n’étaient que trop faciles à citer, l’année dernière comme aujourd’hui, et probablement comme l’année prochaine.
Il va sans dire que les amis d’Eugène le raillaient continuellement sur sa morale et ses scrupules : «Que prétends-tu , lui demandait souvent un de ses camarades, nommé Marcel, qui faisait profession d’être un bon vivant, que prouvent une faute ou un accident arrivé une fois par hasard?
— Qu’il faut s’abstenir, répondait Eugène, de peur qu’ils n’arrivent une seconde fois.
— Faux raisonnement ! répliquait Marcel ; argument de capucin de carte, qui tombe si le compagnon trébuche. De quoi vas-tu t’inquiéter ? Tel d’entre nous a perdu au jeu ; est-ce une raison pour se faire moine ? L’un n’a plus le sou, l’autre boit de l’eau fraîche; est-ce qu’Élise en perd l’appétit? A qui la faute si le voisin porte sa montre au Mont-de- Piété pour aller se casser un bras à Montmorency? la voisine n’en est pas manchote. Tu te bats pour Rosalie; on te donne un coup d’épée : elle te tourne le dos, c’est tout simple ; en a-t-elle moins fine taille ? Ce sont de ces petits inconvénients dont l’existence est parsemée, et ils sont plus rares que tu ne penses. Regarde un dimanche, quand il fait beau temps, que de bonnes paires d’amis dans les cafés, les promenades et les guinguettes! Considère-moi ces gros omnibus bien rebondis, bien bourrés de grisettes, qui vont au Ranelagh ou à Belleville. Compte ce qui sort, un jour de fête seulement, du quartier Saint-Jacques: les bataillons de modistes, les armées de lingères, les nuées de marchandes de tabac; tout cela s'amuse, tout cela a ses amours ; tout cela va s’abattre autour de Paris, sous les tonnelles des campagnes, comme des volées de friquets. S’il pleut, cela va au mélodrame manger des oranges et pleurer; car cela mange beaucoup, c’est vrai, et pleure aussi très-volontiers, c’est ce qui prouve un bon caractère. Mais quel mal font ces pauvres filles, qui ont cousu, bâti, ourlé, piqué et ravaudé toute la semaine, en prêchant d’exemple, le dimanche, l’oubli des maux et l’amour du prochain? Et que peut faire de mieux un honnête homme, qui, de son côté , vient de passer huit jours à disséquer des choses peu agréables, que de se débarbouiller la vue en regardant un visage frais, une jambe ronde, et la belle nature?
— Sépulcres blanchis, disait Eugène.
— Je dis et je maintiens, continuait Marcel, qu’on peut et qu’on doit faire l’éloge des grisettes, et qu’un usage modéré en est bon. Premièrement, elles sont vertueuses, car elles passent la journée à confectionner les vêtements les plus indispensables à la pudeur et à la modestie ; en second lieu, elles sont honnêtes, car il n'y a pas de maîtresse lingère ou autre qui ne recommande à ses filles de boutique de parler au monde poliment; troisièmement, elles sont très-soigneuses et très-propres, attendu qu'elles ont sans cesse entre les mains du linge et des étoffes qu’il ne faut pas qu’elles gâtent, sous peine d’être moins bien payées; quatrièmement, elles sont sincères, parce qu’elles boivent du ratafia; en cinquième lieu, elles sont économes et frugales, parce qu'elles ont beaucoup de peine à gagner trente sous, et, s’il se trouve des occasions où elles se montrent gourmandes et dépensières, ce n’est jamais avec leurs propres deniers; sixièmement, elles sont très-gaies, parce que le travail qui les occupe est en général ennuyeux à mourir, et qu’elles frétillent comme le poisson dans l’eau dès que l’ouvrage est terminé. Un autre avantage qu’on rencontre en elles, c’est qu’elles ne sont point gênantes, vu. qu’elles passent leur vie clouées sur une chaise dont elles ne peuvent pas bouger, et que, par conséquent, il leur est impossible de courir après leurs amants comme des dames de bonne compagnie. En outre, elles ne sont pas bavardes, parce qu’elles sont, obligées de compter leurs points. Elles ne dépensent pas grand’ chose pour leur chaussure, parce qu’elles marchent peu, ni pour leur toilette, parce qu'il est rare qu’on leur fasse crédit. Si on les accuse d’inconstance, ce n’est pas parce qu’elles lisent de mauvais romans ni par méchanceté naturelle ; cela tient au grand nombre de personnes différentes qui passent devant leurs boutiques; d’un autre côté, elles prouvent suffisamment qu’elles sont capables de passions véritables par la grande quantité d’entre elles qui se jettent journellement dans la Seine ou par leur fenêtre, ou qui s'asphyxient dans leurs domiciles. Elles ont, il est vrai, l’inconvénient d’avoir presque toujours faim et soif, précisément à cause de leur grande tempérance, mais il est notoire qu’elles peuvent se contenter, en guise de repas, d’un verre ..."

DERNIERS VERS D'ALFRED DE MUSSET ...
L'heure de ma mort, depuis dix-huit mois,
De tous les côtés sonne à mes oreilles.
Depuis dix-huit mois d'ennuis et de veilles,
Partout je la sens, partout je la vois.
Plus je me débats contre ma misère,
Plus s'éveille en moi l'instinct du malheur;
Et, dès que je veux faire un pas sur terre,
Je sens tout à coup s'arrêter mon cœur.
Ma force à lutter s'use et se prodigue
Jusqu'à mon repos, tout est un combat;
Et, comme un coursier brisé de fatigue,
Mon courage éteint chancelle et s'abat.
Portrait d'Alfred de Musset, c. 1850s. par Alexandre Bida (1823-1895).
