- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Ivan Tourgueniev (1818-1883), "Mémoires d'un chasseur" (1847-1852), "Journal d'un homme de trop" (1850), "Le Nid de gentilshommes" (1858), "Pères et Fils" (1862) - Mikhail Saltykov-Chtchédrine (1826-1889), "Les Golovlev" (1873-1874) - Nikolaï Semenovitch Leskov (1831-1895), "Une Famille déchue" (1867) - Ivan Kramskoï (1837-1887) - ...
Last Update : 31/11/2016

Le plus occidental des trois grands romanciers de la littérature russe dans la la seconde moitié de ce XIXe siècle s'interroge sur la finalité de son existence dans une réalité sociale russe qui se complexifie, mais en plus en psychologue qu'en politique - Alors que Tolstoï et Dostoïevski - il était de dix ans l'aîné du premier et de trois celui du deuxième - eurent une réaction allergique aux influences de la culture occidentale en Russie, le romancier et dramaturge Ivan Turgenev (1818-1883) s'y orienta avec prédilection.
Malgré son admiration affichée pour ses deux contemporains, Turgenev fut logiquement la victime d'une satire sans merci dans un roman de Dostoïevski, "Les Démons" (1872), et Tolstoï le provoqua même en duel. Quoiqu'il en soit, son roman le plus célèbre, "Pères et Fils" (1861), et sa profusion de récits courts lui valurent d'être reconnu comme l'un des plus grands écrivains russes. Certes, il eut à subir une longue éclipse, tant ses questions idéologiques semblaient dépassées, ses descriptions fades, ses personnages manquant de vigueur, devant des auteurs tels que Dostoïevski, Tolstoï, ou Tchékhov.
Le cosmopolitisme de Tourgueniev n'était nullement du à un désamour de sa patrie, il avait fait ses études à l'université de Berlin, - attiré par la culture allemande, comme presque tous les intellectuels russes de l'époque -, admirait un grand nombre des idéaux des Lumières, mais éprouva une grande passion pour la Russie, bien qu'il se soit mis à dos ses censeurs. Ce fut surtout sa longue aventure avec la cantatrice Pauline Viardot (1821-1910), rencontrée en 1843, qui l'attira hors de Russie : elle sera courtisée par Alfred de Musset qu'elle repoussa et adulée par George Sand. Intime de nombreux compositeurs français de l'époque, Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns, Frédéric Chopin, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1849 la fit quitter la France pour l'Allemagne pour quelques temps. En novembre 1874, Tourgueniev achèta une demeure de maître à Bougival où il installa la famille Viardot. Mais un Tourgueniev gentilhomme russe de moyenne condition, partageant son existence entre son domaine campagnard et Moscou, plutôt que Saint-Pétersbourg ou les capitales occidentales, Berlin et Paris, en fait sans foyer, sans patrie, sans croyance et ayant rencontré toute une génération d'écrivains français, George Sand en 1850, Prosper Mérimée et Alexandre Dumas en 1857, Gustave Flaubert en 1863, et dans les années 1870, Emile Zola, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt ...
(Ilya Repin, The Arrest of a Propagandist, 1880, Moskva, The Tretyakov Gallery)

Ivan Tourgueniev (1818-1883)
Né à Orel, ayant vécu jusqu'à l'âge de sept ans dans le domaine maternel de Spasskoje, d'un père dont il ne parla que peu, officier des cuirassiers et personnage insignifiant qui avait épousé la riche Lutovinova, plus âgée que lui, par intérêt, une mère donc aigrie par une vie malheureuse depuis l'enfance, pervertie par la toute-puissance que lui offrait le servage et se laissant aller à des accès redoutables de colère ou d'excentricité - il en a tracé un portrait
impitoyable dans "Mumu" (1852) -, tel est la première partie de la vie d'Ivan Sergueïevitch Tourguénev. C'est à ce moment-là qu'il connut lesmonstruosités auxquelles donnait lieu l'institution du servage. Un serf, qu'il évoque avec reconnaissance dans "Punin et Baburin" (1874), lui donna goût de la lecture et de la littérature russes. A Moscou que le jeune Tourguénev suivit, dans des pensions, les cours preparatoires à l`Université, où il entra, selon les usages du temps, à l'âge de quinze ans. Il continua ses études à Saint-Pétersbourg. Par son professeur de littérature Pletnev, grand ami de Pouchkine, Tourguénev, seul de sa génération, aura un lien vivant avec la tradition poétique de cette époque. En 1837, après la mort d'Alexandre Pouchkine, il édite la correspondance de ce dernier et en 1938 son fameux poème "Le soir" est publié dans une revue progressiste. En 1838, pour parfaire ses études et son apprentissage de la vie, Tourguénev part pour Berlin, trois années à fréquenter la Faculté de philosophie et une pléiade de jeunes philosophes russes, Granovskij, Stankevic, Bakounine... unis par une dévotion commune à Hegel. Séduit par la civilisation "avancée" de l'Occident, Tourgénev se range résolument dans le camp des occidentalistes.
Comme le content ses biographes, la Russie et Saint-Pétersbourg le revoient en 1841 jeune, élégant, remarquablement cultivé. Il songe au professorat, mais les parties de chasse l'empêchent de poursuivre, il a une liaison avec une lingère, de laquelle naîtra sa fille Pélagie - deviendra Pauline, la fille adotptive des Viardot -, devient fonctionnaire en 1843 et rencontre le critique Vissarion Belinski. A la même époque, fréquentant le «nid de gentilshommes» qu'était la famille Bakounine, il brise, en passant, le cœur de Tatiana, sœur du futur révolutionnaire. Le 28 octobre 1843, au cours d'une partie de chasse, Tourguéniev rencontre Louis Viardot, quelques jours après il est peésenté à sa femme, la célèbre cantatrice Pauline Garcia, future Viardot, il la suivra jusqu'à Paris et entretiendra avec elle une liaison jusqu’à sa mort. Cette période marque son abandon de la poésie pour la prose, après "Andréi Kilosov" (1844), l'histoire de "Petuskov" (1847), un homme faible brisé par une femme de rien contient déjà en germe tout l'univers romanesque de l'écrivain.
De 1847 à 1850, Tourgueniev vit en France et publiera beaucoup. Sa mère lui a coupé les vivres, le condamnant à une vie de bohème, dont le recueil "Mémoires d’un chasseur" et la pièce "Un mois à la campagne" (1850). Il fréquente Belinsky, Herzen, Annenkov, passe quelques jours près de Paris dans le château de Courtavenel, propriété des Viardot, fait connaissance de Charles Gounod, George Sand, Mérimée, Musset, Chopin. En 1850, il est rappelé en Russie, la mort de sa mère le met définitivement à l'abri des soucis financiers. L'article nécrologique dédié à Nicolas Gogol en 1852 lui vaut un mois d'arrêts et l'exil dans son domaine de Spasskoje. Son retour en novembre 1853 à Saint-Pétersbourg sera d'autant plus triomphal que ses "Récits ou Mémoires d'un Chasseur" viennent d'être publiés et lui vaut une place parmi les écrivains russes.

"Mémoires d'un chasseur" (1847-1852, Zapiski okhotnika)
Recueil de vingt-cinq nouvelles tirées de la vie des paysans et des propriétaires terriens . Un recueil qui marque une date importante dans l'évolution de la sensibilité russe au XIXe siècle, d'abord par un sentiment de la nature qui jamais encore n`avait allié tant de ferveur à tant de précision réaliste, mais surtout parce qu`il découvrait au public un monde nouveau. Il introduisait. en effet. en littérature un personnage qui désormais s'imposera, le paysan. dans son cadre autonome, avec ses passions et ses traditions, toute son âme dont on découvrit qu'elle est aussi complexe que celle de maint aristocrate. En une vingtaine de contes, qui n`ont d`autre lien apparent que la personnalité du narrateur, Tourgueniev évoquait les nuances infinies de l`univers rustique. Tous ces récits sont présentés comme extraits des carnets d'un chasseur, qui se promène et parfois s`égare dans la campagne ; alors, en spectateur objectif, effacé, le plus souvent silencieux, il note les traits de mœurs, laisse parler paysans et propriétaires terriens, enregistre consciencieusement, et avec un détachement apparent, les histoires, les racontars, les disputes, les drames : Le Putois et Kalinytch (1847), Iermolaï et la Meunière (1847), L'Eau de framboise (1848), Le Médecin de campagne (1848), Mon voisin Radilov (1847), L'Odnodvorets Ovsianikov (1847), Lgov (1847), Le Pré Béjine (1851), Cassien de la belle Métcha (1851), Le Régisseur (1847), Le Bureau (1847), Le Loup-garou (1848), Deux gentilshommes campagnards (1852), Lébédiane (1848), Tatiana Borissovna et son neveu (1848), La Mort (1848), Les Chanteurs (1850), Pierre Pétrovitch Karataïev (1847), Le Rendez-vous (1850), Le Hamlet du district de Chtchigry (1849), Tchertopkhanov et Nédopiouskine (1849), La Fin de Tchertopkhanov (1872), Relique vivante (1874), On vient (1874), La Forêt et la Steppe (1849) ...
"Un jour d'automne, vers le milieu de septembre, j'étais assis dans un bois de bouleaux. Une pluie fine et un clair soleil alternaient depuis le matin. Le temps était douteux. Tantôt le ciel se couvrait de nuages blancs et légers, tantôt l'horizon se dégageait brusquement, et l'azur, clair et tendre, apparaissait alors comme un doux regard. Je regardais autour de moi et j'écoutais. Au-dessus de ma tête les feuilles bruissaient très doucement; — et ce bruit seul eût suffi à caractériser la saison. Ce n'était pas le gai frémissement du printemps, ni le froissement moelleux, le long bavardage de l'été, ni le bégaiement timide de la fin de l'automne : c'était un babil perceptible à peine, assoupissant. Un léger souffle passait sur les sommets; l'intérieur du bois, tout imprégné de pluie, se transformait sans cesse, selon que le soleil se montrait ou se cachait derrière un nuage; tantôt le bois entier s'éclairait comme un vaste et soudain sourire, les tiges roses et minces des bouleaux prenaient un éclat adouci et satiné de blanc, les feuilles bariolaient le sol brillant comme de l'or monnayé, et les hampes exquises de la haute fougère, déjà teinte de ses couleurs hivernales qui rappellent celles du raisin trop mûr, se croisaient et se confondaieut ; tantôt tout reprenait une teinte bleuâtre et les couleurs vives disparaissaient, ..."
Le livre constitue une véritable comédie humaine et si les paysans y tiennent une large place. ils n`y sont pas les seuls acteurs. et partagent la scène avec les propriétaires (pomiechtchiki). gens assez ignobles, moins méchants naturellement que pervertis par la vie des villes, gaspillant leur temps dans la fainéantise. l'ennui et la débauche. Les préférences de Tourgueniev vont bien entendu aux paysans. Il les découvre avec amour, mais avec lucidité. On ne trouve nulle trace dans son livre de messianisme facile : son paysan n`est pas une créature divine. qui aurait conservé au fond d`elle-même quelque pureté originelle qui le rendrait foncièrement différent du reste des membres de la société. C'est simplement un homme comme les autres. ni meilleur ni pire, plus proche sans doute de la nature. mais aussi de la sauvagerie primitive, qui reparaît parfois dans ses débauches monstrueuses. ll a pourtant des qualités particulières : une profonde pitié pour toutes choses. animées ou non, une entente naturelle avec les rythmes du monde, un amour vrai et spontané du prochain, une résignation aux hasards de la vie qui déboucherait aisément sur le fatalisme. Tourgueniev sait montrer ses héros dans leur vie, dans leurs gestes. les laissant être eux-mêmes. complétement, sans jamais venir les troubler par sa présence. ni par une admiration indiscrète. Et rien de plus varié que la suite de ces récits, parfois simples, ou grandioses évocations de paysages (L'Epilogue). parfois conversations entendues au détour d'un bois (Le Pré Biéjine). parfois véritables drames (Le Rendez-Vous). La réussite du conteur est précisément de faire sentir que ce monde paysan, qu`on s'imaginait sous la forme d'une masse brute et bestiale. est agitée d`autant de passions et de nuances dans les passions. que n`importe quelle autre humanité.
Cet être misérable de la "Relique vivante", que le narrateur aperçoit au fond d`un hangar et dans lequel il reconnait la servante, jadis jolie, de ses parents atteinte maintenant d'un mal étrange qui donne à ses chairs la dureté du bronze, ce squelette oublié du monde. peut-être n'est-il que l`image immuable de la douleur humaine ...
".. Je m'engageai dans le sentier et j'arrivai au rucher. Tout auprès s'élevait un de ces petits hangars de branches tressées, que l'on nomme amschanik, où l'on abrite les ruches du froid d'hiver. A travers la porte entr'ouverte j'aperçus un réduit plein d'ombre et de paix; l'air y était sec et il s'exhalait des senteurs de menthe et de mélisse. Dans un coin était étendue sur un lit de planches une sorte de petite forme enveloppée d'une couverture... J'allais me retirer...
— Bârine! bârine! Piotre Petroviteh! fit une voix faible, traînante, enrouée; on eut dit le bruissement des joncs sur un étang.
Je m'arrêtai.
— Piotre Petrpvitch! je vous prie, approchez! reprit la voix qui venait des planches.
J'approchai et je restai stupéfait. C'était un être vivant qui était étendu devant moi, un être humain, mais quel être! Son visage tout desséché avait un ton de bronze comme les vieilles icônes russes; le nez était mince comme une lame de couteau, les lèvres ne s'apercevaient presque pas; la blancheur des yeux et des dents tranchait seule sur ce visage sombre; des cheveux jaunes pendaient sur le front en mèches rares, échappées; d'un foulard. Sous le menton, émergeant de la couverture, deux mains minuscules, de bronze comme la figure, remuaient, tels des bâtonnets, des doigts maigres.
Je regardai avec plus d'attention : ce visage n'était point laid, il était même beau, mais terrible... d'autant plus terrible que ce masque métallique s'efforçait... s'efforçait, sans y arriver, de se contracter en sourires.
— Vous ne me reconnaissez pas, bârine? murmura encore la voix qui paraissait exhalée comme une vapeur d'entre ses lèvres presque immobiles. D'ailleurs, comment pourriez-vous me reconnaître! Loukeria... vous rappelezvous? C'est moi qui menais la ronde à Spasskoïé, chez votre maman, vous rappelez-vous? C'est moi aussi qui entonnais les chansons.
— Loukeria! m'écriai-je. C'est toi? Est-il possible!
— Oui, bârine, moi-même, Loukeria. J'étais stupéfait et ne savais que. dire; je regardai cette figure sombre et sèche comme celle d'une morte, tandis qu'elle fixait ses grands yeux clairs sur moi. Cela se pouvait-il? Cette momie pouvait-elle être Loukeria, la plus jolie de nos dvorovis, cette grande fille robuste, blanche, rose, rieuse, qui chantait, qui dansait tant! Loukeria, la maligne Loukeria, à qui tous nos jeunes gars faisaient la cour, et pour qui, moi-même, à seize ans, en secret, j'avais soupiré!
— Voyons, Loukeria, fis-je enfin, que t'est-il donc arrivé? ..."
Mais la nature ne cesse ici de se confondre avec l'être humain, les limites entre le social. le physique et le magique sont presque estompées : dans "Le Pré Biéjine", le chasseur, perdu, à la nuit tombante, dans le monde des bois saturés de brume. s`approche d'un feu où s'est assemblée la troupe des pâtres. Bientôt, par les conversations de la veillée, il se trouve introduit dans l'univers des esprits et des génies de la forêt : la présence de l'invisible est suggérée par une poésie de clair-obscur, quelques lumières subites et brèves jetées sur les puissances de la nuit. le tout sur un fond sombre, d`où l`on croit entendre les cris des noyés appelant du fond des rivières...
Avec un réalisme absolu, portant intérêt au moindre détail, soucieux d`une peinture exacte et impersonnelle, Tourgueniev ne cesse jamais d`être lyrique, d`accorder sa langue souple et voluptueuse aux courants infinis qui agitent ses paysages. Il a pour les choses autant de sympathie que pour les êtres humains et parfois le vrai sujet de son livre paraît être la Nature : de simple cadre, elle grandit au cours de l'ouvrage et, dans la description féerique de "L`Épilogue", elle seule demeure, comme l`expression la plus totale de l`âme paysanne...
" Et qu'elle est belle encore la forêt à la fin de l'automne, quand passent les bécasses ! La bécasse ne s'arrête jamais dans l'épaisseur du fourré; c'est à la lisière du bois qu'il faut la chercher. Pas de vent, pas de soleil non plus: ni clarté, ni ombre, ni mouvement, ni bruit. Dans l'atmosphère douce s'exhale cette particulière odeur de l'automne qui rappelle l'odeur du vin. Une vapeur fine s'élève au-dessus des champs qui brunissent au loin. A travers le filtre des branches dépouillées apparaît un ciel immobile, blanc mat. Çà et là, les dernières feuilles dorées pendant sur les tilleuls. Le sol humide est élastique sous le pied, les hautes herbes sèches sont sans mouvement et de longs fils déliés couvrent d'un filet brillant les gazons pâles. La poitrine se dilate, mais l'âme se trouble. On longe la lisière du bois, on semble ne s'occuper que de son chien, mais les images favorites, les âmes aimées, vivantes ou mortes, hantent la mémoire. Des impressions oubliées se réveillent, l'imagination voltige, tout le passé surgit, s'agite, se dessine clairement; mais le cœur bat d'émoi, tantôt s'élançant en avant et tantôt plongé, pour n'en plus vouloir émerger, dans l'océan des souvenirs. Rêveries mélancoliques et douces! Toute la vie s'ouvre légèrement, rapidement, et, comme un rouleau, elle se déroule de tout son passé, de tous ses sentiments, de toute son âme. L'homme est maître, et rien alentour pour le distraire, ni vent, ni bruit, ni soleil ...".
"Les Mémoires d 'un chasseur" valurent à Tourgueniev une célébrité immédiate : il avait pourtant eu, en Russie même, des précurseurs Dimitri Grigorovitch (1822-1899, "Le Village", 1846) ou Constantin Aksakov (1817-1860), mais ici l'influence dominante est celle de George Sand (1804-1876) et de Berthold Auerbach (1812-1882). Le livre eut d`autres conséquences : l'auteur. accusé de subversion sociale, fut envoyé en exil. Il n`y a cependant aucune intention polémique dans les Mémoires d 'un chasseur, Tourgueniev ne soutient aucune thèse et se contente de peindre avec le plus de vérité possible. Son œuvre contribua pourtant à l'abolition du servage. (Trad. Gallimard, 1981).

"Journal d'un homme de trop" (Dnevnik lišnego čeloveka, 1850), "Roudine" (Rudin, 1855).
L'impuissance d'agir - Tourguéniev compose des portraits de gentilshommes de la province, désœuvrés, sans véritable culture ni vocation, mais en quête de quelque utilité pour ne pas se laisser gagner par cette indifférence à la réalité russe qui ne cesse de le tourmenter lui-même. Comment sortir de soi? L'interrogation hante "L'Hamlet du district de Chtchigry" (Gamlet ščigrovskogo ujezda, 1849), le narrateur, Tchoulkatourine, du "Journal d'un homme de trop" (Dnevnik lišnego čeloveka, 1850), "Une correspondance" (Perepiska, 1855). "Roudine" (Rudin, 1855), un phraseur ayant goûté de la philosophie allemande, rejoint ces «hommes de trop», et mourra sur une barricade parisienne en juin 1848, échouant dans sa tentative par méconnaissance de lui-même et de son propre pays. On y a reconnu autant un portrait de l'écrivain que de Bakounine, son ami des années quarante disparu au fond de la Sibérie. Le héros du premier roman de Tourguéniev pose, à la fin du règne de Nicolas Ier, en termes psychologiques et non idéologiques, le problème de l'engagement personnel. C'est en 1855 qu'Alexandre ll accéda au trône, et l'assouplissement de la censure va favoriser la publication de nombreux nouveaux ouvrages ...
".. Je me rappelle que je n’eus pas un seul instant de doute au sujet du sentiment que m’inspira Élisabeth Cyrillovna. Je fus passionnément amoureux d’elle dès le premier jour, et je sus dès le premier jour que j’étais amoureux d’elle. Pendant trois semaines, je ne cessai de la voir. Ces trois semaines furent le temps le plus heureux de ma vie ; mais c’est un souvenir qui me pèse. Je ne puis penser à ces trois semaines sans songer involontairement à ce qui arriva ensuite, et sans qu’une amertume empoisonnée ne pénètre ce cœur qui allait s’attendrir.
Lorsqu’un homme heureux est complètement sain d’esprit et de cœur, on sait que son cerveau travaille peu. Un sentiment calme et serein, le sentiment de la satisfaction, s’empare de tout son être ; il en est envahi, la conscience de sa personnalité lui échappe. « Il nage dans la béatitude », disent les mauvais poètes ; mais lorsque ce « charme » s’évanouit enfin, l’homme éprouve quelquefois un certain dépit, presque un regret de s’être si peu observé au milieu de son bonheur, de n’avoir point appelé la réflexion et le souvenir à son aide pour prolonger et doubler ses jouissances, comme si « dans la béatitude » l’homme pouvait trouver qu’il valût la peine de réfléchir sur ses sentiments ! L’homme heureux est comme une mouche au soleil. Aussi m’est-il presque impossible, lorsque je me rappelle ces trois semaines, de retenir dans mon esprit une impression exacte et définie. Cela me réussit d’autant moins qu’il ne se passa rien de particulièrement remarquable entre nous pendant tout ce temps… Ces vingt jours m’apparaissent comme quelque chose de chaud, de jeune et de parfumé, comme un rayon lumineux dans ma vie mate et décolorée. Ma mémoire ne devient tout à coup inexorablement précise et sûre qu’à compter du moment où, pour employer encore les expressions de ces mêmes mauvais poètes, « les coups du sort s’abattirent sur moi. »
Et pourtant ces trois semaines ont laissé en moi quelque empreinte. Lorsqu’il m’arrive parfois de réfléchir longuement sur cette époque, certains souvenirs se dégagent soudain des ténèbres du passé, pareils aux étoiles que le regard fixement tendu découvre inopinément au milieu du ciel nocturne. J’ai conservé surtout le souvenir d’une promenade à travers le bois qui se trouve derrière la ville d’O… Nous étions quatre : la vieille Ojoguine, Lise, moi et un certain Besmionkof, dont j’aurai encore à parler, employé inférieur domicilié à O…, petit homme blondasse, paisible et bon. M. Ojoguine était resté chez lui. Il s’était donné une migraine à force de dormir. La journée était magnifique, chaude et pure. Les Russes ne sont pas en général grands amateurs de jardins de plaisance ou de promenades publiques. Quelle qu’en soit la raison, on rencontre rarement âme qui vive dans ces soi-disant jardins publics ; une vieille femme vient de temps en temps s’asseoir en gémissant sur un banc de gazon bien rôti au soleil, près duquel s’élève un chétif arbuste. Si pourtant il se trouve aux environs de la ville un maigre petit bois de bouleaux, les marchands et quelquefois les employés aiment à s’y transporter les dimanches et les jours de fête ; ils emportent avec eux des samovars, des gâteaux et des melons d’eau, et, après avoir étalé toutes ces friandises sur l’herbe poussiéreuse qui borde la grande route, ils s’assoient tout à l’entour, boivent et mangent jusqu’au soir à la sueur de leurs fronts. Il existait justement un petit bois semblable à deux verstes de la ville d’O… Nous y allâmes un peu après le dîner. Besmionkof offrit son bras à la vieille Ojoguine, je donnai le mien à Lise. Le jour était déjà sur son déclin. C’était le temps de la première ferveur de mon amour..."

"Premier Amour" (1860)
En 1856, Tourgueniev reçoit enfin l'autorisation de quitter la Russie. Mais entre Pauline Viardot et lui s'interpose désormais un rival, le peintre Arry Scheffer, qui mourra en 1858. Il est alors l'un des grands artistes du mouvement romantique français, comparable à Delacroix et à Delaroche, dira-t-on, "La mort de Géricault" ou "Paolo et Francesca" figurent parmi ses oeuvres les plus connues. En attendant, Tourgueniev rentre en Russie et écrit, des nouvelles, parmi ses meilleurs : "Deux Amis" (1853), "Un coin tranquille" (1854), "Jacques Pasynkov" (1855), "Asja" (1857), et "Premier Amour" (1860)....
"... J’aurais été bien embarrassé si l’on m’avait demandé de raconter par le menu tout ce que j’éprouvai au cours de la semaine qui suivit mon infructueuse expédition nocturne. Ce fut, pour moi, une époque étrange et fiévreuse, une sorte de chaos où les sentiments les plus contradictoires, les pensées, les soupçons, les joies et les tristesses valsaient dans mon esprit. J’avais peur de m’étudier moi-même, dans la mesure où je pouvais le faire avec mes seize ans. Je redoutais de connaître de mes propres sentiments. J’avais seulement hâte d’arriver au bout de chaque journée. La nuit, je dormais… protégé par l’insouciance des adolescents. Je ne voulais pas savoir si l’on m’aimait et n’osais point m’avouer le contraire.
J’évitais mon père… mais ne pouvais pas fuir Zinaïda… Une sorte de feu me dévorait en sa présence… Mais à quoi bon me rendre compte de ce qu’était cette flamme qui me faisait fondre ?… Je me livrais à toutes mes impressions, mais manquais de franchise envers moi-même. Je me détournais de mes souvenirs et fermais les yeux sur tout ce que l’avenir me faisait pressentir… Cet état de tension n’aurait certainement pas pu durer longtemps… un coup de tonnerre mit brusquement fin à tout cela et m’orienta sur une nouvelle voie…
Une fois que je rentrai pour dîner, à l’issue d’une assez longue promenade, j’appris avec étonnement que j’allais me mettre à table tout seul : mon père était absent et ma mère, souffrante, s’était enfermée à clef dans sa chambre. Le visage des domestiques me fit deviner qu’il venait de se produire quelque chose d’extraordinaire… Je n’osais pas les interroger, mais, comme j’étais au mieux avec Philippe, notre jeune maître d’hôtel, grand chasseur et ami de la guitare, je finis par m’adresser à lui.
Il m’apprit qu’une scène terrible venait d’avoir lieu entre mes parents. On avait tout entendu à l’office, jusqu’au dernier mot ; bien des choses avaient été dites en français, mais Macha, la bonne, ayant vécu plus de cinq ans à Paris, au service d’une couturière, avait tout compris. Maman avait accusé mon père d’infidélité et lui avait reproché ses trop fréquentes rencontres avec notre jeune voisine. Au début, il avait essayé de se défendre, puis, éclatant brusquement, avait prononcé quelques paroles très dures à propos « de l’âge de Madame » ; ma mère avait fondu en larmes.
Puis, revenant à la charge, maman avait fait allusion à une lettre de change qu’elle aurait donnée à la vieille princesse et se serait permis des remarques fort désobligeantes sur son compte et sur celui de sa fille. Là-dessus, mon père l’avait menacée…
« Tout le malheur est venu d’une lettre anonyme, ajouta Philippe… On ne sait toujours pas qui a bien pu l’écrire ; sans cela, le pot aux roses n’aurait jamais été découvert.
— Mais est-ce qu’il y eut vraiment quelque chose ? » articulai-je à grand-peine, en sentant mes bras et mes jambes se glacer, tandis que quelque chose frissonnait au fond de ma poitrine.
Philippe cligna de l’œil d’un air entendu :
« Que voulez-vous, ce sont là des histoires qu’on ne peut pas cacher éternellement… Votre père a beau être prudent, mais il lui a bien fallu, par exemple, louer une voiture… On ne peut jamais se passer des domestiques. »
Je renvoyai le maître d’hôtel et m’effondrai sur mon lit… Je ne pleurais pas, ne m’abandonnais pas au désespoir, ne me demandais pas quand et comment cela s’était produit, ne m’étonnais point de ne pas m’en être douté plus tôt, n’accusais même pas mon père… Ce que je venais d’apprendre était au-dessus de mes forces… J’étais écrasé, anéanti… Tout était fini… Mes belles fleurs gisaient, éparses autour de moi, piétinées, flétries...."
"PREMIER AMOUR" est une des œuvres de Tourgueniev où l'on remarque le plus le pessimisme un peu romantique de ce peintre des hommes "inutiles" et des amours inachevées. Un adolescent. Vladimir, pendant les vacances d'été, s'éprend d`une très belle jeune fille, coquette et capricieuse. qui habite de l'autre côté de son jardin. La jeune fille, Zénaïde, réunit fréquemment chez elle ses nombreux adorateurs; elle s'amuse à les rendre jaloux et leur fait faire une quantité de sottises. Mais un jour, elle rencontre le père de Vladimir, homme beau et autoritaire, et ne peut lui résister. Une nuit, Vladimir épie un rendez-vous que se sont donné. dans le jardin, Zénaïde et son père; après avoir appris la vérité, il croit devenir fou de douleur. Mais le temps et la reprise de ses études guérissent sa blessure, et il se délivre bientôt de l'ensorcellement de ce premier amour. Quant à son père et à Zénaïde, ils sont tous deux frappés par un sort tragique : le premier meurt d'une attaque d`apoplexie, laissant à son fils une lettre où il l`exhorte à se garder de l'amour ; Zénaîde, qui s'est mariée entre-temps, meurt peu après en couches.
Dans ce récit, Tourgueniev se propose de représenter l`amour comme une maladie, un désordre organique qui frappe les hommes de différentes manières, selon leur tempérament et leur âge. Dans "Premier amour", cette maladie est étudiée avec une grande acuité psychologique et en même temps avec une extrême délicatesse, de telle sorte que le caractère en soi assez scabreux du sujet, la rivalité entre un père et un fils. se trouve atténué. (Trad. Gallimard, 1984).
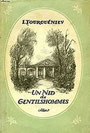
"Le Nid de gentilshommes" (Dvorianskoe gnezdo, 1858)
Tourguéniev évoque dans ses comédies de 1851-1852 la réalité provinciale russe et l'on a ou y voir les esquisses du théâtre tchékhovien. Dans "Le Nid de gentilshommes", la raillerie vis-à-vis des fausses valeurs occidentales est bien présente et l'éloge des traditions authentiquement russes bien accentué. L'occidentalisme de Tourguéniev n'exclut pas une idéalisation sentimentale de la Russie et une mise en garde contre les engouements à l'égard de l'Europe. Mais Tourgueniev dit ici adieu à l'ancien ordre social de la Russie et exalte ses profondes assises religieuses. Lisa Kalitina, dans la lignée de la "Tatiana de "Eugène Onéguine" d'Alexandre Pouchkine, sera considérée comme un modèle de la "jeune fille à la Tourguéniev", noble, charmante, pure, volontaire.
Dans "À la veille" (Nakanune, 1859), Tourgueniev semble avoir trouvé une solution de type romantique, en antithèse absolue avec Roudine, à son tourment d'action, le jeune Insarov, un étudiant bulgare, quitte Moscou avec sa femme Hélène pour aller affranchir son pays par les armes tandis que la jeune femme s'accomplit, portrait héroïque d'une nouvelle génération, par l'évasion d'un milieu familial insipide, par l'amour sans calcul et le sacrifice total. Tourguéniev tente d'être le porte-parole d'une nouvelle génération à l'aube des grandes réformes ...
"... Lavretzky, de l’avis des médecins, emmena sa femme aux eaux à l’étranger. Les distractions lui étaient nécessaires après le chagrin qu’elle venait d’éprouver, et l’état de sa santé réclamait d’ailleurs un climat plus doux. Le jeune couple passa l’été et l’automne en Allemagne et en Suisse ; l’hiver les vit à Paris, comme on devait s’y attendre. Varvara Pavlowna ne tarda pas à se remettre entièrement, et elle embellit beaucoup.
À Paris, elle sut faire son nid aussi vite, aussi habilement qu’à Pétersbourg. Elle avait un intérieur très-coquet, dans l’une des rues les plus tranquilles et les plus fashionables de la capitale. Elle fit faire à son mari une robe de chambre comme il n’en avait encore jamais porté ; elle prit à son service une femme de chambre élégante, une excellente cuisinière, un laquais des plus alertes, – se donna une charmante voiture, un délicieux piano. Une semaine s’était à peine écoulée, que déjà elle traversait la rue, portait son châle, ouvrait son ombrelle et mettait ses gants comme une vraie Parisienne.
Elle ne tarda pas non plus à se former un cercle de connaissances ; – d’abord il ne se composa guère que de Russes ; ensuite on y vit paraître des Français, aimables et polis, des célibataires, gens aux belles manières et portant des noms sonores. Ils parlaient tous avec animation et volubilité, saluaient avec grâce et faisaient les doux yeux, montraient leurs dents blanches entre des lèvres roses. Comme ils savaient sourire ! – Chacun d’eux amenait ses amis, et bientôt la belle madame de Lavretzky fut connue de la Chaussée-d’Antin à la rue de Lille. – À cette époque (ces événements se passaient en 1836), on n’avait pas encore vu se répandre cette race de journalistes et de chroniqueurs qui fourmille partout à présent ; cependant on remarquait dans le salon de Varvara Pavlowna un certain M. Édouard, d’un extérieur peu avenant, d’une réputation détestable, servile et insolent à la fois, comme tous les duellistes et les hommes souffletés. Ce M. Édouard déplaisait beaucoup à Varvara Pavlowna, mais elle le recevait, car il écrivait dans quelques journaux, et parlait continuellement d’elle, la nommant tantôt madame de L–tzky, tantôt madame de ***, cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P… ; il racontait à tout l’univers, c’est-à-dire à quelques centaines d’abonnés qui ne s’intéressaient guère à madame de L–tzky, combien cette dame, une vraie Française par l’esprit (les Français ne connaissent pas de plus grand éloge), était aimable et charmante, qu’elle possédait en musique un talent hors ligne et valsait à ravir. Varvara Pavlowna valsait en effet de manière à entraîner tous les cœurs dans les ondulations de sa robe vaporeuse. En un mot, il répandait sa renommée dans le monde, ce qui est toujours assez flatteur.
Mademoiselle Mars avait déjà quitté la scène, sur laquelle n’avait point encore paru mademoiselle Rachel ; néanmoins, Barbe allait fort souvent au spectacle. La musique italienne l’enchantait ; les ruines d’Odry la faisaient rire ; elle bâillait de la façon la plus convenable à la Comédie-Française, et pleurait en voyant madame Dorval dans les drames ultra-romantiques. Mais, ce qui avait encore plus de prix à ses yeux, Liszt avait joué deux fois chez elle et avait été d’une amabilité, d’une simplicité charmantes ! – Vers la fin de cet hiver, passé si agréablement, Varvara Pavlowna avait même été présentée à la cour.
Fœdor Ivanowitch, de son côté, ne s’ennuyait pas ; cependant, sa vie lui paraissait quelquefois bien lourde, – lourde par sa frivolité même. Il lisait les journaux, suivait les cours de la Sorbonne et du Collége de France, écoutait les discussions des Chambres, et avait entrepris la traduction d’un ouvrage scientifique fort connu, sur les irrigations. – Je ne perds pas mon temps, se disait-il, tout cela est utile ; mais il faut absolument que je retourne en Russie pour l’hiver prochain, et que je me mette à l’œuvre.
Savait-il bien précisément lui-même en quoi consistait cette œuvre, et s’il pourrait de sitôt retourner en Russie ? En attendant, il devait partir avec sa femme pour BadenBaden. Un événement inattendu vint renverser tous ses projets.
En entrant un jour dans le cabinet de Barbe, en son absence, Lavretzky vit à terre un petit papier soigneusement plié. Il le ramassa, le déplia machinalement, et lut les lignes suivantes écrites en français : « Betty, mon cher ange (je ne puis me décider à te nommer ni Barbe, ni Varvara), je t’ai attendue en vain au coin du boulevard ..."
Tout comme dans "Roudine" (1855), la trame de "Nid de gentilshommes", le second roman de Tourgueniev, est simplifiée à l'extrême. Fédor Lavretzky, un noble d'un certain âge qui a reçu une éducation à l`européenne, mais qui est resté profondément russe de cœur et d'esprit, se prend d'enthousiasme pour les idées mises en avant par les slavophiles. Ayant laissé a Paris sa femme, Varvara Pavlovna, un être superficiel et corrompu qui l'a scandaleusement trompé avec un Français, il retourne en Russie. Malheureux, mais vivant dans l'espoir de pouvoir tout oublier grâce au travail, il se consacre à organiser ses terres et à en améliorer la production, non plus suivant des projets chimériques et grandioses. mais en travaillant lui-même la terre en toute humilité et suivant les méthodes les plus rationnelles.
Une fois sur ses terres, il rencontre une de ses voisines, la jeune Liza Kalitina, qui l`attire non seulement par son charme, mais aussi par ses qualités morales. Liza et Lavretzky tombent amoureux l'un de l`autre: Cependant sur le développement romanesque de leur passion plane une ombre, celle de la femme indigne de Lavretzky ...
Mais voici qu`un jour Lavretzky apprend par un article de journal que sa femme est morte : aussitôt il se fiance avec Liza. Leur bonheur sera de courte durée : en effet, l'article du journal n'était qu`une fausse information; Varvara Pavlovna est bien vivante et, comble de malchance, rentre en Russie. Désespérée, Liza se retire dans un monastère.
La sécheresse schématique de cette trame ne diminue en rien la valeur du roman. dont le thème central est celui de la vie menée par la noblesse terrienne russe (d`où le titre du roman). "Un nid de gentilshommes" eut un succès immense. peut-être le plus grand de toute la carrière de Tourgueniev, puisqu`il ne fut terni par aucune polémique, comme ce fut le cas pour "Roudine" et, plus tard, pour "Pères et Fils". Un succès dû surtout à la netteté avec laquelle l`écrivain avait dépeint le personnage de Liza qui, comme la Tatiana d` "Eugène Oneguine", de Pouchkine, est devenue une figure symbolique : la jeune fille russe idéale. (Trad. Payot, 1927, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1982).
En 1861, date de l'abolition du servage de la glèbe, Tourgueniev accourt à Spasskoie, libère ses serviteurs, accorde le rachat aux paysans des terres cultivées en aidant par la suite ces hommes du mieux qu'il put, leur cédant même un cinquième des autres terres. ...
" Le pays qu’ils traversaient n’était pas précisément pittoresque. Une vaste plaine cultivée s’étendait jusqu’à l’horizon, et le sol ne s’élevait un peu que pour s’infléchir bientôt après ; quelques petits bois paraissaient à de rares intervalles, et des ravins tapissés de buissons bas et clairsemés serpentaient un peu plus loin, rappelant assez fidèlement les dessins qui les représentent sur les vieux plans datant du règne de l’impératrice Catherine. On rencontrait aussi de temps en temps de petites rivières aux rives dépouillées, des étangs retenus par de mauvaises digues, de pauvres villages dont les maisons peu élevées étaient surmontées de toits de chaume noirs et à moitié dégarnis, de chétives granges à battre le blé, aux murs formés de branches entrelacées, avec des portes énormes bâillant sur des aires vides ; des églises, les unes en briques recouvertes d’une couche de plâtre qui commençait à se détacher, les autres en bois surmontées de croix mal affermies et entourées de cimetières mal tenus.
Arcade sentait son cœur se serrer peu à peu. Comme par un fait exprès, tous les paysans avec lesquels ils se croisaient avaient l’air misérable et montaient de petites ros ses ; les saules qui bordaient la route9ressemblaient, avec leurs écorces arrachées et leurs branches cassées, à des mendiants en guenilles ; des vaches au poil hérissé, maigres et farouches, broutaient l’herbe avidement, le long des fossés. On eût dit qu’elles venaient d’échapper à grand’peine à je ne sais quelles griffes meurtrières ; la vue de ces pauvres animaux évoquait, au milieu de l’éclat d’une journée printanière, le blanc fantôme d’un hiver sans fin, d’un hiver impitoyable avec ses gelées et ses tourbillons de neige. « Non, se dit Arcade, cette contrée n’est pas riche, elle ne frappe pas par le bien-être, par les traces d’un travail assidu ; il est impossible qu’elle reste dans cet état ; elle demande à être transformée... ; mais comment s’y prendre ? » (Pères et Fils)

"Pères et Fils" (1861)
Tourgueniev publie "Pères et Fils", Bazarov, jeune étudiant nihiliste - dont Tourguéniev consacre l'usage -, sans croyance ni morale, incarne les aspirations de la nouvelle génération. D'extraction modeste, résolu à servir le peuple, le nihilisme de Bazarov signifie le refus des principes en vigueur dans la noblesse, la critique de toute forme d'autorité et l'adhésion à un empirisme positiviste : il étudie la médecine et dissèque des grenouilles. Ses façons sont rudes, parfois ridicules. Aussi Tourguéniev dut-il se défendre d'avoir voulu offenser la jeune génération, la critique cria au scandale. Ressentant douloureusement cet échec, l'écrivain décide de s'établir définitivement à l'étranger et de renoncer à la littérature. Il s'installe en Allemagne, à Baden-Baden où les Viardot ont élu domicile, la société y est brillante...
(...)
" — Eugène Vassilief, répondit Bazarof d’une voix forte mais lente ; et, rabattant le col de son caban, il se laissa voir en plein à Kirsanof. Il avait le visage long et maigre, le front ouvert, le nez large dans le haut et effilé par le bout, de grands yeux verdâtres, et des favoris longs et pendants couleur de sable ; un sourire tranquille se jouait sur ses lèvres, toute sa physionomie exprimait l’intelligence et la confiance en soi.
— J’espère, mon cher Eugène Vassilitch, reprit Kirsanof, que vous ne vous ennuierez pas chez nous.
Les lèvres de Bazarof s’entrouvrirent un peu, mais il ne répondit rien, et se contenta de soulever sa casquette. Malgré son épaisse chevelure d’un châtain foncé, il était facile de distinguer les protubérances prononcées de son large crâne."
(...)
Le jeune Arcade se rend avec son ami Bazarov chez son père, Nicolas Pétrovitch Kirsanov, qui vit avec son frère Paul. Nicolas Pétrovitch Kirsanov, petit aristocrate terrien, "lisait beaucoup, surtout des livres anglais ; tout son genre de vie était disposé à l’anglaise ; il fréquentait peu les propriétaires du voisinage et ne s’absentait guère que pour assister aux élections, où il se taisait presque toujours, n’ouvrant la bouche que pour effrayer par ses boutades libérales et ses plaisanteries les propriétaires attachés à l’ancien régime, sans pour cela se rapprocher des représentants de la nouvelle génération. On l’accusait généralement de fierté ; mais on le respectait à cause de ses manières aristocratiques et de sa réputation d’homme à bonnes fortunes ; on le respectait parce que sa mise était recherchée et qu’il habitait toujours les plus belles chambres des meilleurs hôtels ; parce qu’il faisait ordinairement bonne chère, et qu’un jour il avait même dîné avec Wellington chez le duc d’Orléans ; parce qu’il ne se mettait jamais en route sans emporter avec lui un nécessaire d’argent et une baignoire de voyage ; parce qu’il se parfumait avec des odeurs particulières, fort « distinguées ; » parce qu’il jouait le whist en perfection et perdait toujours ; enfin, on le respectait aussi beaucoup à cause de sa parfaite honnêteté. Les dames du district le considéraient comme un mélancolique plein d’attrait, mais il ne leur accordait pas la moindre attention". Il est père d'un enfant, conçu avec Fénetchka mais, femme du peuple, hésite à l'épouser. Son frère Paul est lui un "triste célibataire", il "entrait dans le crépuscule de la vie, dans cette période néfaste de regrets qui ressemblent à des espérances, et d’espérances qui ressemblent à des regrets, lorsque la jeunesse est déjà passée, et que la vieillesse n’est pas encore venue. Ce temps devait paraître plus pénible à Paul qu’à tout autre : ayant perdu son passé, il avait tout perdu..". Mais Paul, qui se révèlera neutre à l'égard du nihilisme, tout en ne pouvant dissimuler son animosité à l'adresse du jeune Bazarov, et aussi homme de ressources pour son frère : "Paul n’assista pas longtemps à l’entretien de son frère avec l’intendant ; ce dernier, homme de haute taille, maigre, à l’œil rusé, à la voix mielleuse et éteinte, répondait aux observations de Nicolas Petrovitch par un éternel : « Assurément ! sans aucun doute ! » tout en s’efforçant de présenter les paysans comme des ivrognes et des voleurs. Le nouveau mode d’administration que l’on venait d’adopter ne fonctionnait encore qu’en criant, comme une roue mal graissée, ou un meuble fait avec du bois humide par un ouvrier de village. Cela ne décourageait nullement Kirsanof, mais il soupirait et demeurait souvent pensif ; il comprenait que sans argent les choses ne marcheraient pas, et l’argent lui manquait : Arcade avait dit vrai : Paul Petrovitch était venu plus d’une fois au secours de son frère ; plus d’une fois, le voyant qui se cassait la tête pour trouver un moyen de se tirer d’embarras...)"
(...)
Une première discussion s'engage entre les quatre hommes, Bazarov, totalement acquis aux idées matérialistes et anti traditionalistes (le "nihiliste"), est le plus véhément, Arcade, quant à lui, épouse certes les idées de ce dernier mais sans son extrême conviction. Ce qui me chagrine dans tout ceci, se confiera Nicolas à son frère Paul, après des premiers échanges assez vifs, "c’est que j’espérais précisément me rapprocher étroitement et amicalement d’Arcade, et voilà que je me trouve arriéré ; il m’a devancé, et nous ne pouvons plus nous comprendre. (...) Je fais tout ce que je peux pour marcher avec le siècle ; j’ai fait une position à mes paysans et établi une ferme sur mes terres, ce qui m’a valu d’être appelé rouge dans tout le gouvernement ; je lis, j’étudie, et fais des efforts pour être au niveau des besoins du pays, et ils disent que ma chanson est finie. Après tout il est bien possible qu’ils aient raison.
— Comment cela ?
— Écoute, aujourd’hui j’étais assis à lire Pouchkine ; je venais de commencer les Bohémiens... lorsque tout à coup Arcade s’approche de moi en silence avec une sorte de compassion caressante ; il me prit doucement mon livre, comme il l’eût fait à un enfant, et le remplaça par un autre, un livre allemand... puis, il sourit et se retira en emportant Pouchkine.
— Vraiment ? Et quel est le livre qu’il t’a donné ?
— Le voici.
Kirsanof sortit de la poche de derrière de sa redingote la neuvième édition de la fameuse brochure de Buchner. Paul en tourna quelques pages.
— Arcade s’occupe de ton éducation, dit-il ; as-tu essayé de lire cela ?
— Oui.
— Eh bien ?
— Il faut que je sois bête ou que l’auteur n’ait pas le sens commun. Mais c’est sans doute moi qui suis bête.
— Tu n’as pas oublié ton allemand ? demanda Paul.
— Non...
Paul tourna le livre dans ses mains, en regardant son frère à la dérobée. Ils se taisaient l’un et l’autre...."
(...)
"Pères et Fils", publié en 1861, est le roman de Tourgueniev qui suscita la plus violente de toutes les polémiques qu'aient allumées les ouvrages de cet écrivain en raison de son insistance à souligner les contrastes entre l`ancienne et la nouvelle génération, ...
Mais la bataille déclenchée à propos de ce roman trouva aussi des raisons dans l'opinion, alors répandue que celui-ci était moins une prise de position polémique qu'une caricature de la nouvelle génération. Toute l'œuvre est centrée sur Bazarov, personnage pour lequel Tourgueniev créa le terme de "NIHILISTE", nihiliste, "parce qu'iI ne s'incline devant aucune autorité, n'accepte aucun principe sans examen", suivant la définition de son ami Arkadi Kirsanov. L`action est relativement simple et linéaire. à l`inverse de l`âme du héros. qui est d`une grande complexité. Deux étudiants, Evgeni Bazarov. futur médecin. et son ami Arkadi Kirsanov. reviennent, après trois ans d'absence, dans leur village natal. Ils s'arrêtent d`abord chez les parents d'Arkadi : le père, veuf, homme timide et affairé qui se partage entre un amour sénile et les soucis que lui donne sa propriété depuis que le servage a été aboli : et un oncle, ex-officier de la Garde qui a quitté le service à la suite d'un drame passionnel et s`est retiré à la campagne. Dans le conflit qui oppose les jeunes gens (et surtout Bazarov) aux parents d'Arkadi se révèle l'esprit de la nouvelle génération. Le contraste est dû non seulement aux idées nouvelles qu`exprime Bazarov, mais encore aux manières insolentes, en partie voulues, mais le plus souvent spontanées, avec lesquelles il les exprime. Il offense ainsi profondément ses hôtes, attachés aux traditions et aux convenances ...
Un trait caractéristique de Bazarov est ainsi la façon dont il envisage le problème de la femme : "Si une femme vous convient. tâchez d'atteindre votre but; si elle se refuse, adressez-vous ailleurs ; la terre est assez grande pour cela". Or, c'est précisément sur ce point que Bazarov sera mis en déroute. En effet, après avoir quitté la propriété des Kirsanov. les deux jeunes gens se rendent au chef-lieu de la province où, au cours d`un bal, Bazarov fait la connaissance d'Anna Odintsova. dont il tombe aussitôt amoureux. Bazarov a beau faire, il a beau lutter contre lui-même et essayer de ramener ses sentiments à une plus juste mesure, son amour est précisément de ceux qu'il a persiflés et raillés. La "proie" lui échappe, bien qu'il ait suscité un vif intérêt chez Anna. Dès lors, il vit au jour le jour comme s'il ne trouvait plus rien à faire sur cette terre. Revenu enfin auprès de ses parents, il tente de se retrouver en reprenant ses expériences scientifiques d`autrefois; mais un jour qu'il s`est blessé au doigt en opérant un tuberculeux, il omet, par apathie, de se soigner et la maladie ne tardera pas à l`emporter...
Nouvelle discussion entre les quatre hommes, Nicolas, Bazarof, Arcade et Paul, qui termine son propos ...
"... J’ose dire que je suis généralement reconnu pour un homme libéral et aimant le progrès ; mais c’est précisément pour cela que j’estime les aristocrates, les véritables aristocrates. Rappelez-vous, mon cher monsieur (Bazarof leva les yeux sur Paul), rappelez-vous, mon cher monsieur, répéta-t-il avec hauteur, les aristocrates anglais. Ils ne cèdent pas un iota de leurs droits, et n’en respectent pas moins les droits des autres ; ils exigent ce qui leur est dû et ne manquent jamais eux-mêmes à ce qu’ils doivent aux autres. L’aristocratie a donné la liberté à l’Angleterre et elle en est le plus ferme appui.
— C’est une vieille chanson que nous avons souvent entendue, répondit Bazarof ; mais que prétendez-vous prouver par cela ?
— Je prétends prouver par ça, mon cher monsieur — (Paul, lorsqu’il se mettait en colère, employait certaines locutions familières, quoiqu’il sût fort bien qu’elles étaient défectueuses. Cette habitude remonte au règne de l’empereur Alexandre. Les grands seigneurs de l’époque, lorsqu’il leur arrivait de parler leur langue maternelle, affectaient une prononciation vicieuse comme pour donner à entendre qu’en leur qualité de grands seigneurs il leur était permis de dédaigner les règles de la grammaire, imposées aux écoliers) — je prétends prouver par ça que, sans la conscience de sa propre dignité, sans le respect de soi-même, et ces sentiments sont familiers à l’aristocratie, il ne saurait exister de solides fondements pour le... bien public ... pour l’édifice public. L’individu, la personnalité, mon cher monsieur, voilà l’essentiel ; la personnalité humaine doit être résistante comme un roc, car tout repose sur cette base. Je sais fort bien que vous trouvez risibles mes manières, mon costume, jusqu’à mes habitudes de propreté ; mais tout cela découle du respect de soi-même, du sentiment du devoir, oui, oui, monsieur, du devoir. J’habite le fond de la province, mais je ne m’abandonne pas pour cela, je respecte l’homme en ma personne.
— Permettez, Paul Petrovitch, lui répondit Bazarof ; vous dites que vous vous respectez, et vous restez assis les bras croisés ; quel avantage cela procure-t-il au bien public ? Vous ne vous respecteriez pas, que vous n’agiriez pas autrement.
Paul Petrovitch pâlit.
— C’est une toute, autre question, reprit-il ; il ne me convient nullement de vous expliquer - maintenant pourquoi je reste les bras croisés, comme vous voulez bien le dire. Je voulais me borner à vous rappeler que l’aristocratie repose sur un principe, et que les hommes immoraux ou sans aucune valeur sont les seuls qui puissent vivre de nos jours sans principes. Je le disais à Arcade le lendemain de son arrivée, et je ne fais que vous le répéter aujourd’hui. N’est-ce pas vrai, Nicolas Petrovitch ?
Kirsanof fit de la tête un signe d’assentiment.
— Aristocratie, libéralisme, principes, progrès, répétait en attendant Bazarof. Que de mots étrangers à notre langue, et parfaitement inutiles ! Un vrai Russe n’en voudrait pas pour rien.
— Que lui faut-il donc, suivant vous ? À vous entendre, nous sommes en dehors de ’humanité, en dehors de ses lois. C’est un peu fort ; la logique de l’histoire exige...
— Qu’avons-nous besoin de cette logique-là ? Nous pouvons fort bien nous en passer.
— Comment ?
— Ah ! voici. Je pense que vous vous passez fort bien de logique pour porter un morceau de pain à votre bouche, lorsque vous avez faim. À quoi bon toutes ces abstractions ?
Paul leva les mains.
— Je ne comprends plus du tout, dit-il. Vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas que l’on puisse ne pas reconnaître des principes, des règles ! Qu’est-ce qui vous dirige donc dans la vie ?
— Je vous ai déjà dit, mon oncle, reprit Arcade, que nous ne reconnaissons aucune autorité.
— Nous agissons en vue de ce que nous reconnaissons pour utile, ajouta Bazarof : aujourd’hui il nous paraît utile de nier, et nous nions.
— Tout ?
— Absolument tout.
— Comment ? non-seulement l’art, la poésie, mais encore.... j’hésite à le dire....
— Tout, répéta Bazarof avec une inexprimable tranquillité.
Paul le regarda fixement ; il ne s’attendait pas à cette réponse ; Arcade rougit de plaisir.
— Permettez, permettez, dit Kirsanof, vous niez tout, ou, pour parler plus exactement, vous détruisez tout... Cependant, il faut aussi rebâtir....
— Cela ne nous regarde pas... il faut avant tout déblayer la place.
— La condition actuelle du peuple l’exige, ajouta Arcade d’un air grave ; nous devons remplir ce devoir ; nous n’avons pas le droit de nous abandonner aux satisfactions de l’égoïsme personnel.
Cette dernière phrase déplut à Bazarof ; elle sentait la philosophie, c’est-à-dire le romantisme, car il donnait ce nom aussi à la philosophie ; mais il ne jugea pas à propos de contredire son jeune élève.
— Non ! non ! s’écria Paul dans un élan subit, je ne veux pas croire que vous autres, messieurs, vous ayez une juste opinion du peuple russe, que vous exprimiez ce qu’il demande, ses vœux secrets ! Non ! le peuple russe n’est pas tel que vous le représentez. Il a un saint respect pour la tradition ; il est patriarcal ; il ne peut vivre sans foi...
— Je n’essayerai pas de vous contredire, reprit Bazarof ; je suis même prêt à reconnaître que vous avez raison cette fois.
— Mais si j’ai raison...
— Mais cela ne prouve absolument rien...
— Absolument rien, répéta Arcade avec l’assurance d’un joueur d’échecs expérimenté, qui, ayant prévu un coup que son adversaire croit dangereux, n’en paraît nullement déconcerté.
— Comment cela ne prouve-t-il rien ? dit Paul avec stupéfaction ; vous vous séparez donc de votre peuple ?
— Et quand cela serait ? Le peuple croit que, lorsqu’il tonne, le prophète Élie se promène en char dans le ciel. Eh bien, faut-il que je partage son opinion à cet égard ? Vous croyez me confondre en me disant que le peuple est russe ; et moi, ne le suis-je pas aussi ?
— Non ; après tout ce que vous venez de dire, vous n’êtes point russe ! Je ne peux plus vous reconnaître pour tel.
— Mon grand-père conduisait la charrue, répondit Bazarof avec un orgueil superbe ; demandez au premier venu de vos paysans dans lequel de nous deux, de vous ou de moi, il reconnaît plus volontiers son concitoyen.
Vous ne savez même pas parler avec lui.
— Et vous, qui savez parler avec lui, vous le méprisez.
— Pourquoi pas, s’il le mérite ? Vous blâmez la direction de mes idées ; mais qui vous dit qu’elle est accidentelle, qu’elle n’est point déterminée par l’esprit général de ce peuple que vous défendez si bien ?
— Allons donc ! Les nihilistes sont bien nécessaires !
— Qu’ils le soient ou non, ce n’est pas à nous à le décider. Ne vous supposez-vous pas aussi bon à quelque chose ?
— Messieurs, messieurs, point de personnalités, s’écria Kirsanof en se levant.
Paul sourit, et, posant la main sur l’épaule de son frère, il le força à se rasseoir.
— Sois tranquille, lui dit-il, je ne m’oublierai pas, précisément en raison de ce sentiment de dignité que persifle si vivement Monsieur. Monsieur le docteur, permettez, continua-t-il en s’adressant de nouveau à Bazarof ; vous croyez peut-être que votre manière de voir est nouvelle ? c’est une erreur. Le matérialisme que vous professez a déjà été en honneur plus d’une fois, et s’est toujours montré insuffisant...
— Encore un mot étranger ! reprit Bazarof. — Il commençait à devenir aigre, et sa figure avait pris une teinte cuivrée peu agréable à voir. — D’abord, je vous dirai que nous ne prêchons pas ; ce n’est pas dans nos habitudes...
— Que faites-vous donc ?
— Je vais vous le dire. Nous avons commencé par appeler l’attention sur les employés concussionnaires sur le manque de routes, sur l’absence de commerce, sur la manière dont on rend la justice.
— Oui, oui, vous êtes des dénonciateurs, des divulgateurs ; c’est le nom que l’on vous donne, si je ne me trompe. — Je suis d’accord avec vous sur un grand nombre de vos critiques ; mais...
— Puis, nous n’avons pas tardé à reconnaître qu’il ne suffisait pas de bavarder sur les plaies qui nous rongent, que cela n’aboutissait uniquement qu’à la platitude et au doctrinarisme ; nous nous aperçûmes que nos hommes avancés, nos divulgateurs, ne valaient absolument rien, que nous nous occupions de sottises, telles que l’art pour l’art, la puissance créatrice qui s’ignore elle-même, le parlementarisme, la nécessité des avocats et mille autres sornettes, tandis qu’il faudrait penser à notre pain quotidien, tandis que la superstition la plus crasse nous étouffe, tandis que toutes nos sociétés par actions font banqueroute, et cela uniquement parce qu’il y a disette d’honnêtes gens, tandis que la liberté des serfs elle-même, dont s’occupe tant le gouvernement, ne produira peut-être rien de bon, parce que notre paysan est prêt à se voler lui-même pour aller boire des drogues empoisonnées dans les cabarets.
— Bien, reprit Paul, très-bien. Vous avez découvert tout cela et ne vous en êtes pas moins décidés à ne rien entreprendre de sérieux.
— Oui, nous y sommes décidés, répéta Bazarof d’un ton brusque.
(...)
Les querelles qui entourèrent la parution de cet ouvrage firent négliger à la critique et au public la valeur artistique et psychologique du roman. On peut ainsi relever la justesse avec laquelle Tourgueniev a su évoquer atmosphères et paysages, et l'on admire. sans restriction aucune, la pénétration avec laquelle sont représentés les personnages et définis leurs traits les plus caractéristiques, révolte, désir de vie et soif de progrès et, derrière le masque de leur attitude, une souffrance profondément humaine. (Trad. Gallimard. 1987).

Tourgueniev reprend l'écriture et tente de peindre d'autres figures de révolutionnaires. Dans "Fumée" (Dym, 1867), une oeuvre typique de l'auteur, le révolutionnaire Goubarev, qualifié de slavophile, est ridiculisé et, avec lui, le populisme et son idéalisation puérile du moujik. Tourgueniev achève ainsi de couper les ponts entre la Russie et lui....
Dans "Fumée" (Dym), l`action se développe presque exclusivement hors de Russie, à Baden-Baden, où se trouve réunie la fine fleur du grand monde international. mais où l'on rencontre également les gens les plus extravagants. surtout dans la colonie russe. A cette époque, il existait a Baden-Baden un soi-disant "arbre russe", à l'ombre duquel les Russes avaient pris l`habitude de se rencontrer quand ils n'étaient pas ... à la roulette. Le héros du roman, Litvinov. ne fréquente aucun de ces lieux, sa seule préoccupation étant la prochaine arrivée de sa fiancée, sa cousine Tatiana Petrovna Shestova, avec qui il doit retourner, sous peu, en Russie pour se marier.
Mais il rencontre une ancienne conquête, Irina Pavlovna Ratmirova, femme belle et capricieuse, qui, alors qu'il devait l'épouser, l`avait abandonné pour un jeune général assez fat. Maintenant. en femme intelligente et brillante, Irina Pavlovna domine ce milieu qu`elle méprise. Rencontrant Litvinov, elle est subitement prise du désir de le reconquérir et lui, bien que sachant à quel point Irina vaut moins que Tatiana, abandonne sa fiancée et propose à lrma de s'enfuir. Ruinant une seconde fois sa vie, cette dernière repousse, au moment ultime, cette offre et reste avec son mari. Litvinov, dans un ultime sursaut d'énergie, retourne en Russie. se voue au travail et reconquiert l`amour et la confiance de Tatiana. La fumée qui, pour lui, enveloppait toute chose, sa vie, l'humanité en général, et plus particulièrement tout ce qui est russe, se dissipe enfin. Mais le symbole persiste...
La satire qui imprègne ce récit garde tout son intérêt, surtout en ce qui concerne le tableau de la vie des Russes à Baden-Baden, fresque dans laquelle il est aisé de retrouver de nombreux souvenirs personnels de l`auteur. Une œuvre satirique sufffisament mordante pour provoquer, à l`époque, l'indignation du public russe tout entier. Reste la réputation d'un Tourgueniev qui, bien que nostalgique de son pays, n'aurait jamais compris la Russie, la regardant de trop loin ...
Dans les années 1870, Tourgueniev vit à Paris, chez les Viardot, rencontre Zola (dont il publie les romans en Russie), Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt, Jules Verne. La guerre de 1870 vient briser cette vie quasi idyllique, Londres, Paris, près de laquelle les Viardot s'installent, à Bougival. Avec "Eaux printanières" (1871), Tourguéniev revient à du romanesque pur (De passage à Francfort, Sanine, jeune nombe russe, s'éprend d'une splendide jeune fille italienne, Gemma, fiancée à un Allemand, un roman, dira-t-il qu'il a vécu, d'où sa puissance d'évocation). Son dernier roman, "Terres vierges" (1876), se veut roman de la Russie nouvelle, cherchant ses assises après les importantes réformes sociales du tsar Alexandre II. Il tente ici de renouer avec l'élan des masses ("aller au peuple"), mais Nejdanov, fils illégitime d'un aristocrate, ayant rallié le mouvement révolutionnaire mais obligé pour gagner sa vie d'accepter la situation de précepteur du fils d'un haut dignitaire, est réduit au suicide en raison de l'échec de ces tentatives et du déclin de sa foi révolutionnaire. La texture du roman sera elle-aussi un échec.
Jusqu'à la fin de ses jours Tourgueniev ne cessera d'écrire, mais son "Chant de l'amour triomphant" (1881) ou "Clara Milic" (1882) appartiennent à un tout autre registre et sombre dans un agnosticisme pessimiste nourri de Schopenhauer. En 1875, Tourgueniev est élu vice-président au Congrès International de Littérature, aux côtés de Victor Hugo qu'il rencontre pour la première fois. À la fin des années 1870 et au début des années 1880, l'époque des grandes réformes étant révolues et les passions politiques ayant décliné, Tourgueniev revient épisodiquement en Russie, fort d'une certaine renommée. Il est emporté le 22 août 1883 par un cancer de la moelle épinière et s'éteint dans sa demeure de Bougival, pour être inhumé le 9 octobre 1883 à Saint-Pétersbourg, au cimetière Volkovo aux pieds de Belinski, selon son vœu ...


"Kramskoy peignant un Portrait de sa fille, 1884"
Ivan Kramskoï (1837-1887) - Nikolaevich Kramskoy est né dans la ville russe d’Ostrogoschsk dans une famille petite-bourgeoise appauvrie. Malgré cela, le jeune homme talentueux a pu étudier la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg de ses vingt à vingt-six ans. Mais il a rapidement commencé à se rebeller contre le style artistique académique et ses restrictions, organisant même une sorte de révolte, la "rébellion des Quatorze", au cours de laquelle quatorze étudiants en art ont fait preuve de désobéissance civile. Il a été expulsé de l’Académie. Mais Kramskoy n’a pas renoncé à se battre pour son idée de la responsabilité des artistes pour leur public et pour le réalisme dans l’art. C’est pourquoi l’artiste, avec d’autres peintres, a fondé le Mouvement des Peredwishniki, en allemand Wanderer (Ambulants ou Itinérants). La société (qui compte notamment en 1886, Sergueï Ammossov, Aleksandre Kisseliov, Nikolaï Nevrev, Vladimir Makovski, Aleksandre Litovtchenko, Illarion Prianichnikov, Kirill Lemokh, Ivan Kramskoï, Ilia Répine, Vassili Sourikov, Ivan Chichkine, Nikolaï Iarochenko, Pavel Brioullov) a existé pendant plus de 50 ans et a organisé des expositions itinérantes dans de nombreuses villes russes, par exemple à Moscou, Kiev, Kharkov, Kazan, Odessa et Riga. Les peintres du réalisme qui y étaient représentés ont condamné la domination absolutiste de la Russie et ont voulu montrer les facettes complexes de la société russe, en particulier les traditions du peuple et la vie urbaine et rurale. Pour eux, le naturel et l’authenticité étaient très importants et ils ne peignaient plus dans les couleurs sombres traditionnelles de l’époque, mais dans des tons clairs et irisés. Beaucoup de peintres russes très talentueux, mais aussi des artistes d’Ukraine, d’Arménie et de Lettonie ont rejoint les Peredwishniki et Ivan Nikolaevich Kramskoy est resté le chef du mouvement jusqu’à sa mort en 1887 ...








... un extraordinaire portraitiste des plus célèbres artistes de son temps : Léon Tolstoï, 1873 - Ivan Chichkine, 1873 - Pavel Tretiakov, 1876 - N. A. Nekrassov dans la période des « Derniers Chants », 1877-1878 - Mikhail Saltykov-Shchedrin - Ilya Efimovich Repin, 1876 - Iwan Gontscharow - ...
... et deux oeuvres parmi les plus connues des peintures russes, "L'Inconnue" (1883), portrait d'une femme dans une calèche, et "Roussalki" (1871) réalisé sur base d'un récit de Nicolas Gogol et tiré de ses "Soirées du hameau près de Dikanka" ...
En 1882, Ilia Répine réalise un "Portrait du peintre Ivan Nikolaïevitch Kramskoï", tous exposés à Moscou, galerie Tretiakov....
Les "Grandes Réformes" de l`empereur Alexandre II, cette si brève époque de l'Histoire russe qui se situe entre 1861 et 1864, ont déclenché un mouvement de forces et d'idées violentes et contradictoires. Leur tragique antinomie a préparé la catastrophe de 1917. La Révolution russe a marqué à la fois le triomphe et la fin du "nihilisme". Longtemps, les éléments destructifs qui, dès la seconde moitié du règne d'Alexandre II, avaient répondu à l' "émancipation" prudente par l' "action directe" des groupes terroristes, avaient formé l'un des thèmes principaux, complexes et passionnants, de la littérature russe du XIXe siècle. Mais, à l`exception de Leskov et de Dostoïevski, rares furent les auteurs qui jugèrent les révolutionnaires de leur temps avec sévérité. D'après Gordanov, le personnage principal du roman "A Couteaux tirés" , de Nikolaï Semenovitch Leskov, "il ne fallait pas, comme le préconisaient les anarchistes, d'abord ruiner la société. puis la détruire ; il fallait au contraire la détruire d'abord et la ruiner ensuite". Et en attendant il fallait profiter de cette société décadente pour s'enrichir et pour jouir des biens de ce monde. Le roman de Leskov fut publié dans la revue "Le Messager russe" (Ruskij Vestnik) en 1870-1871, alors que "Les Possédés" de Dostoïevski, - qui, avec plus de profondeur, étudiaient le même phénomène social et psychologique -, y parurent au cours de l'année suivante ..

Mikhail Saltykov-Chtchédrine (1826-1889)
L'un des plus grands satiristes russes naquit dans le village de Spas-Ugol, dans le gouvernement de Tver, étudia au lycée de Tsarskoïé-Sélo où Pouchkine avait été élève, puis fut employé, de 1844 à 1848, au ministère de la Guerre et fréquenta dès cette époque les cercles libéraux. Il collabore à des revues de tendance occidentale. Ayant publié en mars 1848 un récit intitulé "Une affaire embrouillée" (Zaputanoje délo) dans les Annales de la patrie, il doit quitter la capitale, est déporté à Vjatka pendant huit années. Appelé à Saint-Pétersbourg en 1856, il y occupe un poste au ministère de l'lntérieur. En 1855 paraît dans la revue Le Messager russe (Russkij vesnik) son premier recueil de nouvelles, les "Esquisses provinciales", dans lequel se révèle son don de satiriste. Nommé vice-gouverneur de Rjazan (1858), puis de Tver (1860), Saltykov va pouvoir ainsi acquérir dans ces milieux administratifs une expériences qui va abondamment inspirer son œuvre. En 1862,Saltykov obtient un congé de deux ans et devient un des collaborateurs réguliers de la revue "Le Contemporain", mais aussi dans celle des frères Dostoïevski , Le Temps : paraissent les "Récits innocents" (Nevinnye razskazy) et les "Satires en prose" (Satiry v prozé). In renoue avec l'administration en 1864, occupe divers postes à Penza, Tula et Rjazan, puis démissionne en 1868 pour se consacrer entièrement à la littérature et accepter, à la demande du poète Nekrassov, la direction des "Annales de la patrie". De 1868 à 1888, il ne cessera de publier pour dénoncer vices et abus dont souffrait alors la Russie (Lettres sur la province, 1868-70, Histoire d'une ville, Les Messieurs de Tachkent, 1869-72, Les Pompadours, messieurs et dames, 1873).
Saltykov donne enfin un roman en 1873-1874, "Les Golovlev", sombre tableau des moeurs qui, avec "La Mort de Pazuhine", publié en 1851, constituent des chefs d'oeuvre d'intensité dramatique... (cf. Œuvres (Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard) Nicolas Leskov et Saltykov-Chtchédrine).

"Les Golovlev" (1873-1874)
Publiée entre 1873 et 1874, "Les Golovlev" (Gospoda Golovlëvy) constitue l'une des plus sombres peintures de moeurs de la littérature mondiale. La servitude de la glèbe sert de thème général à ce romans, une servitude considérée sous l'angle des conséquences des réformes de 1861 (abolition du servage par le tsar Alexandre ll). L'auteur se place au point de vue de la noblesse terrienne, pour laquelle ces réformes conduiront à des conséquences parfois dramatiques. Le roman nous fait pénétrer dans l'intimité d'une famille de vieille noblesse qui, justement, par suite de l`abolition du servage qui la prive d'une main-d'œuvre gratuite, court vers la ruine. Les trois traits de caractère que les Golovlev se transmettent de génération en génération sont : l'oisiveté, l'incapacité notoire à tout travail et l'alcoolisme.
lci nous sommes loin de l'oisiveté idyllique d'un Oblamov décrite par Gontcharov. Chez Porphyre, dernier rameau de la famille Golovlev, que ses frères eux-mêmes appellent "loudouschka" (petit Judas), ces traits caractéristiques atteignent les extrêmes limites du possible. De ses deux frères, l'un s`adonne à l'alcoolisme et en meurt ; l'autre sombre petit à petit dans la folie. La préoccupation principale de "petit Judas" est la mainmise totale sur le patrimoine familial. ll a deux fils, dont l'un a été déshérité par lui après avoir fait un mariage d`amour, et s'est suicidé par la suite. Le deuxième, ayant perdu de grosses sommes au jeu, demanda à son pères mais en vain, de venir à son aide. Ce dernier ayant refusé tout appui, il a subi la dégradation et est mort au bagne. loudouschka a une maîtresse qui, bientôt. régente toute la maison; ils ont un fils que son père a abandonné aux "enfants trouvés". La famille Golovlev comporte deux autres personnages : deux nièces qui, n'arrivant pas à manger à leur faim. quittent la maison et se font actrices dans quelque trou de province. N'ayant pas réussi, l'une d'elles s'empoisonne et I`autre se réfugie chez son oncle, lequel lui propose bientôt de devenir sa maîtresse. Elle refuse et s'enfuit, mais, ne sachant plus où aller, elle tourne bride et accepte de devenir la compagne des orgies de son oncle.
À cet endroit, le récit atteint son point culminant : la nièce parvient à faire naitre chez son oncle, d`abord le remords, puis un désir d'expiation tel qu'il finit par se suicider sur la tombe de sa mère. Ce dénouement tend évidemment à démontrer que, même chez un "monstre", sommeille, suivant I`expression de l'auteur, une conscience "mise sous le boisseau et oubliée", reléguant jusqu`à un moment déterminé cette sensibilité agissante qui rappelle inévitablement à l'homme que la conscience existe. (Trad. Gallimard, 1949)

"Pochekhonie d'autrefois" (Posekhonskaja starina)
Suite de récits publiés en 1887-1889 et dernière composition du satirique russe Mikhail Saltykov-Chtchédrine (Le Bon Vieux Temps) : il répond ainsi avec une certaine férocité aux descriptions plus ou moins idylliques de la campagne russe offertes par des écrivains tels que Sergueï Aksakov (Chronique familiale, 1856), Tolstoï, Tourgueniev ou Gontcharov." Ce que j'ai dépeint, écrit Saltykov lui-même, ressemble à l'enfer, mais n'est pas de mon invention : je peux poser la main sur mon cœur et dire : conforme à l'original...". On prend souvent comme exemple de cette terrible chronique l'histoire de la tante Anfissa Porfirievna, qui sauve son mari, capitaine en retraite, d'un départ comme soldat dans un régiment disciplinaire, en le faisant passer pour mort et en l'obligeant à tenir le rôle d`un serf de la glèbe. C`est pour elle l'occasion de se venger de tout ce qu'il lui a fait supporter durant les longues années de leur mariage, en le traitant à son tour comme un esclave, sans qu'il puisse se faire reconnaître ou se rebeller sous peine d`être aussitôt arrêté. De la même veine sont la plupart des histoires de cette chronique, écrite à la première personne et, de toute évidence, fondée sur des souvenirs et des matériaux recueillis par Saltykov lui-même.

"Une Famille déchue" (1867), Nikolaï Semenovitch Leskov (1831-1895)
Malgré les efforts de Gorki, et si Leskov fut intellectuellement ignoré par les progressistes russes, il fut sans doute l'un de ceux qui, par obligation de gagner sa vie, connut le mieux la Russie qui souffre : 1857-1859, à Kiev, en Sibérie, dans les steppes bachkires et tatares, dans le Sud, dans le Grand Nord. Peut-on imposer au peuple des réformes qui ne lui conviennent pas, qui heurtent trop ses habitudes ou ses croyances? En 1861, il part pour Saint-Pétersbourg tenter sa chance dans le monde des lettres, c'est alors l'ère des réformes d'Alexandre II ...
"Une Famille déchue" (1867) et "A Couteaux tirés" (1870-1871), deux grandes fresques de la société russe à l'époque des "réformes" d'Alexandre Il, déchaînèrent contre Leskov les foudres de Dmitri Pissarev (1840-1868), prototype des nihilistes russes que l'on décrit dans le roman "Pères et fils" d'Ivan Tourgueniev (1862).
Dans ces deux romans, Leskov brossait un sombre tableau de ceux qui pour lui n'étaient que des songe-creux, des cyniques bénéficiaires du nouveau système politique et de la libération des paysans asservis. Ici, il cherche à indiquer au lecteur le chemin le plus droit qui permette, d`après lui, de sortir de l`impasse morale dans laquelle s`était égarés la Russie. Une famille déchue, sorte de chronique familiale, rédigée par la petite-fille de la princesse Barbe Protozanov, nous transporte à l'époque d'AIexandre ler, des guerres napoléoniennes et de la "réaction" idéologique provoquée par les contacts de la société russe avec l`Europe révolutionnaire, romantique et mystique du début du XIXe siècle. Honnête, bonne et courageuse, la princesse Protozanov incarne aux yeux de Leskov les grandes qualités de la véritable noblesse russe, patriarcale et tout enracinée dans la glèbe. Restée veuve à 25 ans, avec trois enfants (une fille, Anastasie, et deux fils, Léon et Jacques), Barbe Protozanov gère et administre son vaste domaine avec une compréhension parfaite des besoins matériels et moraux de "ses" gens, des paysans qui la considèrent comme une vraie "souveraine", c`est-à-dire comme leur protectrice et leur conseillère. toujours prête a les aider dans les dures réalités de la vie. Autour de cette figure centrale. gravitent quelques personnages secondaires, chacun d`eux est dessiné avec une précision et une délicatesse de touche qui n'ont rien à envier à l'art de Tolstoï, mais qui peuvent sembler parfois plus justes parce que non entachées de tendances doctrinaires. Le fidèle majordome, Patrikei (ancien serviteur du prince Protozanov, qu'il avait accompagné à la guerre), le trompette Graivorona, petit-russien hirsute, balafré, ivrogne et chevaleresque (qui fut aux côtés du prince lors de la dernière charge), la servante-amie Olga Fedotovna, Marie, fille du diacre de I'église paroissiale, autant de figures et inoubliables types de ce bon peuple russe dont les vertus, d`après Leskov, ne se réduisent point à la morne patience : ni aux élans d'un anarchisme sanglant et généreux...
ll y a aussi Dorimedont Rogogine, pauvre gentilhomme campagnard. fou et magnanime, voyageur infatigable à travers le pays, éternel redresseur de torts que la princesse protège et soustrait parfois aux poursuites des autorités provinciales. À Saint-Petersbourg, où Mme Protozanov se rend pour accueillir sa fille (qui vient de terminer ses études à l`Institut Smolny, internat créé par l'impératrice Catherine II et pépinière de la plus grande noblesse russe), la châtelaine retrouve ce "monde" qu`elle a abandonné depuis dix ans et dont l`évolution n'a fait qu'accentuer les tares et la dégénérescence. Elle y retrouve entre autres la comtesse Motetov, vieille bigote qui enrichit les monastères, mais néglige et maltraite ses paysans, et le comte Basile Founkendorf, quinquagénaire alerte et élégant (parfait spécimen du bureaucrate habile, intelligent, d'une moralité douteuse et d'un esprit accommodant). Après avoir essayé en vain d'obtenir la main de la veuve (encore belle et fraiche à 35 ans), Founkendorf se laisse sans déplaisir entrainer par Motetov dans une série de manœuvres matrimoniales se terminant par le mariage du comte avec Mlle Anastasie Protozanov, trop contente de pouvoir obtenir ainsi sa "liberté" en quittant la maison maternelle, un peu austère à son avis. Au reste. la princesse Protozanov ne tarde pas à constater que ses largesses vis-à-vis de sa fille ont été exploitées d'une façon ignominieuse. Les paysans, qu'elle a cédés à la jeune comtesse Founkendorf sur les terres constituant la dot de cette dernière, sont dépouillés de leurs biens et maltraités. Pour réparer les méfaits de sa fille et de son gendre, Barbe Protozanov n`hésite pas à se ruiner, en couvrant les dégâts de ses propres deniers. Elle-même terminera ses jours dans le château familial, devenu propriété de ses fils, entourée de l`amour et de la vénération de ses anciens "sujets" reconnaissants. Sur le fond mouvementé de cette chronique familiale, plusieurs personnages historiques apparaissent : le grand peintre Kiprenski, portraitiste de la Cour et du grand monde et surtout la figure du professeur Méthode Tcherver, - ami du célèbre Sperenski, le Père du libéralisme russe . (Trad. Gallimard, 1967).

"A Couteaux tirés" (Na nozah), 1870-1871, Nikolaï Semenovitch Leskov (1831-1895)
En comparaison de Dostoïevski, Leskov, anti nihiliste, n'est ni prophète ni visionnaire et ses créatures, viles ou atroces, n`annoncent point la fin irrémédiable d'un monde : elles ne sont à ses yeux que les protagonistes d`une période intermédiaire. mais qui ne présage rien de bon. Paul Gordanov, jeune, présentant bien, intelligent et parfaitement immoral. jouit d'une grande popularité parmi ses camarades de l`université de Saint-Petersbourg. Au début des années 70, les idées anarchistes y sont fort répandues. Un petit noble de province, Joseph Visléniev, ami de Gordanov, organise un complot puéril. ll est pris, ainsi qu'un certain nombre de jeunes gens, compromis dans l'affaire. Alexandrine Grinévitch, la fiancée de Visléniev, rompt avec ce dernier et épouse le général Sintianine, personnage sinistre mais influent (qu'on suppose avoir assassiné sa première femme). En se sacrifiant, Alexandrine réussit à faire relâcher Visléniev (qu`elle méprise) et les victimes innocentes de sa propagande révolutionnaire.
Gardanov, quant à lui, s`est retiré à temps des cercles anarchistes.Après avoir fait un court stage comme fonctionnaire, il se jette dans les affaires louches et dans l'aventure. Ayant vendu sa maîtresse, la belle et brillante Glafira Akatov, au vieux Michel Bodrostine (maréchal de la noblesse provinciale), il "cède" son ami, le veule Visléniev (pour une somme rondelette) à l'usurier juif Kichenski (journaliste et policier à ses heures). Celui-ci, en effet, doit pourvoir d'un mari légitime sa maîtresse Aline (dont il a eu plusieurs enfants). Dûment compromis dans une nouvelle affaire politique. Visléniev se voit forcé de payer la rançon, en épousant sa "bienfaitrice", qui ne tarde pas à le mettre sous sa coupe, en lui faisant signer des traites à son nom. Gordanov devient l'associé de Kichenski, mais il est roulé à son tour par le couple. Pour se renflouer. il gagne la ville natale de son ami Visléniev, le chef-lieu administratif où habitent tous les principaux personnages du roman : Bodrostine et son
épouse Glafira, Sintianine, la belle et faible Larissa (sœur de Joseph Visléniev) et Podoziérov un jeune agronome, loyal et intelligent.
Déçu par l'idéologie creuse de ses anciens camarades, Podoziérov consacre sa vie aux affaires des paysans, en remplissant ses devoirs administratifs avec beaucoup de compétence. Epris de la belle Larissa, Podoziérov reste insensible à l'amour que lui vouent en silence Glafira et Alexandrine. Il ne tarde pas à entrer en conflit avec Gordanov (qui joue le rôle de séducteur auprès de Larissa). Dans un duel déloyal, Podoziérov est grièvement blessé et Gordanov doit quitter en hâte la ville; mais il n'a pas perdu son temps : il a repris contact avec Glafira. Celle-ci sait que son mari l'a déshéritée au profit d'un jeune neveu, aussi a-t-elle falsifié le testament de Bodrostine, avec l'aide du régisseur Cetton Ropchine, qui lui voue une admiration sans borne. Résolue à faire disparaître son époux à un moment propice, elle associe Gordanov à son "grand projet".
Podoziérov a épousé Larissa, mais leur union n'est pas heureuse. Tandis que Glafira fait un voyage à l'étranger en compagnie de Visléniev, Gordanov réussit à gagner la confiance de Bodrosline qu`il pousse à s`engager dans des affaires fantaisistes. Glafira une fois rentrée, les complices parviennent à "liquider" le neveu encombrant, sans éveiller de suspicion. Visléniev, criblé de dettes, veule et déchu, pousse sa sœur dans les bras de Gordanov, tandis que Glafira doit céder enfin aux instances de Ropchine qui, au risque de se perdre lui-même, menace de révéler à Bodrostine l`histoire du fameux testament. Cependant Visléniev, travaillé par Gordanov, consent à assassiner Bodrostine, car il s'imagine pouvoir "conquérir" Glafira aprés la disparition de son mari. En dépit de toutes les précautions prises par Gordanov, les deux complices sont démasqués. Visléniev assassine Bodrostine au cours d'une cérémonie nocturne, sauvage et organisée par les paysans pour conjurer une épizootie qui décime leur bétail; mais il ne parvient pas à faire imputer le crime aux paysans révoltés. Lui-même et son mauvais génie sont confondus et arrêtés, le général Sinlianine ayant réussi à les faire prendre dans les filets qu`il leur a tendus. Larissa, déshonorée et humiliée, met fin à ses jours, après être rentrée de sa fugue avec Gordanov. Celui-ci meurt en prison, d`une septicémie. Visléniev, devenu complétement fou, est transféré dans un asile. Glafira, disculpée par Ropchine, est obligée de l'épouser et devient l'esclave docile de son ancien serviteur.
Cinq personnages seulement (deux femmes, Alexandrine Sintianine et Catherine Forov, et trois hommes, Forov, Podoziérov et le prêtre Evauguel) font preuve de bonté, de compréhension et de dignité dans cette société sinistre, composée d`êtres faibles, féroces ou dépravés. Podoziérov, dans un dernier dialogue avec Evanguel, résume le sens de l`intrigue : "Il n'est pas facile de reconnaitre le but de notre marche, ce but vers lequel nous cheminons, à couteaux tirés, comme si plusieurs d'entre nous ne rêvaient que de la destruction de tout ce qui présente une certaine valeur dans la vie. Mais d'ores et déjà l`on peut constater qu'il s'agit du prologue d'une tragédie formidable qui doit arriver fatalement ..."
Après cet ouvrage, point culminant de sa première période, Leskov se tourna vers une autre thématique pour décrire un monde qu'il connaissait bien, le monde religieux au sens le plus large, et que nul avant lui n'avait aussi exactement dépeint, "Gens d'Eglise" (1872), "L'Ange scellé" (1876) ...

"LADY MACBETH AU VILLAGE", nouvelle Nikolaï Semenovitch Leskov, publiée en 1865.
Katerina L'vovna, femme d`un riche marchand de province, est une sorte de "Lady Macbeth" qui commet une série de crimes pour se rapprocher de son amant, et qui finira par se suicider. Avec l'aide d'un jeune paysan dont elle s'est éprise, Katerina étrangle son mari et cache son corps dans la cave. Après quoi elle empoisonne son beau-père, lequel a surpris son secret; enfin, elle étrangle un enfant afin de rester l'unique héritière du patrimoine. Traînée devant les tribunaux avec son amant, elle est condamnée aux travaux forcés. Pendant le voyage de déportation vers la Sibérie, ce dernier la trahit avec une autre déportée; l'héroïne se jette alors dans le fleuve, en y entraînant sa rivale.
Ce conte est écrit avec beaucoup de réalisme et une grande connaissance des conditions de vie des déportés. L'auteur en conclut qu'une sinistre fin attend tout être que gouverne un excessif appétit de bonheur, une morale qui n'est que suggérée, la puissance du récit vaut bien sa lecture et le compositeur russe Dimitri Chostakovitch (1906-1975) a tiré de ce conte un opéra qui fut représenté à Leningrad en 1934. (Trad. Gallimard, 1939).
