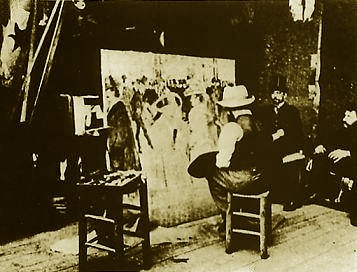- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Guy de Maupassant (1850-1893), "Les Dimanches d’un bourgeois de Paris", "Boule de Suif" (1880), "Contes de la Bécasse" (1883), "Une Vie" (1883), "Bel Ami" (1885), "Pierre et Jean" (1887), "Le Horla" (1187), "Le Rosier de Madame Husson" (1888)
Last Update: 11/11/2016

Guy de Maupassant, , esprit sombre et désabusé, écrivain sobre d'une rare précision, a écrit en dix ans plus de trois cents contes, publiés dans divers journaux, et six romans. Si l'objet de l'art est pour lui de donner "une image exacte de la vie", il montre une prédilection pour les personnages moyens ou médiocres, décrits dans le cadre rétréci de leurs occupations quotidiennes. Les diverses sources de son inspiration, récits du terroir normand, épisodes de guerre, évocation de la vie des employés de bureau, s'appuient sur son expérience vécue. Ses textes utilisent un vocabulaire simple, décrivent des comportements et refusent toute dramatisation. Mais son univers est noir et pessimiste : la vie sociale est pour lui une grotesque comédie, "nous sommes tous dans un désert", la philosophie comme la science restent à la surface des problèmes et la religion est un recours illusoire.
On reconnaît en Maupassant la perfection de ses contes : le décor y est rapidement brossé, l'atmosphère est créée, l'aspect physique et le comportement des personnages, la qualité des dialogues suffisent à nous faire pénétrer dans le secret leurs états d'âmes, et ce sont ces états d'âme qui vont déterminer le cheminement de l'intrigue.
".... La petite femme est un modèle, bien entendu. Elle posait chez lui. Elle était jolie, élégante, surtout, et possédait, paraît-il, une taille divine. Il devint amoureux d'elle, comme on devient amoureux de toute femme un peu séduisante qu'on voit souvent. Il s'imagina qu'il l'aimait de toute son âme. C'est là un singulier phénomène. Aussitôt qu'on désire une femme, on croit sincèrement qu'on ne pourra plus se passer d'elle pendant tout le reste de sa vie. On sait fort bien que la chose vous est déjà arrivée; que le dégoût a toujours suivi la possession; qu'il faut, pour pouvoir user son existence à côté d'un autre être, non pas un brutal appétit physique, bien vite éteint, mais une accordance d'âme, de tempérament et d'humeur. Il faut savoir démêler, dans la séduction qu'on subit, si elle vient de la forme corporelle, d'une certaine ivresse sensuelle ou d'un charme profond de l'esprit...»
"... Cet homme était marié depuis dix ans. Depuis dix ans il avait l'habitude de sentir une femme près de lui, toujours. Il était accoutumé à ses soins, à cette voix familière quand on rentre, à l'adieu du soir, au bonjour du matin, à ce doux bruit de robe si cher aux féminins, à cette caresse tantôt amoureuse et tantôt maternelle qui rend légère l'existence, à cette présence aimée qui fait moins lentes les heures. Il était aussi accoutumé aux gâteries matérielles de la table peut-être, à toutes les attentions qu'on ne sent pas et qui nous deviennent peu à peu indispensables. Il ne pouvait plus vivre seul. Alors, pour passer les interminables soirées, il prit l'habitude d'aller s'asseoir une heure ou deux dans une brasserie voisine. Il buvait un bock et restait là, immobile, suivant d'un oeil distrait les billes du billard courant l'une après l'autre sous la fumée des pipes, écoutant sans y songer les disputes des joueurs, les discussions de ses voisins sur la politique et les éclats de rire que soulevait parfois une lourde plaisanterie à l'autre bout de la salle. Il finissait souvent par s'endormir de lassitude et d'ennui. Mais il avait au fond du coeur et au fond de la chair le besoin irrésistible d'un coeur et d'une chair de femme; et sans y songer, il se rapprochait un peu, chaque soir, du comptoir où trônait la caissière, une petite blonde, attiré vers elle invinciblement parce qu'elle était une femme...."

Guy de Maupassant (1850-1893)
Guy de Maupassant est né en Normandie, au château de Miromesnil, à Turvilles sur Arques, en 1850. Il passe son enfance à Etretat et vit dans la familiarité des paysans et des pêcheurs. Il fait de solides études, puis part faire la guerre en 1870. À son retour, il est employé au ministère de la Marine puis au Ministère de l'Instruction publique. Son goût des filles de joie et des maisons closes débouchera en 1877 sur le diagnostic de cette "petite vérole" qui, avec l’absinthe, fait des ravages dans cette fin de siècle. C'est la même année que se situe l'épisode bien connu de la représentation très privée de la pièce érotico-exotique de Maupassant "À la Feuille de rose, maison turque", dans l’atelier des peintres Becker et Leloir, rue de Fleurus, et qui "réunit" Zola, Huysmans, Valtesse de la Bigne, Suzanne Lagier, chanteuse de l’Alcazar, et Edmond de Goncourt.
Sous la direction de Gustave Flaubert qui corrige durement ses premiers écrits et semble apprécier son côté épicurien, il compose aussi bien des poèmes que des contes ou des pièces de théâtre. C'est à l'occasion de la publication de Boule de Suif en 1880, dans l'ouvrage collectif "Les Soirées de Médan", que Maupassant se fait connaître et se démarque du groupe des naturalistes et de Zola. Son succès l'encourage à travailler la forme du conte, et il parvient désormais à vivre de sa plume. Il entre alors dans une période d'intense production littéraire. En mai 1881, il publie son premier volume de nouvelles sous le titre de "La Maison Tellier" puis termine son premier roman, "Une Vie", qui lui aura coûté six années, en 1883 : les vingt-cinq mille en moins d’un an. Sa réputation ira jusqu’en Russie, grâce notamment à Ivan Tourgueniev. Avec les droits d’auteur de ces deux succès littéraires, il se fait construire une maison à Étretat et en cette même année, a un premier fils, avec une couturière, Joséphine Litzelmann.
En 1884, il vit une liaison avec la comtesse Emmanuela Potocka, une mondaine issue d'une riche et célèbre famille napolitaine,les Pignatelli, assidûment courtisée par les Paul Bourget, Jacques-Emile Blanche, Jean-Louis Forain, Frédéric Mistral, et Montesquiou-Fézensac, et qui apparaît dans les romans de Maupassant sous les traits de Christiane Andermatt dans "Mont-Oriol", et dans "Notre Coeur" sous ceux de la baronne de Frémines.
En 1885, "Bel-Ami", qui décrit l’ascension sociale fulgurante d’un journaliste cynique, dont l’unique talent est de savoir séduire des femmes influentes, d’abord paru en feuilleton dans Gil Blas, connaît un succès populaire immédiat. Guy de Maupassant s'est alors définitivement affranchi de l’influence de Gustave Flaubert.
Alors que les contes des années 1880 ont plutôt pour cadre la Normandie de son enfance, le goût de Maupassant pour le morbide est de plus en plus flagrant dans ses dernières œuvres, ce qui ne va pas sans laisser penser à une influence de sa maladie sur son écriture. Sujet à des troubles nerveux probablement dus à sa syphilis, il est d'abord en proie à des hallucinations, puis à un délire qui le conduit à être interné en 1891. Il meurt dix-huit mois plus tard.
« Les Employés » (Chronique) Le Gaulois, 4 janvier 1882
« Comme je passais dans cette foule compacte, dans cette foule engourdie, lourde, pâteuse, qui coulait lentement dimanche, sur le boulevard comme une épaisse bouillie humaine, plusieurs fois ce mot me frappa l'oreille : « La gratification ». En effet, ce qui remuait si difficilement le long des trottoirs, c'était le peuple des employés. De toutes les classes d'individus, de tous les ordres de travailleurs, de tous les hommes qui livrent quotidiennement le dur combat pour vivre, ceux-là sont le plus à plaindre, sont les plus déshérités de faveurs. On ne le croit pas. On ne le sait point. Ils sont impuissants à se plaindre ; ils ne peuvent pas se révolter ; ils restent fiés, bâillonnés dans leur misère, leur misère correcte, leur misère de bachelier.
Comme je l'aime, cette dédicace de Jules Vallès : « A tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim ! »
Voici qu'on parle d'augmenter le traitement des députés, ou plutôt, voici que les députés parlent d'augmenter leur traitement. Qui parlera d'augmenter celui des employés, qui rendent ma foi, autant de discutables services que les bavards du palais Bourbon ?
Sait-on ce qu'ils gagnent, ces bacheliers, ces licenciés en droit, ces garçons que l'ignorance de la vie, la négligence coupable des pères et la protection d'un haut fonctionnaire ont fait entrer, un jour, comme surnuméraires dans un ministère ?
Quinze ou dix-huit cents francs au début ! Puis, de trois ans en trois ans, ils obtiennent une augmentation de trois cents francs, jusqu'au maximum de quatre mille, auquel ils arrivent vers cinquante ou cinquante-cinq ans. Je ne parle point ici des très rares élus qui deviennent chefs de bureau. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Sait-on ce que gagne aujourd'hui, dans Paris, un bon maçon ? - Quatre-vingts centimes l'heure. Soit huit francs par jour, soit deux cent huit francs par mois, soit deux mille cinq cents francs environ par an. Un ouvrier dans une spécialité quelconque ? Douze francs par jour. Soit trois mille sept cents francs par an ! Et je ne parle pas des habiles !
Or, messieurs les gouvernants, vous savez ce que vaut le pain, et le reste, n'est-ce pas, puisque vous vous trouvez insuffisamment rétribués ? Vous admettez bien que les bureaucrates se marient comme vous, aient des enfants comme vous, s'habillent au moins un peu, sans fourrures, mais enfin aillent vêtus à leur bureau. Et vous voulez qu'aujourd'hui, avec deux mille cinq cents francs, moyenne des traitements, un homme ait une femme, deux mioches au moins - (un de chaque sexe, pour maintenir l'équilibre des unions futures et la population de la France, dont vous vous inquiétez), et que cet homme achète des culottes pour lui et son garçon, des jupes pour sa femme et sa fille. Calculons : loyer, cinq cents ; habillement et linge, six cents ; tous autres frais, cinq cents. - Il reste neuf cents francs justes, soit deux francs quarante-cinq centimes par jour pour nourrir le père, la mère et les deux enfants. C'est odieux et révoltant !
Et pourquoi donc, seuls, les employés demeurent-ils dans cette misère, alors que l'ouvrier vit à son aise. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent ni réclamer, ni protester, ni se mettre en grève, ni changer d'emploi, ni se faire artisan.
Cet homme est instruit, il respecte son éducation et se respecte lui-même. Ses diplômes l'empêchent de clouer des tentures ou de racler du plâtre, ce qui vaudrait mieux pour lui. S'il quittait sa fonction, que ferait-il ? Où irait-il ? On ne change pas d'administration comme d'atelier. Il y a les fo-or-ma-li-tés. Il ne peut pas protester ; on le chasserait. Il ne peut même pas réclamer. Voici un exemple : Il y a quelques années, les employés de la marine, las de mourir de faim, de voir les Expositions universelles et l'augmentation générale du bien-être faire tout renchérir, alors que leurs traitements demeuraient invariablement dérisoires rédigèrent humblement une requête à M. Gambetta, président de la Chambre. Il y eut dans les bureaux un soupir d'espoir. Tout le monde signait. Des députés avaient promis, dit-on, d'intervenir. Or, la requête fut dénoncée, saisie, au nom de la discipline et au mépris de tout droit. L'amiral quelconque, alors ministre, fulmina des menaces de révocation pour les signataires, terrorisa l'administration tout entière. Que pouvait-on faire ? On se tut, et on continua à crever de misère.
Et quand on songe que ces pauvres diables d'employés trouvent encore quelquefois le moyen, par suite de je ne sais quels insondables mystères d'économie, d'envoyer leurs fils au collège, afin de leur faire obtenir, plus tard, ce ridicule et inutile diplôme de bachelier ! C'est à eux qu'on peut appliquer l'image hardie si connue, et dire : « Ils vivent de privations ».
Parlons de leur existence. Sur la porte des Ministères, on devrait écrire en lettres noires la célèbre phrase de Dante : « Laissez toute espérance, vous qui entrez ».
On pénètre là vers vingt-deux ans. On y reste jusqu'à soixante. Et pendant cette longue période, rien ne se passe. L'existence tout entière s'écoule dans le petit bureau sombre, toujours le même, tapissé de cartons verts. On y entre jeune, à l'heure des espoirs vigoureux. On en sort vieux, près de mourir. Toute cette moisson de souvenirs que nous faisons dans une vie, les événements imprévus, les amours douces ou tragiques, les voyages aventureux, tous les hasards d'une existence libre, sont inconnus à ces forçats.
Tous les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années se ressemblent. A la même heure on arrive ; à la même heure, on déjeune ; à la même heure, on s'en va ; et cela de vingt-deux à soixante ans. Quatre accidents seulement font date : le mariage, la naissance du premier enfant, la mort de son père et de sa mère. Rien autre chose ; pardon, les avancements. On ne sait rien de la vie ordinaire, rien même de Paris. On ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues, et les vagabondages dans les champs : car jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. On se constitue prisonnier à dix heures du matin ; la prison s'ouvre à cinq heures, alors que la nuit vient. Mais, en compensation, pendant quinze jours par an on a bien le droit, - droit discuté, marchandé, reproché, d'ailleurs - de rester enfermé dans son logis. Car où pourrait-on aller sans argent ?
Le charpentier grimpe dans le ciel, le cocher rôde par les rues ; le mécanicien des chemins de fer traverse les bois, les plaines, les montagnes, va sans cesse des murs de la ville au large horizon bleu des mers. L'employé ne quitte point son bureau, cercueil de ce vivant ; et dans la même petite glace où il s'est regardé, jeune, avec sa moustache blonde, le jour de son arrivée, il se contemple, chauve, avec sa barbe blanche, le jour où il est mis à la retraite. Alors, c'est fini, la vie est fermée, l'avenir clos. Comment cela se fait-il qu'on en soit là, déjà ? Comment donc a-t-on pu vieillir ainsi sans qu'aucun événement se soit accompli, qu'aucune surprise de l'existence vous ait jamais secoué ? Cela est pourtant. Place aux jeunes, aux jeunes employés ! Alors on s'en va, plus misérable encore, avec l'infime pension de retraite. On se retire aux environs de Paris, dans un village à dépotoirs, où l'on meurt presque tout de suite de la brusque rupture de cette longue et acharnée habitude du bureau quotidien, des mêmes mouvements, des mêmes actions, des mêmes besognes aux mêmes heures.
Parlons des chefs maintenant.
Les quelques inconnus d'avant-hier qui, hier, se sont réveillés ministres n'ont pas pu ressentir un plus violent affolement d'orgueil qu'un vieil employé nommé chef. Lui, l'opprimé, l'humilié, le triste obéissant, il commande, il en a le droit, - et il se venge. Il parle haut, durement, insolemment, et les subordonnés s'inclinent. Il faut excepter certains ministères comme celui de l'instruction publique, où d'anciennes traditions de bienveillance et de courtoisie ont été jusqu'ici conservées. D'autres sont des galères. J'ai cité celui de la marine ; j'y reviens. J'y ai passé, je le connais. Là-dedans on a le ton de commandement des officiers sur leur pont. Il n'est pas le seul ; d'ailleurs, rien n'égale la morgue, l'outrecuidance, l'insolence de certains pions parvenus, dont l'ancienneté a fait des rois de bureau, des despotes au rond de cuir. L'ouvrier insulté par le contremaître retrousse ses manches et frappe du poing. Puis il ramasse ses outils et cherche un autre chantier. Un employé un peu fier serait sans pain le lendemain, et pour longtemps, sinon pour toujours.
Dernièrement, un ministre prenant possession de son département prononçait à peu près ces paroles devant les « hauts fonctionnaires » de son administration, les chefs et les employés : « Et n'oubliez pas, messieurs, que j'exige votre estime et votre obéissance : votre estime, parce que j'y ai droit ; votre obéissance, parce que vous me la devez ».
Cela sent-il assez l'autoritaire parvenu ?
Et songeons à ce que deviendra un pareil discours passant de bouche en bouche jusqu'au sous-chef haranguant ses expéditionnaires !
Oh ! il y a bien des cœurs froissés dans ces vastes usines à papier noirci, et des coeurs tristes, et de grandes misères, et de pauvres gens instruits, capables, qui auraient pu être quelqu'un, et qui ne seront jamais rien, et qui ne marieront point leurs filles sans dot, à moins de leur faire épouser un employé comme eux."

Contes divers 1875-1880 : La main d'écorché - Le docteur Héraclius Gloss - Le donneur d'eau bénite - Le mariage du lieutenant Laré - «Coco, coco, coco frais !» - Boule de suif - Les dimanches d'un bourgeois de Paris - Jadis - Une page d'histoire inédite -
1880 - Les Dimanches d’un bourgeois de Paris
Les Dimanches d’un bourgeois de Paris est initialement publiée dans la revue "Le Gaulois" en 1880. Cette nouvelle n’a pas été incorporée dans un recueil du vivant de Maupassant. Cette œuvre d’une cinquantaine de pages marque le début de la collaboration entre Le Gaulois et Maupassant qui écrit à Émile Zola : « Je viens de rentrer au Gaulois avec Joris-Karl Huysmans, nous donnerons un article par semaine et toucherons cinq cent francs par mois".
M. Patissot, employé de bureau, voit son existence bouleversée le jour où il apprend qu'il est menacé d'apoplexie s'il ne s'adonne pas à l'exercice physique. Notre homme se lance alors fièrement à l'assaut de la nature: excursions à la campagne, partie de pêche, canotage, émois amoureux s'enchaînent... Et heureusement pour lui, contrairement à l’apoplexie, le ridicule ne tue pas....
"Monsieur Patissot, né à Paris, après avoir fait, comme beaucoup d’autres, de mauvaises études au collège Henri IV, était entré dans un ministère par la protection d’une de ses tantes, qui tenait un débit de tabac où s’approvisionnait un chef de division. Il avança très lentement et serait peut-être mort commis de quatrième classe, sans le paterne hasard qui dirige parfois nos destinées. Il a aujourd’hui cinquante-deux ans, et c’est à cet âge seulement qu’il commence à parcourir, en touriste, toute cette partie de la France qui s’étend entre les fortifications et la province.
L’histoire de son avancement peut être utile à beaucoup d’employés, comme le récit de ses promenades servira sans doute à beaucoup de Parisiens qui les prendront pour itinéraires de leurs propres excursions, et sauront, par son exemple, éviter certaines mésaventures qui lui sont advenues.
M. Patissot, en 1854, ne touchait encore que 1. 800 francs. Par un effet singulier de sa nature, il déplaisait à tous ses chefs, qui le laissaient languir dans l’attente éternelle et désespérée de l’augmentation, cet idéal de l’employé. Il travaillait pourtant ; mais il ne savait pas le faire valoir : et puis il était trop fier, disait-il. Et puis sa fierté consistait à ne jamais saluer ses supérieurs d’une façon vile et obséquieuse, comme le faisaient, à son avis, certains de ses collègues qu’il ne voulait pas nommer. Il ajoutait encore que sa franchise gênait bien des gens, car il s’élevait, comme tous les autres d’ailleurs, contre les passe-droits, les injustices, les tours de faveur donnés à des inconnus, étrangers à la bureaucratie. Mais sa voix indignée ne passait jamais la porte de la case où il besognait, selon son mot : « Je besogne… dans les deux sens, monsieur ».
Comme employé d’abord, comme Français ensuite, comme homme d’ordre enfin, il se ralliait, par principe, à tout gouvernement établi, étant fanatique du pouvoir… autre que celui des chefs. Chaque fois qu’il en trouvait l’occasion, il se postait sur le passage de l’empereur afin d’avoir l’honneur de se découvrir : et il s’en allait tout orgueilleux d’avoir salué le chef de l’État.
À force de contempler le souverain, il fit comme beaucoup : il l’imita dans la coupe de sa barbe, l’arrangement de ses cheveux, la forme de sa redingote, sa démarche, son geste – combien d’hommes, dans chaque pays, semblent des portraits du Prince ! – Il avait peut-être une vague ressemblance avec Napoléon III, mais ses cheveux étaient noirs – il les teignit.
Alors la similitude fut absolue ; et, quand il rencontrait dans la rue un autre monsieur représentant aussi la figure impériale, il en était jaloux et le regardait dédaigneusement. Ce besoin d’imitation devint bientôt son idée fixe, et, ayant entendu un huissier des Tuileries contrefaire la voix de l’empereur, il en prit à son tour les intonations et la lenteur calculée.
Il devint aussi tellement pareil à son modèle qu’on les aurait confondus, et des gens au ministère, des hauts fonctionnaires, murmuraient, trouvant la chose inconvenante, grossière même ; on en parla au ministre, qui manda cet employé devant lui. Mais, à sa vue, il se mit à rire, et répéta deux ou trois fois : « C’est drôle, vraiment drôle ! » On l’entendit, et le lendemain, le supérieur direct de Patissot proposa son subordonné pour un avancement de trois cents francs, qu’il obtint immédiatement.
Depuis lors, il marcha d’une façon régulière, grâce à cette faculté simiesque d’imitation. Même une inquiétude vague, comme le pressentiment d’une haute fortune suspendue sur sa tête, gagnait ses chefs, qui lui parlaient avec déférence.
Mais quand la République arriva, ce fut un désastre pour lui. Il se sentit noyé, fini, et, perdant la tête, cessa de se teindre, se rasa complètement et fit couper ses cheveux courts, obtenant ainsi un aspect paterne et doux fort peu compromettant.
Alors, les chefs se vengèrent de la longue intimidation qu’il avait exercée sur eux, et, devenant tous républicains par instinct de conservation, ils le persécutèrent dans ses gratifications et entravèrent son avancement. Lui aussi changea d’opinion ; mais la République n’étant pas un personnage palpable et vivant à qui l’on peut ressembler, et les présidents se suivant avec rapidité, il se trouva plongé dans le plus cruel embarras, dans une détresse épouvantable, arrêté dans tous ses besoins d’imitation, après l’insuccès d’une tentative vers son idéal dernier : M. Thiers.
Mais il lui fallait une manifestation nouvelle de sa personnalité. Il chercha longtemps ; puis, un matin, il se présenta au bureau avec un chapeau neuf qui portait comme cocarde, au côté droit, une très petite rosette tricolore. Ses collègues furent stupéfaits ; on en rit toute la journée, et le lendemain encore, et la semaine, et le mois. Mais la gravité de son attitude à la fin les déconcerta ; et les chefs encore une fois furent inquiets. Quel mystère cachait ce signe ? Était-ce une simple affirmation de patriotisme ? – ou le témoignage de son ralliement à la République ? – ou peut être la marque secrète de quelque affiliation puissante ? – Mais alors, pour la porter si obstinément, il fallait être bien assuré d’une protection occulte et formidable. Dans tous les cas il était sage de se tenir sur ses gardes, d’autant plus que son imperturbable sang-froid devant toutes les plaisanteries augmentait encore les inquiétudes. On le ménagea derechef, et son courage à la Gribouille le sauva, car il fut enfin nommé commis principal, le 1er janvier 1880.
Toute sa vie avait été sédentaire. Resté garçon par amour du repos et de la tranquillité, il exécrait le mouvement et le bruit. Ses dimanches étaient généralement passés à lire des romans d’aventures et à régler avec soin des transparents qu’il offrait ensuite à ses collègues. Il n’avait pris, en son existence, que trois congés, de huit jours chacun, pour déménager. Mais quelquefois, aux grandes fêtes, il partait par un train de plaisir à destination de Dieppe ou du Havre, afin d’élever son âme au spectacle imposant de la mer.
Il était plein de ce bon sens qui confine à la bêtise. Il vivait depuis longtemps tranquille, avec économie, tempérant par prudence, chaste d’ailleurs par tempérament, quand une inquiétude horrible l’envahit. Dans la rue, un soir, tout à coup, un étourdissement le prit qui lui fit craindre une attaque.
S’étant transporté chez un médecin, il en obtint, moyennant cent sous, cette ordonnance :
« M. X…, cinquante-deux ans, célibataire, employé. –
Nature sanguine, menace de congestion. – Lotions d’eau froide,
nourriture modérée, beaucoup d’exercice.
« MONTELLIER, D. M. P. »
Patissot fut atterré, et pendant un mois, dans son bureau, il garda tout le jour, autour du front, sa serviette mouillée, roulée en manière de turban, tandis que des gouttes d’eau, sans cesse, tombaient sur ses expéditions, qu’il lui fallait recommencer. Il relisait à tout instant l’ordonnance, avec l’espoir, sans doute, d’y trouver un sens inaperçu, de pénétrer la pensée secrète du médecin, et de découvrir aussi quel exercice favorable pourrait bien le mettre à l’abri de l’apoplexie. ..."

1880 - Boule de Suif
"Boule de Suif" fut d'abord lue par Maupassant devant ses amis du « groupe de Médan », puis publié dans le recueil collectif de nouvelles "les Soirées de Médan", le 15 avril 1880.
Abandonnée par les « lambeaux d'une armée en déroute », la ville de Rouen est envahie par les Prussiens qui trouvent chez les « bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce », un accueil plutôt complaisant, à quelques actes de résistance près. Dans la cité occupée, «le besoin du négoce travailla de nouveau le coeur des commerçants du pays» : ils sont dix à s'embarquer pour Dieppe à bord d'une diligence. La société tout entière se trouve résumée là, comme dans une arche de Noé, par couples : des commerçants, des grands bourgeois, des nobles. Plus deux religieuses, enfin deux marginaux : « Comudet le démoc » (le républicain) et Boule de suif, une prostituée aux formes arrondies. Les femmes honnêtes l'insultent d'abord, mais comme elle seule a prévu des provisions pour le voyage qui s'éternise, tous finissent par accepter ses offres et, malgré des scrupules de vertu outragée, vident son panier. On arrive enfin à l'hôtel de Tostes, occupé par des soldats allemands, Leur officier fait demander Élisabeth Rousset, alias Boule de suif, qui revient exaspérée, on ne sait trop pour quel motif. Le lendemain matin, ordre est donné de ne pas atteler. Affolés à l'idée d'être retenus en otages, les hôtes pressent Boule de suif de leur révéler « le mystère de sa visite » à l'officier. « Ce qu'il veut, ce qu'il veut? Il veut coucher avec moi!» On s'indigne, on fait chorus autour de Boule de suif puis on réfléchit, on s'impatiente, on tente de convaincre la prostituée de se sacrifier pour ses compagnons. « Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre ? »
« Dans la voiture, on se regardait curieusement, à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient, en face l'un de l'autre, M. et Mme Loiseau, des marchands de vins en gros de la rue Grand-Pont.
Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruses et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie, qu'un soir à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de "Loiseau vole", le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. Loiseau était en outre célèbre par ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises; et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement: "Il est impayable, ce Loiseau." De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce, qu'il animait par son activité joyeuse.
A côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de trois filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté, tout le temps de l'Empire, chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Mme Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis à son époux, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un air navré l'intérieur lamentable de la voiture.
Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de la Normandie . Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province.
Collègue de M. Carré-Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conservât la vieille galanterie, et dont l'entrée fût difficile. La fortune des Bréville, toute en biens-fonds, atteignait, disait-on, cinq cent mille livres de revenu. Ces six personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes.
Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc; et la comtesse avait encore pour voisines deux bonnes soeurs qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des Pater et des Ave. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vérole comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phtisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés.
En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous.
L'homme, bien connu, était Cornudet le démoc, la terreur des gens respectables. Depuis vingt ans, il trempait sa barbe rousse dans les bocks de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au quatre septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet; mais quand il voulut entrer en fonctions, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires.
La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir; et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables.
Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de "prostituée", de "honte publique" furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux à l'exception de Loiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leurs dignités d'épouses en face de cette vendue sans vergogne; car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. »
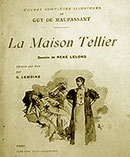
1881 – La Maison Tellier
« La Maison Tellier » (1ère publication dans ce recueil) - « Les Tombales » (Gil Blas, 9 janvier 1891) - « Sur l'eau » (sous le titre « En canot », Le Bulletin français, 10 mars 1876) - « Histoire d'une fille de ferme » (La Revue politique et littéraire, 26 mars 1881) - « En famille » (La Nouvelle Revue, 15 février 1881) - « Le Papa de Simon » (La Réforme politique, littéraire, philosophique, scientifique et économique, 1er décembre 1879) - « Une partie de campagne » (La Vie moderne, les 2 et 9 avril 1881) - « Au printemps » (1ère publication dans ce recueil) - « La Femme de Paul » (1ère publication dans ce recueil)
LA MAISON TELLIER
Une nouvelle dans laquelle Maupassant, en quelques touches précises et colorées, déploie toutes ses prodigieuses qualités de conteur. La maison Tellier, tenue par une patronne respectable, accueille chaque soir les bourgeois de Fécamp, qui se livrent là à une «débauche honnête et médiocre». L'établissement, comportant un café et un salon où l'on «monte», héberge cinq pensionnaires: Fernande la belle blonde, Raphaële la belle Juive, Rosa la Russe et deux servantes, Louise et Flora. Un samedi soir, les notables fécampois trouvent la maison fermée. Privés de leur plaisir, ils se disputent, ne comprennent pas. L'explication se trouve sur une pancarte: «Fermée pour cause de première communion.» Toute la compagnie s'est en effet transportée dans l'Eure, où la nièce de Mme Tellier, Constance, fait sa première communion …. Dans "Une partie de campagne", on suit M. Dufour, un commerçant parisien, qui vient en famille passer une journée à la campagne, s'arrête dans une auberge pour pique-niquer au bord de l'eau : deux canotiers décident de séduire la mère et la fille ...
"... La maison avait deux entrées. À l’encoignure, une sorte de café borgne s’ouvrait, le soir, aux gens du peuple et aux
matelots. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l’aide du garçon, nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un boeuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et, les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation.
Les trois autres dames (elles n’étaient que cinq) formaient une sorte d’aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu’on eût besoin d’elles en bas et que le premier fût vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l’endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d’un grand dessin représentant Léda étendue sous un cygne. On parvenait dans ce lieu au moyen d’un escalier tournant terminé par une porte étroite, humble d’apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne comme celles qu’on allume encore en certaines villes aux pieds des madones encastrées dans les murs.
Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d’eau de Cologne passait dans les
couloirs ou bien une porte entrouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée.
Madame, familière avec les clients ses amis, ne quittait point le salon et s’intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes ; elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques.
Les trois dames du premier s’appelaient Fernande, Raphaële et Rosa la Rosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d’elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaële, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle Juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de boeuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n’avait pas été marqué d’une raie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire
accentuée où deux dents neuves, en haut, faisaient tache à côté de celles du bas qui avaient pris en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens.
Rosa la Rosse, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d’une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessait de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l’exiguïté de ses pattes ; et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse, de-ci, de-là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien.
Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocote, et Flora, dite Balançoire parce qu’elle boitait un peu, l’une toujours en Liberté avec une ceinture tricolore, l’autre en Espagnole de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carotte à chacun de ses pas inégaux, avaient l’air de filles de cuisine habillées pour un carnaval. Pareilles à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d’auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux Pompes.
Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de Madame et à son intarissable bonne humeur. L’établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut ; elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde ; son bon coeur était si connu qu’une sorte de considération l’entourait...."

UNE PARTIE DE CAMPAGNE
Dans "Une partie de campagne", on suit M. Dufour, un commerçant parisien, qui vient en famille passer une journée à la campagne, s'arrête dans une auberge pour pique-niquer au bord de l'eau : deux canotiers décident de séduire la mère et la fille ...
"... Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois et, sur le pont, ç’avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière ; une buée s’en élevait, pompée par le soleil, et l’on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant à respirer enfin un air plus pur qui n’avait point balayé la fumée noire des usines ou les miasmes des dépotoirs.
Un homme qui passait avait nommé le pays : Bezons.
La voiture s’arrêta et M. Dufour se mit à lire l’enseigne engageante d’une gargote : Restaurant Poulin, matelotes et fritures, cabinets de société, bosquets et balançoires. « Eh bien, madame Dufour, cela te va-t-il ? Te décideras-tu à la fin ? »
La femme lut à son tour : Restaurant Poulin, matelotes et fritures, cabinets de société, bosquets et balançoires. Puis elle regarda la maison longuement. C’était une auberge de campagne, blanche, plantée au bord de la route. Elle montrait, par la porte ouverte, le zinc brillant du comptoir devant lequel se tenaient deux ouvriers endimanchés.
À la fin, Mme Dufour se décida : « Oui, c’est bien, dit-elle ; et puis il y a de la vue. » La voiture entra dans un vaste terrain planté de grands arbres qui s’étendait derrière l’auberge et qui n’était séparé de la Seine que par le chemin de halage.
Alors on descendit. Le mari sauta le premier puis ouvrit les bras pour recevoir sa femme. Le marchepied, tenu par deux branches de fer, était très loin, de sorte que, pour l’atteindre, Mme Dufour dut laisser voir le bas d’une jambe dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant des cuisses.
M. Dufour, que la campagne émoustillait déjà, lui pinça vivement le mollet puis, la prenant sous les bras, la déposa lourdement à terre comme un énorme paquet. Elle tapa avec la main sa robe de soie pour en faire tomber la poussière, puis regarda l’endroit où elle se trouvait.
C’était une femme de trente-six ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l’étreinte de son corset trop serré ; et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. La jeune fille ensuite, posant la main sur l’épaule de son père, sauta légèrement toute seule. Le garçon aux cheveux jaunes était descendu en mettant un pied sur la roue et il aida M. Dufour à décharger la grand-mère.
Alors on détela le cheval qui fut attaché à un arbre ; et la voiture tomba sur le nez, les deux brancards à terre. Les hommes, ayant retiré leurs redingotes, se lavèrent les mains dans un seau d’eau, puis rejoignirent leurs dames installées déjà sur les escarpolettes.
Mlle Dufour essayait de se balancer debout, toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C’était une belle fille de dix-huit à vingt ans ; une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d’un désir subit et vous laisse jusqu’à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement des sens. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair qu’accentuaient encore les efforts des reins qu’elle faisait pour s’enlever.
Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête, de sorte que sa poitrine se dressait, sans une secousse, à chaque impulsion qu’elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle ; et l’escarpolette peu à peu se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu’au genou, et jetant à la figure des deux hommes qui la regardaient en riant, l’air de ses jupes, plus capiteux que les vapeurs du vin.
Assise sur l’autre balançoire, Mme Dufour gémissait d’une façon monotone et continue : « Cyprien, viens me pousser ; viens donc me pousser, Cyprien ! » À la fin, il y alla et, ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d’entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie.
Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d’être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes, secouées, tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais, comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays ; et, là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une garniture de têtes polissonnes que des rires faisaient grimacer diversement...."

EN FAMILLE
" Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour éviter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court ; et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d’une fin de journée d’été tombait sur la route d’où s’élevait, bien qu’aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons Des gens venaient sur leurs portes, cherchant de l’air.
Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l’intérieur (car on préférait, par ces jours chauds, l’impériale ou les plates-formes). C’étaient de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive ; des messieurs las du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d’argent, les anciennes espérances définitivement déçues ; car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoirs qui borde Paris.
Tout près de la portière, un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d’aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d’un vieux panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue ; c’était M. Caravan, commis principal au Ministère de la marine. L’autre, ancien officier de santé à bord d’un bâtiment de commerce, avait fini par s’établir au rond-point de Courbevoie où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité.
M. Caravan avait toujours mené l’existence normale des bureaucrates. Depuis trente ans, il venait invariablement à son bureau, chaque matin, par la même route, rencontrant, à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d’hommes allant à leurs affaires ; et il s’en retournait, chaque soir, par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu’il avait vus vieillir.
Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d’un sou à l’encoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses deux petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d’un coupable qui se constitue prisonnier ; et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d’inquiétude, dans l’attente éternelle d’une réprimande pour quelque négligence qu’il aurait pu commettre.
Rien n’était jamais venu modifier l’ordre monotone de son existence ; car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu’il fût au ministère, soit qu’il fût dans sa famille (car il avait épousé, sans dot, la fille d’un collègue), il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n’avait d’autres pensées, d’autres espoirs, d’autres rêves, que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d’employé : l’accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait à cause de leurs galons d’argent, aux emplois de sous-chef et de chef ; et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu’il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation.
Il était vieux maintenant, n’ayant point senti passer sa vie, car le collège, sans transition, avait été continué par le bureau, et les pions, devant qui il tremblait autrefois, étaient aujourd’hui remplacés par les chefs qu’il redoutait effroyablement. Le seuil de ces despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête ; et de cette continuelle épouvante il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégaiement nerveux.
Il ne connaissait pas plus Paris que ne le peut connaître un aveugle conduit par son chien, chaque jour, sous la même porte ; et s’il lisait dans son journal d’un sou les événements et les scandales, il les percevait comme des contes fantaisistes inventés à plaisir pour distraire les petits employés. Homme d’ordre, réactionnaire sans parti déterminé, mais ennemi des « nouveautés », il passait les faits politiques que sa feuille, du reste, défigurait toujours pour les besoins payés d’une cause ; et quand il remontait tous les soirs l’avenue des Champs-Élysées, il considérait la foule houleuse des promeneurs et le flot roulant des équipages à la façon d’un voyageur dépaysé qui traverserait des contrées lointaines...."

SUR L’EAU - " J’avais loué, l’été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j’allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d’un de mes voisins, un homme de trente à quarante ans, qui était bien le type le plus curieux que j’eusse jamais vu. C’était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l’eau, toujours sur l’eau, toujours dans l’eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final.
Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s’anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible : la rivière.
Ah ! me dit-il, combien j’ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous ! Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce qu’est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c’est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l’on voit, la nuit, des choses qui ne sont pas, où l’on entend des bruits que l’on ne connaît point, où l’on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière : et c’est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l’on n’a point de tombeau.
La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l’ombre, quand il n’y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n’éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante c’est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer ; tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l’eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l’Océan.
Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d’immenses pays bleuâtres où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d’étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n’a que des profondeurs noires où l’on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu’elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent...."
LA VEILLEE
Un homme et une femme veillent une morte : leur mère. Apres avoir prié et pleuré, ils évoquent ensemble le souvenir de la disparue. Mais, à la lecture de quelques lettres découvertes dans un tiroir, ils apprennent avec stupeur que leur mère a eu un amant et qu`elle a trompé son mari avec cet homme. Très dignement, ils quittent la pièce...

1882 - Mademoiselle Fifi
« Mademoiselle Fifi » (1ère version Gil Blas, 23 mars 1882) - « La Bûche » (Gil Blas, 26 janvier 1882) - « Le Lit » (Gil Blas, 16 mars 1882) - « Un réveillon » (Gil Blas, 5 janvier 1882) - « Mots d'amour » (sous le titre « Les Mots d'amour », Gil Blas, 2 février 1882) Une aventure parisienne » (sous le titre « Une épreuve », Gil Blas, 22 décembre 1881) - « Marroca » (sous le titre « Marauca », Gil Blas, 2 mars 1882) - « Madame Baptiste » (Gil Blas, 28 novembre 1882) - « La Rouille » (sous le titre « Monsieur de Coutelier », Gil Blas, 14 septembre 1882) - « La Relique » (Gil Blas, 17 octobre 1882) - « Fou ? » (Gil Blas, 23 août 1882) - « Réveil » (Gil Blas, 20 février 1883) - « Une ruse » (Gil Blas, 25 septembre 1882) - « A cheval » (Le Gaulois, 14 janvier 1883) - « Deux amis » (Gil Blas, 5 février 1883) - « Le Voleur » (Gil Blas, 21 juin 1882) - « Nuit de Noël » (Gil Blas, 26 décembre 1882) - « Le Remplaçant » (sous le titre « Les Remplaçants », Gil Blas, 2 janvier 1883)
MADEMOISELLE FIFI
La nouvelle qui donne son titre au recueil, est une des plus connues de Maupassant. Le château d'Uville est occupé par cinq officiers prussiens. Parmi eux, «un tout petit blondin fier et brutal», surnommé Mademoiselle Fifi à cause de son allure féminine. Le saccage du luxueux château ne parvenant pas à tromper l'ennui, on décide d'organiser une petite fête avec des dames de Rouen. Elles arrivent, ces cinq «filles à plaisir», dont Rachel, «une brune toute jeune, à l'œil noir comme une tache d'encre». Elle échoit en partage à Mademoiselle Fifi, qui la brutalise, «saisi d'une férocité rageuse, travaillé par son besoin de ravage». Au moment des toasts, les Allemands insultent les Français vaincus, et surtout les Françaises, qu'ils déclarent toutes leur propriété. Rachel se révolte alors ….
UNE AVENTURE PARISIENNE
"Est-il un sentiment plus aigu que la curiosité chez la femme ? Oh ! savoir, connaître, toucher ce qu’on a rêvé ! Que ne ferait-elle pas pour cela ? Une femme, quand sa curiosité impatiente est en éveil, commettra toutes les folies, toutes les imprudences, aura toutes les audaces, ne reculera devant rien.
Je parle des femmes vraiment femmes, douées de cet esprit à triple fond qui semble, à la surface, raisonnable et froid, mais dont les trois compartiments secrets sont remplis : l’un d’inquiétude féminine toujours agitée ; l’autre, de ruse colorée en bonne foi, de cette ruse de dévots, sophistiquée et redoutable ; le dernier enfin, de canaillerie charmante, de tromperie exquise, de délicieuse perfidie, de toutes ces perverses qualités qui poussent au suicide les amants imbécilement crédules, mais ravissent les autres.
Celle dont je veux dire l’aventure était une petite provinciale, platement honnête jusque-là. Sa vie, calme en apparence, s’écoulait dans son ménage, entre un mari très occupé et deux enfants, qu’elle élevait en femme irréprochable.
Mais son cœur frémissait d’une curiosité inassouvie, d’une démangeaison d’inconnu. Elle songeait à Paris, sans cesse, et lisait avidement les journaux mondains. Le récit des fêtes, des toilettes, des joies, faisait bouillonner ses désirs ; mais elle était surtout mystérieusement troublée par les échos pleins de sous-entendus, par les voiles à demi soulevés en des phrases habiles, et qui laissent entrevoir des horizons de jouissances coupables et ravageantes. De là-bas elle apercevait Paris dans une apothéose de luxe magnifique et corrompu.
Et pendant les longues nuits de rêve, bercée par le ronflement régulier de son mari qui dormait à ses côtés sur le dos, avec un foulard autour du crâne, elle songeait à ces hommes connus dont les noms apparaissent à la première page des journaux comme de grandes étoiles dans un ciel sombre ; et elle se figurait leur vie affolante, avec de continuelles
débauches, des orgies antiques épouvantablement voluptueuses et des raffinements de sensualité si compliqués qu’elle ne pouvait même se les figurer.
Les boulevards lui semblaient être une sorte de gouffre des passions humaines ; et toutes leurs maisons recelaient assurément des mystères d’amour, prodigieux. Elle se sentait vieillir cependant. Elle vieillissait sans avoir rien connu de la vie, sinon ces occupations régulières, odieusement monotones et banales qui constituent, dit-on, le bonheur du foyer. Elle était jolie encore, conservée dans cette existence tranquille comme un fruit d’hiver dans une armoire close ; mais rongée, ravagée, bouleversée d’ardeurs secrètes. Elle se demandait si elle mourrait sans avoir connu toutes ces ivresses damnantes, sans s’être jetée une fois, une seule fois, tout entière, dans ce flot des voluptés parisiennes.
Avec une longue persévérance, elle prépara un voyage à Paris, inventa un prétexte, se fit inviter par des parents, et, son mari ne pouvant l’accompagner, partit seule.
Sitôt arrivée, elle sut imaginer des raisons qui lui permettraient au besoin de s’absenter deux jours ou plutôt deux nuits, s’il le fallait, ayant retrouvé, disait-elle, des amis qui demeuraient dans la campagne suburbaine. Et elle chercha. Elle parcourut les boulevards sans rien voir, sinon le vice errant et numéroté. Elle sonda de l’œil les grands cafés, lut attentivement la petite correspondance du Figaro, qui lui apparaissait chaque matin comme un tocsin, un rappel de l’amour.
Et jamais rien ne la mettait sur la trace de ces grandes orgies d’artistes et d’actrices ; rien ne lui révélait les temples de ces débauches qu’elle imaginait fermés par un mot magique, comme la caverne des Mille et une Nuits et ces catacombes de Rome, où s’accomplissaient secrètement les mystères d’une religion persécutée.
Ses parents, petits bourgeois, ne pouvaient lui faire connaître aucun de ces hommes en vue dont les noms bourdonnaient dans sa tête ; et, désespérée, elle songeait à s’en retourner, quand le hasard vint à son aide...."

1882 - Contes divers
Pétition d'un viveur malgré lui - Le gâteau - Souvenir - Le saut du berger - Vieux objets - L'aveugle - Magnétisme - Conflits pour rire - En voyage - Un bandit corse - Rencontre - La veillée - Rêves - Autres temps - Confessions d'une femme - Clair de lune - Un drame vrai - Voyage de noce - Une passion - Correspondance - Un vieux - Un million - Le baiser - Ma femme - Rouerie - Yveline Samoris .
YVELINE SAMORIS -
"La comtesse Samoris.
– Cette dame en noir, là-bas ?
– Elle-même, elle porte le deuil de sa fille qu’elle a tuée.
– Allons donc ! Que me contez-vous là ?
– Une histoire toute simple, sans crime et sans violences.
– Alors quoi ?
– Presque rien. Beaucoup de courtisanes étaient nées pour être des honnêtes femmes, dit-on ; et beaucoup de femmes dites honnêtes pour être courtisanes, n’est-ce pas ? Or, Mme Samoris, née courtisane, avait une fille née honnête femme, voilà tout.
– Je comprends mal.
– Je m’explique :
La comtesse Samoris est une de ces étrangères à clinquant comme il en pleut des centaines sur Paris, chaque année. Comtesse hongroise ou valaque, ou je ne sais quoi, elle apparut un hiver dans un appartement des Champs-Élysées, ce quartier des aventuriers, et ouvrit ses salons au premier venant, et au premier venu. J’y allai. Pourquoi ? direz-vous. Je n’en sais trop rien. J’y allai comme nous y allons tous, parce qu’on y joue, parce que les femmes sont faciles et les hommes malhonnêtes. Vous connaissez ce monde de flibustiers à décorations variées, tous nobles, tous titrés, tous inconnus aux ambassades, à l’exception des espions. Tous parlent de l’honneur à propos de bottes, citent leurs ancêtres, racontent leur vie, hâbleurs, menteurs, filous, dangereux comme leurs cartes, trompeurs comme leurs noms, l’aristocratie du bagne enfin.
J’adore ces gens-là. Ils sont intéressants à pénétrer, intéressants à connaître, amusants à entendre, souvent spirituels, jamais banals comme des fonctionnaires publics. Leurs femmes sont toujours jolies, avec une petite saveur de coquinerie étrangère, avec le mystère de leur existence passée peut-être à moitié dans une maison de correction. Elles ont en général des yeux superbes et des cheveux invraisemblables. Je les adore aussi.
Mme Samoris est le type de ces aventurières, élégante, mûre et belle encore, charmeuse et féline ; on la sent vicieuse jusque dans les moelles. On s’amusait beaucoup chez elle, on y jouait, on y dansait, on y soupait… enfin on y faisait tout ce qui constitue les plaisirs de la vie mondaine. Et elle avait une fille, grande, magnifique, toujours joyeuse, toujours prête pour les fêtes, toujours riant à pleine bouche et dansant à corps perdu. Une vraie fille d’aventurière. Mais une innocente, une ignorante, une naïve, qui ne voyait rien, ne savait rien, ne comprenait rien, ne devinait rien de tout ce qui se passait dans la maison paternelle.
« Comment le savez-vous ? »
Comment je le sais ? C’est plus drôle que tout. On sonne un matin chez moi, et mon valet de chambre vint me prévenir que M. Joseph Bonenthal demande à me parler...."

1883 - Clair de lune
Clair de lune - Un coup d'Etat - Le loup - L'enfant - Conte de Noël - La reine Hortense - Le pardon - La légende du Mont Saint-Michel - Une veuve - Mademoiselle Cocotte - Les bijoux - Apparition - La porte - Le père - Moiron - Nos lettres - La nuit
CLAIR DE LUNE
"" Il portait bien son nom de bataille, l’abbé Marignan. C’était un grand prêtre maigre, fanatique, d’âme toujours exaltée, mais droite. Toutes ses croyances étaient fixes, sans jamais d’oscillations. Il s’imaginait sincèrement connaître son Dieu, pénétrer ses desseins, ses volontés, ses intentions.
Quand il se promenait à grands pas dans l’allée de son petit presbytère de campagne, quelquefois une interrogation se dressait dans son esprit : « Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? » Et il cherchait obstinément, prenant en sa pensée la place de Dieu, et il trouvait presque toujours. Ce n’est pas lui qui eût murmuré dans un élan de pieuse humilité : « Seigneur, vos desseins sont impénétrables ! » Il se disait : « Je suis le serviteur de Dieu je dois connaître ses raisons d’agir, et les deviner si je ne les connais pas. »
Tout lui paraissait créé dans la nature avec une logique absolue et admirable. Les « Pourquoi » et les « Parce que » se balançaient toujours. Les aurores étaient faites pour rendre joyeux les réveils, les jours pour mûrir les moissons, les pluies pour les arroser, les soirs pour préparer au sommeil et les nuits sombres pour dormir.
Les quatre saisons correspondaient parfaitement à tous les besoins de l’agriculture ; et jamais le soupçon n’aurait pu venir au prêtre que la nature n’a point d’intentions et que tout ce qui vit s’est plié, au contraire, aux dures nécessités des époques, des climats et de la matière.
Mais il haïssait la femme, il la haïssait inconsciemment, et la méprisait par instinct. Il répétait souvent la parole du Christ : « Femme, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ? » et il ajoutait : « On disait que Dieu lui-même se sentait mécontent de cette œuvre-là. » La femme était bien pour lui l’enfant douze fois impure dont parle le poète. Elle était le tentateur qui avait entraîné le premier homme et qui continuait toujours son œuvre de damnation, l’être faible, dangereux, mystérieusement troublant. Et plus encore que leur corps de perdition, il haïssait leur âme aimante. Souvent il avait senti leur tendresse attachée à lui et, bien qu’il se sût inattaquable, il s’exaspérait de ce besoin d’aimer qui frémissait toujours en elles. Dieu, à son avis, n’avait créé la femme que pour tenter l’homme et l’éprouver. Il ne fallait approcher d’elle qu’avec des précautions défensives, et les craintes qu’on a des pièges. Elle était, en effet, toute pareille à un piège avec ses bras tendus et ses lèvres ouvertes vers l’homme...."
L'abbé Marignan, curé de campagne aux mœurs sévères et d'une austérité farouche, apprend avec une violente indignation que sa nièce a un amoureux. Un soir, il sort dans l'intention de surprendre les deux jeunes gens dans leur promenade romantique, mais la vue d'un merveilleux clair de lune, emplissant la nuit d'un charme poétique incomparable et qui semble répandre sur la campagne endormie d'amoureux effluves, apaise sa colère et incline son âme à une indulgente compréhension.
" Tout le jour, il demeura muet, gonflé d’indignation et de colère. À sa fureur de prêtre, devant l’invincible amour, s’ajoutait une exaspération de père moral, de tuteur, de chargé d’âme, trompé, volé, joué par une enfant ; cette suffocation égoïste des parents à qui leur fille annonce qu’elle a fait, sans eux et malgré eux, choix d’un époux.
Après son dîner, il essaya de lire un peu, mais il ne put y parvenir ; et il s’exaspérait de plus en plus. Quand dix heures sonnèrent, il prit sa canne, un formidable bâton de chêne dont il se servait toujours en ses courses nocturnes, quand il allait voir quelque malade. Et il regarda en souriant l’énorme gourdin qu’il faisait tourner, dans sa poigne solide de campagnard, en des moulinets menaçants. Puis, soudain, il le leva, et, grinçant des dents, l’abattit sur une chaise dont le dossier fendu tomba sur le plancher.
Et il ouvrit sa porte pour sortir ; mais il s’arrêta sur le seuil, surpris par une splendeur de clair de lune telle qu’on n’en voyait presque jamais. Et comme il était doué d’un esprit exalté, un de ces esprits que devaient avoir les Pères de l’Église, ces poètes rêveurs, il se sentit soudain distrait, ému par la grandiose et sereine beauté de la nuit pâle.
Dans son petit jardin, tout baigné de douce lumière, ses arbres fruitiers, rangés en ligne, dessinaient en ombre sur l’allée leurs grêles membres de bois à peine vêtus de verdure ; tandis que le chèvrefeuille géant, grimpé sur le mur de sa maison, exhalait des souffles délicieux et comme sucrés, faisait flotter dans le soir tiède et clair une espèce d’âme parfumée. Il se mit à respirer longuement, buvant de l’air comme les ivrognes boivent du vin, et il allait à pas lents, ravi, émerveillé, oubliant presque sa nièce.
Dès qu’il fut dans la campagne, il s’arrêta pour contempler toute la plaine inondée de cette lueur caressante, noyée dans ce charme tendre et languissant des nuits sereines. Les crapauds à tout instant jetaient par l’espace leur note courte et métallique, et des rossignols lointains mêlaient leur musique égrenée qui fait rêver sans faire penser, leur musique légère et vibrante, faite pour les baisers, à la séduction du clair de lune.
L’abbé se remit à marcher, le cœur défaillant, sans qu’il sût pourquoi. Il se sentait comme affaibli, épuisé tout à coup ; il avait une envie de s’asseoir, de rester là, de contempler, d’admirer Dieu dans son œuvre...."

1883 - Contes de la Bécasse
« La Bécasse » (Le Gaulois, 5 décembre 1882) - « Ce cochon de Morin » (Gil Blas, 21 novembre 1882) - « La Folle » (Le Gaulois, 5 décembre 1882) - « Pierrot » (Le Gaulois, 9 octobre 1882) - « Menuet » (Le Gaulois, 20 novembre 1882) - « La Peur » (Le Gaulois, 23 octobre 1882) - « Farce normande » (Gil Blas, 8 août 1882) - « Les Sabots » (Gil Blas, 21 janvier 1883) - « La Rempailleuse » (Le Gaulois, 1er septembre 1882) - « En mer » (Gil Blas, 12 février 1883) - « Un Normand » (Gil Blas, 10 octobre 1882) - « Le Testament » (Gil Blas, 7 novembre 1882) - « Aux champs » (Le Gaulois, 31 octobre 1882) - « Un coq chanta » (Gil Blas, 5 juillet 1882) - « Un fils » (sous le titre « Père inconnu », Gil Blas, 19 avril 1882) - « Saint Antoine » (Gil Blas, 3 avril 1883) - « L'Aventure de Walter Schnaffs » (Le Gaulois, 11 avril 1883)
Un des recueils de contes les plus connus de Maupassant, dans lequel la farce est très présente, une farce souvent cruelle (comme la chasse qui est un thème important de ces contes), illustrant «les fortes brutalités" de la nature ou des hommes.
A priori, l’œuvre peut sembler n’être qu’un assemblage sans cohérence de textes. De chasse, il est peu question. On songe pourtant aux Mémoires d’un chasseur de Tourguéniev que Maupassant connaissait et admirait. Surtout, le récit liminaire met en scène un vieux chasseur auquel ses amis viennent raconter différentes histoires. La Normandie – pays de Caux et pays d’Auge – en constituera le cadre essentiel. Ainsi, d’un récit à l’autre, une ligne se dessine. Celle des peurs et des obsessions de Maupassant – angoisses de la mort et de la folie, de la sexualité et d’un monde âpre, dur, difficile aux humbles, à ceux qui méritent compassion ou pitié même lorsqu’ils se révèlent insupportables ou ridicules. Dans «Ce cochon de Morin», est contée l'histoire d'un mercier arrêté pour outrage aux bonnes mœurs après avoir embrassé de force une jeune fille dans un train. Dans «Aux champs», deux familles de paysans pauvres, les Tuvache et les Vallin, vivent côte à côte et élèvent ensemble leurs enfants. Un jour, un riche couple de citadins propose d'abord aux Tuvache, puis aux Vallin, d'adopter l'un de leurs fils moyennant dédommagement financier. Les Tuvache refusent ; les Vallin acceptent...

1883 – Une Vie
"La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit". - Le premier roman de Maupassant raconte l'histoire de Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme sensible et romanesque, depuis sa sortie du couvent. Accablée par un mariage malheureux (le vicomte Julien de Lamare qu'elle a épousé se révèle rapidement volage et calculateur), ayant perdu un à un tous ses proches (son époux est assassiné par un mari jaloux, elle élève seule son fils qui à dix-huit ans s'enfuit en Angleterre et la ruine), Jeanne fait, au terme de son existence, le bilan d'une vie qui ne lui laisse que regrets et amertume. La mort de ses parents la conduit au bord de la folie que seuls la fidélité de sa bonne et les quelques souvenirs des jours heureux parviennent à endiguer.
"On se taisait ; les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d’un oeil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu’une plante enfermée qu’on vient de remettre à l’air ; et l’épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son coeur de la tristesse. Bien qu’elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au-dehors sa main pour l’emplir d’eau qu’elle boirait ; et elle jouissait d’être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages, et de se sentir à l’abri au milieu de cette inondation.
Et, sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des deux bêtes exhalaient une buée d’eau bouillante. La baronne, peu à peu, s’endormait. Sa figure, qu’encadraient six boudins réguliers de cheveux pendillants, s’affaissa peu à peu, mollement soutenue par les trois grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite ; les joues s’enflaient, tandis que, entre ses lèvres entrouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle, et posa doucement, dans ses mains croisées sur l’ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla ; et elle considéra l’objet d’un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s’ouvrit. De l’or et des billets de banque s’éparpillèrent dans la calèche..."

1884 - Miss Harriet
« Miss Harriet » (sous le titre « Miss Hastings », Le Gaulois, 9 juillet 1883) - « L'Héritage » (La Vie militaire illustrée, du 15 mars au 26 avril 1884) - « Denis » (Le Gaulois, 2 juin 1883) - « L'Âne » (sous le titre « Le Bon Jour », Le Gaulois, 15 juillet 1883) - « Idylle » (Gil Blas, 12 février 1884) - « La Ficelle » (Le Gaulois, 25 novembre 1883) - « Garçon, un bock !... » (Gil Blas, 1er janvier 1884) - « Le Baptême » (Le Gaulois, 13 janvier 1885) - « Regret » (Le Gaulois, 4 novembre 1883) - « Mon oncle Jules » (Le Gaulois, 7 août 1883) - « En voyage » (Le Gaulois, 10 mai 1883) - « La Mère Sauvage » (Le Gaulois, 3 mars 1884)
MISS HARRIET
Dans "Miss Harriet", le personnage principal est une vieille fille anglaise excentrique qui vit en maison d'hôte sur la côte normande. Le narrateur, un peintre talentueux, fait sa connaissance et l'observe avec une tendresse amusée. Elle se prend pour lui d'une passion secrète dont la révélation aura des conséquences tragiques, elle finira par se suicider ...
L'école naturaliste dans toute son expression...
L'HERITAGE
"Bien qu’il ne fût pas encore dix heures, les employés arrivaient comme un flot sous la grande porte du Ministère de la marine, venus en hâte de tous les coins de Paris, car on approchait du jour de l’an, époque de zèle et d’avancements. Un bruit de pas pressés emplissait le vaste bâtiment tortueux comme un labyrinthe et que sillonnaient d’inextricables couloirs, percés par d’innombrables portes donnant entrée dans les bureaux.
Chacun pénétrait dans sa case, serrait la main du collègue arrivé déjà, enlevait sa jaquette, passait le vieux vêtement de travail et s’asseyait devant sa table où des papiers entassés l’attendaient. Puis on allait aux nouvelles dans les bureaux voisins. On s’informait d’abord si le chef était là, s’il avait l’air bien luné, si le courrier du jour était volumineux.
Le commis d’ordre du « matériel général », M. César Cachelin, un ancien sous-officier d’infanterie de marine, devenu commis principal par la force du temps, enregistrait sur un grand livre toutes les pièces que venait d’apporter l’huissier du cabinet. En face de lui l’expéditionnaire, le père Savon, un vieil abruti célèbre dans tout le ministère par ses malheurs conjugaux, transcrivait, d’une main lente, une dépêche du chef, et s’appliquait, le corps de côté, l’œil oblique, dans une posture roide de copiste méticuleux.
M. Cachelin, un gros homme dont les cheveux blancs et courts se dressaient en brosse sur le crâne, parlait tout en accomplissant sa besogne quotidienne : « Trente-deux dépêches de Toulon. Ce port-là nous en donne autant que les quatre autres réunis. » Puis il posa au père Savon la question qu’il lui adressait tous les matins : « Eh bien ! mon père Savon, comment va madame ? »
Le vieux, sans interrompre sa besogne, répondit : « Vous savez bien, monsieur Cachelin, que ce sujet m’est fort pénible. »
Et le commis d’ordre se mit à rire, comme il riait tous les jours, en entendant cette même phrase. La porte s’ouvrit et M. Maze entra. C’était un beau garçon brun, vêtu avec une élégance exagérée, et qui se jugeait déclassé, estimant son physique et ses manières au-dessus de sa position. Il portait de grosses bagues, une grosse chaîne de montre, un monocle, par chic, car il l’enlevait pour travailler, et il avait un fréquent mouvement des poignets pour mettre bien en vue ses manchettes ornées de gros boutons luisants.
Il demanda, dès la porte : « Beaucoup de besogne aujourd’hui ? » M. Cachelin répondit : « C’est toujours Toulon qui donne. On voit bien que le jour de l’an approche ; ils font du zèle, là-bas. » ...
... Une histoire où tout est sordide, calcul sordide, commérages, mesquineries, la petite bourgeoisie, en résumé. Un petit bourgeois, Cachelin. vieux plumitif, veut marier sa fille à un sien collegue. Malgré sa condition modeste. la jeune fille n`en est pas moins un appât véritable : quelque petit million de dot promis par sa maniaque de tante dont le passé fut orageux. L'affaire est vite conclue. Hélas, à la mort de la tante on apprend que le testament comporte une certaine clause, laquelle n`a point été respectée par les époux : en effet, pour hériter du million, il faut que la famille en question ait un enfant dans le cours des trois premières années de mariage. La jeune femme et son père, en accord avec l`époux, dénoueront la situation en recourant aux bons offices d'une personne de connaissance...
DENIS
M. Marambot, homme aisé, ex-pharmacien de village, risque d`être victime de son fidéle serviteur, Denis, pris d'un subit accès de folie homicide ; mais bientôt le jeune homme, repentant, soigne les blessures qu`il a lui-même causées et devient pour son patron le plus précieux des domestiques, méritant ainsi son pardon dans toute la force du terme. Peu de temps après, cependant, une autre affaire fait connaitre l`incident aux gendarmes : Denis finit en cour d'assises en dépit des protestations de son patron; comme on demande à ce dernier pourquoi il ne s`est pas défait d`un individu aussi dangereux, il se justifie en balbutiant qu'au jour d'aujourd`hui, il n`est pas si facile de trouver de bons serviteurs!
MON ONCLE JULES
" ... Jersey est l’idéal du voyage pour les gens pauvres. Ce n’est pas loin ; on passe la mer dans un paquebot et on est en terre étrangère, cet îlot appartenant aux Anglais. Donc, un Français, avec deux heures de navigation, peut s’offrir la vue d’un peuple voisin chez lui et étudier les mœurs, déplorables d’ailleurs, de cette île couverte par le pavillon britannique, comme disent les gens qui parlent avec simplicité.
Ce voyage de Jersey devint notre préoccupation, notre unique attente, notre rêve de tous les instants. On partit enfin. Je vois cela comme si c’était d’hier : le vapeur chauffant contre le quai de Granville ; mon père, effaré, surveillant l’embarquement de nos trois colis ; ma mère inquiète ayant pris le bras de ma sœur non mariée, qui semblait perdue depuis le départ de l’autre, comme un poulet resté seul de sa couvée ; et, derrière nous, les nouveaux époux qui restaient toujours en arrière, ce qui me faisait souvent tourner la tête.
Le bâtiment siffla. Nous voici montés, et le navire, quittant la jetée, s’éloigna sur une mer plate comme une table de marbre vert. Nous regardions les côtes s’enfuir, heureux et fiers comme tous ceux qui voyagent peu.
Mon père tendait son ventre, sous sa redingote dont on avait, le matin même, effacé avec soin toutes les taches, et il répandait autour de lui cette odeur de benzine des jours de sortie, qui me faisait reconnaître les dimanches. Tout à coup, il avisa deux dames élégantes à qui deux messieurs offraient des huîtres. Un vieux matelot déguenillé ouvrait d’un coup de couteau les coquilles et les passait aux messieurs qui les tendaient ensuite aux dames. Elles mangeaient d’une manière délicate, en tenant l’écaille sur un mouchoir fin et en avançant la bouche pour ne point tacher leurs robes. Puis elles buvaient l’eau d’un petit mouvement rapide et jetaient la coquille à la mer.
Mon père, sans doute, fut séduit par cet acte distingué de manger des huîtres sur un navire en marche. Il trouva cela bon genre, raffiné, supérieur, et il s’approcha de ma mère et de mes sœurs en demandant :
– Voulez-vous que je vous offre quelques huîtres ?
Ma mère hésitait, à cause de la dépense ; mais mes deux sœurs acceptèrent tout de suite. Ma mère dit, d’un ton contrarié :
– J’ai peur de me faire mal à l’estomac. Offre ça aux enfants seulement, mais pas trop, tu les rendrais malades.
Puis, se tournant vers moi, elle ajouta :
– Quant à joseph, il n’en a pas besoin ; il ne faut point gâter les garçons.
Je restai donc à côté de ma mère, trouvant injuste cette distinction. Je suivais de l’œil mon père, qui conduisait pompeusement ses deux filles et son gendre vers le vieux matelot déguenillé.
Les deux dames venaient de partir, et mon père indiquait à mes sœurs comment il fallait s’y prendre pour manger sans lais ser couler l’eau ; il voulut même donner l’exemple et il s’empara d’une huître. En essayant d’imiter les dames, il renversa immédiatement tout le liquide sur sa redingote et j’entendis ma mère murmurer :
– Il ferait mieux de se tenir tranquille.
Mais tout à coup mon père me parut inquiet ; il s’éloigna de quelques pas, regarda fixement sa famille pressée autour de l’écailleur, et, brusquement, il vint vers nous. Il me sembla fort pâle, avec des yeux singuliers. Il dit, à mi-voix, à ma mère.
– C’est extraordinaire, comme cet homme qui ouvre les huîtres ressemble à Jules.
Ma mère, interdite, demanda :
– Quel Jules ?…
Mon père reprit :
– Mais… mon frère… Si je ne le savais pas en bonne position en Amérique, je croirais que c’est lui.
Ma mère effarée balbutia :
– Tu es fou ! Du moment que tu sais bien que ce n’est pas lui, pourquoi dire ces bêtises-là ?
– Va donc le voir, Clarisse ; j’aime mieux que tu t’en assures toi-même, de tes propres yeux.
Elle se leva et alla rejoindre ses filles. Moi aussi, je regardais l’homme. Il était vieux, sale, tout ridé, et ne détournait pas le regard de sa besogne. Ma mère revint. Je m’aperçus qu’elle tremblait. Elle prononça très vite :
– Je crois que c’est lui. Va donc demander des renseignements au capitaine. Surtout sois prudent, pour que ce garnement ne nous retombe pas sur les bras, maintenant !
Mon père s’éloigna, mais je le suivis. Je me sentais étrangement ému.
Le capitaine, un grand monsieur, maigre, à longs favoris, se promenait sur la passerelle d’un air important, comme s’il eût commandé le courrier des Indes. Mon père l’aborda avec cérémonie, en l’interrogeant sur son métier avec accompagnement de compliments :
Quelle était l’importance de Jersey ? Ses productions ? Sa population ? Ses mœurs ? Ses coutumes ? La nature du sol, etc., etc.
On eût cru qu’il s’agissait au moins des États-Unis d’Amérique.
Puis on parla du bâtiment qui nous portait, l’Express, puis on en vint à l’équipage. Mon père, enfin, d’une voix troublée :
– Vous avez là un vieil écailleur d’huîtres qui parait bien intéressant. Savez-vous quelques détails sur ce bonhomme ?
Le capitaine, que cette conversation finissait par irriter, répondit sèchement :
– C’est un vieux vagabond français que j’ai trouvé en Amérique l’an dernier, et que j’ai rapatrié. Il a, parait-il, des parents au Havre, mais il ne veut pas retourner près d’eux, parce qu’il leur doit de l’argent. Il s’appelle Jules… Jules Darmanche ou Darvanche, quelque chose comme ça, enfin. Il parait qu’il a été riche un moment là-bas, mais vous voyez où il en est réduit maintenant.
Mon père, qui devenait livide, articula, la gorge serrée, les yeux hagards :
– Ah’ ah, très bien… fort bien… Cela ne m’étonne pas… Je vous remercie beaucoup, capitaine.
Et il s’en alla, tandis que le marin le regardait s’éloigner avec stupeur.
Il revint auprès de ma mère, tellement décomposé qu’elle lui dit :
– Assieds-toi ; on va s’apercevoir de quelque chose.
Il tomba sur le banc en bégayant :
– C’est lui, c’est bien lui !
Puis il demanda.
– Qu’allons-nous faire ?…"

1884 - Yvette
Yvette ( Le Figaro du 29 août au 9 septembre 1884) - Le retour - L'abandonné - Les idées du colonel - Promenade - Mohammed-Fripouille - Le garde - Berthe -
YVETTE
" En sortant du Café Riche, Jean de Servigny dit à Léon Saval :
– Si tu veux, nous irons à pied. Le temps est trop beau pour prendre un fiacre.
Et son ami répondit :
– Je ne demande pas mieux.
Jean reprit :
– Il est à peine onze heures, nous arriverons beaucoup avant minuit, allons donc doucement.
Une cohue agitée grouillait sur le boulevard, cette foule des nuits d’été qui remue, boit, murmure et coule comme un fleuve, pleine de bien-être et de joie. De place en place, un café jetait une grande clarté sur le tas de buveurs assis sur le trottoir devant les petites tables couvertes de bouteilles et de verres, encombrant le passage de leur foule pressée. Et sur la chaussée, les fiacres aux yeux rouges, bleus ou verts, passaient brusquement dans la lueur vive de la devanture illuminée, montrant une seconde la silhouette maigre et trottinante du cheval, le profil élevé du cocher, et le coffre sombre de la voiture. Ceux de l’Urbaine faisaient des taches claires et rapides avec leurs panneaux jaunes frappés par la lumière.
Les deux amis marchaient d’un pas lent, un cigare à la bouche, en habit, le pardessus sur le bras, une fleur à la boutonnière et le chapeau un peu sur le côté comme on le porte quelquefois, par nonchalance, quand on a bien dîné et quand la brise est tiède. Ils étaient liés depuis le collège par une affection étroite, dévouée, solide.
Jean de Servigny, petit, svelte, un peu chauve, un peu frêle, très élégant, la moustache frisée, les yeux clairs, la lèvre fine, était un de ces hommes de nuit qui semblent nés et grandis sur le boulevard, infatigable bien qu’il eût toujours l’air exténué, vigoureux bien que pâle, un de ces minces Parisiens en qui le gymnase, l’escrime, les douches et l’étuve ont mis une force nerveuse et factice. Il était connu par ses noces autant que par son esprit, par sa fortune, par ses relations, par cette sociabilité, cette amabilité, cette galanterie mondaine, spéciales à certains hommes.
Vrai Parisien, d’ailleurs, léger, sceptique, changeant, entraînable, énergique et irrésolu, capable de tout et de rien, égoïste par principe et généreux par élans, il mangeait ses rentes avec modération et s’amusait avec hygiène. Indifférent et passionné, il se laissait aller et se reprenait sans cesse, combattu par des instincts contraires et cédant à tous pour obéir, en définitive, à sa raison de viveur dégourdi dont la logique de girouette consistait à suivre le vent et à tirer profit des circonstances sans prendre la peine de les faire naître.
Son compagnon Léon Saval, riche aussi, était un de ces superbes colosses qui font se retourner les femmes dans les rues. Il donnait l’idée d’un monument fait homme, d’un type de la race, comme ces objets modèles qu’on envoie aux expositions. Trop beau, trop grand, trop large, trop fort, il péchait un peu par excès de tout, par excès de qualités. Il avait fait d’innombrables passions.
Il demanda, comme ils arrivaient devant le Vaudeville :
– As-tu prévenu cette dame que tu allais me présenter chez elle ?
Servigny se mit à rire.
– Prévenir la marquise Obardi ! Fais-tu prévenir un cocher d’omnibus que tu monteras dans sa voiture au coin du boulevard ?
Saval, alors, un peu perplexe, demanda :
– Qu’est-ce donc au juste que cette personne ?
Et son ami répondit :
– Une parvenue, une rastaquouère, une drôlesse charmante, sortie on ne sait d’où, apparue un jour, on ne sait comment, dans le monde des aventuriers, et sachant y faire figure.
Que nous importe d’ailleurs. On dit que son vrai nom, son nom de fille, car elle est restée fille à tous les titres, sauf au titre innocence, est Octavie Bardin, d’où Obardi, en conservant la première lettre du prénom et en supprimant la dernière du nom. C’est d’ailleurs une aimable femme, dont tu seras inévitablement l’amant, toi, de par ton physique. On n’introduit pas Hercule chez Messaline, sans qu’il se produise quelque chose.
J’ajoute cependant que si l’entrée est libre en cette demeure, comme dans les bazars, on n’est pas strictement forcé d’acheter ce qui se débite dans la maison. On y tient l’amour et les cartes, mais on ne vous contraint ni à l’un ni aux autres. La sortie aussi est libre.
Elle s’installa dans le quartier de l’Étoile, quartier suspect, voici trois ans, et ouvrit ses salons à cette écume des continents qui vient exercer à Paris ses talents divers, redoutables et criminels.
J’allai chez elle ! Comment ? Je ne le sais plus. J’y allai, comme nous allons tous là-dedans, parce qu’on y joue, parce que les femmes sont faciles et les hommes malhonnêtes. J’aime ce monde de flibustiers à décorations variées, tous étrangers, tous nobles, tous titrés, tous inconnus à leurs ambassades, à l’exception des espions. Tous parlent de l’honneur à propos de bottes, citent leurs ancêtres à propos de rien, racontent leur vie à propos de tout, hâbleurs, menteurs, filous, dangereux comme leurs cartes, trompeurs comme leurs noms, braves parce qu’il le faut, à la façon des assassins qui ne peuvent dépouiller les gens qu’à la condition d’exposer leur vie. C’est l’aristocratie du bagne, enfin.
Je les adore. Ils sont intéressants à pénétrer, intéressants à connaître, amusants à entendre, souvent spirituels, jamais banals comme des fonctionnaires français. Leurs femmes sont toujours jolies, avec une petite saveur de coquinerie étrangère, avec le mystère de leur existence passée, passée peut-être à moitié dans une maison de correction. Elles ont en général des yeux superbes et des cheveux incomparables, le vrai physique de l’emploi, une grâce qui grise, une séduction qui pousse aux folies, un charme malsain, irrésistible ! Ce sont des conquérantes à la façon des routiers d’autrefois, des rapaces, de vraies femelles d’oiseaux de proie. Je les adore aussi...."

1885 - Contes du jour et de la nuit
« Le Crime au Père Boniface » (Gil Blas, 24 juin 1884) - « Rose » (Gil Blas, 19 janvier 1884) - « Le Père » (Gil Blas, 20 novembre 1883) - « L'Aveu » (Gil Blas, 22 juillet 1884) - « La Parure » (Le Gaulois, 17 février 1884) - « Le Bonheur » (Le Gaulois, 21 janvier 1884) - « Le Vieux » (Le Gaulois, 6 janvier 1884) - « Un lâche » (sous le titre « Un lâche ? », Le Gaulois, 27 janvier 1884) - « L'Ivrogne » (Le Gaulois, 20 avril 1884) -« Une vendetta » (Le Gaulois, 14 octobre 1884) - « Coco » (Le Gaulois, 21 janvier 1884) - « La Main » (Le Gaulois, 23 décembre 1883) - « Le Gueux » (Le Gaulois, 9 mars 1884) - « Un parricide » (Le Gaulois, 25 septembre 1885) - « Le Petit » (Le Gaulois, 19 août 1883) - « La Roche aux guillemots » (Le Gaulois, 14 avril 1882) - « Tombouctou » (Le Gaulois, 2 août 1883) - « Histoire vraie » (Le Gaulois, 18 juin 1882) - « Adieu » (Gil Blas, 18 mars 1884) - « Souvenir » (Gil Blas, 20 mai 1884) - « La Confession » (Le Gaulois, 21 octobre 1883).
LA PARURE
Dans "La parure" (1884), madame Loisel est la femme d'un petit fonctionnaire qu'elle a épousé faute de mieux. Elle rêve d'une vie moins morne, plus frivole. Elle emprunte la parure de diamants de son amie de pension pour une soirée au ministère. Mais à l'issue de cette soirée mémorable, le collier a disparu. Elle ne dit rien et va s'endetter de longues années pour acheter une parure semblable. Bien plus tard, son amie lui avouera que le collier était faux.
" C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun moyen d’être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué ; et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l’instruction publique.
Elle fut simple ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée ; car les femmes n’ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d’élégance, leur souplesse d’esprit, sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames.
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l’usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l’indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culotte courte qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l’attention.
Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air enchanté : « Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela… » elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges au milieu d’une forêt de féerie ; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d’une truite ou des ailes de gélinotte.
Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n’aimait que cela ; elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse.
Or, un soir, son mari rentra, l’air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe.
– Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi.
Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots : « Le ministre de l’instruction publique et Mme Georges Ramponneau prient M. et Mme Loisel de leur faire l’honneur de venir passer la soirée à l’hôtel du ministère, le lundi 18 janvier. »
Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle jeta avec dépit l’invitation sur la table, murmurant :
– Que veux-tu que je fasse de cela ?
– Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c’est une occasion, cela, une belle ! J’ai eu une peine infinie à l’obtenir. Tout le monde en veut ; c’est très recherché et on n’en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel.
Elle le regardait d’un œil irrité, et elle déclara avec impatience :
– Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?
Il n’y avait pas songé ..."
LE PERE
"Comme il habitait les Batignolles, étant employé au ministère de l’instruction publique, il prenait chaque matin l’omnibus, pour se rendre à son bureau. Et chaque matin il voyageait jusqu’au centre de Paris, en face d’une jeune fille dont il devint amoureux.
Elle allait à son magasin, tous les jours, à la même heure.
C’était une petite brunette, de ces brunes dont les yeux sont si noirs qu’ils ont l’air de taches, et dont le teint à des reflets d’ivoire. Il la voyait apparaître toujours au coin de la même rue ; et elle se mettait à courir pour rattraper la lourde voiture. Elle courait d’un petit air pressé, souple et gracieux ; et elle sautait sur le marche-pied avant que les chevaux fussent tout à fait arrêtés. Puis elle pénétrait dans l’intérieur en soufflant un peu, et, s’étant assise, jetait un regard autour d’elle.
La première fois qu’il la vit, François Tessier sentit que cette figure-là lui plaisait infiniment. On rencontre parfois de ces femmes qu’on a envie de serrer éperdument dans ses bras, tout de suite, sans les connaître. Elle répondait, cette jeune fille, à ses désirs intimes, à ses attentes secrètes, à cette sorte d’idéal d’amour qu’on porte, sans le savoir, au fond du cœur. Il la regardait obstinément, malgré lui. Gênée par cette contemplation, elle rougit. Il s’en aperçut et voulut détourner les yeux ; mais il les ramenait à tout moment sur elle, quoiqu’il s’efforçât de les fixer ailleurs.
Au bout de quelques jours, ils se connurent sans s’être parlé. Il lui cédait sa place quand la voiture était pleine et montait sur l’impériale, bien que cela le désolât. Elle le saluait maintenant d’un petit sourire ; et, quoiqu’elle baissât toujours les yeux sous son regard qu’elle sentait trop vif, elle ne semblait plus fâchée d’être contemplée ainsi.
Ils finirent par causer. Une sorte d’intimité rapide s’établit entre eux, une intimité d’une demi-heure par jour. Et c’était là, certes, la plus charmante demi-heure de sa vie à lui. Il pensait à elle tout le reste du temps, la revoyait sans cesse pendant les longues séances du bureau, hanté, possédé, envahi par cette image flottante et tenace qu’un visage de femme aimée laisse en nous. Il lui semblait que la possession entière de cette petite personne serait pour lui un bonheur fou, presque au-dessus des réalisations humaines.
Chaque matin maintenant elle lui donnait une poignée de main, et il gardait jusqu’au soir la sensation de ce contact, le souvenir dans sa chair de la faible pression de ces petits doigts ; il lui semblait qu’il en avait conservé l’empreinte sur sa peau. Il attendait anxieusement pendant tout le reste du temps ce court voyage en omnibus. Et les dimanches lui semblaient navrants.
Elle aussi l’aimait, sans doute, car elle accepta, un samedi de printemps, d’aller déjeuner avec lui, à Maisons-Laffitte, le lendemain...."
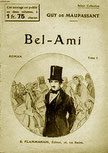
1885 – Bel Ami
Bel-Ami est l’histoire de l'irrésistible ascension sociale d'un journaliste cynique et beau garçon, auquel une série de succès féminins permettent de réaliser ses ambitions sociales. Georges Duroy, revenu d'Afrique du nord, se rend à Paris dans l'espoir de réussir et faire fortune. Il se fait embaucher au journal la Vie française, où il est rédacteur. Duroy plait aux femmes et se sert de ses atouts de séduction pour assurer l'ascension sociale à laquelle il aspire...
Ce roman connut un grand succès et fit scandale; Maupassant fut accusé de pessimisme outrancier, lui se contentant de répondre qu'il s'était borné à faire une satire d'un "certain journalisme" et de "certains" milieux politiques et mondains de Paris. Une oeuvre marquante dans la production littéraire de l'époque..
" Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d’ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d’un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon, qui s’étendent comme des coups d’épervier.
Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d’un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d’une robe de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette gargote à prix fixe.
Lorsqu’il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu’il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour finir le mois.
Cela représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. C’était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Il marchait ainsi qu’au temps où il portait l’uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entrouvertes comme s’il venait de descendre de cheval ; et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l’oreille son chapeau à haute forme
assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l’air de toujours défier quelqu’un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beau soldat tombé dans le civil.
Quoique habillé d’un complet de soixante francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d’un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d’une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires.
C’était une de ces soirées d’été où l’air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces.
Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d’un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main.
Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s’arrêta encore, indécis sur ce qu’il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l’avenue du bois de Boulogne pour trouver un peu d’air frais sous les arbres ; mais un désir aussi le travaillait, celui d’une rencontre amoureuse...."

Georges Duroy, de modeste origine et médiocrement instruit, mais à l'esprit résolu et prompt et, surtout, jeune et séduisant, vient tenter sa chance à Paris après avoir servi
quelque temps en Afrique comme sous-officier. Un métier de misère lui permet de vivoter, jusqu'à ce que la rencontre d'un ancien compagnon d'armes, Charles Forestier - qui s'est fait une brillante situation dans le journalisme -, lui offre l'aubaine tant attendue.
La femme de son ami, Madeleine, belle intrigante, l`aide à rédiger son premier article pour La Vie française. Cet article fait sa fortune. Duroy sait plaire au directeur du journal, le riche Walter, homme d'affaires particulièrement rusé, qui le charge de la Chronique et des Echos . Son audace va suppléer à son manque de culture. Mais c'est surtout aux femmes qu'il sait plaire. ".. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que, vraiment, l’ensemble était satisfaisant. Alors il s’étudia comme font les acteurs pour apprendre leurs rôles. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments : l’étonnement, le plaisir, l’approbation ; et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l’œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu’on les admire et qu’on les désire..."
Une jeune femme élégante et corrompue, Clotilde de Marelle, devient sa maîtresse; la femme et les filles de son patron sont également folles de lui. Un duel terminé à son avantage accroît encore son prestige. Toutes ces amitiés féminines aident puissamment Duroy, devenu désormais "Bel-Ami" : il doit ce surnom à la fille d'une de ses amies, séduite,
comme les autres, par son charme...
".. Quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu’il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d’aller devant lui en songeant à l’avenir et en respirant l’air doux de la nuit ; mais la pensée de la série d’articles demandés par le père Walter le poursuivait, et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail.
Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur, et le suivit jusqu’à la rue Boursault qu’il habitait. Sa maison, haute de six étages, était peuplée par vingt petits ménages ouvriers et bourgeois, et il éprouva en montant l’escalier, dont il éclairait avec des allumettes-bougies les marches sales où traînaient des bouts de papiers, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches, en des demeures propres, avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fosse d’aisances et d’humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieille muraille, qu’aucun courant d’air n’eût pu chasser de ce logis, l’emplissait du haut en bas.
La chambre du jeune homme, au cinquième étage, donnait, comme sur un abîme profond, sur l’immense tranchée du chemin de fer de l’Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s’accouda sur l’appui de fer rouillé.
Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, trois signaux rouges immobiles avaient l’air de gros yeux de bête ; et plus loin on en voyait d’autres, et encore d’autres, encore plus loin. À tout instant des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit, les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de là-bas, du côté d’Asnières. Ils avaient des modulations comme des appels de voix. Un d’eux se rapprochait, poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde en seconde, et bientôt une grosse lumière jaune apparut, courant avec un grand bruit ; et Duroy regarda le long chapelet des wagons s’engouffrer sous le tunnel.
Puis il se dit : « Allons, au travail ! » Il posa sa lumière sur sa table ; mais au moment de se mettre à écrire, il s’aperçut qu’il n’avait chez lui qu’un cahier de papier à lettres. Tant pis, il l’utiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l’encre et écrivit en tête, de sa plus belle écriture : Souvenirs d’un chasseur d’Afrique.
Puis il chercha le commencement de la première phrase..."
En fait, Bel-Ami n'a pas de plan défini. Ce n'est que peu à peu que naît, dans son esprit d`arriviste sans scrupule, l'idée de faire son chemin par les femmes; de là sa désinvolture et, dans sa fourberie, cet air avenant qui trompe souvent les moins naïfs. Déjà, la conquête de Mme Walter n'est plus une simple curiosité de vicieux; en renvoyant cyniquement la pauvre femme après le premier caprice dévoile jusqu'au plus profond son âme. Son ami Forestier meurt poitrinaire. Bel-Ami épouse Madeleine et conclut avec elle une sorte de pacte d'entraide. Le vieux comte de Vaudrec, ami intime du ménage Forestier, puis du ménage Duroy, meurt en léguant un million à Madeleine. Pour accepter la succession, il lui faut le consentement de son mari. Prétextant qu'il importe de « sauvegarder les apparences", celui-ci donne son accord en échange de la moitié du legs.
Or, "La Vie française" a fait fortune; le politicien, le politicien qui l'inspirait, Laroche-Mathieu, est devenu ministre, c'est un familier de la maison Duroy. Et Bel-Ami se fait désormais appeler M. Du Roy. Sa faveur est plus grande que jamais. Mais il ne s'estime pas assez comblé et convoite l'immense fortune de son patron Walter, directeur du journal et homme d'affaires. Pour y parvenir, il se fait aimer de Suzanne, sa fille, à peine âgée de 17 ans. Puis il fait surprendre sa femme Madeleine et le ministre en flagrant délit; Laroche-Mathieu doit démissionner et Madeleine accepter le divorce. Enfin, il enlève Suzanne pour contraindre Walter à cette union tant désirée, et ne se soucie nullement de Mme Walter qui devient folle de douleur.

1886 - Monsieur Parent
Monsieur Parent - La bête à maît'Belhomme - À vendre - L'inconnue - La confidence - Le baptême - Imprudence - Un fou - Pourquoi? - Tribunaux rustiques - L'épingle - Les bécasses - En wagon - Ça ira - Découverte - Solitude - Au bord du lit - Petit soldat -
MONSIEUR PARENT.
Une histoire conjugale contée avec une crudité de ton caractéristique. Henri Parent, un petit rentier d'une quarantaine d`années, mène une existence médiocre, empoisonnée par les caprices et les humeurs de sa jeune femme, Henriette. Il trouve son unique consolation dans leur enfant, le petit Georges, alors âgé de quatre ans. Une vieille bonne. très dévouée à son maître, lui révèle qu'Henriette le trompe depuis toujours avec un ami de la maison, Paul Limousin. Avec la décision soudaine et la violence des timides, il ne tarde pas à trouver les preuves du fait et a une explication violente avec les deux coupables. Sa femme le quitte, emmenant avec elle le petit Georges, qui se révèle ne pas être l'enfant d'Henri mais celui de son ami. Cette révélation plonge M. Parent dans un état de prostration profonde: à partir de ce moment, il mènera une vie désaxée et solitaire et, passant des heures interminables au café, il s`acheminera tristement vers la vieillesse. Au cours d`une promenade à Saint-Germain à laquelle il s'est décidé pour sortir de l`état d'hébètement dans lequel il est tombé, il rencontre sa femme avec son ami et leur enfant qui est maintenant un grand garçon. À la vue de ce paisible bonheur familial, un mouvement de fureur l`envahit et il éclate en propos insensés. Puis il rentre en ville et retourne à son café habituel...
AU BORD DU LIT
Une histoire cynique sur un ton mondain, traitée avec habileté et malice ...
"... Elle demanda : – Est-ce une scène ? avez-vous l’intention de me faire des reproches ?
– Non, ma chère amie, je dis seulement que ce M. Burel a été presque inconvenant auprès de vous. Si… si… si j’avais eu des droits… je me serais fâché.
– Mon cher ami, soyez franc. Vous ne pensez plus aujourd’hui comme vous pensiez l’an dernier, voilà tout. Quand j’ai su que vous aviez une maîtresse, une maîtresse que vous
aimiez, vous ne vous occupiez guère si on me faisait ou si on ne me faisait pas la cour. Je vous ai dit mon chagrin, j’ai dit, comme vous ce soir, mais avec plus de raison : Mon ami, vous compromettez madame de Servy, vous me faites de la peine et vous me rendez ridicule. Qu’avez-vous répondu ? Oh ! vous m’avez parfaitement laissé entendre que j’étais libre, que le mariage, entre gens intelligents, n’était qu’une association d’intérêts, un lien social, mais non un lien moral. Est-ce vrai ?
Vous m’avez laissé comprendre que votre maîtresse était infiniment mieux que moi, plus séduisante, plus femme ! Vous avez dit : plus femme. Tout cela était entouré, bien entendu, de ménagements d’homme bien élevé, enveloppé de compliments, énoncé avec une délicatesse à laquelle je rends hommage. Je n’en ai pas moins parfaitement compris.
Il a été convenu que nous vivrions désormais ensemble, mais complètement séparés. Nous avions un enfant qui formait entre nous un trait d’union.
Vous m’avez presque laissé deviner que vous ne teniez qu’aux apparences, que je pouvais, s’il me plaisait, prendre un amant pourvu que cette liaison restât secrète. Vous avez longuement disserté, et fort bien, sur la finesse des femmes, sur leur habileté pour ménager les convenances, etc., etc.
J’ai compris, mon ami, parfaitement compris. Vous aimiez alors beaucoup, beaucoup madame de Servy, et ma tendresse légitime, ma tendresse légale vous gênait. Je vous enlevais, sans doute, quelques-uns de vos moyens. Nous avons, depuis lors, vécu séparés. Nous allons dans le monde ensemble, nous en revenons ensemble, puis nous rentrons chacun chez nous.
Or, depuis un mois ou deux, vous prenez des allures d’homme jaloux. Qu’est-ce que cela veut dire ?
– Ma chère amie, je ne suis point jaloux, mais j’ai peur de vous voir vous compromettre. Vous êtes jeune, vive, aventureuse…
– Pardon, si nous parlons d’aventures, je demande à faire la balance entre nous.
– Voyons, ne plaisantez pas, je vous prie. Je vous parle en ami, en ami sérieux. Quant à tout ce que vous venez de dire, c’est fortement exagéré.
– Pas du tout. Vous avez avoué, vous m’avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l’autorisation de vous imiter. Je ne l’ai pas fait…
– Permettez…
– Laissez-moi donc parler. Je ne l’ai pas fait. Je n’ai point d’amant, et je n’en ai pas eu… jusqu’ici. J’attends… je cherche… je ne trouve pas. Il me faut quelqu’un de bien… de mieux que vous… C’est un compliment que je vous fais et vous n’avez pas l’air de le remarquer.
– Ma chère, toutes ces plaisanteries sont absolument déplacées...."
CA IRA
Une jeune Parisienne aimant l'aventure, que l'auteur connue du temps où il canotait sur la Seine et qu`il retrouve paisible buraliste dans petite ville de province...
LA BÊTE À MAÎT'BELHOMME
De la cour de l'hôtel du Commerce, que tient Malandain fils, la diligence Criquetot-Le Havre va partir. Césaire Horlaville, postillon facétieux, fait l'appel des voyageurs ; défilé pittoresque des gens de la campagne. Puis commence le voyage. Belhomme, l`un des voyageurs, ressent un malaise, se plaint, gémit si fort que ses compagnons de voyage finissent par s'intéresser à lui. Parmi eux se trouve un docteur, que le malade consulte sur un mystérieux mal à l'oreille (qui semble s'être aggravé du fait du mouvement de la voiture) ; il a, dit-il, l'impression qu'une bête veut lui dévorer le cerveau. Le curé intervient, et, après des manœuvres bien singulières, arrive à libérer notre homme en lui versant dans l'oreille de l'huile et de l'eau chaude : ce qui fait sortir de l'oreille une puce. Comment d'un fait insignifiant, Maupassant nous brosse toute une série de portraits pittoresques, dans un style rapide, coloré ...

Dans sa Préface de "Pierre et Jean", Maupassant, après avoir rappelé la grande variété des écrits narratifs qu'on a l'habitude de grouper sous le nom traditionnel de "roman", explique justifie la nouvelle école dite réaliste ou naturaliste, on le sent plus proche d'un Flaubert que d'un Zola...
"Le romancier, au contraire, qui prétend nous donner une image exacte de la vie, doit éviter avec soin tout enchaînement d’événements qui paraîtrait exceptionnel. Son but n’est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. À force d’avoir vu et médité il regarde l’univers, les choses, les faits et les hommes d’une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de l’ensemble de ses observations réfléchies. C’est cette vision personnelle du monde qu’il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre. Pour nous émouvoir, comme il l’a été lui-même par le spectacle de la vie, il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il devra donc composer son œuvre d’une manière si adroite, si dissimulée, et d’apparence si simple, qu’il soit impossible d’en apercevoir et d’en indiquer le plan, de découvrir ses intentions.
Au lieu de machiner une aventure et de la dérouler de façon à la rendre intéressante jusqu’au dénouement, il prendra son ou ses personnages à une certaine période de leur existence et les conduira, par des transitions naturelles, jusqu’à la période suivante. Il montrera de cette façon, tantôt comment les esprits se modifient sous l’influence des circonstances environnantes, tantôt comment se développent les sentiments et les passions, comment on s’aime, comment on se hait, comment on se combat dans tous les milieux sociaux, comment luttent les intérêts bourgeois, les intérêts d’argent, les intérêts de famille, les intérêts politiques.
L’habileté de son plan ne consistera donc point dans l’émotion ou dans le charme, dans un début attachant ou dans une catastrophe émouvante, mais dans le groupement adroit des petits faits constants d’où se dégagera le sens définitif de l’œuvre.
S’il fait tenir dans trois cents pages dix ans d’une vie pour montrer quelle a été, au milieu de tous les êtres qui l’ont entourée, sa signification particulière et bien caractéristique, il devra savoir éliminer, parmi les menus événements innombrables et quotidiens tous ceux qui lui sont inutiles, et mettre en lumière, d’une façon spéciale, tous ceux qui seraient demeurés inaperçus pour des observateurs peu clairvoyants et qui donnent au livre sa portée, sa valeur d’ensemble...."

1887 - Pierre et Jean
Le quatrième roman de Maupassant resserre dans un temps très court (deux mois) et avec peu de personnages (deux frères, leurs parents, quelques comparses de second plan) les données d'un drame bourgeois. Pierre et Jean sont les deux fils de M et Mme Roland, unis et opposés par «une fraternelle et inoffensive inimitié». La famille apprend que Jean hérite seul de Maréchal, un ancien ami de la famille. Et le doute s'insinue en Pierre qui va mener son enquête.
Trop souvent occulté par le célèbre texte théorique intitulé « Le Roman » qui le précède sans en constituer à proprement parler la Préface, ce bref récit – longue nouvelle ou « petit roman », comme le qualifiait lui-même l’auteur – constitue cependant, sur le plan formel comme dans le traitement de thèmes obsédants et la vision du monde qu’il suppose, l’une des œuvres les plus fortes de Maupassant. Monsieur Roland, ancien bijoutier parisien passionné de navigation, s’est retiré au Havre avec sa femme et ses deux fils : Pierre, l’aîné, jeune diplômé de médecine, et Jean, son cadet de cinq ans, qui vient de terminer son droit. Au cours d’une partie de pêche familiale en compagnie d’une jeune veuve, Mme Rosémilly, les deux frères, pour plaire à la jeune femme, se livrent à une frénétique compétition à la rame qui révèle, sous une apparence d’union et d’affection, la rivalité qui les oppose...
" Dès qu’il fut dehors, Pierre se dirigea vers la rue de Paris, la principale rue du Havre, éclairée, animée, bruyante. L’air un peu rais des bords de mer lui caressait la figure, et il marchait lentement, la canne sous le bras, les mains derrière le dos.
Il se sentait mal à l’aise, alourdi, mécontent comme lorsqu’on a reçu quelque fâcheuse nouvelle. Aucune pensée précise ne l’affligeait et il n’aurait su dire tout d’abord d’où lui venaient cette pesanteur de l’âme et cet engourdissement du corps. Il avait mal quelque part, sans savoir où. ; il portait en lui un petit point douloureux, une de ces presque insensibles meurtrissures dont on ne trouve pas la place, mais qui gênent, fatiguent, attristent, irritent, une souffrance inconnue et légère, quelque chose comme une graine de chagrin.
Lorsqu’il arriva place du Théâtre, il se sentit attiré par les lumières du café Tortoni, et il s’en vint lentement vers la façade illuminée ; mais au moment d’entrer, il songea qu’il allait trouver là des amis, des connaissances, des gens avec qui il faudrait causer ; et une répugnance brusque l’envahit pour cette banale camaraderie des demi-tasses et des petits verres. Alors, retournant sur ses pas, il revint prendre la rue principale qui le conduisait vers le port.
Il se demandait : « Où irais-je bien ? » cherchant un endroit qui lui plût, qui fût agréable à son état d’esprit. Il n’en trouvait pas, car il s’irritait d’être seul, et il n’aurait voulu rencontrer personne. En arrivant sur le grand quai, il hésita encore une fois, puis tourna vers la jetée ; il avait choisi la solitude.
Comme il frôlait un banc sur le brise-lames, il s’assit, déjà las de marcher et dégoûté de sa promenade avant même de l’avoir faite. Il se demanda : « Qu’ai-je donc ce soir ? » Et il se mit à chercher dans son souvenir quelle contrariété avait pu l’atteindre, comme on interroge un malade pour trouver la cause de sa fièvre.
Il avait l’esprit excitable et réfléchi en même temps, il s’emballait, puis raisonnait, approuvait ou blâmait ses élans ; mais chez lui la nature première demeurait en dernier lieu la plus forte, et l’homme sensitif dominait toujours l’homme intelligent.
Donc il cherchait d’où lui venait cet énervement, ce besoin de mouvement sans avoir envie de rien, ce désir de rencontrer quelqu’un pour n’être pas du même avis, et aussi ce dégoût pour les gens qu’il pourrait voir et pour les choses qu’ils pourraient lui dire...."
Maupassant a-t-il réussi ici à égaler l'intensité de ses plus puissantes nouvelles, pour certains, oui. Monsieur Roland, donc brave homme borné et commun, maniaque invétéré de la pêche, a laissé Paris et son modeste commerce de joaillier pour se retirer au Havre, où il passe ses journées en la mer. Sa femme, bien plus fine que lui. douce, affectueuse, mère idéale, ne vit que que pour ses enfants. Ceux-ci sont fort différents tant au physique qu'au moral. L'aîné, Pierre, près de la trentaine, brun, maigre et nerveux, tourmenté par de grands projets et sujet à des découragements imprévus, après avoir commencé et abandonné diverses études, a enfin été reçu docteur en médecine. Jean, de cinq ans plus jeune, gros, blond placide, est docteur en droit et se prépare à exercer tranquillement la profession d'avocat. Dans l'affection qui lie les deux frères, il y a toujours eu une sorte de rivalité, le plus jeune a constamment été proposé comme modèle, grâce à sa vie régulière, à Pierre l'indiscipliné. Cette rivalité secrète éclate à l'occasion d'une promenade en barque, à laquelle est invitée la belle et blonde Mme Rosémilly, jeune veuve d'un riche capitaine de vaisseau. Le soir même, la vie tranquille de la famille est bouleversée par une nouvelle : un certain M. Maréchal, fidèle et vieil ami de la famille, est mort à Paris et a laissé comme unique héritier de sa fortune considérable le plus jeune fils des Roland, Jean.
Pendant que les autres s'abandonnent à la joie et commencent à faire des projets, Pierre est assailli par la jalousie; dans ce sentiment s'insinue une autre pensée atrocement torturante, réveillée par certaines phrases de ses amis et qui très vite l'obsède. Tandis que Jean, avec le prestige de sa récente richesse, se déclare à la veuve et obtient d'elle une promesse, le malheureux Pierre, honteux de lui-même et torturé par les remords, poursuit cependant une sorte d'enquête particulièrement pénible, déchirant le cœur de sa mère qui l'a deviné et qui perd peu à peu à ses yeux tout son charme serein de femme aux pures affections.
Un soir, il ne résiste plus et, au cours d'une dispute avec son frère, lui révèle sa découverte, insoucieux de sa mère qui, certainement, les entend de la chambre à côté. Jean, bouleversé, obtient peu après la confirmation de la vérité de la bouche même de sa mère, il est le fils de Maréchal. Mais son caractère placide et positif prend rapidement le dessus : il dédommagera son frère, en renonçant en sa faveur au petit patrimoine de la famille ; en attendant, puisque Pierre n'a plus envie de vivre à la maison, il facilitera son embarquement comme médecin de bord sur un grand transatlantique.
Tout se passe ainsi, et M. Roland accepte tout, sans soupçonner le moins du monde la récente tragédie....

1887 – Le Horla
« Le Horla » (1ère version Gil Blas, 26 octobre 1886) - « Amour » (Gil Blas, 7 décembre 1886) - « Le Trou » (Gil Blas, 9 novembre 1886) - « Clochette » (Gil Blas, 21 décembre 1886) - « Le Marquis de Fumerol » (Gil Blas, 5 octobre 1886) - « Le Signe » (Gil Blas, 27 avril 1886) - « Le Diable » (Le Gaulois, 5 août 1886) - « Les Rois » (Le Gaulois, 23 janvier 1887) - « Au bois » (Gil Blas, 22 juin 1886) - « Une famille » (Gil Blas, 3 août 1886) - « Joseph » (Gil Blas, 21 juillet 1886) - L'Auberge » (Les Lettres et les Arts, 1er septembre 1886) - « Le Vagabond » (Nouvelle Revue, 1er janvier 1887)
LE HORLA
La première nouvelle, "Le Horla", qui donne son titre au recueil, est une des nouvelles fantastiques les plus connues de la littérature française, et pourtant elle déconcerta les lecteurs de Maupassant. Le naturalisme est passé par là plus que Poe ou Hoffmann, la vogue de l'époque est aux études sur les maladies du système nerveux entreprises par le docteur Charcot.
Le narrateur, qui vit seul près de Rouen, obsédé par la présence d'un double maléfique, Le Horla, tient le journal de son immersion dans la folie jusqu'au suicide. Sous la forme d'un journal, Maupassant nous rapporte les hallucinations d'un homme obsédé par la mystérieuse présence d'un être surnaturel auquel il donne le nom de « Horla ». Ce Horla posséderait toutefois un corps, fait d'une matière invisible et impalpable lui permettant d'échapper à toute investigation des sens. Cet être surnaturel est capable de raisonnement, tout comme les hommes : c'est en fait une manière de surhomme qui s'empare du premier venu, lui impose sa propre volonté, jusqu'à en faire son esclave et absorbe, à son bénéfice, toute l'énergie vitale de sa victime...
L'AUBERGE
Le surnaturel évoqué dans Le Horla réapparaît ici. Ulrich, un jeune montagnard suisse, doit passer l'hiver comme gardien dans une grande auberge de haute montagne. Son compagnon, Gaspard, disparaît au cours d'une partie de chasse et Ulrich va se croire persécuté par son âme. Une trop longue solitude qui le précipite dans la folie...
AMOUR
" Dans la vallée, c’étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies ; puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s’épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j’aie jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l’entretenait comme un parc. À travers l’immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d’étroites avenues où les barques plates, conduites et dirigées avec des perches, passaient, muettes, sur l’eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes et plonger les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement.
J’aime l’eau d’une passion désordonnée : la mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder, les rivières si jolies mais qui passent, qui fuient, qui s’en vont, et les marais surtout où palpite toute l’existence inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c’est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout.
Rien n’est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois qu’un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basse couvertes d’eau ? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes ou bien les brumes bizarres, qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes, ou bien encore ’imperceptible clapotement, si léger, si doux, et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marais à des pays de rêve, à des pays redoutables cachant un secret inconnaissable et dangereux.
Non. Autre chose s’en dégage, un autre mystère, plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être ! Car n’est-ce pas dans l’eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s’ouvrit au jour le premier germe de vie ?.."
La brève histoire d'un chasseur qui découvre un matin ce qu'est l'Amour, il tire sur des oiseaux, tue la femelle, le mâle tournoie dans le ciel , " Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante ; et la bête, la petite bête épargnée se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains", l'oiseau ne peut en effet abandonner sa compagne et se laisse tuer...
LE TROU
Léopold Renard, honnête tapissier de Paris, féru de pêche à la ligne. a été amené à causer la mort d`un homme au cours d'une de ses promenades dominicales. Il est traduit en cour d'assises et, pour se disculper, il expose le fait qui est à l`origine du drame : sa dispute avec un autre pêcheur pour une affaire de femme, qui s'est terminée par la chute de l'adversaire dans un coin dangereux de la rivière. Ce récit, conçu sur un mode lent, progressif, est rehaussé de détails colorés et conduit avec une telle simplicité que certains l'ont tenu pour un chef-d`œuvre.

1888 - Le Rosier de Madame Husson
« Le Rosier de Madame Husson » (Nouvelle Revue, 15 juin 1887) - « Un échec » (Gil Blas, 16 juin 1885) - « Enragée ? » (Gil Blas, 7 août 1883) - « Le Modèle » (Le Gaulois, 12 décembre 1883) - « La Baronne » (Gil Blas, 17 mai 1887) - « Une vente » (Gil Blas, 22 février 1884) - « L'Assassin » (Gil Blas, 1er novembre 1887) - « La Martine » (Gil Blas, 11 septembre 1883) - « Une soirée » (Gil Blas, 29 mars 1887) - « La Confession » (Gil Blas, 12 août 1884) - « Divorce » (Gil Blas, 21 février 1888) - « La Revanche » (Gil Blas, 18 novembre 1884) - « L'Odyssée d'une fille » (Gil Blas, 25 septembre 1883) - « La Fenêtre » (Gil Blas, 10 juillet 1883)
LE ROSIER DE MADAME HUSSON
" Petite, trottant court, ornée d’une perruque de soie noire, cérémonieuse, polie, en fort bons termes avec le bon Dieu représenté par l’abbé Malou, elle avait une horreur profonde, une horreur native du vice, et surtout du vice que l’Église appelle luxure. Les grossesses avant mariage la mettaient hors d’elle, l’exaspéraient jusqu’à la faire sortir de son caractère. Or c’était l’époque où l’on couronnait des rosières aux environs de Paris, et l’idée vint à Mme Husson d’avoir une rosière à Gisors..." - Madame Husson, éprise de pureté et de vertu, s'est donc mis en tête de faire couronner la «rosière» de Gisors, c'est-à-dire la jeune fille la plus chaste. Après une enquête menée par sa bonne, l'intraitable Françoise, elle comprend qu'aucune fille de la ville ne répond aux critères énoncés. Elle ne trouve alors guère que le fils de la fruitière, Isidore, jeune homme simple et candide.
" Les mots hardis, les gauloiseries, les allusions graveleuses le faisaient rougir si vite que le Dr Barbesol l’avait surnommé le thermomètre de la pudeur. Savait-il ou ne savait-il pas ? se demandaient les voisins, les malins. Était-ce le simple pressentiment de mystères ignorés et honteux, ou bien l’indignation pour les vils contacts ordonnés par l’amour qui semblait émouvoir si fort le fils de la fruitière Virginie ? Les galopins du pays, en courant devant sa boutique, hurlaient des ordures à pleine bouche afin de le voir baisser les yeux ; les filles s’amusaient à passer et repasser devant lui en disant des polissonneries qui le faisaient rentrer dans la maison. Les plus hardies le provoquaient ouvertement, pour rire, pour s’amuser, lui donnaient des rendez-vous, lui proposaient un tas de choses abominables.
Donc Mme Husson était devenue rêveuse..."
Après avoir demandé conseil à l'abbé Malou, Isidore est couronné «rosier» en grande cérémonie. Le repas terminé, il disparaît avec la bourse qu'on lui a donnée. On le retrouve huit jours plus tard, "ivre et abruti par huit jours de soûlerie, ivre et dégoûtant à n’être pas touché par un chiffonnier. Son beau costume de coutil blanc était devenu une loque grise, jaune, graisseuse, fangeuse, déchiquetée, ignoble ; et sa personne sentait toutes sortes d’odeurs d’égout, de ruisseau et de vice. Il fut lavé, sermonné, enfermé, et pendant quatre jours ne sortit point. Il semblait honteux et repentant. On n’avait retrouvé sur lui ni la bourse aux cinq cents francs, ni le livret de caisse
d’épargne, ni même sa montre d’argent, héritage sacré laissé par son père le fruitier...."

1889 - La Main gauche - Allouma ( L'écho de Paris des 10 et 15 février 1889)- Hautot père et fils - Boitelle - L'ordonnance- Le lapin - Un soir - Les épingles - Duchoux - Le rendez-vous - Le port - La morte
Allouma - ".. En me voyant entrer, elle se leva et resta devant moi debout, couverte de ses bijoux sauvages, dans une attitude de fière soumission.
– Que fais-tu ici ? lui dis-je en arabe.
– J’y suis parce qu’on m’a ordonné de venir.
– Qui te l’a ordonné ?
– Mohammed.
– C’est bon. Assieds-toi.
Elle s’assit, baissa les yeux, et je demeurai devant elle, l’examinant.
La figure était étrange, régulière, fine et un peu bestiale, mais mystique comme celle d’un Bouddha. Les lèvres, fortes et colorées d’une sorte de floraison rouge qu’on retrouvait ailleurs sur son corps, indiquaient un léger mélange de sang noir, bien que les mains et les bras fussent d’une blancheur irréprochable.
J’hésitais sur ce que je devais faire, troublé, tenté et confus. Pour gagner du temps et me donner le loisir de la réflexion, je lui posai d’autres questions, sur son origine, son arrivée dans ce pays et ses rapports avec Mohammed. Mais elle ne répondit qu’à celles qui m’intéressaient le moins et il me fut impossible de savoir pourquoi elle était venue, dans quelle intention, sur quel ordre, depuis quand, ni ce qui s’était passé entre elle et mon serviteur.
Comme j’allais lui dire : « Retourne sous la tente de Mohammed », elle me devina peut-être, se dressa brusquement et levant ses deux bras découverts dont tous les bracelets sonores glissèrent ensemble vers ses épaules, elle croisa ses mains derrière mon cou en m’attirant avec un air de volonté suppliante et irrésistible.
Ses yeux, allumés par le désir de séduire, par ce besoin de vaincre l’homme qui rend fascinant comme celui des félins le regard impur des femmes, m’appelaient, m’enchaînaient,
m’ôtaient toute force de résistance, me soulevaient d’une ardeur impétueuse. Ce fut une lutte courte, sans paroles, violente, entre les prunelles seules, l’éternelle lutte entre les deux brutes humaines, le mâle et la femelle, où le mâle est toujours vaincu.
Ses mains, derrière ma tête, m’attiraient d’une pression lente, grandissante, irrésistible comme une force mécanique, vers le sourire animal de ses lèvres rouges où je collai soudain les miennes en enlaçant ce corps presque nu et chargé d’anneaux d’argent qui tintèrent, de la gorge aux pieds, sous mon étreinte. Elle était nerveuse, souple et saine comme une bête, avec des airs, des mouvements, des grâces et une sorte d’odeur de gazelle, qui me firent trouver à ses baisers une rare saveur inconnue, étrangère à mes sens comme un goût de fruit des tropiques.
Bientôt… je dis bientôt, ce fut peut-être aux approches du matin, je la voulus renvoyer, pensant qu’elle s’en irait ainsi qu’elle était venue, et ne me demandant pas encore ce que je ferais d’elle, ou ce qu’elle ferait de moi. Mais dès qu’elle eut compris mon intention, elle murmura :
– Si tu me chasses, où veux-tu que j’aille maintenant ? Il faudra que je dorme sur la terre, dans la nuit. Laisse-moi me coucher sur le tapis, au pied de ton lit.
Que pouvais-je répondre ? Que pouvais-je faire ? Je pensai que Mohammed, sans doute, regardait à son tour la fenêtre éclairée de ma chambre ; et des questions de toute nature, que je ne m’étais point posées dans le trouble des premiers instants, se formulèrent nettement.
– Reste ici, dis-je, nous allons causer.
Ma résolution fut prise en une seconde. Puisque cette fille avait été jetée ainsi dans mes bras, je la garderais, j’en ferais une sorte de maîtresse esclave, cachée dans le fond de ma maison, à la façon des femmes des harems. Le jour où elle ne me plairait plus, il serait toujours facile de m’en défaire d’une façon quelconque, car ces créatures-là, sur le sol africain, nous appartenaient presque corps et âme...."

1889 - Fort comme la mort
Comme "Notre Coeur" qui le suivit de près (1890), il s'agit plus d'une minutieuse étude psychologique, une suite de tableaux particulièrement suggestifs, que d'un véritable récit. Olivier Bertin. peintre devenu illustre et riche parce qu`il s`est toujours tenu entre les audaces modernes et l`académisme, est parvenu a une cinquantaine presque heureuse en dissimulant avec succès la médiocrité de sa personnalité. Un amour constant et sincère profond l'a accompagné jusque-là : la belle Antoinette de Guilleroy, dite Any, femme délaissée d`un petit noble normand entièrement pris par la politique, est venue à lui alors qu'il approchait au seuil de la vieillesse. Mais la fille d`Any, Annette. après avoir passé les dernières années en compagnie de sa grand-mère à la campagne, revient a l`improviste ; Olivier l'a connue et aimée alors qu'elle était une enfant, et maintenant qu`il la retrouve jeune fille il lui trouve une étonnante ressemblance avec sa mère. C'est ainsi que, sans qu`il s`en rende compte, il se laisse emporter à revivre sa jeunesse passée. Suite à des évènements cruellement révélateurs, la mère comprend la vérité et la découvre à son vieil ami qui. d`abord incrédule et scandalisé, doit pourtant avouer à lui-même et à Any ses sentiments. Mais le peintre cache sa passion à la jeune fille qui se mariera sous peu, mais tous deux en restent déchirés. Le voici découvrant l'inévitable déchéance de la vieillesse. De jour en jour, il a le sentiment d'un vide intérieur qui le gagne peu à peu; aussi, lorsqu`il est renversé par un omnibus, au cours d`une de ses promenades mélancolique, et blessé à mort. il voit dans cet accident le signe du destin.
1890, "Notre Coeur" est l'histoire des amours de Mme Michèle de Burne et d'André Mariolle. Mme de Burne, une veuve riche, spirituelle, coquette et froide, qui vit plus par la tête que par le cœur ou par les sens, a tenu longtemps la balance égale entre les adorateurs qui peuplent son salon. Mais l'amour à la fois violent et discret d'André Mariolle a fini par la toucher; et, bravement, elle est devenue sa maîtresse. Il lui a fallu, pour s'y décider, un réel courage, car les réalités lui répugnent. André ne tarde pas à comprendre l'immense sacrifice que lui a fait Mme de Burne et que chacune de leurs entrevues est une corvée pour elle. Il le comprend et il en souffre. C'est un homme du monde, distingué, intelligent, instruit, presque musicien, presque poète. presque peintre, mais c''est aussi un esprit inquiet, trop délicat et trop subtil.
Que peut-il reprocher à sa maîtresse? Elle est fidèle ; et jamais elle ne se refuse quand il la sollicite. Mais il la sent absente au moment même qu'elle se donne. Même alors, la pensée de Mme de Burne est ailleurs : chez la comtesse une telle, à qui elle a promis sa visite pour aujourd'hui ; au milieu des convives qui s'assoiront demain à sa table... André n'a jamais tenu, il ne tiendra jamais dans ses bras que la vaine forme, que le fantôme de sa maîtresse.
Alors il se décide à s'en aller, à fuir, à s'enterrer dans un coin de campagne, aux environs de la forêt de Fontainebleau. Là, il fait In connaissance dune jeune fille, Elisabeth, qui sert dans une auberge et dont il est, bientôt, passionnément aimé. Elle n'est pas une raffinée, une compliquée, une intellectuelle : elle se donne simplement et absolument. André trouve dans cette naïve passion quelque adoucissement à ses chagrins. Cependant, il pense toujours à Mme de Burne : et. quand celle- ci vient le chercher dans la retraite où il se cache, elle n'a pas de peine à le reconquérir : sans renoncer à Elisabeth. André renouera avec Mme de Burne la chaîne des amours incomplètes et douloureuses.

1890 - L’inutile beauté
« L'Inutile Beauté » (L'Echo de Paris, du 2 au 7 avril 1890) - « Le Champ d'oliviers » (Le Figaro, les 14 et 23 février 1890) - « Mouche » (L'Echo de Paris, 7 février 1890) - « Le Noyé » (Le Gaulois, 16 août 1888) - « L'Épreuve » (L'Echo de Paris, 13 juillet 1889) - « Les Vingt-Cinq Francs de la Supérieure » (Gil Blas, 28 mars 1888) - « Un cas de divorce » (Gil Blas, 31 août 1886) - « Qui sait ? » (L'Echo de Paris, 6 avril 1890)
L'INUTILE BEAUTÉ
Parmi les onze nouvelles que compte le recueil, celle qui a donné son titre à l`ouvrage, met en scène une femme bien malheureuse, la comtesse de Mascaret : elle accuse en effet son mari d`avoir fait d`elle une "jument poulinière" en lui ayant donné une ribambelle
d'enfants. Décidée à en finir, elle lui fait croire qu'un de ses rejetons est adultérin, tout en se refusant à dire lequel. Le comte, torturé par la jalousie, supplie sa femme de lui livrer le nom de son amant. Il apprend qu'il ne fut jamais trompé, le mensonge en question ayant
été pour elle un moyen de l'éloigner de sa couche. M. de Mascaret s'avise enfin qu'une femme est un être ayant sa vie propre et digne d`embellir notre vie....
MOUCHE
Cinq amis possèdent un bateau et coulent de douces heures sur la Seine. L'un d'eux amène un soir Mouche, sa maîtresse, qui devient celle des quatre autres. Elle est bientôt enceinte. Les pères sont radieux mais un accident les prive de l'enfant "collectif". Ils se proposent de renouveler une si belle expérience ...
L'EPREUVE
Un commerçant retiré Blondel vit paisiblement avec sa femme à Saint-Germain. Au cours d'une discussion, un soir, madame Blondel laisse entendre à son mari que la légèreté des femmes est plus répandue qu'il ne croit. L`autre aussitôt de se torturer l'esprit. Si sa femme l`a trompé autrefois, ce ne peut être qu'avec l'ami Tancret. Il va le trouver, le ramène chez lui pour surprendre sa femme. L`émotion de celle-ci, après tant d`années, en face de Tancret, en dit assez long pour que Blondel n'insiste davantage...
Norbert Gœneutte (1854-1894)
Parisien de naissance, le peintre Norbert Gœneutte vivra dans la capitale jusqu’au moment où, sa santé s’affaiblissant, il gagnera Auvers-sur-Oise, pour y mourir à l’âge de quarante ans des suites de la tuberculose. C'est le peintre des scènes de la vie parisienne, des portraits de famille et de ses amis, des scènes de genre, des élégantes et de nombreux paysages, ami intime de Manet, il fréquenta Renoir, Monet, Pissarro, mais aussi , le docteur Gachet, Charles Cros, Guillaumin, Lesclide et Catulle Mendès, Debussy, Satie, Zola.
A noter : "La soupe du matin" (Musée du Luxembourg, Paris); 1888, "Le Pont de l'Europe et la Gare Saint-Lazare" (Baltimore Museum of Art, US).

Jules Vallès (1832-1885)
Né dans un milieu pauvre, paysan, en révolte contre toute tutelle, vivotant de petits métiers, Vallès s'occupe d'un journal socialiste, "La Rue". Après la Commune, à laquelle il participe, il est exilé en Angleterre : c'est là qu'il rédige ses romans autobiographiques, la "trilogie de Jacques Vingtras", "L'Enfant", "Le Bachelier", "L'Insurgé". Tout en se réclamant de l'idéal naturaliste, Vallès est avant tout un militant et toute son oeuvre exprime rancoeur et vide affectif, haine de la société. L'image de la mère, sinistre marâtre, contamine le regard de l'enfant, toute autorité est par nature injuste et esclavagiste.

L'Enfant, 1879 (Jacques Vingtras, tome 1)
Ce premier volume est dédié à tous ceux qui furent roués de coups par leurs parents. «À tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège ou qu’on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre.» C’est par ces mots que Jules Vallès commence le premier tome de son roman autobiographique. On l’y retrouve sous les traits de Jacques Vingtras, un gamin mal aimé par sa mère, mal protégé par son père, malmené par la vie… Fils d'un professeur de collège et d'une paysanne bornée, Vingtras est, dès le bas âge, instruit à l'école du malheur. "Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins; quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi et rarement plus tard que quatre heures." Sous prétexte de l'aguerrir, on s'ingénie à lui rendre la vie la plus dure possible, on le crétinise à longueur de journée, et on finit par lui reprocher le pain qu'il mange. Vallès restitue une vie de province que l'on ne peut oublier.

Le Bachelier, 1881 (Jacques Vingtras, tome 2)
Ce deuxième volume est dédié à tous ceux qui crevèrent de faim pour s'être nourris de racines grecques. Vingtrans part pour Paris :"vingt-quatre sous, dix-sept ans, des épaules de lutteur, une voix de cuivre, des dents de chien, la peau olivâtre, les mains comme du citron et les cheveux comme du bitume. " Aucun des métiers qu'il exercera ne lui permettra de subsister. L'atmosphère de Paris s'ajoute à sa détresse, en fond l'insurrection de juin 1848, durement réprimée par Cavaignac. Vingtrans fait cause commune avec les miséreux et se sent mûr pour la rébellion.
"..C’est qu’il m’arrive souvent, le soir quand je suis seul, de me demander aussi si je n’ai pas quitté une cuistrerie pour une autre, et si après les classiques de l’Université, il n’y a pas les classiques de la Révolution – avec des proviseurs rouges, et un bachot jacobin !
Par moments, j’ai peur de n’être qu’un égoïste, comme le vieil ouvrier m’appela quand je lui parlai d’être apprenti. Je voudrais dans les discours des républicains trouver des phrases qui correspondissent à mes colères.
Ils ne parlent pas des collèges noirs et cruels, ils ne parlent pas de la loi qui fait du père le bourreau de l’enfant, ils ne parlent pas de ceux que la misère rend voleurs ! J’en ai tant vu dans la prison de chez nous qui allaient partir pour le bagne et qui me paraissaient plus honnêtes gens que le préfet, le maire et les autorités.
Égoïste ! Oh ! non ! Je serais prêt – je le jure bien – à souffrir et à mourir pour empêcher que d’autres ne souffrent et meurent des supplices qui m’ont fait mal, que je n’ai plus à craindre, mais que je voudrais voir crever devant moi…
Matoussaint ne parle que de commissaires à écharpe tricolore ou de tribuns à cocarde rouge, qui prendront la place des rois et des traîtres… Je m’en moque, de ça ! Quand donc brûlera-t-on le Code et les collèges ! Ils ne m’écoutent pas, me blaguent et m’accusent d’insulter les saints de la République !.."

L'insurgé, 1886 (Jacques Vingtras, tome 3)
Ce troisième volume est dédié à tous ceux qui donnèrent leur sang pour la Commune de Paris. Vingtras devient un des membres les plus influents de cette Commune dont Vallès nous retrace l'histoire, l'armée des Versaillais qui pénètre dans Paris, la guerre des barricades, les incendies et les massacres d'otages. Vingtras parvient à fuir : "Paris, "on dirait une grande blouse inondée de sang."
"... Je hais Robespierre le déiste, et trouve qu’il ne faut pas singer Marat, le galérien du soupçon, l’hystérique de la Terreur, le névrosé d’une époque sanguine ! Je joins mes malédictions à celles de Vermorel, quand elles visent les complices de Cavaignac dans le massacre de Juin, quand elles menacent la bedaine de Ledru, la face vile de Favre, la loupe de Garnier-Pagès, la barbe prophétique de Pelletan… mais, plus sacrilège que lui, je crache sur le gilet de Maximilien et fends, comme l’oreille d’un cheval de réforme, la boutonnière de l’habit bleu barbeau où fleurit le bouquet tricolore, le jour de la fête de l’Être suprême.
Dire que c’est pour cela peut-être que, sans le dire ou sans le savoir, Vermorel défend le tueur d’Hébert et de Danton ! … parce que les défroqués ne font que changer de culte et que dans le cadre de l’hérésie même, ils logent toujours des souvenirs de religion ! Leur foi ou leur haine ne fait que se déplacer ; ils marcheront, s’il est utile, comme les jésuites – leurs premiers maîtres ! – par des chemins de scélérats, au but qu’ils ont juré d’atteindre.
Il aurait fallu que Vermorel naquît dans un Quatre-vingttreize. Il était capable d’être le Sixte Quint d’une papauté sociale. Au fond, il rêve la dictature, ce maigre qui est venu trop tard ou trop tôt dans un monde trop lâche ! Parfois une rancoeur lui prend.
Pour ceux qui ont cru au ciel, souvent la terre est trop petite ; et, ne pouvant frapper ou être frappés sur les marches de quelque Vatican de faubourg, en plein soleil, ils se dévorent les poings dans l’ombre, ces déserteurs de la chaire ! Ayant ruminé la vie éternelle, ils agonisent de douleur dans la vie étroite et misérable.
Le spleen ronge, avec la gloutonnerie d’un cancer, la place où jadis ils croyaient avoir une âme, et fait monter la nausée du dégoût jusqu’à leurs narines, qui palpitèrent aux odeurs d’encens. Faute de ce parfum, il leur fallait le parfum de la poudre… or, l’air n’est chargé que de torpeur et de couardise ! Ils se débattent quelque temps encore ; un beau soir, ils avalent du poison pour crever comme les bêtes – qui n’ont pas d’âme !.."
Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)
Peintre, graveur, illustrateur, affichiste suisse et anarchisant, naturalisé français en 1901, Steinlen s'installe à Paris en 1881 et réalise pour Mirliton d'Aristide Bruant et pour le Chat noir des affiches et décorations fort populaires : Apothéose des chats (1889), Tournée du Chat-Noir avec Rodolphe Salis (1896, Paris, musée des Arts décoratifs). Il collabore à tous les journaux qui ont lutté pour une justice sociale : le Gil Blas illustré (1891-1900), le Chambard socialiste, fondé par Gérault-Richard (1893-1895), l'En-Dehors (1894) et la Feuille (1898-1899), le Rire (1895-1898), l'Assiette au beurre (1901-1905). Il illustre de nombreux romans : "les Femmes d'amis" de Courteline , "l'Affaire Crainquebille" d'Anatole France (1901).

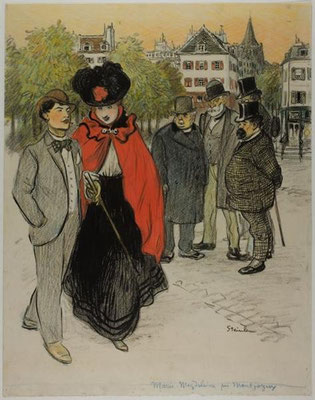

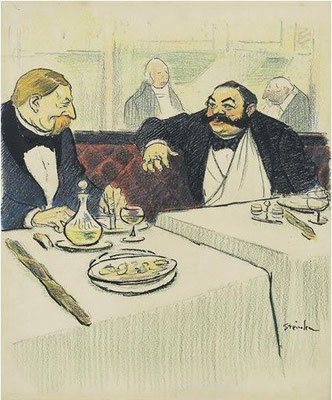





Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
Toulouse-Lautrec devint célèbre en 1895, principalement comme illustrateur et affichiste. Son talent de peintre ne sera reconnu qu'après sa mort. D'origine aristocratique, souffrant dès 1878 d'une maladie des os incurable, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa entre à l'Ecole des beaux-arts en 1882, se lie d'amitié avec Van Gogh, est influencé par Manet, puis se rapproche de Renoir et des Nabis.
C'est en 1890 qu'il commence à célébrer les cabarets de Montmartre, "Le Bal du Moulin de la galette" (1889), "Au Moulin rouge, la danse" (1890), hante le Chat Noir, les salles de café-concert, les lupanars comme le fameux "salon" de la rue des Moulins ("Le Divan, 1893; Au Salon de la rue des Moulins, 1894). Il fréquente ces lieux tous les soirs, en compagnie de son cousin, le docteur Tapié de Celeyran, apprécie les fameuses goualeuses (Nini Peau-de-Chien, Rosa la Rouge), les danseuses de cancan (Grille d'Egout, Rayon d'Or, Nini Patte-en-l'air, Trompe-la-Mort, Jane Avril, dite la Mélinite, et surtout la Goulue et le danseur Valentin le désossé). Lautrec va magnifier ces femmes et sera impitoyable pour le spectateur voyeur ou le souteneur. Il use de toutes les techniques picturales, peinture, pastel, dessins, gravure, mais affectionne les panneaux de bois non préparés et le carton épais brut, brun ou gris, qui absorbe par endroits la peinture fluide et offre un fond de matière à son oeuvre. Sa vie nocturne le mène à l'alcoolisme, atteint de paralysie il meurt à trente-sept-ans.
Le Musée d'Albi offre, en autres, "Autoportrait" (1880), "Au Salon de la rue des Moulins" (1894), "Yvette Guilbert saluant le public" (1894), le Musée d'Orsay (Paris), "Jane Avril dansant" (1892), "La Toilette" (1896), "Justine Dieuhl assise dans le jardin de M.Forest" (1891), ...















La vie que mène Toulouse-Lautrec à Paris est d'année en année plus fiévreuse. Il boit beaucoup. En 1888, il a une brève liaison avec Suzanne Valadon. Puis il contracte la syphilis, contaminé par une fille de l'Élysée-Montmartre, Rosa la Rouge. En 1895, il exécute plusieurs panneaux destinés à décorer la baraque foraine qu'une danseuse de cabaret alors célèbre, la Goulue, a ouverte sur la place du Trône. L'année suivante, il voyage en Hollande, en Espagne et au Portugal. De retour à Paris, il s'installe dans un nouvel atelier, avenue Frochot (1897), et achève le grand album de lithographies qu'il voulait intituler "Filles", mais qui s'appellera "Elles". Le cabaret (Monsieur Boileau au café, 1893, musée de Cleveland, Ohio), les «maisons closes» (Au salon de la rue des Moulins, 1894, Albi), le vélodrome (Tristan Bernard au vélodrome Buffalo, 1895), le cirque (la Clownesse Cha-U-Kao, vers 1897, musée d'Orsay) sont ses thèmes de prédilection les plus féconds.


Toulouse-Lautrec utilise et joue avec la photographie, notamment avec ses amis et compagnons de "sorties", Maurice Guibert (1856-1913), photographe amateur connu pour ses auto-portraits et photos de Toulouse-Lautrec , Paul Sescau (1858-1926), photographe de Montmartre qui réalise pour lui des photos de ses tableaux (seul subsiste de lui un album de 35 photographies), ou par l'entremise des quelques clichés amateurs de Thadée Natanson (1868-1951), grand collectionneur de tableaux et qui soutint, avec sa flamboyante épouse, Misia Godebska, nombre de peintres ou écrivains de l'époque (Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton, Fernand Gregh, Anatole France, Octave Mirbeau, Marcel Proust, Jules Renard, Stéphane Mallarmé).