- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Herbert George Wells (1866-1946), "The Time Machine" (1895), "The Island of Doctor Moreau" (1896), "The Invisible Man" (1897), ,"The War of the Worlds" (1898), "The First Men in the Moon" (1901), "The Shape of Things to Come" (1933) - ...
Last update: 2020/11/11

Le désir de s'épanouir par-delà les préjugés est une constante de nombreux écrivains britanniques du début du XXe siècle, un désir partagé tant par Herbert George Wells que par George Bernard Shaw. L'époque victorienne n'a pas manqué d'écrivains ou d'artistes s'évertuant à imaginer d'autres sociétés et des futurs utopiques, tels que Edward Bulwer-Lytton (1803-1873, The Coming Race, 1871), Samuel Butler (1835-1902, Erewhon, 1872), William Henry Hudson (1841-1922, A Crystal Age, 1887), William Morris (1864-1896, News from Nowhere, 1890).
Et sans rêves, la vie humaine serait insupportable pour la plus grande multitude des êtres humains, mais plus encore le monde est comme un grand atelier dans lequel le présent n'est plus que du matériel pour l'avenir. Fasciné par la réalité visible d'une société divisée en classes sociales, par les effets du capitalisme et l'évolution de la race humaine, toute la singularité de HG Wells tient à ce qu'il ignore délibérément le passé et ne pense plus désormais que pour explorer le futur : "c'est dans le futur que nous allons, demain est la chose importante et féconde pour nous. C'est demain qui renferme tout ce qui reste à sentir pour nous, nos enfants et toux ceux qui nous sont chers (...) C'est notre ignorance de l'avenir et notre persuasion que cette ignorance est absolument incurable qui donnent seules au passé son énorme prédominance dans nos pensées" (It is our ignorance of the future and our persuasion that ignorance is absolutely incurable that alone gives the past its enormous predominance in our thoughts).
Wells distingue ainsi en 1902 deux stratégies de pensée, une pensée focalisée sur le passé ("the legal mind") et celle tournée principalement vers le futur ("the creative mind"). La grande majorité des habitants de notre planète ne semble guère penser à l'avenir, cet avenir est une sorte de non-existence vide sur laquelle le présent en marche écrira pas à pas des événements, au fond le passé lui importe plus que l'avenir, et toute l'existence n'est faite que de conséquences de ce passé. Cet état d'esprit emporte une certaine idée de soumission, de passivité, un besoin de se référer constamment à la loi, au droit, à l'autorité de la chose passé. Wells entend défendre une autre façon de penser, privilégier les choses à venir, et ne penser aux choses présentes que par rapport aux résultats qui peuvent en découler. Ce type d'individu va contester et vouloir modifier en permanence l'ordre établi des choses, et considérer le monde comme un grand atelier dans lequel le présent n'est qu'un matériau pour l'avenir, pour ce qui est encore destiné à être. L'homme ordinaire tente de cohabiter avec ces deux formes, mais la seconde s'avère plus féconde en tout point, à une époque où domine, selon l'écrivain, une incertitude et une indécision sur toutes les questions, morales ou esthétiques, religieuses ou politiques....
"... the type of the majority of living people, is that which seems scarcely to think of the future at all, which regards it as a sort of blank non-existence upon which the advancing present will presently write events. The second type, which is, I think, a more modern and much less abundant type of mind, thinks constantly and by preference of things to come, and of present things mainly in relation to the results that must arise from them. The former type of mind, when one gets it in its purity, is retrospective in habit, and it interprets the things of the present, and gives value to this and denies it to that, entirely with relation to the past. The latter type of mind is constructive in habit, it interprets the things of the present and gives value to this or that, entirely in relation to things designed or foreseen. While from that former point of view our life is simply to reap the consequences of the past, from this our life is to prepare the future. The former type one might speak of as the legal or submissive type of mind, because the business, the practice, and the training of a lawyer dispose him toward it; he of all men must constantly refer to the law made, the right established, the precedent set, and consistently ignore or condemn the thing that is only seeking to establish itself. The latter type of mind I might for contrast call the legislative, creative, organizing, or masterful type, because it is perpetually attacking and alterng the established order of things, perpetually falling away from respect for what the past has given us. It sees the world as one great workshop, and the present is no more than material for the future, for the thing that is yet destined to be. It is in the active mood of thought, while the former is in the passive; it is the mind of youth, it is the mind more manifest among the western nations, while the former is the mind of age, the mind of the oriental.
Things have been, says the legal mind, and so we are here. The creative mind says we are here because things have yet to be. Now I do not wish to suggest that the great mass of people belong to either of these two types. Indeed, I speak of them as two distinct and distinguishable types mainly for convenience and in order to accentuate their distinction. There are probably very few people who brood constantly upon the past without any thought of the future at all, and there are probably scarcely any who live and think consistently in relation to the future. The great mass of people occupy an intermediate position between these extremes, they pass daily and hourly from the passive mood to the active, they see this thing in relation to its associations and that thing in relation to its consequences, and they do not even suspect that they are using two distinct methods in their minds..." (The Discovery of the Future, 1902).

Herbert George Wells (1866-1946)
Entre 1895 et l'extraordinaire "The Time Machine", et sa mort, en 1946, Herbert George Wells a publié au long d'une ère victorienne qui agonise dans la respectabilité plus d'une centaine de livres, souvent d'une imagination débridée lorsqu'il nous fait voyager dans le temps, nous fondre dans l'invisibilité, assister à une invasion extraterrestre, nous horrifier des conséquences de manipulations génétiques. Mais alors qu'un Jules Verne (1828-1905) entremêle avec délectation aventures et technologies modernes, Wells, qui a grandi dans l'ombre de l'Origine des Espèces de Darwin, ne peut échapper à un sentiment de désespoir total, l'humanité a totalement sombré dans "The Time Machine" et ne peut résister aux avancées technologiques des Martiens dans "The War of the Worlds". Son extraordinaire imagination débridée fait surgir de son époque les pires cauchemars à venir. Père de la science-fiction moderne, il a aussi produit des best-sellers de toutes sortes, des comédies dickensiennes ("Kipps", "L'histoire de M. Polly"), des romans à clef évoquant sa passion des femmes ("Ann Veronica"), le spectre de la guerre et le cataclysme de la Première Guerre mondiale ("M. Britling Sees It Through"), des ouvrages de prospective comme "Anticipations", ou des encyclopédies concentrant en deux volumes toutes les réalisations de l'humanité ("The Outline of History"). Wells ne se pense pas romancier, ne recherche pas une renommée littéraire, mais l'amélioration, le progrès de l'humanité : ce qu'il entreprend, c'est "la tentative de démêler la possible dérive de la vie en général et de la vie humaine en particulier du flot confus des événements, et les moyens de contrôler cette dérive, si l'on en trouve" (“the attempt to disentangle the possible drift of life in general and of human life in particular from the confused stream of events, and the means of controlling that drift, if such are to be found.”).

H.G. Wells , "The Time Machine" (1895)
H.G.Wells naquit à Bromley, dans le comté de Kent, en Angleterre, le 21 septembre 1866, de Sarah Neil, femme de ménage au service de familles aisées, et de Joseph Wells, joueur de cricket professionnel et commerçant, un milieu familial qui souffre de la pauvreté et ne tarde pas à se séparer. Wells obtient une bourse d'étude en 1884 à la Normal School of Science et se forme à la biologie et au darwinisme sous la direction de Thomas Henry Huxley. Mais une fois de plus, il ne termine pas ses études, commence à vivre avec sa tante et son oncle à Fitzroy Road à Londres et enseigne à l'école de ce dernier tout en continuant à étudier à temps partiel. Il épouse sa cousine, Isabel Mary Wells, en 1891, et publie son premier essai, "La Redécouverte de l'Unique" dans la Fortnightly Review. En 1893, il décide de devenir écrivain et publie "Text-Book of Biology". En fait, Wells n'a jamais renoncé à tenter d'être pris au sérieux en tant qu'homme de science, au sens littéral du terme, et pensait l'humanité pouvait améliorer sa condition pour peu qu'elle s'en remette au gouvernement éclairé des scientifiques (Anticipations). Wells quitte sa première femme en 1894 pour une ancienne élève, Amy Catherine Robbins. Le couple se marie en 1895. Il publie la même année "The Wonderful Visit", "The Stolen Bacillus and Other Incidents" et son premier roman de fiction, "The Time Machine", l'une des premières œuvres de science-fiction et l'ancêtre du genre "time travel" (voyage dans le temps)....
"The Time Traveller (for so it will be convenient to speak of him) was expounding a recondite matter to us. His pale grey eyes shone and twinkled, and his usually pale face was flushed and animated. The fire burnt brightly, and the soft radiance of the incandescent lights in the lilies of silver caught the bubbles that flashed and passed in our glasses. Our chairs, being his patents, embraced and caressed us rather than submitted to be sat upon, and there was that luxurious after-dinner atmosphere, when thought runs gracefully free of the trammels of precision. And he put it to us in this way—marking the points with a lean forefinger—as we sat and lazily admired his earnestness over this new paradox (as we thought it) and his fecundity."
"L'EXPLORATEUR du Temps (car c'est ainsi que pour plus de commodité nous l'appellerons) nous exposait un mystérieux problème. Ses yeux gris et vifs étincelaient, et son visage, habituellement pâle, était rouge et animé. Dans la cheminée la flamme brûlait joyeusement et la lumière douce des lampes à incandescence, en forme de lis d'argent, se reflétait dans les bulles qui montaient brillantes dans nos verres. Nos fauteuils, dessinés d'après ses modèles, nous embrassaient et nous caressaient au lieu de se soumettre à regret à nos séants ; il régnait cette voluptueuse atmosphère d'après dîner où les pensées vagabondent gracieusement, libres des entraves de la précision. Et il nous expliqua la chose de cette façon – insistant sur certains points avec son index maigre – tandis que, renversés dans nos fauteuils, nous admirions son ardeur et son abondance d'idées pour soutenir ce que nous croyions alors un de ses nouveaux paradoxes."
Un scientifique de l'époque victorienne affirme avoir inventé un dispositif lui permettant de voyager dans le temps, et avoir visité le futur, en arrivant en l'an 802 701. Il y découvre que l'espèce humaine a évolué, au fond conformément à cette structuration sociale bien vivante à l'époque victorienne entre classe supérieure et classe inférieure, en deux formes distinctes, empruntés à la vision biblique d'Eli et Moloch....
" Aussi loin que je pouvais voir, le monde étalait la même exubérante richesse que la vallée de la Tamise. De chaque colline que je gravis, je pus voir la même abondance d'édifices splendides, infiniment variés de style et de manière ; les mêmes épais taillis de sapins, les mêmes arbres couverts de fleurs et les mêmes fougères géantes. Ici et là, de l'eau brillait comme de l'argent, et au-delà, la campagne s'étendait en bleues ondulations de collines et disparaissait au loin dans la sérénité du ciel. Un trait particulier, qui attira bientôt mon attention, fut la présence de certains puits circulaires, plusieurs, à ce qu'il me sembla, d'une très grande profondeur. L'un d'eux était situé auprès du sentier qui montait la colline, celui que j'avais suivi lors de ma première excursion. Comme les autres, il avait une margelle de bronze curieusement travaillé, et il était protégé de la pluie par une petite coupole. Assis sur le rebord de ces puits, et scrutant leur obscurité profonde, je ne pouvais voir aucun reflet d'eau, ni produire la moindre réflexion avec la flamme de mes allumettes. Mais dans tous j'entendis un certain son : un bruit sourd, par intervalles, comme les battements d'une énorme machine ; et d'après la direction de la flamme de mes allumettes, je découvris qu'un courant d'air régulier était établi dans les puits. En outre, je jetai dans l'orifice de l'un d'eux une feuille de papier, et au lieu de descendre lentement en voltigeant, elle fut immédiatement aspirée et je la perdis de vue..."
En surface vivent les Eloi, des créatures innocentes et enfantines livrées à un peuple obscur et cruel, reclus dans le tréfonds de la Terre, les Morlocks. Le voyageur du temps admire dans un premier temps ces Eloi qui semblent avoir adopté un mode de vie communautaire sans le moindre problèmes, mais se retrouve rapidement surpris devant leur paresse et leur manque d'intelligence. La fin de la période victorienne, une période marquée par de grand progrès technique et une singulière stabilité sociale, semblait annoncer un avenir radieux et des progrès sans fin, ce que Wells semble ici contester.
"Je croyais être parvenu à l'époque du déclin du monde. Le crépuscule rougeâtre m'évoqua le crépuscule de l'humanité. Pour la première fois, je commençai à concevoir une conséquence bizarre de l'effort social où nous sommes actuellement engagés. Et cependant, remarquez-le, c'est une conséquence assez logique. La force est le produit de la nécessité : la sécurité entretient et encourage la faiblesse. L'œuvre d'amélioration des conditions de l'existence – le vrai progrès civilisant qui assure de plus en plus le confort et diminue l'inquiétude de la vie – était tranquillement arrivée à son point culminant. Les triomphes de l'humanité unie sur la nature s'étaient succédés sans cesse. Des choses qui ne sont, à notre époque, que des rêves, étaient devenues des réalités. Et ce que je voyais en était les fruits !
« Après tout, l'activité d'aujourd'hui, les conditions sanitaires et l'agriculture en sont encore à l'âge rudimentaire. La science de notre époque ne s'est attaquée qu'à un minuscule secteur du champ des maladies humaines, mais malgré cela elle étend ses opérations d'une allure ferme et persistante. Notre agriculture et notre horticulture détruisent à peine une mauvaise herbe ici et là, et cultivent peut-être une vingtaine de plantes saines, laissant les plus nombreuses compenser, comme elles peuvent, les mauvaises. Nous améliorons nos plantes et nos animaux favoris – et nous en avons si peu ! – par la sélection et l'élevage ; tantôt une pêche nouvelle et meilleure, tantôt une grappe sans pépins, tantôt une fleur plus belle et plus parfumée ; tantôt une espèce de bétail mieux adaptée à nos besoins. Nous les améliorons graduellement, parce que nos vues sont vagues et hésitantes, et notre connaissance des choses très limitée ; parce qu'aussi la Nature est timide et lente dans nos mains malhabiles. Un jour tout cela ira de mieux en mieux. Tel est le sens du courant, en dépit des reflux. Le monde entier sera intelligent, instruit et recherchera la coopération ; toutes choses iront de plus en plus vite vers la soumission de la Nature. À la fin, sagement et soigneusement nous réajusterons l'équilibre de la vie animale et de la vie végétale pour qu'elles s'adaptent à nos besoins humains.
« Ce réajustement, me disais-je, doit avoir été fait et bien fait : fait, à vrai dire, une fois pour toutes, dans l'espace du temps à travers lequel ma machine avait bondi. Dans l'air, ni moucherons, ni moustiques ; sur le sol, ni mauvaises herbes, ni fongosités ; des papillons brillants voltigeaient de-ci, de-là. L'idéal de la médecine préventive était atteint. Les maladies avaient été exterminées. Je ne vis aucun indice de maladie contagieuse quelconque pendant tout mon séjour. Et j'aurai à vous dire plus tard que les processus de putréfaction et de corruption eux-mêmes avaient été profondément affectés par ces changements.
« Des triomphes sociaux avaient été obtenus. Je voyais l'humanité hébergée en de splendides asiles, somptueusement vêtue, et jusqu'ici je n'avais trouvé personne qui fût occupé à un labeur quelconque. Nul signe, nulle part, de lutte, de contestation sociale ou économique La boutique, la réclame, le trafic, tout le commerce qui constitue la vie de notre monde n'existait plus. Il était naturel que par cette soirée resplendissante je saisisse avec empressement l'idée d'un paradis social. La difficulté que crée l'accroissement trop rapide de la population avait été surmontée et la population avait cessé de s'accroître.
« Mais avec ce changement des conditions viennent inévitablement les adaptations à ce changement, et à moins que la science biologique ne soit qu'un amas d'erreurs, quelles sont les causes de la vigueur et de l'intelligence humaines ? Les difficultés et la liberté : conditions sous lesquelles les individus actifs, vigoureux et souples, survivent et les plus faibles succombent ; conditions qui favorisent et récompensent l'alliance loyale des gens capables, l'empire sur soi-même, la patience, la décision. L'institution de la famille et les émotions qui en résultent : la jalousie féroce, la tendresse envers la progéniture, le dévouement du père et de la mère, tout cela trouve sa justification et son appui dans les dangers qui menacent les jeunes. Maintenant, où sont ces dangers ? Un sentiment nouveau s'élève contre la jalousie conjugale, contre la maternité farouche, contre les passions de toute sorte ; choses maintenant inutiles, qui nous entravent, survivances sauvages et discordantes dans une vie agréable et raffinée.
« Je songeai à la délicatesse physique de ces gens, à leur manque d'intelligence, à ces ruines énormes et nombreuses, et cela confirma mon opinion d'une conquête parfaite de la nature. Car après la lutte vient la quiétude. L'humanité avait été forte, énergique et intelligente et avait employé toute son abondante vitalité à transformer les conditions dans lesquelles elle vivait. Et maintenant les conditions nouvelles réagissaient à leur tour sur l'humanité.
« Dans cette sécurité et ce confort parfaits l'incessante énergie qui est notre force doit devenir faiblesse. De notre temps même, certains désirs et tendances, autrefois nécessaires à la survivance, sont des sources constantes de défaillances. Le courage physique et l'amour des combats, par exemple, ne sont pas à l'homme civilisé de grands secours – et peuvent même lui être obstacles. Dans un état d'équilibre physique et de sécurité, la puissance intellectuelle, aussi bien que physique, serait déplacée. J'en conclus que pendant d'innombrables années, il n'y avait eu aucun danger de guerre ou de violences isolées, aucun danger de bêtes sauvages, aucune épidémie qui aient requis de vigoureuses constitutions ou un besoin quelconque d'activité.
Pour une telle vie, ceux que nous appellerions les faibles sont aussi bien équipés que les forts, et de fait ils ne sont plus faibles. Et même mieux équipés, car les forts seraient tourmentés par un trop-plein d'énergie. Nul doute que l'exquise beauté des édifices que je voyais ne fût le résultat des derniers efforts de l'énergie maintenant sans objet de l'humanité, avant qu'elle eût atteint sa parfaite harmonie avec les conditions dans lesquelles elle vivait – l'épanouissement de ce triomphe qui fut le commencement de l'ultime et grande paix. Ce fut toujours là le sort de l'énergie en sécurité ; elle se porte vers l'art et l'érotisme, et viennent ensuite la langueur et la décadence.
« Cette impulsion artistique elle-même doit à la fin s'affaiblir et disparaître – elle avait presque disparu à l'époque où j'étais. S'orner de fleurs, chanter et danser au soleil, c'était tout ce qui restait de l'esprit artistique ; rien de plus. Même cela devait à la fin faire place à une oisiveté satisfaite. Nous sommes incessamment aiguisés sur la meule de la souffrance et de la nécessité et voilà qu'enfin, me semblait-il, cette odieuse meule était brisée.
« Et je restais là, dans les ténèbres envahissantes, pensant avoir, par cette simple explication, résolu le problème du monde – pénétré le mystère de l'existence de ces délicieux êtres. Il se pouvait que les moyens qu'ils avaient imaginés pour restreindre l'accroissement de la population eussent trop bien réussi, et que leur nombre, au lieu de rester stationnaire, eût plutôt diminué. Cela eût expliqué l'abandon des ruines. Mon explication était très simple, et suffisamment plausible – comme le sont la plupart des théories erronées."
Après avoir sauvé Weena, une créature qui s'attache à lui jusqu'à la mort, la disparition de sa machine conduit le "Time Traveller" à découvrir des créatures souterraines, évoquant cet archétype de la ville industrialisée du XIXe siècle qu'était Londres, peuplée d'ouvriers misérables et de riches dirigeants industriels. Le capitalisme a ainsi conduit à une épouvantable division du travail dans laquelle les travailleurs doivent vivre dans la clandestinité. Mais les ouvriers se vengent maintenant de leurs anciens maîtres. Les Morlocks mangent, chassent et terrorisent les Eloi, tout comme les ancêtres des Eloi s'en prenaient métaphoriquement à leurs ouvriers assujettis. Si les sociétés capitalistes ont très souvent produit des récits centrées sur les craintes d'un soulèvement de leur base, Wells, lui, semble considérer que le soulèvement est une conséquence inévitable de l'évolution.
"Sous mes pieds, par conséquent, la terre devait être fantastiquement creusée et percée de tunnels et de galeries, qui étaient la demeure de la race nouvelle. La présence de cheminées de ventilation et de puits au long des pentes de la colline – partout, en fait, excepté au long de la vallée où coulait le fleuve – indiquait combien ses ramifications étaient universelles. Quoi de plus naturel que de supposer que c'était dans ce monde souterrain que se faisait tout le travail nécessaire au confort de la race du monde supérieur ? L'explication était si plausible que je l'acceptai immédiatement, et j'allai jusqu'à donner le pourquoi de cette division de l'espèce humaine. Je crois que vous voyez comment se présente ma théorie, encore que, pour moi-même, je dusse bientôt découvrir combien elle était éloignée de la réalité.
« Tout d'abord, procédant d'après les problèmes de notre époque actuelle, il me semblait clair comme le jour que l'extension graduelle des différences sociales, à présent simplement temporaires, entre le Capitaliste et l'Ouvrier ait été la clef de la situation. Sans doute cela vous paraîtra quelque peu grotesque – et follement incroyable – mais il y a dès maintenant des faits propres à suggérer cette orientation. Nous tendons à utiliser l'espace souterrain pour les besoins les moins décoratifs de la civilisation ; il y a, à Londres, par exemple, le Métropolitain et récemment des tramways électriques souterrains, des rues et passages souterrains, des restaurants et des ateliers souterrains, et ils croissent et se multiplient. Évidemment, pensais-je, cette tendance s'est développée jusqu'à ce que l'industrie ait graduellement perdu son droit d'existence au soleil. Je veux dire qu'elle s'était étendue de plus en plus profondément en de plus en plus vastes usines souterraines, y passant une somme de temps sans cesse croissante, jusqu'à ce qu'à la fin… Est-ce que, même maintenant un ouvrier de certains quartiers ne vit pas dans des conditions tellement artificielles qu'il est pratiquement retranché de la surface naturelle de la terre ?
« De plus, la tendance exclusive de la classe possédante – due sans doute au raffinement croissant de son éducation et à la distance qui s'augmente entre elle et la rude violence de la classe pauvre – la mène déjà à clore dans son intérêt de considérables parties de la surface du pays. Aux environs de Londres, par exemple. La moitié au moins des plus jolis endroits sont fermés à la foule. Et cet abîme – dû aux procédés plus rationnels d'éducation et au surcroît de tentations, de facilités et de raffinement des riches –, en s'accroissant, dut rendre de moins en moins fréquent cet échange de classe à classe, cette élévation par intermariage qui retarde à présent la division de notre espèce par des barrières de stratification sociale. De sorte qu'à la fin, on eut, au-dessus du sol, les Possédants, recherchant le plaisir, le confort et la beauté et, au-dessous du sol, les Non Possédants, les ouvriers, s'adaptant d'une façon continue aux conditions de leur travail. Une fois là, ils eurent, sans aucun doute, à payer des redevances, et non légères, pour la ventilation de leurs cavernes ; et s'ils essayèrent de refuser, on put les affamer ou les suffoquer jusqu'au paiement des arrérages. Ceux d'entre eux qui avaient des dispositions à être malheureux ou rebelles durent mourir ; et, finalement, l'équilibre étant permanent, les survivants devinrent aussi bien adaptés aux conditions de la vie souterraine et aussi heureux à leur manière que la race du monde supérieur le fut à la sienne. À ce qu'il me semblait, la beauté raffinée et la pâleur étiolée s'ensuivaient assez naturellement.
« Le grand triomphe de l'humanité que j'avais rêvé prenait dans mon esprit une forme toute différente. Ce n'avait pas été, comme je l'avais imaginé, un triomphe de l'éducation morale et de la coopération générale. Je voyais, au lieu de cela, une réelle aristocratie, armée d'une science parfaite et menant à sa conclusion logique le système industriel d'aujourd'hui. Son triomphe n'avait pas été simplement un triomphe sur la nature, mais un triomphe à la fois sur la nature et sur l'homme. Ceci, je dois vous en avertir, était ma théorie du moment. Je n'avais aucun cicérone convenable dans ce modèle d'Utopie. Mon explication peut être absolument fausse, je crois qu'elle est encore la plus plausible ; mais, même avec cette supposition, la civilisation équilibrée, qui avait été enfin atteinte, devait avoir depuis longtemps dépassé son zénith, et s'être avancée fort loin vers son déclin. La sécurité trop parfaite des habitants du monde supérieur les avait amenés insensiblement à la dégénérescence, à un amoindrissement général de stature, de force et d'intelligence. Cela, je pouvais le constater déjà d'une façon suffisamment claire, sans pouvoir soupçonner encore ce qui était arrivé aux habitants du monde inférieur ; mais d'après ce que j'avais vu des Morlocks – car, à propos, c'était le nom qu'on donnait à ces créatures – je pouvais m'imaginer que les modifications du type humain étaient encore plus profondes que parmi les Éloïs, la belle race que je connaissais déjà.
« Alors vinrent des doutes importuns. Pourquoi les Morlocks avaient-ils pris la Machine ? Car j'étais sûr que c'étaient eux qui l'avaient prise. Et pourquoi, si les Éloïs étaient les maîtres, ne pouvaient-ils pas me faire rendre ma Machine ? Pourquoi avaient-ils une telle peur des ténèbres ? J'essayai, comme je l'ai dit, de questionner Weena sur ce monde inférieur, mais là encore je fus désappointé. Tout d'abord elle ne voulut pas comprendre mes questions, puis elle refusa d'y répondre. Elle frissonnait comme si le sujet eût été insupportable. Et lorsque je la pressai peut-être un peu rudement, elle fondit en larmes..."

H.G. Wells , "The Island of Doctor Moreau" (1896)
"L’étude de la Nature rend un homme au moins aussi impitoyable que la Nature." - En 1896, Wells publie "The Wheels of Chance: A Bicycling Idyll", dans lequel il évoque son enfance à quatorze ans où il commença à travailler comme apprenti dans un atelier de drapier, puis "L'Île du docteur Moreau". A la dérive dans un canot pneumatique, Edward Prendick, l'unique survivant du bon navire Lady Vain, est secouru par un navire transportant une étrange cargaison, une ménagerie d'animaux sauvages. Soigné par leur gardien, Montgomery, qui lui donne une potion noire au goût de sang, Prendick se retrouve bientôt échoué sur une île inexplorée du Pacifique avec son sauveteur et les bêtes. Il y rencontre le maître de Montgomery, le sinistre Dr Moreau, un brillant scientifique dont les célèbres expériences de vivisection lui ont fait abandonner le monde civilisé. " Je pose une question, invente quelque méthode d’avoir une réponse et j’obtiens… une nouvelle question. Ceci ou
cela est-il possible ? Vous ne pouvez vous imaginer ce que cela signifie pour un investigateur, quelle passion intellectuelle s’empare de lui. Vous ne pouvez vous imaginer les étranges délices de ces désirs intellectuels. La chose que vous avez devant vous n’est plus un animal, une créature comme vous, mais un problème. La souffrance par sympathie – tout ce que j’en sais est le souvenir d’une chose dont j’ai souffert il y a bien des années. Je voulais – c’était mon seul désir – trouver la limite extrême de plasticité dans une forme vivante..."
"The Island of Dr. Moreau" sera condamné par le Daily Telegraph comme "une aberration morbide de la curiosité scientifique" (a morbid aberration of scientific curiosity). La science médicale expérimentale et ses nouvelles techniques venaient en effet d'aborder en Angleterre, des revues comme The Spectator et la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals menèrent des campagnes actives contre la vivisection des animaux dans les laboratoires. Les moeurs avaient évolué : "On the Origin of Species" de Charles Darwin qui avait bouleversé la Grande-Bretagne du milieu de l'époque victorienne (1859), semblait conclure d'une manière très positive que l'humanité devait évoluer vers toujours plus de perfection. Dans les années 1880, le message ne semblait plus autant optimiste. L'île du Dr Moreau suggère au contraire que nos avancées morales et intellectuelles sont précaires et que le déclin est inévitable. Et l'homme de science ayant acquis cette possibilité de manipuler la frontière entre l'homme et l'animal ne fait qu'accroître le doute....
" Alors, quelque chose de froid toucha ma main. Je tressaillis violemment et aperçus tout contre moi une vague forme rosâtre, qui ressemblait à un enfant écorché plus qu’à un autre être. La créature avait exactement les traits doux et repoussants de l’aï1,le même front bas et les mêmes gestes lents. Quand fut dissipé le premier aveuglement causé par le passage subit du grand jour à l’obscurité, je commençai à y voir plus distinctement. La petite créature qui m’avait touché était debout devant moi, m’examinant. Mon conducteur avait disparu.
L’endroit était un étroit passage creusé entre de hauts murs de lave, une profonde crevasse, de chaque côté de laquelle des entassements d’herbes marines, de palmes et de roseaux entrelacés et appuyés contre la roche, formaient des repaires grossiers et impénétrablement sombres. L’interstice sinueux qui remontait le ravin avait à peine trois mètres de large et il était encombré de débris de fruits et de toutes sortes de détritus qui expliquaient l’odeur fétide.
Le petit être rosâtre continuait à m’examiner avec ses yeux clignotants, quand mon Homme-Singe reparut à l’ouverture de la plus proche de ces tanières, me faisant signe d’entrer. Au même moment, un monstre lourd et gauche sortit en se tortillant de l’un des antres qui se trouvaient au bout de cette rue étrange ; il se dressa, silhouette difforme, contre le vert brillant des feuillages et me fixa. J’hésitai – à demi décidé à m’enfuir par le chemin que j’avais suivi pour venir –, puis, déterminé à pousser l’aventure jusqu’au bout, je serrai plus fort mon bâton dans ma main et me glissai dans le fétide appentis derrière mon conducteur.
C’était un espace semi-circulaire, ayant la forme d’une demi-ruche d’abeilles, et, contre le mur rocheux qui formait la paroi intérieure, se trouvait une provision de fruits variés, noix de coco et autres. Des ustensiles grossiers de lave et de bois étaient épars sur le sol et l’un d’eux était sur une sorte de mauvais escabeau. Il n’y avait pas de feu. Dans le coin le plus sombre de la hutte était accroupie une masse informe qui grogna en me voyant ; mon Homme-Singe resta debout, éclairé par la faible clarté de l’entrée, et me tendit une noix de coco ouverte, tandis que je me glissai dans le coin opposé où je m’accroupis. Je pris la noix et commençai à la grignoter, l’air aussi calme que possible, malgré ma crainte intense et l’intolérable manque d’air de la hutte. La petite créature rose apparut à l’ouverture, et quelque autre bipède avec une figure brune et des yeux brillants vint aussi regarder par-dessus son épaule..."

"Island of Lost Souls" (1932) est la première adaptation cinématographique non muette du roman de H. G. Wells de 1896, L'île du Dr Moreau. L'"horreur" était alors l'un des créneaux favoris à Hollywood (White Zombie, Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Black Cat ). Le film a été produit par Paramount Pictures, dirigé par Erle C. Kenton, à partir d'un scénario co-écrit par l'auteur de science-fiction Philip Wylie. Les acteurs principaux étaient Charles Laughton, particulièrement diabolique, Richard Arlen, Leila Hyams, Bela Lugosi et Kathleen Burke, la sensuelle femme-léopard. Fourmillant d'hybrides animaux-humains, de suggestion de bestialité entre le héros naufragé et une séduisante femme léopard et d'idées irréligieuses menaçantes, Les indices de cette perversité se sont avérés trop nombreux pour de nombreuses commissions de censure, et le film a été interdit en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe et l'Amérique pendant de nombreuses années...

H.G. Wells , "The Invisible Man" (1897)
"On fit cercle autour de lui, on vit les traces nouvelles de mes pas sur la dernière marche et sur le trottoir. - Qu’est-ce qu’il a ? demanda quelqu’un - Des pieds ! voyez ! Des pieds qui courent " - Wells publie en 1896 un recueil d'essais et d'histoires, "Certain Personal Matters", puis l'année suivante "The Invisible Man". La vie et la mort d'un physicien nommé Griffin, devenu fou, quoique l'amertume imprègne chacun de ses actes. "Je me rappelle, se souvient-il après la mort de son père et alors qu'il s'est abandonné à la solitude de ses recherches, mon retour au foyer désert, la traversée de ce qui jadis avait été un village et que des entrepreneurs avaient retapé maintenant à la vilaine image d’une ville. Dans toutes les directions, les rues aboutissaient à des terrains vagues et se terminaient par des tas de décombres ou d’herbes. Je me vois encore, fantôme maigre et noir, marchant le long du trottoir luisant et glissant, avec un étrange détachement qui me venait de ces ignobles maisons bourgeoises, de ces boutiques sordides. Je ne me sentais nullement attristé par la mort de mon père. Il me faisait l’effet d’avoir été la victime d’une sentimentalité folle. Les convenances, l’usage exigeaient ma présence à l’enterrement ; mais le cœur n’y était pas."
Ayant réussi à rendre son corps invisible, Griffin s'aperçoit que ni ses vêtements ni la nourriture qu'il absorbe ne le sont, que nu il souffre de faim et de froid, et qu'habillé il doit porter des gants et cacher son visage, un déguisement qui le rend encore plus étrange. Condamné à se réfugier dans une auberge, il devient progressivement caractériel et misanthrope, les gens autour de lui se posent maintes question...
"The stranger came early in February, one wintry day, through a biting wind and a driving snow, the last snowfall of the year, over the down, walking from Bramblehurst railway station, and carrying a little black portmanteau in his thickly gloved hand. He was wrapped up from head to foot, and the brim of his soft felt hat hid every inch of his face but the shiny tip of his nose; the snow had piled itself against his shoulders and chest, and added a white crest to the burden he carried. He staggered into the "Coach and Horses" more dead than alive, and flung his portmanteau down. "A fire," he cried, "in the name of human charity! A room and a fire!" He stamped and shook the snow from off himself in the bar, and followed Mrs. Hall into her guest parlour to strike his bargain. And with that much introduction, that and a couple of sovereigns flung upon the table, he took up his quarters in the inn. Mrs. Hall lit the fire and left him there while she went to prepare him a meal with her own hands. A guest to stop at Iping in the wintertime was an unheard-of piece of luck, let alone a guest who was no "haggler," and she was resolved to show herself worthy of her good fortune."
"L’étranger arriva en février, par une matinée brumeuse, dans un tourbillon de vent et de neige. Il venait, à pied, par la dune, de la station de Bramblehurst, portant de sa main couverte d’un gant épais, une petite valise noire. Il était bien enveloppé des pieds à la tête, et le bord d’un chapeau de feutre mou ne laissait apercevoir de sa figure que le bout luisant de son nez. La neige s’était amoncelée sur ses épaules, sur sa poitrine ; elle ajoutait aussi une crête blanche au sac dont il était chargé. Il entra, chancelant, plus mort que vif, dans l’auberge, et, posant à terre son bagage :
« Du feu, s’écria-t-il, du feu, par charité ! Une chambre et du feu !
Il frappa de la semelle, secoua dans le bar la neige qui le couvrait, puis suivit Mme Hall dans le petit salon pour faire ses conditions. Sans autre préambule, et jetant deux souverains sur la table, il s’installa dans l’auberge. Mme Hall disposa le feu et alla préparer le repas de ses propres mains. Un hôte s’arrêtant à Iping en hiver, c’était une aubaine dont on n’avait jamais entendu parler. Et encore un hôte qui ne marchandait pas ! Elle était résolue à se montrer digne de sa bonne fortune."
"Dès que le jambon fut bien à point, dès que Millie, la lymphatique servante, eut été un peu réveillée par quelques injures adroitement choisies, l’hôtesse apporta nappes, assiettes et verres dans la salle et commença de mettre le couvert avec le plus d’élégance possible. Quoique le feu brûlât vivement, elle constata, non sans surprise, que le voyageur conservait toujours son chapeau et son manteau, et, regardant par la fenêtre la neige tomber dans la cour, se tenait de manière à dissimuler son visage. Ses mains toujours gantées étaient croisées derrière son dos. Il paraissait perdu dans ses réflexions.
Elle remarqua que la neige fondue qui saupoudrait encore ses épaules, tombait goutte à goutte sur le tapis.
« Voulez-vous me permettre, monsieur, dit-elle, de prendre vos effets, pour les mettre à sécher dans la cuisine ?
— Non », répondit l’autre sans se retourner.
N’étant pas sûre d’avoir bien entendu, elle allait répéter sa question, quand il retourna la tête et, la regardant : « Je préfère les garder », ajouta-t-il nettement.
Mme Hall observa qu’il portait de grosses lunettes bleues, avec des verres sur le côté à angle droit, et que d’épais favoris, répandus sur le col de son vêtement, empêchaient de rien voir de ses joues ni de son visage.
« Très bien, monsieur, comme il vous plaira… Dans un moment la pièce sera plus chaude. »
Il ne répliqua pas et se détourna de nouveau. Mme Hall, sentant ses avances inopportunes, acheva lestement de dresser la table et s’empressa, en trottinant, de sortir. Quand elle revint, son hôte était toujours là, debout, immobile comme une statue de pierre, faisant le gros dos, le collet relevé, le bord du chapeau rabattu et dégouttant, la figure et les yeux complètement cachés. Elle servit d’un geste important les œufs au jambon et cria, plutôt qu’elle ne dit :
« Votre déjeuner est prêt, monsieur !
— Merci », répondit aussitôt l’étranger.
Mais il ne bougea pas jusqu’à ce qu’elle eût refermé la porte sur elle.
Alors seulement il fit volte-face et s’approcha de la table avec une certaine impatience.
Comme elle arrivait à la cuisine, en passant derrière le comptoir, Mme Hall entendit un bruit renouvelé à intervalles réguliers : tac, tac, tac, cela se répétait toujours ; c’était le bruit d’une cuiller tournant dans un bol.
« Ah ! cette fille ! s’écria-t-elle. Là ! j’ai tout à fait oublié la moutarde. C’est sa faute : pourquoi est-elle toujours si lente ? »
Et, tout en achevant elle-même de battre la moutarde, elle lança vers Millie quelques aménités sur les inconvénients de l’indolence. « N’avait-elle pas de ses mains préparé les œufs et le jambon, mis le couvert, et tout fait en somme, tandis que Millie, mon Dieu ! mon Dieu ! n’avait réussi qu’à l’empêcher de servir la moutarde ! Et cela, avec un nouvel hôte, qui montrait l’intention de séjourner ! » Alors l’hôtesse remplit le moutardier et, le plaçant avec cérémonie sur le plateau à thé, noir et or, elle le porta dans le salon.
Elle frappa et entra tout de suite. Aussitôt l’étranger fit un mouvement rapide : elle n’eut que le temps d’entrevoir un objet blanc qui disparaissait derrière la table ; le voyageur avait l’air de ramasser quelque chose sur le parquet. Ce n’est qu’après avoir déposé son plateau qu’elle remarqua que pardessus et chapeau avaient été ôtés et placés sur une chaise devant le feu. Une paire de souliers mouillés menaçait de la rouille son garde-feu en acier. Elle s’avança résolument vers cette défroque, et, d’un ton qui n’admettait pas de refus : Maintenant, sans doute, je puis prendre tout cela pour le faire sécher.
— Laissez le chapeau ! » répondit le visiteur d’une voix sourde.
En se retournant, elle vit qu’il avait levé la tête et qu’il la fixait. Pendant une minute, elle le considéra fixement, trop surprise pour dire un mot. Il tenait un linge blanc, une serviette apportée par lui, sur la partie inférieure de sa figure, de façon que sa bouche et ses mâchoires fussent complètement cachées : cela expliquait le timbre assourdi de sa voix. Mais ce n’était pas cela qui étonnait le plus Mme Hall. En effet, tout le front du voyageur, au-dessus des lunettes bleues, était couvert d’un bandeau blanc, un autre bandeau, appliqué sur les oreilles, ne laissait pas apercevoir le moindre bout de visage, si ce n’est un nez rouge et pointu, toujours aussi rouge et luisant que tout à l’heure, à l’arrivée. L’homme portait une jaquette de velours foncé, avec un large collet noir, relevé autour du cou et laissant passer une ligne de linge. La chevelure, épaisse et brune, qui s’échappait au hasard, en petites queues, en petites cornes singulières, de dessous les deux bandeaux croisés, donnait à la physionomie l’aspect le plus étrange que l’on pût imaginer. Cette tête, enveloppée, emmitouflée, était si différente de ce qu’avait prévu Mme Hall que celle-ci, pendant un moment, demeura pétrifiée...."
Mais ses ressources financières viennent à se tarir et il ne tarde pas à sombrer dans les pires excès, vole et doit fuir des contrées qui ont promis récompense à qui l'attraperait. Blessé, hors de lui, toujours obsédé par sa soif de domination, il se réfugie chez le docteur Kemp, un ami d'enfance qui ne tarde pas à le dénoncer, tout autant par crainte que par jalousie. L'homme invisible est sauvagement tué par la foule et son corps redevient progressivement visible...
"...Soudain l’étranger leva en l’air ses mains toujours gantées, frappa du pied encore une fois et cria : « Assez ! » avec tant de violence qu’il fit taire Mme Hall.
« Vous ne comprenez pas, dit-il, qui je suis ni ce que je suis. Je vais vous le montrer. Parbleu ! je vais vous le montrer ! »
Il mit alors sa main ouverte sur sa figure, et, lorsqu’il la retira, il y avait, au milieu de son visage, un trou noir !
« Tenez ! »
Et, faisant deux pas en avant, il tendit à Mme Hall quelque chose que celle-ci, les yeux en arrêt sur cette face transformée, accepta machinalement. En voyant ce que c’était, elle poussa un grand cri, laissa tomber l’objet et recula en chancelant. Le nez – c’était le nez rosé et luisant de l’étranger – roula sur le parquet avec un bruit sourd de carton creux.
Il ôta ses lunettes, et chacun dans le bar demeura bouche bée. Il enleva son chapeau et, d’un geste violent, arracha ses favoris et ses bandeaux. Un pressentiment passa comme l’éclair à travers le bar.
« Oh ! mon Dieu ! » cria-t-on. Et tout le monde s’enfuit.
C’était plus épouvantable qu’on ne peut se le figurer.
Mme Hall, frappée d’horreur, poussa un gémissement et se dirigea vers la porte de la maison. Jugez donc ! On s’attendait à voir des balafres, des difformités, des horreurs réelles – mais rien, rien ! Les bandeaux et la perruque traversèrent à la volée le corridor et allèrent tomber dans le bar, où les gens firent des sauts de carpe pour ne pas être atteints. Et tous de dégringoler le perron, en cohue. En effet, l’homme qui se tenait là, hurlant une explication incohérente, était des pieds jusqu’au col un gaillard solide et gesticulant ; mais au-dessus du col, c’était le néant ! Rien ! rien que l’on pût voir !
Les gens, dans le bas du village, entendirent des cris, des clameurs ; en regardant la rue, ils virent l’auberge vomir au dehors tout son monde. Ils virent Mme Hall tomber et Teddy Henfrey sauter pour ne pas culbuter sur elle. Ils entendirent les hurlements d’effroi de Millie, qui, surgissant soudain de la cuisine au bruit du tumulte, s’était heurtée à l’étranger sans tête. Un véritable sauve-qui-peut. Sur-le-champ chacun, d’un bout à l’autre de la rue, le marchand de confiseries, le propriétaire du jeu de massacre et son aide, l’homme de la balançoire, gamins et gamines, élégants de village, pimpantes jeunes filles, vieillards en blouse et bohémiennes à tablier, commencèrent à courir ; en un clin d’œil, une foule de quarante personnes peut-être fut rassemblée, grossissant d’ailleurs toujours. Et ce furent des allées et venues, des huées, des questions, des exclamations, des suppositions, à n’en plus finir, devant l’établissement de Mme Hall. Chacun paraissait pressé de parler en même temps que les autres ; résultat : la tour de Babel ! Un petit groupe soutenait Mme Hall, que l’on avait relevée évanouie. C’était la discussion la plus confuse, coupée par les dépositions incroyables d’un bruyant témoin oculaire. « Au revenant !..."

Dans la droite ligne des succès obtenus avec "Frankenstein" en 1931, puis "The Old Dark House" en 1932, Universal Pictures confie à James Whale la réalisation de "The Invisible Man" (1933), avec un Claude Rains moins impitoyable et cruel que le personnage du roman, et Gloria Stuart, sa fiancée, un tournage de trois mois avec des effets spéciaux de John P. Fulton. Le thème de l'Homme invisible fit recette, une suite, intitulée "The Invisible Man Returns" et mettant en vedette Vincent Price, fut produite en 1940...

H.G. Wells , "The War of the Worlds" (1898)
Publié par Pearson's Magazine au Royaume-Uni et par le magazine The Cosmopolitan aux États-Unis en 1897, le roman détaille les événements d'une invasion martienne vécue par un narrateur masculin non identifié et son frère. Le roman a été illustré pour la première fois par Warwick Goble pour le magazine de l'éditeur britannique.
Ce qui frappe dans le récit de Wells, c'est tout d'abord que cette arrivée des Martiens ne surprend guère les habitants, quand bien même après que les envahisseurs aient tués plusieurs personnes. La vie quotidienne n'est pas plus perturbée, les Anglais restent imperturbablement rivés à leurs structures sociales ("The most extraordinary thing to my mind, of all the strange and wonderful things that happened upon that Friday, was the dovetailing of the commonplace habits of our social order with the first beginnings of the series of events that was to topple that social order headlong"). Le chaos ne s'installe que lorsque s'effondre les hiérarchies sociales ("I felt the first inkling of a thing that presently grew quite clear in my mind, that oppressed me for many days, a sense of dethronement, a persuasion that I was no longer a master, but an animal among the animals, under the Martian heel"). Le roman remportera en 1898 un énorme succès commercial et cinq ans après sa publication, sera traduit en dix langues.
"No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man’s and yet as mortal as his own; that as men busied themselves about their various concerns they were scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency men went to and fro over this globe about their little affairs, serene in their assurance of their empire over matter. It is possible that the infusoria under the microscope do the same. No one gave a thought to the older worlds of space as sources of human danger, or thought of them only to dismiss the idea of life upon them as impossible or improbable. It is curious to recall some of the mental habits of those departed days. At most terrestrial men fancied there might be other men upon Mars, perhaps inferior to themselves and ready to welcome a missionary enterprise. Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. And early in the twentieth century came the great disillusionment..."
"Personne n’aurait cru dans les dernières années du XIXe siècle, que les choses humaines fussent observées, de la façon la plus pénétrante et la plus attentive, par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles ; que, tandis que les hommes s’absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d’aussi près peut-être qu’un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d’eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de-ci de-là par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que, sous le microscope, les infusoires fassent de même. Personne ne donnait une pensée aux mondes plus anciens de l’espace comme sources de danger pour l’existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l’idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus les habitants de la Terre s’imaginaient-ils qu’il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux, et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l’espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la con quête de notre monde. Et dans les premières années du XXe siècle vint la grande désillusion..."
Nous sommes en 1894, alors que Mars est au plus près de la Terre. Le narrateur est témoin d'un flash de lumière dans son observatoire d'Ottershaw, dans le Surrey, en Angleterre , et un matin, une "étoile filante" s'écrase sur Horsell Common, une vaste étendue de terrain public près de la maison du narrateur à Maybury. Lorsque le narrateur se rend sur le site du crash, il trouve une foule d'une vingtaine de personnes réunies autour d'un grand objet cylindrique encastré dans une fosse de sable. Le cylindre s'ouvre le lendemain, un appendice tentaculaire s'accrochait à son bord tandis qu'un autre se balance dans les airs.
"Ceux qui n’ont jamais vu de Martiens vivants peuvent difficilement s’imaginer l’horreur étrange de leur aspect, leur bouche singulière en forme de V et la lèvre supérieure pointue, le manque de front, l’absence de menton au-dessous de la lèvre inférieure en coin, le remuement incessant de cette bouche, le groupe gorgonesque des tentacules, la respiration tumultueuse des poumons dans une atmosphère différente, leurs mouvements lourds et pénibles, à cause de l’énergie plus grande de la pesanteur sur la Terre et par-dessus tout l’extraordinaire intensité de leurs yeux énormes – tout cela me produisit un effet qui tenait de la nausée. Il y avait quelque chose de fougueux dans la peau brune huileuse, quelque chose d’inexprimablement terrible dans la maladroite assurance de leurs lents mouvements. Même à cette première rencontre, je fus saisi de dégoût et d’épouvante.
Soudain le monstre disparut. Il avait chancelé sur le bord du cylindre et dégringolé dans le trou avec un bruit semblable à celui que produirait une grosse masse de cuir, je l’entendis pousser un singulier cri rauque et immédiatement après une autre de ces créatures apparut vaguement dans l’ombre épaisse de l’ouverture.
Alors mon accès de terreur cessa. Je me détournai et dans une course folle m’élançai vers le premier groupe d’arbres, à environ cent mètres de là. Mais je courais obliquement et en trébuchant, car je ne pouvais détourner mes regards de ces choses."

En 1953, Byron Haskin adapta au cinéma "The War of the Worlds", avec Gene Barry, Ann Robinson, Les Tremayne, et en fit un modèle pour nombre de films de science-fiction à venir. Tourné en Technicolor par le directeur de la photographie George Barnes, dans le décor d'une petite ville du sud de la Californie digne des illustration d'un Chesley Bonestell, le maître de la science-fiction, Cedric Hardwicke ouvre le film en lisant les premières parties du roman de H.G. Wells, qui décrit les froides intelligences martiennes qui surveillent la Terre depuis millénaires. Quant aux machines de guerre des martiens, elles furent le directeur artistique Albert Nozaki, des raies manta volantes, d'où sort un long périscope qui ressemble à la tête d'un cobra, une image qui fut l'une des plus célèbres du cinéma de science-fiction...

H.G. Wells , "When the Sleeper Wakes" (1899)
"L’élément merveilleux de sa destinée prenait vie soudain. Pouvait-elle avoir été la sienne, en vérité, cette mesquine existence dont le souvenir persistait encore dans sa mémoire, cette vie d’il y avait deux cents ans… ? Et celle-ci lui appartenait-elle davantage ? - "When the Sleeper Wakes", écrit sous une pression considérable, a été publié en feuilleton dans The Graphic entre 1898 et 1903, et réécrit en 1910 sous le titre The Sleeper Awakes. Il raconte l'histoire d'un homme, Graham, un pamphlétaire radical attendant avec impatience le vingtième siècle et tous les progrès qu'il apportera, qui s'endort en 1897 et qui se réveille 203 ans plus tard pour découvrir Londres, métropole d'acier et de verre étincelante où tout est automatisé et mécanisé, et surtout qu'il est devenu le maître du monde. En effet, après s'être endormi, Graham a hérité d'une énorme somme d'argent dans un trust (le White Council) qui, pendant son sommeil, a géré ses avoirs, les ont investi dans un nouvel ordre mondial et ont établi leur propre vision de la domination politique et sociale. Ainsi, au réveil de Graham, d'un point de vue juridique, Graham possède la majorité de la planète. Le White Council tente d'assassiner Graham, mais des rebelles, dirigés par le dirigeant révolutionnaire Ostrog, l'aident à s'échapper. Graham se retrouve ainsi malgré lui au milieu d'une révolution naissante mais accepte de devenir un leader par défaut. Mais il ne tarde pas à ouvrir les yeux et à se rendre compte que l'ancien monde n'a pas totalement disparu et que les plus faibles sont toujours autant exploités....
"Le Maître de la terre n’était pas même, en ces conjonctures, maître de son propre esprit. Sa volonté semblait ne plus lui appartenir, ses actes mêmes le surprenaient et n’étaient qu’une partie de la confusion d’étrangetés qui pleuvaient sur son être. Les seules choses certaines, c’est que les aéroplanes étaient en route, qu’Hélène Wotton avait averti le peuple de leur venue, et qu’il était Maître de la terre. Chacun de ces faits luttait pour prendre complète possession de sa pensée. Ils se dégageaient d’un arrière-plan d’étendues fourmillantes, de passages élevés, de salles où délibéraient des chefs de sections, de chambres à cinématographes et à téléphones, et de fenêtres donnant sur les flots houleux de la cohue en marche. Il n’arrivait pas à saisir si l’homme en jaune, et d’autres qu’il entendait désigner sous le nom de chefs de sections, le poussaient en avant ou le suivaient avec soumission. Peut-être faisaient-ils un peu des deux. Peut-être quelque puissance invisible et insoupçonnée les dirigeait-elle tous. Mais il savait parfaitement qu’il était sur le point de lancer une proclamation au peuple de la Terre, et il avait dans son esprit des phrases grandioses, flottantes et imprécises comme ce qu’il voulait dire..."

H.G. Wells , "The First Men in the Moon" (1901)
Wells publie en 1901, "Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought", le premier d'une longue série de livres dans lesquels l'auteur essaie de prévoir, avec une fortune diverse, les formes de l'avenir. "The First Men in the Moon", publiée à l'origine en feuilleton dans The Strand Magazine de décembre 1900 à août 1901, au cours duquel un narrateur homme d'affaires, M. Bedford, et un scientifique excentrique, M. Cavor, découvrent que la Lune est habitée par une civilisation extraterrestre sophistiquée de créatures ressemblant à des insectes qu'ils appellent "Selenites".
"... Plus loin, un autre apparut, puis un troisième, et enfin, comme s'il guidait vers leur pâturage ces blocs mouvants, un sélénite apparut un court instant. J'agrippai convulsivement le pied de Cavor en apercevant ce nouvel être, et nous restâmes immobiles et le regard fixe, longtemps après qu'il eut disparu. Par contraste avec les veaux lunaires, il paraissait être une créature insignifiante, une fourmi, d'un mètre quatre-vingts de haut. Il portait des vêtements faits d'une substance semblable à du cuir, de sorte qu'aucune partie de son véritable corps ne paraissait ; mais cela, nous l'ignorions encore entièrement. Il se présentait donc comme une créature compacte et hérissée, ayant beaucoup d'analogie avec un insecte compliqué, muni de longs tentacules semblables à des lanières et d'un bras cliquetant, qui se projetait hors de son corps cylindrique et brillant. La forme de sa tête était dissimulée par une sorte de casque énorme et muni de pointes longues et nombreuses. Nous découvrîmes, par la suite, qu'il se servait de ces pointes pour aiguillonner les animaux récalcitrants, et une paire de besicles de verre sombre, disposée sur les côtés, donnait un aspect de gros bourgeon à l'appareil métallique qui recouvrait sa tête. Ses bras ne dépassaient pas l'espèce d'étui ou de fourreau qui enfermait son corps et il était soutenu par deux courtes jambes qui, bien qu'enveloppées dans une sorte de housse, paraissaient à nos yeux terrestres extraordinairement menues et faibles. Il avait des cuisses très courtes, des jambes fort longues et de petits pieds. Malgré son enveloppe d'aspect pesant, le Sélénite avançait par enjambées qui, au point de vue terrestre, eussent été considérables, et son appendice cliquetant était très affairé. La nature de ses mouvements, pendant le court instant où nous le vîmes passer, suggérait la hâte et une certaine irritation ; peu après
que nous l'eûmes perdu de vue, nous entendîmes le beuglement d'un des animaux se changer brusquement en un cri bref et aigu, suivi de bruissements plus rapides dus à l'accélération de son allure. Graduellement ces mugissements s'éloignèrent, et ils finirent par cesser, comme si les pâturages cherchés eussent été atteints.
Nous écoutâmes. Le monde lunaire sembla pour un instant avoir repris toute sa tranquillité. Mais nous n'osâmes pas recommencer immédiatement notre recherche rampante de la sphère disparue...."

H.G. Wells ,"A Modern Utopia" (1905)
"Anticipations" (1901), "Mankind in the Making" (1903), et surtout "A Modern Utopia" (1905), révèle bien pour Wells, et pour ses lecteurs, que l'humanité est engagée sur la voie d'un immense progrès non seulement technologique mais social. Après avoir exploré la possibilité d'un voyage temporel dans La Machine à explorer le temps, les manipulations génétiques dans L’Île du docteur Moreau, l’invisibilité dans L’Homme invisible, l’invasion extraterrestre dans La Guerre des Mondes ou encore l’exploration spatiale dans Les Premiers hommes sur la Lune, Wells s'interroge sur la possibilité d'un Etat mondial capable de libérer l'être humain et d'établir la paix et la justice en ce monde. Et ce qui l'obsède particulièrement, dans un premier temps, c'est de résoudre le problème que pourrait poser pour la planète Terre la combinaison du progrès et de la stabilité politique. " I wrote that book, écrira-t-il à propos d' "Anticipations", in order to clear up the muddle in my own mind about innumerable social and political questions, questions I could not keep out of my work, which it distressed me to touch upon in a stupid haphazard way, and which no one, so far as I knew, had handled in a manner to satisfy my needs. But Anticipations did not achieve its end..." Dans L'humanité en devenir, j'ai donc essayé, ajoutera Wells, "de revoir l'organisation sociale d'une manière différente, de la considérer comme un processus éducatif au lieu de la traiter comme une chose ayant une histoire future", puis, au bout du compte, "j'ai essayé de présenter non pas un simple idéal, mais un idéal en réaction avec deux personnalités" ( I have tried to present not simply an ideal, but an ideal in reaction with two personalities).
Dans "A Modern Utopia", deux terriens en villégiature dans les Alpes se retrouvent projetés sur une planète semblable à la Terre, un double de la planète, gouverné par un État mondial utopique. Pour mener ce récit à bien, une véritable expérience de l'Utopie, Wells va user d'une structure littéraire assez complexe, se limiter d'abord aux limites des possibilités humaines telles que nous les connaissons, puis laisser agir nos passions et incertitudes si destructrices : Wells a lu a République de Platon, la Nouvelle Atlantide, l'Utopie de More, ou les "News from Nowhere" de William Morris. Deux personnages interrogateurs vont donc se déployer en fond de cette exploration de l'Utopie moderne. Deux personnages, "the Owner of the Voice", "un homme blanchâtre et dodu, un peu en dessous de la taille et de l'âge moyen, avec des yeux bleus comme beaucoup d'Irlandais, agile dans ses mouvements et avec une légère calvitie amygdalienne - un penny pourrait le couvrir - de la couronne. Son front est convexe. Il s'abaisse parfois comme la plupart d'entre nous, mais pour la plupart, il se porte aussi vaillamment qu'un moineau. De temps en temps, sa main s'envole en faisant un geste d'illustration. Et sa voix (qui est désormais notre médium) est un ténor peu attrayant qui devient parfois agressif. Vous devez l'imaginer assis à une table en train de lire un manuscrit sur les Utopies, un manuscrit qu'il tient dans deux mains qui sont juste un peu grosses au poignet". Et l'accompagnant, "the botanist", "un homme plus maigre, plutôt plus grand, plus grave et beaucoup moins garrotté. Son visage est faiblement beau et fait dans des tons de gris, il est féerique et a les yeux gris, et on le soupçonnerait de dyspepsie. C'est un soupçon justifiable. Les hommes de ce type, remarque le président avec une soudaine intrusion d'exposition, sont romantiques avec une ombre de méchanceté, ils cherchent à la fois à dissimuler et à modeler leurs envies sensuelles sous des sentiments flagrants, ils s'embrouillent et s'attirent des ennuis avec les femmes, et il a eu ses ennuis. Vous en entendrez parler, car c'est la qualité de son type. Il n'a aucune expression personnelle dans ce livre"... Le narrateur anonyme et son compagnon de voyage vont donc, pour nous et à travers eux, explorer toutes les possibilités offertes par la société utopique de Wells...

Mais à partir de 1902, à 36 ans, avec "Miss Waters", l'imagination de Wells semble tarie, ou peut-être n'est-ce qu'une conséquence...
Lui qui pensait qu'il était possible, en utilisant ce qu'il a d'abord appelé "l'histoire inductive" (inductive history) et l'étude des "conséquences biologiques, intellectuelles et économiques" de nos possibilités intellectuelles, et donc de même dans faire un usage raisonnable, fut sans doute irrévocablement déçu par l'échec de sa vision politique idéalisée, un gouvernement mondial, qu'il décrit dans "A Modern Utopia" (1905). Il décide donc d'abandonner la science-fiction pour peindre la classe moyenne inférieure, ses espoirs et ses frustrations.
Ainsi dans "Love and Mr. Lewisham" (1900, The Story of a Very Young Couple), "Kipps : The Story of a Simple Soul" (1905), l'histoire d'un orphelin, Artie Kipps, en marche vers la classe supérieure fort d'un important héritage et de son éducation, "Tono-Bungay" (1909), "The History of Mr. Polly" (1910), Alfred Polly, un jeune homme de son temps, doué d'un "innate sense of epithet" mais qui a perdu une grande partie de sa confiance naturelle dans ses possibilités d'apprendre des choses et qui parvient pourtant à faire son chemin... .
Wells rencontre Beatrice et Sydney Webb, en 1903, rejoint la Société Fabian et devient un socialiste actif, bien que critique quant aux méthodes. L'amère querelle qu'il a déclenchée en 1906-07 par sa tentative infructueuse d'arracher le contrôle de la Fabian Society à George Bernard Shaw et aux Webb est racontée dans son roman "The New Machiavelli" (1911), dans lequel les Webb sont parodiés sous les traits des Bailey. Le roman est ambitieux, le personnage, Remington, est un jeune homme idéaliste qui déroule son récit à la première personne, devient parlementaire, tory, épouse la belle et intelligente Margaret, mais songe à une autre femme, Isabelle, la lutte de l'ambition et de l'amour dans une société marquée par l'hypocrisie permanente...

"Craving for some lovelier experience than life had yet given me" - "Miss Waters" (The Sea Lady) paraît en feuilleton de juillet à décembre 1901 dans Pearson's Magazine avant d'être publié en volume l'année suivante...
"Les Bunting ne se baignaient pas avec tout le monde, hommes et femmes mêlés, car cela paraissait encore d’une décence douteuse en 1900, mais M. Randolph Bunting et son fils Fred, bien que miss Mabel Glendower, la fiancée de Fred, fût du nombre des baigneuses, se dirigeaient franchement vers la plage avec ces dames, au lieu de se cacher ou d’aller faire une promenade, comme c’était l’usage autrefois. Ils s’avançaient en cortège sous les chênes verts du jardin, descendaient l’escalier et parvenaient ainsi jusqu’au bord de la mer En tête marchait Mme Bunting, le lorgnon sur le nez, comme pour découvrir aux environs le faune capable de reluquer indiscrètement les charmes de ses nymphes. Miss Adeline, qui ne se baignait jamais en public, car elle jugeait sa dignité diminuée en un appareil aussi sommaire, l’accompagnait, vêtue d’une de ces toilettes d’une simplicité artistique et coûteuse, telle qu’en arborent les opulentes socialistes..."
L'histoire, histoire fantastique et satirique, met en scène une créature de légende, une sirène, qui débarque sur la côte sud de l'Angleterre, à Sandgate, près de Folkestone, en 1899, et qui, adoptée par une riche famille anglaise, les Buntings, découvre la société anglaise prosaïque et raffinée, sous le nom de "Miss Doris Thalassia Waters". Une sirène qui en fait connait fort bien ce monde et qui a pour véritable objectif de séduire Harry Chatteris, un homme rencontré jadis dans les mers du Sud, près de Tonga. Harry Chatteris est un beau jeune homme, ami des Buntings, qui se présente comme candidat libéral aux prochaines élections , et qui, lors d'un précédent voyage en Amérique, s'était fiancé à la fille d'un millionnaire, l'avait abandonnée pour regagner l' Angleterre par les mers du Sud. Sa carrière de député est en fait sa façon de se racheter et de reprendre sa place dans la vie respectable, et c'est dans cette même perspective qu'il s'est fiancée avec la respectable Adeline Glendower , elle-même dotée d'un grand sens du devoir politique. A ce triangle amoureux il faut associé un certain Melville, un ami des Buntings et le cousin du narrateur. Melville ne cesse d'être interpellé par la singularité d'une Miss Waters qui ne connaît aucune convention sociale ou morale : " Il vous semble que telles choses sont convenables ou scandaleuses, bonnes ou mauvaises… parce que vous êtes dans un rêve, dans un petit rêve fantastique et malsain, si étriqué, si minuscule !", lui dit-elle. "Que voulez-vous dire ? Qui êtes-vous ?, lui rétorque Melville. Que venez-vous chercher dans une existence qui n’est pas la vôtre, vous qui prétendez être une femme et qui nous murmurez d’incompréhensibles paroles, à nous qui subissons cette existence, à nous qui ne pouvons nous en échapper ?". Chatteris, lui, ne peut résister aux pouvoirs de séduction de "Miss Waters" : il rompt les fiançailles avec Adeline, provoque un nouveau scandale, tandis que Mme Bunting ne tarde pas à réaliser que notre sirène n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Mais Chatteris mourra de s'être laissé emporté par un fantasme sexuel exotique plutôt qu'un mariage respectable. Est-ce du Wells? On a souvent rapproché ce roman, plus complexe qu'on ne pense, de "The Sacred Fount" publié par Henry James en 1901...




H.G. Wells , "Ann Veronica" (1909)
En 1906, Wells voyage pour la première fois aux Etats-Unis, rencontre Maxime Gorki à New-York, déjeune avec le président Theodore Roosevelt à la Maison-Blanche. Libre penseur en matière de sexe et de sexualité, Wells n'a pas laissé le mariage l'empêcher d'avoir d'autres liaisons.
Dans "A man of parts" (2011), David Lodge, érudit et satiriste, nous peint un H.G.Wells malade, séquestré dans sa maison de Regent's Park en 1944, et revient sur une vie remplie d'évènements, de livres et de femmes. Autrefois, il fut sans doute l'écrivain le plus célèbre du monde, "l'homme qui a inventé demain", mais aujourd'hui, il se sent comme l'homme d'hier, abandonné par les lecteurs et déprimé par l'effondrement de ses rêves utopiques. Et selon le décompte de Lodge, inspiré de "H. G. Wells in Love", un "Postscriptum" privé complétant "Experiment in Autobiography" de l'écrivain, Wells "a dû avoir bien plus de cent femmes dans sa vie", un décompte qui comprend deux épouses, - un premier mariage sexuellement décevant avec sa cousine Isabel, un son second tout aussi peu passionné, avec Amy Catherine Robbins (Jane, "Elle avait toujours considéré mon imagination sexuelle comme une sorte de maladie constitutionnelle ; elle m'a soutenu patiemment, attendant discrètement que la fièvre s'apaise") -, quatre ou cinq maîtresses de longue date, deux adolescentes filles de collègues dirigeants de la Société Fabian, plusieurs écrivains comme Rebecca West, Elizabeth von Arnim, Margaret Sanger, Martha Gellhorn, ainsi qu'un probable agent-double soviétique, Moura Budberg, le dernier grand amour de Wells.
La grande passion de Wells dans les années 1908-1909 pour Amber Reeves (1887-1981), la brillante fille de dix-neuf ans sociétaire de la Cambridge University Fabian Society, lui inspira un roman à clef, "Ann Veronica" (1909), puis le personnage d'Amanda dans son roman "The Research Magnificent" (1915). Amber Reeves lui apporta, dira-t-il, tout l'imaginaire sexuel que sa femme, Jane, ne pouvait supporter, mais il ne put se résoudre à quitter cette dernière. Sa liaison avec Amber Reeves a abouti à la naissance de leur fille Anna-Jane en 1909, date à laquelle il rencontre Elizabeth von Arnim dite Little E.
"Ann Veronica" raconte l'histoire d'une fille de classe moyenne "libérée", Ann Veronica Stanley, qui déménage à Londres, devient suffragette et tombe amoureuse de son professeur de sciences marié, M. Capes. Rien ici n'évoquera une quelconque scène de sexe, mais un contexte résolument féministe (Sarah Grand incarne l'archétype de la « femme nouvelle » (New Woman) en 1894, et Henry James en popularise l'attitude dans "Daisy Miller", 1878) : "mon livre fut écrit essentiellement pour exprimer le ressentiment et la détresse qu'éprouvent aujourd'hui beaucoup de femmes devant le fait qu'elles dépendent pratiquement et inévitablement de quelque individu masculin qu'elles n'ont point délibérément choisi, et en accord complet avec l'idée naturelle mais peut-être anarchique et antisociale, qu'il est intolérable pour une femme d'avoir des rapports sexuels avec un homme qu'elle n'aime pas..." (I confess myself altogether feminist. I have no doubts in the matter [...] My book was written primarily to express the resentment and distress which many women feel nowadays at their unavoidable practical dependence upon some individual man not of their deliberate choice, and in full sympathy with the natural but perhaps anarchistic and antisocial idea that it is intolerable for a woman to have sexual relations with a man with whom she is not in love, and natural and desirable and admirable for her to want them, and still more so to want children by a man of her own selection, “Letter to the Editor"). Et des dialogues particulièrement "libérés" en pleine respectabilité victorienne...





Ce qui a attiré Amber Reeves et Rebecca West et tant d'autres, ce n'est pas la présence physique de Wells - une enfance mal nourrie l'avait laissé petit et léger, jusqu'à ce qu'il devienne petit et costaud avec l'âge - mais ce qu'il représentait. Wells croyait sincèrement à la franchise sexuelle et à la libération des femmes, à une époque où la chasteté victorienne se figeait dans une hypocrisie pesante. Il le montre clairement dans sa description de Capes, l'un des nombreux personnages de sa fiction basée sur lui-même : "Capes était sûrement différent. Capes en regardait un et pas un autre, parlait à un autre, le traitait comme un fait concret visible. . . . De toute façon, il ne l'a pas sentimentalisée".
"So much life with (so to speak) so little living." (Tant de vie avec (pour ainsi dire) si peu de vie), écrira James à propos d'un certain Wells. Le peu de sentimentalisme sexuel de Wells apparaît clairement dans ses mémoires. Il a fait une exception pour ses femmes et deux ou trois de ses maîtresses, mais le reste de ses passages, écrit-il, "ont eu à peu près la même place dans ma vie que la pêche à la mouche ou le golf ont dans la vie de beaucoup d'hommes occupés". On pourrait dire qu'en matière de sexe, comme en matière d'art, Wells était un homme trop moderne pour se préoccuper de ce que James appelait le doute, la passion et la tâche. Il écrivait et aimait de manière pragmatique et hygiénique, afin de libérer certaines énergies et d'atteindre certains objectifs. C'est pourquoi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fameux célibat d'Henry James est plus fertile pour notre imagination que l'amour de Wells - tout comme l'art de James est plus convaincant que la productivité de Wells. James croyait que sa façon de vivre et d'écrire avait une valeur symbolique permanente, et le fait d'y croire la rendait réelle.
La conviction la plus profonde de Wells, en revanche, s'exprime dans les dernières pages de son roman "Tono-Bungay", dans lequel un voyage à travers Londres sur la Tamise devient une métaphore de la mutabilité de toutes les choses humaines. "Le fleuve passe - Londres passe, l'Angleterre passe", écrit Wells. "Nous sommes tous des choses qui font et qui passent, et nous nous efforçons d'accomplir une mission cachée, en pleine mer". Le problème qu'il se posait était de savoir comment combiner cette mission, sa dévotion furieuse au progrès humain, avec la certitude froide que la fin de tout progrès serait l'entropie, la dévolution, la nullité. La façon dont il a vécu ce paradoxe, plus encore que ses livres, est ce qui fait de Wells, encore, un homme moderne peut-être exemplaire...

H.G. Wells , "The Country of the Blind" (1911)
Wells fut l'auteur de plusieurs douzaines de nouvelles, la plus connue étant "The Country of the Blind" (1911), publiée en avril 1904 dans The Strand Magazine. Un alpiniste, Nuñez, au cours d'une ascension dans les Andes, disparaît et se retrouve accidentellement dans une contrée inconnue, isolée du reste du monde, le "pays des aveugles". "Les trois hommes, debout côte à côte, ne le regardaient pas venir ; mais ils tendaient l’oreille dans sa direction et semblaient fort attentifs au bruit inaccoutumé de ses pas. Ils se pressaient l’un contre l’autre comme des gens qui ont peur, et Nuñez observait leurs paupières closes et renfoncées, sous lesquelles il ne devait plus y avoir de globe oculaire. Leurs visages exprimaient l’inquiétude. – Un homme… C’est un homme… Un homme ou un esprit qui descend par les rochers, – proféra l’un des aveugles dans un espagnol à peine reconnaissable. Nuñez avançait, du pas confiant de l’adolescent qui entre dans la vie. Toutes les vieilles histoires de la vallée ensevelie et du Pays des Aveugles lui étaient revenues en mémoire et, comme un refrain dans ses pensées, il se répétait le proverbe : Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois..."...
"Three hundred miles and more from Chimborazo, one hundred from the snows of Cotopaxi, in the wildest wastes of Ecuador's Andes, there lies that mysterious mountain valley, cut off from all the world of men, the Country of the Blind. Long years ago that valley lay so far open to the world that men might come at last through frightful gorges and over an icy pass into its equable meadows, and thither indeed men came, a family or so of Peruvian half-breeds fleeing from the lust and tyranny of an evil Spanish ruler. Then came the stupendous outbreak of Mindobamba, when it was night in Quito for seventeen days, and the water was boiling at Yaguachi and all the fish floating dying even as far as Guayaquil; everywhere along the Pacific slopes there were land-slips and swift thawings and sudden floods, and one whole side of the old Arauca crest slipped and came down in thunder, and cut off the Country of the Blind for ever from the exploring feet of men..."
" À plus de trois cents milles du Chimborazo, à une centaine de milles des neiges du Cotopaxi, dans la région la plus déserte des Andes équatoriales, s’étend une mystérieuse vallée : le Pays des Aveugles. Il y a fort longtemps, cette vallée était suffisamment accessible pour qu’on pût, après avoir franchi d’effroyables gorges et un glacier périlleux, parvenir jusqu’à ses pâturages ; et, en effet, quelques familles de métis péruviens s’y étaient réfugiées, fuyant la cruauté et la tyrannie de leurs maîtres espagnols. Puis était venue la stupéfiante éruption du Mindobamba, qui, pendant dix-sept jours, plongea Quito dans les ténèbres ; les sources bouillaient à Yaguachi, et, sur les rivières, jusqu’à Guyaquil, les poissons morts flottaient. Partout, sur le versant du Pacifique, il y eut des avalanches, des éboulements énormes, des dégels subits et des inondations ; l’antique crête montagneuse de l’Arauca glissa et s’écroula avec un bruit de tonnerre, élevant à jamais une infranchissable barrière entre le Pays des Aveugles et le reste des hommes..."
Nuñez va tenter de prendre le pouvoir sur les habitants, tous aveugles depuis des générations, mais la situation va se retourner contre lui : il ne parvient pas à s'acclimater à la société développée par les aveugles, à un temps partagé entre la sensation du chaud et celle du froid, il ne peut pas travailler dans l'obscurité et dormir le jour comme eux, ses sens ne sont pas autant aiguisés, il apparaît très rapidement comme un être totalement inadapté, maladroit et inutile. "Leurs sens, devenus extraordinairement aigus, leur permettaient, à une distance d’une douzaine de pas, d’entendre et de deviner quel geste faisait un homme ; ils percevaient même les battements de son cœur. L’intonation de la voix avait remplacé l’expression du visage, et le toucher, les gestes .." Il cède donc à cette existence, se soumet, toute résistance étant vaine. "Ainsi Nuñez devint citoyen du Pays des Aveugles : les habitants cessèrent d’être un groupement impersonnel ; ils furent pour lui des individus avec lesquels il se familiarisa, tandis que le monde de par-delà les montagnes se perdait dans le lointain et l’irréel. Il connut surtout Yacob, son maître, homme bienveillant quand rien ne le contrariait ; Pedro, neveu d’Yacob, et Medina-Saroté, la plus jeune fille de son maître. Celle-ci était peu prisée de ses compatriotes, parce qu’elle avait un visage aux traits nets et non pas cette face aplanie et flasque qui est l’idéal de la beauté féminine chez les aveugles. Nuñez, dès le début, l’avait trouvée agréable, et bientôt elle fut pour lui le plus bel objet de la création." Il va donc se mettre en tête de la séduire et l'épouser, "le moment arriva où Nuñez se dit que, s’il pouvait l’obtenir, il se résignerait à vivre dans la vallée le reste de ses jours." Son projet de mariage ne souleva pas d'enthousiasme la communauté, - on le prenait pour un idiot et un incapable -, jusqu'au jour où l'un des Anciens, parmi les plus doctes, eut une idée : le rendre aveugle...
Seule solution, fuir. "Au cours de la nuit il avait décidé de se rendre en un endroit écarté, d’où les prairies seraient belles de narcisses blancs, et d’y rester jusqu’à l’heure de son sacrifice ; mais, tout en cheminant, il leva les yeux, et il vit le ma- tin, le matin qui descendait les pentes de la montagne, comme un ange en armure d’or. Devant cette splendeur, il lui sembla que le monde aveugle de la vallée, et lui-même et son amour n’étaient pas autre chose qu’un cauchemar infernal. Renonçant à la prairie des narcisses, il continua d’avancer, franchit le mur d’enceinte et gagna les pentes rocheuses, les yeux fixés sur les glaciers et les neiges ensoleillées. Il vit leur beauté infinie, et son imagination prit l’essor vers les choses d’au-delà, avec lesquelles il avait consenti à rompre pour toujours...."
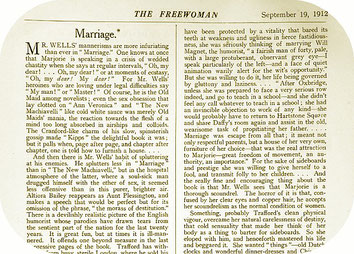
H.G. Wells , "Mariage" (1912) - Publié en série dans le magazine American Magazine de novembre 1911 à octobre 1912, "Mariage" est une nouvelle de plus de 500 pages qui conte le mariage, contre sa volonté, de Marjorie Pope, la fille aînée d'un fabricant de voitures dont l'entreprise a été ruinée par l'avènement de l'automobile, et de R.A.G. Trafford, un physicien spécialisé en cristallographie, un mariage que tout rendait improbable mais qui parvient à trouver sa voie dans la nature sauvage du Labrador, dans l'Est du Canada. Et c'est précisément par cette nouvelle qu'en 1913, Wells a 46 ans, il rencontre Rebecca West, elle a 21 ans, alors critique du Clarion et séduite par la mécanique intellectuelle du célèbre auteur. Quant à elle, elle commence à être déjà connue pour son engagement féministe et son franc-parler. Leur liaison durera une dizaine d'années (1913-1923), une relation qui ne sera pas sans conséquences sur leur créativité littéraire et auront un fils, Anthony, né en 1914 et auteur d'une biographie, "Heritage" (1955) particulièrement amère.

Wells croyait fermement à la liberté d'expression et de pensée, à l'élimination de la guerre par la coopération internationale, et dans le même temps éprouvait une sainte horreur pour toute cette "multitude de créatures méprisables et stupides, animées par la peur, impuissantes et inutiles, malheureuses ou haineusement heureuses au milieu d'un sordide déshonneur, faibles, laides, inefficaces, nées de convoitises effrénées, et qui se multiplient et s'accroissent par pure incontinence et stupidité", utopie d'Anticipations oblige. Toutes les contradictions d'un progressisme pur et dur croyant en un univers à venir radieux.
La Première Guerre mondiale ébranlera la foi de Wells dans le progrès humain, mais sans de véritables remises en cause, ni "An Englishman Looks at the World" (1914), un recueil d'articles hétéroclites écrits entre 1909 et 1914, ni "The War That Will End War" (1914), compilation dont le titre paradoxal montre à quel point Wells entretient toujours l'espoir que l'humanité cesse un jour de se faire la guerre. Dans ses travaux ultérieurs, il modifiera sa conception de l'évolution sociale, avançant l'idée que l'homme ne pouvait progresser que s'il s'adaptait aux circonstances changeantes par le biais de la connaissance et de l'éducation, romans et essais se succèdent faisant feu de tout bois pour entretenir la flamme: 295 pages de spéculations avec "What Is Coming?" (1916), qui montre que le pouvoir de la raison humaine doit l'emporter sur la passion et l'État mondial sur l'État-nation, "God the Invisible King" (1917), une erreur, avouera plus tard Wells provoquée par la consternation et l'anxiété, les 750 pages de "Joan and Peter" (1918), qui critiquent la stagnation de l'éducation en Angleterre pendant ces années cruciales avant la Grande Guerre, "The Undying Fire" (1919), une curieuse reprise du Livre de Job qui montre toute la détermination nécessaire à l'homme qui enseigne aux autres hommes ("We can open his eyes to the past and to the future and to the undying life of Man. So through us and through us only, he escapes from death and futility").

Et parmi ceux-ci, "Mr. Britling Sees It Through" (1916), met en scène un homme de lettres célèbre qui vit parmi les siens dans sa propriété de campagne de Matching's Easy, dans l'Essex, en toute quiétude, donc un certain H.G.Wells qui nous révèle ses réactions devant la guerre de 1914-1918, ce fut un véritable succès, le plus humain des ouvrages de Wells : "Matching's Easy At Ease", récit, paisible, du long été d'avant-guerre édouardien; "Matching's Easy at War", l'avènement de la guerre, Heinrich, un ami allemand de la famille, doit regagner son pays, le secrétaire de Britling, Teddy, s'engage, son fils bien-aimé Hugh s'engage lui aussi, secrètement, et meurt au front; "The Testament of Matching's Easy", dernière partie, toute une nuit au cours de laquelle Britling, qui a survécu au traumatisme et aux bouleversements que la guerre lui a infligé, va coucher par écrit son immense désarroi.
"His lamp was still burning, but for some time he had not been writing by the light of his lamp. Insensibly the day had come and abolished his need for that individual circle of yellow light. Colour had returned to the world, clean pearly colour, clear and definite like the glance of a child or the voice of a girl, and a golden wisp of cloud hung in the sky over the tower of the church. There was a mist upon the pond, a soft grey mist not a yard high. A covey of partridges ran and halted and ran again in the dewy grass outside his garden railings. The partridges were very numerous this year because there had been so little shooting. Beyond in the meadow a hare sat up as still as a stone. A horse neighed. Wave after wave of warmth and light came sweeping before the sunrise across the world of Matching's Easy. It was as if there was nothing but morning and sunrise in the world..."

"Man lives in the dawn for ever" - En 1914, Wells voyage pour la première fois en Russie et publie "A Prophetic Trilogy" dans le Century Illustrated Monthly Magazine, édité sous le titre "The World Set Free" (La Destruction libératrice). Mais cette histoire de la maîtrise de la puissance et de l'énergie par l'homme, facteur de progrès technologique et donc humain, a pris une nouvelle dimension. L'époque est à l'accélération des connaissances relatives à la radioactivité, quinze ans après sa découverte, et si la lente désintégration radioactive naturelle d'éléments comme le radium peut se poursuivre pendant des milliers d'années un taux de libération d'énergie négligeable, la quantité totale libérée dépasse l'entendement. Wells a lu William Ramsay, Ernest Rutherford et Frederick Soddy (1877-1956) qui a découvert la désintégration de l'uranium. Avec son génie habituel, l'entremise d'un personnage, Marcus Karenin, Wells monte un réquisitoire contre les dangers de l'arme nucléaire (atom bombs) et la mise au point d'armes capables potentiellement de détruire complètement la civilisation. L'espoir de voir de construire un nouvel État mondial utopique ne s'amenuise pas pour autant : si l'introduction de l'énergie atomique dans un monde divisé peut entraîner l'effondrement de la société, reste à la seule alternative d'une rechute de l'humanité dans la barbarie des premiers âges, l'acceptation de la science comme base d'un nouvel ordre social.
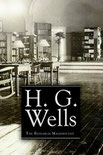
"This is the story of a man who was led into adventure by an idea..." - En 1915, Wells conte la vie de William Porphyry Benham ("The Research Magnificent"), un homme qui n'a pas besoin de travailler, indépendant des nécessités quotidiennes, qui peut voyager à travers le monde, se marier et se séparer de sa femme, mais qui a persévé à suivre un chemin et connu des situations au cours desquelles le fantastique a pu cotoyer le ridicule. Le temps est venu pour lui d'un peu d'introspection, quelle est donc l'idée qui l'a mené jusque-là, "une idée qui peut jouer un si grand rôle dans une vie doit nécessairement avoir quelque chose de la complication et de la qualité protéiforme de la vie elle-même" (An idea that can play so large a part in a life must necessarily have something of the complication and protean quality of life itself. It is not to be stated justly in any formula, it is not to be rendered by an epigram). L'idée de Benham était finalement des plus simples : il était incurablement persuadé "qu'il devait vivre la vie noblement et complètement", une "vie aristocratique", au sens d'intensité et de clarté. "Pour lui, la noblesse était de tirer quelque chose de son existence individuelle, une flamme, un joyau, une splendeur" (Nobility for him was to get something out of his individual existence, a flame, a jewel, a splendour). En retraçant le parcours de son personnage, Wells en fin de compte en viendra à nous montrer que le monde, un monde par trop passif, n'est décidément pas en mesure de faire un peu de place aux thèses et à la personnalité qui est la sienne...

Peut-on imaginer un écrivain comme Henry James (1843-1916), pratiquer comme Wells le "hobby war game" et écrire en 1913 pour ses fils "Little War", un "floor game" qui met en jeu petits soldats, briques, planches, madriers en bois, matériel roulant et rails de chemin de fer électrique? C'est à cette époque que Wells s'engage dans cette fameuse querelle qu'il eut avec Henry James, Wells a 49 ans, en pleine interrogation sur lui-même, Henri James 72 ans, à la fin de sa vie. L'occasion: la publication de "Boon" (The Mind of the Race, the Wild Asses of the Devil, and The Last Trump: Being a First Selection from the Literary Remains of George Boon, Appropriate to the Times, Prepared for Publication by Reginald Bliss, with an Ambiguous Introduction by H.G. Wells). Wells s'était demandé non sans humour si au bout du compte la conscience collective (the Mind of Humanity) pouvait réellement exister, si quelque chose de plus étendu que les volontés individuelles et les processus individuels de raisonnement pouvait habiter l'humanité, un Esprit commun exprimant l'espèce (a common Mind expressing the species). Wells évoque, avec ambiguïté, "The Mind of the Race", c'est malheureusement l'époque. Mais c'est bien la littérature qui semble ici poser problème, "Mon cher James, qu'est-ce que cet esprit d'humanité sans une certaine touche de romantisme, d'aventure ? Au cours des dernières décennies, face aux formidables avancées de la science qui semblent promettre monts et merveilles, que nous apporte la scène littéraire, une abondance d'activités, une énorme richesse de matière : "Personne n'a pu apprécier, savourer, observer et réagir, plus que moi, à l'énorme bruit croissant du processus mental tel qu'il s'est manifesté au cours du dernier demi-siècle". Mais lorsqu'il s'agit de rassembler tout cela, on peut s'interroger à un moment donné sur la finalité de telles entreprises. Et si l'on quitte la question implicite que pose "Reginald Bliss", au fond à quoi sert la littérature, on peut rappelait que Henry James comparait la technique littéraire de la génération de Wells à celle d'un homme qui presse une éponge par une fenêtre ouverte. Mais, rétorque Wells, est-ce une raison pour concevoir des personnages de roman qui ne transpirent ni ne s'agitent frénétiquement, ou des intrigues laborieusement construites indice par indice. Quelle est la finalité d'un style de prose aussi laborieux que celui du "grand James", un hippopotame essayant de ramasser un pois ( It is leviathan retrieving pebbles. It is a magnificent but painful hippopotamus resolved at any cost, even at the cost of its dignity, upon picking up a pea which has got into a corner of its den). Tous les deux en fait ne partagent pas la même vision de la littérature, tout simplement. Au contraire de James qui sacralise l'écriture et recherche l'oeuvre parfaite, Wells ne se pense pas en ce début du XXe romancier, mais un essayiste progressiste au service de cet avenir toujours aussi radieux qu'offre la science...
En 1920, Wells quitte alors les rivages de l'éducation, pour l'Histoire (The Outline of History, 1920), la biologie (The Science of Life, 1931), et l'économie (The Work, Wealth and Happiness of Mankind, 1932)...



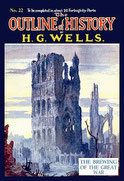
H.G. Wells , "The Outline of History" (1920)
The Making of our World - "There can be no peace now, we realize, but a common peace in all the world; no prosperity but a general prosperity. But there can be no common peace and prosperity without common historical ideas. Without such ideas to hold them together in harmonious co-operation, with nothing but narrow, selfish, and conflicting nationalist traditions, races and peoples are bound to drift towards conflict and destruction." - En 1920, Wells voyage en Russie, rencontre à nouveau Maxim Gorky (1868-1936) et Moura Budberg (1892-1974), femme de lettre russe et agent double...
Mais c'est surtout à cette date que Wells va publier son oeuvre ma plus vendue de son vivant, "The Outline of History", "l'image sans précédent de toute l'humanité actuelle et dans toutes ses multiples activités", deux millions d'exemplaires à la fin des années 1920 et, périodiquement mis à jour, tout au long du siècle, traduite dans en nombre de langues. L'impact fut immense sur la culture et l'éducation du milieu du siècle. La querelle esquissée entre Henry James et H.G.Wells révèle à sa manière que nous sommes entrer, en 1920, dans un autre monde. Et si le style est particulièrement clair, fluide, Wells continue à faire avancer ses idées pour l'avenir : la création de notre monde, la Terre dans l'espace et le temps, la création de l'homme, le processus d'évolution par sélection naturelle, l'ère des reptiles, l'ère des mammifères, les premiers hominidés, l'homme de Neandertal et l'homo sapiens, l'origine du langage, l'agriculture, l'organisation sociale à grande échelle, la guerre et les débuts de la civilisation sociale et culturelle. L'histoire de l'humanité parcourt "les cinq premiers millénaires" d'un récit historique jugé cohérent, de la "vie aryenne primitive" aux Sumériens, Assyriens, Chaldéens et Égyptiens, en passant par les premières civilisations de l'Inde et de la Chine, l'invention de l'écriture et la fusion des sentiments religieux en systèmes fixes de "dieux et étoiles, prêtres et rois". Les livres suivant s'attachent successivement à la Judée, la Grèce et l'Inde, de Saül, David et Salomon jusqu'à Alexandre le Grand, l'essor et l'effondrement de l'Empire romain, les débuts, essor et divisions du christianisme et de l'islam, le "Grand Empire de Jengis Khan" et la Renaissance européenne. Si la période entre 400 et 1600 après J.-C. n'est pas traitée ("l'histoire de l'Europe du cinquième au quinzième siècle est très largement l'histoire de l'échec de cette grande idée d'un gouvernement mondial divin à se réaliser dans la pratique"), le chapitre "Princes, Parlements et Pouvoirs" suggère que l'ère de l'absolutisme monarchique a commencé à céder la place, vers 1700, à la logique politique moderne des "forces nouvelles et informes de la liberté dans la communauté". On se déplace rapidement à travers la montée des "nouvelles républiques démocratiques d'Amérique et de France", Napoléon est ignoré, le récit se déroule jusqu'en 1920, via le XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. L'ensemble du XIXe siècle apparaît comme "l'accroissement des connaissances et la clarté de la pensée : la phase nationaliste". Le dernier chapitre, "La fin de la période des grandes puissances" permet de conclure que l'État mondial est sur le point de s'imposer. "We can venture to prophesy that the next chapters to be written will tell, though perhaps with long interludes of set-back and disaster, of the final achievement of world-wide political and social unity..."
À cette époque, Wells a également essayé de faire avancer ses idées politiques dans le monde réel. Il se présente au Parlement en tant que candidat du parti travailliste en 1922 et 1923, mais ces deux efforts se soldent par un échec. Parallèlement, de nouvelles façons d'appréhender la modernité de notre monde et de penser son avenir possible, inéluctable, vont progressivement se constituer : Aldous Huxley et George Orwell entreront ainsi en contact avec H.G.Wells, dans les dix dernières années de sa vie, 1930-1940...
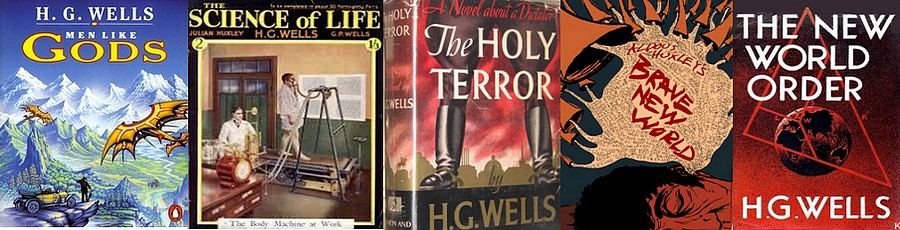
"You are the first Utopians I have actually seen at work," he said - Dans "Men Like Gods" (1923), Wells invite les lecteurs à une utopie futuriste, toujours et encore notre planète Terre après des milliers d'années de progrès...
"Mr. Barnstaple was, indeed, ceasing to secrete hope, and for such types as he, hope is the essential solvent without which there is no digesting life. His hope had always been in liberalism and generous liberal effort, but he was beginning to think that liberalism would never do anything more for ever than sit hunched up with its hands in its pockets grumbling and peeving at the activities of baser but more energetic men. Whose scrambling activities would inevitably wreck the world.
Night and day now, Mr. Barnstaple was worrying about the world at large. By night even more than by day, for sleep was leaving him. And he was haunted by a dreadful craving to bring out a number of the Liberal of his very own —to alter it all after Mr. Peeve had gone away, to cut out all the dyspeptic stuff, the miserable, empty girding at this wrong and that, the gloating on cruel and unhappy things, the exaggeration of the simple, natural, human misdeeds of Mr. Lloyd George, the appeals to Lord Grey, Lord Robert Cecil, Lord Lansdowne, the Pope, Queen Anne, or the Emperor Frederick Barbarossa (it varied from week to week), to arise and give voice and form to the young aspirations of a world reborn, and, instead, to fill the number with —Utopia! to say to the amazed readers of the Liberal: Here are things that have to be done! Here are the things we are going to do! What a blow it would be for Mr. Peeve at his Sunday breakfast! For once, too astonished to secrete abnormally, he might even digest that meal!
But this was the most foolish of dreaming. There were the three young Barnstaples at home and their need for a decent start in life to consider. And beautiful as the thing was as a dream, Mr. Barnstaple had a very unpleasant conviction that he was not really clever enough to pull such a thing off. He would make a mess of it somehow..."
Et c'est ainsi que le brave Mr. Barnstaple se retrouve par accident projeté dans un monde parralèle peuplé d'innombrables Utopistes: ce n'est pas un gouvernement qui règne sur eux, mais l'éducation, il n'y a plus ni politique, ni religion, mais la vie personnelle, la libre circulation des personnes, la connaissance illimitée, la vérité et la libre discussion. Et M. Barnstaple retournera sur la planète Terre fort de son expérience...
Après "Men Like Gods" (1923), suivront "The Science of Life" (1930), "The Shape of Things to Come" (1933), "The Holy Terror" (1939), "The New World Order" (1939)...
Or, en 1932, in certain Aldous Huxley (1894-1963) publie "Brave New World" (1932), pour nombre une parodie et une critique des idées utopiques de Wells. Il est singulier que tous deux, Wells et Huxley, à quasiment 30 ans d'intervalle, une génération, aient été inspirés par Thomas Henry Huxley (1825-1895), le grand-père d'Aldous Huxley, qui a cherché toute sa vie les preuves nécessaires pour transformer les idées évolutionnistes de Charles Darwin (1809 - 1882) en faits. Mais si avec Wells la technologie peut changer la route de l'évolution de l'humanité, comme pour le fameux voyageur du temps, Aldous Huxley voit plutôt dans la technologie le moyen, pour l'humanité de prendre le contrôle de son évolution.
C'est aussi à cette époque que prend fin la relation de H.G.Wells avec Rebecca West : "I always knew that you would hurt me to death some day, but I hoped to choose the time and place. You’ve always been unconsciously hostile to me and I have tried to conciliate you by hacking away at my love for you, cutting it down to the little thing that was the most you wanted. I am always at a loss when I meet hostility, because I can love and I can do practically nothing else...", écrira-t-elle, magnifique...

H.G. Wells , "The Shape of Things to Come" (1933)
Wells se lance dans le cinéma dans les années 1930. En voyageant à Hollywood, il adapte au grand écran son roman de 1933, "The Shape of Things to Come" qui spécule sur les événements futurs jusqu'à l'année 2106. N'avait-il pas déjà publié en 1897 "A Story of the day to come", dans The Pall Mall Magazine, puis dans un recueil de nouvelles, "Tales of Space and Time": Le Londres du début du 22e siècle compte plus de 30 millions d'habitants, les classes inférieures vivant dans des logements souterrains, et les classes moyennes et supérieures dans des gratte-ciel et des logements en grande partie collectifs. Des trottoirs roulants relient la ville entre elles, avec des liaisons aériennes rapides et des autoroutes entre les villes. Ici, une longue crise économique provoque une guerre majeure qui laisse l'Europe dévastée et menacée par la peste. Les nations disposant des forces aériennes les plus puissantes mettent en place une dictature bienveillante qui ouvre la voie à la paix mondiale en abolissant les divisions nationales, en promouvant l'apprentissage scientifique et en interdisant la religion. Les citoyens du monde éclairés seront capables de renverser pacifiquement les dictateurs, et de créer une nouvelle race de super-talents, capable de maintenir une utopie permanente...
Son film de 1936, intitulé "Things to Come", réalisé par William Cameron Menzies, avec Raymond Massey, Edward Chapman, Ralph Richardson, conte l'histoire d'un siècle, une seconde guerre mondiale qui dure des décennies, laissant un monde livré à la peste et à l'anarchie, pour voir émerger un État rationnel qui reconstruit la civilisation et tente de voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, Wells a travaillé sur la version cinématographique d'une de ses nouvelles, "The Man Who Could Work Miracles"...

Orson Welles’s radio play remains the most famous adaptation of Wells’s novel. On October 30, 1938, Welles presented an adaptation of The War of the Worlds on his radio program, The Mercury Theatre on the Air. La pièce radiophonique d'Orson Welles reste l'adaptation la plus célèbre du roman de Wells. Le 30 octobre 1938, Welles a présenté une adaptation de La guerre des mondes dans son émission de radio, The Mercury Theatre on the Air. Comme Wells le dira plus tard aux journalistes, il a écrit (et joué) la pièce radiophonique pour qu'elle ressemble à une véritable émission d'information sur une invasion de Mars. Certains auditeurs qui ont manqué l'introduction de la pièce ont pris l'émission pour une véritable couverture médiatique d'une invasion martienne. La réaction qui en a résulté a été fortement exagérée par la presse. Les titres des journaux américains ont rapporté que "Attack from Mars in Radio Play Puts Thousands in Fear", "Radio Listeners in Panic, Taking War Drama As Fact" et "Radio Fake Scares Nation". Le 31 octobre, le New York Times a rapporté que des milliers de personnes "ont appelé la police, les journaux et les stations de radio ici et dans d'autres villes des États-Unis et du Canada pour demander des conseils sur les mesures de protection contre les raids". Au total, on estime que l'émission a trompé environ 20 %, soit moins d'un million, de ses auditeurs...

H.G. Wells , "Mind at the End of Its Tether" (1945)
En 1939, alors que l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, Wells publie "The Fate of Homo Sapiens", une vaste synthèse qui débute par la signification de la guerre comme une conséquence de la réussite évolutive et biologique de notre espèce: "primitive war was a necessity forced upon the human community by biological success through the production of a surplus of young males". Mais on y retrouve toute l'ambiguïté parfois détestable du climat antisémite d'une époque préparant les convulsions de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Wells publie son dernier roman, "You can't be too careful" (Un homme averti en vaut deux), un ouvrage qui n'apporte plus rien de neuf.
En 1941-1942, une polémique oppose Wells, le fervent partisan du grand potentiel de la science, et George Orwell (1903-1950) qui n'a cessé de jeter sur elle un point de vue des plus sceptiques ("Nineteen Eighty-Four" date de 1949).
“What is Science?”, s'interroge Orwell, les jeunes sont-ils mieux éduqués parce qu'ils en ont plus appris sur la radioactivité ou les étoiles, plutôt que sur la façon de "penser plus précisément". Une personne de formation scientifique aura-t-elle une approche plus intelligente des choses qu'une personne qui en est dépourvue? De plus, sans les scientifiques, continue Orwell, "la machine de guerre allemande n'aurait jamais pu être construite." Les personnes pensantes qui sont nées vers le début de ce siècle", écrivait George Orwell en 1941, "sont en quelque sorte la propre création de Wells' (Thinking people who were born about the beginning of this century, are in some sense Wells's own creation). Dans "Wells, Hitler, and the World State" (1941), Orwell semble en terminer définitivement avec Wells et l'époque qui le porta...
"But is it not a sort of parricide for a person of my age (thirty-eight) to find fault with H.G. Wells? Thinking people who were born about the beginning of this century are in some sense Wells's own creation. How much influence any mere writer has, and especially a ‘popular’ writer whose work takes effect quickly, is questionable, but I doubt whether anyone who was writing books between 1900 and 1920, at any rate in the English language, influenced the young so much. The minds of all of us, and therefore the physical world, would be perceptibly different if Wells had never existed. Only, just the singleness of mind, the one-sided imagination that made him seem like an inspired prophet in the Edwardian age, make him a shallow, inadequate thinker now. When Wells was young, the antithesis between science and reaction was not false. Society was ruled by narrow-minded, profoundly incurious people, predatory business men, dull squires, bishops, politicians who could quote Horace but had never heard of algebra. Science was faintly disreputable and religious belief obligatory. Traditionalism, stupidity, snobbishness, patriotism, superstition and love of war seemed to be all on the same side; there was need of someone who could state the opposite point of view. Back in the nineteen-hundreds it was a wonderful experience for a boy to discover H. G. Wells. There you were, in a world of pedants, clergymen and golfers, with your future employers exhorting you to ‘get on or get out,’ your parents systematically warping your sexual life, and your dull-witted schoolmasters sniggering over their Latin tags; and here was this wonderful man who could tell you about the inhabitants of the planets and the bottom of the sea, and who knew that the future was not going to be what respectable people imagined. A decade or so before aeroplanes were technically feasible Wells knew that within a little while men would be able to fly. He knew that because he himself wanted to be able to fly, and therefore felt sure that research in that direction would continue. On the other hand, even when I was a little boy, at a time when the Wright brothers had actually lifted their machine off the ground for fifty-nine seconds, the generally accepted opinion was that if God had meant us to fly He would have given us wings. Up to 1914 Wells was in the main a true prophet. In physical details his vision of the new world has been fulfilled to a surprising extent."
"Mais n'est-ce pas une sorte de parricide pour une personne de mon âge (trente-huit ans) de trouver à redire à H.G. Wells ? Les personnes qui sont nées vers le début de ce siècle sont en quelque sorte la création de Wells lui-même. On peut se demander quelle est l'influence d'un simple écrivain, et surtout d'un écrivain "populaire" dont l'œuvre prend rapidement effet, mais je doute que quelqu'un qui écrivait des livres entre 1900 et 1920, en tout cas en anglais, ait autant influencé les jeunes. L'esprit de chacun d'entre nous, et donc le monde physique, serait sensiblement différent si Wells n'avait jamais existé. Seulement, l'unicité de l'esprit, l'imagination unilatérale qui le faisait passer pour un prophète inspiré à l'époque édouardienne, en font aujourd'hui un penseur superficiel et inadéquat. Quand Wells était jeune, l'antithèse entre la science et la réaction n'était pas fausse. La société était dirigée par des gens bornés, profondément incurables, des hommes d'affaires prédateurs, des écuyers ennuyeux, des évêques, des politiciens qui pouvaient citer Horace mais n'avaient jamais entendu parler de l'algèbre. La science était peu recommandable et la croyance religieuse obligatoire. Le traditionalisme, la stupidité, le snobisme, le patriotisme, la superstition et l'amour de la guerre semblaient être du même côté ; il fallait quelqu'un qui puisse exprimer le point de vue opposé. Dans les années 1900, c'était une expérience merveilleuse pour un garçon de découvrir H. G. Wells. Vous étiez là, dans un monde de pédants, d'ecclésiastiques et de golfeurs, avec vos futurs employeurs qui vous exhortaient à "monter ou descendre", vos parents qui déformaient systématiquement votre vie sexuelle, et vos maîtres d'école à l'intelligence terne qui ricanaient sur leurs étiquettes latines ; et voici cet homme merveilleux qui pouvait vous parler des habitants des planètes et du fond de la mer, et qui savait que l'avenir ne serait pas ce que les gens respectables imaginaient. Une dizaine d'années avant que les avions ne soient techniquement réalisables, Wells savait que dans peu de temps, les hommes seraient capables de voler. Il le savait parce qu'il voulait lui-même être capable de voler, et il était donc sûr que les recherches dans ce sens se poursuivraient. D'un autre côté, même lorsque j'étais petit garçon, à l'époque où les frères Wright avaient en fait soulevé leur machine du sol pendant cinquante-neuf secondes, l'opinion généralement admise était que si Dieu avait voulu que nous volions, il nous aurait donné des ailes. Jusqu'en 1914, Wells était dans l'ensemble un vrai prophète. Dans les détails physiques, sa vision du nouveau monde s'est réalisée de manière surprenante."
Parmi ses dernières œuvres, on trouve "Mind at the End of Its Tether" de 1945, un essai pessimiste dans lequel Wells contemple la fin de l'humanité. Certains critiques ont spéculé que la santé déclinante de Wells a façonné cette prédiction d'un avenir sans espoir. Il meurt le 13 août 1946 à Londres....
