- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Hermann Hesse (1877-1962), "Der Steppenwolf (1927) - ..
Last update: 29/11/2016

Littérature allemande des années 1920-1930
En Allemagne, les 15 années qui suivirent la fin de la Première Guerre mondiale sont marquées par une inflation démesurée et un chômage généralisé. Paradoxalement, cette époque est aussi celle de la culture de Weimar marquée par une effervescence jusque-là inconnue tant au niveau artistique que scientifique. Au niveau artistique, la littérature allemande, celle de Hermann Hesse (1877-1962), "Le Loup des steppes" (1927), Alfred Döblin (1878-1957), "Berlin Alexanderplatz" (1929), Thomas Mann (1875-1955), "La Montagne magique" (1924), Robert Musil (1880-1942), "L'Homme sans qualités" (1930), Leo Perutz (1882-1957), "Le maître du jugement dernier" (1923), Stefan Zweig (1881-1942), "La Confusion des sentiments" (1926), veut exprimer la complexité d'un monde moderne qui s'installe dans la confusion la plus extrême...
(Hans Baluschek (1898) "Monday Morning" - Stiftung Stadtmuseum Berlin)
Chez Hesse, a-t-on souvent écrit, le romancier se double d'un philosophe et le roman n'est le plus souvent qu'un prétexte pour exposer les idées de l'auteur sur l'attitude qu'il convient de prendre devant notre existence. Lui-même, longtemps brimé, ne s'est que difficilement libéré de sa famille mais se sentira incapable de s'habituer tant aux conventions de la société qu'au bonheur conjugal. Il restera tourmenté par le sens de la vie. Et s'il faut un exemple à peine romancé du processus tumultueux de la découverte de soi, nous le trouverons non pas tant dans le premier grand succès de Hermann Hesse, "Peter Camenzind" (1905) que dans "Le Loup des Steppes" (Der Steppenwolf, 1927), représentation symbolique de l'homme d'après-guerre, du civilisé qui voit réapparaître en lui l'animal. Henry Haller, le protagoniste de celui-ci, est clouloureusement partagé entre deux personnalités diamétralement opposées, l'une est associée à son intellect et aux nobles idéaux auxquels il aspire, tandis que l'autre se fonde sur des instincts plus vulgaires et les désirs de la chair. Cette tension qui domine sa vie intérieure est exprimée depuis trois points de vue distincts, représentés par le neveu de sa logeuse, un traité de psychanalyse et son propre récit autobiographique. Aidé par les autres personnages du roman, Haller apprend peu à peu que "chaque ego, loin de former une unité, est un univers infiniment varié, un paradis constellé, un chaos de formes". Il décide donc d'explorer les multiples aspects de son être par l'expérience de la sexualité, la fréquentation des clubs de jazz où il apprend à danser le fox-trot, et la rencontre avec des groupes qu'îl jugeait auparavant avec condescendance et dérision. ll comprend ainsi que ces activités sont aussi appréciables que la découverte intellectuelle. La nature déconcertante et très expérimentale de cette conclusion explique en partie pourquoi ce sera, et restera, le plus incompris des romans d'Hesse. C'est aussi une critique cinglante et prémonítoire de la suffisance de la classe moyenne allemande devant le militarisme croissant qui a permis à Hitler d'accéder au pouvoir...






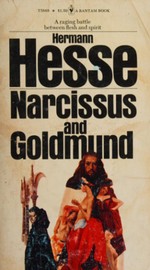

Hermann Hesse (1877-1962)
"Mes œuvres ont été écrites sans intention de servir une idée. Pourtant, si je cherche ce qu'elles pourraient avoir en commun, je découvre, rétrospectivement, cela : de "Camenzind" au "Loup de steppes" (Der Steppenwolf) et à "Josef Knecht", elles peuvent toutes être comprises comme une défense de l'individu, à l'occasion comme un cri de détresse en faveur de cette défense. L'individu humain est unique ; avec son hérédité, ses possibilités, ses dons et ses penchants, il représente une chose si tendre et si fragile qu'elle a besoin d'être défendue."
Son premier succès, "Peter Camenzina" (1904) raconte la révolte d'un enfant contre sa propre famille et la difficulté de la recherche de soi face à l'évolution décadente du monde moderne. Hermann Hesse a toujours posé un regard sévère et inquiet sur la naissance de la société industrielle. Il était souabe, avec une mère venue de Suisse ; son père avait été, dans sa jeunesse, missionnaire protestant aux Indes, avant de venir vivre à Calw, où naquit l'écrivain. La Première Guerre mondiale l'a horrifié : en même temps que Romain Rolland lançait l'appel d'Au-dessus de la mêlée, Hesse s'adressait à ses compatriotes au nom de Beethoven et de la fraternité universelle. Unis contre les mêmes ennemis, Hesse et Rolland devaient demeurer amis jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'un et l'autre ont espéré trouver en Orient et en particulier en Inde une pensée fidèle à l'esprit d'humanité dont ils voyaient les peuples d'Europe se détourner (Demian, 1919; Siddhaarth, 1922). Dès 1912, Hesse avait quitté l'Allemagne de l'empereur Guillaume II pour la Suisse et ses prises de position pacifistes créèrent une rupture avec son public. Une grande partie de la jeune génération ne découvrit Hesse qu'après 1945. En 1931, il commença à composer sa dernière grande œuvre, "Le Jeu des perles de verre". En 1933, à l'époque de la parution du "Voyage en Orient" , Hermann Hesse écrit à Thomas Mann en ces termes : " Je ne peux pas me défaire de la qualité d'Allemand qui est la mienne et je crois que mon individualisme de même que ma résistance et ma haine à l'égard de certaines attitudes et d'une certaine phraséologie allemandes constituent des fonctions dont l'exercice est non seulement profitable pour soi-même, mais rend également service à mon peuple. "
"Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muß eine Welt zerstören."
"L'oiseau se bat pour sortir de l'oeuf. L'oeuf est le monde. Quiconque veut naître doit détruire un monde" (Demian)

Peter Camenzind (1904)
Hesse entre en littérature en vagabond de l'art, s'opposant à la civilisation citadine et occidentale. Ses deux premiers romans, ""Peter Camenzind" en 1904 et "l'Ornière" (Unterm Rad) en 1906, sont inspirés par ses souvenirs de jeunesse. Peter Camenzind, amoureux des cimes et des nuages, a fait de Hesse un homme célèbre. Ce jeune garçon solitaire vit dans un petit village perdu des Alpes suisses. A la mort de sa mère et devant sa répugnance pour les travaux de la terre, son père l'autorise à gagner la ville pour y suivre des études de philologie. A Zurich, le jeune homme se lie avec un garçon de son âge, Richard, aristocrate, musicien, qui lui révèle les joies de l'amitié tout en lui donnant confiance en ses dons d'écrivain. Ce premier élan enthousiaste et plein d'espoirs va se heurter à bien des obstacles : de drames en déceptions, d'amours déçues en désillusions, Peter va lentement faire l'apprentissage de ce qu'est la vie. Le héros de "Unterm Rad" se révolte contre les contraintes de l'école et de la famille, il étouffe dans les bibliothèques, et la nostalgie des lointains le consume...
Im Anfang war der Mythus. Wie der große Gott in den Seelen der Inder, Griechen und Germanen dichtete und nach Ausdruck rang, so dichtet er in jedes Kindes Seele täglich wieder.
Wie der See und die Berge und die Bäche meiner Heimat hießen, wußte ich noch nicht. Aber ich sah die blaugrüne glatte Seebreite, mit kleinen Lichtern durchwirkt, in der Sonne liegen und im dichten Kranz um sie die jähen Berge, und in ihren höchsten Ritzen die blanken Schneescharten und kleinen, winzigen Wasserfälle, und an ihrem Fuß die schrägen, lichten Matten, mit Obstbäumen, Hütten und grauen Alpkühen besetzt.
Und da meine arme, kleine Seele so leer und still und wartend lag, schrieben die Geister des Sees und der Berge ihre schönen kühnen Taten auf sie. Die starren Wände und Flühen sprachen trotzig und ehrfürchtig von Zeiten, deren Söhne sie sind und deren Wundmale sie tragen. Sie sprachen von damals, da die Erde barst und sich bog und aus ihrem gequälten Leibe in stöhnender Werdenot Gipfel und Grate hervortrieb.
"Au commencement était le mythe. La divinité qui, dans son effort pour s’exprimer, le fit éclore dans l’âme primitive des Hindous, des Grecs et des Germains le crée aussi chaque jour à nouveau dans toute âme d’enfant.
Je ne savais pas encore les noms du lac, des montagnes et des rivières de mon pays natal, mais je voyais s’étendre sous le soleil la vaste nappe des eaux immobiles, vertes et bleuâtres, brochées de mille reflets lumineux, les montagnes abruptes dressant tout autour leur épaisse couronne avec les brèches étincelantes de neige, les minces cascades minuscules dans les découpures de leurs sommets, et, à leur pied, les pentes baignées de lumière, les pâturages parsemés d’arbres fruitiers, de chalets et de vaches grises des Alpes.
Et sur ma pauvre petite âme qui attendait, vierge encore et silencieuse, les esprits du lac et des montagnes gravèrent leurs exploits splendides et hardis. Les flancs rigides des monts et les falaises parlaient avec colère et respect des temps qui leur ont donné naissance et dont ils portent les cicatrices. Ils disaient les époques lointaines où, dans les gémissements et les douleurs de l’enfantement, la terre tourmentée éclatait pour faire surgir de son corps torturé les cimes et les arêtes.
Dans un grondement de tonnerre des masses puissantes de rochers surgissaient, se pressaient éperdues, lançant à l’assaut de l’immensité sans limites leurs pointes qui, brisées, retombaient sur elles-mêmes, et les montagnes jumelles engageaient une lutte désespérée pour la conquête de l’espace, jusqu’à ce que l’une d’elles se dressât triomphante et rejetât sa sœur à l’écart en la faisant voler en éclats. Çà et là, témoins de ces lointaines époques, des tronçons d’aiguilles fendues et mutilées, rejetés au loin dans la tourmente, surplombent encore les ravins et, à chaque fonte des neiges, les eaux torrentueuses entraînent au long des pentes d’énormes blocs de rochers, les brisant comme verre ou les faisant pénétrer profondément sous la violence de leurs coups dans la chair molle des alpages.
Toujours ils répétaient la même histoire, ces amas de rochers. Et on n’avait pas de peine à les comprendre en voyant leurs parois abruptes, aux couches de terrain tordues les unes au-dessus des autres, déviées, éclatées, toutes pleines de blessures béantes. « Nous avons enduré des choses effroyables, disaient-elles, et nous en endurons encore. » Mais leur langage était fier, sévère, obstiné, comme celui de gens de guerre, blanchis sous le harnois, et dont on ne viendra jamais à bout.
Oui certes, des gens de guerre. Je les regardais dans leur lutte contre les eaux et la tempête, au cours des nuits d’épouvante où s’annonce le printemps, quand le foehn gronde et s’acharne autour de leurs vieilles têtes et que les torrents arrachent à leurs flancs des blocs de chair pantelante. Dans ces nuits-là, ils se dressaient, sinistres, cramponnés obstinément de toutes leurs racines, retenant leur souffle, serrant les dents, présentant à la tempête leurs parois et leurs pics fendus par les intempéries, ramassant toutes leurs forces dans une attitude de défi. Et à chaque blessure, ils faisaient retentir le grondement lugubre de leur fureur et de leur angoisse, qui se répercutait dans tous les bruits lointains, brisé et rageur, en gémissements épouvantables.
Et je voyais les alpages et les pentes, les échancrures des rochers garnis de terre, couverts d’herbes, de fleurs, de fougères et de ces mousses auxquelles la vieille langue populaire a donné des noms si étranges, si lourds de signification.
Ils vivaient dans l’innocence, ces enfants des montagnes, de génération en génération, sur les espaces qu’ils s’étaient choisis, et brillaient de leurs mille couleurs. Je les tâtais, je les observais, j’aspirais leur parfum, j’apprenais leurs noms. Les arbres me faisaient une impression plus sévère et plus profonde. Je regardais chacun d’eux mener sa vie à part, donner à sa couronne une forme personnelle, projeter son ombre qui ne ressemblait à aucune autre. Je voyais en eux des ermites et des combattants, étroitement apparentés aux montagnes, car chacun d’eux, surtout ceux qui se dressaient tout là-haut, menait sa lutte silencieuse et tenace contre le vent, les intempéries et la rocaille pour subsister et croître.
Chacun avait sa charge à porter, chacun devait s’accrocher solidement au sol et recevait, dans cet effort, sa silhouette particulière, ses blessures à lui. Il y avait des pins à qui la tempête n’avait permis d’avoir des branches que d’un seul côté, d’autres dont les troncs rougeâtres s’étaient enlacés comme des serpents autour des rochers qui les surplombaient, en sorte que l’arbre et le roc se serraient l’un à l’autre pour subsister. Ils se présentaient à moi comme des guerriers et éveillaient dans mon cœur un sentiment de crainte et de respect.
Unsere Männer und Frauen aber glichen ihnen, waren hart, streng gefaltet und wenig redend, die besten am wenigsten. Daher lernte ich die Menschen gleich Bäumen oder Felsen anschauen, mir Gedanken über sie zu machen und sie nicht weniger zu ehren und nicht mehr zu lieben als die stillen Föhren.
Les hommes et les femmes de chez nous leur ressemblaient ; ils étaient durs, sous leurs traits sévères, taciturnes, les meilleurs surtout. J’appris donc à regarder les hommes comme des arbres et des rochers et, quand je me mis à me faire sur eux mes idées à moi, à ne les honorer pas moins et à ne pas les aimer davantage que les pins silencieux.
Nimikon, notre village, est situé sur une pente qui descend en triangle vers le lac, coincée entre deux avancées de montagnes. Un chemin mène vers le monastère voisin, un autre vers un village distant de quatre lieues et demie ; c’est par la voie des eaux qu’on se rend aux autres bourgs des bords du lac. Nos maisons sont bâties dans le vieux style des chalets de bois et n’ont pas d’âge bien défini ; on ne rencontre presque jamais de constructions neuves ; dans ces vieilles masures on répare un coin après l’autre, selon les besoins ; une année le parquet, une autre fois quelque partie du toit. Un bout de poutre ou une latte de bois qui, naguère, avaient trouvé place dans une cloison font maintenant office de chevron sur la toiture, et quand, là aussi, ils sont hors de service, mais trop bons encore pour faire du feu, on les emploie cette fois à réparer l’étable ou le grenier à foin ou pour remplacer la traverse d’une porte. Il en va de même des habitants ; chacun joue son rôle aussi longtemps qu’il peut dans la vie en commun, pour passer ensuite peu à peu dans la catégorie des inutiles et disparaître sans qu’on en fasse grand cas. Quiconque, après avoir vécu des années loin du village, revient au pays, ne trouve rien de changé, si ce n’est qu’on a remis à neuf quelques vieux toits et que quelques toitures plus récentes ont pris de l’âge ; les vieillards d’alors ne sont plus là, il est vrai, mais d’autres vieillards ont pris leur place, habitent les mêmes chaumières, portent les mêmes noms, surveillent les mêmes bandes d’enfants aux cheveux foncés, et se distinguent à peine dans leurs traits et dans leurs gestes de ceux qui, pendant ce temps-là, sont descendus dans la tombe...."
Peter Camenzind quitte son petit village pour conquérir le monde, regardant à la vie à travers l'esthétique et laissant l'écriture lentement s'emparer de son âme d'éternel vagabond ...
".. Je ne me prenais pas pour un écrivain. Ce que je rédigeais à l’occasion, c’était du feuilleton, non du travail artistique. Mais en moi-même, et tout en me gardant bien de le dire, je me laissais aller à l’espoir qu’il me serait donné un jour d’écrire un poème, un grand et puissant poème de nostalgie et de vie.
Le gai et clair miroir de mon âme fut parfois terni par une espèce de mélancolie, mais jamais, à ce moment-là, il ne fut sérieusement troublé. Les idées noires apparaissaient de temps en temps pour un jour ou pour une nuit, comme une tristesse rêveuse et solitaire qui disparaissait ensuite sans laisser de traces pour revenir après des semaines ou des mois. Peu à peu, je m’habituai à elle comme à une amie familière. Elle ne me donnait plus l’impression d’un tourment, mais d’une inquiétude et d’une fatigue qui n’étaient pas sans charmes. Quand elle prenait possession de moi la nuit, je restais, au lieu de dormir, des heures durant à la fenêtre à regarder le lac sombre, les silhouettes des montagnes se dessinant sur le ciel et, au-dessus, les belles étoiles.
Alors souvent j’étais pris d’un sentiment violent de douce angoisse, comme si toute cette splendeur de la nuit me regardait avec un air de reproche justifié. Comme si les étoiles, les monts et le lac aspiraient à trouver un être qui comprît et exprimât leur beauté et la douleur de leur muette existence, comme si j’étais cet être, comme si ma véritable mission était de donner dans l’œuvre d’art une expression à la nature muette. Jamais je ne me demandais de quelle manière cela pourrait bien se faire, mais je sentais simplement la belle et sévère nuit qui m’attendait silencieuse, impatiente de désir. Jamais non plus je n’écrivis quoi que ce soit dans un tel état d’esprit ; mais j’avais seulement conscience de ma responsabilité à l’égard de ces appels indistincts et, à la suite de pareilles nuits, j’entreprenais ordinairement des marches à pied solitaires de plusieurs jours. J’avais l’impression de pouvoir ainsi témoigner un peu mon amour à la terre qui s’offrait à moi dans une muette prière ; une idée dont je riais moi-même ensuite.
Ces voyages à pied restèrent une des habitudes fondamentales de ma vie. J’ai passé une grande partie des années qui se sont écoulées depuis lors à cheminer ainsi à travers divers pays en des excursions qui duraient des semaines et des mois. Je pris l’habitude de faire de longues courses avec peu d’argent et un morceau de pain dans ma poche, de passer des jours dans la solitude sur les routes et de coucher souvent à la belle étoile..."
Le voici, vagabond, faisant connaissance avec le monde des êtres humains qui l'entourent, les poètes, artistes, et philosophes, prenant conscience "de cet immense besoin qui, dans toutes les âmes d’aujourd’hui, appelait à grands cris la délivrance et des voies étranges dans lesquelles il les engageait" : "Croire en Dieu passait pour bête, presque pour inconvenant ; mais, à part cela, on voulait bien croire à toutes sortes de doctrines et de noms : à Schopenhauer, à Bouddha, à Zarathoustra, à cent autres. Il y avait de jeunes artistes inconnus qui, dans des demeures de grand style, devant des statues et des tableaux, se livraient à de solennelles méditations. Ils auraient rougi de se prosterner devant Dieu, mais ils se mettaient à genoux devant le Jupiter d’Orticoli. Il y avait des ascètes qui se torturaient dans la continence et dont la toilette était un scandale. Leur Dieu avait nom Tolstoï ou Bouddha. Il y avait des artistes qui cherchaient à se suggérer des états d’âme originaux devant des tapisseries choisies avec un soin délicat et finement nuancées, au moyen de certaines musiques, de mets, de vins, de parfums, de cigares. Ils parlaient couramment, en feignant d’y voir des données du sens commun, de lignes musicales, d’accords de couleurs et de subtilités du même genre ; partout à l’affût d’une « notation personnelle » qui n’était le plus souvent rien de plus qu’une petite mystification anodine dont ils étaient eux-mêmes les premières victimes, à moins que ce ne fût quelque extravagance."
Après l'Italie, sa jeunesse prend fin à Zurich, le voici à Paris, une expérience brute particulièrement révélatrice qui le décide définitivement à rejeter avec violence cette civilisation urbaine et artificielle, il y perd son goût de la bohême. Peter Camenzind renoncera ainsi à sa vie vagabonde et regagnera son petit village...

Rosshalde (1914)
Rosshalde, c'est le nom du domaine, quelque part en Allemagne, où vivent un peintre de grand talent, Johann Veraguth, son épouse Adèle et leur petit garçon Pierre, avant la Première Guerre mondiale. La nature y est somptueuse et la vaste maison est une de ces demeures de famille qui sont synonymes de souvenirs précieux. Mais ici la réalité est tout autre : l'enfant, sensible et fragile, est une source de conflit entre ses parents, qui ne communiquent plus et se déchirent. Victime de la haine des adultes, il tombe gravement malade. Ce drame va déterminer en grande partie le destin de Johann, l'obligeant à poser un regard lucide sur sa vie, à renoncer aux mirages de la jeunesse avec dans les mains son unique bien : sa valeur d'artiste.
"..Chaque fois qu'ils se retrouvaient - et cette fois plus que jamais - Veraguth se transportait en esprit dans ce pays lointain dont son ami s'était fait une seconde patrie. Il ne soupçonnait pas combien la séduction et la trouble attirance qui envahissaient son âme répondaient aux desseins cachés d'Otto Burkhardt. Certes, ils étaient fascinants, les tableaux exotiques qui suscitaient ses rêves. Ils le hantaient comme des visions réelles : mers des tropiques aux eaux scintillantes, forêts et fleuves démesurés, indigènes à demi nus, à la peau couleur de bronze. Pourtant, ce qu'il aspirait plus encore à connaître, c'était l'immense éloignement et la paix d'une contrée sans limites où ses chagrins actuels, ses soucis, ses luttes et ses misères lui sembleraient effacées à jamais, très loin de lui, emportés par le vent du large. Il n'aurait plus de coeur oppressé, chaque jour, par mille tracas pesants; il aurait l'esprit libre pour s'adapter à une atmosphère nouvelle où tout ne serait que pureté, innocence et délices.
L'après-midi s'achevait et les ombres s'étaient déplacées. Pierre, depuis longtemps, était parti vers d'autres jeux. Burkhard avait peu à peu cessé de parler, puis avait fini par s'endormir. Mais le tableau était terminé, à quelques détails près. Le peintre ferma un instant ses yeux las, laissa reposer ses mains. Il respira profondément et, pendant quelques minutes, il se recueillit avec une ferveur presque douloureuse pour jouir pleinement de cette heure calme encore ensoleillée et de la présence de son ami, tandis qu'une agréable fatigue, celle qui succède au travail bien fait, se glissait dans ses membres après une tension excessive. Depuis longtemps déjà, il ne connaissait pas de volupté plus profonde ni plus exaltante - outre l'ivresse qui étreint quand on attaque une oeuvre nouvelle pour s'y adonner sans répit - que ces instants de grâce où tout, dans l'organisme, cède au désir de détente et sombre dans une sorte d'apathie, d'inconscience, à mi-chemin entre l'état de veille et le sommeil.."
"Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades."
"La vie de chaque être est un chemin qui le mène à lui-même, un essai de chemin, l'ébauche d'un sentier"
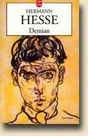
Demian (1919)
"Demian" est un roman autobiographique écrit au sortir d'une cure psychanalytique menée avec un disciple de Carl Gustav Jung. Hesse tente ici de retracer le "processus d'individuation", à la façon de Jung, c'est-à-dire la réalisation de toutes les potentialités de l'individu. Sinclair et Lewis apparaissent comme les deux facettes d'un même être, Demian incarnant une critique de la civilisation et l'ensemble du roman et des personnages étant constellés d'intentions symboliques.
Depuis sa plus tendre enfance, Émile Sinclair est partagé entre le monde familier et ordonné de sa famille bourgeoise, dont les valeurs sont l'amour, le respect et le devoir, et l' « autre côté », l'univers cru et violent des petites gens, des voleurs et des prostituées. À l'école, il fait la rencontre d'un individu qui va bouleverser sa vie : Max Demian, un être mystérieux au charisme envoûtant qui semble venu de nulle part. Le jeune homme enseigne à Sinclair, sur le front duquel il reconnaît le signe de Caïn, la marque de la rébellion, à ne pas suivre l'exemple de ses parents, à se révolter pour se trouver, à traverser le chaos et la solitude pour mériter l'accomplissement de sa propre destinée. Écrit en 1919, Demian tente de répondre à la question suivante : comment l'homme peut-il échapper au monde des miroirs et parvenir à être lui-même ? Roman à l'atmosphère sombre, hanté par des personnages sulfureux et inquiétants, il raconte la difficulté d'être un et unique face à la multitude.
"Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Darum leben die meisten. Menschen so unwirklich, weil sie die Bilder außerhalb für das Wirkliche, halten und ihre eigene Welt in sich gar nicht zu Worte kommen lassen."
"Il n'est pas d'autre réalité que celle que nous avons en nous. C'est pourquoi la plupart des hommes vivent tant en dehors de la réalité, parce qu'ils prennent les images qui se trouvent à l'extérieur pour le réel et ne laissent pas la parole à leur propre monde."

"Le dernier été de Klingsor" (Klingsors letzter Sommer, 1920)
Hermann Hesse retrouve à travers quatre nouvelles quelques-uns des grands thèmes qui hantent son univers romanesque, l'angoisse, l'amour, la mort . Une fois encore, l'écrivain se révèle un chirurgien des âmes, toujours soucieux de mettre à nu ce qu'il y a de plus absolu et de plus mystérieux dans le maelström des sentiments humains. «La scierie du marbrier» (Die Marmorsäge) explore les paradoxes de l'amour. «Âme d'enfant» (Kinderseele) retranscrit les terreurs étranges des univers d'enfance. «Klein et Wagner» montre un homme qui s'égare dans ses labyrinthes intimes. «Le dernier été de Klingsor» (Klingsors letzter Sommer), enfin, analyse l'agonie qui est aussi, parfois, l'ultime occasion offerte de regarder la vie en face...
".. Il appuya son front et ses yeux endoloris contre la balustrade en fer, trouvant à ce contact un instant de fraîcheur. Dans une année peut-être, et même plutôt, il serait aveugle, la flamme qui le brûlait intérieurement s'éteindrait. Non, aucun être humain ne supporterait longtemps cette vie dévorante, même pas lui, Klingsor, qui pourtant menait dix existences à la fois. Personne au monde ne pouvait vivre indéfiniment tous feux allumés et tous volcans en activité; il était impossible à quiconque, au-delà d'une courte période, de vivre nuit et jour à l'état de brasier, livré à l'ardeur d'un travail continu, en proie la nuit à des pensées fulgurantes, ne songeant qu'à jouir de la vie, à créer des formes, sans accorder aucun répit à la lucidité des sens et à la vibration des nerfs, comme si l'âme de l'artiste était un château où l'on ferait de la musique toute la journée, dans toutes les pièces, et où chaque nuit s'allumeraient mille chandelles. Cela ne pourrait pas durer. Ses forces étaient en grande partie épuisées, sa vue bien compromise et son existence à moitié sacrifiée.
Soudain, il se redressa et se mit à rire. Ces impressions, ces pensées et ces craintes, il les connaissait de longue date. Pendant sa jeunesse déjà, comme dans les moments les plus féconds et les plus significatifs de sa carrière, il avait vécu de cette manière-là, brûlant la chandelle par les deux bouts; tantôt il jubilait, tantôt il déplorait ce gaspillage insensé, cette hâte à se consumer, ce besoin désespéré de vider la coupe d'un seul trait, secrètement angoissé qu'il était par l'idée de la mort. Maintes fois déjà, il avait connu de tels moments et brûlé d'un feu créateur. Parfois, l'approche de la fin s'était fait sentir doucement : il succombait alors à une sorte de torpeur, un peu comme les animaux lorsqu'ils hibernent. D'autres fois, la réaction avait été terrible; il se sentait ravagé par d'insupportables douleurs, il appelait des médecins, il renonçait tristement à vivre, il capitulait devant son mal, succombait à la faiblesse.
Mais toujours, il avait fini par survivre.."

"Siddharta" (1922)
« C'est la confession d'un homme d'origine et d'éducation chrétiennes, qui a tôt quitté l'Église et qui s'est efforcé de comprendre d'autres religions, en premier lieu celles de l'Inde et de la Chine. J'ai cherché à déceler ce qui est commun à toutes les confessions, à toutes les formes de piété, ce qui dépasse les différences entre les nations, ce qui peut être cru et respecté par tout homme, à quelque race qu'il appartienne. » Hesse justifie ici une humanité qui parviendrait à réconcilier en elle toutes les formes possibles de vie...
Véritable "poème hindou" plus que roman, célèbre pour la maîtrise de son écriture - Siddharta est un fils de brahmane qui, tourmenté par le besoin de la vérité absolue, quitte la maison paternelle pour aller à la recherche d'une sagesse parfaitement accordée à la vie. Cheminant avec un compagnon, Gavinda, qui symbolise la civilisation occidentale. il pénètre d'abord dans une forêt où il reçoit des sages Samanas les leçons de mortification et de jeûne, de renoncement total, qui devraient le faire accéder au nirvana. Mais Siddharta s'avère peu touché par cet enseignement qui ne parvient à lui donner la paix de l`âme. C'est alors que, toujours en compagnie de Gavinda, il rencontre un homme d'une figure rayonnante et transparente, Gautama, dit le Bouddha, le Sublime... Siddharta pressent aussitôt qu'il vient d`être mis en présence de celui qui pourra être son intercesseur pour aller vers la sagesse : et en effet. contrairement à ce qu'attend de lui Gavinda. le Bouddha n'enseigne aucune doctrine, mais apprendra au contraire à Siddharta à se détacher de toute conception du monde a priori et à se rendre disponible pour toutes les expériences. La vraie sagesse consiste non à nier, mais à dilater son âme à la mesure du monde : elle est acceptation totale.
Siddharta doit donc commencer ses expériences, se mêler à la banalité de la vie pour apprendre à la dépasser. Il quitte la forêt et entre dans la ville pour prendre le chemin commun des hommes. Il y rencontre notamment la belle et sensuelle Koumala, une
courtisane, et le marchand Kamasvani, dont il devient bientôt l`associé et l`ami. Mais dans la ville, Siddharta semble sur le point de se perdre : ce n`est qu'au moment où il aura été marqué par les tares de la civilisation, qu'il sera devenu cupide, vieilli, aux approches de la mort, que la sagesse se révélera enfin à lui, par un immense dégoût qui l`entraîne vers une dernière solitude, sur les bords du fleuve, symbole de l`infini, de l`apaisement donné aux parfaits qui ont abandonné toute recherche d`intérêt particulier. Siddharta connaît bien la liberté, mais ce n'est plus celle, misérable, que lui avaient d`abord proposée les Samanas : s'il est détaché. c`est aprés avoir fait l'expérience totale de la vie, en pleine connaissance de cause. L`unité qu'il a conquise est celle d`une adhésion, d`une participation universelles. On mesure alors la distance spirituelle parcourue par Siddharta face à un Gavinda qui le supplie de lui "apprendre" la sagesse. Mais la sagesse ne s`apprend pas, et Siddharta. devenu intercesseur à son tour, se contente de donner un baiser à Gavinda...

"Le Loup des steppes" (Der Steppenwolf, 1927)
Crise que traverse un homme de cinquante ans, mais aussi expérience spirituelle, récit initiatique, délire de psychopathe, "Le Loup des steppes" multiplie les registres. Salué à sa parution en 1927 (entre autres par Thomas Mann, qui déclare : « Ce livre m’a réappris à lire »), interdit sous le régime nazi, roman culte des années 1960 et 1970, c’est une des œuvres phares de la littérature universelle du XXe siècle.
Trois parties, la présentation du héros, la confession de celui-ci, et un petit traité intercalé dans la confession.
"Harry Haller, le héros, derrière lequel il n'est pas difficile de voir le double de Hermann Hesse, est « un sans-métier, un sans-famille, un sans-patrie », en rupture avec son milieu bourgeois : "Harry besteht nicht aus zwei Wesen, sondern aus hundert, aus tausenden".. Déraciné dans une grande ville, derrière laquelle il est possible de reconnaître Zurich, ayant pris pension dans une mansarde qui lui offre l'espace nécessaire pour lire, écrire, se retrancher, Harry Haller, dont le comportement intrigue ses logeurs, se trouve un soir d'errance en possession d'une brochure intitulée Traité du Loup des steppes dans laquelle il peut distinguer, comme dans un miroir brisé, son portrait. Ce traité présente la vision nietzschéenne de l'homme moderne dont le moi s'est « vaporisé » en une multitude de facettes qu'il est difficile de rassembler.
Il serait simpliste de voir dans ce portrait une « double postulation » entre la chair et l'esprit, les aspirations de l'intellect et les nécessités du corps. Les labyrinthes de l'âme, « la dispersion du monde intérieur » (Blanchot), entremêlent inextricablement les fils difficiles à faire coexister de l'humanité et de l'animalité. C'est à cet imbroglio que Harry Haller se voit confronté. Ses résistances tiennent encore aux anciennes valeurs « bourgeoises » dans lesquelles il étouffe mais qu'il ne peut quitter. Il cède toutefois à la tentation sous les traits d'une jeune femme, Hermine, qui lui fait découvrir les plaisirs que peuvent offrir les bas-fonds d'une grande métropole."
"In Wirklich aber ist kein Ich, auch nicht das naivste, eine Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternhimmel, ein Chaos von Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten."
"En réalité aucun moi, pas même le plus naïf, ne forme une unité, mais au contraire un monde éminemment pluriel, un petit ciel d'étoiles, un chaos de formes, d'étapes et d'états, d'héritages et de possibilités."
Harry Haller, donc, un solitaire d`une cinquantaine d`années, vient un jour louer une chambre dans une maison bourgeoise d`une grande ville. Il a des manières correctes. mais quelque chose d`étrange ou d'étranger. Le narrateur le donne comme le représentant d`un de ces hommes supérieurs qui sont pris entre deux époques et dont le destin est de subir cruellement toute l'ambiguïté de la vie humaine :
".. Chaque époque, chaque culture, chaque tradition possède son ton. Elle a les douceurs et les atrocités, les beautés et les cruautés qui lui conviennent. Elle accepte certaines souffrances comme naturelles, s’accommode patiemment de certains maux. La vie humaine
ne devient une vraie souffrance, un véritable enfer, que là où se chevauchent deux époques, deux cultures, deux religions.
Un homme de l’Antiquité qui aurait dû vivre au Moyen Âge aurait misérablement étouffé de même qu’un sauvage étoufferait au milieu de notre civilisation. Mais il y a des époques où toute une génération se trouve coincée entre deux temps, entre deux genres de vie, tant et si bien qu’elle en perd toute spontanéité, toute moralité, toute fraîcheur d’âme. Naturellement, chacun ne ressent pas cela avec la même intensité. Une nature telle que Nietzsche a dû, anticipant une génération, souffrir la misère dont nous souffrons à présent ; ce par quoi il a passé seul et incompris, des milliers le ressentent aujourd’hui. »

L'homme moderne souffre de ses contradictions et de ne pouvoir se réfugier dans une foi. Mais on ne peut renoncer aussi aisément. Il faut partir en quête de sa vérité. Le traité du Loup des steppes développe ainsi deux thèmes : l`illusoire dualité de l`homme, qui n`est pas loup et homme. instinct et esprit ; et d`autre part l`unité nécessaire de ce monde qui nous apparait comme un chaos.
" ... Donc, le Loup des steppes avait à la fois une nature humaine et une nature de fauve, tel était son destin, et il se pourrait bien que ce destin ne fût ni si singulier ni si rare. Il existe bon nombre d’hommes qui ont en eux quelque chose du chien ou du renard, du poisson, ou du serpent, sans pour cela subir des difficultés particulières. Chez ceux-là, l’homme et le renard, l’homme et le poisson vivent côte à côte ; aucun ne fait souffrir l’autre, au contraire, ils s’entraident même ; certains hommes dont on envie la destinée doivent leur bonheur au singe ou au renard qu’ils recèlent plutôt qu’à l’être humain. C’est une chose bien connue de tous. Chez Harry, par contre, l’homme et le loup ne cohabitaient pas paisiblement, et, bien loin de s’entraider, menaient perpétuellement entre eux une lutte à vie et à mort ; l’un ne vivait que pour faire enrager l’autre, et, lorsque deux êtres, dans le même sang et la même âme, se haïssent mortellement, ce n’est pas une existence heureuse. Enfin ! tout homme a son destin, et aucun n’est facile.
Notre loup des steppes avait donc la conscience, comme c’est le cas chez tous les êtres mixtes, d’être tantôt un loup, tantôt un homme ; mais, lorsqu’il était loup, l’homme veillait en lui, spectateur et juge ; et, lorsqu’il était homme, le loup observait à son tour. Par exemple, quand Harry l’homme avait une belle pensée, éprouvait une sensation noble et raffinée ou accomplissait ce qu’on est convenu de nommer une bonne action, le loup, au-dedans de lui, montrait les dents, éclatait de rire et lui prouvait avec une raillerie cinglante le ridicule de toute cette grandiloquente comédie jouée par un fauve, un carnassier qui, au fond de son cœur, savait exactement ce qui lui convenait : courir, solitaire, la steppe, se gorger de sang de temps en temps ou traquer une louve. Ainsi, vue par le loup, toute action humaine devenait férocement comique et maladroite, stupide et outrecuidante. Mais il en était de même quand Harry sentait et se conduisait en loup, quand il montrait les dents, quand il éprouvait une haine et une aversion mortelle envers tous les hommes, leurs mœurs et leurs manières hypocrites. À ce moment-là, ce qui veillait, c’était sa partie humaine ; elle observait le loup, le traitait de brute et d’animal et lui empoisonnait toutes les joies de sa nature de fauve, simple, saine et sauvage. Tel était le sort du Loup des steppes, et l’on peut facilement s’imaginer que la vie de Harry n’était pas précisément agréable.
Ce qui ne veut pas dire qu’il ait été tout particulièrement malheureux (bien que lui-même en fût persuadé, car chacun de nous tient ses souffrances pour les plus cruelles de toutes). C’est une chose qu’on ne devrait dire de personne. Même celui qui n’a pas de loup en lui n’est pas forcément heureux. Cependant la vie la plus douloureuse a encore ses heures ensoleillées et ses petites fleurs de bonheur parmi les sables et les pierres. Il en était ainsi pour le Loup des steppes. La plupart du temps, on ne saurait le nier, il souffrait et pouvait aussi faire souffrir les autres, notamment ceux qui l’aimaient et qu’il aimait. Car tous ceux qui lui donnaient leur amour ne voyaient d’ordinaire en lui qu’un seul côté. Certains l’aimaient comme un homme fin, personnel et intelligent, et se montraient horrifiés et déçus quand ils découvraient en lui le loup. Mais ils ne pouvaient faire autrement que le découvrir parce que Harry, comme tout être, désirait qu’on l’aimât tout entier et ne voulait pas camoufler ni truquer le loup, surtout aux yeux de ceux à l’amour desquels il tenait le plus. Mais d’autres, justement, aimaient en lui le fauve, l’essence libre, sauvage, indomptable, dangereuse, puissante, et ceux-là, à leur tour, subissaient le désappointement le plus cuisant, quand le loup farouche et furieux se trouvait encore, par-dessus le marché, être un homme, quand il éprouvait la nostalgie de la tendresse et de la douceur, qu’il voulait entendre Mozart, lire des vers et nourrir un idéal humain. Ceux-là, pour la plupart, étaient les plus déçus et les plus irrités, et c’est ainsi que le Loup des steppes empoisonnait de sa dualité et de sa disparité tous les destins qu’il frôlait."
(...)
"Il lui arriva ce qui arrive à tous : ce qu'il cherchait et poursuivait obstinément, par un besoin inné de sa nature, lui fut donné, mais au-delà de ce qui est bon pour un humain. Ce qui fut d'abord son rêve et son bonheur devint ensuite son amer destin. L'homme puissant périt par la puissance; le cupide, par l'argent; l'humble, par la servitude; le jouisseur, par la volupté. Le Loup des steppes, lui, périt par l'indépendance. Il avait atteint son but : personne ne le commandait, il n'avait à se soumettre à personne, il disposait librement de lui. Car tout homme fort atteint inévitablement ce que lui fait chercher un besoin inévitable.
Mais, lorsqu'enfin il se sentit absolument libre, Harry s'aperçut soudain que sa liberté était une mort, qu'il était resté seul, que le monde le laissait lugubrement tranquille, qu'il ne se souciait plus des hommes ni de lui-même, qu'il étouffait lentement dans une atmosphère toujours plus rare de vide et d'isolement. La solitude et l'indépendance avaient cessé d'être son désir et son but pour devenir son sort et sa condamnation; le vœu magique était formulé et ne pouvait être repris ; cela ne servait plus à rien de tendre les mains, d’être plein de désir et de bonne volonté, prêt à l’attachement et à la communauté : maintenant, on le laissait seul.
Non pas qu’il fut haï ou évité des hommes. Au contraire, il avait beaucoup d’amis. Bien des gens avaient de l’estime pour lui. Mais ce n’était toujours que de la sympathie et de la bienveillance ; on l’invitait, on lui faisait des cadeaux, on lui envoyait des lettres charmantes, mais personne ne se rapprochait de lui, n’engageait un lien, n’avait l’aptitude et le désir de partager sa vie. Il était entouré maintenant de l’air du solitaire, de cette atmosphère silencieuse, de ce dépouillement du monde environnant, de cette inaptitude aux relations humaines, contre lesquelles ne pouvaient lutter aucune volonté ni aucune nostalgie. C’était un des signes les plus caractéristiques de sa vie...."

Le bourgeoisisme, le Loup des steppes et l'imagination - Le narrateur ne peut pas ne pas traiter les relations du Loup des steppes au contexte social de son époque, et notamment ses rapports singuliers avec le "bourgeoisisme". Le bourgeois ne survit durablement que par l'existence de ces Loups des steppes qui errent à sa périphérie, entre ces deux espèces, s'ouvre le territoire de l'imagination ...
"Le Loup des steppes, en raison de sa propre conception, se trouvait absolument hors du monde bourgeois, puisqu’il ne connaissait ni vie de famille ni ambition sociale. Il se sentait exclusivement comme un être à part, tantôt comme un maniaque et un solitaire morbide, tantôt comme un individu aux aptitudes géniales, au-dessus des normes mesquines de la vie quotidienne. En toute conscience, il méprisait le bourgeois et se félicitait de n’en être pas un. Cependant, sous maint rapport, il vivait fort bourgeoisement, il avait de l’argent à la banque et secourait des parents pauvres ; il s’habillait sans recherche, mais convenablement et sobrement ; il cherchait à vivre en paix avec la police, le fisc et autres puissances. En outre, une nostalgie profonde et secrète l’attirait continuellement vers le petit monde bourgeois, vers les pensions de famille tranquilles et convenables, aux jardins proprets, aux escaliers astiqués, et à toute cette modeste atmosphère d’ordre et de décence. Il lui plaisait de cultiver ses petits vices et ses extravagances, de se sentir en maniaque ou en génie, mais il ne séjournait, ne demeurait jamais, pour ainsi dire, dans les régions de la vie où le bourgeoisisme n’existe plus. Il ne se sentait chez lui ni dans l’atmosphère des hommes violents et exceptionnels, ni dans celle des criminels et des déclassés, et continuait à habiter la province bourgeoise, à entretenir des relations quelconques, fût-ce celle du contraste et de la révolte, avec ses normes et son atmosphère.
En outre, il avait reçu l’éducation d’un milieu petit-bourgeois et il en avait conservé une foule de notions et de poncifs. En principe, il n’avait pas le moindre grief contre la prostitution, mais, en pratique, il aurait été incapable de prendre une fille au sérieux et de la considérer réellement comme une égale. Il pouvait aimer comme son frère un criminel politique, un révolutionnaire, un séducteur intellectuel honni par l’État et la société, mais, sur l’assassin, le bandit, le voleur, il n’aurait su que s’apitoyer le plus bourgeoisement du monde.
De cette façon, une moitié de son être reconnaissait et confirmait toujours ce que niait et combattait l’autre. Élevé dans une maison bourgeoise et intellectuelle, selon des mœurs et des règles strictes, il y était toujours resté attaché par une partie de son âme, même après s’être, depuis longtemps, individualisé au-delà des limites du bourgeoisisme, après s’être délivré des croyances et des idéals bourgeois.
Le bourgeoisisme lui-même, en tant qu’état humain qui subsiste à perpétuité, n’est pas autre chose qu’une aspiration à la moyenne entre les innombrables extrêmes et antipodes de l’humanité. Prenons pour exemple une de ces paires de contrastes telle que le saint et le débauché, et notre comparaison deviendra immédiatement intelligible. L’homme a la possibilité de s’abandonner absolument à l’esprit, à la tentative de pénétration du divin, à l’idéal de la sainteté. Il a également la possibilité inverse de s’abandonner entièrement à la vie de l’instinct, aux convoitises de ses sens, et de concentrer tout son désir sur le gain de la jouissance immédiate. La première voie mène à la sainteté, au martyre de l’esprit, à l’absorption en Dieu. La seconde mène à la débauche, au martyre des sens, à l’absorption en la putrescence. Le bourgeois, lui, cherche à garder le milieu modéré entre ces deux extrêmes. Jamais il ne s’absorbera, ne s’abandonnera ni à la luxure ni à l’ascétisme ; jamais il ne sera un martyr, jamais il ne consentira à son abolition : son idéal, tout opposé, est la
conservation du moi ; il n’aspire ni à la sainteté ni à son contraire, il ne supporte pas l’absolu, il veut bien servir Dieu, mais aussi le plaisir ; il tient à être vertueux, mais en même temps à avoir ses aises. Bref, il cherche à s’installer entre les extrêmes, dans la zone agréable et tempérée, sans orages ni tempêtes violentes, et il y réussit, mais aux dépens de cette intensité de vie et de sentiment que donne une existence orientée vers l’extrême et l’absolu. On ne peut vivre intensément qu’aux dépens du moi. Le bourgeois, précisément, n’apprécie rien autant que le moi (un moi qui n’existe, il est vrai, qu’à l’état rudimentaire).
Ainsi, au détriment de l’intensité, il obtient la conservation et la sécurité ; au lieu de la folie en Dieu, il récolte la tranquillité de la conscience ; au lieu de la volupté, le confort ; au lieu de la liberté, l’aisance ; au lieu de l’ardeur mortelle, une température agréable. Le
bourgeois, de par sa nature, est un être doué d’une faible vitalité, craintif, effrayé de tout abandon, facile à gouverner.
C’est pourquoi, à la place de la puissance, il a mis la majorité ; à la place de la force, la loi ; à la place de la responsabilité, le droit de vote.
Il est clair que cet être pusillanime, en quelque grande quantité qu’il existe, est incapable de se maintenir, qu’en raison de ses facultés il ne peut jouer dans le monde un autre rôle que celui d’un troupeau de brebis entre des loups errants. Néanmoins, nous voyons que, aux périodes de domination des natures puissantes, le bourgeois, bien qu’opprimé, ne reste jamais sur le carreau et parfois paraît même régir le monde. Comment est-ce possible ?
Ni la quantité numérique du troupeau, ni la vertu, ni le sens commun, ni l’organisation ne seraient assez puissants pour le sauver de la mort. Aucune médecine au monde ne saurait garder en vie celui dont la force vitale, dès l’abord, est à ce point affaiblie. Cependant le bourgeoisisme existe, il est fort, il prospère. Pourquoi ?
La réponse est : grâce aux Loups des steppes. En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader.
C’est ainsi que s’accumulent autour de la masse fondamentale du bourgeoisisme proprement dit de vastes couches d’humanité, des milliers de vies et d’intelligences dont chacune, bien qu’échappée à l’élément bourgeois et destinée à l’absolu, se rattache encore à l’existence bourgeoise par des sentiments infantiles : infectée en partie par sa décroissance de vitalité, elle continue à lui appartenir, à la servir et à la magnifier. Car le mot d’ordre du bourgeoisisme est le principe inverti des forts : celui qui n’est pas contre moi est pour
moi.
Si c’est à ce point de vue-là que nous envisageons l’âme du Loup des steppes, il nous paraît destiné à être un non-bourgeois par le degré même qu’atteint son individualité, car toute individualisation poussée à l’extrême se tourne contre le moi et tend à le détruire. Nous voyons qu’il a en lui des penchants violents à la sainteté comme à la débauche, mais qu’une faiblesse ou une indolence quelconque l’empêche de faire le saut dans l’espace universel, libre et farouche, et le laisse attaché à la lourde constellation maternelle du bourgeoisisme. Telle est sa place dans l’univers, tel est son enchaînement. La plupart des intellectuels, le plus grand nombre des artistes appartiennent à ce type.
Seuls les plus forts d’entre eux pourfendent l’atmosphère du monde bourgeois et atteignent au cosmique ; tous les autres se résignent et consentent à des compromis, méprisent le bourgeoisisme et pourtant lui appartiennent, le renforcent, le glorifient, puisque, finalement, ils sont forcés de le réaffirmer afin de pouvoir vivre.
Il en résulte pour ces innombrables existences non pas une grandeur tragique, mais un désastre et une infortune dont l’enfer même attise et féconde le talent. Les rares êtres qui s’y arrachent se retrouvent dans l’absolu et périssent admirablement, ce sont les tragiques ; leur nombre est restreint. Mais les autres, les enchaînés, dont les talents sont souvent fort honorés par la bourgeoisie, voient s’ouvrir devant eux un troisième royaume, un monde imaginaire, ..."

Le Théâtre magique - Harry Haller nous fait lui-même le récit de ses expériences dont la plus importante est l`épreuve du "Théâtre magique" où. en état d`ivresse, il se trouve face à face avec son inconscient. Le livre devient ici roman fantastique. On voit paraître Mozart et Goethe qui, des régions supérieures, assistent à la chute du héros et lui rappellent l`existence du monde de l`art où peut régner la sérénité. A la fin du livre. Mozart dit au héros : "Vous êtes extraordinairement peu doué. mon pauvre petit. mais peu à peu vous avez dû tout de même vous faire une idée de ce qu`on exige de vous. Vous devez apprendre à rire. voilà ce qu'on veut. Vous devez concevoir l`humour de la vie" ...
" Lorsque je repris conscience, Mozart était toujours assis à côté de moi, me tapait sur l’épaule et disait : « Vous avez entendu le verdict. Vous allez devoir vous habituer à écouter comme toujours la T.S.F. de la vie. Cela vous fera du bien. Vous êtes extraordinairement peu doué, mon pauvre petit, mais peu à peu vous avez dû tout de même vous faire une idée de ce qu’on exige de vous. Vous devez apprendre à rire, voilà ce qu’on veut. Vous devez concevoir l’humour de la vie. Mais, bien entendu, vous êtes prêt à tout au monde, excepté ce qu’on vous demande ! Vous êtes prêt à assassiner des femmes, prêt à vous faire solennellement exécuter, vous seriez sûrement prêt à faire pénitence et à vous flageller pendant cent ans. N’est-ce pas ?
— Oh oui ! de tout mon cœur ! m’écriai-je du fond de ma misère.
— Naturellement ! Vous êtes feu et flamme pour toute entreprise stupide et sans humour ; vous êtes prêt, homme aux grandes phrases, à tout ce qui est pathétique et creux. Eh bien, moi, je n’en suis pas. Elle ne vaut pas deux sous, votre expiation romantique ! Vous voulez être châtié, vous voulez qu’on vous guillotine, espèce de fou furieux ! Vous commettriez encore dix assassinats pour cet idéal bêta. Vous voulez mourir, lâche que vous êtes, mais vous ne voulez pas vivre. Mais, pardieu, ce qu’il faut justement, c’est vivre ! Vous mériteriez d’être condamné à la peine suprême.
— Oh ! et quelle serait-elle ?
— Nous pourrions, par exemple, ressusciter la jeune femme et vous obliger à l’épouser.
— Non, ça, je n’y consentirais pas. Je ferais un malheur.
— Comme si vous n’en aviez déjà pas fait assez ! Mais que ce soit fini, maintenant, une fois pour toutes, les phrases pathétiques et les assassinats. Une parcelle de bon sens, que diable ! Vous devez vivre, et vous devez apprendre à rire. Vous devez apprendre à écouter la sacrée T.S.F. de la vie, à révérer l’esprit à travers elle, à blaguer les niaiseries en elle. C’est tout, on ne vous demande pas autre chose. »
Doucement à travers mes dents serrées, je demandai :
« Et si je refuse ? Et si je ne vous donne pas le droit, monsieur Mozart, de disposer du Loup des steppes et de son destin ?
— Dans ce cas-là, dit paisiblement Mozart, je te propose de fumer encore une de mes bonnes petites cigarettes. » À l’instant où il dit cette phrase et, d’un geste magique, sortit de sa poche une cigarette, il n’était plus Mozart ; il me regardait chaleureusement de ses beaux yeux noirs exotiques, et c’était mon ami Pablo, ressemblant d’ailleurs comme un frère jumeau à celui qui m’avait appris à jouer aux échecs. « Pablo ! m’écriai-je en tressaillant. Pablo, où sommes-nous ? » ...

"Narcisse et Goldmund" (Narziss und Goldmund, 1930)
Roman d'initiation, histoire allégorique de la lutte chez l'homme entre la spiritualité et l'animalité, ce roman est aussi un hymne à la Nature, source d'équilibre et de joie pour Hermann Hesse. Dans l'Allemagne du Moyen Âge, Narcisse est un jeune novice au couvent de Mariabronn, où il enseigne. Il se prend d'amitié pour l'un de ses élèves, Goldmund et le pousse à réaliser sa destinée en lui faisant quitter le couvent. Goldmund, n'ayant aucun souvenir de sa mère, qui l'abandonna enfant, part à la recherche de la mère originelle, celle des Arts, qui unit la naissance et la mort, le bien et le mal. la vie de Goldmund le mène d'une aventure amoureuse à l'autre, mais les temps sont dangereux et la cruauté des hommes, la maladie et la mort se placent sur le chemin du jeune homme, épris d'absolu et de liberté. Narcisse, devenu grand prêtre, le guidera. Goldmund poursuivra inlassablement sa quête, celle de la mère, l'Eve éternelle car, comme il le dit lui-même : "Sans mère, on ne peut pas aimer, sans mère, on ne peut pas mourir..."
"..Ce fut une étrange amitié, celle qui s’établit entre Narcisse et Goldmund. Il n’était guère de gens à qui elle plût et, parfois, on pouvait avoir l’impression qu’elle leur déplaisait à eux-mêmes.
Ce fut Narcisse, le penseur, qui, d’abord, eut le plus à en souffrir. Tout, pour lui, était pensée, l’amour aussi. Il n’avait pas le bonheur de pouvoir s’abandonner sans réfléchir à une inclination. Il était, dans cette amitié, le meneur de jeu, et, longtemps, il fut seul à prendre pleinement conscience de son destin, de sa portée et de son sens. Longtemps, au cœur même de son amour, il resta solitaire, sachant bien que son ami ne lui appartiendrait vraiment que quand il l’aurait révélé à lui-même. Goldmund s’abandonnait en se jouant, et sans rien approfondir, à l’intimité, à la ferveur de sa nouvelle vie. Narcisse accueillait avec le sentiment d’une pleine responsabilité cette haute faveur du destin.
Pour Goldmund, ce fut d’abord une libération et une guérison. La vue et le baiser d’une belle jeune fille venaient d’éveiller, et en même temps de refouler sans espoir, son juvénile besoin de tendresse. Il le sentait au plus profond de lui-même, la vie qu’il avait jusqu’ici rêvée, tout ce à quoi il croyait, tout ce à quoi il se jugeait appelé et destiné, était mis en péril dans sa racine même par ce baiser reçu à la fenêtre, par le regard de ces yeux sombres. Voué par son père à la vie monacale, acceptant de toute sa volonté cette vocation, orienté avec toute l’ardeur d’un premier enthousiasme vers un idéal de piété ascétique et héroïque, il avait senti indéniablement à sa première rencontre fugitive avec la femme, au premier appel de la vie à ses sens, au premier salut que lui avait adressé l’éternel féminin, que là se trouvaient son ennemi et son démon, que la femme était son danger.
Et voici que le destin lui jetait une planche de salut ; voici que se présentait à lui, dans la pire détresse, cette amitié qui ouvrait à son désir un jardin en fleurs, à son besoin de vénération un nouvel autel. Là, il lui était permis d’aimer sans péché, de faire don de soi-même, de livrer son cœur à un ami plus âgé, plus sage, qu’il admirait, de substituer à l’embrasement périlleux des sens la flamme d’un noble sacrifice, de sublimer sa tendresse.
Pourtant, dès le premier printemps de cette amitié, pénétrant à sa grande surprise dans des régions glacées, il se heurta à d’étranges obstacles, à de mystérieuses, à d’effroyables exigences. Car il ne lui venait pas à l’esprit de se représenter l’ami comme son contraire et comme le pôle opposé au sien. Il pensait qu’il n’était besoin que de l’amour, que du don sincère de soi-même, pour ne faire qu’un cœur de deux cœurs, pour effacer les différences et concilier les contraires. Mais qu’il était donc âpre et sûr de lui, lucide et inflexible, ce Narcisse ! L’innocent abandon d’un cœur reconnaissant au cours d’une promenade commune à la campagne n’avait pour lui aucun attrait, lui semblait n’avoir rien à faire avec l’amitié. On eût dit qu’il ignorait les chemins qui ne mènent nulle part, la marche errante dans le rêve, qu’il ne voulait point les admettre. Sans doute, quand Goldmund avait paru malade, il s’était montré inquiet à son sujet, sans doute il le conseillait et l’aidait fidèlement dans tout ce qui concernait l’étude et la science, lui expliquant les passages difficiles des textes, lui ouvrant des vues sur le royaume de la grammaire, de la logique, de la théologie ; mais jamais il n’avait l’air vraiment satisfait de l’ami, jamais il ne paraissait d’accord avec lui, bien souvent même on eût dit qu’il se moquait de lui, ne le prenait pas au sérieux. Goldmund sentait bien que ce n’était pas là simple attitude de maître d’école, que ce n’était pas pour l’aîné et le plus fort une manière de se donner de l’importance ; il voyait bien qu’il y avait autre chose derrière, quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Mais il n’arrivait pas à se rendre compte de ce que c’était et ainsi son amitié pour Narcisse le laissait souvent triste et désemparé.
En réalité Narcisse n’ignorait nullement ce que lui offrait son ami ; il ne fermait pas les yeux à sa beauté en fleurs, à sa vitalité orientée dans le sens de la nature, à l’opulence de ses dons en plein épanouissement. Il n’était rien moins qu’un maître d’école soucieux de gaver de grec une jeune âme ardente, de payer de logique sa tendresse ingénue. Au contraire, son affection pour le blondin était trop ardente et c’était là pour lui le danger, car aimer n’était pas pour lui une fonction naturelle, mais un miracle. Il ne lui était pas permis de s’éprendre de Goldmund, de se borner à contempler avec délices ces jolis yeux, le rayonnement épanoui de ces cheveux blonds. Il ne pouvait permettre à son amour, même pour un instant, de s’attarder dans la sensualité. Car Narcisse, qui se sentait destiné pour son existence entière à la vie ascétique du moine, à l’effort vers la sainteté, était vraiment promis à une telle existence. Une seule forme d’amour lui était permise : la plus haute. Mais Narcisse ne croyait pas que Goldmund fût appelé à la vie ascétique. Il s’entendait mieux que tout autre à lire dans la conscience des hommes et ici où il aimait, les choses lui apparaissaient dans une clarté plus vive. Il discernait la véritable nature de Goldmund et la comprenait à fond, car elle était une moitié perdue de sa propre nature. Il la pénétrait, toute bardée qu’elle fût d’une solide enveloppe de chimères, fruit d’une éducation à contresens et de préceptes paternels. Il soupçonnait depuis longtemps le secret tout simple de cette jeune existence. Son devoir lui apparaissait clair : dévoiler ce secret à celui qui en était porteur, le débarrasser de sa gangue, restituer à son ami sa nature vraie. Ce serait pénible et le plus dur était qu’il y pourrait peut-être perdre son amitié.
Il se rapprocha de son but avec une infinie lenteur. Des mois s’écoulèrent avant qu’une sérieuse attaque, un entretien pénétrant jusqu’au fond des choses fût seulement possible. Tant ils étaient loin l’un de l’autre en dépit de toute leur amitié, tant entre eux l’arc était tendu. Ils cheminaient l’un près de l’autre, l’un voyant, l’autre aveugle ; que l’aveugle ignorât sa cécité, c’était pour lui un soulagement.
Ce fut en cherchant à tirer au clair l’incident qui, naguère, avait poussé vers lui en une heure de faiblesse le jeune homme tout ébranlé que Narcisse ouvrit la première brèche. Ses investigations furent moins difficiles qu’il n’avait pensé...."

Le jeune novice, Narcisse, aimé ou jalousé de tous pour son étonnante beauté, sa connaissance précoce du grec et des mathématiques, ses nobles manières, son don de révéler les autres à eux-mêmes, s'est donc pris d`amitié pour l`élève Goldmund dans lequel il découvre tant son opposé que son complément. Goldmund a oublié sa mère, une danseuse belle et païenne, qui abandonna son foyer en laissant un souvenir diabolique. ll appartient à Narcisse de restituer son enfance à son ami et de lui indiquer sa destinée ...
... Narcisse "sentait que Goldmund était aujourd’hui plus ouvert à ses paroles et les accueillait en lui de meilleure grâce. Il se rendit compte qu’il avait prise sur lui. Il se laissa entraîner par le succès à en dire plus qu’il n’avait eu l’intention, il se laissa emporter par ses propres paroles.
« Vois », dit-il, « il n’y a qu’un point où j’aie sur toi l’avantage. J’ai les yeux ouverts tandis que tu n’es qu’à demi éveillé ou que parfois tu dors tout à fait. J’appelle un homme en éveil celui qui, de toute sa conscience, de toute sa raison, se connaît lui-même, avec ses forces et ses faiblesses intimes qui échappent à la raison, et sait compter avec elles. Apprendre cela, voilà le sens que peut avoir pour toi notre rencontre. Chez toi, Goldmund, la nature et la pensée, le monde conscient et le monde des rêves sont séparés par un abîme.
Tu as oublié ton enfance. Des profondeurs de ton âme elle cherche à reprendre possession de toi. Elle te fera souffrir jusqu’à ce que tu entendes son appel. Il suffit là-dessus !
Comme je te l’ai dit, je suis en éveil bien plus que toi. En cela je te dépasse de cent coudées et c’est pour cela que je puis te servir. Dans tout le reste, mon cher, tu me dépasses sans conteste. Plutôt tu me dépasseras dès que tu te seras trouvé toi-même. »
Goldmund avait écouté avec surprise ; mais à la formule « tu as oublié ton enfance », il fit un mouvement convulsif comme touché d’une flèche sans que Narcisse, qui, à son habitude, tenait en parlant les yeux baissés ou fixes devant soi, comme s’il trouvait ainsi mieux ses mots, s’en fût aperçu. Il ne remarqua pas que le visage de Goldmund se convulsait tout à coup et se mettait à pâlir.
« Supérieur à toi ! moi ! » balbutia-t-il, simplement pour dire quelque chose. Et ses traits se figèrent.
« Bien sûr », poursuivit Narcisse, « les natures du genre de la tienne, les hommes doués de sens délicats, ceux qui ont de l’âme, les poètes, ceux pour qui toute la vie est amour nous sont presque toujours supérieurs, à nous, chez qui domine l’intellect. Vous êtes, par votre origine, du côté de la mère. Vous vivez dans la plénitude de l’être. La force de l’amour, la capacité de vivre intensément les choses est votre lot. Nous autres, hommes d’intellect, bien que nous ayons l’air souvent de vous diriger et de vous gouverner, nous ne vivons pas dans l’intégrité de l’être, nous vivons dans les abstractions. À vous la plénitude de la vie, le suc des fruits, à vous le jardin de l’amour, le beau pays de l’art. Vous êtes chez vous sur terre, nous dans le monde des idées. Vous courez le risque de sombrer dans la sensualité, nous d’étouffer dans le vide. Tu es artiste, je suis penseur. Tu dors sur le cœur d’une mère, je veille dans le désert. Moi, c’est le soleil qui m’éclaire, pour toi brillent la lune et les étoiles. Ce sont des jeunes filles qui hantent tes rêves ; moi, ce sont mes écoliers…

Goldmund quittera le cloître pour se réaliser dans le siècle. ll ira de révélation amoureuse en révélation amoureuse. mais il s'agit surtout de l`amour pour l`art et pour la mère, celle qui réconcilie la naissance et la mort, le bien et le mal, la vie et l'anéantissement. Son rêve est de sculpter la mère originelle. ll repousse les honneurs et la sécurité. Or l'époque est dangereuse. Goldmund est condamné à mort quand on découvre sa liaison avec la femme du gouverneur. Le prêtre qui vient l`assister est Narcisse. Celui-ci obtient sa grâce et le ramène au couvent. Narcisse est maintenant abbé, grand prêtre du Logos. Goldmund, l`écolier d'Eros, un grand créateur de formes. lls mesurent tous deux le chemin parcouru. Puis Goldmund s`échappe à nouveau. Sa maîtresse le repousse. il manque de périr dans un accident. il revient, vaincu au couvent. Vaincu? Mais non : la grande Eve éternelle, c'est elle que partout il a rencontrée et éperdument adorée : "Maintenant elle est la mort." Goldmund consent à la mort : "Comment veux-tu donc mourir un jour. Narcisse, puisque tu n`as point de mère ? Sans mère on ne peut pas aimer. sans mère on ne peut pas mourir."
"... « Mon cher », murmura Goldmund, « je ne veux pas attendre à demain. Il faut que je prenne congé de toi et, pour l’adieu, il faut encore que je te dise tout. Écoute-moi encore un instant. Je voulais te parler de ma mère, te raconter qu’elle tient ses doigts serrés autour de mon cœur. Depuis bien des années, c’était mon plus cher désir et mon rêve le plus mystérieux de faire son image ; c’était la plus sacrée de toutes les figures ; sans cesse je la portais en moi : une mystérieuse vision d’amour. Il y a peu de temps encore il m’eût été tout à fait insupportable de songer que je pourrais mourir sans avoir fixé ses traits, ma vie entière m’eût semblé inutile. Et maintenant, vois la tournure bizarre qu’ont prise les choses : au lieu que ce soient mes mains qui la sculptent et la forment, c’est elle qui me pétrit et qui me façonne. Elle a ses mains autour de mon cœur et elle le dégage et elle me vide ; elle m’a séduit et entraîné vers la mort ; avec moi meurt aussi mon rêve : la belle statue de la grande Ève maternelle. Je la vois encore, et, si j’avais de la force dans mes mains, je pourrais lui donner forme. Mais elle ne le veut pas ; elle ne veut pas que je révèle son secret ; elle aime mieux que je meure. Et je meurs sans regret, cela m’est aisé grâce à elle. »
Narcisse écoutait tout bouleversé. Il lui fallut se pencher jusque sur le visage de son ami pour percevoir encore ses paroles. Il en était qu’il n’entendait qu’indistinctement, d’autres qu’il entendait bien, mais dont le sens lui restait caché.
Et puis le malade souleva encore une fois ses paupières et regarda longuement le visage de son ami. Ses yeux prenaient congé de lui. Et dans un mouvement qui semblait un essai pour faire un signe de dénégation, il chuchota : « Mais comment veux-tu mourir un jour, Narcisse, puisque tu n’as point de mère ? Sans mère on ne peut pas aimer, sans mère on ne peut pas mourir. »
Ce qu’il murmura encore resta incompréhensible. Narcisse passa à son chevet les deux dernières journées, nuit et jour, le regardant s’éteindre. Les dernières paroles de Goldmund brûlaient dans son cœur comme une flamme."

"Le Jeu des perles de verre" (Das Glasperlenspiel, 1943)
Récit d'anticipation, roman d'éducation intellectuelle et religieuse, utopie pessimiste, mais aussi critique de la société exprimée en termes symboliques. C'est dans ce roman que Herman Hesse utilise l'alliage très particulier de la psychanalyse jungienne et du mysticisme oriental. "Qu'adviendrait-il si, un jour, la science, le sens du beau et celui du bien se fondaient en un concert harmonieux ? Qu'arriverait-il si cette synthèse devenait un merveilleux instrument de travail, une nouvelle algèbre, une chimie spirituelle qui permettrait de combiner, par exemple, des lois astronomiques avec une phrase de Rach et un verset de la Bible, pour en déduire de nouvelles notions qui serviraient à leur tour de tremplin à d'autres opérations de l'esprit ? " Cette extraordinaire mathématique, c'est celle du jeu des perles de verre, que manie parfaitement Joseph Valet, héros fascinant jonglant avec tous les éléments de la culture humaine.
