- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

- Valery Larbaud (1881-1957), "Fermina Marquez" (1911), "A.O.Barnabooth" (1913), "Amants, heureux Amants" (1926) - Paul Morand (1888-1976), "Ouvert la nuit" (1922), "L'Europe galante" (1925), "Milady" (1936), "L'Homme pressé" (1941), "Hécate et ses chiens" (1954) - Alexandre Vialatte (1901-1971), "Le Fidèle Berger" (1942), "Battling le Ténébreux " (1928), "Les Fruits du Congo" (1950) - .....
Last Update : 12/31/2022

Naissance de la poésie du monde et de l'aventure? Le roman des années 1920 reste, pour la littérature française, un des plus riches qui lui aient été donné de produire, il se prolongera quelque peu dans les années 1930, avec une nouvelle génération, mais c'est toute une littérature poétique qui vient à éclore, une poésie qui elle-même se détache du symbolisme et de son monde clos pour l'image et la vie présente. C'est dans ce vaste mouvement qui voit fleurir des Apollinaire, Max Jacob, Léon-Paul Fargue, Pierre Reverdy, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, mais aussi Giraudoux, l'aventure surréaliste et Breton, Valéry, Gide, Claudel, que nous pouvons ici évoquer un Paul Morand, qui a su "photographier" l''avènement de cette "nouvelle conscience" qu'inaugure le "siècle des années 20", et un Valéry Larbaud, qui, peut-être, nul plus que lui n'a développé ce nouveau goût de "vivre et d'aimer dans le vaste monde" : il va enrichir le lyrisme moderne dès les Poésies de A. O. Barnabooth (1908) où "il accorde au réalisme et au rythme de son temps le rite du dépaysement romantique et cosmopolite. A une époque où les "grands express" sont les seuls moyens d'évasion, il donne à l'Europe qu'il parcourt passionnément une présence toute nouvelle" ...
"J'ai senti pour la première fois toute la douceur de vivre
Dans une cabine du Nord-Express entre Wirballen et Pskow...
Et vous, grandes glaces à travers lesquelles j'ai vu passer la Sibérie et les Monts du Samnium,
La Castille âpre et sans fleurs, la mer de Marmara sous la pluie tiède!
Prêtez-moi, ô Orient-Express, Sud-Brenner-Bahn, prêtez-moi
Vos miraculeux bruits sourds..." (Ode)
Blaise Cendrars franchira un nouveau pas promouvant la véritable aventure au rang d'acte poétique....
(Jean Oberlé (1900-1961, peintre et illustrateur)

(Valery Larbaud, Léon-Paul Fargue, Marie Monnier, Sylvia Beach et Adrienne Monnier)

Valery Larbaud (1881-1957)
On sait que Valéry Larbaud, traducteur influent dans le groupe de la N.R.F., vécut à l'ombre d'écrivains comme Gide et de critique littéraire comme Jean Paulhan, se contentant d'être un expert en littératures étrangères. "Une grande fortune et une santé fragile assurent à un adolescent qui se cherche disponibilité et sensibilité". Grand voyageur, il parcourt l'Europe, amoureux des littératures étrangères, fait découvrir aux Français des écrivains comme Samuel Butler, Walt Withman, H. von Hofmannsthal, Svevo, et rencontre James Joyce, qu'il traduisit et dont il imita le monologue intérieur dans "Amants, heureux amants" (1926). Larbaud a créé, à sa façon, un style littéraire : en effet, ce n'est pas tant une intrigue et des personnages qu'il entend construire, que l'ambiance d'un lieu, la vie d'un monde extérieur qu'il parcourt et re-parcourt dans un monologue intérieur, tout en nuances et en hésitation. Larbaud ne cesse aussi de poursuivre son être intime à travers le masque d'Archibald-Orson Barnabooth, milliardaire de fiction : "Poèmes par un Riche Amateur ou Oeuvres Françaises de M. Barnabooth" paraissent en 1908 et ses poèmes célèbrent les paquebots, les trains de luxe, les palaces cosmopolites. Son "Journal intime" entraînera le lecteur dans des villes qu'il aime, d'Amsterdam à Florence, de Moscou à Picadilly (1922). Il est ausi l'auteur de nombre d'essais critiques : Ce vice impuni, la lecture (Domaine anglais, 1925 ; Domaine français, 1941).
Sensible à la littérature ibérique, il édita en France Ramón Gómez de la Serna Puig (1888-1963), notamment "Le Docteur invraisemblable" (El Doctor Inverosímil, 1914), compilation d’une centaine de cas cliniques diagnostiqués et traités par un certain docteur Vivar, dont la méthode consiste à observer le patient dans son entourage. Prolifique écrivain catalan, Ramón inventa les "greguerías" (brèves sentences surgies de la rencontre de la collision de la pensée et de la réalité) et fit connaître à l'Espagne les avant-gardes européennes.
Atteint d'aphasie, dès 1935 Valéry Larbaud a dû cesser d'écrire ; il avait déjà presque pressenti l'état de passivité muette par lequel il achèverait une carrière toute en modestie...

Ce vice impuni, la lecture (1936)
"Incomparable «passeur» qui s'est employé à faire connaître en France les écrivains de langue anglaise, espagnole, portugaise, italienne, et réciproquement, à l'étranger, les nouveaux auteurs français, Valery Larbaud avait regroupé ses études sur la littérature de langue anglaise en 1925 pour La Phalange. Il reprit et compléta le volume en 1936 pour les éditions Galimard. Enfin, Domaine anglais figure en 1951 dans ses Œuvres complètes, avec, en appendice, plusieurs études supplémentaires. ...
Larbaud y célèbre Samuel Butler, G.K. Chesterton, Joseph Conrad, Charles Dickens, William Faulkner, Thomas Hardy, Nathaniel Hawthorne, James Joyce, George Meredith, Edgar Poe, H.G. Wells, Walt Whitman et beaucoup d'autres." (Editions Gallimard). Ce sera en humaniste que Larbaud soulignera l`existence d'une littérature spécifiquement américaine dont Edgar Poe n`est qu'un reflet tandis que Nathaniel Hawthorne et Walt Whitman en incarnent l`esprit original. Dès 1932, Larbaud écrira une présentation de William Faulkner en Préface à "Tandis que j 'agonise", et l'écrivain y définira son rôle d'introducteur et d'intermédiaire, rôle qu'il jouera pour deux écrivains d'outre-Manche, Samuel Butler et James Joyce. Du premier, il a traduira tant les œuvres essentielles (Ainsi va toute chair, Erewhon, La Vie et l'Habitude, les Carnets intimes). Et c'est le concours de James Joyce, qu'il procèdera à une revue devenue incontournable de la traduction d' "Ulysse" et retracé l'évolution de l'écrivain en Préface à "Dublinois".
"Domaine français (1941), le second tome de l`œuvre critique de Larbaud, est composé de deux parties, la première, consacrée aux auteurs antérieurs au XIXe siècle, la seconde, aux auteurs modernes. Les études sur Racan, Maurice Scève, Mérimée, Valéry se proposent de guider l` "étranger absolu" qui désire obtenir une "naturalisation intellectuelle". Et c`est pour ce lecteur, dont il veut éveiller la curiosité et auquel il veut transmettre le plaisir qu'il y a à remonter des derniers venus aux maîtres et précurseurs des maîtres, qu`il destine son oeuvre critique...

A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes - Fermina Márquez - Enfantines - Beauté, mon beau souci... - Amants, heureux amants... - Mon plus secret conseil...
Valery Larbaud (1881-1957)
Né et mort à Vichy (Allier), fils unique du pharmacien Nicolas Larbaud (qui a donné son nom à une célèbre source thermale, Larbaud-Saint Yorre et qui devait faire fortune en l`exploitant), très choyé par des parents à la fortune conséquente, Valery Larbaud fut mis tout d'abord au collège de Sainte-Barbe-des-Champs, à Fontenay-aux-Roses, "vieux collège, plus cosmopolite qu`une exposition universelle" : il y eut en effet pour condisciples de jeunes Américains du Sud, une leçon d`exotisme, dira-t-on, qui devait le marquer définitivement. Ayant achevé ses études secondaires au lycée Henri IV à Paris, il fréquenta la Sorbonne. Le voici à vingt-ans recueillant l'héritage paternel, voyageant en Italie, Allemagne, Angleterre, Suède, et, l'Espagne, déjà visitée dès l'âge de quinze ans et devenue sa seconde patrie. En 1908, il obtint sa licence ès lettres. Par la suite il partagera son temps entre Paris et son Bourbonnais natal. Bientôt, il deviendra le grand Européen dont il devait donner l'image dans son héros Barnabooth. Collaborant à La Plume dès 1901, il se fit connaître par sa traduction de la "Ballade du vieux marin" de Coleridge, de 1902 à 1907, il compose ces "Poèmes par un riche amateur" (1908), publiés à nouveau en 1923 sous le titre de "Poésies de A.O. Barnabooth". S'inspirant du grand poète américain Walt Whitman, il manifeste un esprit qui annonce celui de Paul Morand. Dès 1906,il se mit à écrire "Fermina Marquez", petit roman qu'il achève en 1909 et publie en 1911...
"Simple et raffiné, sentimental et cynique, voyageur et contemplatif, ne sachant jamais s'il préfère la littérature aux femmes ou la «nation» des femmes aux livres, Larbaud construit son art sur ses contradictions. Il invite le lecteur à les partager. Et, en effet, comment ne pas tomber sous le charme de chacune des œuvres de fiction regroupées dans le présent volume ? On commence par A. O. Barnabooth qui est bien plus qu'un roman : les œuvres complètes d'un richissime américain imaginé par Larbaud, et qui se serait mis à vivre et à écrire de façon autonome. Suit Fermina Márquez, considéré comme un des meilleurs romans sur les amours adolescentes. Ensuite Enfantines, ces nouvelles qui mêlent l'esprit d'enfance à un délicat érotisme. Enfin les trois courts romans : Beauté, mon beau souci..., Amants, heureux amants..., et Mon plus secret conseil..., qui offrent plusieurs portraits doux-amers de femmes : aimées quittées. Les histoires de Larbaud restent longtemps dans l'esprit du lecteur. On se prend à rêver à ces jours où d'heureux mortels n'avaient rien d'autre à faire que de voyager, tomber amoureux, se consoler en Espagne des chagrins de Londres, traîner dans les librairies de Florence et goûter, à travers l'Europe, la magie des wagons-lits." (Editions Gallimard)
Europe ! tu satisfais ces appétits sans bornes
De savoir, et les appétits de la chair,
Et ceux de l’estomac, et les appétits
Indicibles et plus qu’impériaux des Poètes,
Et tout orgueil de l’Enfer.
(Je me suis parfois demandé si tu n’étais pas une des marches, un canton adjacent de l’Enfer.)
Ô ma Muse, fille des grandes capitales ! tu reconnais tes rythmes
Dans ces grondements incessantes des rues interminables.
Viens, quittons nos habits du soir, et revêtons
Moi ce veston usé et toi cette robe de laine,
Et mêlons-nous au commun peuple que nous ignorons.
Allons danser au bal des étudiants et des grisettes,
Allons nous encanailler au café-concert !
Dis-toi
Que nous ne sommes ici que des hôtes de passage
Dont les empreintes marquent à peine, sans doute,
Sur cette boue légère et brillante que nous foulons.
Quand nous voudrons, nous rentrerons aux forêts vierges.
Le désert, la prairie, les Andes colossaux,
Le Nil blanc, Téhéran, Timor, les Mers du Sud,
Et toute la surface planétaire sont à nous, quand nous voudrons !
Car si j’étais un de ceux-là qui vivent toujours ici
Travaillant du matin au soir dans des usines,
Et dans des bureaux, et allant dans des soirées,
Ou jouer pour la centième fois un rôle dans un théâtre,
Ou dans les cercles, ou dans les réunions hippiques,
Je n’y pourrais tenir ! et tel qu’un paysan
Qui revient après avoir vendu sa récolte à la ville,
Je partirais,
Un bâton à la main, et j’irais, et j’irais,
Je marcherais sans m’arrêter vers l’Équateur !
Pour moi,
L’Europe est comme une seule grande ville
Pleine de provisions et de tous les plaisirs urbains,
Et le reste du monde
M’est la campagne ouverte où, sans chapeau,
Je cours contre le vent en poussant des cris sauvages !
Ode
Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce,
Ton glissement nocturne à travers l’Europe illuminée,
Ô train de luxe ! et l’angoissante musique
Qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré,
Tandis que derrière les portes laquées, aux loquets de cuivre lourd,
Dorment les millionnaires.
Je parcours en chantonnant tes couloirs
Et je suis ta course vers Vienne et Budapesth,
Mêlant ma voix à tes cent mille voix,
Ô Harmonika-Zug !
J’ai senti pour la première fois toute la douceur de vivre,
Dans une cabine du Nord-Express, entre Wirballen et Pskow.
On glissait à travers des prairies où des bergers,
Au pied de groupes de grands arbres pareils à des collines,
Étaient vêtus de peaux de moutons crues et sales…
(Huit heures du matin en automne, et la belle cantatrice
Aux yeux violets chantait dans la cabine à côté.)
Et vous, grandes places à travers lesquelles j’ai vu passer la Sibérie et les monts du Samnium,
La Castille âpre et sans fleurs, et la mer de Marmara sous une pluie tiède !
Prêtez-moi, ô Orient-Express, Sud-Brenner-Bahn , prêtez-moi
Vos miraculeux bruits sourds et
Vos vibrantes voix de chanterelle ;
Prêtez-moi la respiration légère et facile
Des locomotives hautes et minces, aux mouvements
Si aisés, les locomotives des rapides,
Précédant sans effort quatre wagons jaunes à lettres d’or
Dans les solitudes montagnardes de la Serbie,
Et, plus loin, à travers la Bulgarie pleine de roses…
Ah ! il faut que ces bruits et que ce mouvement
Entrent dans mes poèmes et disent
Pour moi ma vie indicible, ma vie
D’enfant qui ne veut rien savoir, sinon
Espérer éternellement des choses vagues.
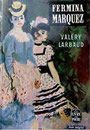
"Fermina Marquez" (1911)
"La pensée de la Ferminita est la plus belle pensée qu'on puisse avoir. Et ensuite, il y a le désir d'être aimé de la Ferminita. Mais la voir, ou plutôt la connaître, ou l'avoir connue, suffit à poétiser toute une existence. Des paquebots traversent l'océan Atlantique. Plus tard, quand nous serons des hommes, nous irons dans l'Amérique du Sud. Nous y verrons toutes les femmes avec ces yeux qui auront vu Fermina Marquez..." - Parmi les romans de Valery Larbaud évoquant l'enfance et l'adolescence, Fermina Marquez est reconnu comme le plus autobiographique et sans doute le plus beau. Il raconte l'émoi des pensionnaires d'un collège des environs de Paris devant l'apparition quotidienne dans le parc voisin d'une jeune fille de seize ans, Fermina, venue rendre visite à son frère. Prêts à tout pour l'approcher, quelques collégiens vont braver les interdits....
(I) "Le reflet de la porte vitrée du parloir passa brusquement sur le sable de la cour, à nos pieds. Santos leva la tête, et dit : "Des jeunes filles." Alors, nous eûmes tous les yeux fixés sur le perron, où se tenaient, en effet, à côté du préfet des études, deux jeunes filles en bleu, et aussi une grosse dame en noir. Tous quatre descendirent les quelques marches et, suivant l'allée qui longeait la cour, se dirigèrent vers le fond du parc, vers la terrasse d'où l'on voyait la vallée de la Seine et Paris, au loin. Le préfet des études montrait aux parents des nouveaux élèves, une fois pour toutes, les beautés de son collège. Comme les jeunes filles passaient le long de la grande cour ovale, où les élèves de toutes les classes étaient réunis, chacun de nous les dévisagea à son aise.
Nous étions une bande d'effrontés, de jeunes roués (entre seize et dix-neuf ans) qui mettions notre honneur à tout oser en fait d'indiscipline et d'insolence. Nous n'étions pas élevés à la française, et, du reste, nous Français, nous n'étions qu'une bien faible minorité dans le collège; à tel point, que la langue en usage entre élèves était l'espagnol. Le ton dominant de l'institution était la dérision de toute sensiblerie et l'exaltation des plus rudes vertus. Bref, c'était un lieu où l'on entendait cent fois par jour, prononcés avec un accent héroïque, ces mots : "Nous autres Américains."
Ceux qui disaient cela (Santos et les autres) formaient une élite dont tous les élèves exotiques (Orientaux, Persans, Siamois) étaient exclus, une élite dans laquelle, pourtant, nous Français étions admis, d'abord parce que nous étions chez nous, dans notre propre pays, et ensuite parce que, comme nation, historiquement nous valions presque la race au sang bleu, la gent de raison. C'est là un sentiment qui paraît perdu, aujourd'hui, chez nous : on dirait que nous sommes des bâtards qui évitons de parler de nos pères. Ces fils des armateurs de Montevideo, des marchands de guano du Callao, ou des fabricants de chapeaux de l'Équateur, se sentaient, dans toute leur personne et à tous les instants de leur vie, les descendants des Conquistadores. Le respect qu'ils avaient pour le sang espagnol, -même lorsque ce sang était, comme chez la plupart d'entre eux, un peu mélangé de sang indien, - était si grand, que tout orgueil nobiliaire, que tout fanatisme de caste semble mesquin, comparé à ce sentiment-là, à la certitude d'avoir pour ancêtres des paysans de la Castille ou des Asturies. C'était une belle et bonne chose, après tout, que de vivre parmi des gens qui avaient ce respect d'eux-mêmes (et ce n'étaient que de grands enfants). Je suis sûr que le petit nombre d'anciens élèves restés en France se rappellent aujourd'hui avec reconnaissance notre vieux collège, plus cosmopolite qu'une exposition universelle, cet illustre collège Saint-Augustin, maintenant abandonné, fermé depuis quinze ans déjà...
C'est parmi les souvenirs d'une des plus glorieuses nations de la terre que nous y avons grandi; le monde castillan fut notre seconde patrie, et nous avons, des années, considéré le Nouveau Monde et l'Espagne comme d'autres Terres Saintes où Dieu, par l'entremise d'une race de héros, avait déployé ses prodiges. -Oui, l'esprit qui dominait chez nous était un esprit d'entreprise et d'héroïsme ; nous nous efforcions de ressembler aux plus âgés d'entre nous, que nous admirions : à Santos, par exemple; à son frère cadet Pablo; naïvement nous imitions leurs manières et jusqu'au son de leur voix, et nous avions, à les imiter ainsi, un plaisir extrême. Voilà pourquoi nous nous tenions tous, à ce moment, près de la haie de myrtes qui séparait la cour de la grande allée du parc, domptant notre timidité pour admirer, avec une impudence voulue, les étrangères.
De leur côté, les jeunes filles soutinrent hardiment tous les regards. L'aînée surtout : elle passa lentement devant nous, nous regarda tous, et ses paupières ne battirent pas une seule fois. Quand elles eurent passé, Pablo dit à très haute voix : "Jolies filles"; c'était ce que nous pensions tous.
Puis, chacun, parlant courtement, donna son opinion. En général, la plus jeune des deux sœurs, celle qui avait sur le dos une épaisse queue de cheveux noirs nouée en papillon d'un large ruban bleu, la "petite", fut jugée insignifiante, ou du moins trop jeune (douze, treize ans, peut-être) pour être digne de notre attention : nous étions de tels hommes!
Mais l'aînée! nous ne trouvions pas de mots pour exprimer sa beauté; ou plutôt, nous ne trouvions que des paroles banales qui n'exprimaient rien du tout; des vers de madrigaux : yeux de velours, rameau fleuri, etc., etc. Sa taille de seize ans avait, à la fois, tant de souplesse et de fermeté; et ses hanches, au bas de cette taille, n'étaient-elles pas comparables à une guirlande triomphale? Et cette démarche assurée, cadencée, montrait que cette créature éblouissante avait conscience d'orner le monde où elle marchait...
Vraiment, elle faisait penser à tous les bonheurs de la vie.
"Et elle est chaussée, habillée et coiffée à la dernière mode", conclut Demoisel, un grand noir de dix-huit ans, une brute, qui avait coutume d'affirmer, sans vouloir s'expliquer mieux, que sa propre mère était "Parisienne de Paris" et la reine du bon ton à Port-au-Prince...."
Ce trouble, devenu bouleversement, qu'apporte une jeune Péruvienne, Fermina Márquez, dans la vie quotidienne des collégiens de Saint-Augustin, va tout simplement les initier à la pratique de la vie : Joanny Lienôt, le fort en thème qui travaillait par ennui. pour oublier les murs du collège, sitôt que le préfet des études le charge de piloter la jeune voyageuse, le voici aussitôt jeté aux prises avec l`existence. ll croit ne pas manquer de ressources pour l`affronter et la retenir. N`a-t-il pas lu tous les classiques psychologues de la passion amoureuse ? Ne s'est-il pas débarrassé du préjugé familial des "honnêtes" femmes ? ll n`y a pas d` "honnêtes" femmes, se dit Joanny, cette croyance n'a pour seul objectif que d'entretenir la timidité des jeunes garçons et leur retenue. Fermina Marquez sera celle donc à qui aura l'audace de la conquérir. Certes, Santos Iturria de Monterey, le bel Américain du Sud, fier de son sang castillan, déjà émancipé, qui tous les soirs fait le mur du collège pour aller passer ses nuits à Montmartre, aurait eu plus de chances que Joanny. Mais c'est Joanny, et non Santos condamné aux récréations communes après le réfectoire, qui accompagne Fermina dans ses promenades.
Le bon élève part à l'assaut de l`adolescente comme font les bons élèves pour les versions grecques. Mais quelle surprise ! Cette citadelle, cette version rébarbative, cette femme dont il faut emporter de vive force les faveurs, n'est qu'une gentille camarade, qui tend sa main avec tant de grâce, parle sans cesse de la douleur du Christ et des clous de la Croix, et prête à son compagnon, pour qu`il édifie son âme, la vie de sainte Rose de Lima. Toutes les stratégies possibles en face d`elIe, s`écroulent, les auteurs classiques laissent la timidité adolescente sans secours, et pourtant une joie de vivre pénètre l'âme : la place d`étude n'est plus maintenant que le lieu où Fermina s`est assise, où elle a laissé un peu de son parfum, un jour que Joanny lui faisait visiter le collège ; et son lit, au dortoir, ce n`est plus celui où le bon élève repassait encore et encore ses leçons, c`est la place que Fermina a daigné un jour effleurer d'un coup d`œil. Mais alors quelle ruse ménager, quelle séduction développer avec une vierge angélique qui ne parle que des saints et de la "puanteur de ses péchés"? Il faut alors idéaliser, Joanny révèle à Fermina son grand projet, dont tous se moquent, son rêve de restaurer un jour l'admirable empire universel de la Rome antique. Fermina pourrait être cette âme soeur qu'il recherche tant?
Au retour des vacances de Pentecôte, Fermina ne parle plus des clous de la Croix ni de sainte Rose de Lima. C'est qu'entre le futur restaurateur de l`empire d'Auguste et le beau Santos Iturria qui lui a rendu visite à Paris pendant les vacances, elle a choisi. Elle aussi a découvert son cœur, décide, pour vaincre la tentation, de se mettre par terre, couchée une heure les bras en croix devant le crucifix mais suffoque au bout de dix minutes. Alors, elle ouvre ses fenêtres sur la nuit, elle se couche dans sa plus belle robe, elle boit de toutes les puissances de l`imagination l`image de Santos. Joanny a compris. Il dira tout à Fermina et demandera au père préfet de le décharger de sa charge de cicerone.
Que deviendront-elles, les amours adolescentes? Le collège Saint-Augustin fermera, Santos épousera une superbe Allemande, Joanny n'aura pas le temps de montrer son génie : il mourra d'une épidémie à la caserne. Mais, l`espace d`un printemps, parce qu'une robe de jeune fille est apparue un jour dans la galerie du collège des pères jésuites, les murs du collège ont tremblé, le beau temps des prix d`excellence, des versions et de la restauration de l'Empire romain, le beau temps de l`adolescence aura pris fin : une sainte de moins sur la terre, un peu de joie, beaucoup de désespoir dans l`âme d`un bon élève ...

"A.O.Barnabooth" (1913)
C'est en 1913 que Valéry Larbaud publia le livre qui fonda sa réputation, "A.O.Barnabooth. Le pauvre chemisier. Son journal intime"... C'est en effet le journal intime d`un personnage imaginaire, un multi-millionnaire sud-américain qui entend n'être pas la victime de son immense fortune, et mène d'hôtel de luxe en hôtel de luxe une vie oisive et studieuse et son interminable quête de raisons de vivre ..
Le livre s'ouvre sur un court apologue, "Le pauvre chemisier", qui permet de faire la connaissance du personnage central. ll y apparaît dans une de ses mésaventures caractéristiques comme un être à la fois inquiet et moqueur, sérieux et capricieux. Le "Journal" est le récit, au jour le jour, de ses tentatives et de ses aventures. Pris entre son désir d'une liberté toujours plus grande que seuls sa fortune, ses préjugés et la délicatesse de sa conscience empêchent d'être totale, et la nostalgie des attachements humains, A. O. Barnabooth retrace fidèlement les étapes de son éducation sentimentale, et par là le livre de Valery Larbaud se rattache à la grande tradition des romans de la formation.
Quelques amis, cosmopolites comme lui et que leurs conditions de famille et de fortune rendent aussi peu dépendants que lui des circonstances extérieures : un gentilhomme français, un esthète irlandais et un prince russe lui donnent la réplique. Eux aussi se trouvent dans la situation de choisir leur forme de vie : ou bien de s'engager par l'exercice d'une tâche quotidienne et la fondation d`une famille, ou bien de poursuivre leur vagabondage élégant. Lorsque A. O. Barnabooth se décide enfin au mariage et au retour au pays natal, il abandonne ce journal qui dorénavant n'aurait plus de raison d'être.
C'est une œuvre bien isolée au milieu des courants littéraires de son temps et qui rend un son très moderne, d'autant que Valery Larbaud joint à la meilleure tradition de l'humour satirique anglais (celle de Butler par exemple), la tradition moraliste de la littérature française classique, et mêle à un ton parfois frivole une analyse remarquablement profonde des sentiments de ses personnages...
"... Promenades à pied, dans les rues profondes et fraîches. Le matin, de petites voitures chargées de choses odorantes remplissent de vacarme les carrefours sombres. Au bout d'une ficelle, un joli panier descend du troisième étage, le long du mur, jusqu'à hauteur d'homme. Un maraîcher y met des salades et des fruits, et le facteur qui survient y dépose une lettre. On voit sur Taccoudoir le bras nu ensoleillé qui tient la ficelle. Le panier remonte en faisant des bonds d'allégresse. Des popolane qui passent me raillent. Plus loin une petite fille traverse la rue devant moi et me crie : " Signorino ! " d'une voix grêle... J'ouvre mes mains à l'air tiède, je souris aux coulées de soleil qui coupent les bandes grises et les bandes vertes des perspectives où tournent les rues sans trottoirs. Et à la limite du ciel, les toits plats, grands chapeaux de soleil, avancent un peu, faisant une ombre courte au front des maisons ; des toits avec leur armature ; vrais et beaux comme une expression homérique. L'après-midi, un peu de tramontane raclait la pierre.
Mon premier voyage d'homme libre : puisque je me suis libéré de mes devoirs sociaux ; évadé de la caste où le destin voulait m'emprisonner ; puisque je ne suis plus l'esclave de mon écurie de course et de mon équipage de chasse ; puisque je ne rencontre plus, au bout de tous mes chemins, le démon de la propriété immobilière.
Tour aux Cascine et retour le long de l'Arno. Ces quais de pierre, ce parapet à la double bande rose fané et jaune pâle, de brique et de pierre, cette chaussée droite et dure ; comme on s'attache à l'Italie ! qu'y a-t-il de si beau et de si aimable dans le paysage provincial que je vois de ces fenêtres : les champs dorés de l'Arno entre les ponts et, oltr'Arno, la masse aveugle et le dôme ennuyé de San Frediano au milieu des maisons vieilles et nues ; et ce bout de campagne déjà, avec une ou deux villas jaunes entre des cyprès et de petits cèdres déchiquetés ? Je ne sens rien ici de l'antique République. C'est plutôt un ennui vague de n'être plus le Salon de l'Europe et d'avoir vu fuir le dernier Grand-Duc de Toscane. Une Florence provinciale et vivant des souvenirs de l'époque léopoldine, et de la bousculade des cinq années où elle fut capitale. Anciens carnavals, mascarades de la Pergola et des Uffizi, courses de chars devant Sainte- Marie-Nouvelle, est-ce que ces printemps d'autrefois n'étaient pas plus gais que ceux-ci ; autre chose que ce Danemark d'été ?
Les journaux de ce soir publient le portrait de Stéphane et sont remplis des extraits du discours qu'il a prononcé aux cérémonies du jubilé royal de Saxe. Nous l'avions préparé ensemble, ce fameux discours, et j'en avais fait une parodie qui nous avait rendus malades de rire. — Mon pauvre Stéphane, quand seras-tu libre, toi aussi ?
Carlton Hôtel, Florence, 14 Avril.
Désir d'aller jusqu'au Val d'Ema voir l'ancien Casino Barnabooth. Mais le désir plus fort de flâner dans les pasticcerie du centre de la ville m'a retenu. Ce soir, j'y songe avec quelque regret. J'imagine le Casino Barnabooth, pauvre maison aux contrevents fermés, toute seule dans la nuit sur les collines parfumées. Il était cramponné à flanc de coteau, entre des chemins pleins d'inutiles détours. Le jardin carré était en terrasse sur quatre murs gris. On avait tout fait pour qu'il n'eût ni ombre ni verdure dans ce jardin. Oh, mes buis taillés en lions, en tortues et en pintades (ou en paons, peut-être ?), o cantaros noirs inclinés sur la soif de midi juste ! Et mes bosquets de lilas qui n'ont jamais fleuri, et mon labyrinthe où il n'était pas possible, avec la meilleure volonté du monde, de s'égarer.
Cartuyvels l'a vendu à une société de spéculateurs, et il est vide, en ce moment.
Cartuyvels, le fidèle C. — Je suis content d'avoir enfin échappé à sa surveillance en faisant vendre mes biens. Sous prétexte d'administrer ma fortune, il cherchait à être mon mentor. Il y a entre nous un malentendu que le temps seul pourra dissiper. II croit qu'il est seul de nous deux à prendre la vie au sérieux. Il estime qu'en ce moment je ne fais que m'amuser, jeter ma gourme à tous les vents de l'Europe. Il se dit aussi que cela n'aura qu'un temps, et que je finirai bien par me ranger.
Toute cette ferveur de ma jeunesse, cette ardente quête de Dieu, pour Cartuyvels c'est "la noce" qu'il faut bien que tout jeune homme "dans ma position" fasse. Son œil plein d'expérience (de son expérience à lui) me surveille, et attend, attend que le poulain échappé revienne au râtelier.
Et moi je pense : " Pauvre homme, ton petit bonheur te suffit donc ? Tu bois et tu manges et tu dors, et jamais tu n'as songé à déchiffrer l'énigme de la vie. Tout de suite tu as rejeté le monde comme on repousse, agacé, un rébus difficile, et tu as choisi la routine, la vie animale, pour ta part... " Mais je sens que je suis injuste à son égard.
La vente de mes biens, cette évasion hors de mon milieu social, l'a d'abord atterré. Il croyait déjà que je me rangeais, que j'allais m'enliser dans des habitudes, et que bientôt mon âme serait écrasée sous l'énorme faix de ma richesse. Son attente a été bien trompée. Mais il s'est vite remis. Cette action, que je considère comme d'une importance presque symbolique, est pour lui une frasque un peu plus forte que les autres, voilà tout. Son regard dit clairement : "Tôt ou tard, ça viendra."
Et par moments, j'ai peur. Est-ce que ça viendra vraiment ? Ce jour où je me mettrai au service de mon argent, où j'aurai tourné le dos à l'absolu ; où je serai un satisfait, comme Cartuyvels, comme presque tout le monde, — ce jour où j'abdiquerai Tout ! Ah, non ! plutôt mourir, Fidèle !
Avoir avec lui une explication... Lui montrer qu'il se trompe, lui faire bien sentir tout ce qu'il est, remuer toutes les fondations de sa vie en sa présence, — et puis enfin lui crier : "Mais moi, je ne te méconnais pas. Fidèle ! moi, je t'estime terriblement, mon bon vieux !"
Florence, Jeudi 15 Avril...."

"Amants, heureux amants" (1920-1924)
Ayant, en 1919, fait la connaissance de James Joyce, Valéry Larbaud fut si séduit par son "monologue intérieur", qu`il usa lui-même de ce moyen d`expression dans le recueil de récits qu'il publia ensuite, "Amants, heureux amants". Et, nous dit-on, soucieux de témoigner à Joyce son tribut de reconnaissance littéraire, il lui proposa de revoir avec lui la si complexe traduction d' "Ulysse", due à Auguste Morel et Stuart Gilbert (1929). Il cessa par la suite de cultiver le roman pour se vouer à la tâche d'essayiste, de critique et de traducteur. De même qu'il avait fait connaître à l'étranger la littérature française contemporaine, Larbaud, grâce à son don des langues, révéla à son pays natal bien des écrivains qu'elle ignorait, Samuel Butler, G. K. Chesterton, Joseph Conrad, Coventry Patmore, Ramon Gomez de la Sema, et bien entendu James Joyce, etc....
Recueil de trois nouvelles parues en 1920-1924, dont la première, "Beauté, mon beau souci" est un récit de forme classique, le personnage principal ne parvient à faire revivre des amours adolescentes .. Marc Fournier, jeune Français en villégiature à Londres, prend pour intendante et maitresse une veuve anglaise. Au bout de quelque temps, il fait la connaissance de sa fille à peine sortie de l'adolescence, et une curieuse intrigue lie le jeune homme et la petite Queenie. Quelques années plus tard. il la retrouve à Londres pendant un court séjour. La mère de Queenie est morte et celle-ci, déçue par les hommes, se retrouve pauvre et seule dans la vie. Marc Fournier essaie de reprendre leur relation d`autrefois, mais se heurte à la méfiance de la jeune Anglaise qui refuse l'aide qu`il lui propose. Finalement, Queenie épousera un homme qu`elle a d`abord détesté et se réconciliera avec sa famille, qu`elle avait quittée ; elle identifiera cet étranger à son premier amour et parviendra à l`aimer.
Dédiée à James Joyce, la deuxième nouvelle, qui donne son titre au recueil, est un long monologue intérieur qui voit le personnage principal se résigner à ne plus pouvoir prolonger une intrigue qui meurt d`elle-même. C'est une méditation où la pensée de celui qui parle commence par s'attarder sur la présence de deux jeunes femmes aimées, Inga et Cerri, qui vont tout à l`heure le quitter et partir ensemble. Le style de ce monologue procède par associations d`idées et de sensations et entend reproduire I'état apparemment incohérent et cependant dialectique de la pensée même; il charrie, comme un torrent, toutes sortes d`impressions, de projets mort-nés, de souvenirs....
"Des flots et de Palavas-les-Flots le soleil qui vient tout droit jaillit à travers les lames de la persienne; c'est bon, de pouvoir laisser la fenêtre ouverte toute la nuit, à ce commencement de novembre. Les bouteilles et les coupes sur la table et sur le guéridon, la bouteille encore bouchée, dans le seau à glace; ce désordre. Et la porte ouverte qui tous ces derniers jours était verrouillée. Elles dorment encore. Tant mieux. J'aime me sentir seul à cette heure la plus fraîche et la plus solitaire; la plus, de toutes, lucide. Elle réduit à leurs justes proportions toutes ces histoires de... Bon, de se retrouver soi-même, l'esprit net et tranquille, désabusé, après la confusion et le délire. Ne pas bouger. Mais non. ]'irai. Les regarder dormir. Doucement; pourvu que le chien de Cerri ne se mette pas à aboyer. Zitto, Zitto. Il m'a vu et reste couché sur le fauteuil. M'étendre sur le canapé; retourner ce coussin; ce galon me gêne; ornements; il n'y en aura pas de l'autre côté. Horrible, le toucher du velours. Au réveil et jusqu'après le bain on ne devrait avoir de contact qu'avec de la toile. D`ici, je les vois assez bien. Sommeil au champagne. L'oreiller me cache leur figure. Les boucles blondes près des lanières bleu-noir, et le bras brun et lourd de Cerri sous le bras tendre et nerveux et blanc d'Inga. Elles se sont prises par la main en dormant. Brave ragazze. Leurs formes confuses sous les couvertures; mêlées. Et cette chambre qui était pour moi, hier encore, "la chambre à côté de la mienne". Ne pas bouger. Cela durera jusqu'à ce que ce long rayon étroit se soit assez allongé pour toucher leur oreiller. De ma chambre vient jusqu'ici le souffle frais du dehors, l'odeur du matin provençal. Celle à qui je pense m'a dit un jour : "Comme ça doit être triste, un pays où on ne dit pas la messe." Oui, et après le pays sans messe il y a la ville qui ne connaît pas la mer. Villes non marines, villes de terre; après elles, la monotonie des cultures, partout. Mais les meilleures des villes marines sont celles qui ont été très indolentes pour rejoindre le rivage proche : Athènes, Valence, celle-ci et d'autres, - bien peu, - que je ne connais pas. Prudes, fausses timides, mais difficiles à démasquer d'abord, comme celle à qui je pense, avec son linge qui pourrait tenir, chiffonné, dans mon poing fermé, et ses fines dentelles sous le saint habit de Notre-Dame. De même Inga : la tenue décente et correcte, l'air Candide, et sa vie sans frein. Athènes, Valence et celle-ci qui ressemble à Athènes : au plus calme de leurs jardins, au cœur de leurs patios frais et bleus, dans le silence de leurs enclos où repose, tout noir et hérissé, l'alignement épais des orangers - tout à coup : "Viens donc!" - le vent du large. Et les tentures des cafés et des magasins, celle de la Paz, rue de la Loge, se mettent à s'enfler et à battre comme des voiles, et tout ce qui peut s'agiter dans la brise est saisi de l'allégresse de la mer. Et se balancent et chantent ces rideaux de bambou, de perles et de verre qui sont aux portes des coiffeurs. Et même la nuit, à un carrefour, au long de l'Esplanade vide, la rencontre avec le souffle tendu, éperdu, tout d'une pièce, des grandes traversées. "Viens donc!" Et pourquoi pas? j'en ai vu bien d'autres. Cette grosse lumière rouge au flanc du cargo-boat, dans le noir universel, c'était La Sude; et comme on était passé près de la Petite-Cythère : tous les détails du paysage en amphithéâtre; les troupeaux, les oliviers, une fontaine. Et un Arlequin et une Colombine rose et verte, soudain aperçus et perdus de vue au fond d'une avenue aux arbres dépouillés : les premiers habitants que je rencontrais, un jour que je venais de débarquer dans une ville, ayant oublié qu'on était en Carnaval. Et la mer, encore, à son réveil, qui est apaisement, à cette heure-ci, sensible jusque sur la plus lointaine, la plus pauvre place de cette ville: le macadam luisant comme le pont d'un paquebot lavé à l'aurore et que sèche le même vent rapide et désordonné. Il faudra que je les mène aux environs de la ville, aux bords du Lez, à ce coin de verdures et d'eau tranquille. Ce qu'il y a de tableau champêtre bien composé, de Poussin surtout, dans ces paysages de petits fleuves au voisinage de la Méditerranée. Et que je leur montre de plus près ces jardins de la banlieue blanche. Oï. Κεπόι. Tout à fait ça : derrière les murs blancs, que longe une rue profondément tapissée de poussière, il y a le joli Kèpos frais, plein de verdure, de fleurs et d'eaux vives. Et les bois sacrés sur les collines, la campagne civilisée, arrangée par les architectes pour servir de fond aux rues, aux avenues et aux terrasses de la ville. Entre les panaches des pins maritimes, la ville toute raide et archaïque regarde la garrigue tachetée de touffes de buis et de romarin, et plus bas les oliviers et les cyprès, et plus loin Latte, et les lagunes, et Maguelone, et le long, mince reflet de fer-blanc au bord du ciel. La campagne autour de Mégare. Il faut que ces deux enfants de la grâce connaissent mieux cette gracieuse cité. Elles n`ont pas encore vu l'arc de triomphe au seuil de la grande terrasse qui est une solitude d'eaux prisonnières et de pierres dévorées par des siècles de lumière, et le petit temple derrière lequel l'aqueduc
commence sa marche ininterrompue, une jambe pour chaque pas, jusqu`aux collines qui bornent l'horizon. Ce matin même je les y mènerai, puisqu'elles repartent ce soir. Ah, le chien de Cerri a bougé. Sa chute, hier, à Palavas. "Poverino! tutto bagnato! Giù!" Désagréable animal. Le soleil touche le drap juste à la hauteur de... Si je ne craignais pas de les réveiller, je tirerais le drap pour voir arriver le rayon sur la gorge d'Inga, comme ce jour où nous étions ensemble dans son pays, ce matin de l'autre été, dans la chambre d'auberge, à Finja. L'odeur des brindilles de sapin dont les planchers étaient parsemés. Là, je l'ai eue bien à moi, tout entière, et pas une arrière-pensée entre nous, rien que la jeunesse et l'été, et ses dix-neuf ans, et à son bras gauche ce lourd anneau d'or qu'elle avait oublié de quitter. Et c'est un de ces jours-là qui a été son anniversaire. Oui, à moi sûrement, cette fois du moins. Ni toute son expérience, ni son art, ni ses années d'Autriche, de France, et d'Italie, ne comptaient plus : comme elle savait bien être "fille du pays" : Fröken Ingeborg, Kaere Inga, sa dignité, sa tenue si prude, et son rire pouffant, de petite fille, tout à coup. Mais femme aussi : la jeune dame de la ville, dans cette auberge de village, dans le grand lit paysan. Fille et femme des Rois de la Mer : la même race, les mêmes yeux farouches et tendres, - ses longs yeux clairs, - que ces filles qu'ils emportaient dans leurs navires hérissés de longues rames, à la proue en forme de tête de cheval ou de dragon. Jonchées de lis sur les rudes toisons, le doux et grand butin de guerre. Aux rives de Northumbrie, d'Écosse ou d'Islande, ils les débarquaient soigneusement, comme les Phéniciens leurs tapis et leurs vases. Et parfois il dut y avoir la rencontre d'une fille d'Italie ou de la Narbonnaise avec une de ces grandes païennes toutes claires et dorées comme l'ancienne Aphrodite d'or. La façon dont elles se considéraient sans rien dire; leur étonnement. Comme ce pape, au marché des esclaves, à Rome : "Non pas Angles mais Anges." Quelque chose comme cela; à moins... Comme c'est secret pour nous, les pensées d'une femme à la vue d'une autre femme. La première rencontre d'Inga et de Cerri. Mais avec Inga il n'y a pas de doute. Pourquoi cela ne se passe-t-il plus souvent? "je n'ai eu que des brunes pour amies, de ces femmes qui ont toujours l'air d'être à l'ombre, comme les sources. A l'école j'avais Greta Kromer, au Conservatoire Rosele Mayer; ensuite il y eut Carmela Savini, et j'ai pensé mourir quand Maria Ferrero m'a quittée." Pauvre cœur d'Inga ! depuis ses douze ou treize ans occupé par ces amitiés passionnées, torturé par les jalousies, les fureurs, les délices, les lâchetés, les triomphes, les abandons. Ses lettres, ses bouquets fanés, ses rubans, un grand tiroir, chez elle, plein d'éventails brisés, et les boucles de cheveux bruns ou noirs dans les médaillons ternis. Nulle place pour autre chose, dans ce cher cœur d'Inga ..."
(Gallimard)
Dédiée à à Emile Dujardin (1861-1949), - l`auteur de "Les lauriers sont coupés" (1887) et considéré comme l`ancêtre du monologue intérieur -, la troisième nouvelle, "Mon plus secret conseil", est également un monologue intérieur, mais d`un mode tout à fait différent du précédent, et dont le personnage principal renonce à toute nouvelle aventure. Rédigé tantôt à la troisième, tantôt à la première personne, il accompagne le voyage de réflexion, la retraite méditative d`un jeune homme qui fuit sa maîtresse avant de rejoindre celle qui l`a remplacée dans son affection. Sa méditation est interrompue par l`annonce des gares où passe le train et par des évocations des paysages qu`il traverse. Au fur et à mesure qu`il s`éloigne du lieu où sont encore les deux femmes, le héros se dégage de mieux en mieux de ces événements auparavant trop proches de lui pour qu`il puisse porter sur eux un jugement valable. Après avoir esquissé le projet de revenir vers sa première maîtresse, il se résout à ne plus revenir vers ces deux femmes dont l'une est trop réelle et dont l`autre n'est qu`un rêve : il repartira, seul ...
"XVII - C'est à l'époque de ces promenades hors de la ville qu'a eu lieu la grande scène : l'inoubliable, la plus terrible de toutes, celle qui aurait dû être la dernière parce qu'elle m'a offert un prétexte, et même une raison sans réplique, pour rompre avec Isabelle, et je n'en ai pas profité!
La journée avait bien commencé. Elle avait consenti à sortir avant le déjeuner, à venir avec moi jusqu`au jardin botanique. Après, au lieu de rentrer à la maison, nous allons déjeuner au restaurant qui est au coin du Toledo et de la Chiaja. A une table voisine, un couple de vieilles gens. Elle, grande, droite, un buste en bois ou en carton, une figure sèche, rougeâtre, fripée. Lui, plus grand encore, le visage long, tout rasé, rectangulaire, grandes joues plates, couperosées, yeux vitreux, monocle indévissable, avec lequel on l'imagine très bien dormant ou étendu mort sur un lit d'apparat; une vague de cheveux grisonnants, courte et massive, un peu relevée en toupet au sommet du front resté jeune.
"Isabelle, savez-vous qui sont nos voisins? - Non, des Anglais, sans doute. - Penchez-vous, je vous dirai le nom; vous le connaissez. - Eh bien? - Joë Chamberlain et sa femme. Ils sont en Sicile; j'ai vu leurs noms dans le journal, hier soir. Ils sont au Bertolini." Puis nous parlons d'autre chose.
Nous sortons, prenons une voiture pour aller sur la route de Pausilippe... Il n'y aura pas d'orage aujourd'hui. Elle n'a pas cette gaîté nerveuse qui précède les crises, mais je sens qu'ellç est contente; il y a comme un retour aux gentillesses des premières semaines, quand il lui arrivait de parler si joliment, avec des trouvailles qui me surprenaient, des répliques pleines d'à-propos, des déformations d'objets parfois tout à fait drôles... Maintenant elle parle des longues joues plates de l'homme d'État anglais, des caricatures de lui qu'elle a vues; elle dit : "Un collégien de soixante ans, plus grand que nature; fait remarquer qu'il n'avait pas d'orchidée à la boutonnière de son veston clair; demande des renseignements sur son grand discours de Birmingham : "Apprenez à penser impérialement"; comment cela se dit-il en anglais, et qu'est-ce que cela signifie au juste?" Elle écoute mes explications avec un beau regard d”écolière attentive et sage, qui comprend vite ce qu'on lui dit... Nous parlons d'autre chose... Des auberges allemandes de Capri avec leurs serveuses en costumes noir-blanc-rouge. Mais elle revient à Joë Chamberlain. Ah, je comprends... Serait-ce possible ?... Tout ce contentement parce qu'elle a déjeuné à une table placée près de la table où déjeunait l'homme politique le plus célèbre du moment !... Oui, voilà l'explication...
Oh, c'est touchant. Un de ces traits de naïveté qui nous font aimer les gens. Petite bourgeoise, oh, ma petite bourgeoise... Moi, si on me pressait un peu, je dirais que c'est plutôt Joë Chamberlain qui pourrait être flatté d'avoir été le voisin de table du jeune poète
français Lucas Letheil. Mais pour elle il n`y a pas de comparaison possible entre son amant et ce grand homme, cet agitateur de peuples, ce chef de parti dont les journaux impriment le nom tous les jours et dont les paroles bouleversent les marchés financiers... Oh, je suis content de voir ça, ce côté humble et snob de son caractère; je ne m'y attendais pas. Et encore mieux que cela : elle m`est reconnaissante de ce contentement qu'elle éprouve. Elle pense qu'avec son mari, là-bas dans quelque préfecture de l`Est, pareille aventure ne lui serait jamais arrivée. Oui : un voyage, de loin en loin, à Paris; mais non pas des déjeuners dans des restaurants où on peut se trouver assise à deux mètres de gens célèbres dans le monde entier. Elle m'est reconnaissante de lui avoir donné une existence dans laquelle il vous arrive de ces choses-là... Se dit probablement qu'il est plus élégant de passer l'hiver à Naples que dans le cinquième arrondissement; se compare peut-être aux héroïnes des romans de Paul Bourget. Comme c'est touchant. Irène sans doute aurait d'autres naïvetés, mais pas celle-là, qui me découvre jusqu'au fond la petite vie modeste, effacée, l'âme toute simple d`Isabelle. La comparaison qu'elle fait ainsi de sa vie avant d'être ma maîtresse et de sa vie depuis qu'elle l'est peut être l'origine d'un retour sur elle-même, d'une heureuse modification de son caractère. Et penser que je devrai tout cela à Joë Chamberlain !
Eh bien, pour fêter cet événement, cette espèce de réconciliation tacite, nous allons nous faire conduire à ce restaurant populaire de la banlieue, fameux pour ses langoustes, son macaroni aux fruits de mer et sa mozzarella in carrozzella (dont cet ami de donna Clementina m'a parlé). Nous garderons la voiture, qui nous ramènera au Vomero vers onze heures du soir. L'endroit va être amusant avec son mélange de gens du peuple et de touristes des grands hôtels.
Nous mangeons et nous buvons beaucoup; et je m'amuse à remplir sans cesse son verre de ce merveilleux vin de Capri. Du moment que nous avons gardé la voiture... Peu probable que je lise Thomas de Quincey cette nuit.
Nous rentrons; dans l'obscurité bleue de la route en terrasse sur la mer. Elle m'a pris la main. Elle chante à mi-voix dans le bruit de la voiture, dans la respiration de la mer, dans le chuchotement et les aspersions des vagues au long de la côte, un cantique de première
communiante, en français, et j'écoute cette voix de son enfance et je pense à la petite fille qu'elle a été... Bambina, bambina mia... Je suis presque infidèle à Irène.
Enfin, à la maison. De nous deux, c'est moi le plus calme; non, exactement: le plus ridicule. Elle s'est laissée tomber sur le canapé de notre chambre. Monsieur déshabillera Madame ce soir. Et d'abord ces chers petits pieds prisonniers. L'odeur du cuir chaud et de la chair propre. Les baiser bien dévotement pour les remercier de m'avoir apporté tout ce grand bonheur qui s'élève et s'appuie sur eux. Et ces douces longues choses glissantes et chaudes et brillantes, de soie et de chair, laissez que mes mains... "Non, finis. Et puis, je me déshabillerai bien toute seule. Tes mains m'énervent." Pourquoi? je la regarde. Devenue lucide, elle aussi. ]'insiste. "Non, non, laisse-moi." D'abord en riant, comme si elle feignait une pudeur alarmée. Est-ce un jeu? Non. Ses refus deviennent durs, presque blessants. Le vin de Capri. Je lui dis : "Un caprice au vin de Capri." Elle ne rit pas, et en effet il n'y a pas de quoi. Elle me repousse. "J'ai sommeil. Et du reste tu as employé un mot grossier. Tu as dit : cette belle dame est... et un mot que jamais on ne m'avait appliqué, pour dire que j'ai trop pris de ce vin." Elle cherche une querelle, mais je n'y tiens pas du tout; elle peut me dire les pires choses, je réponds par des caresses. A la fin elle se lève, se jette sur le lit, rageuse. "Et puis fais ce que tu voudras!"
On me cède de mauvaise grâce, mais enfin... Et puis je sens déjà qu`il y a quelque chose d'inexplicable, qui m'inquiète, quelque chose dont j'ai peur.
J'atteins une des agrafes des jarretelles. Tout ce joli harnachement de la cuisse nue. Bon, défaite, celle-ci. A l'autre maintenant... Oh, ce soupir sifflant, entre ses dents, juste au moment où mes doigts rencontrent quelque chose de dur, enveloppé de papier, attaché
avec un lacet le long de la jarretelle.
Dégrisé. Isabelle me trompe. Un billet, sans doute et oui, une clé. Ça doit être une clé. Un homme nous suivait, était là, me regardait rire, et lui verser le vin de Capri. C“est à la fin qu'elle l'a rejoint, au lavabo. Elle n'en finissait pas. Mais déjà ma trouvaille est entre mes mains. Elle a ramené un des oreillers sur sa tête. Je déplie la chose. Rien d`écrit sur le papier. Et ce n'est pas une clé. C”est une de ces petites pinces en métal argenté qui faisaient partie du couvert du premier service, des pinces pour briser les pattes des langoustes. « Isée! pourquoi as-tu ?..." Et en une seconde je fouille tout notre passé, je tâche de revoir tous ses gestes dans les restaurants, dans les magasins... Y a-t-il, soit rue Berthollet, soit ici, aucun objet dont la provenance ne s'explique pas immédiatement par un achat, par une facture? Non, je ne trouve rien. Absolument rien. C'est la première fois... Mais cette action basse... Surtout la préméditation : aller s'enfermer au lavabo, envelopper l'objet, l'attacher. "Isabelle, explique-moi... défends-toi..."
Elle boude. Au fond, je suis rassuré. Mais je lâche le mot : "Voleuse." Un gémissement, une voix étouffée, sous l'oreiller : "Tu ne sais pas... tu ne sais pas si... si je ne suis pas enceinte..."
Besoin irrésistible d'être seul. Je la laisse. Le salottino; notre intimité; mes livres. Et ma vie brisée. Non, mais sérieusement endommagée. Et Irène perdue. Prendre des mesures. Pourquoi n'a-t-elle rien dit jusqu'à ce soir? Des mesures. La visite honteuse à une sage-femme; toute une suite d'actions répugnantes; le danger, la mort; une dénonciation possible. Ou alors des liens détestés, intolérables, pour toute la vie. Une personne que j'ai aimée, que j'ai voulu rendre heureuse, devenue mon plus cruel ennemi. Un escroc qui me dépouille à la fois de ma liberté et de mon argent. Le jeu sentimental, l'expérience de la vie conjugale, la chose qui devait être sans conséquence, devenue un désastre. Mais non, elle ment. Ce n'est pas possible... Voyons; ah oui, il y a juste une possibilité. Mais non, elle ment; pour se justifier, elle ment. Une feuille de papier, un crayon; inscrire ces dates, compter des jours... Mais oui, elle a menti!... Je rentre dans la chambre. Elle a fini de se dévêtir, est couchée, très rouge, le regard dur, me défiant. Mais la discussion qu'elle attend n'aura pas lieu. "Pour la voleuse" et "pour la menteuse"! - de toutes mes forces, et ça m'est bien égal si la servante, de sa chambre près de la cuisine, a entendu les joues de Madame retentir sous la main de Monsieur. Et tant pis, encore, si elle entend les tendres gémissements et les baisers avec lesquels Madame, soudain dressée et jetée sur la poitrine de Monsieur, le remercie de son intervention dans le conflit intérieur qui la tourmentait.
Tout : sa confusion, ses remords, son étonnement et sa grande douleur quand je lui demande si c'est la première fois, me prouve que c'est en effet la première fois. La surexcitation causée par le grand air, le repas, le vin peuvent expliquer ce qui, à elle, paraît encore inexplicable. Une fois, quand elle avait sept ans, dans un bazar elle a été prise du désir violent de posséder un petit objet, un de ces petits singes en plomb peint, tu sais? Elle n`avait pas pu résister; elle avait choisi le moment où sa mère et le vendeur ne la regardaient pas. Ç'avait été le drame de son enfance. Sa mère avait trouvé l'objet volé, l'avait obligée à le rapporter au bazar, à le rendre, en sa présence, au vendeur. Elle répète en sanglotant : "Un petit singe en plomb, un de ces petits singes qui ont un habit rouge et qui jouent du violon..." Son chagrin de petite fille semble revenir, se mêle à son chagrin d`à présent. Il faut la consoler, lui dire que ce n'est rien. On n'en parlera plus, - là. On n'y pensera même plus. Et puis, elle n'avait pas su comment s'excuser, avait dit la première chose qui lui était passée par la tête. Demain, j'irai jeter ces pinces dans la mer pour que tu ne les voies plus...."
Une même source d'intrigues inspire ces trois nouvelles : les personnages principaux de Valery Larbaud, des hommes à qui les femmes sont nécessaires et, peut-être plus que les femmes, l`idée de la femme, pour reprendre la remarque d'un critique, s`éloignent à regret d'aventures passagères et retournent à leurs vies d'égocentristres sans illusions. Le thème du retour à la solitude est un de ceux qui nourrit l'oeuvre de Valéry Larbaud, on pense à "A.O.Barnabooth" ...

Paul Morand (1888-1976)
Né et mort à Paris, Paul Morand était le fils d'Eugène Morand, auteur dramatique et peintre, et fut élève du lycée Carnot. En 1905, il passa l'été à Munich, ayant raté son bachot de philo en juin, on lui donna un précepteur pour préparer la session d`octobre, ce précepteur était Jean Giraudoux, alors correspondant du Figaro, ce fut alors la naissance d'une très longue amitié. Morand s'inscrivit ensuite à l`Ecole des Sciences Politiques et à la Faculté de Droit, passa ses vacances à l'étranger, Italie, Angleterre, vit une année à Oxford, puis passe en 1912, passe le concours des vice-consulats, aux Affaires étrangères et devient attaché au protocole. L`année suivante il est reçu au concours des ambassades et est nommé attaché à Londres. I ira en poste à Rome, à Madrid, à Bangkok, représente la France en 1938 aux commissions du Danube, sera chef de la mission de guerre économique à Londres en 1939-1940, ambassadeur de France à Bucarest en 1943, puis à Berne en juin 1944. Mais il sera révoqué sans traitement ni retraite à la libération de la France, puis en 1953, après décision du Conseil d'État, réintégré dans tous ses droits, et aussitôt mis à la retraite. Le général de Gaulle lui interdit l'entrée à l'Académie française en 1958, mais n'opposa plus son veto par la suite, et c'est en 1969 que Paul Morand fut élu...
En 1914, mobilisé, il est au bout d'un mois renvoyé comme "affecté spécial" à l'ambassade de Londres. ce qu'il appellera son "âge snob" se retrouve dans son "Journal d'un attaché d'ambassade" (1947). Son service lui permet de venir souvent à Paris et il fréquente les salons, fait la connaissance de Marcel Proust, se lie avec la princesse Hélène Soutzo qui tiendra désormais une place considérable dans sa vie - il l'épousera et le couple s'installera dans une luxueuse demeure de l'avenue Charles-Floquet -. En attendant, il quitte Londres et devient attaché au cabinet Briand, puis au cabinet Ribot. De cette époque date son amitié avec Cocteau, Auric, Milhaud. En 1917, il est nommé troisième secrétaire à Rome, et c'est aussi l'année où il publie sa première nouvelle, "Clarisse", dans le Mercure de France, écrit les poèmes de "Lampes à arc". En 1918, c`est le retour à Paris, ou il a rang de deuxième secrétaire et travaille dans les services culturels du ministère. Son premier recueil de nouvelles, "Tendres Stocks" paraît en 1921 avec une préface de Marcel Proust (qui lui suggère au passage d'utiliser moins de métaphores...) ...
Années 1920 - Paul Morand attire donc l'attention du monde littéraire dès ses premiers recueils de poèmes, "Lampes à arc" (1919) et "Feuilles de température" (1920), et le voici célèbre à trente-trois ans avec "Ouvert la nuit" (1922), puis "Fermé la nuit" (1923), "Lewis et Irène" (1924), "L'Europe galante" (1925) : il connait ainsi le succès des forts tirages, devient l'écrivain à la mode, le maître incontesté de la nouvelle, de l'image qui fait mouche, du style rapide, étincelant. Que cherche-t-il, semble-t-il, tout en agissant avec désinvolture et détachement, à conserver l'image de la réalité présente; - de "sa réalité", le monde élégant et cultivé de l'âge bourgeois -, qui fuit de toute part, une civilisation sur son déclin, à sauvegarder par l'écrit ce qui ne se reverra plus...
"NOUVELLES D'UNE VIE"...
Cette anthologie en deux volumes des nouvelles de Paul Morand, composée par lui-même et publiée en 1965, avec en volume I, "Nouvelles du cœur", et en volume II, "Nouvelles des yeux" révèle à quoi tient son succès du moment : des récits vifs et rapides au long desquels des personnages singuliers finissent par symboliser un pays et une époque.
L`époque est celle des années folles, nous l'avons dit, on cherchait alors un nouvel art de vivre dans le sport, la vitesse, le plaisir, dans une morale cosmopolite de l`élégance et de l`esprit, et c'est avec un léger bagage d' "homme pressé" que Morand parcourt de monde, l`a photographié en formules poétiques. ll s`agissait alors de dépeindre un monde fugace et changeant, et de fixer les aspects d`une civilisation tout autant sur son déclin, des perspectives dans lesquelles il a su manifester une extraordinaire intuition. Vers 1935, après avoir beaucoup couru, beaucoup regardé, il se mit à s`observer lui-même, lui dont le regard oscillait entre ironie et férocité et qui avait parfaitement su jusque-là garder distance et impassibilité. Ses "Nouvelles du cœur" lèveront donc le masque, "Mílady" (1927) marque ce tournant, "Le Dernier Dîner de Cazotte" (1959) traduit son intérêt pour l`illuminisme et les phénomènes métapsychiques, "Parfaite de Saligny" (1956) témoigne de sa maîtrise de la nouvelle historique...

"Ouvert la nuit" (1922), ""Fermé la nuit" (1923)
Recueil composé de six nouvelles, qui sera suivi en 1923 d'un second volume de quatre nouvelles intitulé "Fermé la nuit". Avec ces deux ouvrages, Morand aborde un univers plein d`excès et d`extravagances et le lecteur se retrouve projeté au milieu de personnages schématiques aux contours précis, presque caricaturaux, mais représentatifs du pays et de la région du monde qu`elle représente. Certes, dans cette synthèse de l`Europe des années 20, "La Nuit romaine", "La Nuit hongroise", "La Nuit des Six-Jours" n`ont ni l'ampleur tragique de "La Nuit turque", ni le piquant amer de "La Nuit catalane". L'héroïne de "La Nuit turque" tourne autour d'Anna, une russe exilée et sans espoir. Le morceau de choix a pour titre "La Nuit de Putney" et met en scène un Levantin pittoresque, énorme pacha en chemise rose, qui se faufile à travers toutes les vicissitudes sans être touché par elles, et guette la chance qui va passer. ...
"L'Orient-Express traînait dans la nuit son public tri-hebdomadaire. Le même, toujours. Les couturières françaises et les modistes, moins âgées, rentraient à Constantinople après un voyage de réassortiment; à Laroche, le parfum de Paris se dispersa tandis que réapparurent les odeurs tenaces d'Orient : la rose et la bergamote poivrée. Les femmes du Civil Service vacillaient dans le couloir avec six bébés blonds qui ne connaîtront plus, avant Bombay, de petit lit. Des officiers d'état-major, en bonnet de police, arpentent les quais pendant la halte,
d'une courte jambe tendue et autoritaire. Les Français ont tant de décorations qu'on ne voit plus leur coeur. Les Anglais dormaient tard et, sifflant, occupaient le lavabo jusqu'à ce que la provision d'eau et de serviettes fût épuisée. Enfin, des familles israélites espagnoles de Salonique, retour de Vichy où leur teint s'est éclairci, restaient couchées tout le jour, campant en tailleur sur les lits défaits tandis que les fiasques de chianti se balançaient, suspendues à la lampe électrique. Puis tout s'endormit à la chanson des essieux, accompagnée de castagnettes d'acier. On ronfla. On frappa du poing l'acajou des cloisons pour y faire rentrer les punaises. Le conducteur reposait à l'entrée du couloir, assis sur un coussin bourré, en contrebande, de lei, de lires, de dinars, de drachmes et de livres turques, portant, en outre, sous sa tunique d'alpaga, dans de petits papiers pliés, des pierres précieuses.
Le train éveilla des gares suisses, de style gothique, dont les vitraux tremblèrent. Le Simplon, durant vingt-neuf minutes, donna l'audition d'une grande symphonie de fer, puis, sur des chaussées, on passa les rizières du Piémont jusqu'à une station qui finissait sur rien, sur une grande citerne d'ombre, de silence, et ce fut Venise. Au réveil, une bise de zinc faucha les maïs de la plaine croate. La Serbie s'annonçait par ses porcs, rayés noir et blanc comme des coureurs, et qui dévoraient, renversée dans le fossé, une carcasse de wagon dont ne restaient que les roues et le signal d'alarme. On échangea contre les fleuves d'autres fleuves passés sur des barrages flexibles comme un osier, tandis que, voisines, les piles de l'ancien pont décapité dans les retraites, émergeaient. A Vinkopje, les Roumains en velours furent détachés du train, dans la nuit glacée. Après Sofia, les maisons portèrent leurs piments qui séchaient, frères des vignes vierges. Éclairées par le soleil levant, labourées par des boeufs, les plaines bulgares affichaient une prospérité symbolique, comme sur les vignettes des
timbres-poste ou au revers des monnaies. Enfin, après la traversée du désert de Thrace, sous un ciel d'étoiles mais où nos yeux, habitués aux constellations d'Occident, cherchaient en vain l'étoile polaire, ne reconnaissaient plus le Chariot qui au ras du sol prenait cette fois une route terrestre, dans une brèche de la muraille byzantine, la mer de Marmara s'élargit.
Le bateau ne partait que le lendemain matin et une nuit me restait à passer dans la ville. L'hôtel était intolérable, orné de faces veules, bouches molles, nez gras, mentons fuyants, paupières de crêpe charbonnées, yeux coupants de Péra. L'orchestre partait comme un coup de feu, jouant des valses aux divans du fumoir couverts de faux Boukharas, aux lampes de mosquée faites de bouteilles à soda, à l'état-major grec, palikares anglomanes, tout en galons d'or et en poils noirs. Les portes-revolvers étaient gardées par des boy-scouts juifs.
On m'indiqua, pour y dîner, les restaurants russes. Il y en avait, au choix, une demi-douzaine, récemment ouverts par des réfugiés du Sud, et où des dames servaient. Je choisis, au fond d'un couloir, dans la grand-rue de Péra, le restaurant Feodor.
Au deuxième étage, dans une pièce basse, une touffe de fumée, de bruit et d'alcool dans laquelle le courant d'air des nouveaux arrivants creusait de curieuses cavernes, se trouvait suspendue, rasant les têtes, cloisonnant horizontalement la salle. Au plafond, il y avait des lampes bleues et mauves; sur les murs, peints à la fresque par un artiste russe, se promenaít sous des palmiers stylisés le Tout-Moscou coiffé d'un fez dérisoire. Des femmes dansaient au son d'un orchestre de singes, qu'un ours blanc en casquette et en blouse précédait de
son violoncelle. Au-dessus de la fumée émergeait la tête du patron, ex-régisseur du théâtre de Kiev.
Il rappelait Chaliapine tel qu'on pouvait le voir dans sa loge, à Covent Garden, chanter La Marseillaise, le verre à la main, lors de sa dernière apparition, le 29 juillet 1914, et par sa stature évoquait la Russie comme on la représentait aux côtés du Monténégro, dans l'Almanach Hachette.
Sous la voûte impalpable, la société s'empIoyait à boire; quelques Anglais, quelques Pérotes, des Russes surtout. La maîtresse de maison, danseuse au ballet impérial, figée dans le froid d'un manteau d'hermine, un collier de perles roses au cou, recevait à l'entrée. Un orchestre hongrois jetait sur les têtes, comme un doux lasso, des czardas. Les servantes étaient assises aux tables, peu habituées à rester debout. Elles portaient les plats, donnaient des ordres, en recevaient avec une distinction douce qui révélait des femmes de condition. On surprenait çà et là chez elles des façons aisées, un mot précieux, ou, rendu avec élégance, un geste qu'on a coutume cle voir faire servilement et qui attirait l'attention.
A une table non lointaine, des convives buvaient un champagne grec qui, ayant travaillé pendant la traversée, lançait au plafond le bouchon, avec une détonation terrible. Une boîte de fer, haute d'un pied et pleine de caviar, faisait l'unité du repas.
Un officier accablé d'une barbe de dix jours, portant ses insignes de commandement épinglés sur un pardessus à taille, était régalé par des hommes usés, sordides et fastueux comme des notaires en fuite, tandis qu'une très belle dame à tête crépue, portant aux oreilles des glands d'or qui tombaient jusque sur les épaules, mettait du sel dans le seau à glace. Puis une autre dame décolletée qui me tournait le dos dit en bon français : "Et maintenant, qu'allons-nous manger?" avec tant d'autorité que je la pris pour l'hôtesse. Mais après qu'on eut décidé du plat, au lieu d'appeler, elle sortit de sa poche un carnet à souche; avec un crayon relié à sa ceinture par une ficelle, elle se mit en devoir d'inscrire les commandes. Elle se trouvait être à la fois l'invitée et la servante.
Quand elle se leva de table, repoussant sa chaise pour aller à l'office et se tournant vers moi :
- Anna Valentinovna, vous ici!
- Bonjour, dit-elle, non sans emphase. Voilà une curieuse rencontre. Depuis quand à Constantinople?
-- Depuis deux heures.
En vain relevait-elle jusqu'au plus haut les derniers mots de ses phrases, aucun étonnement ne paraissait triompher d'elle. Elle semblait, comme jadis sur le perron de l'hôtel, m'attendre pour une promenade, la canne sous le bras, mettant ses gants, chassant son chien d'un coup de pied.
--Je suis une réfugiée, dit-elle, offrant ses mains ouvertes, d'un air pauvre; par les chemins depuis dix-huit mois, et ici depuis le printemps dernier. Quant à vous, vous m'avez l'air d'être bien dans vos bottes. Les miennes sont ressemelées en fer-blanc avec des tiges en peau d'oie. Theotocopovli existe-t-il toujours, rue Fontaine? Je lui dois encore cent trente paires.
- Mais expliquez-moi...
- On n'explique pas, ajouta-t-elle : On ne comprend pas la Russie avec la raison, on ne peut que croire à la Russie. Cependant, on peut raconter ..."

"Lewis et Irène" (1924)
Roman qui porte la marque de son temps et met en scène un personnage peint à grands traits. sans nuances, sans profondeur, sans aucune de ces qualités intérieures qui sont
le commun de l`humanité. Morand l'a fabriqué et, à la fin, tout s`évanouit en fumée. Lewis achète, vend, voyage pour acheter et vendre encore, mais il n`est qu'un ensemble de
rouages bien graissés. Quand il aime, c'est encore parce que la mécanique l'a contraint à aimer; et s`il aime une mécanique un peu moins déshumanisée que lui, l`engrenage se détraque. Les tics d`une époque sont visés là, d'une main qui ne tremble pas. Mais on sent le procédé sous le détail un peu trop appuyé et sous la volonté de peindre l`actuel monde dans sa réalité la plus brûlante. Le vocabulaire, surtout, est un brin démodé, cet argot du monde de la finance et du monde tout court, qui n'a que la vogue d'un moment. Seul le style sauve l'ensemble ...
Dans les années 1930, Paul Morand baptise "Chroniques du XXe siècle" (L'Europe galante), un ensemble de quatre volumes où il peint successivement l'Europe, "L'Europe galante" (1925), la négritude, les pays asiatiques, l'Amérique du Nord, il y sent le grondement des nouveaux continents - "Magie noire" (1928), "Bouddha vivant" (1927) et "Champions du monde" (1930) -, et obtient quelques-uns de ses plus grands succès avec des portraits de villes, New York (1930), Londres (1933), et un essai sur la Belle Epoque, "1900" (1931). Son chef d'oeuvre reconnu de cette époque est la nouvelle intitulée "Milady" (1936) qui raconte une passion entre un cavalier et son cheval.
"Milady" (1936)
C'est dans la collection "Renaissance de la nouvelle" dont il vient de prendre la direction chez Gallimard que Paul Morand publie un recueil intitulé "Les Extravagants", où figurent deux textes qui témoignent de la modification de son style, plus classique, entre les années 1920 et 1930, "Mílady", "Monsieur Zéro"...
"Milady" raconte l'histoire du commandant Gardefort, ancien écuyer du Cadre noir de Saumur ("seize ans de vie d'écuyer, quatre cent quatre-vingts chevaux dressés par moi, dont dix-neuf en haute école"), un homme à ce point passionné par les chevaux que son épouse, jalouse, l'a quitté. ll découvre Milady, une jument refusée par l'armée, et voit en elle la perle rare qu'il cherche depuis toujours. Il commence à la dresser, dévoilant à travers sa relation à l'animal une sensibilité que sa nature austère et inflexible avait tendance à dissimuler. Mais une dette l'oblige à vendre le cheval et la retrouvera trois mois plus tard, transformée en un pathétique "canasson de saltimbanque"...
En 1938, il approuve les accords de Munich et estime de son devoir de reprendre du service aux Affaires étrangères. En 1939, la guerre déclarée, il est nommé chef de la mission française de guerre économique auprès du gouvernement anglais à Londres. En juillet 1940, il rentre en France et gagne Vichy où l`on ne sait trop que faire de lui. Il revient à Paris et publie un roman, "L'Homme pressé" (1941) où les lecteurs de l`époque ne retrouveront aucune de leurs préoccupations du moment. Il accepte en 1943 de devenir ministre de France à Bucarest. En 1944, il obtient l'ambassade de Berne et il occupe encore ce poste quand Paris est libéré. Il sera révoqué, se retire à Montreux, écrit, se penche plus volontiers désormais sur le passé, puis sera réhabilité : ses "Nouvelles d'une vie" (1965) lui vaudront la consécration, ou peu s'en faut ...

"L'Homme pressé" (1941)
Autoportrait de Paul Morand, styliste voltigeur et grand adepte de la vitesse, ou caricature des Années Folles de l'écrivain diplomate tentant de se réhabiliter sous les traits de Pierre Nioxe, un antiquaire parisien qui épuise son entourage; séduit sans jamais aimer, rencontre Hedwige, croit trouver un peu de paix, mais reprend sa course et se consume : "à quoi reconnaître qu'on est arrivé si l'on ne s'arrête jamais" ?

"Hécate et ses chiens" (1954)
Un livre qualifié parfois d'audace inouïe, qui vaut pour son exploration du subconscient le plus noir racontée par ce virtuose de la suggestion qu'est Paul Morand. Le personnage principal évoque des souvenirs les plus affreux qu'il mêle à d`autres plus heureux. ll a connu autrefois, en Afrique, une femme "plutôt laide", Clotilde, et par désœuvrement, d`abord, l`a aimée sans vraiment chercher à la connaître. ll ne l'interroge ainsi jamais sur le mari qu`elle a eu et dont elle vit séparée. Ainsi vit-il heureux. Le climat des romans : le bonheur physique de ses personnages fait un peu pitié, le plaisir physique, le confort, le luxe, les fêtes, "cette petite existence qu`on nomme la grande vie", leur suffisent. Mais une atmosphère lourde pèse sur ce roman. Le héros s`illusionne sur le plaisir qu'il donne à sa compagne, se croit aimé alors qu'il n`est que supporté. Mais en même temps il s`obstine, il s`oblige même à partager les dérèglements de celle qu`il aime. Car il s`aperçoit dans le même temps qu`elle s`échappe et qu`il tient a elle, dans la mesure justement où elle le fuit. Un jour, en effet, il a un soupçon abominable. Clotilde, comme Hécate la mangeuse d`hommes, s'adonne à des orgies. N`apaise-t-elle pas la fureur de ses sens auprès de jeunes enfants qu`elle pourchasse en secret ? Patiemment, bribe à bribe, il lui arrache des aveux, la nuit. Le jour, il la retrouve comme naguère. fraîche et insouciante. Mais cette Clotilde-là ne l'intéresse plus. Il n`aime plus d`elle que son hideux visage de nuit où se reflètent d'incompréhensibles voluptés. Comme entraîné par une force mystérieuse, il en vient, lui aussi à poursuivre de tendres proies, espérant lire en elles le secret de Clotilde et l`explication d`un assouvissement physique qu`il n`a jamais su lui donner. L'amour entre eux maintenant n'est plus qu'une relation de vice et de haine. Clotilde, ce monstre à deux têtes, refuse de partager avec son amant ses désordres érotiques. Elle le fuit.
Plus tard. le hasard placera le mari de Clotilde sur sa route et il essaiera vainement de déchiffrer, à travers ce dernier, le mystère de celle qu`il a perdue et dont le souvenir est attaché à lui comme une lèpre. Quinze ans après il la retrouve, toute à des œuvres charitables, un peu solennelle. ll tente une dernière fois de percer l`énigme. Est-ce son mari qui l'a pervertie? Est-ce elle au contraire qui a ravagé son mari ? La question reste sans réponse, et le livre se referme sur un silence épais. L'être humain est fermé à l'être humain, semble nous dire Morand, et nos actes les plus simples semblent venir d`instincts inavouables, et souvent même inconnus de nous. L`amour et la vie ne sont alors possibles qu'avec la complicité d'un bien lourd silence sur nous-mêmes...
"Ecrire n'est intéressant que lorsque l'oeuvre collabore avec l'auteur, quand ils enfantent ensemble, quand il sort quelque chose qu'on n'attendait pas." On connaît la célèbre définition De l'Homme par Alexandre Vialatte : "Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière." Et c'est vrai que le Vialatte qui a toujours aimé considérer l'homme sous l'angle de la zoologie, est l'inspirateur d'un monde le plus souvent inattendu, ce qui lui donna notoriété et méconnaissance tant il "dépayse" le lecteur.
Alexandre Vialatte, "Dernières nouvelles de l'homme", "Suicides - ... Les gens solidement attablés devant une choucroute à trois étages assurent généralement qu'il est extrêmement lâche de préférer la mort à la vie. "Le courage, c'est de vivre", disent-ils. Et, la bouche encore pleine de saucisson de Morteau, ils commandent vaillamment un camembert bien fait avec une bouteille de bourgogne. La vérité, c'est qu'ils n'aiment pas la mort. La mort, généralement, n'a pas d'ami sincère. Inversement, des gens qui ont une vie de chien la mènent pendant soixante-dix ans, sans cesser d'affirmer que la mort est préférable. Les hommes ne savent pas bien ce qu'ils disent, ou agissent rarement comme ils pensent. Aussi est-il très difficile de juger ceux qui ne veulent plus de la vie.."
"Le train du soir - Vingt fois j'ai voulu dire adieu à ma jeunesse. Vingt fois j'ai craint de me montrer ridicule. C'était trop tôt. La fois suivante, elle était partie. On ne saurait dire adieu trop vite à sa jeunesse. Elle s'en va sur la pointe des pieds. L'homme entre dans le soir de sa vie comme dans un pays étranger. Les gares sont plus petites et plus rares. Les voyageurs deviennent moins nombreux. Ils ont changé de costume. On ne voit plus de bérets basques. Les quais sont de plus en plus déserts. Les affiches, dans les salles d'attente, ne parlent plus des mêmes montagnes. Et soudain, au bout d'un tunnel, l'horizon lui-même a changé. Quels sont ces longs pays bleuâtres? Des plaines s'étendent, qu'on n'avait jamais vues; transfigurées par on ne sait quel reflet. Plus loin, au loin (mais à quelle distance exactement? les distances trompent), plus loin, c'est la terre de la mort..."

Alexandre Vialatte (1901-1971)
Né dans un village de la Haute-Loire (Magnac-Laval), Vialatte ne fut longtemps considéré comme un dilettante de la littérature qui s'adonnait sans réserve à l'écriture de plus d'un millier de chroniques (publiées dans La Montagne, Le Spectacle du monde, etc.) - et qui seront réunies dans "Dernières Nouvelles de l'homme" (1978), "Et c'est ainsi qu'Allah est grand" (1979), "L'éléphant est irréfutable" (1980), "Almanach des quatre saisons" (1981). Et pourtant c'est à lui que revient le mérite d'avoir introduit Kafka en France en traduisant "Le Procès" (1933), "Le Château" (1938), "L'Amérique" (1946), les nouvelles qui composent "La Métamorphose" (1938), "La Colonie pénitentiaire" (1948) et "La Muraille de Chine" (1950). Il aura de même traduit Thomas Mann, Nietzsche et d'autres auteurs allemands. C'est grâce à Jean Paulhan qu'il a passé près de six ans en Allemagne à partir de 1922, traducteur civil à Spire, interprète militaire à Berlin, rédacteur à La Revue rhénane éditée à Mayence.
De retour en Auvergne, il achève son premier roman, "Battling le Ténébreux "(1928), un des grands romans sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais dont le sous-titre, La Mue périlleuse, dessine déjà les thèmes de son oeuvre, marquée par la poésie du cocasse, de l'absurde. Il se marie en 1929, vit en conflit permanent avec sa femme, vit à Clermont, s'y consacre à la traduction et au journalisme, puis à Paris de 1934 à 1937. Après un séjour en Egypte, il est mobilisé, est fait prisonnier en 1940, libéré au début de 1941, et rapporte son expérience dans "Le Fidèle Berger" (1942). Il passera le temps de l'Occupation à Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme), travaillant à plusieurs romans qui ne seront publiés, plus ou moins achevés, que longtemps après sa mort (La Dame du Job, 1987; La Maison du joueur de flûte, 1986). Il retrouvera l'Allemagne en 1945 comme correspondant de presse. Il faut attendre 1951 et "Les Fruits du Congo" pour que Vialatte, donnant libre cours à son imagination et à son humour noir, atteigne une sorte de célébrité....
