- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Bloomsbury Group - Virginia Woolf (1882-1941), "Jacob's Room" (1922), "Mrs. Dalloway" (1925), "To the lighthouse" (1927), "Orlando" (1928), "A Room of One's Own" (1929), "The Waves" (1931), "The Years" (1937), "Three Guinees" (1938) - Vanessa Bell (1879-1961) - Duncan Grant (1885-1978) - Roger Eliot Fry (1866-1934) - Lytton Strachey (1880-1932) - Dora Carrington (1893-1932) - Vita Sackville-West (1892-1962) - Rosamond Lehmann (1901-1990) - ...
Last update: 12/27/2016
Lire un livre comme si nous lisions un être vivant, reading a living thing ... - Dans un essai de 1924, «Character in Fiction», Virginia Woolf encourage les lecteurs à exiger davantage de la description de la personnalité par les romanciers que des portraits réducteurs réalisés grâce à l’énorme pression exercée par le réalisme sur le tissu des choses (enormous stress upon the fabric of things) — sur les maisons, les vêtements, la maladie et d’autres choses discrètes. circonstances descriptibles. « Vous êtes allée vous coucher la nuit, déconcertée par la complexité de vos sentiments » (You have gone to bed at night bewildered by the complexity of your feelings), rappelle-t-elle à son auditoire. « En un jour, des milliers d’idées ont circulé dans votre cerveau; des milliers d’émotions se sont rencontrées, sont entrées en collision et ont disparu dans un désordre étonnant. » (In one day thousands of ideas have coursed through your brains; thousands of emotions have met, collided, and disappeared in astonishing disorder). Cette complexité est pour Wollf bien représentative de « l’esprit par lequel nous vivons, la vie elle-même » (the spirit we live by, life itself), et c’est cet esprit qu’elle cherche à capturer puis restituer dans ses romans. C'est sans doute dans "To the Lighthouse" (1927) qu'elle y est le mieux parvenue...
"Mrs Dalloway" (1925), roman de Virginia Woolf, se déroule sur une seule journée et constitue l'un des textes déterminants du Londres moderniste. ll retrace les mouvements étroitement liés des deux protagonistes principaux autour de Regent's Park : Clarissa Dalloway, épouse de Richard Dalloway, député conservateur, appartient au Tout-Londres, tandis que Septimus Warren Smith, ancien combattant de la Grande Guerre, souffre de psychose traumatique. Dans ce roman, le passage du temps, ponctué par les coups périodiques d'un Big Ben géant et phallique, finit par nous mener à un double paroxysme, le succès de l'illustre soirée de M .Dalloway et le suicide de Septimus Warren Smith, qui se trouve incapable de vivre dans cette ville d'après-guerre...
L'effet produit par cette œuvre dérive pour une grande part de l'incompatibilité des deux parties, reflétée par l'espace urbain lui-même. Différentes personnes vaquent à leurs occupations, préparant leur dîner ou leur suicide, et il est impossible, suggère le livre, de bâtir un pont entre eux. Septimus et Clarissa sont séparés par leur classe, leur sexe, la géographie, mais en même temps la capacité du roman à passer d'un point de vue à l'autre suggère une sorte de lien intime et clandestin, né de la réponse de Zarissa à l'annonce de la mort de Septimus. Un espace poétique, qui ne correspond pas à l'espace temporel rythmé par Big Ben, sous-tend la ville et suggère une nouvelle façon de penser les relations entre hommes et femmes, entre une personne et une autre ...
Le lecteur qui cède à l’attrait de la prose de Woolf entre dans un domaine où les mots transcendent à la fois l’intrigue et la description pour communiquer avec une sincérité inégalée les beautés et les peines du temps, la perte, l’amour, l’amitié, la coutume, l’art. Contrairement à James Joyce, son aventurier contemporain dans le domaine du courant de la conscience, qui a tracé ses routes avec une rigueur scolastique qui tenait l’art, en fin de compte, à l’écart de la vie, Woolf place sa foi dans « l’esprit par lequel nous vivons », in the spirit that we live by ...

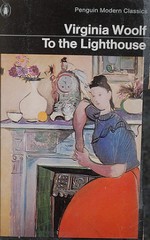


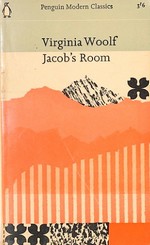



Le groupe de Bloomsbury
(Bloomsbury Group, 1904-1940)
Né au début du XXe dans le quartier londonien de Bloomsbury, le groupe de Bloomsbury est un cénacle d'intellectuels et d'artistes liés à Cambridge qui,
pendant les dix années précédant la Première Guerre mondiale, eut une influence déterminante sur la vie culturelle anglaise. Ainsi les œuvres littéraires de Virginia Woolf comptent parmi les plus
significatives de la culture occidentale; Roger Fry, Clive Bell, Duncan Grant, Vanessa Bell ouvrirent à l'art moderne français les portes de l'Angleterre en organisant à Londres, en 1910 et en
1912, les expositions du postimpressionnisme; les théories économiques de Maynard Keynes influent encore sur la vie de millions d'individus. Dans la mouvance du groupe, on trouve les romanciers
E. M. Forster (1879-1970) et Aldous Huxley (1894-1963), le philosophe Bertrand Russell (1872-1970), le poète T. S. Eliot (1888-1965), Ludwig Wittgenstein (1889-1951), George Orwell
(1903-1950), Lytton Strachey (1880-1932), Dora Carrington (1893-1932).

Le groupe de Bloomsbury ne constitua jamais une école mais dessina plutôt une constellation d'individualités exceptionnelles. Une influence commune les unissait, celle des "Principia Ethica" (1903) du philosophe George Edward Moore (1873-1958). C'est dans son éthique intuitionniste et la simplicité libératrice de sa réflexion privilégiant le sens commun, - ce ne sont pas tant le monde ou les sciences qui m'ont posé des problèmes philosophiques, écrira-t-il, que les étranges paroles écrits des philosophes - que les membres du groupe puiseront leur attachement aux relations personnelles et leur conviction que le sens du beau est une voie privilégiée vers la vie morale. Répugnant à construire un système philosophique de plus, Moore s'est avéré être le plus grand "questionneur de la philosophie moderne".
Comme à peu près tout le reste de la culture moderne, le premier Bloomsbury se vit bouleversé dans son développement par la Première Guerre
mondiale. Aucun des hommes n'y a combattu. La plupart d'entre eux étaient objecteurs de conscience, ce qui, bien entendu, ajouta aux controverses contre le Groupe.
Les années 1920 virent le renouveau de Bloomsbury : Virginia Woolf publie ses romans les plus célèbres," Mrs Dalloway", "To the Lighthouse", "The Waves"; E.
M. Forster achève "A Passage to India"; Duncan Grant puis Vanessa Bell exposent. Les années 1930 virent le déclin de Bloomsbury avec la mort de ses principaux protagonistes. L'aventure collective
sombrera avec l'Europe tout entière dans le second conflit mondial, Virginia Woolf se suicide en 1941.

Vanessa Bell & Duncan Grant
Le peintre Vanessa Bell (1879-1961) est la sœur aînée de Virginia Woolf. Sa sœur fait allusion dans ses essais autobiographiques "A Sketch of the Past et 22 Hyde Park Gate" des abus sexuels qu'elles ont toutes deux subis de leurs demi-frères George et Gerald Duckworth. Après la mort de leurs parents, les deux sœurs vivent dans le quartier londonien de Bloomsbury. En 1907, elle épouse Clive Bell (1881-1964), historien de l'art, mais se séparent peu avant la Première Guerre mondiale. Vanessa part vivre avec le peintre Duncan Grant (1885-1978), connu pour sa liaison avec John Maynard Keynes, et son ami David Garnett et forment un groupe de peintres scandaleux pour l'époque.

Works from Vanessa Bell - "The Memoir Club (Duncan Grant; Leonard Woolf; Vanessa Bell; Clive Bell; David Garnett; Baron Keynes; Lydia Lopokova; Sir Desmond MacCarthy; Mary MacCarthy; Quentin Bell; E. M. Forster) (1943, National Portrait Gallery, London) - "Angelica Garnett, née Bell as 'Mistress Millament' in The Way of the World" (Government Art Collection - "Interior Scene, with Clive Bell and Duncan Grant Drinking Wine" (Birkbeck, University of London) - "Virginia Woolf, née Stephen" (1912, National Portrait Gallery, London) - "Aldous Huxley" (1931, National Portrait Gallery, London) - "Self Portrait" (1958, Charleston) - "Leonard Sidney Woolf" (1940, National Portrait Gallery, London)...

Works from Duncan Grant - "Interior" (Ulster Museum) - "Bea Howe" (Museums Sheffield) - "Julian Bell Writing" (Charleston) - "Lytton Strachey" (Charlesto)n - "Miss Mary Coss" (The Fitzwilliam Museum) - "Police Constable Harry Daley" (Guildhall Art Gallery) - "Self Portrait" (Aberdeen Art Gallery & Museums) - "The Bedside Lamp" (Salford Museum & Art Gallery) - "The Sofa" (Brighton and Hove Museums and Art Galleries) -" Venetian Sideboard" (Government Art Collection)...

Roger Eliot Fry (1866-1934)
Peintre et critique d'art, il organise aux Grafton Galleries de Londres, en 1910, une exposition Manet et les postimpressionnistes, qui exercera une influence considérable sur le goût du public.

Works form Roger Eliot Fry - "Virginia Woolf" (Leeds Art Gallery, Leeds Museums and Galleries) - "Portrait of Nina Hamnett" (1917, The Courtauld Gallery) & (1917, The Stanley & Audrey Burton Gallery, University of Leeds) - "Edward Carpenter" (1894, National Portrait Gallery, London) - "Self-portrait" (1928, The Courtauld Gallery) - "Bertrand Arthur William Russell" (1923, National Portrait Gallery, London) - "Edith Sitwell" (1918, Museums Sheffield) - "Charles Percy Sanger, Barrister" (Trinity College, University of Cambridge)...

Monk’s House & Virginia Woolf - In the small village of Rodmell in East Sussex, England, there is a 17th-century weather-boarded cottage that served as a weekend home for Virginia Woolf. The writer and her husband, political activist and journalist Leonard Woolf, bought this home in 1919. In 1928, the couple bought an adjoining field to preserve the magnificent view from the garden to Mount Caburn. The house was expanded by two additional floors in 1929. Monk’s House is where a many of her novels were written, including Jacob’s Room, Mrs. Dalloway, The Years, Between the Acts, among other..





Virginia Woolf (1882-1941)
Fille d'un « éminent victorien » (sir Leslie Stephen, gendre de Thackeray) côtoyant dès l'enfance la fleur de l'intelligentsia britannique, égérie du groupe
de Bloomsbury, Adeline Virginia Stephen bâtit son œuvre comme une digue contre la maladie mentale qui dévorait ses énergies et qui la frappait presque régulièrement à la parution de ses livres.
Née à Londres, privée très tôt de la paix que lui procurait sa mère, morte en 1895, elle perd successivement sa demi-sœur Stella (1897) et son frère Thoby (1906). Quand sa sœur Vanessa, peintre,
se marie en 1907, elle voit s'éloigner celle dont elle avait été la plus proche. Elle épouse en 1912 Leonard Woolf (économiste, pacifiste), dont l'inlassable bonté l'aidera à se doter d'une
influence doublement vitale ; avec lui, elle monte une maison d'édition où seront notamment publiés Katherine Mansfield, T. S. Eliot et Freud. Après ces premiers essais que sont "la Traversée des
apparences" ("The Voyage Out", 1915), qu'elle met sept ans à écrire, "Nuit et Jour" (Night and Day, 1919), "la Chambre de Jacob" (Jacob's Room, 1922), le génie de Virginia Woolf éclate avec
"Mrs. Dalloway" (1925).

Homosexuelle pudique, elle écrit, à la gloire de Vita Sackville-West, "Orlando" (1928), célébration de l'androgyne. Virginia Woolf écrit l'exil des femmes,
leurs rancœurs, les défaillances du vouloir-vivre, la souffrance étouffée, tue et dissimulée. Elle peint le mal de vivre, elle tente de relier les « moments de vie » et d'unifier les coulisses de
l'âme, ses envies et ses haines. Féministe puritaine, elle soutient de loin le combat des suffragettes mais rédige plusieurs ouvrages essentiels sur la condition féminine : "Une chambre à soi"
(1929), "Trois Guinées" (1936). Autre sommet de l'œuvre woolfienne, "La Promenade au phare" (1927) : Mrs. Ramsay (portrait de la mère de Virginia) possède le génie de transformer chaque événement
de la vie quotidienne en un instant de plénitude, une « illumination ». Traumatisée par la Seconde Guerre mondiale et les bombardements, craignant de tomber aux mains des nazis (Leonard Woolf
était juif), elle se suicida à l'approche d'une nouvelle crise, répondant au « tragique appel des eaux » qui résonne d'un bout à l'autre de son œuvre : elle remplit ses poches de pierres et se
jeta dans la rivère Ouse près de sa maison de Rodmell dans le Sussex en 1941...


La Chambre de Jacob (Jacob's Room, 1922)
"So of course,” wrote Betty Flanders, pressing her heels rather deeper in the sand, “there was nothing for it but to leave.” Slowly welling from the point of her gold nib, pale blue ink dissolved the full stop; for there her pen stuck; her eyes fixed, and tears slowly filled them. The entire bay quivered; the lighthouse wobbled; and she had the illusion that the mast of Mr. Connor’s little yacht was bending like a wax candle in the sun. She winked quickly. Accidents were awful things. She winked again..."
"La Première Guerre mondiale est au cœur de ce grand roman expérimental de Virginia Woolf. L’action se situe pourtant principalement dans l’Angleterre d’avant 1914. Mais Jacob Flanders, jeune homme dilettante et volage qui en est le héros, meurt au champ de bataille et Virginia Woolf semble composer son portrait en ayant constamment à l’esprit ce dénouement fatal. Dès la première scène, on sent ainsi la mort rôder autour de Jacob alors que, encore enfant, il joue sur une plage de Cornouailles. Avec ce roman, publié en 1922 comme l’Ulysse de Joyce, Virginia Woolf rompt avec les conventions du réalisme et du naturalisme. Son héros n’apparaît jamais au premier plan mais sous la forme d’impressions qu’ont pu avoir de lui son entourage : sa mère, jeune veuve de petite noblesse, les femmes qu’il a aimées et trompées, une vieille dame croisée dans un train. Virginia Woolf offre au lecteur une vision kaléidoscopique où se superposent le passé, le présent et l’avenir du héros. S’intéressant à la difficulté pour l’écrivain de restituer la nature complexe et opaque d’un être humain, elle donne une existence littéraire au caractère faillible et trouble de la mémoire."
"« Dans ces conditions, bien entendu, écrivait Betty Flanders, enfouissant de plus en plus ses talons dans le sable, il n’y avait pas autre chose à faire que de partir. » Lentement amassée à la pointe de sa plume, une pâle encre bleue noya le point final, où le stylo s’était immobilisé. Betty regardait sans rien voir : des larmes montèrent à ses yeux. Toute la baie devint tremblante, le phare se mit à osciller ; et elle crut voir le grand mât du petit yacht de Mr Connor ployer comme un cierge de cire exposé au grand soleil. Elle cligna vivement des yeux. Il arrive parfois des accidents terribles ! Elle battit encore des paupières. Le mât se redressa, la houle redevint régulière, le phare rigide ; mais la tache s’était étalée sur la feuille. « Pas autre chose à faire que de partir », relut-elle. « Écoute, dit-elle à Archer, l’aîné de ses fils, dont l’ombre se projetait sur son papier à lettres et s’allongeait toute bleue sur le sable (Betty Flanders eut un petit frisson – dire qu’on était déjà au trois septembre !) écoute ; du moment que Jacob ne veut pas jouer… L’affreuse tache ! Il doit commencer à se faire tard. « Où est-il, cet odieux gamin ? reprit-elle. Je ne le vois pas. Cours le chercher. Dis-lui de venir tout de suite… « Mais grâce à Dieu, continuât-elle à griffonner, sans plus s’occuper de la tache, tout semble s’être arrangé pour le mieux, bien que nous soyons entassés comme des harengs en caque et qu’il faille tolérer dans l’appartement la voiture d’enfant ; car, bien entendu, la propriétaire… »
Tel était le genre de lettres que Betty Flanders écrivait au capitaine Barfoot – pages nombreuses, maculées de larmes. Car Scarborough est à sept cents milles de distance de Cornouailles ; et le capitaine habite Scarborough ; et elle est veuve ; et Seabrook, son mari, est mort. Les larmes de Betty Flanders font onduler, en vagues rutilantes, les dahlias de son jardin, et scintiller devant ses yeux le vitrage de la serre ; elles paillettent la cuisine d’étincelantes lames de couteaux : de plus, c’est à cause de ces larmes que, pendant le service religieux, Mrs Jarvis, la femme du recteur, écoutant l’orgue et voyant Mrs Flanders prosternée au-dessus de la tête de ses trois garçons, se dit que le mariage est une sûre forteresse, et que les veuves solitaires, misérables et sans appui, errent au hasard dans les champs, les malheureuses ! ne récoltant que des cailloux, glanant bien peu d’épis mûrs ! Mrs Flanders avait perdu son mari depuis deux ans. « Ja - cob ! Ja - cob ! » criait Archer. « Scarborough », traça Mrs Flanders sur l’enveloppe, et elle souligna le mot d’un trait hardi. Scarborough était sa ville natale : à ses yeux, le centre du monde. Un timbre, un timbre, à présent. Elle fureta dans son sac : elle le retourna sens dessus dessous, le vida au creux de sa jupe, chercha ; le tout avec tant d’énergie que Charles Steele, le paysagiste toujours coiffé d’un Panama, resta le pinceau en l’air. Comme l’antenne d’un insecte irritable, ce pinceau frémissait. La voilà qui bougeait, cette femme, qui se préparait à s’en aller, le diable l’emporte ! Il plaqua vivement sur sa toile une touche d’un noir violet. Car cette touche était nécessaire à son paysage. Décoloré, comme d’habitude, avec tous ces gris fondus en lavande, et cette unique étoile, ou bien cette mouette blanche – mais oui ! – en suspens dans le ciel. Décoloré, décoloré. Les critiques n’allaient pas se gêner pour le dire : car il n’était qu’un artiste obscur, un exposant inconnu : portant une croix à sa chaîne de montre : adoré des gosses de sa logeuse ; et très flatté quand celle-ci marquait du goût pour sa peinture – ce qui arrivait souvent. « Ja - cob ! Ja - cob ! » criait Archer. Exaspéré par ces cris malgré son amour pour les enfants, Steele picorait avec agacement parmi les petits serpents de couleur lovés sur sa palette. « Je l’ai vu, ton frère, dit-il avec un hochement de tête affirmatif, lorsque Archer passa lentement à côté de lui, laissant traîner sa bêche et regardant, les sourcils froncés, ce vieux monsieur à lunettes. « Là-bas, près de ce rocher, murmura Steele, sa brosse entre les dents, pressant son tube de Sienne naturelle et gardant les yeux rivés sur le dos de Betty Flanders. « Ja - cob ! Ja - cob ! » cria Archer, reprenant sa marche traînante. Son appel était d’une tristesse extraordinaire. Pur de toute matérialité, de toute passion, lancé seul et sans réponse à travers le monde, et se brisant contre les rochers. Steele fronça les sourcils ; mais il était content de sa valeur sombre – nécessaire pour mettre son paysage d’aplomb. « Eh ! mais, l’on peut encore faire des progrès, à cinquante ans. Tel le Titien… » Ayant trouvé le ton juste, il leva les yeux, et vit avec épouvante un nuage au-dessus de la baie. Mrs Flanders se leva, tapota son vêtement pour en faire tomber le sable, et ramassa son ombrelle noire. Le rocher était un de ces rocs bruns, ou plutôt noirs, d’une solidité effrayante, un de ces rocs émergeant du sable comme les témoins des temps primitifs. Hérissés de patelles aux coquilles plissées, et jonchés d’une chevelure clairsemée d’algues sèches, l’escalade en est difficile, pour un petit garçon ; il faut qu’il se contorsionne, et qu’il ait l’âme bien héroïque, pour arriver jusqu’en haut. Mais justement, c’est en haut qu’il y a un creux plein d’eau avec un fond de sable : et un lambeau de méduse collé sur le bord ; et aussi des moules. Un petit poisson passe comme une flèche. La frange d’algues rouge brun palpite, un crabe à la carapace opaline apparaît. « Oh ! un énorme crabe ! » et sur ses pattes malingres, voilà le crabe qui déloge. C’est le moment ! Jacob plongea la main dans l’eau. Le crabe était froid, et léger, léger. Mais l’eau était toute chargée de sable, et tenant son petit seau plein à bout de bras, Jacob redescendit péniblement. Il était sur le point de sauter sur la grève, quand il vit, étendu à terre tout de son long, un couple immobile : un homme et une femme, écarlates, démesurés, couchés tout près l’un de l’autre. Un homme et une femme, énormes (et déjà le jour baissait), étendus là, sans mouvement, côte à côte, la tête sur leur mouchoir de poche, et très près de l’eau qui montait, tandis que deux ou trois mouettes rasaient élégamment les vagues, et venaient se poser contre leurs souliers. Les larges faces écarlates, posées sur des mouchoirs de couleur vive, regardaient Jacob avec de grands yeux. Jacob les regardait de même. Enfin tenant son seau avec précaution, il se décida à sauter, et se mit à trottiner, très lentement d’abord et d’un air indifférent, puis de plus en plus vite à mesure que les vagues écumeuses se rapprochaient de lui, et le forçaient à faire des détours, tandis que les mouettes se levaient à son approche, et s’en allaient, portées par le flot, atterrir un peu plus loin. ..."

"Mrs Dalloway" va montrer à quel point Virginia Woolf, en abandonnant la forme rectiligne et réaliste du roman victorien, trouve dans l'écriture dite "moderniste" la possibilité de proposer une image et une pensée de la femme plus en accord avec elle-même. Non seulement elle peut ainsi se laisser aller à un subtil va-et-vient dans le temps passé, présent et avenir, pour éclairer les différents moments de son existence, mais l'intrigue amoureuse peut être rendue dans toutes ses nuances, du mariage au désir : le personnage de Clarissa peut ainsi résister à l'investissement sexuel et possessif de Peter le séducteur et colonisateur psychique, et s'engager dans le mariage avec Richard qui respecte au mieux sa liberté...
"She did undoubtedly then feel what men felt. Only for a moment; but it was enough. It was a sudden revelation, a tinge like a blush which one tried to check and then, as it spread, one yielded to its expansion, and rushed to the farthest verge and there quivered and felt the world come closer, swollen with some astonishing significance, some pressure of rapture, which split its thin skin and gushed and poured with an extraordinary alleviation over the cracks and sores!"
"Elle était certaine de ressentir à ces moments-là ce que ressentent les hommes. Rien qu'un instant; mais cela suffisait. C'était une brusque révélation, une légère coloration comme le rose qui vous monte aux joues et qu'on tente de réprimer, puis, lorsqu'il se répand, voilà qu'on cède à ce débordement, qu'on l'accompagne jusqu'à sa pointe extrême, et là, on tremble, on sent le monde qui se rapproche, tout gonflé de quelque signification extraordinaire, c'est une sorte de ravissement qui fait pression de l'intérieur, qui fait craquer sa mince écorce et qui jaillit et se déverse comme un baume sur les gerçures et les blessures!"

Mrs. Dalloway (1925)
Le roman, publié en 1925, raconte la journée d'une femme élégante de Londres, Clarissa Dalloway - entre le matin et le soir d'une splendide journée de la
mi-juin 1923 -, mêlant impressions présentes et souvenirs, personnages surgis du passé, comme un ancien amour, membres de sa famille et de son entourage. Le personnage, dit-on, s'inspira de
Vanessa Bell. Ce grand monologue intérieur exprime la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l'immobilité. La qualité la plus
importante du livre est d'être un roman poétique, porté par la musique d'une phrase chantante et comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures. Le roman est sans l'ombre d'un doute le
chef-d'oeuvre de Virginia Woolf. L'oeuvre s'ouvre sur Clarissa se préparant à sortir acheter des fleurs pour sa réception du soir, c'est alors que la seule pensée d'ouvrir les portes-fenêtres va
lui rappeler la jeune femme de dix-huit ans qu'elle était dans la maison familiale de Bourton-on-the-Water ...
"Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges; Rumpelmayer’s
men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning — fresh as if issued to children on a beach.
What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a little squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open
the French windows and plunged at Bourton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course, the air was in the early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill
and sharp and yet (for a girl of eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about to happen; looking at the flowers, at the
trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling; standing and looking until Peter Walsh said, “Musing among the vegetables?”— was that it? —“I prefer men to cauliflowers”— was
that it? He must have said it at breakfast one morning when she had gone out on to the terrace — Peter Walsh. He would be back from India one of these days, June or July, she forgot which, for
his letters were awfully dull; it was his sayings one remembered; his eyes, his pocket-knife, his smile, his grumpiness and, when millions of things had utterly vanished — how strange it was! — a
few sayings like this about cabbages.
She stiffened a little on the kerb, waiting for Durtnall’s van to pass. A charming woman, Scrope Purvis thought her (knowing her as one does know people
who live next door to one in Westminster); a touch of the bird about her, of the jay, blue-green, light, vivacious, though she was over fifty, and grown very white since her illness. There she
perched, never seeing him, waiting to cross, very upright.
For having lived in Westminster — how many years now? over twenty — one feels even in the midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was
positive, a particular hush, or solemnity; an indescribable pause; a suspense (but that might be her heart, affected, they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First
a warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victoria Street. For Heaven only knows why one loves it so, how
one sees it so, making it up, building it round one, tumbling it, creating it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on doorsteps (drink their
downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very reason: they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and the
uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing of some aeroplane
overhead was what she loved; life; London; this moment of June.For it was the middle of June."
"Mrs Dalloway dit qu’elle irait acheter les fleurs elle-même. Lucy avait de l’ouvrage par-dessus la tête. On enlèverait les portes de leurs gonds ; les
hommes de Rumpelmayer allaient venir. « Quel matin frais ! pensait Clarissa Dalloway. On dirait qu’on l’a commandé pour des enfants sur une plage. » Comme on se grise ! comme on plonge ! C’était
ainsi jadis à Bourton, lorsque, avec un petit grincement des gonds qu’il lui semblait encore entendre, elle ouvrait toutes grandes les portes- fenêtres et se plongeait dans le plein air. Il était
frais, calme et plus tranquille encore que celui-ci, l’air de Bourton au premier matin ; le battement d’une vague, le baiser d’une vague, pur, vif, et même – elle n’avait alors que dix-huit ans –
solennel ; debout devant la fenêtre ouverte, elle sentait que quelque chose de merveilleux allait venir ; elle regardait les fleurs, les arbres où la fumée jouait, et les corneilles s’élevant,
puis retombant. Elle restait là, elle regardait… Soudain la voix de Peter Walsh : « Rêverie parmi les légumes ? » Est-ce bien cela qu’il disait ? Ou : « J’aime mieux les gens que les
choux-fleurs. » Était-ce bien cela ? Il devait l’avoir dit au déjeuner, un matin qu’elle était sur la terrasse. Peter Walsh… Il allait revenir de l’Inde un de ces jours, en juin ou en juillet,
elle ne savait plus, car ses lettres étaient bien ennuyeuses. Mais ses mots, on s’en souvenait ; ses yeux, son couteau de poche, son sourire, ses grogneries, et, lorsque tant d’images s’étaient
évanouies, – quelle drôle de chose ! – quelques mots comme ceux-là, à propos de choux. Elle se redressa un peu au bord du trottoir, laissa passer le camion de Durtnall.
« Charmante personne ! pensa Scrope Purvis (qui la connaissait, comme on se connaît à Westminster quand on vit porte à porte) ; un peu de l’oiseau en
elle, du geai, bleu-vert, léger, vif… bien qu’elle ait plus de cinquante ans et qu’elle soit devenue très blanche depuis sa maladie. » Elle se tenait perchée, ne le vit pas, attendait pour
traverser, très droite. Quand on a vécu à Westminster – combien d’années main- tenant ? plus de vingt – on sent au milieu du mouvement, si on s’éveille la nuit (Clarissa l’affirmait), une sorte
d’arrêt, quelque chose de solennel, une pause qu’on ne peut décrire ; tout semble se figer (c’était son cœur peut-être, disait-on, son cœur troublé par la grippe) avant que Big Ben sonne. Ah ! Il
commence. D’abord, un avertissement musical, puis l’heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvent dans l’air. « Quels fous nous sommes ! pensait-elle en tournant dans Victoria Street…
Qui sait pourquoi nous l’aimons ainsi, pourquoi nous la voyons ainsi, pourquoi nous l’élevons autour de nous, la construisons, la détruisons – et la recréons à chaque minute ? Les plus tristes
mégères, les plus misérables débris assis au seuil des portes (l’ivrognerie les a perdus) font comme nous. Aucune loi ne pourra les mater, j’en suis sûre. Pourquoi ? Parce qu’ils aiment la vie. »
Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, leur tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voitures, autos, omnibus, camions, hommes-sandwich traînant et oscillant, orchestres,
orgues de Barbarie, dans le triomphe et dans le tintement et dans le chant étrange d’un aéroplane au-dessus de sa tête, il y avait ce qu’elle aimait : la vie, Londres, ce moment de juin. Car
c’était le milieu de juin.

"The War was over, except for some one like Mrs. Foxcroft at the Embassy last night eating her heart out because that nice boy was killed and now the
old Manor House must go to a cousin; or Lady Bexborough who opened a bazaar, they said, with the telegram in her hand, John, her favourite, killed; but it was over; thank Heaven — over. It was
June. The King and Queen were at the Palace. And everywhere, though it was still so early, there was a beating, a stirring of galloping ponies, tapping of cricket bats; Lords, Ascot, Ranelagh and
all the rest of it; wrapped in the soft mesh of the grey-blue morning air, which, as the day wore on, would unwind them, and set down on their lawns and pitches the bouncing ponies, whose
forefeet just struck the ground and up they sprung, the whirling young men, and laughing girls in their transparent muslins who, even now, after dancing all night, were taking their absurd woolly
dogs for a run; and even now, at this hour, discreet old dowagers were shooting out in their motor cars on errands of mystery; and the shopkeepers were fidgeting in their windows with their paste
and diamonds, their lovely old sea-green brooches in eighteenth-century settings to tempt Americans (but one must economise, not buy things rashly for Elizabeth), and she, too, loving it as she
did with an absurd and faithful passion, being part of it, since her people were courtiers once in the time of the Georges, she, too, was going that very night to kindle and illuminate; to give
her party. But how strange, on entering the Park, the silence; the mist; the hum; the slow-swimming happy ducks; the pouched birds waddling; and who should be coming along with his back against
the Government buildings, most appropriately, carrying a despatch box stamped with the Royal Arms, who but Hugh Whitbread; her old friend Hugh — the admirable Hugh!
“Good-morning to you, Clarissa!” said Hugh, rather extravagantly, for they had known each other as children. “Where are you off
to?”
“I love walking in London,” said Mrs. Dalloway. “Really it’s better than walking in the country.”
They had just come up — unfortunately — to see doctors. Other people came to see pictures; go to the opera; take their daughters out; the Whitbreads
came “to see doctors.” Times without number Clarissa had visited Evelyn Whitbread in a nursing home. Was Evelyn ill again? Evelyn was a good deal out of sorts, said Hugh, intimating by a kind of
pout or swell of his very well-covered, manly, extremely handsome, perfectly upholstered body (he was almost too well dressed always, but presumably had to be, with his little job at Court) that
his wife had some internal ailment, nothing serious, which, as an old friend, Clarissa Dalloway would quite understand without requiring him to specify. Ah yes, she did of course; what a
nuisance; and felt very sisterly and oddly conscious at the same time of her hat. Not the right hat for the early morning, was that it? "
"La guerre était finie. Sauf pour certains : Mrs Foxcroft qui hier à l’Ambassade se rongeait de chagrin parce que ce joli garçon avait été tué et que maintenant le vieux Manor House passerait à un cousin ; Lady Bexborough, qui, disait-on, avait ouvert une vente de charité en tenant à la main un télégramme : John, son préféré, tué. C’était fini, Dieu merci, fini. Et voilà le mois de juin. Le Roi et la Reine étaient au Palais. Et pourtant, bien qu’il fût encore très tôt, il y avait un bruit sourd de poneys galopants, des claquements de crosses et de crickets ; Lords, Ascot, Ranelagh et tous les autres, voilés par le doux réseau gris-bleu de l’air matinal qui, plus tard, se dissiperait, laisserait voir sur les pelouses et sur les pistes les poneys bondissants, qui frappent à peine le sol de leurs pieds de devant et s’élancent, les ardents jeunes gens et les jeunes filles rieuses, aux transparentes mousselines, qui, ce matin même, après avoir dansé toute la nuit, promenaient leurs ridicules chiens au poil de laine. Déjà de discrètes douairières partaient dans leurs voitures pour des courses mystérieuses ; les marchands s’agitaient dans leurs vitrines avec leurs pierres fausses et leurs diamants et ces charmantes vieilles broches vert-de-mer aux montures XVIIIe siècle qui tentent les Américains (mais il faut économiser, ne pas faire pour Élisabeth trop de folles dépenses), et elle aussi qui aimait ces choses d’une absurde et fidèle passion, qui en faisait partie, puisque sa famille avait figuré à la Cour sous les George, elle allait, ce soir même, se mettre en frais et illuminer, elle allait donner sa soirée. Mais quelle chose étrange, en entrant dans le Parc, que ce silence, cette brume, ce bourdonnement, les canards heureux qui nageaient lentement, les oiseaux pansus qui se dandinaient ! Et qui vient donc là-bas, du côté des Ministères, justement, avec un portefeuille aux armes royales ? C’est Hugh Whitbread, son vieil ami Hugh, Hugh l’admirable. « Comment va, Clarissa ? s’écria Hugh en exagérant un peu (ils s’étaient connus tout enfants). Où allez-vous ainsi ? – J’adore marcher dans Londres, dit Clarissa, c’est beaucoup plus agréable qu’à la campagne. » Ils venaient d’arriver en ville, hélas ! pour consulter les docteurs. On vient à Londres pour voir les expositions, aller à l’Opéra, faire sortir ses filles. Les Whitbread venaient « pour consulter les docteurs ». Que d’innombrables visites Clarissa avait faites à Evelyn Whitbread dans des cliniques ! « Evelyn est de nouveau malade ? – Evelyn est assez patraque », dit Hugh avec une moue et en gonflant un peu son très beau corps, un peu gros, mais si noble, si parfaitement soigné (il était comme d’habitude trop bien mis, à cause de sa petite charge à la Cour, c’était sans doute nécessaire). Il voulait dire par là que sa femme souffrait d’un mal interne – oh ! rien de sérieux ! – Clarissa, sa vieille amie, comprendrait parfaitement sans l’obliger à préciser. Mais oui, elle comprenait. Quel ennui ! et elle se sentit émue comme une sœur, et aussi drôlement gênée à cause de son chapeau. Ce n’était pas exactement le chapeau du matin, n’est- ce pas ? ..."
Par une claire matinée de juin, Clarissa Dalloway, sortie de chez elle pour acheter des fleurs et orner sa maison en vue de la fête qui s`y tiendra dans la soirée, en profite pour effectuer une promenade à travers Londres : et Virginia Woolf l'accompagne, recueillant les images qui s`offrent à ses yeux, les pensées et les sentiments que suscite en elle la claire lumière
du printemps, mêlant toutes choses dans un rythme harmonieux. L`esprit de Clarissa est empli de l'image de Peter Walsh, un ami d'enfance qu`elle avait rêvé d`épouser et qui, à en croire ce qui lui a été rapporté, vient de rentrer des lndes ; le souvenir de Peter la ramène à son adolescence. dans la maison paternelle. Néanmoins les souvenirs ne l'absorbent pas au point de l`empêcher de prêter attention à ce qui l'entoure : car Mrs. Dalloway est amoureuse de la vie dont tous les aspects la frappent et la passionnent ... et ainsi le récit se développe-t-il, du passé au présent, entremêlant l`un à l'autre. C'est avec un égal intérêt qu`elle observe l`agent qui règle la circulation, les vitrines des magasins, la voiture qui passe rapidement, rideaux tirés. abritant peut-être quelque membre de la famille royale ; voici un couple de jeunes gens qui la croise. alors qu'elle flâne dans les jardins de Kensington ; le couple a l`air tout désemparé. en proie à la plus grande inquiétude.
Animée d'une sympathie active et toujours en éveil, Woolf nous transporte dans l`intimité de ce couple, nous contant leur histoire : Septimus Warren Smith, après avoir participé à la guerre mondiale avec un enthousiasme d'idéaliste, en est revenu tout bouleversé et étrange ; depuis, il regarde toute chose comme "au travers d`une vitre"; quant à sa femme Lucrezia, petite modiste italienne, elle tente en vain, par son amour, de le sauver d'un cauchemar qui frise la folie.
Au terme de sa promenade, Clarissa revient chez elle : tandis qu`elle est occupée à remettre de l'ordre dans sa maison, voici que survient Peter; entre eux se déroule un jeu d`émotions contenues et profondes, qu'interrompra l`arrivée d'Elisabeth, fille de Clarissa. Elisabeth, intelligente et belle, préoccupe sa mère par son sérieux, son intérêt pour des choses qui sont toujours demeurées étrangères à Clarissa, pour son amitié avec miss Kilman, vieille fille cultivée et dévote qui se dit illuminée de Dieu et cherche à inspirer à la jeune fille le dégoût de la vie raffinée qui l'entoure.
La journée continue, et tout en demeurant dans la solitude de sa demeure, Clarissa continue à dominer la vie et les pensées de ceux qui la connaissent : de Peter, qui après tant d'années d`exil, se replonge avec délices dans l'atmosphère de Londres à laquelle est indissolublement liée pour lui l'image de la femme aimée; de son mari, Richard Dalloway, qui, après une réunion politique chez lady Bruton, éprouve soudain le besoin d`acheter des fleurs, pour les apporter à sa femme et lui dire combien il l'aime; d'Elisabeth, qui, en compagnie de miss Kilman, est allée faire quelques emplettes dans un magasin. Mais, obéissant soudain à une sorte d'appel, elle revient auprès de sa mère, abandonnant son amie qui en éprouve un sentiment mortifiant de défaite.
La journée s'achève, voici venue l'heure de la fête tant attendue; tous se retrouvent : Peter, partagé entre une admiration encore vive pour Clarissa et le besoin de lui trouver des limitations et des défauts; Sally Seton, la passionnée jeune file d`antan, devenue l'épouse d'un commerçant de Manchester et la mère de cinq enfants ; Richard, lady Bruton et Elisabeth; au cours de la conversation, on fera connaissance avec un autre personnage, Septimus, qui s'est suicidé le jour même et dont le docteur qui le soígnait raconte quelle fut la vie : Septimus s`est tué, car il ne pouvait plus supporter ce sentiment d'irréalité dont il se sentait constamment accablé; et le récit même de ce suicide semble donner soudain, par contraste, une solidité nouvelle au monde sans importance où Clarissa évolue. (Trad. Stock, 1948)

Vers le phare (To the lighthouse, 1927)
"Yes, of course, if it’s fine tomorrow,” said Mrs. Ramsay. “But you’ll have to be up with the lark,” she added. To her son these words conveyed an extraordinary joy, as if it were settled, the expedition were bound to take place, and the wonder to which he had looked forward, for years and years it seemed, was, after a night’s darkness and a day’s sail, within touch..."
"Une soirée d'été sur une île au large de l'Ecosse. Pôle de convergence des regards et des pensées, Mrs Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d'aller au Phare. L'expédition aura lieu un beau matin d'été, dix ans plus tard. Entre-temps, mort et violence envahissent l'espace du récit. Au bouleversement de la famille Ramsay répond le chaos de la Première Guerre mondiale. La paix revenue, il ne reste plus aux survivants désemparés, désunis, qu'à reconstruire sur les ruines. Des bonheurs et des déchirements de son enfance, Virginia Woolf a fait la trame d'une oeuvre poétique, lumineuse et poignante qui dit encore le long tourment de l'écriture et la brièveté de ses joies : visions fragiles, illuminations fugaces .."
"Promenade au phare" est considéré comme le roman le plus autobiographique de Virginia Woolf, une histoire des plus simples dans laquelle elle a représenté ses parents, Julia et Leslie Stephen, sous les traits de M. et Mme Ramsay. Le roman est composé de deux journées à dix ans d'intervalle.
Dans la première partie, "La Fenêtre" (The Window), les Ramsay et leurs invités sont décrits au cours d'une journée (y compris la peintre Lily Briscoe) dans une île des Hébrides (l’île de Skye ) où ils possèdent un pavillon d'été. Mme Ramsay assure son jeune fils James qu’une sortie au phare sera effectivement possible le lendemain, mais M. Ramsay insiste sur le fait que le temps contrecarrera le plan; un dîner est organisé...
La section centrale, "Le Temps passé" (Time Passes), est un essai de narration moderniste dans lequel Woolf inclut les formes représentatives que lui suggérait l'art cinématographíque nouveau. Mme Ramsay meurt et la guerre mondiale intervient pour fracturer l'histoire et les expériences.
"WHAT DOES IT mean then, what can it all mean? Lily Briscoe asked herself, wondering whether, since she had been left alone, it behoved her to go to the kitchen to fetch another cup of coffee or wait here. What does it mean? — a catchword that was, caught up from some book, fitting her thought loosely, for she could not, this first morning with the Ramsays, contract her feelings, could only make a phrase resound to cover the blankness of her mind until these vapours had shrunk. For really, what did she feel, come back after all these years and Mrs. Ramsay dead? Nothing, nothing — nothing that she could express at all.
She had come late last night when it was all mysterious, dark. Now she was awake, at her old place at the breakfast table, but alone. It was very early too, not yet eight. There was this expedition — they were going to the Lighthouse, Mr. Ramsay, Cam, and James. They should have gone already — they had to catch the tide or something. And Cam was not ready and James was not ready and Nancy had forgotten to order the sandwiches and Mr. Ramsay had lost his temper and banged out of the room.
“What’s the use of going now?” he had stormed.
Nancy had vanished. There he was, marching up and down the terrace in a rage. One seemed to hear doors slamming and voices calling all over the house. Now Nancy burst in, and asked, looking round the room, in a queer half dazed, half desperate way, “What does one send to the Lighthouse?” as if she were forcing herself to do what she despaired of ever being able to do...."
Dans la troisième et dernière partie, dix ans après « La fenêtre », "Le Phare" (The Lighthouse), une partie de la famille retourne à la maison d’été, l'artiste Lily Briscoe termine le portrait de Mme Ramsay dont l'image lui échappait auparavant, et M. Ramsay et ses deux plus jeunes enfants, James et Cam, atteignent le phare, réalisant ainsi l'excursion prévue des les premières lignes du livre.
Mais le terme d' «histoire», bien sûr, n'est pas juste, car le livre ne se déroule pas tant par le récit des événements de l’auteur que par le mouvement continu de l’esprit d’un personnage à celui d’un autre, puis un autre, puis un autre, passant comme un fantôme bienveillant entre les incitations à la perception et les rêveries chaotiques et rédemptrices de la conscience. C'est ainsi que, d’un paragraphe à l’autre, Woolf anime les émotions fugaces d’un jeune garçon, les ambitions contrariées de son père philosophe craintif, et la sagesse poignante de Mme Ramsay, qui entend, dans la chute des vagues sur le rivage, le battement impitoyable de la mesure de la vie, avertissant « celle dont la journée s’était écoulée d’un geste rapide à l’autre que tout était aussi éphémère qu’un arc-en-ciel » (her whose day had slipped past in one quick doing after another that it was all as ephemeral as a rainbow).
“.. Perhaps you will wake up and find the sun shining and the birds singing,” she said compassionately, smoothing the little boy’s hair, for her husband, with his caustic saying that it would not be fine, had dashed his spirits she could see. This going to the Lighthouse was a passion of his, she saw, and then, as if her husband had not said enough, with his caustic saying that it would not be fine tomorrow, this odious little man went and rubbed it in all over again.
“Perhaps it will be fine tomorrow,” she said, smoothing his hair. All she could do now was to admire the refrigerator, and turn the pages of the Stores list in the hope that she might come upon something like a rake, or a mowing-machine, which, with its prongs and its handles, would need the greatest skill and care in cutting out. All these young men parodied her husband, she reflected; he said it would rain; they said it would be a positive tornado.
But here, as she turned the page, suddenly her search for the picture of a rake or a mowing-machine was interrupted. The gruff murmur, irregularly broken by the taking out of pipes and the putting in of pipes which had kept on assuring her, though she could not hear what was said (as she sat in the window which opened on the terrace), that the men were happily talking; this sound, which had lasted now half an hour and had taken its place soothingly in the scale of sounds pressing on top of her, such as the tap of balls upon bats, the sharp, sudden bark now and then, “How’s that? How’s that?” of the children playing cricket, had ceased; so that the monotonous fall of the waves on the beach, which for the most part beat a measured and soothing tattoo to her thoughts and seemed consolingly to repeat over and over again as she sat with the children the words of some old cradle song, murmured by nature, “I am guarding you — I am your support,” but at other times suddenly and unexpectedly, especially when her mind raised itself slightly from the task actually in hand, had no such kindly meaning, but like a ghostly roll of drums remorselessly beat the measure of life, made one think of the destruction of the island and its engulfment in the sea, and warned her whose day had slipped past in one quick doing after another that it was all ephemeral as a rainbow — this sound which had been obscured and concealed under the other sounds suddenly thundered hollow in her ears and made her look up with an impulse of terror.
They had ceased to talk; that was the explanation. Falling in one second from the tension which had gripped her to the other extreme which, as if to recoup her for her unnecessary expense of emotion, was cool, amused, and even faintly malicious, she concluded that poor Charles Tansley had been shed. That was of little account to her. If her husband required sacrifices (and indeed he did) she cheerfully offered up to him Charles Tansley, who had snubbed her little boy.
One moment more, with her head raised, she listened, as if she waited for some habitual sound, some regular mechanical sound; and then, hearing something rhythmical, half said, half chanted, beginning in the garden, as her husband beat up and down the terrace, something between a croak and a song, she was soothed once more, assured again that all was well, and looking down at the book on her knee found the picture of a pocket knife with six blades which could only be cut out if James was very careful..."
Ce roman est une sorte d'histoire de fantômes, dans laquelle Woolf explore l'impact de la mort, en ne la représentant qu'indirectement alors qu'elle résonne dans toute l'œuvre. L'auteur renverse les priorités habituelles du roman en regroupant mort et mariage dans la partie centrale et en s'intéressant aux changements que provoque le temps sur la matière. C'est une exploration en profondeur du temps et de la mémoire, des conventions victoriennes en matière de virilité et de féminité, et de la relation entre l'art et ce qu'il cherche à refléter ...

Vita Sackville-West (1892-1962, poétesse ("The Land", 1927), romancière ("The Edwardians", 1930, "All Passion Spent", 1931), essayiste, biographe, traductrice et conceptrice de ses jardins au Château de Sissinghurst, dans le Kent, peinte par William Strang en 1918, mariée à Harold Nicolson, bisexuel comme elle, fût une femme passionnée, amante de Violet Trefusis (1894-1972), femme de lettres ("Broderie Anglaise", 1939–1945) et mondaine connue du Tout-Paris, et de Virginia Woolf dans les années 1920 : c'est dans ce contexte passionnel que sera écrit "Orlando", analyse subtile des rapports entre les sexes sur quatre siècle dans la société anglaise et que domine la figure androgyne d'Orlando. Leurs lettres amoureuses respectives firent l'objet par ailleurs de maintes publications...

Orlando (1928)
"He — for there could be no doubt of his sex, though the fashion of the time did something to disguise it — was in the act of slicing at the head of a Moor which swung from the rafters. It was the colour of an old football, and more or less the shape of one, save for the sunken cheeks and a strand or two of coarse, dry hair, like the hair on a cocoanut. Orlando’s father, or perhaps his grandfather, had struck it from the shoulders of a vast Pagan who had started up under the moon in the barbarian fields of Africa; and now it swung, gently, perpetually, in the breeze which never ceased blowing through the attic rooms of the gigantic house of the lord who had slain him..."
"Orlando, ce sont les mille et une vies dont nous disposons, que nous étouffons et qu'Orlando seul libère, car il lui est donné de vivre trois siècles en ayant toujours trente ans. Jeune lord comblé d'honneurs, il est nommé ambassadeur en Turquie, devient femme et rejoint une tribu de bohémiens puis retourne vivre sous les traits d'une femme de lettres dans l'Angleterre victorienne. Assoiffé de vie et de poésie, à l'image de Virginia Woolf, Orlando traverse les siècles, accumule les sensations, déploie les multiples facettes qui composent notre être. La nature de l'homme et de la femme, l'amour, la vie en- société, la littérature, tout est dénudé avec un prodigieux humeur. - hymne à la joie, au plaisir, ce conte fantastique révèle que la pensée créatrice est bien « de tous les moyens de transport le plus divagant et le plus fou! »."
"Il – car son sexe n’était pas douteux, quoique la mode du temps fît quelque chose pour le déguiser – faisait siffler son épée à coups de taille contre une tête de Maure qui, pendue aux poutres, oscillait. Elle avait la couleur d’un vieux ballon ; elle en aurait eu plus ou moins la forme, sans ses joues avalées et une ou deux touffes de cheveux rudes et secs comme la tignasse d’une noix de coco. Le père d’Orlando, ou peut-être son grand- père, l’avait décollée des épaules d’un énorme infidèle surgi soudain, au clair de lune, dans les champs barbares d’Afrique ; et voici que doucement, sans arrêt, dans la brise qui soufflait toujours par les greniers de cette maison géante, elle oscillait sous le toit du Lord qui l’avait tranchée. Les aïeux d’Orlando avaient chevauché par des champs d’asphodèles, et des champs pierreux, et des champs encore, arrosés d’étranges rivières ; ils avaient décollé de maintes épaules maintes têtes de maintes couleurs, et les avaient rapportées pour les suspendre aux poutres de leur toit. Ainsi ferait Orlando, jurait-il. Mais comme il n’avait que seize ans et qu’il était trop jeune pour accompagner les autres dans leurs chevauchées d’Afrique ou de France, il se contentait d’échapper à sa mère et aux paons du jardin, de monter en son grenier, et là, d’estoquer, tailler et trancher l’air à grands coups de sa lame sifflante. Quelquefois il coupait la corde qui retenait la tête : elle rebondissait sur le sol ; il devait la rependre, et, chevaleresque, attachait presque hors de portée cet ennemi dont les lèvres desséchées et noires grimaçaient alors un sourire de triomphe. La tête ballante oscillait : car ces greniers où Orlando avait élu domicile étaient au sommet d’une maison si vaste que le vent lui-même y semblait pris au piège, soufflant d’ici, soufflant de là, hiver comme été. La tapisserie verte, celle qui représentait une chasse, sans cesse ondulait dans la brise. Les aïeux d’Orlando avaient été nobles dès leur apparition dans le monde. Ils étaient issus des brouillards nordiques avec des couronnes sur leurs têtes. Ces zébrures d’ombre dans la pièce et ces jaunes étangs en damier sur le sol ne venaient-ils pas du soleil traversant une ample cotte d’arme sur le vitrail de la fenêtre ? Orlando se dressait maintenant dans le jaune d’un léopard héraldique. Lorsqu’il posa la main sur la poignée de la fenêtre pour l’ouvrir, à l’instant elle se colora de rouge, de jaune et de bleu comme une aile de papillon. Ceux qui aiment les symboles et se plaisent à les déchiffrer, auraient pu alors observer que si les jambes élégantes, la taille bien prise, les épaules fermes d’Orlando étaient toutes diaprées de lumières héraldiques, son visage, lorsqu’il ouvrit largement la fenêtre, ne fut éclairé que par le soleil. On n’aurait su trouver visage à la fois plus candide et plus sombre. Heureuse la mère qui porte un tel être ! plus heureux encore le biographe qui raconte sa vie ! L’une n’aura jamais à s’affliger, ni l’autre à demander le secours du romancier ou du poète. De haut fait en haut fait, de gloire en gloire, de charge en charge, le héros doit aller toujours, son scribe le suivant, jusqu’au siège suprême, si haut placé soit-il, où tendent leurs désirs communs. À voir Orlando, on le devinait taillé précisément pour une telle carrière. L’incarnat de ses joues était voilé par un duvet de pêche ; et le duvet de sa lèvre était à peine plus épais que le duvet de sa joue. Ses lèvres elles-mêmes, courtes, se retroussaient légèrement sur des dents d’une exquise blancheur d’amande. Son nez était d’une seule courbe, tel le vol court et tendu d’une flèche ; sa chevelure était sombre, ses oreilles petites, étroitement appliquées contre la tête. Mais hélas, pourquoi faut-il, à ce répertoire de tendres beautés, ajouter encore le front et les yeux ? Hélas ! pourquoi naît-il si rarement des hommes qui en soient pourvus ? En effet, au premier coup d’œil jeté sur Orlando à sa fenêtre, il nous faut admettre qu’il avait des yeux comme des violettes trempées, de grands yeux que l’eau semblait emplir et dilater encore ; et que son front, entre les deux médaillons vides de ses tempes, avait le renflement d’un grand dôme de marbre. Ainsi, au premier coup d’œil sur ses yeux, sur son front, nous nous mettons à poétiser. Ainsi, au premier coup d’œil sur ses yeux, sur son front, il nous faut admettre mille choses fâcheuses que tout bon biographe s’efforce d’ignorer. Par les yeux entraient en Orlando des spectacles perturbateurs – par exemple sa mère, une très belle dame vêtue de vert qui s’en al- lait nourrir ses paons, accompagnée de Twitchett sa suivante ; des spectacles qui l’enthousiasmaient – les oiseaux et les arbres ; qui le rendaient amoureux de la mort – le ciel crépusculaire ou le retour des freux ; et ainsi, montant par la spirale de l’escalier jusque dans son cerveau – qui était des plus vastes – tous ces spectacles, et les bruits du jardin aussi, le choc du marteau, les coups d’une hache, instauraient ces désordres et ces émeutes des passions et des mouvements que tout bon bio- graphe déteste. Mais poursuivons. – Orlando, lentement, rentra la tête, s’assit devant une table, et, avec l’air à demi conscient des hommes en train de faire ce qu’ils font à cette heure tous les jours de leur vie, prit un cahier intitulé : « Æthelbert, Tragédie en cinq actes », et plongea dans l’encre une vieille plume d’oie toute tachée. Il eut bientôt couvert dix pages et plus de poésie. Son style était coulant, à coup sûr, mais abstrait. Le Vice, le Crime, la Misère étaient les personnages de ce drame. Rois et reines y gouvernaient d’impossibles États ; d’horribles intrigues les accablaient ; de nobles sentiments les soulevaient ; il n’y avait pas là un seul mot qu’Orlando eût dit lui-même, mais tout était tourné avec une aisance et une douceur qui, si l’on considère l’âge de l’auteur – il n’avait pas encore dix-sept ans – et le fait que le XVIe siècle avait encore quelques années à vivre, étaient vraiment assez remarquables. À la fin, pourtant, Orlando s’arrêta. Il était en train de décrire, comme tous les jeunes poètes le font toujours, la nature ; et, afin d’accorder son épithète à une nuance précise de vert, il regarda – en quoi il montra plus d’audace que beaucoup – la chose elle-même : un massif de lauriers qui, justement, poussait sous sa fenêtre. Et, naturellement, c’en fut fini d’écrire...."
"Orlando" fut une étape importante sur la route suivie par l`auteur dans la recherche et la création d'une forme d'art neuve et hardie. Vers la fin du XVIe siècle. dans un manoir d`Angleterre. vit Orlando, un jeune homme de haut lignage. Il joint à une nature chevaleresque un, profond amour de la poésie. La reine Elisabeth, conquise par son charme, l'appelle à sa Cour, le comble de charges et d`honneurs. ll reste à la Cour, admiré de tous, même après la mort de la reine. Durant l`année du grand gel, le roi Jacques fait construire sur la glace de la Tamise une sorte de champ de foire. Orlando y rencontre Sasha, une princesse des plus fantasques, nièce de l'ambassadeur de Russie. Elle lui révèle l`amour et s`enfuit sans un mot.
Désespéré, Orlando s`en retourne dans son manoir où il passe quelques jours dans une sorte d`hébétude. Quand il se réveille, il est guéri de sa passion. Se sentant envahi alors par l`ambition littéraire, il se fait le serment de devenir le premier poète de sa lignée et d`illustrer son nom. ll fait venir au manoir., pour lui demander aide et conseil, le littérateur Nicolas Greene : mais ce dernier, féru de classicisme, ne comprend rien à ses aspirations et le décourage par ses railleries. C'est ainsi qu`à trente ans Orlando, déçu par l`amour et par l'ambition, convaincu de la vanité des femmes et des poètes, cherche un réconfort dans la nature et consacre tout son temps à la restauration de son manoir.
Repris toutefois par son démon poétique, il commence un poème "Le Chêne", en un style très différent de celui de ses premiers vers. Cette vie de solitude et de contemplation est troublée par l'arrivée d'une riche duchesse roumaine, qui veut à tout prix lui imposer le mariage. Pour fuir ses persécutions. Orlando se fait envoyer comme ambassadeur à Constantinople où, peu de temps après, il tombe dans l`atonie la plus complète. Il se réveille, mystérieusement transformé en femme. Sous sa nouvelle nature, Orlando se joint à une tribu de bohémiens et erre avec eux dans les montagnes de l`Anatolie; la nature lui révèle son aspect d`éternité et la millénaire sagesse des bohémiens lui fait comprendre la futilité des traditions de sa famille. Puis. poussée par la nostalgie et par son besoin d`écríre, elle prend la mer et revient à Londres, qu'elle trouve profondément changée.
Nous sommes à l'époque d`Addison, de Dryden et de Pope ; une atmosphère nouvelle baigne toutes choses. Peu à peu. Orlando s`habitue à sa condition de femme. Fréquentant la brillante société de l'époque de la reine Anne, elle y rencontre des gens de lettres et perd en même temps ses illusions, "peut-être pour s`en forger de nouvelles". Avec les années qui passent, l`atmosphère du monde se transforme : l'humidité imprègne les choses, le lierre recouvre les maisons, à l'intérieur desquelles triomphe le goût victorien; une extraordinaire fécondité se manifeste, la mode est à la crinoline ; la littérature elle-même tend à l'exagération et à l'emphase. Orlando, qui presque sans le savoir avait accédé naturellement à la tournure d`esprit qui régna lors de la restauration des Stuarts, éprouve une aversion profonde pour l`esprit du XIXe siècle. Poussée par une nécessité d`ordre uniquement social à choisir un mari, elle épouse Marmaduke Bonthrop Shelmerdine, hardi marin dont l'existence n'est voué qu'à tenter de franchir le cap Horn. Pendant son absence, Orlando reprend et achève son poème "Le Chêne" et Nicolas Greene, qu`elle a retrouvé à Londres et qui imite Addison comme il imitait autrefois Cicéron, la décide à le publier.
Le temps continue sa course. L'automobile, l'électricité apparaissent, la monstrueuse prospérité victoríenne semble à bout de souffle. C`est l'époque actuelle : 1928. Orlando est une femme de notre temps, elle a des enfants, elle conduit elle-même son automobile, elle a reçu un prix littéraire; mais elle poursuit toujours, et en vain, la révélation de l'instant présent dont la vibration perpétuelle s'anime de mille souvenirs bruissant autour d`images perpétuellement nouvelles...
Orlando est une œuvre de fantaisie sur la métempsycose, très à la mode à l`époque élisabéthaine (cf. "Les Pérégrinations de l'âme", de John Donne). Ce roman fut inspiré à l'auteur par la personnalité de la romancière Victoria Sackville West, qui était son amie intime et qui était censé réaliser la dernière incarnation d`Orlando. L`étrange personnage d`Orlando, homme et femme ayant vécu plus de trois siècles en accumulant un inépuisable trésor de pensées et de sensations permet à l'auteur de donner une vivante représentation de la fluidité perpétuelle de la vie, cette vie où les formes du "moi" se dissolvent continuellement et où la notion du temps se révèle si variable et relative....
(Trad. Stock. 1931).

Les Vagues (The Waves, 1931)
"Tandis que les vagues déferlent sur le rivage, six voix s’élèvent en contrepoint, celles de trois filles et de trois garçons, qui parlent dans la solitude,
se racontent, s’entrelacent, et pleurent la mort de leur ami Percival. A la différence de la plupart de ses romans, Virginia Wolf a ici construit un poème en prose, où alternent souvenirs heureux
et sombres de l’enfance, communions éphémères, rencontres manquées, amour de la vie et fascination de la mort. Chaque image fait surface un bref instant, à la manière de cet aileron entrevu un
jour sur la mer vaste et vide, source de terreur et d’extase, que l’auteur s’efforce ici de capturer. Et les vagues, de leur grondement sourd et éternel, referment le livre comme elles l’avaient
ouvert."
"The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was slightly creased as if a cloth had wrinkles in it. Gradually as the sky whitened a dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky and the grey cloth became barred with thick strokes moving, one after another, beneath the surface, following each other, pursuing each other, perpetually.
As they neared the shore each bar rose, heaped itself, broke and swept a thin veil of white water across the sand. The wave paused, and then drew out again, sighing like a sleeper whose breath comes and goes unconsciously. Gradually the dark bar on the horizon became clear as if the sediment in an old wine-bottle had sunk and left the glass green. Behind it, too, the sky cleared as if the white sediment there had sunk, or as if the arm of a woman couched beneath the horizon had raised a lamp and flat bars of white, green and yellow spread across the sky like the blades of a fan. Then she raised her lamp higher and the air seemed to become fibrous and to tear away from the green surface flickering and flaming in red and yellow fibres like the smoky fire that roars from a bonfire. Gradually the fibres of the burning bonfire were fused into one haze, one incandescence which lifted the weight of the woollen grey sky on top of it and turned it to a million atoms of soft blue. The surface of the sea slowly became transparent and lay rippling and sparkling until the dark stripes were almost rubbed out. .."
C'est l'oeuvre la plus expérimentale de Virginia Woolf. On retrouve dans "Les Vagues" de nombreuses préoccupations de ses autres romans, - l'expérimentation sur le temps et le récit, les identités qui se défont et la représentation de diverses vies à travers une écriture biographique. Mais l'auteur pousse aussi le monologue intérieur dans de nouvelles directions, plutôt qu'une technique narrative, il devient une exploration de la relation entre la vie intérieure et les éléments "impersonnels" naturels que représentent les vagues et l'eau. Elle explore la temporalité de la vie sur une période de vingt-quatre heures - le mouvement des vagues définit le passage de l'aube au crépuscule et structure l'ouvrage. Des «monologues dramatiques» représentant les six personnages sont entremêlés d'«ínterludes poétiques» décrivant le passage du soleil dans le ciel et les rythmes des marées. "Les Vagues" retracent six vies depuis l'enfance jusqu'à la cinquantaine, et cherchent à montrer leur continuité plutôt qu'à décrire des événements précis. Les personnages offrent leurs pensées en tant qu'êtres distincts, rarement au sein d'un dialogue, et pourtant le roman les rassemble en prêtant l'oreille à des moments synchrones de leur vie et en les regroupant à divers stades...
"The Waves" ne contient ni action ni dialogue, mais une longue suite de monologues intérieurs à travers lesquels la vie de six êtres humains s'écoule devant nos yeux dans un flot ininterrompu et toujours renaissant. Nous les découvrons alors qu'ils ne sont que des enfants et assistons à la découverte que chacun d`eux fait. avec une sorte d`exaltation angoissée, de sa personnalité : Louis, assoiffé de solitude parce que accablé par le sentiment de son infériorité sociale ; Bernard, toujours pris au piège d`une imagination qui le tient éloigné de la réalité ; Neville, tourmenté par sa faiblesse physique et ses visions morbides, aimant profondément l'ordre et la régularité ; Suzanne, avide de possession absolue et exclusive; Jinny, anxieuse de se lancer dans la vie comme dans une valse tourbillonnante; Rhoda, effrayée de tout, même de sa propre existence.
De la salle de jeux, nous les accompagnons jusqu`à l`école. Puis nous voici à l`université avec Bernard, qui continue à mener toutes sortes de vies imaginaires, s`identifiant tour à tour à Tolstoï. Byron, Meredith. tandis que Neville, poussé par sa nature de poète, se tourmente dans la recherche d une inaccessible perfection ; Louis a du abandonner ses études pour entrer dans un bureau et continue sa lutte harassante pour se faire une place dans le monde; Suzanne, revenue dans sa maison de campagne, sent qu`elle s`identifie à la nature et se prépare inconsciemment à son destin de mère ; Jinny, reçue dans la société de Londres, commence une carrière mondaine que sa beauté rend particulièrement brillante : quant à Rhoda, elle ne parvient pas à trouver l`assurance de Suzanne et de Jinny; elle doute, tremble et craint sans cesse Dieu sait quoi.
Quelques années plus tard, les six se retrouvent pour dire adieu à Perceval qui part pour les Indes : Bernard qui a sans cesse besoin d`être éclairé par le regard des autres, Louis devenu "sculptural, pareil à une figure de pierre", Neville exact et précis, Suzanne "avec ses yeux pareils à des globes de cristal", Jinny qui danse comme une flamme fébrile et ardente sur la terre aride. Rhoda enfin la "nymphe de la fontaine toujours en larmes". Ensemble ils vivent un moment de jeunesse et de beauté, que domine leur héros, Perceval, en qui chacun trouve un reflet de ses propres aspirations.
Comme une vague pousse l`autre, les années s`écoulent et voici que le soleil de la vie commence à décliner; Perceval meurt d'une chute de cheval aux Indes et laisse à tous le sentiment d`un vide qu`ils ne peuvent combler ; lorsque les six se réunissent encore une fois, Louis est devenu un homme d`affaires qui aime son travail et sent le "poids du monde sur ses épaules"; Bernard, marié et père de famille, a composé d`innombrables phrases, mais n'a jamais trouvé la réalité ; Suzanne est devenue mère, elle a acquis de l`assurance et de la maîtrise tandis que Jinny continue à mener sa vie sans jamais s`arrêter, sans jamais s`attacher à personne; Neville, lui, a trouvé dans l`amour une compensation à sa laideur, à la méchanceté des hommes et à la mort de Perceval; seule Rhoda, qui a été pendant quelque temps la maîtresse de Louis, n`a rien su conquérir, est restée "sans visage" ...
Mais pour tous l'élan et le désir victorieux du début de la vie se sont évanouis : leur route est désormais tracée, chacun est immobilisé à son poste; la vie ne se présente plus à leurs yeux comme une conquête, mais comme une lutte contre la mort ...

Une chambre à soi (A Room of One's Own, 1929)
Avec une irritation voilée d'ironie, Virginia Woolf a composé ce pamphlet à partir de plusieurs conférences effectuées en octobre 1928 dans deux collèges de
l'université Cambridge qui étaient alors réservés aux femmes, Newnham College et Girton College. Comment, jusqu'à une époque toute récente, les femmes ont été savamment placées sous la dépendance
spirituelle et économique des hommes et, par voie de conséquence, réduites au silence. Que leur manque-t-il pour affirmer leur génie : de quoi vivre, du temps et une chambre à
soi.
"A Roam of One's own", un essai littéraire composé d'après des notes prises pour deux conférences, l'une faite à la "Arts Society", à Newnham, et l'autre à l` "Odtaa", à Girton. Après avoir passé une journée dans un centre universitaire, et fait un luxueux repas dans un collège de garçons, et un modeste dîner dans un collège de jeunes filles, qui dispose de moyens très limités, Virginia Woolf se demande pourquoi les femmes sont plus pauvres que les hommes. Elle cherche en vain une réponse dans les livres de la bibliothèque du British Museum où elle est étonnée de l'énorme quantité d`ouvrages écrits par des
hommes et concernant les femmes : il ne s'agit pas seulement d'œuvres sans profondeur, mais d'écrits scientifiques et de graves sermons moraux et philosophiques dont le ton, cependant, ne révèle pas une sereine impartialité de jugement, mais une irritation voilée d`ironie.
Jusqu'à une époque toute récente, les hommes ont voulu tenir les femmes économiquement et spirituellement sous leur dépendance, surtout pour ne pas perdre le sentiment de leur supériorité et pour voir leur image magnifiée dans l'esprit rendu docile des femmes. L'époque du règne d'Elisabeth n'eut, il est vrai, aucune femme écrivain de la valeur de Shakespeare; mais, étant donné les conditions dans lesquelles les femmes vivaient alors, une jeune fille, si intelligente et si favorisée par le sort, fût-elle une sœur en art de Shakespeare, qui serait allée comme lui à Londres pour y affirmer son génie théâtral, aurait été rapidement et douloureusement vaincue dans la lutte inégale contre les habitudes et les préjugés. Les premières femmes écrivains rencontrèrent partout des barrières qui entravaient leur développement spirituel. Seule Jane Austen sut s'adapter avec sérénité et refléter avec une limpide perfection le monde étroit dans lequel elle était confinée. Chez d`autres femmes de lettres, plus grandes peut-être, comme Charlotte Brontë, le sens de la révolte nuit à la sérénité artistique.
Les conditions actuelles sont différentes et cependant, encore aujourd'hui, une femme de lettres intelligente comme Mary Carmichael peut se laisser influencer par les conseils et par les avertissements de professeurs et de pédagogues. Les femmes devraient écrire d'une manière différente des hommes : elles peuvent saisir et donner du relief à des situations qui sortent du champ d`expérience masculin. Dans cent ans, si elle peut disposer d'une "chambre à soi", pour travailler sans être dérangée, et d'une rente qui lui assure une certaine aisance, une jeune femme de lettres comme Mary Carmichael écrira des livres meilleurs et sera peut-être une vraie poétesse.
Notre esprit est formé d`éIéments masculins et féminins qui devraient coopérer harmonieusement pour produire de grandes œuvres. En Shakespeare, la coopération est parfaite ; chez quelques écrivains modernes, par réaction inconsciente peut-être contre le progrès du sexe faible, l`élément masculin domine d'une manière absolue et leurs œuvres manquent de pouvoir suggestif. La réaction artistique doit être précédée par la fusion des éléments masculins et féminins opposés : l'écrivain ne doit pas penser à son propre sexe, ni alimenter un antagonisme ou une irritation qui altèrent la sérénité de l'oeuvre. Elle ne doit pas subir l`influence de suggestions extérieures, mais rendre la propre vision de l`écrivain avec une parfaite honnêteté. Pour cela, une certaine indépendance matérielle garantissant la sérénité de l'esprit est indispensable ...

Les Années (The Years, 1937)
"Ce roman raconte l'histoire d'une famille en trois générations, où tout évolue, les conditions économiques, les valeurs spirituelles et morales. Les faits
ne sont rien sans la vision, l'histoire sans le sentiment de la durée, l'extérieur sans l'intériorité. Le présent est pénétré de souvenirs, et le passage du temps marque les corps et les coeurs.
Le miracle est que le lecteur se sent à chaque instant touché, englobé dans une histoire qui devient la sienne propre. L'angoisse est la forme extrême de cette interrogation de la vie qui
constitue comme la fondation du roman. Et son sujet, plus que la destinée de tel ou tel personnage, est bien la vie - la vie intérieure, bien sûr, et la contemplation."
"C’était un printemps incertain. Le temps variait sans cesse et chassait des nuages bleus et pourprés au-dessus du pays. Dans la campagne, les fermiers regardaient leurs champs avec méfiance ; à Londres, les gens ouvraient et fermaient leurs parapluies en interrogeant le ciel. Mais on doit s’attendre à ces changements-là en avril. Des milliers de commis des magasins Whiteley et de l’Army and Navy faisaient cette remarque en tendant des paquets soigneusement pliés aux dames à falbalas, debout de l’autre côté du comptoir. D’interminables processions d’acheteurs dans le quartier de l’ouest, et d’hommes d’affaires dans celui de l’est, défilaient sur les trottoirs, semblables à des caravanes en marche incessante. Du moins la comparaison s’imposait à ceux qui, pour une raison ou l’autre, s’arrêtaient un instant, soit pour mettre une lettre à la poste, soit en se plantant à la fenêtre d’un club de Piccadilly. Le flot des landaus, des victorias et des cabs s’écoulait sans arrêt, car la saison débutait. Dans les rues plus tranquilles, les musiciens ambulants lançaient leur mince filet de son, presque toujours mélancolique. Du haut des branches, ici à Hyde Park, ou là à Saint James, le pépiement des moineaux, les brusques éclats de voix intermittents de la grive amoureuse leur faisaient écho ou les parodiaient. Les ramiers des squares s’agitaient à la cime des arbres ; ils laissaient tomber une ou deux brindilles et roucoulaient leur berceuse toujours interrompue. L’après-midi, les grilles de Marble Arch et d’Apsley House étaient bloquées par des dames en robes multicolores, à tournures, et par des mes- sieurs en jaquettes, armés de cannes et l’œillet à la boutonnière. Voici que passait la princesse ; et, sur son passage, les chapeaux se levaient. Au fond des sous-sols des longues avenues, dans les quartiers chics, les femmes de chambre en bonnets et tabliers préparaient le thé. Montée par des détours, la théière d’argent était placée sur la table ; vierges et vieilles filles, de leurs mains qui avaient pansé les plaies de Bermondsey et de Hoxton, mesuraient soigneusement une, deux, trois, quatre cuillerées de thé. Au coucher du soleil, des millions de petites flammes de gaz, dont la forme rappelait les ocelles des plumes de paon, jaillissaient dans leurs cages de verre, sans effacer, cependant, de longues traînées d’ombre sur le trottoir. La lueur des lampes et le soleil couchant se reflétaient également sur les eaux placides de Rond-Point et de la Serpentine. Des invités qui allaient dîner en ville lançaient un regard sur le charmant panorama en traversant le pont au trot des cabs. Enfin la lune se levait ; sa pièce d’argent poli, bien qu’obscurcie par des traînées de nuages, brillait sereine, sévère, ou peut-être tout à fait indifférente. Tour- noyant sans hâte, comme les rayons d’un projecteur, les jours, les semaines et les années passaient les uns après les autres à travers le ciel. Le colonel Abel Pargiter discourait, assis dans une des salles de son club, après déjeuner. Ses compagnons, enfoncés dans leurs fauteuils de cuir, étaient du même type que lui. Anciens militaires ou fonctionnaires retraités, ils pouvaient, à l’aide de vieilles plaisanteries et d’anecdotes, faire revivre leur passé aux Indes, en Afrique et en Égypte. Par une transition naturelle, ils en étaient venus au présent. Il s’agissait d’un rendez- vous, un rendez-vous éventuel. Brusquement, le plus jeune et le plus élégant des trois se pencha en avant. Hier, il avait déjeuné avec… Ici le causeur lais- sa tomber sa voix. Les deux autres s’inclinèrent vers lui. D’un geste bref de la main, le colonel Abel congédia le garçon qui en- levait les tasses à café. Les trois têtes chauves et grisonnantes se tinrent un instant rapprochées, puis le colonel Abel se renversa dans son fauteuil. La lueur de curiosité qui avait passé dans leurs regards à tous quand le major Elkin avait commencé son récit s’était complètement effacée de sa propre physionomie. Il tenait les yeux fixés devant lui, des yeux bleus vifs, un peu crispés, et plissés aux coins, comme s’il leur fallait encore se protéger contre la lumière éblouissante de l’Orient ou éviter la poussière. Une pensée avait frappé le colonel, elle enlevait tout intérêt à ce que disaient ses amis et, même, le rendait désagréable. Il se leva, vint à la fenêtre et abaissa son regard sur Piccadilly. Le cigare à la main, il voyait d’en haut défiler le sommet des omnibus, des cabs, des victorias et des landaus. Il prit un air dé- taché ; il avait lâché tout ça. Et tandis qu’il considérait cette agitation, une ombre se figea sur son beau visage rouge. Une idée lui venait soudain, une question à poser ; il se retourna, mais ses amis s’étaient dispersés. Elkin se dépêchait déjà de passer la porte, Brand s’éloignait pour parler à un autre interlocuteur. Le colonel Pargiter ferma les lèvres sur les paroles qu’il aurait pu prononcer et retourna à la fenêtre qui dominait Piccadilly. Dans la rue encombrée, chacun, semblait-il, avait un but en vue. Chacun se hâtait vers quelque rendez-vous. Les dames elles-mêmes, qui parcouraient Piccadilly au trot de leurs victorias et de leurs coupés, allaient vers des occupations précises. Les gens rentraient à Londres et s’installaient pour la saison. Mais en ce qui concernait le colonel Pargiter la saison n’existait pas, il ne pouvait rien faire. Sa femme était mourante, et elle ne mourait pas. Elle allait mieux aujourd’hui, irait plus mal demain ; une nouvelle infirmière venait, et cela continuerait ainsi. Il ramassa un journal, en tourna les pages. La façade ouest de la cathédrale de Cologne s’offrit à sa vue, il la considéra puis il lança le journal au milieu des autres. Un de ces jours – euphémisme dont il se servait pour désigner le temps où sa femme serait morte – il renoncerait à Londres ; il songea qu’il habiterait la campagne. Mais il avait sa maison, ses enfants, et aussi… son expression changea, s’éclaira, tout en devenant un peu furtive, gênée. ..."

Trois Guinées (Three Guinees, 1938)
Trois Guinées devait être une étude sur la sexualité des femmes. Et si Virginia Woolf examine les circonstances, les protagonistes, les rapports de forces,
si elle dénonce et analyse les conséquences des drames vécus par les femmes comme on l'a rarement fait, elle reste pourtant en retrait. Elle avait en effet de la sexualité une intuition si
violemment subversive qu'elle n'a pu trouver, ni dans la vie ni dans ses textes le langage pour en témoigner. Elle a donc préféré laisser parler l'Histoire et la société, surprenantes et
atterrantes : "derrière nous s’étend le système patriarcal avec sa nullité, son amoralité, son hypocrisie, sa servilité. Devant nous s’étendent la vie publique, le système professionnel, avec
leur passivité, leur jalousie, leur agressivité, leur cupidité. L’un se referme sur nous comme sur les esclaves d’un harem, l’autre nous oblige à tourner en rond… tourner tout autour de l’arbre
sacré de la propriété. Un choix entre deux maux…"

Lytton Strachey (1880-1932) et Dora Carrington (1893-1932) forment un couple improbable, tous deux homosexuels, l'une, Dora Carrington, peintre et décoratrice, issue de la fameuse Slade School, le second, Lytton Strachey, célèbre pour ses "Eminent Victorians" (1911), critiques biographiques sans concession de quelques grands personnages victoriens, et sensible au charme de Ralph Partridge, le mari de Dora.
Works from Dora Carrington - "Lytton Strachey" (1916, National Portrait Gallery, London) - "E. M. Forster" (1920, National Portrait Gallery,
London)...





Rosamond Lehmann (1901-1990)
Rosamond Lehmann a vécu ce qu'elle ré-écrit, allant au fond des choses, les personnages se retrouvent progressivement pris dans des souvenirs et des points
de vue que le narrateur se charge d'alimenter, d'organiser, seule possibilité semble-t-il de percer le voile des apparences de l'existence.
Née à Bourne End (Buckinghamshire) et appartenant à un milieu cultivé, Rosamond Lehmann côtoie Lytton Stratchey, Dora Carrington, ou Virginia Woolf, sans
intégrer le Blomsbury Group. C'est avec "Dusty Answer" (1927, Poussière), récit des expériences douloureuses de la jeune Judith Earle dans ses relations avec les autres, hommes ou femmes, qu'elle
rencontre la notoriété. Son deuxième roman, "A Note in Music" (1930, Une note de musique), plus osé encore, met à jour les réactions de deux couples vivant dans l'indifférence et dont la vie est
soudain bouleversée par l'arrivée de Hugh Miller et de sa sœur Clare, qui vont réveiller en eux la passion. En 1932, "Invitation to the Waltz" (L'Invitation à la valse) décrit de
l'intérieur les émotions et le désarroi d'Olivia Curtis, invitée pour la première fois à un bal. Dans "The Weather in the Streets" (1936, Intempéries), Olivia Curtis, après un mariage raté,
devient la maîtresse d'un de ses amis d'enfance marié et doit affronter les conséquences d'une telle situation. C'est avec "The Echoing Grove" (1953, Le Jour enseveli) que Rosamond Lehmann semble
cristalliser toutes ses intentions narratives : le passé laisse des traces indélébiles, tant psychologiques que physiques et matérielles, en soi, dans les êtres, et dans les paysages ou décors de
l'existence, et ce passé ressurgit sans que l'on n'y prête garde, mais sans confrontation, dans la vie qui s'écoule... En 1958, sa fille Sally meurt subitement de la poliomyélite à l'âge de 23
ans, bouleversant sa carrière : elle rompt avec son parcours de romancière et écrit dans "Moments on Truth" ses expériences médiumniques avec le fantôme de Sally auxquelles elle s'adonne
désormais.

"Dusty Answer" (1927, Poussière)
"Au-delà du paradis des amours enfantines, Judith découvre un monde indistinct où elle tente de raviver les liens de tendresse qui l'unissaient à ses
compagnons de jeu. Entre l'innocence et l'éveil sensuel, les tâtonnements de la passion naissante la poussent tantÔt vers Julien, tantôt vers Rody ou Martin. Mais Julien joue la désinvolture,
Rody le cynisme, Martin la sincérité maladroite. Délaissée par Jennifer; qui s' est plu à exercer sur elle son pouvoir de fascination, Judith apprendra, dans la lucidité des désenchantements, à
conquérir et à affirmer son indépendance. Peinture délicate des milieux étudiants de Cambridge, le roman de Rosamond Lehmann ne se résume pas. Tout y est nuance, allusion discrète. La touche
impressionniste, qui noie les contours des êtres et des choses, donne à l'ensemble du récit une transparence intimiste où chaque geste, chaque futilité du coeur, chaque poussière de vie
s'illumine singulièrement." (Le Livre de Poche, LGF)

"The Echoing Grove" (1953, Le Jour enseveli)
"En publiant en 1953 le Jour enseveli, Rosamond Lehmann mettait un point d'orgue à sa carrière de romancière commencée. Un quart de siècle auparavant avec
Poussière, Anthony Burgess salua ce livre comme un portrait de femme impressionnant qui nous fait - mieux que vingt analyses - comprendre comment nos tourments d'amour naissent d'un impossible
mariage".
















