- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Georges Bernanos (1888-1948), "Sous le soleil de Satan" (1926), "L'Imposture" (1927), "La Joie" (1929), "La Grande Peur des bien-pensants" (1931), "Un Crime" (1935), "Journal d’un curé de campagne" (1936), "Dialogue des Carmélites" (1949) - ....
Last update: 11/11/2016
Fougueux et passionné, Georges Bernanos trouva son accomplissement dans un catholicisme exigeant et tourmenté et dans des activités politiques extrémistes. Ses études à la faculté de Droit et à l'Institut Catholique (1906-1913) coïncident avec les luttes religieuses sous la présidence (du Conseil) d'Emile Combes; c'est aussi l'époque où, dans le prolongement de l'affaire Dreyfus, le poète Déroulède, Barrès, Drumont, théoricien de l'antisémitisme, entretiennent un nationalisme chauvin et raciste. Bernanos a pour maître Maurras et il participe à toutes les turbulences du Quartier latin. La guerre de 1914 où il est blessé et cité alimente sa rancœur contre les impuretés et les scandales du monde moderne. Pamphlétaire-né, il s'en prend tout d'abord au conformisme bourgeois dans sa "Grande peur des bien-pensants" (1931 d'inspiration encore monarchiste. Mais c'est la guerre civile espagnole, dont il fut le témoin direct dans sa résidence de Majorque, qui devait lui arracher les accents les plus authentiques : malgré ses convictions religieuses, il attaque vivement les excès du soulèvement du général Franco ainsi que le clergé espagnol, son complice, dans "Les Grands Cimetières sous la lune" (1938), chef-d'œuvre du genre, qui eut un grand retentissement et qui marque une étape décisive dans l'évolution de sa pensée politique.
Mais ce lutteur toujours sur la brèche, qui devait encore donner de la voix contre les accords de Munich (1938), la politique du gouvernement de Vichy, puis la médiocrité de la IVe République, était aussi un grand romancier. Déjà "L'Imposture" (1927) et "La Joie" (1929) présentaient de façon saisissante les figures antithétiques de l'abbé Cénabre qui a perdu la foi et de Chantal de Clergerie, rayonnante d'une sainteté dont la lumière finira par atteindre Cénabre. Mais le sommet de l'œuvre de Bernanos est constitué par le "Journal d'un curé de campagne" (1936) : dans le décor de son enfance du pays d'Artois, Bernanos met en scène un jeune prêtre qui, comme Chantal de Clergerie, ramène à Dieu des âmes égarées qui semblaient perdues. L'esprit de sainteté et l'esprit d'enfance auxquels Bernanos tenaient tant, sont réunis dans la figure de ce prêtre et expliquent son rayonnement sur les autres personnages qui sont tous à leur façon, dans le bien ou le mal, des âmes d'élite. Bernanos n'était pas à l'aise, spirituellement, dans ce monde. Ou bien il le fustigeait comme polémiste, ou bien il rêvait d'un monde chrétien total, réconcilié avec lui-même et avec Dieu, comme aux plus beaux jours d'une chevalerie idéale dont les hommes ont désespérément perdu le secret ...

"Georges BERNANOS, né à Paris en 1888, d'une origine à la fois espagnole et lorraine, de formation catholique et monarchiste, ancien militant d'Action Française, nationaliste de toujours, lecteur de Léon Bloy, de Drumont, de Veuillot, Georges Bernanos - qui est mort en 1948 - débuta en 1926 par un roman qui fut salué comme un événement littéraire : "Sous le Soleil de Satan". Depuis lors, sa gloire n'a cessé de grandir. Essayiste, chacun de ses livres fit écho à un problème ou à un moment décisif du siècle : condamnant le soulèvement franquiste (Les Grands Cimetières sous la Lune), découvrant l'avilissement de la bourgeoisie française (La Grande Peur des bien-pensants), dénonçant la lâcheté de Munich (Nous autres Français), la honte de l'armistice et de I'occupation (Écrits de Combat). Romancier, nous lui devons I'une des œuvres les plus puissantes de l'époque.
A la différence de Malraux et de Montherlant, de Sartre et de Camus, Bernanos possède les dons traditionnels du romancier : l'imagination portant sur l'événement, sur l'intrigue (après Un Crime et Nouvelle Histoire de Mouchette, Monsieur Ouine est partiellement un roman policier); le pouvoir d'accorder sa narration à l'écoulement de la durée; une sympathie à la fois tendre et virile à l'égard des êtres les plus humbles et les plus éloignés de lui; une lumière, un univers qui est à lui seul.
Mais les romans de Bernanos ne se réduisent jamais à de simples "histoires", ou à des documents psychologiques et sociaux. Servir par la séduction de l'imaginaire une vérité qui est en même temps vision du monde et direction de vie : l'ambition profonde de l'œuvre ne doit pas disparaître derrière ses apparences de tableau des mœurs cléricales. Si Georges Bernanos est le romancier du prêtre, c'est que le prêtre est le héros du drame surnaturel.
Le surnaturel est pour cette œuvre ce que le destin, ou l'histoire, ou la liberté sont pour d'autres : son lieu. C'est la lumière du surnaturel que nous pressentons derrière les ombres fuligineuses du drame terrestre, et qui leur donne leur surprenante grandeur. Et si nul n'est plus éloigné que Bernanos de l'abstraction allégorique, nul ne nous communique plus intimement l'impression que les événements terrestres dont il retrace l'enchaînement ne sont eux-mêmes qu'allusion à une réalité plus secrète.
Il est l'un des metteurs en scène les plus puissants et les plus pathétiques de tout le roman français - et il semble que l'efficacité de certains tableaux s'explique par la seule force dramatique des faits évoqués. Que l'on relise dans Monsieur Ouine, par exemple, le lynchage de Mme de Néréis. Cependant l'impression ne nous quitte jamais que ces scènes, si présentes et si agissantes qu'elles soient, ne sont qu'à demi réelles. Nous ne saisissons que les apparences violentes et confuses d'un drame qui se déroule dans un autre monde ; tout baigne dans une lumière dont nous ne voyons pas la source, comme dans ces toiles de Rembrandt où une bougie invisible bouleverse les apparences coutumières. De cette ambiguïté, de ce double plan des événements, Monsieur Ouine donne une expression saisissante. Tout nous échappe, tout se déroule derrière le rideau : qui a tué le petit Vacher? qui est M. Ouine?... Et comment tout ne plongerait-il pas dans le mystère et l'ombre puisque c'est le salut de l'homme qui est en jeu et que l'issue n'appartient pas au prologue terrestre? Alors que Satan se glisse dans l'âme même du saint, de qui peut-on dire qu'il est sauvé? Et de qui peut-on dire qu'il est perdu, alors que Cénabre lui-même (le héros satanique de L'lmposture et de La Joie) meurt en criant : Pater noster?
Pris entre Dieu et Satan, chaque personnage engage une lutte gigantesque dont l'enjeu est surnaturel : lutte de toutes ses forces contre la fascination du mal, la tient à distance ou se laisse submerger par elle. Et le mal, c'est l'absence de Dieu.
Car Bernanos ne cesse de dénoncer la tradition selon laquelle être chrétien, c'est ne pas pêcher - et ne pas pécher, ne point céder à la chair. La morale, pour lui, n'est pas "une hygiène des sens" - et le crime de Mouchette n'est pas son amant, mais son suicide. Le mal, on le saisit à la source même dans ces existences mystérieuses dont l'effort semble être de
s'exclure de toute relation avec le surnaturel - et, par-là, de toute adhésion profonde à elles-mêmes : car on ne peut s'aimer qu'en Dieu. L'haleine glacée de l'indifférence à soi, de l'indifférence au salut: tel est le mal dont M. Ouine, plus encore que Cénabre, est l'inoubliable incarnation. Mais ce n'est pas pour la dénonciation du mal que la voix de Bernanos est faite :c`est pour la poursuite de Dieu.
Bernanos n'est pas le romancier du péché, comme Mauriac : il est le romancier de la sainteté. Si la paix glacée de Satan tient dans son œuvre une si large place, c'est que la situation du romancier est parallèle à celle du polémiste :le monde actuel, dominé par le mal, contraint à la dénonciation les voix qui sont faites pour l'amour.
De cette œuvre qu'emplissent les tumultes du combat spirituel monte pourtant la simple odeur de la terre - celle de la sueur de l'homme et des labours. Ce lutteur des sommets prend appui sur la réalité la plus familière. Le petit presbytère de campagne, avec le maigre rosier qui orne sa fenêtre; la ferme misérable où hommes et femmes travaillent et meurent avec une mystérieuse patience ; l'école de village d'où reviennent à la nuit les gamins haillonneux ; l'estaminet où l'on boit le genièvre en frôlant la fille de salle; la pièce commune où s'élèvent le cri du nouveau-né rachitique et l'odeur aigre des langes étendus : tel est l'univers dont se détache sans l'ignorer ou le repousser le héros spirituel. Nul n'est plus près de l'humble, de ses pauvres et fiers secrets. C'est que la lumière de la charité transfigure le moindre visage : il suffit de savoir aimer la condition de l'homme dans le dépouillement de son humilité.
Mais l'angoisse, elle aussi, a sa lumière, qui croise ses rayons troubles avec ceux de la charité. Dans chaque livre de Bernanos, un homme se souvient de l'effroi de son enfance. Ce sont toujours les routes nocturnes sur lesquelles le voyageur s'égare, avec les haies, les chênes tordus, les flaques où l'on glisse sous la pluie furieuse, dans le grand vent des Flandres venu de la mer : et arrive toujours ce moment où l'on tombe, où l'on croit mourir, pour se réveiller à la lueur d'une lanterne inconnue. La ronde fantastique des ombres dans le vent appartient au tissu profond de cet univers visionnaire, autant que le souvenir de ce coin d'estaminet où l'enfant oublié voit se lever le soleil de la luxure sur le visage des hommes ivres. C'est sur la boue et les ténèbres des chemins de la terre que brillent les éclairs du drame surnaturel.
Pour beaucoup, cependant, Bernanos est avant tout un "directeur de conscience" - l'auteur de quelques essais où la dénonciation du monde contemporain est poussée jusqu'à son extrême limite. Les romans se raréfient, à mesure que les essais deviennent plus fréquents : après "Le Journal d'un Curé de campagne" (1936), il faut attendre "Monsieur Ouine" (1946).
Mais à partir des "Grands Cimetières sous la Lune" (1938) paraissent "Scandale de la Vérité", "Nous autres Français" (1939) et, de 1940 à 1947, "La Lettre aux Anglais", les "Écrits de Combat", les "Réflexions sur le cas de conscience français", "La France contre les Robots".
ll peut paraître surprenant, toutefois, qu'une œuvre allant à ce point à contre-courant ait pris une telle importance. Car, de son temps, il n'est rien que Bernanos accepte, rien qui ne le blesse et ne le dresse, qui n'appelle en lui colère et dégoût. Chrétien dans un monde sans Christ et sans Dieu; monarchiste dans une époque qui n'hésite plus qu'entre démocratie et totalitarisme ; aristocrate sous le règne de la masse ou du parti ; individualiste dans l'apothéose du collectif; chevaleresque au temps de la resquille et de l'égoïsme; traditionaliste dans un monde de plus en plus détaché du passé; vieil Européen dans le déclin de l'Europe; soldat parmi des militaires; homme parmi les robots : comment attendre une règle de vie d'une pensée à ce point étrangère?...
Mais n'est-ce pas à cette opposition qu'elle a dû de découvrir avant d'autres le visage du malheur qui est celui de ce siècle ? Si les premiers essais de Bernanos ont pris une actualité extraordinaire, c'est sans doute qu'ils sont la prophétie pathétique des catastrophes qu'une illusoire prospérité nous dissimulait : devinant l'odeur future des charniers comme il arrive de sentir, au plus profond de l'hiver, "le parfum des haies d'aubépines encore nues pourtant sous la neige". Et s'il y a en Bernanos un enfant déçu par le monde des adultes se rejetant vers les images qui tirent la magie et la sécurité de son passé - saint Louis sous son chêne, Bayard mourant, Jeanne au sacre de Reims, - la rêverie n'est pas son dernier mot.
Plus qu'un rêveur, il est un dénonciateur, un combattant, un guide. Sa violence même serait inexplicable, sans l'espoir d'arracher à la catastrophe de ce temps les quelques hommes libres qui demeurent, et de sauver en leur personne I 'ultime honneur humain. En dépit de tout, Bernanos demeure l'homme du pourquoi pas? - de la lutte et de l'espoir. Sa voix n'est ni brisée ni plaintive : elle nous soufflette, nous exalte, nous arrache au sommeil de la démission. Pour reprendre une expression familière, où Bernanos se révèle tout entier, elle nous permet de faire face...." (Gaëtan Picon, Panorama de la Nouvelle Littérature française, Nrf)
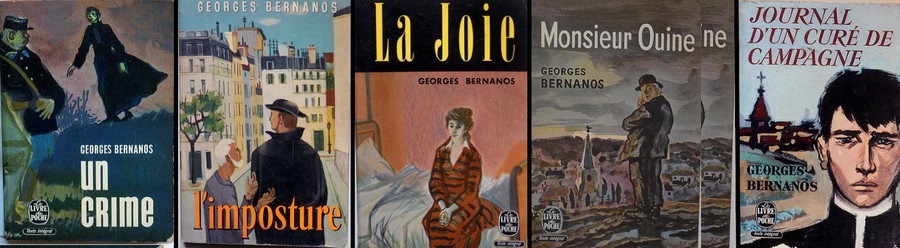

Georges Bernanos (1888-1948)
"Nos fautes cachées empoisonnent l'air que d'autres respirent.. " Epris de grandeur, assoiffés d’idéal les héros de
Bernanos font l’expérience d’une révolte qui peut prendre des formes diverses. Mais surtout, pour Georges Bernanos, l'homme est en butte aux puissances du mal, il est l'enjeu et le théâtre d'un
combat entre Satan et Dieu.
Après des études de droit et de lettres, Georges Bernanos milite chez 'Les Camelots du roi', ligue d'extrême-droite et collabore à divers journaux
monarchistes, avant d'en diriger un à Rouen. Décoré après la Première Guerre mondiale, il se marie et devient inspecteur des assurances à La Nationale. Durant ses tournées, il rédige "Sous le
soleil de Satan" dont le succès est éclatant, et lui permet, au seuil de la quarantaine, de se consacrer entièrement à la littérature. Il obtient le Prix Femina en 1929 pour "La Joie" puis
connaît sa plus grande fécondité littéraire lors de son séjour à Majorque entre 1934 et 1937. Le Grand prix du roman de l'Académie française récompense "Le Journal d'un curé de campagne" en
1936. Surpris par la guerre d'Espagne, ses sympathies politiques l'inclinent à soutenir les insurgés franquistes, mais les horreurs de
la répression à Majorque et le rôle joué par certains prélats l"accablent profondément : il écrit sa grande oeuvre vengeresse qui en appelle à la conscience des catholiques, "Les Grands
Cimetières sous la lune". Il revient en France puis s'embarque pour le Paraguay et le Brésil, où il achève en 1940 "Monsieur Ouine". Lorsque
la guerre éclate en Europe, il multiplie les articles dans la presse brésilienne et devient l'un des plus grands animateurs spirituels de la Résistance française. Son journal de l'année
1939-1940, "Les Enfants humiliés" est un de ses plus beaux livres. Si ses personnages se débattent dans un monde de boue et de ténèbres,
mais refuse la misère et le désespoir, Bernanos sait aussi s'en prendre directement au conformisme mou des bien-pensants (La Grande peur des biens-pensants, 1931). C'est en Tunisie, où il
s'est réfugié, qu'il écrit son dernier chef d'oeuvre, "Dialogue des Carmélites".

1926 - Sous le soleil de Satan
Dès sa première oeuvre Bernanos affirme toute la puissance de son style et ses thèmes de prédilection : autour du personnage central de l'abbé Donissan, jeune
prêtre tourmenté par la chair et par l'impiété de sa paroisse, une galerie de personnages brûlés par la souffrance et le mal. Germaine Malhorty, ou Mouchette, par révolte, petite provinciale qui
s'ennuie, se donne à l'aristocrate et marquis de Cardignan. Enceinte et repoussée, elle fait croire qu'elle est la maîtresse du docteur Gallet, député et bourgeois libidineux qui le convoite
depuis longtemps. Elle tue l'aristocrate, se donne au docteur Gallet, veut l'entraîner dans son crime, crime dont personne ne la soupçonne. La voici enfermée dans son drame, "mystique ingénue et
petite servante de Satan", et entre en scène l'abbé Donissan qui la délivre de sa possession et ramène dans l'église, au grand scandale de ses paroissiens, le corps agonisant de Mouchette.. Satan
devient ici une présence visible et charnelle, le nier, pour Bernanos, serait nier toute vie intérieure.
".. Si son amour-propre eût été moins profondément blessé, Malorthy se fût décidé sans doute à rendre bon compte à sa femme de sa visite au château. Il pensa mieux faire en dissimulant quelque temps encore son inquiétude et son embarras, dans un silence altier, plein de menaces. D’ailleurs, il voulait sa revanche et pensait l’obtenir aisément, par un coup de théâtre domestique, dont sa fille eût fait les frais. Pour beaucoup de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, puisqu’elle met à leur disposition, et comme à portée de la main, un petit nombre d’êtres faibles, que le plus lâche peut effrayer. Car l’impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d’autrui. C’est pourquoi, sitôt le souper achevé, Malorthy, tout à coup, de sa voix de commandement :
– Fillette, dit-il, j’ai à te parler… Germaine leva la tête, reposa lentement son tricot sur la table, et attendit.
– Tu m’as manqué, continua-t-il sur le même ton, gravement manqué… Une fille qui faute, dans la famille, c’est comme un failli…, tout le monde peut nous montrer demain du doigt, nous, des gens sans reproche, qui font honneur à leurs affaires, et ne doivent rien à personne. Hé bien ! au lieu de nous demander pardon, et d’aviser avec nous, comme ça se doit, qu’est-ce que tu fais ? Tu pleures à t’en faire mourir, tu fais des oh ! et des ah ! voilà pour les jérémiades. Mais pour renseigner ton père et ta mère, rien de fait. Silence et discrétion, bernique ! Ça ne durera pas un jour de plus, conclut-il en frappant du poing sur la table, ou tu sauras comment je m’appelle ! Assez pleuré ! Veux-tu parler, oui ou non ?
– Je ne demande pas mieux, répondit la pauvrette, pour gagner du temps.
La minute qu’elle attendait, en la redoutant, était venue, elle n’en doutait pas ; et voilà qu’à l’instant décisif les idées qu’elle avait mûries en silence, depuis une semaine, se présentaient toutes à la fois, dans une confusion terrible.
– J’ai vu ton amant tout à l’heure, poursuivit-il ; de mes yeux vu… Mademoiselle s’offre un marquis ; on rougit de la bière du papa… Pauvre innocente qui se croit déjà dame et châtelaine, avec des comtes et des barons, et un page pour lui porter la queue de sa robe !… Enfin nous avons eu un petit mot ensemble, lui et moi. Voyons si nous sommes d’accord : tu vas me promettre de filer droit, et d’obéir les yeux fermés.
Elle pleurait à petits coups, sans bruit, le regard clair à travers ses larmes. L’humiliation qu’elle avait crainte par avance ne l’effrayait plus. « J’en mourrai de honte, sûr ! » se répétait-elle la veille encore, attendant d’heure en heure un éclat. Et maintenant elle cherchait cette honte, et ne la trouvait plus.
– M’obéiras-tu ? répétait Malorthy. – Que voulez-vous que je fasse ? fit-elle.
Il réfléchit un moment : – M. Gallet sera demain ici.
– Pas demain, interrompit-elle…, le jour du franc marché : samedi. Malorthy la contempla une seconde, bouche bée.
– Je n’y pensais plus, en effet, dit-il. Tu as raison, samedi. Elle avait fait cette remarque d’une voix nette et posée que son père ne connaissait pas. Au coin du feu la vieille mère en reçut le choc, et gémit.
– Samedi… bon ! Je dis samedi, continua le brasseur, qui perdait le fil de discours. Gallet, c’est un garçon qui connaît la vie. Il a des scrupules et du sentiment… Garde tes larmes pour lui, ma fille ! Nous irons le trouver ensemble.
– Oh ! non…, fit-elle. Parce que les dés étaient jetés, en pleine bataille, elle se sentait si libre, si vivante ! Ce non, sur ses lèvres lui parut aussi doux et aussi amer qu’un premier baiser. C’était son premier défi.
– Par exemple ! tonna le bonhomme.
– Voyons, Antoine ! disait maman Malorthy, laisse-lui le temps de respirer ! Que veux-tu qu’elle dise à ton député, cette jeunesse ?
– La vérité, sacrebleu ! s’écria Malorthy. D’abord mon député est médecin, une ! Si l’enfant naît hors mariage, nous aurons un mot de lui pour une maison d’Amiens, deux ! D’ailleurs un médecin, c’est l’instruction, c’est la science…, ce n’est pas un homme. C’est le curé du républicain. Et puis vous me faites rire avec vos secrets ! Crois-tu que le marquis parlera le premier ? La petite n’avait pas l’âge, à l’époque, c’est peut-être un détournement, ça pourrait le mener loin ! On l’y traînera, en cour d’assises, tonnerre ! Ça garde des grands airs, ça vous prend pour un imbécile, ça nie l’évidence, ça ment comme ça respire, un marquis en sabots !… Malheureuse ! cria-t-il en se retournant vers sa fille, il a porté la main sur ton père ! Il n’avait pas prémédité ce dernier mensonge, qui n’était qu’un trait d’éloquence. Le trait, d’ailleurs, manqua son but. Le cœur de la petite révoltée battit plus fort, moins à la pensée de l’outrage fait à son seigneur maître, qu’à l’image entrevue du héros, dans sa magnifique colère… Sa main ! Cette terrible main !… Et d’un regard perfide, elle en cherchait la trace sur le visage paternel.
– Laisse-moi un moment, dit alors la vieille Malorthy, quitte-moi parler !… Elle prit la tête de sa fille entre ses deux mains. – Pauvre sotte, fit-elle, à qui veux-tu avouer la vérité, sinon à ton père et à ta mère ? Quand je me suis doutée de la chose, il était déjà trop tard, mais depuis ! À présent, tu sais ce qu’elles valent, les promesses des hommes ? Tous des menteurs, Germaine ! La demoiselle Malorthy ?… fi donc ! Je ne la connais pas ! Et tu ne serais pas assez fière pour lui faire rentrer son mensonge dans la gorge ? Tu laisseras croire que tu t’es donnée à un gars de rien, à un valet, à un chemineau ? Allons, avoue-le ! Il t’a fait promettre de ne rien dire ?… Il ne t’épousera pas, ma fille ! Veux-tu que je te dise, moi ? Son notaire de Montreuil a déjà l’ordre de vente de la ferme des Charmettes, moulin et tout. Le château y passera comme le reste..."

"Voici l’heure du soir qu’aima P. J. Toulet. Voici l’horizon qui se défait — un grand nuage d’ivoire au couchant et, du zénith au sol, le ciel crépusculaire, la solitude immense, déjà glacée, — plein d’un silence liquide… Voici l’heure du poète qui distillait la vie dans son cœur, pour en extraire l’essence secrète, embaumée, empoisonnée. Déjà la troupe humaine remue dans l’ombre, aux mille bras, aux mille bouches ; déjà le boulevard déferle et resplendit… Et lui, accoudé à la table de marbre, regardait monter la nuit, comme un lis. Voici l’heure où commence l’histoire de Germaine Malorthy, du bourg de Terninques, en Artois...."
Le livre s`ouvre par un long Prologue. sous forme de récit, dont on voit d'abord assez mal les liens avec le reste de l`œuvre. Une petite provinciale s`ennuie : mais, par ce banal sentiment, c'est la tragédie surnaturelle de la possession qui va s'engouffrer et emporter Germaine Malhorty, dite Mouchette. Par esprit d'aventure, par révolte contre une vie quotidienne, Mouchette s'est donnée à un aristocrate, le marquis de Cadignan. Enceinte, elle se voit aussitôt repoussée par le hobereau : pour se venger, elle lui fait croire (à tort) qu'elle est la maîtresse du docteur Gallet, député de la contrée, bourgeois libidineux qui tourne depuis longtemps autour d`elle. Puis, au cours d'une scène suffisamment confuse pour que tout le monde croie ensuite à un accident, Mouchette tue le marquis. Devenue la maîtresse du docteur Gallet. qu'elle prie en vain de la faire avorter. Mouchette avoue son crime, veut forcer son nouvel amant à partager son secret ...
"Mais à la pensée de suivre bientôt la capricieuse enfant dans son mensonge, de tenir son rôle devant l’ennemie sceptique et sournoise, sa langue collait au palais. C’est alors que tout à coup, cherchant encore le regard de Mouchette, il ne le trouva plus. Les yeux perfides considéraient le mur au-dessus de lui, déjà mûrs d’un nouveau secret. Il eut le pressentiment, la certitude d’un malheur désormais inévitable. Son vice était là, devant lui, en pleine lumière, évident, éclatant, et il avait voulu près de lui ce témoin irrécusable ! Si la peur ne l’eût cloué sur place, il eût sans doute, à ce moment, jeté Mouchette par la fenêtre. Il eût sauté dessus, comme on piétine une mèche allumée, près de la soute aux poudres. Mais il était trop tard. L’affreuse résignation du lâche le livrait sans défense à sa familière ennemie. ... . Comment livrer ce secret, sans se livrer ? ..."
Et, comme celui-ci se défend par l'incrédulité, Mouchette, brusquement frappée d`une crise d`hystérie, donne naissance à un enfant mort-né. Cette impuissance où elle se trouve à livrer son âme, ce refus de tout le monde à croire à son crime, qui la rend prisonnière de son acte, tels sont les signes de la possession diabolique, comme semble suggérer Bernanos. Désormais. il y a une part d`elle-même qui est soustraite aux hommes et à Dieu ...

Alors commence la seconde partie. d`apparence toute différente : l`auteur met en effet en scène un vicaire de campagne, personne rude et sauvage, âme inquiète, bourreau d`ascétisme, tenu en grande méfiance par ses supérieurs, l`abbé Donissan. Par une bien étrange nuit de cauchemar, sur la route d'Etaples. le prêtre se trouve bientôt égaré hors de l'univers habituel. ll est alors recueilli par un brave homme de maquignon, d'une cordiale vulgarité.
La conversation s`engage, au cours de laquelle l`abbé Donissan reconnaît avec horreur dans son interlocuteur le Malin lui-même. qui lui témoigne une odieuse tendresse. ll est heureusement sauvé par l`arrivée d`un paysan de connaissance.
Mais le prêtre rencontrera Mouchette : possédant le don de lire les âmes, il sait faire dire à celle-ci le secret qui est le nœud de sa possession. Il lui enlève l`orgueil de sa faute; ...
"Ils se trouvèrent de nouveau face à face, comme au premier moment de leur rencontre. La triste aurore errait dans le ciel, et la haute silhouette du vicaire parut à Mlle Malorthy plus haute encore, lorsque, d’un geste souverain, d’une force et d’une douceur inexprimables, il s’avança vers elle et, tenant levée sur sa tête sa manche noire :
— Ne vous étonnez pas de ce que je vais dire : n’y voyez surtout rien de capable d’exciter l’étonnement ou la curiosité de personne. Je ne suis moi-même qu’un pauvre homme. Mais, quand l’esprit de révolte était en vous, j’ai vu le nom de Dieu écrit dans votre cœur.
Et, baissant le bras, il traça du pouce, sur la poitrine de Mouchette, une double croix.
Elle fit un bond léger en arrière, sans trouver une parole, avec un étonnement stupide. Et quand elle n’entendit plus en elle-même l’écho de cette voix dont la douceur l’avait transpercée, le regard paternel acheva de la confondre. Si paternel !… (Car il avait lui-même goûté le poison et savouré sa longue amertume)
La langue humaine ne peut être contrainte assez pour exprimer en termes abstraits la certitude d’une présence réelle, car toutes nos certitudes sont déduites, et l’expérience n’est pour la plupart des hommes, au soir d’une longue vie, que le terme d’un long voyage autour de leur propre néant. Nulle autre évidence que logique ne jaillit de la raison, nul autre univers n’est donné que celui des espèces et des genres. Nul feu, sinon divin, qui force et fonde la glace des concepts. Et pourtant ce qui se découvre à cette heure au regard de l’abbé Donissan n’est point signe ou figure : c’est une âme vivante, un cœur pour tout autre scellé ! Pas plus qu’à l’instant de leur extraordinaire rencontre, il ne serait capable de justifier par des mots la vision extérieure d’un éclat toujours égal, ce qui se confond avec la lumière intérieure dont il est lui-même saturé. La première vision de l’enfant est mêmement si pleine et si pure que l’univers dont il vient de s’emparer ne saurait se distinguer d’abord du frémissement de sa propre joie. Toutes les couleurs et toutes les formes s’épanouissent à la fois dans son rire triomphal.
Quand on l’interrogeait plus tard sur ce don de lire dans les âmes, il niait d’abord et presque toujours obstinément. Parfois aussi, craignant de mentir, il s’en expliqua plus clairement, mais avec un tel scrupule, une recherche de précision si naïve que sa parole était souvent pour les curieux une déception nouvelle. Ainsi quelque dévot villageois interpréterait l’extase et l’union en Dieu de sainte Thérèse ou de saint Jean de La Croix. C’est que la vie n’est confusion et désordre que pour qui la contemple du dehors. Ainsi l’homme surnaturel est à l’aise si haut que l’amour le porte et sa vie spirituelle ne comporte aucun vertige sitôt qu’il reçoit les dons magnifiques, sans s’arrêter à les définir et sans chercher à les nommer.
Que voyez-vous ? demandait-on au saint homme. Quand voyez-vous ? Quel avertissement ? Quel signe ? Et il répétait d’une voix d’enfant studieux auquel échappe le mot du rudiment : « J’ai pitié… J’ai seulement pitié !… » Quand il avait rencontré Mlle Malorthy sur le bord du chemin, ne voyant devant lui qu’une ombre presque indiscernable, une violente pitié était déjà dans son cœur. N’est-ce point ainsi qu’une mère s’éveille en sursaut, sachant de toute certitude que son enfant est en péril ? La charité des grandes âmes, leur surnaturelle compassion semblent les porter d’un coup au plus intime des êtres. La charité, comme la raison, est un des éléments de notre connaissance. Mais si elle a ses lois, ses déductions sont foudroyantes, et l’esprit qui les veut suivre n’en aperçoit que l’éclair.
Le regard que l’homme de Dieu tenait baissé sur Mouchette, à toute autre, peut-être, eût fait plier les genoux. Et il est vrai qu’elle se sentit, pour un moment, hésitante et comme attendrie. Mais alors un secours lui vint — jamais vainement attendu — d’un maître de jour en jour plus attentif et plus dur ; rêve jadis à peine distinct d’autres rêves, désir plus âpre à peine, voix entre mille autres voix, à cette heure réelle et vivante ; compagnon et bourreau, tour à tour plaintif, languissant, source des larmes, puis pressant, brutal, avide de contraindre, puis encore, à la minute décisive, cruel, féroce, tout entier présent dans un rire douloureux, amer, jadis serviteur, maintenant maître.
Cela jaillit d’elle tout à coup. Une colère aveugle, une rage de défier ce regard, de lui fermer son âme, d’humilier la pitié qu’elle sentait sur elle suspendue, de la flétrir, de la souiller. Son élan la jeta, toute frémissante, non pas aux pieds, mais face au juge, dans son silence souverain.
Elle ne trouvait d’abord aucun mot ; en était-il pour exprimer ce transport sauvage ? Elle repassait seulement dans son esprit, mais avec une rapidité et une netteté surhumaine, les déceptions capitales de sa courte vie, comme si la pitié de ce prêtre en était le terme et le couronnement… Elle put articuler enfin, d’une voix presque inintelligible :
— Je vous hais !
— N’ayez pas honte, dit-il.
— Gardez vos conseils, cria Mouchette. (Mais il avait frappé si juste que sa colère en fut comme trompée.) Je ne sais même pas ce que vous voulez dire !
— Assurément, d’autres épreuves vous attendent, continua-t-il, plus rudes… Quel âge avez-vous ? demanda-t-il après un silence.
Depuis un moment le regard de Mouchette trahissait une surprise, déjà déçue. À ce dernier mot, par un violent effort, elle sourit.
— Vous devez le savoir, vous qui savez tant de choses…
— Jusqu’à ce jour vous avez vécu comme une enfant. Qui n’a pas de pitié d’un petit enfant ? Et ce sont les pères de ce monde ! Ah ! voyez-vous. Dieu nous assiste jusque dans nos folies. Et, quand l’homme se lève pour le maudire, c’est Lui seul qui soutient cette main débile !
— Un enfant, fit-elle, un enfant ! Des enfants de chœur comme moi, vous n’en rencontrerez pas beaucoup dans vos sacristies : ils n’useront pas votre eau bénite. Les chemins où j’ai passé, souhaitez ne les connaître jamais.
Elle prononça ces derniers mots avec une emphase un peu comique. Il répondit tranquillement :
— Qu’avez-vous donc trouvé dans le péché qui valût tant de peine et de tracas ? Si la recherche et la possession du mal comporte quelque horrible joie, soyez bien sûre qu’un autre l’exprima pour lui seul, et la but jusqu’à la lie.
L’abbé Donissan fit encore un pas vers elle. Rien dans son attitude n’exprimait une émotion excessive, ni le désir d’étonner. Et pourtant les paroles qu’il prononça clouèrent Mouchette sur place, et retentirent dans son cœur.
— Laissez cette pensée, dit-il. Vous n’êtes point devant Dieu coupable de ce meurtre. Pas plus qu’en ce moment-ci votre volonté n’était libre. Vous êtes comme un jouet, vous êtes comme la petite balle d’un enfant, entre les mains de Satan.
Il ne lui laissa pas le temps de répondre et d’ailleurs elle ne trouvait pas un mot. Il l’entraînait déjà, tout en parlant, sur la route de Desvres, à grands pas, dans les champs déserts. Elle le suivait. Elle devait le suivre. Il parlait, comme il n’avait jamais parlé, comme il ne parlerait plus jamais, même à Lumbres et dans la plénitude de ses dons, car elle était sa première proie. Ce qu’elle entendait, ce n’était pas l’arrêt du juge, ni rien qui passât son entendement de petite bête obscure et farouche, mais avec une terrible douceur, sa propre histoire, l’histoire de Mouchette non point dramatisée par le metteur en scène, enrichie de détails rares et singuliers — mais résumée au contraire, réduite à rien, vue du dedans. Que le péché qui nous dévore laisse à la vie peu de substance ! Ce qu’elle voyait se consumer au feu de la parole, c’était elle-même, ne dérobant rien à la flamme droite et aiguë, suivie jusqu’au dernier détour, à la dernière fibre de chair. À mesure que s’élevait ou s’abaissait la voix formidable, reçue dans les entrailles, elle sentait croître ou décroître la chaleur de sa vie, cette voix d’abord distincte, avec les mots de tous les jours, que sa terreur accueillait comme un visage ami dans un effrayant rêve, puis de plus en plus confondue avec le témoignage intérieur, le murmure déchirant de la conscience troublée dans sa source profonde, tellement que les deux voix ne faisaient plus qu’une plainte unique, comme au seul jet de sang vermeil.
Mais quand il fit silence, elle se sentit vivre encore...."
... mais à cette âme, maintenant "dépouillée de tout, même de son crime", il ne reste plus qu'à se tuer, et l'abbé, au grand scandale de ses paroissiens, ramène dans l'église le corps de l'agonisante ...
".. Comment les rapporterait-on ici ? C’était encore l’histoire de Mouchette, merveilleusement confondue avec d’autres vieilles histoires oubliées depuis longtemps, à moins qu’elles n’eussent été jamais connues. Avant qu’elle en comprît le sens, Mouchette sentit son cœur se serrer, comme à une brusque descente, et cette surprise qui fait hésiter le plus étourdi, au seuil d’une demeure profonde et secrète. Puis ce fut des noms entendus, familiers, ou seulement pleins d’un souvenir vague, de plus en plus nombreux, s’éclairant l’un par l’autre, jusqu’à ce que la trame même du récit apparût en dessous. Humbles faits de la vie quotidienne, sans aucun éclat, pris dans la malice la plus commune — comme des cailloux dans leur gaine de boue, — mornes secrets, mornes mensonges, mornes radotages du vice, mornes aventures qu’un nom soudain prononcé illuminait comme un phare, puis retombant dans des ténèbres où l’esprit n’eût rien distingué encore mais qu’une espèce d’horreur sacrée dénonçait comme un grouillement de vies obscures.
Tandis que Mouchette, une fois de plus, se sentait entraînée malgré sa volonté et sa raison, c’était cette horreur même qui vivait et pensait pour elle. Car, à la frontière du monde invisible, l’angoisse est un sixième sens, et douleur et perception ne font qu’un. Ces noms, que prononçait l’un après l’autre la voix redevenue souveraine, elle les reconnaissait au passage, mais pas tous. C’étaient ceux des Malorthy, des Brissaut, des Paully, des Pichon, aïeux et aïeules, négociants sans reproche, bonnes ménagères, aimant leur bien, jamais décédés intestats, honneur des Chambres de commerce et des études de notaires. (Ta tante Suzanne, ton oncle Henri, tes grand’mères Adèle et Malvina ou Cécile…) Mais ce que la voix racontait, d’un accent tout uni, peu d’oreilles l’entendirent jamais — l’histoire saisie du dedans — la plus cachée, la mieux défendue, et non point telle quelle, dans l’enchevêtrement des effets et des causes, des actes et des intentions, mais rapportée à quelques faits principaux, aux fautes mères. Et certes l’intelligence de Mouchette, à elle seule, n’eût saisi que peu de choses d’un tel récit, dont l’effrayante ellipse eût déçu de plus lucides. Où la voix trouvait son écho, n’était-ce pas dans sa chair même, que chacune de ces fautes avait marquée, affaiblie à l’instant même qu’elle fût conçue ?
À voir peu à peu ces morts et ces mortes sortir tout nus de leur linceul, elle ne sentait même rien qu’on pût appeler surprise. Elle écoutait cette révélation surhumaine, d’un cœur abîmé d’angoisse, toutefois sans véritable curiosité ni stupeur. Il semblait qu’elle l’eût déjà entendue, ou mieux encore. Mensonges calomnieux, haines longuement nourries, amours honteuses, crimes calculés de l’avarice et de la haine, tout se reformait en elle à mesure, comme se reforme, à l’état de veille, une cruelle image du rêve. Jamais, non jamais ! morts ne furent si brutalement tirés de leur poussière, jetés dehors, ouverts. À un mot, à un nom soudain prononcé, ainsi qu’à la surface une bulle de boue, quelque chose remontait du passé au présent — acte, désir, ou parfois, plus profonde et plus intime, une seule pensée (car elle n’était pas morte avec le mort), mais si intime, si profonde, si sauvagement arrachée que Mouchette la recevait avec un gémissement de honte.
Elle ne distinguait plus la voix impitoyable de sa propre révélation intérieure, mille fois plus riche et plus ample. D’ailleurs plus rapides qu’aucune parole humaine, ces fantômes innombrables qui se levaient de toutes parts n’eussent pu seulement être nommés ; pourtant, comme à travers un orage de sons monte la dominante irrésistible, une volonté active et claire achevait d’organiser ce chaos. En vain Mouchette, dans un geste de défense naïve, levait vers l’ennemi ses petites mains. Tandis qu’un autre songe, sitôt fixé de sang-froid, se dérobe et se disperse, celui-ci se rapprochait d’elle, ainsi qu’une troupe qui se rassemble pour charger. La foule, un instant plus tôt si grouillante, où elle avait reconnu tous les siens, se rétrécissait à mesure. Des visages se superposaient entre eux, ne faisaient plus qu’un visage, qui était celui même d’un vice. Des gestes confus se fixaient dans une attitude unique, qui était le geste du crime. Plus encore : parfois le mal ne laissait de sa proie qu’un amas informe, en pleine dissolution, gonflé de son venin, digéré. Les avares faisaient une masse d’or vivant, les luxurieux un tas d’entrailles. Partout le péché crevait son enveloppe, laissait voir le mystère de sa génération : des dizaines d’hommes et de femmes liés dans les fibres du même cancer, et les affreux liens se rétractant, pareils aux bras coupés d’un poulpe, jusqu’au noyau du monstre même, la faute initiale, ignorée de tous, dans un cœur d’enfant…
Et, soudain, Mouchette se vit comme elle ne s’était jamais vue, pas même à ce moment où elle avait senti se briser son orgueil : quelque chose fléchit en elle d’un plus irréparable fléchissement, puis s’enfonça d’une fuite obscure. La voix, toujours basse, mais d’un trait vif et brûlant, l’avait comme dépouillée, fibre à fibre. Elle doutait d’être, d’avoir été. Toute abstraction, dans son esprit, prend une forme, et peut être serrée sur la poitrine ou repoussée. Que dire de ce fléchissement de la conscience même ! Elle s’était reconnue dans les siens et, au paroxysme du délire, ne se distinguait plus du troupeau. Quoi ! pas un acte de sa vie qui n’eût ailleurs son double ? Pas une pensée qui lui appartînt en propre, pas un geste qui ne fût dès longtemps tracé ? Non point semblables, mais les mêmes ! Non point répétés, mais uniques. Sans qu’elle pût retracer en paroles intelligibles aucune des évidences qui achevaient de la détruire, elle sentait dans sa misérable petite vie l’immense duperie, le rire immense du dupeur. Chacun de ces ancêtres dérisoires, d’une monotone ignominie, ayant reconnu et flairé en elle son bien, venait le prendre ; elle abandonnait tout. Elle livrait tout et c’était comme si ce troupeau était venu manger dans sa main sa propre vie. Que leur disputer ? Que reprendre ? Ils avaient jusqu’à sa révolte même.
Alors elle se dressa, battant l’air de ses mains, la tête jetée en arrière, puis d’une épaule à l’autre, absolument comme un noyé qui s’enfonce...."
Alors seulement le Prologue prend son sens : les destinées de Mouchette et du vicaire. si lointaines aux yeux des hommes, étaient en réalité surnaturellement liées : les difficultés, l`angoisse de l`abbé Donissan apparaissent comme un mystérieux contrecoup de la possession de Mouchette et peut-être le prix auquel devait être acheté le salut de cette âme. Dès son premier roman, Bernanos faisait ainsi une place essentielle au dogme de la communion des saints. du rachat réciproque des fautes; de même que dans "La Joie" Chantal sera sacrifiée pour le rachat de l'abbé Cénabre de "L`Imposture".

Dans la troisième et dernière partie, nous retrouvons l'abbé Donissan devenu curé de Lumbres et auréolé d`une réputation de sainteté, bien que ses scrupules religieux ne l`aient point quitté et qu'ils aient même augmenté. La vocation particulière de l'abbé est d'avoir une conscience aiguë de l'action de Satan sur les âmes; de cette action. les saints sont peut-être les objectifs de prédilection. Mais le risque existe pour toutes les créatures, il réside jusque dans les actes qui ont la plus sainte apparence. Satan, le "saint" de Lumbres, ne cesse point de le rencontrer ...
"Son rire ! voici l’arme du prince du monde. Il se dérobe comme il ment, il prend tous les visages, même le nôtre. Il n’attend jamais, il ne fait ferme nulle part. Il est dans le regard qui le brave, il est dans la bouche qui le nie. Il est dans l’angoisse mystique, il est dans l’assurance et la sérénité du sot… Prince du monde ! Prince du monde !"
A travers nous, c`est Dieu lui-même que Satan cherche à atteindre, et l'abbé Donissan s`est persuadé qu`il avait, avec l`ennemi. un combat personnel à mener ...
"Dieu m`a inspiré cette pensée qu`il me marquait ainsi ma vocation, que je devais poursuivre Satan dans les âmes et que j'y compromettrai infailliblement mon repos. mon honneur sacerdotal et mon salut même".
Après avoir essayé de ressusciter un enfant, le curé de Lumbres, assailli par les pénítents, vénéré par la foule, mourra foudroyé par une crise cardiaque. ...

1927 – L’imposture
"Pernichon, chrétien médiocre, folliculaire ambitieux, s'entretient avec l'abbé Cénabre. Chanoine admiré, celui-ci est un être supérieur sur le plan de
l'intelligence - mais dévoré par l'orgueil et l'hypocrisie, il ne croit plus depuis longtemps. Dans un geste satanique, il appelle en pleine nuit l'humble abbé Chevance, ancien curé, destitué, de
Costerel-sur-Meuse. Il prétend vouloir se confesser, en fait il souhaite se moquer de cet être fragile dont la pureté l'inquiète. À la suite de leur entrevue, il tente de se suicider, mais en
vain: son revolver s'enraye... Ce roman composé de plusieurs fragments indépendants, sans intrigue véritablement construite, met principalement en scène deux personnages résolument opposés,
Cénabre et Chevance, le noir et le blanc, ainsi que Chantal, la pure et mystique jeune fille, qui prendra une grande importance dans le second opus de ce diptyque, "La joie". Il nous propose
aussi une galerie de portraits traités par Bernanos avec une magistrale ironie. Un drame spirituel unique se joue: celui d'un prêtre et peut-être aussi de toute une société qui a perdu ou qui n'a
jamais connu la foi..."
"Mon cher enfant, dit l’abbé Cénabre, de sa belle voix lente et grave, un certain attachement aux biens de ce monde est légitime, et leur défense contre les entreprises d’autrui, dans les limites de la justice, me semble un devoir autant qu’un droit. Néanmoins, il convient d’agir avec prudence, discrétion, discernement… La vie chrétienne dans le siècle est toute proportion, toute mesure : un équilibre… On ne résiste guère à ces violences selon la nature, mais nous pouvons en régler le cours avec beaucoup de patience et d’application… Ne défendons que l’indispensable, sans prévention contre personne. À ce prix notre cœur gardera la paix, ou la retrouvera s’il l’a perdue.
– Je vous remercie, dit alors M. Pernichon, avec l’accent d’une émotion sincère. La lutte pour les idées nous échauffe parfois, je l’avoue. Mais l’exemple de votre vie et de votre pensée est un grand réconfort pour moi. (Il parlait ainsi la bouche encore tirée par une grimace convulsive, qui faisait trembler sa barbe.)
– J’accorde, reprit-il, que le rapport annuel eût pu être confié à un autre que moi. Il y a des confrères plus qualifiés. Par exemple, j’aurais cédé volontiers la place au vénérable doyen de la presse catholique, s’il n’avait décliné dès le premier jour un honneur qui lui revenait de droit… Pouvions-nous réellement supposer que l’effacement volontaire du vieux lutteur aurait cette conséquence d’élever un Larnaudin sur le pavois ?
Son regard exprimait une véritable détresse, l’anxiété d’une douleur physique, comme si le malheureux eût vainement cherché à suer sa haine.
– Je n’ai aucune prévention contre M. Larnaudin, fit de nouveau la belle voix lente et grave. Je l’estimerais plutôt. De ses critiques même injustes, j’ai toujours tiré quelque profit. Hé quoi ! mon ami : les doctrinaires ont cela de bon qu’ils réveillent, par contraste, certaines facultés que l’usage et l’expérience de la vie affaiblissent en nous. Ils nous fournissent de repères utiles. Puis il se mit à rire, d’un rire dur.
– Je vous admire ! s’écria passionnément Pernichon. Vous restez, dans ce vain tumulte, un calme observateur d’autrui – à l’autel et partout ailleurs sacerdotal. Néanmoins le tort fait aux intérêts les plus respectables par les polémiques de M. Larnaudin, son parti pris, son entêtement, votre bienveillance même ne peut l’oublier ! « Donner des gages et encore des gages ! disait hier devant moi votre éminent ami Mgr Cimier, le salut est là ! » Or, nous les avons donnés tous, à un seul près : le désaveu formel, nominal – oui, nominal ! – de quelques exaltés sans mandat, que suivent une poignée de naïfs. Est-ce trop demander ? (La sueur ruisselait enfin sur le front du petit homme qui semblait en éprouver un soulagement infini.)
M. Pernichon rédige la chronique religieuse d’une feuille radicale, subventionnée par un financier conservateur, à des fins socialistes. Ce qu’il a d’âme s’épanouit dans cette triple équivoque, et il en épuise la honte substantielle, avec la patience et l’industrie de l’insecte. Presque inconnue aux bureaux de l’Aurore nouvelle, sa silhouette déjà usée, maléfique, encore déformée par une boiterie, est la plus familière à ce public si particulier d’écrivains sans livres, de journalistes sans journaux, de prélats sans diocèses, qui vit en marge de l’Église, de la Politique, du Monde et de l’Académie, d’ailleurs si pressé de se vendre que l’offre restant trop souvent supérieure à la demande, l’âpre commerce est sans cesse menacé d’un avilissement des prix. Telle crise, une fois dénouée, quand on l’a vue se multiplier jusqu’au pullulement, la denrée périssable, désormais sans valeur, achève de pourrir dans les antichambres.
Ancien élève du petit séminaire de Notre-Dame-desChamps, jouant jusqu’au dernier jour la comédie à demi consciente d’une vocation sacerdotale, sitôt le cap franchi d’un baccalauréat hasardeux, on perdit sa trace un long temps, jusqu’à ce moment décisif où il obtint de signer chaque semaine, dans un Bulletin paroissial, des nouvelles édifiantes, puis des « Lettres de Rome » rédigées chez un petit traiteur de la rue Jacob. Quel autre que lui eût semblablement tiré parti de ce rôle obscur ? Mais il sait épargner sou par sou sa future renommée, pareil à ses ancêtres auvergnats qui, l’été, graissant de leur sueur une terre ingrate, viennent l’hiver vendre à Paris les châtaignes dont les cochons se rebutent, amassent lentement leur trésor pour finir inassouvis, seulement déliés par la mort de leur rêve absurde, et hâtivement décrassés, pour la première fois par l’ensevelisseuse, avant la visite du médecin de l’état civil. Ces lettres de Rome ne sont d’ailleurs point sans mérite. Elles en valent d’autres, moins connues, mais rédigées dans le même esprit par des vaniteux déçus pour y décharger, à petits coups, leurs âcretés. Le tour peut en varier sans doute, avec chaque auteur, non pas le sens profond et secret, la rancune vivace, la claire cupidité du pire, et, sous couleur de paix civique, une rage d’infirme contre tout ce qui dans l’Église garde le sens de l’honneur.
Ayant considéré un moment, avec respect, le visage du maître, souriant de ses mille rides précoces :
– Je renonce, dit Pernichon, à vous faire ressentir de l’indignation contre qui que ce soit… Le nonce, cependant, exprimait hier…
– Ne parlons pas du nonce, voulez-vous ? pria l’abbé Cénabre. Le zèle de Sa Sainteté à ne pas déplaire finira par paraître injurieux à nos ministres républicains… La démocratie aime le faste : on lui envoie de petits prélats intrigants, d’une bassesse à écœurer. Tenez ! celui-ci, je vous jure, n’entend pas le grec !… Chez M. le sénateur Hubert…
Il passa ses mains sur ses joues, rêva une seconde, et dit tranquillement :
– À quoi bon ? Vous ne l’entendez pas non plus..."

"La Joie" (1929)
Troisième roman de Bernanos et suite de "L’imposture". M. de Clergerie, sa mère (qui joue la comédie de la folie) et sa fille, Chantal, ont provisoirement quitté Paris pour un séjour à Laigneville. Ils profitent de l’agréable été normand. Au cours d’une discussion avec son père, la jeune Chantal laisse percevoir sa nature mystique, sa pureté et sa simplicité, mais elle ne se sent pas prête pour prendre le voile. Son père souhaite pourtant qu’elle s’établisse: il est surtout soucieux de sa carrière de savant et du fauteuil qu’il brigue à l’Académie. Une scène avec sa grand-mère qui a perdu la raison montre les aptitudes étranges et comme surnaturelles de Chantal de Clergerie: elle semble capable de communiquer avec les âmes…
L'auteur nous avait montré l'abbé Cénabre, prêtre érudit, curieux des choses Surnaturelles, mais incapable d'amour et qui, bien qu'ayant perdu la foi, continuait à exercer ponctuellement les services de son ministère : telle était l'imposture, dont personne ne se rendait compte sauf un pauvre prêtre, l'abbé Chevance, auquel l'abbé Cénabre s'était laissé aller, une nuit, à confier son trouble intérieur. Dès lors, l'abbé Chevance était comptable devant Dieu de l'âme de Cénabre. Sur son lit de mort, alors qu'il paraissait étrangement privé de toute consolation surnaturelle, sa pénitente, Chantal, jeune fille d'excellente famille, lui avait dit : " Je vous donne ma joie..."
Ainsi prend-elle à son tour l'âme de l'abbé Cénabre en compte devant Dieu. Chevance mort, c'est par Chantal que Dieu va continuer d'assiéger l'âme de l`imposteur, et finalement, par le sacrifice suprême de la jeune fille, en aura raison.
Chantal est la fille de l'académicien Aynard de Clergerie, châtelain de province, grand bourgeois catholique et libéral, pharisíen craintif et ignoble, qui vit avec sa fille au milieu d'une galerie de gens médiocres, sa mère, vieille dame frappée de folie, qui se croit toujours la maîtresse de maison, M. de La Pérouse, psychiatre maniaque, une servante, qui se moque de ses maîtres, Fiodor, un réfugié russe, aristocrate éthéromane. ..
Un magnifique portrait d'Aynard de Clergerie ...
"... Il n’osait l’interrompre, il n’osait même plus porter la main sur le corps fragile, tout tremblant de colère. Cette voix, que la vieillesse avait bizarrement aigrie sans toutefois en changer le timbre, c’était celle que petit garçon il avait appris à redouter, mais c’était celle encore qui avait toujours apaisé ses terreurs, tranché d’un mot ses scrupules, répondu de lui devant les hommes, et il semblait qu’elle gardât, qu’elle dût emporter un jour da côté des ombres le médiocre secret de sa vie, ses joies tristes, ses remords, Il l’aimait. Il l’aimait surtout parce qu’elle était la seule chose vivante qu’il comprît pleinement, qu’il comprît comme on aime, par un élan de sympathie profonde, charnelle. Il eût désiré de pouvoir l’entendre, à l’heure de la mort – telle quelle – non pas amollie, mais avec cet accent particulier, cette même vibration de fureur contenue ou de mépris, qui avait tant de fois jadis calmé ses nerfs, lorsque au temps de sa chétive adolescence il s’éveillait brusquement la nuit, dans un délire d’angoisse, « Imbécile ! disait la voix espérée, libératrice. Tu n’as rien vu du tout. Et si tu réveilles ton père, tu auras affaire à moi. » Alors il savourait sa honte, le nez sous les draps, soulagé d’un poids immense.
M. de Clergerie est un petit homme noir et tragique, avec une tête de rat. Et son inquiétude est aussi celle d’un rat, avec les gestes menus, précis, la perpétuelle agitation de cette espèce. Douze volumes ennuyeux sont écrits, sur sa face étroite que plisse et déplisse sans cesse une pensée secrète, vigilante, assidue, toujours la même à travers les saisons de la vie, et si étroitement familière qu’il ne la reconnaît même plus, ne saurait désormais l’exprimer en langage intelligible : il rumine le malheur de ses rivaux, mais sans aucune dépense de haine, d’un cœur exact et laborieux. Ainsi croit-il seulement peser ses chances.
Car il a l’honneur d’appartenir à l’Académie des Sciences morales, et il brigue un siège à l’Académie tout court. Mais la pitié divine, qui de rien n’est absente, n’a pas voulu que le petit homme fit mieux que grignoter et ronger, selon la loi de sa nature. Il n’exerce ses dents ferventes que sur des biens de nul prix. Toute grandeur l’étonne, et il s’en écarte avec stupeur. À peine l’ose-t-il contempler de loin, sans appétit, en passant dans sa courte barbe grise une main fébrile. Sa méchanceté, qui n’a que les traits d’une ingénieuse sottise, n’est mortelle qu’aux sots moins ingénieux que lui. Car la seule farce de cet ambitieux minuscule est de n’admirer rien, ni personne, se tenant lui-même pour un pauvre homme, avide de déguiser son néant. Ainsi va-t-il d’instinct aux médiocres qui lui ressemblent, et il les traite comme tels avec une sorte d’ingénuité terrible ; il entre dans leur mensonge sans se laisser détourner un moment par de pauvres obstacles, dont il connaît la fragilité. Chaque être, si misérable qu’on le suppose, a néanmoins sa vérité. Mais qu’importe la vérité des êtres à qui n’a jamais entrepris de rechercher sa propre vérité ? ..."
Dans cette trop lourde atmosphère, Chantal seule apporte un peu de paix et de joie : rien ne décèle son état d'âme exceptionnel. Bernanos a sans doute voulu peindre ici une sainteté dans le siècle.
"... De son pas juste et léger, rarement hâtif, la jeune fille traversa toute cette lumière, et ne s’arrêta que dans l’ombre du vestibule, les volets clos. Elle écoutait battre son cœur et ce n’était assurément ni de terreur ni de vaine curiosité, car depuis des semaines et des semaines, sans qu’elle y prît garde peut-être, chaque heure de sa vie était pleine et parfaite, et il lui semblait que toutes ses forces ensemble n’y eussent rien ajouté ni moins encore retranché… C’étaient les heures de jadis, si pareilles à celles de l’enfance, et il n’y manquait même pas la merveilleuse attente qui lui donnait autrefois l’illusion de courir à perdre haleine au bord d’un abîme enchanté..."
De son directeur, l'abbé Chevance, elle avait reçu le conseil de ne jamais s'émouvoir, de s'ouvrir simplement à toutes choses, et surtout les plus petites. La spiritualité dont elle vit, c'est celle de l'abandon à la divine Providence, préconisée par le Père de Caussade : "Faire parfaitement les choses faciles". Si l'”imposteur, l`abbé Cénabre, est aussi dans la paix, celle-ci est toute autre, de celui qui ne demande rien, n'aime rien, n'espère rien, - la paix tragique du possédé que Bernanos décrira encore dans "Monsieur Ouine". Il est dans la paix, parce que Dieu ne lui manque plus depuis qu`il a perdu la foi. Mais dans cette citadelle de silence qu'est devenue son âme, une brèche pourtant a été faite, par Cénabre lui-même, et qu'il ne dépend plus de lui de fermer : c`est la confession de son drame, livrée à l'abbé Chevance. Ainsi, malgré sa négation, Cénabre reste-t-il dans la communion de l''Eglise. Le souci spirituel de Chevance à son égard s'est transmis à Chantal, bien que celle-ci ignore encore sa mission.
"Ainsi Mlle Chantal pouvait croire que rien n’avait troublé sa paix, terni sa joie, et déjà la plaie mystérieuse était ouverte d’où ruisselait une charité plus humaine, plus charnelle, qui découvre Dieu dans l’homme, et les confond l’un et l’autre, par la même compassion surnaturelle. Transformation trop intime, trop profonde de la vie de l’âme, pour qu’en paraissent au dehors les signes visibles. Cela était venu par degrés, insensiblement, cela s’était levé lentement dans son cœur. Sans doute, elle n’ignorait pas le mal et n’avait jamais feint de l’ignorer, trop sensible et trop vive pour se dissimuler à soi-même, comme tant d’ingénues volontaires, certaines méfiances et certains dégoûts, mais sa droiture était la plus forte. Ce pressentiment du péché, de ses dégradations, de sa misère, restait vague, indéterminé, parce qu’il faut la déchirante expérience de l’admiration ou de l’amitié déçue pour nous livrer le secret tragique du mal, mettre à nu son ressort caché, cette hypocrisie fondamentale, non des attitudes, mais des intentions, qui fait de la vie de beaucoup d’hommes un drame hideux dont ils ont eux-mêmes perdu la clef, un prodige de duperie et d’artifice, une mort vivante. Mais qui peut décevoir celle qui croit d’avance ne posséder ni mériter rien, n’attend rien que de l’indulgence ou de la charité d’autrui ? Qui peut décevoir la joyeuse humilité ? L’agonie du vieux prêtre avait pourtant fait ce miracle.
C’était réellement la seule déception qu’elle eût jamais connue, et nulle autre que celle-là n’eût été capable de l’atteindre au point vif, de prendre en défaut sa naïve allégresse. Elle ne pouvait imaginer que Dieu lui manquât jamais, et cependant ne l’avait-elle pas cherché en vain, cette nuit mémorable ? Il s’était fait invisible et muet. .."
Un soir, pourtant, elle commencera à deviner qu'un destin l'attend. La jeune fille depuis longtemps était en proie à des extases qu'elle prenait pour des crises nerveuses. Il lui est alors montré ce que Dieu attend d'elIe : ayant donné sa joie, il lui faudra, en échange, embrasser le désespoir. Dans une vision affreuse, Chantal voit Judas sur le gibet et s'avance vers lui ; mais, à mesure qu'elle approche, Judas s'estompe; le gibet demeure, sur lequel, tout à coup, se dresse l'abbé Cénabre. Celui-ci, au cours d'un entretien, découvre avec stupeur l'état de grâce exceptionnel de Chantal. Il comprend que cette sainteté lui est envoyée, que la communion des saints continue à l'assiéger et que Chantal a remplacé Chevance. Mais, pour que Cénabre soit sauvé, il faudra que Chantal fasse le sacrifice total : elle sera assassinée par Fiodor, le chauffeur. Sur son corps, l'abbé Cénabre commence à réciter le "Pater noster" et "tomba la face en avant..."

1931 - La Grande Peur des Bien-Pensants
"..la société qui se crée peu à peu sous nos yeux réalisera aussi parfaitement que possible, avec une sorte de rigueur mathématique, l'idéal d'une société sans Dieu. Seulement, nous n'y vivrons pas. L'air va manquer à nos poumons. L'air manque. Le Monde qui nous observe avec une méfiance grandissante s'étonne de lire dans nos yeux la même angoisse obscure. Déjà quelques-uns d'entre nous ont cessé de sourire, mesurent l'obstacle du regard... On ne nous aura pas... On ne nous aura pas vivants !" - C'est par son pamphlet, "La Grande Peur des Bien-Pensants", qui prend pour prétexte la biographie de l'auteur de "La France juive", Edouard Drumont, que Bernanos s'imposa au public : trente ans d'histoire de France, de 1870 à 1900, une histoire quelque peu remodelée, forment la trame du pamphlet. Drumont y est un géant mythique aux prises avec les "bien-pensants" de l'époque, conservateurs timorés et prêtres ralliés, libéraux chrétiens et dignitaires de l'Eglise, tous agissent par lâcheté et calculs politiques dans le grand combat qui opposa la république anticléricale de Ferry à Combes à l'Eglise. "...la Révolution, au cours du XIXe siècle, a été l'œuvre commune de l'esprit de révolte et de celui d'aveugle acceptation, du conservateur et de l'anarchiste unis dans une sorte de symbiose. On met entre les mains du crétin bien-pensant une petite baguette, et il écarte aussitôt les gens du trottoir pour leur éviter de recevoir les briques sur la tête, mais il ne lui viendrait jamais à l'esprit que la maison qu'on est en train de démolir est justement la sienne..."
Le Bernanos qui écrit ici est encore celui qui brûle de renverser la République et de restaurer la monarchie et la chrétienté, mais le Bernanos de sa jeunesse qui témoigne sans illusion. Et certains passages sont d'une crudité peu commune : "En réalité la société actuelle, société de transition, de compromis, dite moderne, n'a aucun plan, ne se propose aucun but déterminé, sinon celui de durer le plus longtemps possible grâce à la méthode qui l'a servie jusqu'ici, celle d'un dégoûtant empirisme. Après un siècle et demi elle souffre encore, elle souffrira toujours de sa tare originelle et d'avoir été premièrement conçue par des femmes quadragénaires et par des cuistres, entre deux culbutes amoureuses. Philosophes à perruques et à jarretières, bourgeoises opulentes, marquises volcaniques, fortes et poilues comme des hommes, capables de croquer chaque jour un barbacolc au dessert, toute cette canaille dorée de mil sept cent quarante, pourrie jusqu'à l'os du croupion, mangée vive par les chancres et les gommes, et qui laisse dans l'histoire une odeur de culottes suspectes et de seins gras, n'avait sérieusement servi, sous des noms divers, que la libération de la braguette. La société née de leurs chaleurs n'est pas encore complètement guérie de cette illusion....."
Au fond, il n'est que peu question de Drumont comme chef de bandes antisémites que du personnage humilié, vaincu, qui a tenté de réveiller les énergies de la race et de la foi militante des catholiques. "« Drumont, écrivait Léon Daudet le 6 février 1917, observateur visionnaire et doué d'une prescience unique, nous a appris à lire notre temps. » Le vieux maître peut rendre demain le même service à nos fils. Apprendre à lire. Dieu l'a visiblement fait pour ça. Il y a chez lui, comme chez Péguy, du magister de village, avec ce besoin de tout expliquer, ligne à ligne, de poser son gros doigt sur le texte obscur, en levant les yeux par-dessus les lunettes. Sa plus grande crainte est d'aller trop vite, de laisser en arrière le paresseux ou l'imbécile. Pour lui, il a commencé par le commencement, bravement, humblement, ainsi qu'un sage ouvrier prend ses mesures. C'est en vain qu'un Maurras lui reproche de ne pas conclure. Il voit et fait voir, rien de plus..."
En vain. Le temps est bien à l'agonie de la chrétienté, une agonie dont la responsabilité est bien à rechercher auprès de cette "peur des bien-pensants" prêts à toutes les compromissions pour maintenir leurs privilèges.

1935 - Un Crime
Bernanos avait commencé "Un crime" avec l'intention d'en faire un véritable roman policier, et d'atteindre le public habituel du genre. Et tout débute, en effet, comme un roman policier. Mais, par la suite, Bernanos fut rattrapé par son génie : les dialogues entre le juge et le prêtre se réfèrent aux thèmes spirituels fondamentaux de l'œuvre; par ailleurs, l'art du romancier demeure trop allusif, l'éclairage trop indirect pour correspondre au genre prévu. Réserve faite sur une certaine invraisemblance et les complications de l'intrigue, on y ressent toute la puissance de l'écriture romanesque de Bernanos ....
"Qui va là? C'est toi, Phémie?
Mais il était peu probable que la sonneuse vînt si tard au presbytère. Sous la fenêtre, le regard anxieux de la vieille bonne ne pouvait guère voir plus loin que le premier tournant de l'allée; le petit jardin se perdait au-delà, dans les ténèbres.
- C'est vous, Phémie! reprit-elle sans conviction, d'une voix maintenant tout à fait tremblante.
Elle n'osait plus fermer la fenêtre, et pourtant le sourd roulement du vent au fond de la vallée, grandissant de minute en minute comme chaque soir, ne s'apaiserait qu'avec les premiers brouillards de l'aube. Mais elle redoutait plus que la nuit l'odeur fade de cette maison solitaire pleine des souvenirs d'un mort.
Un long moment, ses deux mains restèrent crispées sur le montant de la fenêtre; elle dut faire effort pour les desserrer. Comme ses doigts s'attardaient encore sur l'espagnolette, elle poussa un cri de terreur.
- Dieu! que vous m'avez fait crainte. Par où que vous êtes montée, sans plus de bruit qu'une belette, mam'selle Phémie?
La fille répondit en riant :
- Ben, par le lavoir, donc. Drôle de gardienne que vous faites, sans reproche, mademoiselle Céleste! On entre ici comme dans le ,moulin du père Anselme, parole d'honneur.
Sans attendre la réponse, elle prit une tasse sur l’étagère et se mit tranquillement en demeure de la remplir de genièvre.
– Vous allez tout de même pas me boire ma goutte ?
– On voit bien que vous restez là au chaud, mademoiselle Céleste. Le vent vient de tourner du côté des Trois-Évêques. Il m’a autant dire cinglé les os. Y a pas de fichu qui tienne là-contre !
Elle s’essuya les lèvres à son tablier, cracha poliment dans les cendres, et reprit d’un ton où la vieille femme méfiante crut sentir un léger malaise, dont elle ne s’expliqua pas d’abord la cause :
– Vaudrait mieux vous coucher, mademoiselle Céleste, votre curé est depuis longtemps sous ses draps, vous pouvez me croire. Pensez ! La moto du messager vient d’arriver chez Merle.
Paraît que la brume descendait derrière lui presque aussi vite… Il ne passera plus une voiture d’ici demain par les cols.
– Savoir, ma petite. Un jeune curé, sa première paroisse, voyez-vous, y a pas plus simple, plus naïf. Avec ça, ces gens de Grenoble, ils ne connaissent rien à nos montagnes. Écoutez…
Le ciel venait de vibrer d’un seul coup, presque sans bruit, du moins perceptible à l’oreille, et pourtant la terre parut en frémir jusque dans ses profondeurs, comme du battant d’une énorme cloche de bronze.
– Le vent vient de tourner encore un peu plus au nord, ma fine. Le voilà qui passe entre les Aiguilles Noires. Nous aurons du froid...."
Par une nuit lugubre, dans un presbytère de campagne, la vieille bonne, Céleste, et la sonneuse attendent le nouveau prêtre qui vient d'être nommé curé de Mégère. Avec un retard inexplicable, le voici enfin : il est jeune, frêle, presque féminin, et il a tôt fait de conquérir par sa grâce et sa courtoisie le cœur de Céleste. A peine endormie, celle-ci est réveillée par le prêtre, qui prétend avoir entendu des coups de feu et des appels au secours. L'alarme est donnée. On trouve en effet un cadavre dans le parc d'un château où habite une vieille dame que l`on sait riche et qui vit seule avec sa domestique, Louise. Et, dans le château, c'est la vieille dame elle-même que l'on trouve assassinée. L'enquête commence. Il semble impossible que, depuis son presbytère, le prêtre ait entendu les coups de feu et les cris ; d'autre part, les circonstances de son arrivée, et son retard même, demeurent obscurs. Mais le prêtre subjugue le juge d'instruction Frescheville, et obtient de lui l'autorisation de quitter Mégère, sous prétexte de poursuivre une enquête personnelle orientée par certains indices qu'il aurait obtenus de Mme Louise....
".. Au bruit de la porte, le curé de Mégère ne leva pas la tête. Ses yeux clos, ses joues creuses, le pincement bizarre de ses lèvres lui faisaient un masque si tragique que le juge délibéra un moment de quitter la salle sur la pointe des pieds comme il y était entré, car il le croyait endormi. Au premier pas en arrière, et à sa grande surprise, la main du prêtre sortit de l'ample pèlerine où elle était blottie et lui fit un signe presque amical. Alors le juge crut s'apercevoir, au mouvement des lèvres, qu'il priait.
- Je m'excuse... commença-t-il.
Mais le curé de Mégère ne l'écoutait pas. Il fixait maintenant la flamme dansante du foyer avec un regard douloureux, comme s'il pesait d'avance ses paroles et qu'il les jugeât décisives, irréparables.
- Je suis content que vous soyez venu, fit-il enfin d'une voix sombre. J'avoue que je n'en puis plus.
De ses yeux, il montra la porte au petit clergeon qui s'éloigna.
- Monsieur, reprit-il après un long silence, croyez-vous en Dieu?
- Certes! s'écria le petit juge. Les hommes me dégoûtent trop. Le monde a besoin d'un alibi.
- Ne plaisantez pas, dit le prêtre avec lassitude. Il m'en coûterait trop d'aborder avec vous certaine question si... Mais votre réponse, bien que peu convenable, me suffit. je vous sais sincère.
ll ramena frileusement les pans de son manteau sur ses genoux.
- Monsieur, vous avez devant vous un homme malheureux. Je suis dépositaire d'un secret. Une part de ce secret m'appartient - j'entends par là que je puis en disposer dans l'intérêt de la justice et surtout dans celui d'une pauvre âme tourmentée. L'autre part, j'en devrai compte à Dieu, du premier au dernier mot.
- Vous êtes absolument libre de...
- Non, je ne suis pas libre, interrompit sèchement le curé de Mégère. Si je l'étais, je ne vous aurais certes pas reçu.
-- Rien ne presse, monsieur l'abbé. L'enquête suit son cours. Il est facile d'attendre que votre santé...
- Ma santé, fit le prêtre amèrement. Ma santé n'importe pas du tout. Ou du moins il sera temps d'y songer plus tard. Ma santé!
Ses yeux parurent reculer dans leurs orbites, et tout son visage prit une expression d'ironie insupportable qui frappa le petit juge.
- Hé, hé, bégaya-t-il, sans réussir à éviter le regard qui cherchait tout à coup le sien avec la malice et l'obstination de quelque insecte malfaisant, la santé... heu... heu...
- C'est un mot qui m'écoeure, poursuivit le prêtre sur le même ton. Cela remplit la bouche comme tous les mots que les hommes ont inventés pour essayer de se donner entre eux l'illusion de la sécurité. La sécurité! Leur sécurité! Disons simplement la sécurité de leurs ventres.
- Vous êtes dur, dit le petit juge stupéfait de ce brusque changement, et il semblait suivre avec beaucoup d'attention, du bout de sa bottine, les dessins du tapis, effacés par l'usure.
- ll n'y a pas de sécurité, reprit le curé de Mégère avec une exaltation croissante: et en s'efforçant d'ailleurs de ne pas hausser la voix qui prenait dans les notes hautes une sonorité désagréable.
- Pour les hommes supérieurs, soit, objecta le juge poliment. Les hommes ordinaires...
- Il n'y a pas d'hommes ordinaires. Car ceux qu'on appelle ainsi...
Son regard s'était emparé de celui de son interlocuteur et ne le lâchait plus.
- Oui, monsieur, ils n'ont dans la bouche que les mots de raison, de bon sens, ils ressemblent à ces navigateurs égarés qui désignent du doigt sur la carte une route imaginaire qu'ils ont depuis longtemps quittée à leur insu. Pauvres gens! Leur vie ne reste pas plus longtemps dans le normal que le balancier en mouvement au point mort. Raisonnables ou non, ils finissent toujours par tomber en pleine extravagance, bien que par des voies très différentes. Les uns par timidité, d'autres par imprudence et hardiesse, car leurs folies sont aussi diverses que leurs visages, il n'y a pas deux folies pareilles dans le monde. Il arrive parfois...
Les mots se pressaient si vite dans sa gorge qu'il ne réussissait plus à en articuler chaque syllabe, et pourtant sa voix restait basse et presque douce. Ce contraste avait quelque chose de sinistre.
- ll arrive parfois... oui, on est parfois tout prêt... enfin, qui de nous n'a été tenté d'en finir d'un seul coup avec cette sécurité imbécile? On voudrait leur ouvrir les yeux, coûte que coûte. Les mensonges les plus grossiers...
Les yeux du petit homme s'étaient fermés peu à peu. La tête inclinée sur l'épaule, il semblait dormir, et son visage était si immobile que l'imperceptible frémissement d'un muscle, à la racine du nez, y apparaissait ainsi qu'un signe extraordinaire. Le prêtre se tut.
- Je vous demande pardon, fit le juge, comme s'il sortait d'un songe, je vous suivais très attentivement. J'ai bien souvent pensé moi-même ...
Il n'acheva pas. Son regard gris entre ses cils mi-clos, frappés de biais par la lumière, fit rapidement le tour de la pièce, se fixa un instant sur la porte.
- Vous désirez me parler de Mme Louise, dit-il enfin. C'est une bien singulière personne, un type assez balzacien..
- Vous êtes un homme fin, soupira le curé de Mégère, - lui aussi semblait sortir d'un rêve, - fin et subtil. C'est pourquoi je ne ruserai pas avec vous. Je vous demanderai seulement de m'éviter ultérieurement tout contact, du moins direct, avec la police et les enquêteurs. ,
- Mon devoir..., commença le juge.
- Si, monsieur, vous me l'épargnerez. Qui sait si les renseignements dont je dispose - dont je disposerai bientôt peut-être - ne vous permettront pas de clore une instruction qui semble
vous promettre - de votre propre aveu - plus d'un mécompte...
- Plus de mécomptes que de plaisir, soit!... Je vous entends... Nous parlons d'ailleurs en amis ...
- Voyez-vous, monsieur le juge, reprit le prêtre avec une vivacité soudaine, en poursuivant en moi quelque secret, vous courez après une ombre. Le peu que je sais suffit : le problème posé à ma conscience sacerdotale n'est douloureux que pour moi. Que me veut-on? Oui, que veut-on que je sache d'un crime commis dans un pays inconnu de moi, sur une malheureuse personne dont, il y a deux semaines, j'ignorais jusqu'à l'existence? La victime est morte. Un autre juge que vous a reçu l'aveu du criminel et, je l'espère, son repentir. Le mal commis est donc irréparable, et la société ne saurait même plus s'en venger sur son auteur. Alors? J'aurais cru que la justice classait rapidement ces sortes d'affaires.
- Je voudrais que le problème fût aussi simple...
- Evidemment, il ne l'est plus, si l'on sort du domaine des faits pour entrer dans celui des mobiles que nous appelons, nous, les intentions. Et ce domaine est pratiquement illimité.
- Justement. Voyez-vous, reprit le magistrat, nous savons réellement très peu de chose sur les différentes personnes mêlées à ce drame, en apparence banal. On ignore trop, dans le public, quelles difficultés nous rencontrons, dès qu'il s'agit de rassembler sur tel ou tel les renseignements nécessaires pour dégager l'individu réel, concret, de cette apparence sociale qui peut varier si curieusement aux diverses époques de la vie. On enseigne que le corps humain se renouvelle tout entier, jusqu’à la dernière cellule, en une dizaine d’années. Il ne faut pas un délai plus long pour changer socialement de peau. Ainsi le monde est plein de vieux hommes ou de vieilles femmes dont le passé ne se remonte pas. Les registres d’état civil ou les études notariales fournissent bien quelques points de repère, mais que valent-ils pour permettre d’apprécier certaines existences trop longues, et dont tous les témoins sont morts ?… Hé bien, il y a dans cette affaire pas mal de gens peu… peu déchiffrables. La victime d’abord. Cette dame de Mégère, ici, n’est-ce pas, elle faisait déjà comme partie du paysage. On ne la voyait même pas vieillir ; les très vieilles gens ne vieillissent plus. Il faut un peu de réflexion pour l’imaginer ailleurs… au Caire, par exemple, où elle habitait encore il y a douze ans… Un peu plus tôt, je dois dire, on l’aurait trouvée à Auteuil, dans une pension de famille très chic… Un peu plus tôt encore, à Vence.
Et savez-vous en quel endroit de la terre elle a dû apprendre la première nouvelle de la déclaration de guerre de 1914 ? À Ceylan, cher ami. Des palaces, oui ! Des pensions de famille tant qu’on voudra, mais de famille point… L’héritière est une arrière-petite-nièce du mari.
– Quelle héritière ? demanda le curé d’une voix où se trahissait un peu d’impatience, dissimulée par politesse.
– L’héritière est une demoiselle de Châteauroux – rien d’intéressant de ce côté-là, – une brave fille dévote, qui vit en recluse, une personne inoffensive.
– Les vieilles filles dévotes sont rarement inoffensives, dit le curé de Mégère d’un air las ..."
C'est alors que juge comprend vite que le prêtre ne reviendra pas. Parmi les papiers sans intérêt qu`il a laissés dans son presbytère d'une nuit se trouve une photographie qui intrigue le juge : celle d`une jeune fille. Quelques jours plus tard, il croit reconnaître cette jeune fille dans la personne d'Evangéline Souricet, petite nièce de la victime, qui vient de Châteauroux recueillir l'héritage. Tout cela plonge le juge dans la fièvre et le délire.
La troisième partie jette sur ce mystère les lueurs indispensables. On retrouve le prêtre dans un hôtel du Pays basque, accompagné du petit clergeon de Mégère qui est venu le rejoindre. Averti de l'arrivée dans la région du juge Frescheville, il prend la fuite après avoir congédié le clergeon et lui avoir avoué qu'il n'est pas le curé de Mégère.
Dans le dernier chapitre, nous voyons une femme écrivant une lettre dans un buffet de gare. C'est le faux curé de Mégère sous sa véritable identité, et la lettre est un long adieu adressé à Evangeline Souricet. On comprend alors quel lien unissait les deux femmes, et on devine que le faux prêtre a commis le crime pour qu'Evangéline recueille l'héritage; car, averti par Mme Louise (qui était en réalité sa propre mère), il savait que la vieille dame songeait à déshériter sa petite-nièce. Le livre finit sur un double suicide : celui de la meurtrière et celui du petit clergeon...

1936 – Journal d’un curé de campagne
Le roman, sans doute le plus populaire de Bernanos, possède une trame fort simple : "Bernanos décrit l’existence discrète d’un jeune prêtre catholique dans la
petite paroisse flamande Ambricourt dans le nord de la France. Il est marqué par un cancer de l’estomac et son désespoir devant le manque de foi dans la population du village. Dans la première
partie le jeune prêtre décrit son arrivée dans sa paroisse du nord de la France et ses premières expériences avec la population pauvre. Dans la deuxième partie, il s’agit de la vie quotidienne
dans la paroisse. Le curé décrit ses rencontres avec différentes personnes et les résultats de son travail. Il échoue à remplir son devoir, et c'est seulement pendant une crise dans le château du
village qu'il réussit à convaincre la comtesse, châtelaine d'Ambricourt, de l’existence de Dieu. Elle se trouve dans une situation fatale et elle meurt un jour plus tard. La dernière partie
traite du séjour et de la mort du curé à Lille après un examen médical." Le moment le plus connu de ce "Journal" est celui qui voit le prêtre parvenir à ouvrir les consciences : celle de la fille
de la comtesse qui avoue la haine qu'elle porte à sa mère et le dégoût que lui inspirent les aventures de son père, l'orgueil de la comtesse qui se sait bafouée et refoule le souvenir d'un enfant
mort qui fut son seul amour. "Nos fautes cachées empoisonnent l'air que d'autres respirent, et tel crime, dont un misérable portait le germe à son insu, n'aurait jamais mûri son fruit, sans ce
principe de corruption..."
"Ma paroisse est une paroisse comme les autres. Toutes les paroisses se ressemblent. Les paroisses d’aujourd’hui, naturellement. Je le disais hier à M.
le curé de Norenfontes : le bien et le mal doivent s’y faire équilibre, seulement le centre de gravité est placé bas, très bas. Ou, si vous aimez mieux, l’un et
l’autre s’y superposent sans se mêler, comme deux liquides de densité différente. M. le curé m’a ri au nez. C’est un bon
prêtre, très bienveillant, très paternel et qui passe même à l’archevêché pour un esprit fort, un peu dangereux. Ses boutades font la joie des presbytères, et il les appuie d’un regard qu’il
voudrait vif et que je trouve au fond si usé, si las, qu’il me donne envie de pleurer. Ma paroisse est dévorée par l’ennui, voilà le mot. Comme tant d’autres paroisses ! L’ennui les dévore sous
nos yeux et nous n’y pouvons rien. Quelque jour peut-être la contagion nous gagnera, nous découvrirons en nous ce cancer. On peut vivre très longtemps avec ça.
L’idée m’est venue hier sur la route. Il tombait une de ces pluies fines qu’on avale à pleins poumons, qui vous descendent jusqu’au ventre. De la côte
de Saint-Vaast, le village m’est apparu brusquement, si tassé, si misérable sous le ciel hideux de novembre. L’eau fumait sur lui de toutes parts, et il avait l’air de s’être couché là, dans
l’herbe ruisselante, comme une pauvre bête épuisée. Que c’est petit, un village ! Et ce village était ma paroisse. C’était ma
paroisse, mais je ne pouvais rien pour elle, je la regardais tristement s’enfoncer dans la nuit, disparaître…
Quelques moments encore, et je ne la verrais plus. Jamais je n’avais senti si cruellement sa solitude et la mienne. Je pensais à ces bestiaux que
j’entendais tousser dans le brouillard et que le petit vacher, revenant de l’école, son cartable sous le bras, mènerait tout à l’heure à travers les pâtures trempées, vers l’étable chaude,
odorante… Et lui, le village, il semblait attendre aussi – sans grand espoir – après tant d’autres nuits passées dans la boue, un maître à suivre vers quelque improbable, quelque inimaginable
asile.
Oh ! je sais bien que ce sont des idées folles, que je ne puis même pas prendre tout à fait au sérieux, des rêves… Les villages ne se lèvent pas à la
voix d’un petit écolier, comme les bêtes. N’importe ! Hier soir, je crois qu’un saint l’eût appelé. Je me disais donc que le monde est dévoré par l’ennui. Naturellement, il faut un peu réfléchir
pour se rendre compte, ça ne se saisit pas tout de suite. C’est une espèce de poussière. Vous allez et venez sans la voir, vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez, et elle est si fine, si
ténue qu’elle ne craque même pas sous la dent. Mais que vous vous arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains. Vous devez vous agiter sans cesse pour secouer cette pluie
de cendres. Alors, le monde s’agite beaucoup.
On dira peut-être que le monde est depuis longtemps familiarisé avec l’ennui, que l’ennui est la véritable condition de l’homme. Possible que la semence
en fût répandue partout et qu’elle germât çà et là, sur un terrain favorable. Mais je me demande si les hommes ont jamais connu cette contagion de l’ennui, cette lèpre ? Un désespoir avorté, une
forme turpide du désespoir, qui est sans doute comme la fermentation d’un christianisme décomposé.
Évidemment, ce sont là des pensées que je garde pour moi. Je n’en ai pas honte pourtant. Je crois même que je me ferais très bien comprendre, trop bien
peut-être pour mon repos – je veux dire le repos de ma conscience. L’optimisme des supérieurs est bien mort. Ceux qui le professent encore l’enseignent par habitude, sans y croire. À la moindre
objection, ils vous prodiguent des sourires entendus, demandent grâce. Les vieux prêtres ne s’y trompent pas. En dépit des apparences et si l’on reste fidèle à un certain vocabulaire, d’ailleurs
immuable, les thèmes de l’éloquence officielle ne sont pas les mêmes, nos aînés ne les reconnaissent plus. Jadis, par exemple,
une tradition séculaire voulait qu’un discours épiscopal ne s’achevât jamais sans une prudente allusion – convaincue, certes, mais prudente – à la persécution prochaine et au sang des martyrs.
Ces prédictions se font beaucoup plus rares aujourd’hui. Probablement parce que la réalisation en paraît moins incertaine.
Hélas ! il y a un mot qui commence à courir les presbytères, un de ces affreux mots dits « de poilu » qui, je ne sais comment ni pourquoi, ont paru
drôles à nos aînés, mais que les garçons de mon âge trouvent si laids, si tristes. (C’est d’ailleurs étonnant ce que l’argot des tranchées a pu réussir à exprimer d’idées sordides en images
lugubres, mais est-ce vraiment l’argot des tranchées ?…) On répète donc volontiers qu’il ne « faut pas chercher à comprendre
». Mon Dieu ! mais nous sommes cependant là pour ça ! J’entends bien qu’il y a les supérieurs. Seulement, les supérieurs, qui les informe ? Nous. Alors quand on nous vante l’obéissance et la
simplicité des moines, j’ai beau faire, l’argument ne me touche pas beaucoup…
Nous sommes tous capables d’éplucher des pommes de terre ou de soigner les porcs pourvu qu’un maître des novices nous en donne l’ordre. Mais une
paroisse, ça n’est pas si facile à régaler d’actes de vertu qu’une simple communauté ! D’autant qu’ils les ignoreront toujours et que d’ailleurs ils n’y comprendraient
rien...."
La Joie? "L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde.."
"Il m'a poussé hors de la pièce par les épaules, et la tape amicale d'une de ses larges mains a failli me faire tomber sur les genoux. Puis nous avons bu ensemble un verre de genièvre.
Et tout à coup il m'a regardé droit dans les yeux, d'un air d'assurance et de commandement. C'était comme un autre homme, un homme qui ne rend de compte à personne, un seigneur.
"Les moines sont les moines, a-t-il dit, je ne suis pas un moine. Je ne suis pas un supérieur de moines. J'ai un troupeau, un vrai troupeau, je ne peux pas danser devant l'arche avec mon troupeau -du simple bétail- à quoi je ressemblerais, veux-tu me dire ? Du bétail, ni trop bon ni trop mauvais, des bœufs, des ânes, des animaux de trait et de labour. Et j'ai des boucs aussi. Qu'est-ce que je vais faire de mes boucs ? Pas moyen de les tuer ni de les vendre. Un abbé mitré n'a qu'à passer la consigne au Frère portier. En cas d'erreur, il se débarrasse des boucs en un tour de main. Moi, je ne peux pas, nous devons nous arranger de tout, même des boucs. Boucs ou brebis, le maître veut que nous lui rendions chaque bête en bon état. Ne va pas te mettre dans la tête d'empêcher un bouc de sentir le bouc, tu perdrais ton temps, tu risquerais de tomber dans le désespoir. Les vieux confrères me prennent pour un optimiste, un Roger Bontemps, les jeunes de ton espèce pour un croquemitaine, ils me trouvent trop dur avec les gens, trop militaire, trop coriace. Les uns et les autres m'en veulent de ne pas avoir mon petit plan de réformes comme tout le monde ou de le laisser au fond de ma poche. Tradition! grognent les vieux. Évolution! chantent les jeunes. Moi je crois que l'homme est l'homme, qu'il ne vaut guère mieux qu'au temps des païens. La question n'est d'ailleurs pas de savoir ce qu'iI vaut, mais qui le commande. Ah! si on avait laissé faire les hommes d'Église! Remarque que je ne coupe pas dans le moyen âge des confiseurs : les gens du treizième siècle ne passaient pas pour des petits saints et si les moines étaient moins bêtes, ils buvaient plus qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Mais nous étions en train de fonder un empire, mon garçon, un empire auprès duquel celui des Césars n'eût été que de la crotte - une paix, une Paix romaine, la vraie. Un peuple chrétien, voilà ce que nous aurions fait tous ensemble.
Un peuple de chrétiens n'est pas un peuple de saintes nitouches. L'Église a les nerfs solides, le péché ne lui fait pas peur, au contraire. Elle le regarde en face, tranquillement, et même, à l'exemple de Notre-Seigneur, elle le prend à son compte, elle l'assume. Quand un bon ouvrier travaille convenablement les six jours de la semaine, on peut bien lui passer une ribote, le samedi soir. Tiens, je vais te définir un peuple chrétien par son contraire. Le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste, un peuple de vieux. Tu me diras que la définition n'est pas trop théologique. D'accord. Mais elle a de quoi faire réfléchir les messieurs qui bâillent à la messe du dimanche. Bien sûr qu'ils bâillent! Tu ne voudrais pas qu'en une malheureuse demi-heure par semaine, l'Église puisse leur apprendre la joie! Et même s'ils savaient par cœur le catéchisme du Concile de Trente, ils n'en seraient pas probablement plus gais.
« D'où vient que le temps de notre petite enfance nous apparaît si doux, si rayonnant? Un gosse a des peines comme tout le monde, et il est, en somme, si désarmé contre la douleur, la maladie! L'enfance et l'extrême vieillesse devraient être les deux grandes épreuves de I'homme. Mais c'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe même de sa joie. ll s'en rapporte à sa mère, comprends-tu ? Présent, passé, avenir, toute sa vie, la vie entière tient dans un regard, et ce regard est un sourire. Hé bien, mon garçon, si l'on nous avait laissé faire, nous autres, l'Église eût donné aux hommes cette espèce de sécurité souveraine. Retiens que chacun n'en aurait pas moins eu sa part
d'embêtements. La faim, la soif, la pauvreté, la jalousie, nous ne serons jamais assez forts pour mettre le diable dans notre poche, tu penses! Mais l'homme se serait su le fils de Dieu,
voilà le miracle l ll aurait vécu, il serait mort avec cette idée, dans la caboche - et non pas une idée apprise seulement dans les livres -, non. Parce qu'elle eût inspiré, grâce à nous, les
mœurs, les coutumes, les distractions, les plaisirs et jusqu'aux plus humbles nécessités. Ça n'aurait pas empêché l'ouvrier de gratter la terre, le savant de piocher sa table de logarithmes ou même I 'ingénieur de construire ses joujoux pour grandes personnes. Seulement nous aurions aboli, nous aurions arraché du cœur d'Adam le sentiment de sa solitude. Avec leur ribambelle de dieux, les païens n'étaient pas si bêtes : ils avaient tout de même réussi à donner au pauvre monde I'illusion d'une grossière entente avec l'invisible. Mais le truc maintenant ne vaudrait plus un clou.
Hors l'Église, un peuple sera toujours un peuple de bâtards, un peuple d'enfants trouvés. Évidemment, il leur reste encore l'espoir de se faire reconnaître par Satan. Bernique! Ils peuvent l'attendre longtemps, leur petit Noël noir! Ils peuvent les mettre dans la cheminée, leurs souliers ! Voilà déjà que le diable se lasse d'y déposer des tas de mécaniques aussi vite démodées qu'inventées, il n'y met plus maintenant qu'un minuscule paquet de cocaïne, d'héroïne, de morphine, une saleté de poudre quelconque qui ne lui coûte pas cher. Pauvres types! Ils auront usé jusqu'au péché. Ne s'amuse pas qui veut. La moindre poupée de quatre sous fait les délices d'un gosse toute une saison, tandis qu'un vieux bonhomme bâillera devant un jouet de cinq cents francs. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu l'esprit d'enfance.
Hé bien, l'Église a été chargée par le bon Dieu de maintenir dans le monde cet esprit d'enfance, cette ingénuité, cette fraîcheur. Le paganisme n'était pas l'ennemi de la nature, mais le christianisme seul l'agrandit, l'exalte, la met à la mesure de l'homme, du rêve de l'homme. Je voudrais tenir un de ces savantasses qui me traitent d'obscurantiste, je lui dirais : "Ce n'est pas ma faute si je porte un costume de croque-mort. Après tout, le Pape s'habille bien en blanc, et les cardinaux en rouge. J'aurais le droit de me promener vêtu comme la Reine de Saba, parce que j'apporte la joie. Je vous la donnerais pour rien si vous me la demandiez. L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, vous l'avez fait contre la joie. Est-ce que je vous empêche, moi, de calculer la précession des équinoxes ou de désintégrer les atomes ? Mais que vous servirait de fabriquer la vie même, si vous avez perdu le sens de la vie ? Vous n'auriez plus qu'à vous faire sauter la cervelle devant vos cornues. Fabriquez de la vie tant que vous voudrez ! L'image que vous donnez de la mort empoisonne peu à peu la pensée des misérables, elle assombrit, elle décolore lentement leurs dernières joies. Ça ira encore tant que votre industrie et vos capitaux vous permettront de faire du monde une foire, avec des mécaniques qui tournent à des vitesses vertigineuses, dans le fracas des cuivres et l'explosion des feux d'artifice. Mais, attendez, attendez le premier quart d'heure de silence. Alors, ils l'entendront la parole - non pas celle qu'ils ont refusée, qui disait tranquillement : Je suis la Voie, la Vérité, la Vie - mais celle qui monte de l'abîme : Je suis la porte à jamais close, la route sans issue, le mensonge et la perdition."
Il a prononcé ces derniers mots d'une voix si sombre que j'ai dû pâlir - ou plutôt jaunir, ce qui est, hélas! ma façon de pâlir depuis des mois - car il m'a versé un second verre de genièvre et nous avons parlé d'autre chose. Sa gaieté ne m'a pas paru fausse ni même affectée, car je crois qu'elle est sa nature même : son âme est gaie. Mais son regard n'a pas réussi tout de suite à se mettre d'accord avec elle.
Au moment du départ, comme je m'inclinais, il m'a fait du pouce une petite croix sur le front et a lissé un billet de cent francs dans ma poche : "Je parie que tu es sans le sou, les premiers temps sont durs, tu me les rendras quand tu pourras. Fiche le camp, et ne dis jamais rien de nous deux aux imbéciles." (Journal d'un curé de campagne)
L'incompréhension des hommes tient à leur refus de vivre autrement qu'à la surface d'eux-mêmes :
« J’ai beaucoup réfléchi depuis quelques jours au péché. A force de le définir un manquement à la loi divine, il me semble qu’on risque d’en donner une idée trop sommaire. Les gens disent là-dessus tant de bêtises! Et, comme toujours, ils ne prennent jamais la peine de réfléchir. Voilà des siècles et des siècles que les médecins discutent entre eux de la maladie. S’ils s’étaient contentés de définir un manquement aux règles de la bonne santé, ils seraient d’accord depuis longtemps. Mais ils l’étudient sur le malade, avec l’intention de le guérir. C’est justement ce que nous essayons de faire, nous autres. Alors, les plaisanteries sur le péché, les ironies, les sourires ne nous impressionnaient pas beaucoup.
Naturellement, on ne veut pas voir plus loin que la faute. Or la faute n’est, après tout, qu’un symptôme. Et les symptômes les plus impressionnants pour les profanes ne sont pas toujours les plus inquiétants, les plus graves.
Je crois, je suis sûr que beaucoup d’hommes n’engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d’eux-mêmes, et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson, qui donne l’illusion d’une véritable destinée. Il paraît qu’au cours de la dernière guerre, de petits employés timides se sont révélés peu à peu des chefs; ils avaient la passion du commandement sans le savoir. Oh! certes, il n’y a rien là qui ressemble à ce que nous appelons du nom si beau de conversion – convertere – mais enfin, il avait suffi à ces pauvres êtres de faire l’expérience de l’héroïsme à l’état brut, d’un héroïsme sans pureté. Combien d’hommes n’auront jamais la moindre idée de l’héroïsme surnaturel, sans quoi il n’est pas de vie intérieure! Et c’est justement sur cette vie-là qu’ils seront jugés: des qu’on y réfléchit un peu, la chose paraît certaine, évidente. Alors?... Alors, dépouillés par la mort de tous ces membres artificiels que la société fournit aux gens de leur espèce, ils se retrouveront tels qu’ils sont, qu’ils étaient à leur insu – d’affreux monstres non développés, des moignons d’hommes.
Ainsi faits, que peuvent-ils dire du péché? Qu’en savent ils? Le cancer qui les ronge est pareil à beaucoup de tumeurs – indolore. Ou, du moins, ils n’en ont ressenti, pour la plupart, à une certaine période de leur vie, qu’une impression fugitive, vite effacée. Il est rare qu’un enfant n’ait pas eu – ne fût-ce qu’à l’état embryonnaire – une espèce de vie intérieure, au sens chrétien du mot. Un jour où l’autre, l’élan de sa jeune vie a été plus fort, l’esprit d’héroïsme a remué au fond de son cœur innocent. Pas beaucoup, peut-être juste assez cependant pour que le petit être ait, vaguement entrevu, parfois obscurément accepté, le risque immense du salut, qui fait tout le divin de l’existence humaine. Il a su quelque chose du bien et du mal, une notion du bien et du mal pure de tout alliage, encore ignorante des disciplines et des habitudes sociales. Mais, naturellement, il a réagi en enfant, et l’homme mûr ne gardera de telle minute décisive, solennelle, que le souvenir d’un drame enfantin, d’une apparente espièglerie dont le véritable sens lui échappe, et dont il parlera jusqu’à la fin avec ce sourire attendri, trop luisant, presque lubrique, des vieux… »

1937 - Nouvelle Histoire de Mouchette
La pensée de Mouchette "reste vague, passe aisément d’un plan à l’autre. Si les misérables avaient le pouvoir d’associer entre elles les images de leur malheur, elles auraient tôt fait de l’accabler. Mais leur misère n’est pour eux qu’une infinité de misères, un déroulement de hasards malheureux. Ils ressemblent à des aveugles qui comptent de leurs doigts tremblants des pièces de monnaie dont ils ne connaissent pas l’effigie. Pour les misérables, l’idée de la misère suffit. Leur misère n’a pas de visage. Maintenant qu’elle ne lutte pas, Mouchette retrouve cette résignation instinctive, inconsciente qui ressemble à celle des animaux. N’ayant jamais été malade, le froid qui la pénètre est à peine une souffrance, une gêne plutôt pareille à tant d’autres. Cette gêne n’a rien de menaçant, n’évoque aucune image de mort. Et d’ailleurs, la mort elle-même Mouchette y pense comme à un événement bizarre, aussi improbable, aussi inutile à prévoir que, par exemple, le gain fabuleux d’un gros lot. À son âge, mourir ou devenir une dame sont deux aventures aussi chimériques..."
La Mouchette de ce roman, nous dit l`auteur, n'a de commun avec celle qui paraît dans "Sous le soleil de Satan" que la même tragique solitude. A quatorze ans, Mouchette, fille d`un ivrogne des Flandres, ne parle guère, ne joue pas avec ses camarades, ne donne pas comme elles des rendez-vous aux garçons dans les carrières. Son âme se refuse, non par volonté, mais par un orgueil instinctif, et peut-être avant tout par un besoin de pureté. Le monde n'existe pas pour Mouchette, ce n'est pour elle qu'un rêve, plutôt un brouillard sombre. Un soir, alors qu`elle est seule sur la route, loin de la troupe agitée des écolières, elle est soudain prise, happée par une terrible tornade : la pluie qui l`alourdit la jette dans le fossé boueux. Elle entend des pas : c`est M. Arsène. compagnon de beuveries de son père, braconnier et contrebandier. Ensemble, ils vont se réfugier dans une cabane. Le vent déchire les pans de bois et, pendant que Mouchette se sèche à la flambée, M. Arsène, qui est tout à fait saoul, sort dans l'orage. Effrayée, Mouchette entend dans le lointain deux coups de fusil espacés. Arsène revient : avec réticences, il confesse son crime à la fillette : il a rencontré le garde-chasse, les deux hommes étaient ivres, le garde a mordu la main du braconnier, celui-ci a frappé, très fort, et le garde, maintenant, doit râler dans un fossé.. Mouchette ne connaît point son âme : privée des autres, elle est aussi privée d`elle-même. Arsène la fascine. Pour la première fois, un autre être lui a parlé, s'est confié à elle. Et lorsque le contrebandier, vaincu par l'alcool, s'abat sur le plancher, Mouchette, dans une immense rêverie heureuse. lui prend doucement la tête. Alors Mouchette, pour la première fois de sa vie, chante., Pendant que l'orage déchire la nature, et révèle toute la solitude des deux êtres, Mouchette se donnera au contrebandier.
Au moment de quitter M. Arsène, Mouchette lui demande ce qu'elle devra dire si on l'interroge sur le meurtre du garde. Quel meurtre? M. Arsène ne se souvient de rien : oui, il a vu le garde, ils ont eu des mots. mais ensuite, ils sont allés boire ensemble et rien ne s'est passé. Mouchette s'étonne, sans doute Arsène a une absence. Mais. le lendemain, le garde lui confirmera qu'il ne s`est rien passé. Rien. Et l'orage? Ce n'était qu'une pluie légère comme il y en a tant par ici ..
"... Il avait beau parler maintenant avec beaucoup de calme, la fille n’était pas dupe. Elle épiait ardemment ce visage pourtant connu, il lui semblait qu’elle le voyait pour la première fois. Ou mieux encore, que c’était là le premier visage humain qu’elle eût réellement regardé, absorbée dans une attention si forte et si tendre qu’elle était comme une effusion de sa propre vie. Elle ne songeait pas à le trouver beau. Il était seulement fait pour elle, il tenait aussi à l’aise dans son regard que le manche de son vieux couteau dans sa paume – ce couteau trouvé un soir sur la route, et qui était l’unique chose qu’elle possédât en ce monde, ne l’ayant montré à personne. Elle eût bien désiré poser la main sur ce visage, mais la couleur dorée, aussi chaude que celle du pain, la rendait assez heureuse.
Certes, ce n’est pas un beau visage. Ceux des acteurs de cinéma, qu’elle a vus parfois dans les journaux, appartiennent à des hommes trop différents d’elle, qu’elle ne connaîtra jamais, qui ne lui inspirent qu’un mépris mêlé d’envie. Au lieu que celui-ci est un visage fraternel, un visage complice. Il lui est devenu tout â coup, en un éclair, aussi familier que le sien. Le plaisir qu’elle trouve à le contempler ne vient pas de lui, mais d’elle, du plus profond de son être, où il était caché, attendant de naître, ainsi que le grain de blé sous la neige. Et ce plaisir ne dépend ni du lieu ni de l’heure, rien n’en saurait altérer la puissante et suave essence. Un instant aboli, il renaîtrait de lui-même, selon un rythme aussi naturel, aussi régulier que celui du sommeil ou de l’appétit.
Mon Dieu, sans doute, il lui est arrivé de penser à l’amour, mais pour surmonter une révolte physique dont elle n’est jamais maîtresse, et qui d’ailleurs en secret lui fait honte, elle doit s’efforcer d’imaginer des êtres aussi différents que possible de ceux qui l’entourent, et son imagination se lasse vite. Tandis qu’à cette minute le visage qu’elle tient si précieusement tout entier dans son regard, avec une sollicitude farouche, la laisse aussi tranquille, aussi rassurée que l’image même du sien lorsqu’il lui arrive de le rencontrer dans l’unique glace de la maison. Oui – il était cela précisément – un double mystérieux de son propre visage, mais plus cher mille fois. Car certains jours, sans avoir besoin d’aucun miroir – lorsque, par exemple, les railleries de Madame, frappant au hasard, trouvent tout à coup le point douloureux, quand elle sent monter à ses joues la rougeur inexorable et ce frémissement du menton qui annonce et précède le sanglot – elle déteste sa figure, elle la méprise. Au lieu que le visage de M. Arsène ne lui sera jamais odieux ni ridicule. Même ce rictus hagard de l’ivresse qu’elle haït tant sur la face de son père et qu’elle retrouve, hélas ! sur celle de son ami, ne lui inspire qu’une espèce de compassion tendre, et un autre sentiment qu’elle ne connaît pas du tout – car les gosses lui font horreur – d’humilité protectrice, d’inaltérable patience, d’une patience plus forte que tous les dégoûts – l’instinct maternel frais éclos dans sa conscience, aussi fragile qu’une rose de mai.
– Monsieur Arsène, dit-elle, si vraiment le garde n’est pas mort, à quoi bon raconter que je vous ai vu devant l’estaminet ?
Faudrait bien trouver autre chose. Il est debout contre le mur, les mains croisées derrière son dos, et il la regarde de haut en bas, la tête penchée. D’énormes gouttes de sueur perlent à la racine de ses cheveux, coulent une à une sur sa poitrine nue...."
Mouchette a rêvé, mais dans ce rêve, elle a abandonné son secret, sa réalité, elle s`est livrée à Arsène et s`est dissoute dans ce monde qu`elle refusait. Au milieu de son entière solitude. il n`y avait que sa pureté qui la rattachait encore à elle-même. Et la jeune fille ira se glisser pour mourir dans l'eau trouble, au fond de la carrière, où ses amies de classe attendent les garçons....
Robert Bresson adaptera "Mouchette" en 1967, avec Nadine Nortier et Jean-Claude Guilbert..

1938 – Les Grands cimetières sous la lune
Des apostrophes passionnées, de longues attaques au cours desquelles violence verbale, ironie, humour corrosif se succèdent, Bernanos dénonce violemment les répressions franquistes de la Guerre d'Espagne. Il a commencé ce travail quasi-expiatoire en voyant passer dans des camions des condamnés à mort qui savaient seulement qu'ils allaient mourir : « J'ai été frappé par cette impossibilité qu'ont les pauvres gens de comprendre le jeu affreux où leur vie est engagée. [...] Et puis, je ne saurais dire quelle admiration m'ont inspirée le courage, la dignité avec laquelle j'ai vu ces malheureux mourir ». Alors qu'il a été éduqué dans l'horreur des événements français de 1792, Bernanos ne comprend pas l'attitude complice de ceux qui se donnent l'apparence d'être des braves gens.
Armé d'une lucidité infinie et de mots dont la beauté aride trahit l'impuissance de l'écrivain face à l'horreur, il dénonce tristement cette spirale de la guerre qui enferme les individus dans des réactions collectives dont ils ne sont plus les maîtres." Ces "grands cimetières", ce sont en fait aussi bien ceux de la guerre de 1914, oubliés par la nouvelle génération assoupie dans les habitudes. que ceux de la guerre d`Espagne. Celle-ci éclata en 1936, Bernanos était alors à Majorque, son fils combattit quelque temps dans les rangs des nationalistes. C'est le premier ouvrage de ceux de la déception, suivront "Nous autres Français", "Scandale de la vérité", où l`écrivain instaurera le procès "spirituel" de ses anciens amis politiques de l`école maurrassienne. Pour lui, la position à choisir s'impose rapidement, la guerre d'Espagne est un scandale, mais elle est le signe d'un scandale beaucoup plus vaste, plus ancien et sans doute, plus durable que la seule équipée du général Franco et de ses compagnons. Scandale de l`Eglise ? «S`il m`arrive de mettre en cause l`Eglise, écrit-il, ce n`est pas dans le ridicule dessein de contribuer à la réformer. Je ne crois pas l'Eglise capable de se réformer humainement, du moins dans le sens où l'entendaient Luther et Lamennais. Je ne la souhaite pas plus parfaite, elle est vivante". Scandale donc des "bien-pensants" de l`Eglise, déjà dénoncés dans "La Grande Peur des bien-pensants". Lui qui paraissait l' "homme de droite", nationaliste, antisémite avec Drumont, c'est aux hommes du ralliement, qui rêvaient de réconcilier l'Eglise et le monde moderne, qu`il s'en prend. Les Grands Cimetières marquent un renversement dans l`évolution de Bernanos. Ce qu`il dénonce dans la collusion des catholiques et de l`aventure franquiste, c'est une nouvelle rupture entre l`Eglise de Dieu et les pauvres. Les séductions qu'exercent les tyrannies politiques ou les démagogues sur les gens d'Eglise les plus raisonnables témoignent d`une désincarnation de la foi, d'une habitude, désormais bien prise chez trop de chrétiens, de regarder le monde avec les yeux du monde - et non ceux de la grâce - Dieu se retirant du monde, se retire de nous tout d'abord...
"Les Grands Cimetières sous la lune", on l'a noté, se déroule dans une atmosphère encore plus lourde que "La Grande Peur" : Bernanos est désespéré, la mort de la chrétienté, qu`il envisageait dans son premier pamphlet comme un futur, lui apparaît maintenant comme en voie de réalisation. Celui qui attaque Franco et les hommes de droite qui en France le soutiennent est loin d`être démocrate, c'est un homme d'ordre déçu par ce qu'il se rend compte que cet ordre dont rêvent les modernes n'est qu'un mot, et qu`il est radicalement étranger à l'essence même de l`ordre qu'est l`amour surnaturel.

1946 - Monsieur Ouine
Cette oeuvre est connue pour être le plus déconcertant des romans de Bernanos. L'auteur a rassemblé tous ses personnages dans un village, que le meurtre d'un petit vacher, dont on découvre le corps dans un ruisseau, fait entrer dans la démesure d'une damnation qui n'épargne aucun de ses habitants. Qui aime le mal? personne, sans doute, mais "lequel d'entre nous, si cela était en son pouvoir, oserait le chasser du monde?" Et Monsieur Ouine, professeur retraité, curieux de botanique, qui semble trop bien éduqué pour tuer un homme, s'avère pourtant la maître des lieux parce que"maître des âmes" et démon de ce village damné..
"Elle a pris ce petit visage à pleines mains – ses longues mains, ses longues mains douces – et regarde Steeny dans les yeux avec une audace tranquille. Comme ses yeux sont pâles ! On dirait qu’ils s’effacent peu à peu, se retirent… les voilà maintenant plus pâles encore, d’un gris bleuté, à peine vivants, avec une paillette d’or qui danse. « Non ! non ! s’écrie Steeny. Non ! »
Et il se jette en arrière, les dents serrées, sa jolie figure crispée d’angoisse, comme s’il allait vomir. Mon Dieu !
– Que se passe-t-il ? Voyons, Steeny, interroge une voix inquiète, toute proche, de l’autre côté des persiennes closes. Est- ce vous, Miss ?
Mais elle l’a déjà repoussé violemment, sauvagement, et reste debout sur le seuil, indifférente !
– Eh bien, Steeny, méchant garçon !
Il hausse les épaules, jette vers la porte un regard dur, un regard d’homme.
– Maman ?
– Je croyais t’avoir entendu crier, dit la voix déjà lasse. Si tu sors, prends garde au soleil, mon chéri, quelle chaleur !
Quelle chaleur en effet ! L’air vibre entre les lamelles de bois. Son nez contre la persienne, Steeny le hume, l’aspire, le sent descendre au creux de sa poitrine jusqu’à ce lieu magique où retentissent toutes les terreurs et toutes les joies du monde…
Encore ! Encore ! Cela pue la céruse et le mastic, une odeur plus puissante que l’alcool où se mêle bizarrement l’haleine toujours moite des grands tilleuls de l’allée. Voilà que le sommeil l’a pris en traître, d’un coup sur la nuque, en assassin, avant même qu’il
ait fermé les yeux. L’étroite fenêtre s’ébranle lentement, vacille, puis s’allonge démesurément comme aspirée par en haut. La
salle entière la suit, les quatre murs s’emplissent de vent, battent tout à coup comme des voiles…"
Un événement, le meurtre d'un petit vacher dont on découvre le corps dans un ruisseau, qui pourrait être le début d`une intrigue policière, sert simplement à Bernanos pour crever l'abcès secret qui ronge la communauté de Fenouille. La méchanceté des habitants va être forcée dans sa retraite et contrainte de s'étaler au grand jour. Qui a tué le vacher? Le lecteur ne le saura jamais et sans doute Bernanos lui-même ne s'est pas soucié de le savoir. Est-ce le maire, ce lamentable M. Arsène, à l`âme amollie par la débauche, obsédé par l`idée d'être sale, pourchassé par un regret de la pureté qui n`est pas assez fort pour le détacher du mal? Est-ce Mme de Néréïs, châtelaine inquiétante et luxurieuse, qui porte par trop d'attention aux jeunes gens et que le village a surnommée "Jambe de laine"? Comme M. Arsène, Jambe de laine est déchirée entre la nostalgie de la pureté et la complaisance envers le mal. Sans doute. le péché la contraint à éprouver du dégoût pour elle-même, mais elle aime ce dégoût : "Qui aime le mal? demande-t-elle. Et pourtant, lequel d'entre nous, si cela était en son pouvoir, oserait le chasser du monde ?"...
" – Comment ? Que dites-vous ? Qui peut voir clair en soi ? Et par exemple, qui aime le mal ? Et pourtant lequel d’entre nous, s’il était en son pouvoir, oserait le chasser du monde ?
Elle appuie le menton sur sa main et Philippe voit maintenant de bas en haut les admirables yeux où le jour perd de nouveau toute couleur, pâlit, s’efface.
– Moi aussi, j’ai souhaité de plaire, jadis… À quoi bon plaire ? Qu’importe de trouver le plaisir dans le plaisir d’autrui ? Que m’importe de recevoir ce dont j’ai d'avance acquitté le prix ? Mais cela… cela que nul ne donne volontiers, cela qu’on cède à regret, gémissant et pleurant, cela, cela seul…
Sa phrase s’achève en une espèce de murmure qu’elle étouffe entre les genoux de Philippe. À travers l’étoffe, il sent son souffle long et puissant, rythmé comme celui d’un animal au repos. Dort-elle ? Il se repousse doucement dans l’ombre, respire à peine, aussi immobile qu’à la lisière du bois de Fenouille lorsqu’il affûte ses ramiers."
Est-ce enfin M. Ouine, ce correct professeur retraité, curieux de botanique, mais aussi des âmes? Il est vrai que M. Ouine est trop bien élevé pour tuer un homme. On devine cependant qu'il est le maître du jeu non par de sombres conspirations, mais parce qu`il est le maître des âmes, le démon de ce village damné. ll a cette curiosité maligne, pour Bernanos un des signes évidents de la présence diabolique, celle même qui dévorait l`abbé Cénabre dans "L'imposture" : il veut découvrir, posséder les âmes, le secret de Dieu. Dans ce roman, le diable seul semble être actif, toutes les issues sont bouchées et les personnages sont prisonniers ; la tragédie ira jusqu'à son terme. Mme de Néréïs sera lynchée par la foule, M. Ouine mourra aussi, veillé par un jeune garçon ivre....
La mort de Jambe-de-laine..
"Naturellement la chose se passa au moment qu'on ne l'attendait plus. Comme Simonet s'approchait de nouveau, grimpant sur le tertre, le visage du Belge se trouva juste à la hauteur du sien, elle y enfonça ses griffes puis se détendit comme un arc et les bras levés, dans un effrayant silence, elle se jeta en avant, plongea. Le cri qu'elle retenait depuis si longtemps jaillit de sa gorge, éclata au-dessus des têtes. Presque à la même seconde, elle atteint le mur du cimetière et avec une agilité prodigieuse, pressant son corps contre la grille, elle se glissa de barreau en barreau vers le portail. Fou de rage, Simonot, légèrement blessé au front, montrait à tous son visage ensanglanté. "Elle lui a crevé les yeux, la garce !" hurla une femme.
Ce mot décida probablement du sort de Jambe-de-Laine : la foule y répondit par un merveilleux murmure. Quelques secondes encore elle hésita, parut tourner sur elle-même de ce mouvement familier au chat qui feint de laisser échapper sa proie, au cours de ses jeux féroces. Ceux qui se pressaient à la grille jurèrent qu'lis n'avaient pu l'arrêter. "Elle nous a filé entre les jambes", dirent-ils. Mais elle apparut brusquement à tous, seule au milieu de la route, laissée libre, et avant qu'ils eussent pu faire un pas, ils avaient assisté à une scène extraordinaire.
La grande jument accourait au petit trot, les guides flottantes, secouant son mors avec un petit hennissement de plaisir. Personne ne sut jamais d'où était sortie l'étrange bête : il est probable que sa maîtresse l'avait laissée à l'abri contre le talus du cimetière, dans le chemin très étroit et sans issue qui un peu plus bas aboutit au pâturage banal connu sous le nom du Plan du Marais. La voiture vide grinçait et dansait derrière elle à chaque cahot. Jambe-de-Laine y sauta d'un bond, et trouvant déjà la route barrée sur la droite, laissa glisser la roue dans le fossé peu profond, pivota en un clin d'œiI sur ce point fixe et sans même toucher aux rênes nouées au dossier du siège, d'un simple claquement de langue, fit faire à la bête un bond de quinze pieds.
- Gare là-dessous! cria quelqu'un d'une voix étranglée.
Mais l'avertissement vint trop tard, se fondit dans une de ces clameurs effrayantes qui, ressemblant à un chant, sont la voix même de la foule. En se rassemblant sur les hanches pour bondir, la jument avait lancé en avant sa jambe droite. Le sabot atteignit légèrement à la poitrine le petit Denisane qui tourna deux fois sur lui-même et demeura immobile, le nez dans la poussière. On n'entendit plus que le roulement des grosses semelles qui dégringolaient le talus.
Le premier qui se saisit des rênes fut un valet du nom de Roblard, mais Il nia depuis avoir frappé la bête aux naseaux. ll fut d'ailleurs si brutalement jeté de côté qu'il se démit l'épaule
et ne prit plus aucune part à ce qui suivit. On prétend que la voiture renversée fut traînée plus de vingt mètres; du moins les gendarmes retrouvèrent le lendemain la marque profonde laissée sur le sol. Mais il est probable que le poids des assaillants cramponnés en grappe au marche-pied resté libre suffit à la remettre debout. lls entendirent au-dessus de leurs têtes le double claquement du fouet, lâchèrent prise et virent avec stupeur la silhouette noire de la châtelaine que le choc effroyable n'avait pu arracher de son siège. "Nous croyions l'avoir manquée, dirent-ils, mais nous courions quand même derrière pour voir." Dès ce moment, ils étaient sûrs que la voiture n'irait pas loin. "Elle sautait çà et là comme une grenouille, à cause de I 'essieu faussé." Au virage, la roue sortit de son axe et s'échappa vers le bas-côté de la route, en zigzaguant.
Ils virent Jambe-de-Laine s'élancer hors des débris, grimper le revers du talus et elle leur apparut une dernière fois sur le ciel gris, les haillons de soie noire retombant jusqu'à ses genoux en longues franges que le vent soulevait à peine. Certains se vantèrent plus tard de l'avoir vue pleurer bien qu'avec un visage de pierre. Lorsqu'ils atteignirent la côte tous ensemble et trébuchant, elle leva les bras sans mot dire. Son flanc gauche, mis à nu, était blanc comme de la neige. « Nous voulions l'arrêter, la conduire aux gendarmes, au maire, mais les femmes qui croyaient le petit Denisane mort étaient les plus enragées."
Le premier qui porta la main sur elle fut probablement le fils Riquet, dit "Pipo", un jeune garçon de vingt ans. Plusieurs du moins l'affirmèrent. "Il I'a prise à la gorge, on a bien reconnu sa main, rapport au doigt qui lui manque...." Et la foule furieuse, de l'autre côté de la route, pressée contre la haie du cimetière, entendit alors très distinctement la voix de la châtelaine de Néreis. Elle cria deux fois "Philippe". On remarqua que Pipo Riquet s'appelait, en effet, de son vrai nom Philippe, sans pouvoir néanmoins affirmer que ce fût à lui que s'adressait le suprême appel de cette femme extraordinaire..." (Monsieur Ouine)

1950 - Un mauvais rêve
"... Le soir descend invisible comme toujours, semble couler des façades trempées de pluie et Mainville pense à d’autres soirs en regardant cligner l’œil unique, fulgurant, du Bar-Tabac. Comme de lui-même son mince doigt s’est porté à sa tempe et il compte machinalement les pulsations de l’artère chaque jour plus précipitées, plus brèves, avec des pauses insolites, de longs silences qui lui font monter la sueur au front. Dieu, qu’il a peur de mourir ! Qu’il est seul ! Appartient-il réellement, ainsi que le veut Philippe, à une génération malheureuse, expiatoire ? Le mot de malheur ne lui représente rien d’exaltant, il n’éveille en lui que des images sordides de malchance, d’ennui, et ces catastrophes prochaines que prédisent inlassablement ses aînés ne lui inspirent aucune espèce de curiosité...."
Oeuvre posthume de Georges Bernanos, achevé vers 1935, alors que l'écrivain. en proie à des difficulté financières, songeait à vivre grâce à des romans policiers écrits en dehors de son cycle littéraire. "Un mauvais rêve" commence comme roman policier mais devient très vite un roman où l`on pouvait retrouver les thèmes habituels de l`auteur : possession, imposture, vide effrayant de certaines âmes. Dans le principal personnage, M. Ganse, romancier sur le déclin dont la veine littéraire, qui lui avait servi jusqu`ici à se débarrasser de ses mauvais rêves, est sur le point d'être tarie. Bernanos a transposé ainsi ses soucis d`argent et surtout certains travers propres à l`homme de lettres, grossis à la taille de la fiction. Bernanos attachait en effet une grande importance à la mission de l`écrivain, c`est pourquoi M. Ganse est menacé d'une de ces irrémédiables chutes intérieures qui n`arrivent habituellement qu'aux mauvais prêtres. Esclave de sa célébrité et de sa légende, M. Ganse, lorsque sa plume cesse de le servir, est mis en face de sa réalité. c`est-à-dire de son néant.
".. Il se leva, parcourut la pièce de long en large de son pas pesant.
– Ce n’est pas que je manque d’idées, reprit-il. Je n’en ai que trop. On ne me suit pas, voilà le mal. Il faudrait me suivre. Vous-même, mon enfant, vous ne me suivez plus, vous piétinez, nous perdons du temps à des broutilles. Tenez, par exemple, une nouvelle de trois cents lignes, ça doit sortir en deux heures, ou ne pas sortir du tout. Voilà comment travaillent les Maîtres.
Une fois parti, le reste va de soi : simple question de démarrage. Et c’est ce qui rend justement le rôle d’une collaboratrice telle que vous si curieux, si passionnant… Le démarrage dépend de vous. Il suffit parfois d’un regard, d’un simple regard pour tout compromettre, parfaitement ! Avant d’avoir ouvert la bouche ou dicté une ligne, je vois le vôtre qui flanche. Et pourquoi ? Parce que vous avez peur, chère amie. Vous ne croyez plus en moi, tous !
Il frappa violemment sur la table de son poing fermé.
– Qu’importe ! S’il le faut, je reprendrai la chose, je commencerai une nouvelle carrière. Des œuvres aussi vastes, aussi fécondes que la mienne doivent s’élargir sans cesse, au lieu de se creuser. Je travaille dans la fresque, je ne suis pas un ciseleur de bibelots rares. Tenez, pas plus tard qu’hier, chez Beauvin, je me suis senti plus gaillard que jamais, en pleine forme. Il y avait là des Russes étonnants, qui racontaient des histoires… des… des histoires étonnantes !
Son regard évita brusquement celui de son interlocutrice impassible, car la répétition involontaire des mots était un signe qu’il connaissait bien, – trop bien. Il avala péniblement sa salive.
– On m’a parlé du fils d’un ancien maréchal de la Cour, né au Palais en 1913, réfugié en France avec un vieil oncle, lui-même ex-chambellan, qui pour vivre, ses derniers bijoux vendus, avait accepté une place de veilleur de nuit. Le garçon a poussé tout seul, là-bas, du côté de Belleville, pêle-mêle avec les copains français, et il est maintenant ouvrier quelque part, je ne sais où, un vrai titi parigot. Il ignore tout de son pays, rigole lorsqu’on lui parle des Romanoff, lui, un filleul de l’empereur !
Je crois qu’il y aurait quelque chose à tirer d’une histoire pareille, quelque chose d’éton… Bon Dieu de bon Dieu ! Répondez-moi donc, à la fin. Êtes-vous sourde ?
– Je réfléchissais, dit-elle. Je ne trouve pas.
– Naturellement ! Hé bien ! s’il n’était pas si tard, je vous prouverais le contraire. Oui, en une heure, je ferais le pari de vous dicter, là, sur ce coin de table, une nouvelle éton… épatante, parole d’honneur ! Juste ce qu’il nous faut pour jeudi – le conte hebdomadaire du Mémorial.
Du bout du doigt, elle entrouvrait déjà le portefeuille de cuir.
– Laissez ça, fit-il avec un soupir, pas de blague. Je dîne chez Renouville, ce soir. De toutes manières… Il passa les deux mains sur sa nuque épaisse et comme Simone refermait la serviette en silence, il éclata :
– Ce n’est pas moi qui suis vidé, fit-il d’une voix effrayante, ce sont eux. Le monde se vide. Il se vide par en bas, comme les morts. Plus rien dans le ventre, plus de ventres. Comme disait
l’autre jour je ne sais quel bedeau dans une feuille pieuse : « Ganse n’a jamais visé plus haut que le ventre. » Parfaitement ! Et il n’y a pas de quoi rougir. Dans une société sans ventre, que deviendraient l’art et l’artiste, je vous le demande ! Ils pourraient crever. Pauvres types ! Il est facile de raisonner sur les passions, le difficile est de les peindre. Et si je les peins comme il faut, je parle aux ventres, j’émeus les ventres… Mais quoi ?
Toutes les époques d’impuissance ont eu de ces délicatesses hypocrites. Un ventre est un ventre… Qu’est-ce qu’ils ont à la place, ces petits messieurs, ces coupeurs de fil en quatre, la dernière couvée de M. Gide ! Une poche de pus – et quel pus ? Du pus cérébral, ma chère. Ah ! Ah ! L’image n’est pas mauvaise.
Notez-la.
Il fit craquer ses doigts avec fureur.
– Vidé, moi ? Allons donc ! J’arrive à un âge où un écrivain de génie devrait pouvoir se libérer de toute discipline de travail.
Le problème est là. Plus d’heures de classe ! Désormais la machine est au point, rodée à fond, tourne nuit et jour. Il suffirait de la surveiller, d’en surveiller les produits et les sous-produits, de ne rien perdre. Et ça, ma petite, c’est votre affaire. « La concentration vous épuise ! » rabâche cet imbécile de Lipotte. Elle m’épuise justement parce qu’elle me m’est plus nécessaire.
Tenez, une preuve : Dieudonné me disait l’autre soir : « Vous êtes un improvisateur merveilleux ! » Et pourtant soyez franche, mon enfant : voilà seulement trois ou quatre ans, je ne brillais guère dans un salon, j’étais un causeur très quelconque ?…
Elle passait doucement la paume sur le cuir de la serviette, et son regard attentif restait froid.
– Oui, reprit-il après un long silence, d’une voix bien différente et dont il ne cherchait même plus à masquer l’angoisse, ils croient tous avoir ma peau. Minute ! Depuis l’année dernière,
neuf cents pages de texte, trente-cinq nouvelles de deux cent cinquante lignes, sans parler des conférences, d’un scénario pour Nathan, et je ne dis rien des notes publicitaires, çà et là.
Mais on me compare toujours à moi-même, jamais aux autres : Ganse est Ganse.
Il s’arrêta, braquant sur la secrétaire silencieuse ce regard infaillible qu’allume dans ses yeux la curiosité portée à son paroxysme et qui n’est chez lui qu’une forme de la cruauté demi-consciente, principe de son noir génie.
– La pire bêtise que j’ai faite est d’avoir ouvert ma porte à deux de ces petits messieurs, Mainville et Philippe, Philippe et Mainville, deux jolies canailles, canailles à croquer ! La jeunesse ! Il y a toujours un moment dans la vie où l’on croit à la jeunesse. Signe précurseur, signe fatal du premier fléchissement, de la vieillesse qui s’annonce – la vieillesse, l’âge le plus niais, le plus crédule – oui, plus niais et plus crédule que l’adolescence. Croire à la jeunesse ? Est-ce que nous y avons cru, nous autres, quand nous étions jeunes ? Alors !… Passe encore pour Philippe, mais Mainville, cette petite vipère…"
Cas similaire, Philippe, le neveu de Ganse, communiste du grand monde, qui se suicidera dans une chambre d`hôtel en face de son ami Olivier Mainville, qui n'aura rien fait pour empêcher son geste.
Plus trouble, plus vide encore qu'Olivier, mais finalement révoltée contre elle-même est sa maîtresse, Simone Alfieri, secrétaire de M. Ganse sur laquelle pèse le soupçon du meurtre de son mari. Le couple, privé de tout amour. n`est guère uni que par le goût de la drogue. Simone finira par imaginer d'assassiner une vieille parente de son amant, afin de faire profiter celui-ci de l'héritage. Elle conçoit, avec de grandes précautions, l'attentat, et, après une marche fantastique en pleine nuit dans la campagne, elle arrive à la demeure de la vieille dame.
" À ce moment, dégrisée par la peur, l’absurdité de son entreprise, la certitude de l’échec lui apparurent de nouveau avec une telle force d’évidence qu’elle ferma les yeux comme sous un choc en pleine poitrine, étouffa un gémissement. Le désespoir seul avait pu l’amener jusque-là – un désespoir dont elle n’avait jamais eu qu’à de rares minutes, une claire conscience – désespoir sans cause et sans objet précis, d’autant plus redoutable qu’il s’était lentement infiltré en elle, imprégnant ainsi qu’un autre poison plus subtil chaque fibre de sa chair, courant à travers ses veines avec son sang. Nulle parole n’eût pu l’exprimer, nulle image lui donner assez de réalité pour frapper son intelligence, tirer sa volonté de son engourdissement stupide. À peine se souvenait-elle de l’enchaînement des circonstances, liées entre elles par la logique délirante du rêve, qui l’avaient entraînée jusque-là, et pour quel dessein elle y était venue. Le seul sentiment qui subsistât dans cette horrible défaillance de l’âme était cette sorte de curiosité professionnelle apprise à l’école du vieux Ganse. Comme à ces tournants d’un livre où l’auteur ne se sent plus maître des personnages qu’il a vus lentement se former sous ses yeux, reste simple spectateur d’un drame dont le sens vient de lui échapper tout à coup, elle eût volontiers tiré à pile ou à face un dénouement, quel qu’il fût. L’angoisse qu’elle ne réussissait pas à dominer ne ressemblait d’ailleurs pas à celle de la crainte : c’était plutôt la hâte d’en finir coûte que coûte, une sorte d’impatience, si l’on peut donner ce nom à la fureur sombre, implacable, qui se fût aussi bien tournée en ce moment contre elle-même.
Ses mains tremblaient si fort qu’elle eut beaucoup de mal à soulever sa machine pour franchir le fossé peu profond qui sert de clôture au parc de Souville. Trompée par l’obscurité de la haute futaie, elle crut dissimuler assez la bicyclette en l’enfonçant de quelques pieds dans la broussaille, et commit encore l’imprudence de la laisser dressée contre le tronc d’un pin. Ne prenant même pas la peine d’éviter les pierres branlantes qu’elle entendait rouler bruyamment derrière elle sur la pente, elle atteignit l’allée principale où elle s’engagea aussitôt, sans autre souci que d’atteindre au plus vite la maison maintenant toute proche, absolument comme si elle eût été une visiteuse ordinaire. Et peut-être en ce moment était-elle cette visiteuse, en effet. Mais une rencontre inattendue allait décider de son destin.
Les mains étendues en avant pour éviter les branches basses qui secouaient sur ses épaules, au passage, une poussière d’eau, elle déboucha brusquement de la futaie, se dirigeant droit vers le perron, avec une sûreté de somnambule. Et déjà ses pieds s’enfonçaient jusqu’à la cheville dans l’herbe gluante de la pelouse, lorsqu’une voix la cloua sur place...."
On s'attend à un crime parfait, mais, à peine le geste achevé, Simone rencontre un prêtre avec lequel elle avait fait quelques pas et sent que son âme, à découvert, n'a plus qu`à confesser sa défaite. Des âmes vides qui ne se supportent plus : si Simone tue, c`est moins pour s`emparer de l'héritage que pour se prouver qu`elle petit encore sortir d`elle-même, rejoindre le monde, reprendre la maîtrise de son âme; des âmes solitaires que rien, sinon la commune possession, ne sait plus unir ...
