- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Karen Blixen/ Isak Dinesen (1885-1962), "Sept contes gothiques" (Seven Gothic Tales, 1934), "La Ferme africaine" (Out of Africa, 1937), "Le Dîner de Babette" (Anecdotes of Destiny, 1958), "Ombres sur la prairie" (Shadows on the Grass, 1961) - ...
Last update: 2023/02/02

"Ce que je désire de tout mon être c'est la vie, et ce que je redoute et devant quoi je fuis c'est le vide et l'anéantissement" - De ses lointains ancêtres scandinaves, Karen Blixen a rentenu ce respect quasi religieux de la Nature, qui entraîne une humble soumission à toutes ses manifestations et l'acceptation infinie d'un plan quasi divin qui embrasse toute notre existence. Son expérience africaine lui révèlera l'abîme qui la sépare de cette vision petite-bourgeoise marquée du sceau d'un matérialisme stupide et cupide qui semble animer, en la dissimulant, la société aristocratique danoise de son époque . Elle découvre, au-delà des jugements que l'on peut aujourd'hui porter sur la vérité d'un racisme du Blanc inhérent à son sentiment de puissance, que l'Afrique vivante est en accord avec elle-même, accepte son destin tout en s'adaptant à son milieu naturel, que chaque Africain sait d'instinct ce que les Européens ont oublié, que le bonheur et le malheur, la joie et la souffrance appartiennent à titre égal à la vie: «Je crois que, pour donner en échange quelque chose à quelqu'un, la vie exige qu'on l'aime sous tous ses aspects, et non pas seulement certains de ses côtés ni seulement ses propres idées et idéaux ; et quand tu parles de ma conception de la vie, je n'en ai pas d'autre que celle-ci.» (février 1918).
Avec cet art de conter qui lui donne tant de puissance, - "stories have been told as long as speech has existed, and sans stories the human race would have perished, as it would have perished sans water" (des histoires ont été racontées depuis que la parole existe, et sans histoires, la race humaine aurait péri, comme elle aurait péri sans eau) -, l'écriture de Karen Blixen, porte non seulement son existence, mais nous montre que la réalité est sous-tendue par une vérité bien plus profonde que la seule magie de l'imagination nous donne à voir, à entendre, à ressentir. Et plus encore, voici une narration qui peut, à elle seule, générer des expériences et créer de nouvelles réalité ...
"... Vous souvenez-vous aussi que je disais préférer les animaux sauvages aux animaux apprivoisés - et qu'ils me semblaient plus respectables - parce que, contrairement aux autres, ils avaient un rapport direct avec Dieu? "Regardez des canards dans une cour de ferme - ils s'activent mais nous ne pouvons distinguer de but dans leur activité. Et levez ensuite les yeux vers le ciel et regardez passer le vol des canards sauvages! Comme ils sont conscients de leur but! - oui, au point que nous sur terre qui les voyons et ne pouvons en aucune manière connaître leur but, nous le sentons et nous le reconnaissons. Leur vol est une trajectoire, comme celle d'une flèche !" C'est pour cette raison d'ailleurs que le seul personnage digne de respect dans «Le cavalier» me semble être Hubert. Il se trouve malgré tout en rapport direct avec Dieu - ou peut-être avec le diable -, et il se mêle de ses affaires. Les autres sont terriblement occupés et causent beaucoup, affreusement, mais on ne voit pas de but dans leur activité.
C'est la que réside la dignité de l'homme : il est en rapport direct avec les dieux. C'est là que résidait la dignité des lions et des girafes : ils étaient en rapport direct avec une divinité africaine que j'ignorais peut-être. C'est pour cela qu'il est horrible de les enfermer dans des jardins zoologiques et de placer des êtres humains - même pleins de bonne volonté - entre leur Dieu et eux. C'est ainsi que les Grands d'Espagne se trouvaient en rapport direct avec le roi d'Espagne, et plus ils étaient fiers, plus le roi était satisfait d'eux, c'était une gloire pour le roi d'avoir des serviteurs assez fiers pour qu'ils aient le droit de garder leur chapeau sur la tête en sa présence!
Voilà donc ce que je vous souhaite à Paris : que tout en donnant et en recevant parmi les hommes, vous sentiez néanmoins votre propre être aussi déterminé que celui d'une girafe ou d'un éléphant, aussi indépendant et aussi inébranlable. Que vous n'ayez pas une «valeur nominale» fixée par les hommes, mais que vous soyez pur et de bon aloi en vous-même.
À quoi est-on d'ailleurs bon si on n'a qu'une valeur nominale? On peut circuler et être utilisable dans un certain but, on peut tout miser sur une affaire ou une entreprise. Mais on ne peut rien donner de soi-même. Car la plus petite parcelle d'une pièce d'or de bon aloi, même la poussière obtenue en la grattant, est toujours de l'or. Mais un bout coupé d'un billet de cent couronnes - même la moitié - n'est rien, moins qu'un bout de papier blanc, sur lequel on peut quand même écrire...." (A Thorkild Bjornvig, Rungstedlung, le 6 juin 1950, Lettres du Danemark, traduction Gallimard 2002).












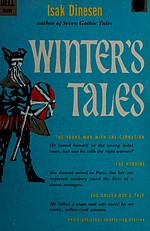



Karen Blixen/Isak Dinesen (1885-1962)
Née en 1885 à quinze miles au nord de Copenhague, à Rungstedlund, au Danemark, Karen Dinesen a grandi dans la vaste propriété familiale et a mené une vie aristocratique assez typique, une famille d'obédience luthérienne unitariste avec des gouts littéraires assez prononcés : son père, Wilhelm Dinesen, écrivit sous le pseudonyme de Bogdanis et son frère Thomas Dinesen publia à travers une vie aventureuse souvenirs, essais et nouvelles. Le capitaine Wilhelm Dinesen participera à la guerre prusso-danoise en 1864, puis partit vivre deux ans aux États-Unis parmi les tribus amérindiennes. En 1895, alors que Karen avait dix ans, Wilhelm s'est pendu, laissant sa femme élever seule ses cinq enfants. Bien que Karen ait peu connu son père, elle a souvent affirmé s'identifier à sa famille et à son sens de l'exploration. En comparant sa vie en Afrique à celle de son père en Amérique, Blixen écrivit ainsi: "il s'est détourné de l'Europe et de sa civilisation et a vécu pendant trois ans parmi les Indiens en Amérique du Nord sans voir un autre homme blanc". Le début de la vie de Blixen est en grande partie constitué de ce qu'elle décrit comme une enfance malheureuse dans un contexte de stricte sensibilité victorienne. Scolarisée à la maison avec un tuteur privé, Blixen ne correspondait pas aux attentes de sa famille. Blixen affirme même que les différences avec sa tante sont devenues "l'une des principales raisons pour lesquelles je suis allée en Afrique". Elle a commencé à écrire à l'âge de huit ans avec les histoires qu'elle racontait souvent à ses sœurs. Blixen a publié sous le pseudonyme d'Osceola, deux histoires en 1907 (Eneboerne, Les Reclus) et une autre en 1909 au Danemark ; toutes trois étaient des histoires de fantômes dont les protagonistes étaient des femmes. Jeune femme, elle fréquente une école de design à Copenhague, puis l'Académie royale danoise des arts, et poursuivit ses études artistiques à Paris en 1910 et à Rome en 1912. Des années plus tard, Blixen a déclaré que sa formation de peintre avait eu une influence majeure sur son œuvre : "La peinture m'a constamment révélé la vraie nature du monde. J'ai toujours eu du mal à voir à quoi ressemble vraiment un paysage, à moins qu'un grand peintre ne m'en ait donné la clé". Cette affinité pour les descriptions riches est devenue un fil conducteur dans ses écrits. Elle séjourne longuement à Paris et en Angleterre avant d'épouser, en 1914, son cousin suédois, le baron Bror von Blixen-Finecke (c'est Hans Blixen-Finecke qu'elle aurait aimé mais le frère jumeau de celui-ci qu'elle finit par épouse) ...
1914 - De 1914 à 1931, elle s'installe avec lui au Kenya pour créer une exploitation de café dans les collines de Ngong, - de même que son frère, Thomas. Son mariage s'est avéré malheureux et s'est soldé par un divorce en 1921, ainsi que par sa lutte contre ce qu'elle pensait être la syphilis contractée quelques années plus tôt et soignée dès 1915 à Nairobi avec force cures de mercure (provoquant une véritable intoxication chronique par métaux lourds marquée par quarante années de crises d'épuisement et de fièvre). Malgré cela, Blixen passa en Afrique années de son existences les plus libératrices et les plus stimulantes. Après son divorce, elle dirigea seule la ferme de café et vécut seule, une pratique peu courante à l'époque : "Ici, enfin, on était en mesure de se moquer de toutes les conventions, c'était une nouvelle forme de liberté que l'on n'avait trouvée jusque-là que dans les rêves". Blixen s'est retrouvée hors du monde victorien du Danemark et immergée dans l'aristocratie de l'Afrique coloniale, première colonisatrice, une position qui lui donne liberté et statut social, et alimente le contexte de ses écrits sur l'Afrique, que l'on retrouve dans ses romans "Out of Africa" et "Shadows on the Grass". Une attitude ambigüe que l'on a pu dénoncer, on a pu parler de "condescendance" (voire d'un certain racisme assimilant l'être humain africain aux animaux sauvages de ces contrées, selon le romancier et critique kenyan Ngugi wa Thiong'o, "Littérature et société"). L' opinion de Blixen sur les Masai, les Somali et les Kikuyu avec lesquels elle est entrée en contact varie en effet considérablement. Dans une conférence donnée en 1938, Blixen décrira ainsi ses sentiments à l'égard des indigènes au contact desquels elle a vécu : "J'aimais les indigènes. C'est en quelque sorte l'émotion la plus forte et la plus incalculable que j'aie connue dans ma vie. M'aimaient-ils ? Non. Mais ils comptaient sur moi d'une manière étrange, incompréhensible et mystérieuse. Une obligation stupéfiante"...
Evoquant en 1933 son désir d'écrire sur l'Afrique-Orientale (elle le fera cinq ans après l'avoir quittée), Karen Blixen nous dit ; "La vie que j'y ai vécue pendant dix-sept ans restera toujours pour moi ma vraie vie. J'ai ressenti au cours de cette vie une passion extrêmement forte, qui est l'amour que je porte aux Indigènes d'Afrique-Orientale - leur pays également, mais surtout aux gens. Je ne peux pas encore écrire sur tout ça, il faut que je prenne plus de distance; le faire maintenant serait comme écrire un livre sur un enfant qu'on viendrait de perdre. Et si je dois un jour écrire sur l'Afrique, le livre comportera à n'en pas douter une bonne part d'amertume et de critiques quant à la façon dont les Anglais ont traité le pays et les gens, et ont laissé s'abattre sur ce pays notre civilisation mécanique et mercantile. Ce ne sera pas une sorte de pamphlet politique, ce sera simplement un cri issu de mon coeur, qui en sortira autant que l'amertume a l'égard du servage qui imprègne les Récits d'un chasseur de Tourgueniev -- si je peux me permettre de comparer un de mes livres à un de ceux de ce grand. poète. Et j'ose a peine me lancer dans une telle entreprise pour un premier livre. Il serait préférable de bien des points de vue que je me sois fait auparavant un nom quelconque en tant qu'écrivain. Je tiens donc a faire tout ce qui est en mon pouvoir pour publier mes contes - car un livre africain, si jamais je parviens à l”écrire, signifierait quelque chose de très différent à mes yeux ..." (Lettres du Danemark, à Dorothy Canfield Fisher). "Out of Africa" (1937 ; Den afrikanske farm) traduiront un amour quasi mystique de l'Afrique et de ses habitants, une réminiscence poétique de ses victoires et de ses peines face à la perte de sa ferme, à la mort de son compagnon, le chasseur anglais Denys Finch Hatton - (sa passion pour l'aviateur britannique Denys Finch Hatton qui périra tragiquement en vol fut décrit, un peu abusivement, comme le point central de sa vie dans le film qu'en fit Sydney Pollack , en 1986, "Out of Africa") -, et à la disparition du mode de vie simple des Africains qu'elle admirait : "ce n'est sans doute qu'une fois dans l'existence que l'on vit" (1932) ...
1931 - Ruinée (mauvaise gestion, sécheresse, chute du prix du café), Karen Blixen regagne le Danemark en 1931, retournant vers une existence qu'elle percevra physiquement et intellectuellement comme une prison. Vivant de la générosité de sa famille, accueillie certes à bras ouvert par sa mère, elle tente de se réhabituer progressivement à une vie bourgeoise qu'elle pensait, dix-sept ans auparavant, avoir quitté pour toujours. J'ai peur, écrira-t-elle encore en 1941, que le Danemark "m'anéantisse", "au cours des dix années que j'ai vécues au Danemark, après l'Afrique, j'ai l'impression d'avoir beaucoup regréssé" (à Karen Sass, 16 septembre).
C'est donc à un âge avancé que Karen Blixen devient écrivain professionnel, l'écriture devint ce qui maintenait à flot son existence ...
"... La difficulté, pour moi, ce n'est pas, en réalité, la perte de Mère ou des autres disparus, mais ma relation avec la vie et les vivants, et le doute qui me hante de savoir si je suis vraiment en état d'avoir ma place parmi eux. Quand je suis rentrée d'Afrique, j'ai dit à Mère qu'elle n'avait pas grand-chose à attendre de moi, car une moitié de moi était restée a Ngong Hills - et j'ai maintenant le sentiment que la moitié du reste repose -, non pas au cimetière, mais dans le passé, en quelque sorte, ou dans l'univers même, sans aucune relation avec la vie de tous les jours ou du moins avec certaines de ses exigences. Il me semble aussi, d'un point de vue purement objectif, que c'est une tâche difficile de se trouver pour la deuxième fois de sa vie devant l''obligation de se créer une existence, alors qu'on est sorti de la jeunesse. Je n'entends pas cela d'un point de vue purement économique ou du point de vue de détails comme l'endroit où on va habiter, la manière de sien sortir, mais dans un sens beaucoup plus profond : comment vivre? Cela dit, j'ai ce temps ici pour clarifier tout ça; je ne suis pas obligée de me presser, je peux laisser les choses s'éclaircir pour moi à leur rythme...." (A Karen Sass, 18 avril 1939, Lettres du Danemark, traduction Gallimard).
1934 - Le premier recueil de Karen Blixen, "Sept contes gothiques", écrit en anglais et publié sous le pseudonyme d'Isak Dinesen, remporta un succès foudroyant en Angleterre et surtout aux Etats-Unis (elle continua à écrire, en règle générale, en anglais, - considérant que ses livres conviennent mieux à un public anglo-saxon qu'à un public danois -, et à se "traduire" en danois, publiant en Angleterre sous le nom d'Isak Dinesen et au Danemark sous celui de Karen Blixen).
Les écrits caractéristiques de Dinesen se présentent sous la forme de contes, des récits très élaborés dans la tradition romantique. Ses recueils comprennent, outre "Sept contes gothiques" (Syv fantastiske fortællinger), "Contes d'hiver" (1942, Winter's Tales, Vinter-eventyr).
En 1940, elle avait été chargée par le quotidien danois Politiken d'une enquête sur les villes de Londres, Paris et Berlin ; ces textes ainsi que d'autres seront repris dans le volume "Samlede Essays" (1965). Les nécessités financières la font écrire "The Angelic Avengers" (Les voies de la vengeance) et vers la fin des années 1940 livrer quelques "anecdotes of destiny" aux magazines américains à gros tirage, "Saturday Evening Post" ou "Ladies Home Journal".
En 1947, sa rencontre avec un cercle d'écrivains beaucoup plus jeunes qu'elle, autour des éditions Wivel et la revue Heretica, à Rungstedlund, ajoute un parfum de scandale à une chronique mondaine déjà sensibilisée à son visage énigmatique et à sa voix exceptionnelle. Dans ce cercle si riche dans lequel elle semble retrouver les impulsions qu'elle avait tant connues à Ngong, citons Thorkild Bjornvig (l'auteur du fameux "Pacte" (1974) dans lequel il décrit son amitié avec l'auteur) et Jorgen Gustava Brandt, le benjamin du groupe....
Ses "Winter’s Tales" (Contes d’hiver, Vinter-Eventyr), publiés en 1942, furent écrits au cours des années solitaires à Rungstedlund après la mort de sa mère en 1939, alors que la guerre et l'Occupation empêchait la cosmopolite Karen Blixen de voyager et de trouver des "âmes-soeurs" en capacité de partager avec elle son imagination et de nouvelles inspirations : et jusqu'à la fin de sa vie elle eut ce besoin de vivre intensément, sans avoir la force de le satisfaire, ainsi de son voyage si marquant aux Etats-Unis en 1959 - elle avait longtemps rêvé de se rendre en Amérique, le premier pays à l'avoir lu alors qu'elle était une parfaire inconnue, mais ce beau rêve ne vint que trop tardivement ...
"Derniers contes" (Last Tales, 1957 ; Sidste fortællinger), fut suivi du "Anecdotes of Destiny" (1958), revint aux souvenirs africains avec "Ombres sur la prairie" (1958). "Carnival : Entertainments and Posthumous Tales" (1977) comprend des histoires non collectées ou inédites. Parmi ses autres ouvrages publiés à titre posthume figurent "Daguerreotypes, and Other Essays" (1979) et "Letters from Africa", 1914-31 (1981). Elle meurt paisiblement à 77 ans en septembre 1962 dans sa maison de Rungslund...
Blixen n'a jamais réellement été reconnue comme une auteure de littérature féminine, mais plutôt comme une femme qui écrivait des histoires, et des récits dont nombre d'entre eux se déroulent dans les années 1870. Il fallut attendre le renouveau du mouvement féministe dans les années 1960 et 1970, pour qu'elle soit lue différemment et paraissent car plus radicale dans sa vision de la nature de la femme et de son rôle dans la vie humaine ...
En 1985, la version cinématographique américaine de "Out of Africa" (Sydney Pollack, avec Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer), avec ses paysages magnifiques tournés au Kenya, multiplia subitement les ventes des livres de Karen Blixen, et c'est ainsi qu'il fut enfin possible de transformer sa maison en musée en 1991, à Rungstedlund...

Lorsque Denys Finch-Hatton surgit, la baronne Blixen va se métamorphoser le soir même, portant la robe du soir d'un grand couturier parisien. C'est en 1922 que Denys s'installe à la "ferme", ou plus précisément, utilise la ferme comme base. Alors que Karen semble être persuadée d'être enceinte, Denys est déjà reparti en Angleterre régler des problèmes personnels, entre autres. Alors qu'en 1926 Karen reste toujours dans l'incertitude sur la réciprocité de l'amour qu'elle éprouve pour Denys, s'esquissent les premiers "Contes gothiques" ...
(Lettres d'Afrique, 1914-1931) - Cher Tommy, le 3-4-1926
"Je crains que cette lettre ne risque de devenir aussi longue que les Confessions de Rousseau, quoique bien moins intéressante, et de ne pas avoir le droit d'exiger de toi que tu la lises. Mais je la continue pourtant car j'éprouve véritablement un sentiment de soulagement, et une impression de bien-être, - que je n'ai que trop peu l'occasion de ressentir, - à l'idée de l'avoir commencée et d'être arrivée jusque-là. Peut-être pourrai-je, lorsque je l'aurai terminée, m'abstenir de l'envoyer et t'épargner ainsi la peine de la lire. Mais en ce moment même, alors que je suis en train d'écrire, il faut que j'aie le sentiment de l'adresser à quelqu'un, c'est-à-dire à toi, puisque je ne connais personne d'autre à qui je puisse ouvrir pareillement mon cœur et de qui je puisse attendre autant de compréhension.
Pour reprendre là où j'en étais restée, je vais donc essayer de te donner une idée de la situation devant laquelle je me trouve a l'heure actuelle, c'est-à-dire en avril 1926.
Denys a passé 2 semaines ici et repart maintenant pour l'Europe, c'est-à-dire que je l'attends ici demain et après-demain et qu'il doit quitter Nairobi mardi.
Pendant le temps qu'il a passé ici, comme auparavant en pareille occasion, j'ai éprouvé un très grand bonheur, mêlé d'un sentiment de désespoir tout aussi grand à la pensée qu'il allait repartir dans si peu de temps, qu'il se pourrait que je ne le revoie jamais, etc.
Le résultat final de sentiments aussi dissemblables est que je suis absolument sûre qu'il est la seule chose qui ait de l'importance pour moi dans la vie et que mon existence tout entière tourne autour de ce fait comme autour d'un axe, ce qui me vaut donc de connaître tant ce que l'on appelle le ciel que ce que l'on appelle l'enfer, avec passage sans transition de l'un à l'autre.
Mais je ne veux ni ne peux vivre de cette façon, c'est-à-dire que ma vie se réduise à cela; pareille situation n'est pas tenable et je ne suis prête en aucune façon à ce que mon avenir immédiat prenne la forme de six mois de désert, de vide et de ténèbres complets, dans le seul espoir de revoir Denys à l'automne et de connaître alors le même bonheur sans réserve, puis de me trouver ensuite rejetée dans les ténèbres et dans le désert - et ainsi de suite jusqu'à la lin de mes jours.
Je sais bien que tu m'as dit qu'il valait la peine d'être totalement malheureux pendant un certain temps pour pouvoir ensuite être totalement heureux pendant une autre période. D'un point de vue strictement mathématique, il est possible que l'on puisse atteindre un état de parfait équilibre, par exemple, en restant pendant six heures dans un bain parfumé à écouter la musique la plus suave qui soit pour être ensuite soumis à la torture pendant les six suivantes (et ainsi de suite); mais, dans la pratique, il est tout simplement impossible de vivre de la sorte parce que l'on ne peut se couper aussi radicalement que cela de son passé et de son avenir; avant qu'il ne s'écoule bien longtemps votre existence serait plongée dans un chaos qui signifierait votre perte.
Je me demande vraiment si, de façon générale, on peut "vivre" comme on dit, d'une passion, - je veux dire par la: si c'est possible au-delà d'un certain laps de temps, assez bref d'ailleurs. Mais, même si c'était le cas, il ne s'agirait plus simplement d'une passion; cela recouvrirait et comporterait bien d'autres choses. À supposer que mes rapports avec Denys se trouvent un jour être la seule chose dans ma vie, que je doive venir vers lui les mains vides, sans avoir d'autres sources d'intérêt, d'autres expériences, de nouvelles pensées ou de nouvelles impressions, alors ce qui est l'amitié la plus heureuse, la sympathie et la compréhension la plus délicieuse que je puisse imaginer, ne sera plus qu'une faim suivie d'une satiété d'ordre purement physique et je ne le veux en aucun cas; d'ailleurs, cela ne serait pas durable uniquement de cette façon, cela se consumerait in no time.
Non, pour que je puisse vivre, de façon générale, et que je puisse connaître, et désirer continuer à connaitre dans ma vie ce bonheur indescriptible qu'est mon amour pour Denys, il faut, vois-tu, que je sois moi-même, que je sois quelque chose à moi seule, que j'aie, que je possède quelque chose qui soit vraiment à moi, que je fasse quelque chose qui exprime ma personnalité et qui m'appartienne. Et ce n'est pas le cas ici, en ce moment, - je n'ai et ne suis rien; j'ai trahi Lucifer et j'ai vendu mon âme aux anges du paradis et pourtant il m'est impossible d'y vivre; il n'y a pas en ce monde d'endroit qui soit fait pour moi et où je puisse vivre, et pourtant il me faut bien être quelque part; je suis prise de haine et de frissons à l'idée de chacune des minutes de ma vie, et pourtant celles-ci se présentent l'une après l'autre; bref, c'est insupportable et, si j'en entendais parler, je n'arriverais pas à croire qu'il soit possible de vivre de cette façon.
ll ne faut pas que tu croies que je suis poule mouillée au point de ne pas m'être demandé s'il ne vaudrait pas mieux que je mette fin à mes jours, et de ne pas être prêtre à le faire si j'en venais vraiment à répondre à cette question par l'affirmative. D"ailleurs, pour ne pas avoir à vivre de la façon dont je vis en ce moment, la pire des poules mouillées y serait prête. Mais il me semble que cela ne servirait à rien. Ce que je désire de tout mon être c'est la vie, et ce que je redoute et devant quoi je fuis c'est le vide et l'anéantissement, - et que croit-on que soit la mort? J'ai terriblement envie de vivre, je suis terriblement contrariée à l'idée de mourir.
Mais si je dois imaginer, ou essayer, de continuer à vivre, il faudra bien que ce soit d'une façon ou d'une autre. Puis-je donc imaginer qu'il me soit possible de partir d'ici et de vivre, - ce que j'appelle vivre, - ici?
Je m'avise tout à coup que j'aurais certainement dû expliquer un peu mieux ce que j'entends par l'expression imagée de "Lucifer", afin qu'elle ne soit pas comprise de travers et ne laisse pas croire, par exemple, que je désire mener une vie débridée, démoniaque.
Je l'entends au sens de vérité, ou bien de recherche de la vérité, d'effort vers la lumière, de critique, - en définitive, sans doute de ce que l'on appelle "l'esprit". C'est le contraire même de la tentation de se bercer de l'idée que ce à quoi l'on tient est et sera toujours ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire le contraire de l'inaction voulue, de la satisfaction et de l'absence d'esprit critique qui règne au paradis. Et également: le travail, - je crois que je suis capable de travailler et que je me lasse moins vite que la plupart des gens, - un sense of humour qui n'ait peur de rien mais qui ose se moquer de tout, en ne se fiant qu'à lui-même, et puis la vie, une lumière nouvelle, le changement.
Et pendant ce temps-là je suis là, dans ce cadre idyllique qui ne l'est pas vraiment, si ce n'est parce que je le veux ainsi.
Ah, crois-tu, mon cher Tommy, crois-tu que je puisse encore "devenir quelque chose", et que je n'aie pas encore gâché toutes mes chances dans la vie pendant qu'il en était encore temps, et que je ne suis pas sans autre ressource que de me flétrir et de monter en graine, d'avoir moi-même de la patience et d'espérer que les autres auront de la patience vis-à-vis de moi qui ai totalement manqué ma vie? ..." (traduction Gallimard, 2006)

"Sept contes gothiques" (Seven Gothic Tales, 1934)
"The Deluge at Norderney", "The Old Chevalier", "The Monkey", "The Roads Round Pisa", "The Supper at Elsinore", "The Dreamers", "The Poet".
Recueil de contes publié sous le nom d`Isak Dinesen, des contes qui se situent dans la première partie du XIXe siècle et considérés comme gothiques dans la mesure où le XIXe siècle romantique renoue avec le Moyen Age. Le Danemark, pays de Hamlet, est resté la terre élue du romantisme, on y aime les méditations philosophiques. La poésie, l'émotion, le sens romantique de l`étrange entrent pour beaucoup dans la verve de l`auteur ainsi qu`une singulière tendresse pour l`être humain directement issue de l'expérience d'un poète initié à ce mystère : notre monde contient partout la formule du bonheur, mais cachée derrière des circonstances accessible seulement à ceux qui peuvent voir et sentir. Karen Blixen nous offre ce monde tel qu`elle a su en prendre possession. Elle nous révèle,. ou nous rappelle, les merveilles innombrables disséminées sur la Terre : les auberges ou de vieux princes, à la chandelle, boivent un vin aromatique en philosophant avant de se battre en duel avec leur meilleur ami : les routes blanches sous le soleil que parcourent au galop des carrosses où méditent de jeunes seigneurs qui poursuivent leur amour; les pigeonniers ou un cardinal et une vieille dame, confinés par l'inondation, recomposent la théologie avant d`être engloutis; les jeunes filles déguisées en cavaliers: les abbesses qui ne partagent leur secret qu`avec leur singe ; les antiques maisons à pignons d`Elseneur où deux vieilles sœurs spirituelles et un peu toquées s'entretiennent jusqu`à minuit avec le fantôme, leur frère. Ces personnages se déplacent beaucoup, sillonnent les continents, jonglent avec cent paradoxes: jeunes barons et grandes dames discutent de métaphysique, d'astronomie et d`amour; tôt ou tard, chacun explique comment il essaie de capturer la joie et de la retenir. Ce conteur reste maître de ses fantasmagories et leur fait danser un ballet dont les figures dessinent toujours, pour qui sait lire, quelque vérité secrète. Les splendeurs de la richesse, les extravagances du luxe, les périls même de l`aventure ne sont qu'ennui et cendre s`ils ne servent de cadre à un cœur épris d`amour...
"The Dreamers"
La grande cantatrice Pellegrina Leoni, dont l`histoire apparaît comme l'une des plus attachantes du recueil, exprime combien on peut être conduit à se réinventer continuellement. - "Regarde. Voilà une paysanne qui va travailler dans les champs ; elle s'appelle peut-être Maria. Elle est heureuse parce que son mari a été gentil et lui a donné un collier de corail. Ou peut-être est-elle triste, parce qu'il la tourmente par sa jalousie. Et qu`en pensons-nous. toi et moi? Une femme qui s`appelle Maria est triste, disons-nous. et nous n'y pensons plus, Et voici une autre avec un äne qui porte ses légumes à Milan. Elle est fâchee parce que l`âne est si vieux qu`il ne marche que lentement... Oui et quoi? Nous n'y pensons plus non plus. Eh bien! l`heure est venue où je veux être cela : une femme quelconque... El si je viens à être trop occupée de cette femme je veux immédiatement disparaître et en devenir une autre. une dentellière en ville, une institutrice d`une petite école de filles, une dame qui se rend à Jérusalem... Je puis être beaucoup de femmes. Qu`eIles soient heureuses ou non, sages ou non, n'importe... Je suis sûre. Marcus, que si chacun sur terre était plus d`une seule personne, tous, oui, tous les hommes auraient le cœur plus léger. N'est-ce pas curieux qu'aucun philosophe n'y ait pensé?"
"The Dreamers" s'ouvre en 1863, sur un boutre naviguant de Lamu à Zanzibar, avec un voyageur européen racontant à deux Arabes une histoire qui s'est déroulée dans les Alpes suisses 20 ans plus tôt, et de cette histoire en découlent trois autres, une méthode que Karen Blixen emploie souvent, construisant ainsi des séquences imbriquées d'histoires....
"The Deluge at Norderney"
Dans cette nouvelle qui vaut un roman pour sa densité, on voit ici combien les personnages de Karen Blixen pensent à une infinité de choses surprenantes, chacun a sa sagesse et sa folie et chacun nous entraîne dans les détours d'un destin bien singulier. La conviction de l'auteur selon laquelle nos chemins dans la vie suivent des parcours déterminés par une puissance supérieure, est à l'origine de The Deluge at Norderney, qui, plus que tout autre récit de Dinesen, affirme la primauté de la narration. Un cardinal et trois aristocrates sont bloqués dans un grenier à foin alors que les eaux montent dans la campagne allemande, dans l'attente de l'aube et d'un éventuel sauvetage. Chacun raconte une histoire, ou se fait raconter une histoire ...
Au cours de l'été 1835, une énorme tempête inonde l'île de Norderney, dans la mer du Nord, qui abrite un bain très prisé par la noblesse d'Europe du Nord. Le vieux cardinal Hamilcar von Sehestedt, qui vit sur l'île avec son valet Kasparson tout en travaillant à un livre sur le Saint-Esprit, est sauvé de son chalet par un groupe de pêcheurs (Kasparson est tué dans l'effondrement du bâtiment). Le cardinal s'efforce de sauver les paysans de l'île et propose de naviguer jusqu'au bain pour sauver les clients qui y sont piégés. À son arrivée, il trouve quatre personnes : la vieille et quelque peu délirante Mlle Malin Nat-og-Dag et sa servante ; la compagne de Nat-ot-Dag, la comtesse adolescente Calypso von Platen ; et le mélancolique Jonathan Maersk. Le groupe monte à bord du bateau et entame son retour, mais rencontre sur son chemin un groupe de paysans piégés dans un grenier à blé. Le bateau étant trop petit pour les transporter tous, tous les membres du groupe, à l'exception de la servante de Nat-og-Dag, acceptent d'échanger leur place avec les paysans et d'attendre l'arrivée des secours. Pendant qu'ils sont coincés dans le grenier, les membres du groupe échangent des histoires. Maersk raconte comment il s'est retrouvé à Norderney : adolescent, il a quitté la petite ville d'Assens pour Copenhague, où il s'est lié d'amitié avec le riche baron von Gersdorff en raison de leur passion commune pour la botanique. Il devient un chanteur de cour à succès, mais finit par apprendre qu'il est le fils du baron; désillusionné, Maersk rejette les offres de légitimation du baron qui lui permettraient d' hériter de son énorme propriété. Mlle Nat-og-Dag raconte ensuite l'histoire de la comtesse Calypso : fille du poète comte Seraphina, qui n'aimait pas la féminité, elle a été élevée dans une abbaye exclusivement masculine, où elle était ignorée de tous. À seize ans, elle décide de se couper les seins, mais s'arrête au dernier moment en voyant une peinture de nymphes dans le reflet d'un miroir. Calypso s'échappe de l'abbaye et marche dans la nuit, tombant sur la maison de Mlle Nat-og-Dag, qui se rend à Norderney. C'est alors que Mlle Nat-og-Dag va convaincre le jeune couple de se marier. Avec l'aide du cardinal, ils accomplissent la cérémonie dans le grenier. Le cardinal raconte alors à un groupe une parabole sur la rencontre entre Saint Pierre et Barabbas dans une auberge de Jérusalem, et les jeunes mariés s'endorment. C'est alors que le cardinal révèle à Mlle Nat-og-Dag qu'il n'est pas le cardinal Hamilcar von Sehestedt, mais son valet, Kasparson. Kasparson raconte sa vie à Nat-og-Dag, décrivant son passé d'acteur, de barbier à Séville, de révolutionnaire à Paris et de marchand d'esclaves à Alger. Selon Kasparson, il est également le frère aîné bâtard de Louis Philippe Ier et a tué le vrai cardinal afin d'endosser un autre "rôle" dans la vie. L'histoire se termine par un baiser entre Kasparson et Mlle Nat-og-Dag, alors que l'eau commence à pénétrer dans le grenier.
Question que soulève l`auteur : "Dieu exige-t-il de nous la verité?" C`est d'abord un cardinal qui essaie d`y répondre. Pour commencer, il évoque un souvenir de jeunesse, quand il était à la oour du duc de Chartres, qui avait émigré à Coblence. Le cardinal y rencontra le grand peintre Abildgaard. Le rêve de toutes les dames de la Cour était d`avoir leur portrait par Abtldgaard, mais il leur disait, "Lavez vos visages, mesdames, point de poudre., de fard ni de teinture, car si vous vous peignez vous-mêmes, je ne peux pas vous peindre". Le cardinal pense que c`est peut-être là ce que Dieu exige des vaniteux mortels : "Lavez vos visages car, si vous les recouvrez d`une épaisse couche d'humilité, de renoncement et de vanité, je n'en puis rien faire". Mlle Nuit-et-Jour (Nat-og-Dag) n`est pas de cet avis. C`est une vieille demoiselle un peu toquée, qui mène la vie la plus digne et s'imagine avoir un passé de grande courtisane : "D'où peut vous venir l`idée, dit-elle, que c`est la vérité que le Seigneur attend de nous? Hélas! Le Seigneur la connait d”avance et jusqu'à en bâiller d'ennui sans doute. Je pense, au contraire, que Dieu a un faible pour la mascarade. ll s`en est d`ailleurs permis une très audacieuse quand il s'est fait chair et a séjourné parmi les hommes..." Le cardinal réplique : "Quand Notre-Seigneur vécut pendant trente années sous le déguisement d'un fils de l`homme, cela n'aurait rien signifié s'il n`avait eu en vérité un coeur humain et de l`amour même pour les hommes qui, en toute modestie, trouvent leur joie dans le bon vin". Le cardinal expose dans une théorie du masque : "Au bal masqué, la femme spirituelle choisit un déguisement qui révèle ingénieusement son esprit et son cœur. Quand elle choisit le vilain masque vénitien à long nez, elle nous apprend non seulement qu`il recouvre un nez classique. mais aussi quelque chose de mieux, et qu'elle exige d'être adorée pour autre chose que sa beauté".
Plus loin. le cardinal propose : "Accordons-nous à nous déclarer que le jour du jugement n`est pas comme le prétendent d'insipides sermonneurs, le moment où nos pauvres petites tentatives de tromperie - que le Seigneur connait déjà trop bien - doivent s'exercer, mais au contraire l'heure où le Tout-Puissant lui-même laisse tomber le masque. Quel moment!" Dans le dialogue entre le cardinal et Nuit-et-Jour, on peut découvrir l`art poétique de Karen Blixen ...
"The Old Chevalier",
Le narrateur écoute l'ami de son père, le baron von Brackel, raconter une histoire quelque peu compliquée sur une rencontre avec une prostituée qu'il a eue dans sa jeunesse. Dans le Paris des années 1870, le baron est abordé par une jeune fille ivre par une nuit pluvieuse, alors qu'il vient de survivre à un attentat au poison perpétré par sa maîtresse, l'épouse jalouse d'un homme d'État parisien de premier plan. Le baron et la jeune fille, qui lui dit s'appeler Nathalie, rentrent chez le baron, qui ne sait pas qu'il s'agit d'une prostituée. Tout au long de son récit, le baron fait de fréquentes digressions pour discuter de l'évolution de la nature des femmes au fil du temps, concluant, à l'intention du jeune narrateur : "Là où nous parlions de la femme-prétexte, nous parlons de la femme : "Where we talked of woman—pretty cynically, we liked to think—you talk of women, and all the difference lies there". Le baron et Nathalie s'abandonnent donc à ce pourquoi ils se sont rencontrés et s'endorment, puis elle le réveille au petit matin, lui demande vingt francs et s'en va. Mais le baron se rend compte qu'il aime Nathalie et se lance à sa poursuite, mais ne la retrouvera pas. Le narrateur demande alors au baron s'il l'a jamais retrouvée, ce à quoi celui-ci répond par une brève anecdote : il a rendu visite à un ami artiste près d'une décennie et demie plus tard et l'a vu peindre une nature morte représentant le crâne d'une jeune femme, un crâne qui présente une ressemblance physique remarquable avec le visage de Nathalie....
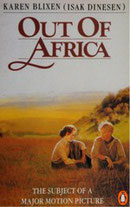
"Out of Africa" (La Ferme africaine, 1937)
L'adaptation cinématographique de Sydney Pollack en 1986 (sa relation amoureuse avec le bel Anglais, Denys Finch Hatton, qui périra dans un accident d'avion) a faussé quelqe peu les perspectives dans lesquelles Karen Blixen rédigea en 1937 ce roman autobiographique, un roman écrit en cinq mois. Elle y dépeint sa vie au Kenya, de 1914 à 1931, et surtout sa découverte de la véritable nature de ce continent, celle des lieux comme celle des hommes. Le contexte, la vie dans sa ferme de culture de café à proximité de Nairobi, une une exploitation immense et féodale. La maîtresse, la "m'saba", règne sur elle comme un seigneur du Moyen Age qui aurait toute la largeur d`esprit d'une femme cultivée du XXe siècle. L'ouverture du récit est célèbre ...
"I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong Hills. The Equator runs across these highlands, a hundred miles to the North, and the farm lay at an altitude of over six thousand feet. In the day-time you felt that you had got high up, near to the sun, but the early mornings and evenings were limpid and restful, and the nights were cold. The geographical position, and the height of the land combined to create a landscape that had not its like in all the world. There was no fat on it and no luxuriance anyrwhere; it was Africa distilled up through six thousand feet, like the strong and refined essence of a continent. The colours were dry and burnt, like the colours in pottery.
The trees had a light delicate foliage, the structure of which was different from that of the trees in Europe; it did not grow in bows or cupolas, but in horizontal layers, and the formation gave to die tall solitary trees a lilteness to the palms, or a heroic and romantic air like fullrigged slups with their sails clewed up, and to tlie edge of a wood a strange appearance as if the whole wood were faintly vibrating. Upon the grass of the great plains the crooked bare old thorn-trees were scattered, and the grass was spiced like thyme and bog-myrtle; in some places the scent was so strong, that it smarted in the nostrils
All the flowers that you found on the plains, or upon the creepers and liana in the native forest, were diminutive like flowers of the downs,— only just in the beginning of the long rains a number of big, massive heavy-scented lilies sprang out on the plains. The views were immensely wide. Everything chat you saw made for greatness and freedom, and unequalled nobility.
The chief feature of the landscape, and of your life in it, was the air. Looking back on a sojourn in the African highlands, you are struck by your feeling of having lived for a time up in the air. The sky was rarely more than pale blue or violet, with a profusion of mighty, weightless, everchanging clouds towering up and sailing on it, but it has a blue vigour in it, and at a short distance it painted the ranges of hills and the woods a fresh deep blue. In the middle of the day the air was alive ovear the land, like a flame burning; it scintillated, waved and shone like running water, mirrored and doubled all objects, and created great Fata Morgana. Up in this high air you breathed easily, drawing in a vital assurance and lightness of heart. In the highlands you woke up m the morning and thought; Here I am, where I ought to be.
«J`ai possédé une ferme en Afrique au pied du Ngong. La ligne de l`Equateur passait dans les montagnes à vingt-cinq milles au nord : mais nous étions à deux mille mètres. Au milieu de la journée, nous avions l`impression d'être tout près du soleil, alors que les après-midi et les soirées étaient fraiches et les nuits froides. L'altitude combinée au climat équatorial composait un paysage sans pareil. Paysage dépouillé, aux lignes allongées et pures, l'exubérance de couleur et de végétation qui caractérise la plaine tropicale en étant absente : ce paysage avait la teinte sèche et brûlée de certaines poteries.
Le feuillage léger des arbres, au lieu de former un dôme comme en Europe, s'étageait en couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière donnait aux arbres isolés tantôt la silhouette de grands phœnix aux palmes mouvantes, tantôt l'attitude fière et héroïque d'un trois-mâts les voiles carguées; à la lisière du bois, un frémissement étrange semblait courir et gagner toute la forêt.
Quelques aubépines vieilles et rabougries surgissaient de place en place dans la plaine dont l'herbe sentait le thym et le piment; l'odeur en était parfois si forte qu'elle prenait aux narines. Les fleurs des prés, les lianes de la forêt étaient en général minuscules, comme celles des plantes grasses qui fixent les dunes.
Pourtant, au début de la saison des pluies, on voyait fleurir différentes variétés de grands lis odorants. Il y en avait à perte de vue, libres et fiers comme la nature de ce pays.
L'air est l'élément essentiel de la vie et du paysage africain. Quand on fait un retour en arrière après un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on a l'impression curieuse que la vie s'y écoulait en l'air.
Le ciel n'était jamais très bleu, il restait pâle, mais si lumineux que les yeux le fixaient avec peine; des nuages légers et changeants le traversaient. Je voyais des palais se construire à l'horizon, les nuages s'en détacher et voguer dans l'espace. Ce ciel avait pourtant des trésors de bleu, qu'il répandait à profusion sur les hauteurs les plus proches.
En plein midi, l'air devenait vivant, il brûlait et éclaboussait comme une flamme mouvante, une flamme liquide comme l'eau, réfléchissant et multipliant les objets en d'incessants mirages. A cette altitude, il vous enivrait et vous donnait des ailes. On se réveillait dans nos montagnes avec le sentiment d'avoir enfin trouvé son élément.
Le Ngong est une longue chaîne de montagnes qui s'étend du Nord au Sud, couronnée de quatre sommets majestueux qui se détachent en grandes vagues d'un bleu profond sur le ciel. La chaîne atteint å l'est sa hauteur maximum : 2 700 mètres, mais il n'y a guère que 700 mètres de dénivellation, tandis qu`à l`ouest la chute est plus profonde, plus rapide aussi, car la falaise se dresse presque verticale sur toute la longueur de la vallée : la Grande Vallée du Rift.
Le vent, dans ces régions montagneuses, souffle presque continuellement du nord-est. C'est le vent qu'on appelle, sur les côtes d'Afrique et d'Arabie, mousson ou vent d'est, comme le cheval favori de Salomon. A notre altitude il était à peine sensible. On eût dit la légère résistance de l'éther lorsque la terre se précipite dans l'espace. Il se brisait contre le Ngong dont les pentes auraient, j'imagine, merveilleusement convenu pour le vol à voile. Porté par les courants aériens il eût été facile de s'élever jusqu'au sommet de la montagne. Les nuages, que le vent entraînait, venaient aussi buter contre elle. Ils y demeuraient accrochés ou bien se déversaient en ondées. Plus haut, d'autres dépassaient les écueils et poursuivaient leur course vers l'Ouest pour disparaître sur les déserts brillants de la vallée du Rift.
J'ai souvent suivi de chez moi leur fuite au-dessus des sommets et c'était, chaque fois, avec la même surprise que je voyais leurs masses imposantes et fières fondre et se dissiper dès qu'elles atteignaient l'arête.
The hills from the farm changed their character many times in the course of the day, and sometimes looked quite close, and at other times very far away. In the evening, when it was getting dark, it would first look, as you gazed at them, as if in the sky a thin silver line was drawn all along the silhouette of the dark mountain; then, as night fell, the four peaks seemed to be flattened and smoothened out, as if the mountain was stretching and spreading itself.
Vues de la ferme, les montagnes changeaient d'aspect au cours d'une même journée : tantôt elles paraissaient toutes proches, tantôt reculées à l'infini. Le soir, quand le soleil avait disparu, une mince ligne d'argent cernait les crêtes sur le ciel assombri. A mesure que tombait la nuit, les quatre sommets s`affaissaient, comme si la montagne s`était allongée pour dormir.
From the Ngong Hilk you have a unique view, you see to the South the vast plains of the great game-country that stretches all the way to Kilimanjaro; to the East and North the park-like country of the foot-hills with the forest behind them, and the undulating land of the Kikuyu-Reserve, which extends to Mount Kenya a hundred miles away,— a mosaic of little square maize-fields, banana-groves and grass-land, with here and there the blue smoke from a native village, a small cluster of peaked mole-casts.
L`horizon que l'on découvre des collines du Ngong est incomparable : au sud de grandes plaines, puis les vastes terrains de chasse qui s'élèvent jusqu'au Kilimandjaro. Au nord-est, au contraire, il n'y a que de faibles ondulations, un paysage soigné de parcs se détachant sur un fond de bois avec au-delà des collines qui s'échelonnent. C'est la réserve Kikuyu qui s'étend sur près de 160 kilomètres jusqu`au mont Kenya, couronné de neige. La région des Kikuyus n`est qu`une mosaïque de champs de mais ou de bananiers et de prairies. Çà et là, on voit s'élever la fumée bleue d'un village toits pointus.
Vers l`ouest, très bas, c'est le paysage lunaire de la plaine africaine, un désert beige ponctué de buissons d'aubépine sur lequel se détache le cours sinueux du fleuve qui apparaît comme une large ligne verte irrégulière faite de mímosas géants aux branches épineuses avec des aiguilles de six pouces. C'est aussi la région des cactus, où vivent les girafes et les rhinocéros.
La région montagneuse du Ngong frappe quand on la parcourt par sa grandeur et son mystère autant que par sa variété avec ses longues vallées, ses fourrés, ses gorges verdoyantes et ses rocs. Elle possède même très haut, à l'abri d'un sommet, une forêt de bambous.
L'eau y ruisselle en sources et en cascades auprès desquelles j'ai souvent dressé ma tente.
De mon temps, il existait encore des buffles, des élans et des rhinocéros dans les montagnes du Ngong; les très vieux indigènes se rappelaient même y avoir vu des éléphants. J'ai toujours regretté que le massif n'ait pas été mieux protégé. On aurait pu y constituer une
réserve pour le gros gibier, alors qu'il n'y avait qu'une petite partie où la chasse fût interdite; un tas de pierres en marquait la limite sur le sommet le plus méridional.
Pour peu que le Kenya ait connu la prospérité, sa capitale Nairobi aurait eu un parc zoologique unique au monde. Mais j'ai pu voir, pendant les dernières années de mon séjour en Afrique, toute la jeunesse dorée de Nairobi, boutiquiers ou employés, partir à motocyclette dans la montagne et tirer indistinctement sur tout ce qu'elle voyait; je crois que le gros gibier a déserté la montagne pour se réfugier plus au sud, dans une région de rochers et de bois.
Sur les pentes, le terrain très accidenté était assez impraticable, mais dès que l'on atteignait le sommet il devenait aisé d'avancer, l'herbe était rase comme sur un pré fraîchement tondu, la roche grise apparaissait çà et là entre les touffes vertes. Tout le long de l'arête
un sentier escaladait les quatre sommets, véritables montagnes russes, sur plusieurs kilomètres de longueur. Un certain matin où je campais dans la montagne, je grimpai jusqu'au sommet et je suivis ce sentier; j'y trouvai les empreintes et les fientes toutes fraîches d'une troupe d'élans. Ces jolies bêtes paisibles avaient dû gagner le sommet avant le lever du soleil, suivant le sentier à la queue leu leu. Pour quelle raison seraient-elles venues là, sinon pour examiner sur les deux versants le pays qu`elles dominaient de si haut?
Nous cultivions surtout le café, mais ni l'altitude ni la région ne lui convenaient très bien; et nous avions souvent du mal à joindre les deux bouts.
Jamais ma ferme n'a connu l'opulence, mais la culture du café est une culture â laquelle on ne renonce pas, elle vous tient constamment en haleine. Dans un champ de calé il y a toujours quelque chose à faire, des travaux que l'on commence toujours trop tard. Au milieu de la brousse la vue d'un terrain bien délimité, avec des plantations régulières, fait plaisir. Au bout de quelque temps d'Afrique, j'avais appris à reconnaître ma ferme rien qu'à l'odeur et j'étais toujours émerveillée par la belle ordonnance de mes plantations, d'un vert si frais au milieu de la plaine grise; je sentais à quel point les figures géométriques répondent à un besoin de l'esprit...."
Tel est le début de ce livre où intelligence et culture, originalité et fantaisie, récits et souvenirs tentent de dégager un événement capital de la vie de l`auteur, sa rencontre et la découverte de la découverte de I`âme "noire"- "Les Noirs, en effet, sont en harmonie avec eux-mêmes et leur entourage. intégrés à la nature... Dès que j`ai connu les Noirs. je n'ai eu qu`une pensée, celle d`accorder à leur rythme celui de la routine quotidienne que l'on considère souvent comme le temps mort de la vie ... Lorsqu'on aperçoit au loin leurs silhouettes, grandes ou petites, toujours l'une derrière l'autre - si bien que les grandes voies de passage ne sont jamais que des sentiers -, ou qu'ils travaillent la terre, surveillent leur bétail, dansent ou vous racontent une histoire, il semble toujours que ce soit l'Afrique elle-même qui se déplace, qui compte ses troupeaux, qui danse ou qui évoque pour vous le passé..." Aimant passionnément la population indigène, Karen Blixen décrit ses mœurs, ses lois, ses interdits, ses habitudes, la forme à la fois mythique et panthéiste de son esprit, et se livre ainsi à une critique indirecte de la civilisation européenne. "Le raisonnement des indigènes ne procède pas comme le nôtre. Les Africains ressemblent aux races disparues, qui trouvaient tout naturel qu'Odin sacrifiât un œil pour obtenir la perception complète de l`univers ou que le dieu de l`Amour fût représenté par un enfant ignorant de l`amour", et quand ils vous parlent de Dieu, "c'est la puissance de son imagination qui les émerveille..."


(L'indigène dans la maison du colon)
"Une année, la pluie fit faux bond.
Ce fut une expérience aussi tragique que terrible, et le fermier qui l'a subie ne l'oublie jamais. Bien des années plus tard, loin de l'Afrique, dans un climat nordique, il va se lever en sursaut au milieu de la nuit en entendant le bruit d'une averse soudaine, et il se dira: "Enfin! Enfin! "
Dans les années normales, la longue saison des pluies commençait vers le 22 mars et durait jusqu'en juin. Au cours des mois qui précédaient la pluie, chaque jour devenait plus chaud et plus sec. On haletait; c'était comme si la nature elle-même était prise de fièvre, songez aux moments qui annoncent un gros orage en Europe, mais en plus lourd et en plus étouffant. À cette époque, les Masais, qui étaient mes voisins sur l'autre rive du fleuve, allumaient des feux sur de vastes étendues de la plaine afin que leur bétail ait de l'herbe verte et fraiche avec les premières ondées; au-dessus de la plaine, l'air dansait dans l'immense incendie, charriant les gros nuages de fumée gris et iridescents; la chaleur et l'odeur de roussi s'abattaient sur les terres cultivées comme l'haleine d'un four. De gigantesques nuages violets et roses s'accumulaient dans le ciel avant de se désagréger; au loin, une légère averse dessinait une ligne bleue et oblique sur l'horizon. Là, le monde entier ne pensait plus qu'à une seule chose.
Un soir, juste avant le coucher du soleil, le paysage semblait soudain se resserrer de tous les bords. Les montagnes se rapprochaient de la maison, tellement vivantes et fortes dans leurs manteaux vert foncé et bleu. Quelques heures plus tard, je sortais et constatais que les étoiles s'étaient retirées dans les profondeurs de la voûte céleste. Je sentais que l'air nocturne était insondable et chargé de promesses.
Quand le souffle passait en sifflant au-dessus de ma tête, c'était le vent dans les grands arbres de la forêt, et non la pluie. Quand il rasait le sol, c'était le vent dans les buissons et les hautes herbes, mais ce n'était pas la pluie. Quand il bruissait et chuintait à hauteur d'homme, c'était le vent dans les champs de maïs. Il possédait si bien les sonorités de la pluie que l'on se faisait abuser sans cesse, cependant, on l'écoutait avec un plaisir certain, comme si un spectacle tant attendu apparaissait enfin sur la scène. Et ce n'était toujours pas la pluie.
Mais lorsque la terre répondait à l'unisson d'un rugissement profond, luxuriant et croissant, lorsque le monde entier chantait autour de moi dans toutes les directions, au-dessus et au-dessous de moi, alors c'était bien la pluie. C'était comme de retrouver la mer après en avoir été longtemps privé, comme l'étreinte d'un amant.
Mais, une année, la pluie fit défaut. On aurait cru que l'univers entier se détournait de nous. Le temps se rafraîchit, il fit même froid quelques jours, mais il n'y avait aucune humidité dans l'atmosphère; il fit de plus en plus sec et l'on aurait dit que toute la force et la grâce s'étaient retirées du monde. Le temps n'était ni bon ni mauvais, il n'y avait simplement plus de temps. En outre, il soufflait un vent triste comme un courant d'air, toutes les couleurs du paysage pâlissaient et fanaient, le sol et les bois ne dégageaient plus le moindre parfum. Les sous-bois dépérirent, figés avec leurs feuilles jaunies. Le pays était écrasé et accablé par l'impression d'être tombé en disgrâce. Au sud, les plaines n'étaient plus que des brûlis noirs et déserts, veinés par des rayures de cendres grises et blanches.
Chaque jour qui s'achevait sans pluie réduisait à néant encore un de nos espoirs et de nos projets. Ce que nous avions labouré, taillé et planté au cours des derniers mois de labeur semblait désormais aberrant, buri. L'activité de la ferme se ralentit, puis cessa totalement.
Les points d'eau des plaines et des hauteurs tarissaient, et de nombreux canards et oies d'espèces inhabituelles hantaient mon réservoir près de la route. Au petit matin et au coucher du soleil, les zèbres venaient boire à l'autre réservoir, à l'extrémité de la ferme, ils
arrivaient en longues files de deux cents ou trois cents bêtes, les femelles gardaient leurs petits près d'elles et n'avaient pas peur de moi quand je passais au milieu d'elles à cheval. Mais nous nous efforcions de les chasser de nos terres, par souci de notre propre bétail, car le niveau d'eau baissait sans cesse dans les réservoirs, pour finir par être très bas. C'était cependant un plaisir de descendre au réservoir, car les joncs formaient un espace vert et frais dans ce bourbier et ce paysage si brun.
Les indigènes se taisaient pendant la sécheresse. Je ne parvenais pas à obtenir leur avis sur le temps, et pourtant, ils savaient déchiffrer les signes dans le ciel et le vent bien mieux que nous. Leur survie même était en jeu. Il leur était déjà arrivé, à eux ou à leurs pères, de perdre les neuf dixièmes de leurs troupeaux lors des grandes sécheresses. Seuls quelques rares plants de mais et de pommes de terre poussaient encore dans la poussière grise de leurs Shambas desséchés. Au fil du temps, j'imitai leur conduite et cessai de me plaindre et de parler des épreuves comme un être maudit.
Mais je n'avais pas encore vécu assez longtemps parmi eux pour apprendre leur silence absolu, ce qui arrive à certains Européens qui passent des décennies seuls au milieu des indigènes. J'étais jeune, et il me fallait concentrer mes forces sur quelque chose pour vivre, si je ne voulais pas être emportée par la poussière qui tourbillonnait sur les routes, ou par la fumée qui s'amoncelait sur la plaine. Le soir, je me mis à écrire des histoires et des contes qui entrainaient mes pensées au loin, vers d'autres contrées et d'autres époques. J'avais déjà
raconté certaines histoires, afin de divertir un ami qui me rendait souvent visite à la ferme. Quand je cessais d'écrire, quand je sortais de la maison, il soufflait un vent léger et impitoyable, le ciel était dégagé avec un million d'étoiles cruelles, tout était sec.
Au début, j'écrivais seulement le soir, par la suite, je m'y consacrais souvent aussi le matin, alors que j'aurais dû parcourir la ferme. Une fois dans les champs, il était difficile de décider: devions-nous passer la charrue sur les maïs flétris et planter à nouveau? Ne valait-il pas mieux arracher les fruits des caféiers afin de sauver les plants? Je ne cessais de remettre au lendemain les décisions à prendre.
J'écrivais dans la salle à manger, au milieu des multiples feuilles qui jonchaient la table, car il me fallait aussi régler les comptes et les budgets, et répondre aux petites notes désespérées du contremaître. Mes gens me demandaient ce que je faisais, et quand ils apprirent que j'essayais d'écrire un livre, ils virent cela comme une ultime tentative de nous tirer d'affaire, et ils me demanderont souvent comment j'avançais. Ils entraient et me contemplaient longuement, leurs têtes sombres se fondaient si bien avec les panneaux foncés de la salle à
manger que, le soir, j'avais l'impression d'avoir pour seule compagnie de longues robes blanches suspendues au mur.
Ma salle à manger avait trois grandes fenêtres qui donnaient sur la terrasse pavée, les pelouses et la forêt. Le terrain descendait en pente douce jusqu'au petit fleuve qui séparait mes terres de la réserve des Masais. On ne voyait pas le fleuve de la maison, mais on
pouvait suivre son cours sinueux grace à la large ligne vert foncé des acacias au milieu du vert olive plus pale des autres arbres de la forêt. Sur l'autre rive, le terrain remontait et, au-dessus des collines boisées, de vertes prairies s'étendaient jusqu'au pied des montagnes.
"Si j'avais eu la foi qui déplace les montagnes, c'est cette montagne-là que j'aurais emportée quand je suis repartie".
Le vent soufflait de l'est, la salle à manger était à l'abri et ses fenêtres étaient toujours ouvertes. En conséquence, les indigènes préféraient le côté ouest de la maison, ils effectuaient un détour pour y passer et traverser la pelouse afin de rester en contact avec
ce qui se déroulait à l'intérieur. Pour la même raison, les petits bergers menaient leurs chèvres paitre sur ma pelouse.
Les petits bergers lsikuyus, qui arpentaient la ferme en compagnie des chèvres et des moutons de leurs pères, toujours à la recherche de bons pâturages, établissaient une sorte de lien entre la vie de la brousse et celle de ma demeure civilisée. Mes domestiques les considéraient avec méfiance et s'opposaient à les voir entrer dans la maison. Les invectives volaient sans relâche entre la cuisine et l'orée de la forêt, comme lorsque "les troupeaux beuglent sur les fils furtifs de la forêt".
Cependant, les enfants nourrissaient un grand amour et de l'enthousiasme pour la civilisation. Pour eux, elle n'était pas dangereuse; ils pouvaient s'en échapper quand ils le désiraient. Elle était incarnée par un vieux coucou allemand accroché dans la salle à manger. Une horloge ou une montre constituaient un véritable luxe dans les hautes terres: la position du soleil permettait de calculer précisément l'heure, et ce, toute l'année. En outre, on n'avait pas à se soucier des horaires des trains et l'on organisait à sa guise la vie à la ferme. Ainsi, la question de savoir l'heure prenait une importance assez secondaire. Mais cette horloge avait fière allure: au milieu d'un bouquet de roses rouges et rondes, une petite porte s'ouvrait à chaque heure, et un coucou en surgissait pour sonner l'heure d'une voix forte et solennelle. Chaque fois, son apparition faisait les délices des jeunes de la ferme. D'après la position du soleil dans le ciel, les enfants savaient avec précision quand se produirait la sonnerie de midi, et dès onze heures et demie, je les voyais s'approcher de la maison, venant de tous les côtés, suivis de leurs troupeaux de chèvres qu”'ls n'osaient pas abandonner. Les têtes noires des enfants et celles brunes et blanches des chèvres se frayaient un chemin à travers les buissons et les hautes herbes du bois, où elles dépassaient comme les têtes des grenouilles dans un réservoir. Les garçons laissaient paître leurs chèvres sur la pelouse et ils entraient sans bruit, pieds nus. Les plus âgés avaient peut-être dix ans, les plus jeunes à peine plus de deux ans. Ils se tenaient fort bien et observaient une sorte de rituel de mon cru: il leur était permis de se déplacer librement dans la maison à condition de ne rien toucher, de ne pas s'asseoir et de ne pas parler sans être interrogés. Quand le coucou bondissait de sa porte, une onde de ravissement et de rires étouffés secouait la petite troupe. ll arrivait aussi parfois qu'un tout petit berger, qui délaissait la surveillance de ses chèvres, vînt seul dans la salle à manger aux premières heures du matin. Il restait perdu à contempler l'horloge close et muette et, après un certain temps, il lui adressait en kikuyu une déclaration d'amour prolixe et chantante,
puis il ressortait d'un pas aussi grave qu'il était venu. Mes domestiques riaient des petits bergers et m'assuraient que les enfants étaient naifs et certains que l'oiseau de l'horloge était vivant.
Maintenant, c'était à leur tour de venir me regarder écrire. Parfois, Kamante restait des heures adossé contre le mur. Ses pupilles, semblables à des gouttes noires sous les cils, suivaient la valse de ma machine à écrire comme s'il avait l'intention d'en connaître si bien
le fonctionnement qu'il lui aurait été possible de la démonter et de la remonter entièrement.
Un soir, je levai la tête et croisai son regard attentif et profond. Au bout d'une seconde, il me demanda: «"Msabu, est-ce que tu crois que tu es capable d'écrire un livre? » Je répondis que je l'espérais. Si l'on veut se faire une idée correcte d'une conversation avec Kamante, il
faut penser au long silence pesant et quasi scrupuleux qui précède chaque phrase. Tous les indigènes sont passés maîtres dans l'art de ces pauses qui donnent une perspective, une profondeur à la conversation. Kamante fit donc un de ces longs silences et dit: "Je ne le
crois pas." Je n'avais personne d'autre à qui parler de mon livre, je posai donc mes feuillets et lui demandai pourquoi il ne le croyait pas.
Je vis alors qu'il avait mûrement réfléchi à la question, et qu'il s'était préparé à l'avance, car il avait l'Odyssée dans son dos et le déposa lourdement sur la table. "Regarde, Msabu, ça c'est un bon livre. Il se tient bien, du début à la fin. Même si on le prend par le dos, même si on le secoue fortement, il ne se défait pas. l'homme qui l'a écrit était sage. Mais toi, ce que tu écris, ajouta-t-il avec un mépris auquel se mêlait une véritable sympathie, ce n'est pas clair. Il y a un bout ici, un autre là. Quand tes employés entrent et oublient de fermer la porte, ça s'envole et ça tombe par terre, et tu es très fâchée. Ça ne peut pas faire un bon livre. " Je lui expliquai que les gens d'Europe sauraient réunir le livre pour que le tout tienne ensemble.
"Est-ce que ton livre sera aussi lourd. que celui-là?" me demanda Kamante en me montrant l'Odyssée; quand il vit que je réfléchissais, il me le tendit, pour que je puisse le soupeser et comparer. "Non, répondis-je, il ne sera pas aussi lourd, mais il y a bien d'autres livres plus légers dans la bibliothèque.
- Et aussi dur?" rétorqua-t-il.
Je lui dis que cela coûtait cher de produire un livre aussi dur. Il réfléchit un moment puis, pour montrer les grands espoirs qu'il plaçait dans mon livre, et peut-être aussi qu'il regrettait ses doutes, il se mit à ramasser les feuillets tombés par terre et les réunit sur la table. Cependant, il ne se retira pas. ll resta planté là, il attendit un instant et me demanda, avec sérieux: "Msabu, qu'est-ce qu'il y a dans les livres?" .... (traduction Gallimard, 2006)
A noter - Le travail d'Alain Gnaedig, un des plus éminents traducteurs des langues scandinaves, rend tout son éclat à la prose de Karen Blixen, en proposant au lecteur français, aux éditions Gallimard, une traduction fidèle de l'original danois de "La ferme africaine", un des titres les plus populaires de la littérature du vingtième siècle. L'album Quarto "Afrique" chez ce même éditeur est un incontournable ...

(Karen Blixen, Afrique, trad. Gallimard, conférence prononcée à Stockholm et Lund, en 1938)
"Noirs et Blancs d'Afrique"
"... Dans les hautes terres africaines, la nature est uniforme; on peut voyager des semaines et des mois sans que le paysage change de caractère. Mais on affronte tout de même là-bas de grands contrastes, les temps primitifs et l'époque actuelle s'y superposent. Le pays s'étend à perte de vue, tel que pendant mille ans, il n'y a pas trace de passage humain, pas même un chemin; les gens qui passent par là suivent les pistes des animaux. Or c'est dans ce paysage que se posent maintenant les avions, le XXe siècle atterrit dans l'âge de la pierre. Les éléphants, les rhinocéros et les girafes sont, par quelque trait, des animaux du passé; on les regarde dans ses jumelles Zeiss et l'on en est changé, on s'est trouvé en face de quelque chose que l'on n'eût pas cru avant. Ici, pendant d'innombrables générations, les lions ont été les souverains absolus dès que le soleil était couché, on le voit fort bien en regardant un lion qui rentre dans son antre après avoir quitté sa proie dans le petit matin rouge et froid. Maintenant, c'est la loi qui sauvegarde les lions, en quelques endroits, mais les brefs rugissements rauques que lion entend par la plaine lorsque les lions sont en chasse, cela ne connaît pas de protection ou de lois humaines. Tout ici dans les hautes terres signifie quelque chose, la distance en est la marque; règne ici, au propre et au figuré, une perspective unique.
Et c'est là que se situa pour moi le lieu de rendez-vous le plus significatif, c'est là que je rencontrai les indigènes noirs. Par là, le monde entier et la vie s'élargirent pour moi, une solidarité, une action commune s'établirent, qui rendirent possibles des mélodies nouvelles.
Nous ne nous étions pas mutuellement cherchés, je n'étais pas venue dans ce pays pour étudier les Noirs, et ils avaient veillé à ce que nous nous en abstenions. Mais confrontés par le destin, nous nous trouvions mener en commun notre vie quotidienne. Nous étions des êtres humains vivant dans des conditions communes; si la pluie tardait à venir pour nous, les Blancs, la situation était lourde de menaces pour les Noirs aussi; si l'eau venait à manquer dans nos safaris, nous avions soif ensemble. Les Noirs étaient plus riches de couleur, tant de peau que d'esprit, mais ils ne demandaient pas grand-chose, ils se conduisaient si calmement.
Que signifiait notre venue pour eux?
Qu'avions-nous à leur donner, là-bas dans leur pays, qu'était tout ce que nous apportions? Et nous-mêmes, nous sentions, dans notre coexistence avec eux, que nous nous trouvions sur de vastes étendues inconnues: « D'où venez-vous? Que signifie la vie - et la mort- pour vous? Pendant que nous allions en croisade, découvrions l'Amérique et inventions la machine à vapeur, que vous a-t-on donné à faire? »
Lentement, nous apprenions, par les petites choses, à nous connaître; de temps à autre, nous écoutions, de temps à autre, nous parlions. Finalement, il en résultait une compréhension et un modus vívendi. Pour parler de choses nouvelles et inconnues, nous employons les expressions et les tournures auxquelles nous sommes habitués. Une très vieille parole me venait souvent à l'idée à propos des indigènes. Nous mentionnons dans le Notre Père « le règne, la puissance et la gloire ». Ici, les choses étaient réparties de telle sorte que le règne revenait aux Noirs et la puissance à nous - pour la gloire, les deux parties auraient pu volontiers l'avoir.
Que le pays fût aux indigènes, il n'était pas nécessaire d'en donner la preuve; on était capable de le voir pour peu que l'on sût se servir de ses yeux. Ils étaient une partie du même tout. Et l'Afrique, qu'était-elle: la plaine, le volcan éteint qui se dressait vers le ciel, les buissons tordus, les girafes, les jeunes et graciles guerriers noirs en voyage, les vieilles femmes courbées devant les Manyattas, les villages, les enfants nus aux yeux noirs qui gardent les chèvres dans les plaines?
Je reprendrai ce que j'ai écrit dans mon livre, sur la terre, la végétation, les animaux et les indigènes: « Ce n'étaient pas des entassements homogènes d'atomes d'espèces différentes, mais des entassements d'espèces différentes des mêmes atomes. Ils se ressemblaient, pas exactement par la forme, mais par l'essence, comme le gland ressemble à la feuille de chêne ou au coffre de chêne. » Il n'y avait pas de luxuriance dans le paysage, non plus que dans les peuplades qui y vivaient; dans les deux cas, ils ,étaient marqués de souplesse, de parcimonie, d'une sorte de contentement de ce qu'on a, de pauvreté si l'on veut. Les indigènes étaient des gens très pauvres et contents de ce qu'ils avaient. Les couleurs étaient les mêmes, également sèches, délicatement brûlées, dans l'air subtil. Ils étaient marqués par l'altitude,
par les deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer; cette espèce de gens ne pouvait simplement pas vivre sur de basses terres. Ils ne faisaient pas de grands gestes et ne parlaient jamais haut. Ils avaient la faculté de rester parfaitement immobiles, comme les bêtes sauvages; aucun animal apprivoisé n'est capable de rester aussi immobile qu'une bête sauvage. Nous autres, nous détonnions dans le paysage et ne pouvions éviter de le faire; eux, ils ne faisaient qu'un avec lui. Eux étaient l'Afrique, il n'y avait aucun doute à cela.
Tout comme il y avait une diversité dans la nature sauvage, là-bas dans les plaines, il y avait, en Afrique orientale, beaucoup de tribus différentes, c'était une richesse que de fréquenter quotidiennement une vingtaine de peuplades qui se distinguaient autant les unes des autres que les Italiens des Finlandais. Je ne peux, bien entendu, vous donner ici quelque image de chacune de ces diverses tribus. Mais il faut que je mentionne les deux auxquelles j'avais surtout affaire, et elles répondaient, par leur allure extérieure et leur tempérament, aux deux sortes d'animaux des hauts plateaux: les herbivores - antilopes et gazelles, buffles et girafes - et les carnivores, les bêtes de proie dont les autres subissaient la domination. Il y avait les Kikuyus, gens pacifiques qui travaillaient pour moi., agriculteurs, et les Masais, ce peuple guerrier qui s'éteint maintenant parce qu'il n'a plus le droit de se battre...." (traduction Gallimard, 2006)

"Shadows on the Grass" (1942, L'Ombre sur la prairie)
Recueil de nouvelles comprenant "Ombres sur la prairie", "Barua a Soldani", "Le Grand Geste", "Echo des montagnes", publié en 1958. Quatre nouvelles qui prolongent son célèbre roman "La Ferme africaine" et illustrent son amour, à sa façon, pour le peuple africain, sa dignité et ses traditions, ainsi que pour la beauté et la sauvagerie du paysage. Les trois premières ont été écrites dans les années 1950 et la dernière, "Echoes from the Hills", a été écrite spécialement pour ce volume au cours de l'été 1960, alors que l'auteur était septuagénaire.
"Ombres sur la prairie", celle qui donne son litre au recueil est construite autour de la personnalité mystérieuse d`un domestique somali, Farah, tour à tour aux prises avec le langage, la mentalité indigène, le personnel et les propres intérêts de la ferme, et qui est pour sa maîtresse à la fois le plus parfait des majordomes, le plus précieux des conseillers, le plus sûr des amis. "lnébranlablement loyal à mon égard, il était du fond du cœur un animal sauvage, un cheetah qui me suivait en silence à une distance de cinq pieds, ou bien un faucon dont les griffes retenaient solidement mes doigts tandis que sa tète se tournait de droite à gauche. de gauche à droite". Farah s'engagea dans la ferme, "ou plutôt il en pris possession". ll ne fut question au début d`aucun contrat : et sans se soucier du bien-être de sa protectrice, il s'estimait responsable "devant Dieu" de son renom et de son honneur. C`est grâce à lui qu`elle entre en contact avec la vie indigène et qu`elle finit par pénétrer quelques-uns de ses mystères. Ainsi observe-t-elle : "Dans mon enfance, je connaissais la plupart des anciennes "sagas" islandaises et plus tard - quand j'ai rencontré les Somalis -, j'ai été frappée par leur ressemblance avec les personnages de ces légendes nordiques. Mon impression a été confirmée à ma grande satisfaction par le professeur Oestrup qui connait les deux mentalités et. faisant un rapprochement entre les Arabes et les Islandais, désignant leur attitude par un terme surprenant, l'affectation. Le souci dévorant de se distinguer à tout prix par une réplique, un geste immortel peut subsister à travers les âges". ..
Dans "Barua a Soldani" ("lettre d'un roi"), Karen Blixen relaie comment une lettre de remerciement, reçue du roi de Danemark, à qui elle avait offert une peau du lion, et qui finit par devenir pour son entourage de couleur un talisman qui opère, effectivement, quelques guérisons miraculeuses. Un jour, alors qu'elle inspectait ses terres, elle trouva un jeune homme de la tribu Kikuyu dont la jambe avait été écrasée sous un arbre abattu. Comme elle n'avait pas de morphine sur elle, elle décida de placer la lettre du roi sur la poitrine du jeune Kikuyu et de lui dire qu'une lettre d'un roi "supprime toute douleur". Cela fonctionne et, à partir de ce jour, la lettre du roi "qui fait des miracles" fait partie de sa réserve de médicaments. Elle a été utilisée si souvent qu'elle est devenue, selon les mots de Karen Blixen, "brune et raidie par le sang" de son usage ...
La dernière nouvelle retrouve Karen Blixen dans son pays natal, lors de la Seconde Guerre mondiale : elle songe avec nostalgie au Kenya qu`elle a dû quitter, aux amis qu'elle y a laissés; elle évoque les randonnées, les chasses dans la foret, les fêtes, les dîners et les danses tribales, la visite du duc de Windsor ; elle essaie de revivre ces souvenirs sous le ciel bas et gris d'un Danemark occupé par les Allemands...
(Echo des montagnes)
"J'ai cette chance, dans l'existence, de rêver en dormant, et mes rêves sont toujours beaux. Je ne connais le cauchemar, avec sa combinaison torve de claustrophobie et d'horror vacui, que par les descriptions d'autrui - et, surtout, depuis ces derniers vingt-cinq ans, par les livres et le théâtre. Cette disposition, ce don ou ce talent à rêver est héréditaire chez nous, il tient de famille. Nous l'estimons tous beaucoup, et nous nous sentons privilégiés en comparaison de notre entourage. Une de mes vieilles tantes voulut que l'on grave ces mots sur sa tombe: "Elle connut bien des jours difficiles, mais ses nuits furent belles."
ll ne faut pas croire pour autant que nos rêves se cantonnent à la sphère de l'idylle ou du jeu, ou sans exception, aux domaines dans lesquels, en état de veille, nous nous sentons en sécurité. Il s'y passe des événements saisissants, des abîmes se creusent et des monstres en surgissent. Les fuites éperdues et les poursuites furieuses y sont monnaie courante, et tout aussi fascinantes. Mais en s'inscrivant dans le monde des rêves, toutes les peurs changent
de caractère. Comme sous l'effet d'une ivresse légère, elles se montrent drôles et enchanteresses, et les dragons les plus noirs deviennent soudain des alliés.
J'ai lu ou l'on m'a raconté qu'un manuel de savoir-vivre, paru au XVIIe siècle, prescrit, dans son premier paragraphe, aux gens bien élevés de ne jamais rapporter leurs rêves à leurs proches, car ils ne sauraient intéresser personne. Il ne me viendrait pas à l'esprit de m'élever contre les bonnes manières du XVIIe siècle, et je ne me permettrais pas de décrire un seul de mes rêves. Mais dans la mesure où les rêves et leur caractère ne cessent de constituer pour moi un sujet passionnant, je prendrai la liberté de consigner ici quelques observations que j'ai pu faire grâce à mes propres rêves. Si le lecteur devait les trouver vagues et incertaines, voire décousues, je le prie de faire montre d'indulgence. Comme avec les parfums, il est dans la nature des rêves de ne pouvoir être saisis ou capturés par les mots.
L'élément essentiel et décisif de mes rêves est celui-ci: je me trouve et me déplace dans un monde qui m'appartient et dont je fais partie, plus profondément que ce n'est le cas dans l'existence quotidienne, et ce, dans la double acception du terme. Cependant, il ne m'arrive jamais de rencontrer en rêve des paysages ou des êtres vivants que je connais ou que j'ai connus. Enfant, j'ai rêvé d'un chien particulièrement chéri, mais, en même temps, j'ai senti avec une clarté et une douleur particulières que Natty Bumppo n'était plus du nombre des vivants - et ce rêve fut une exception et source de maintes interrogations. Même quand je m'endors en pensant à des personnes connues et des projets tangibles, l'atmosphère qui m'environne se métamorphose sous mes yeux, comme à un signal donné. Je suis sur une grand-route, en plein orage, près d'une ville où je ne suis jamais allée, je sors avec une vieille femme acheter du poisson, par une journée plus froide qu'aucunes que j'ai jamais vécues - ou, par un jour tiède d'été, je contemple un bief du haut d'un pont. Selon la loi inexorable de mes rêves, les contrées et les demeures chères à mon coeur vers lesquelles je me hâte, les amis irremplaçables et les plus précieux que je dois retrouver, me sont tous inconnus jusqu'à cet instant-là.
Il n'y a eu qu'une seule période de ma vie, et en relation avec un seul type de personnes, au cours de laquelle la loi a perdu de sa force - et où des événements extérieurs au monde du rêve ont réussi à pénétrer. Ce fut une expérience étrange et nouvelle, et tant par le moment que par le caractère des circonstances qui l'entouraient, elle m'inquiéta. J'en eus le vertige.
L'autre trait de mon monde de la nuit est sa vastitude, ou son absence de limite. Je voyage au milieu de paysages immenses, entre des montagnes et des abîmes prodigieux, avec des panoramas sans fin de tous côtés. Cet espace et cette légèreté de mes rêves se retrouvent dans leur palette de couleurs, avec des tons de bleu et de violet des origines, et un brun mystérieusement transparent. Je me promets de m'en souvenir à mon rêveil, mais je les ai toujours oubliées à ce moment-là. Les arbres de mes rêves sont bien plus hauts que ceux que je vois les yeux ouverts - je les jauge afin d'établir la comparaison, mais suis incapable de me rappeler leur taille au matin.
Des perspectives infinies jaillissent devant moi. Dans mes rêves, je vole sans la moindre entrave, je nage, je plonge et je dérive dans des eaux sans fond et d'un vert bouteille. Dans mes rêves, il m'est arrivé de sentir, dans un instant de béatitude suprême, que j'avais la quatrième dimension à portée de ma main. Le monde du rêve n'obéit pas à la pesanteur, son atmosphère est liberté, son apogée, la conscience du triomphe - incompréhensible et contraire à la logique des heures de veille.
Dans le cosmos de nos rêves, nous nous sommes libérés de tout lien avec les forces qui organisent et soutiennent le monde, pour parvenir ainsi à une conscience universelle. Nous avons remis notre esprit entre les mains des puissances imprévisibles, sauvages et créatrices
du monde, nous avons conclu un pacte avec l'imagination universelle.
Il est possible aux hommes, ici, dans ce bas monde, de mobiliser leur être et de faire appel aux forces qui distinguent et qui mettent de l'ordre, ces forces qui, par la gravitation, maintiennent les planètes dans leurs orbites autour du soleil, et qui, comme après un cyclone, replacent les eaux des océans dans leur nature horizontale. Mais, comme toutes les puissances que l'on peut invoquer, elles savent aussi demander des comptes à celui qui les implore. Leur rétribution est juste, elle va de pair avec le mérite, et la plus haute récompense qu'elles accordent à leurs serviteurs est la sûreté, la plus haute sérénité à laquelle les hommes peuvent aspirer: la paix du cœur.
Mais il nous est impossible d'adresser nos prières à l'imagination indomptable et colossale du monde. Nous n'avons pas oublié notre dernière tentative, et la manière dont les puissances supérieures nous ont alors retourné leurs propres questions, à la vitesse d'un tourbillon: « Où étais-tu alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? » et encore, « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? »
En nous adoptant, les forces créatrices de l'univers nous ont absous une fois pour toutes, elles nous ont exonérés de l'initiative et du choix, et libérés de toute responsabilité. Elles n'exigent de nous aucune contribution, elles attendent seulement que nous recevions.
Ce dont elles nous dotent n'est que cadeau ou grâce - bakchich -, et le don suprême qu'elles nous font, c'est l'inspiration. Il est dans la nature propre du don, même lorsqu'il a été remis entre les mains de celui qui le reçoit, d'appartenir encore au donateur, et de porter le nom des deux. L'inspiration, pour l'homme auquel elle est accordée, ce cadeau dont il a la jouissance, ne fait qu'un avec son étre, mais, en même temps, elle est avant tout le don de Dieu à un être humain.
Le navire a renoncé à lutter contre le vent et le courant, sa voile se gonfle, et il vogue, digne et heureux, sur des vagues dociles. Son cap est-il le sien propre, ou l'oeuvre de forces extérieures? Nous ne saurons le dire. Le danseur s'en remet à son partenaire plus expérimenté et se laisse guider par lui - et l'envolée libre et sûre de la valse est-elle le fait de celui qui conduit ou de celui qui est dirigé? Ni le navire, ni le danseur, ni le rêveur ne peuvent répondre et ne demanderont à répondre. Tous auront atteint et reconnu le triomphe souverain qui réside dans l'aban don, dans la reddition sans condition.
Encore un dernier mot au sujet des rêves.
Je me suis laissé dire que la faculté de rêver appartient à l'enfance et à la prime jeunesse et que cette capacité ou ce don s'affaiblit plus tard, comme l'ouïe ou la vue.
Mon expérience m'a montré que ce n'est pas le cas, au contraire.
Aujourd'hui je rêve plus que je ne rêvais enfant ou jeune fille, et ce qui se manifeste dans mes rêves actuels est encore plus munificent, et affiche un caractère toujours plus riche et plus beau.
Je me dis parfois que mes pieds sont placés sur un chemin qu'il me faudra désormais suivre et que le centre de gravité de mon existence se déplacera lentement du monde quotidien - le domaine des puissances organisatrices, marquantes et stabilisatrices - vers la sphère de l'inspiration et de l'imagination. Il m'est déjà arrivé de croire, comme lorsque j'avais vingt ans et que je devais aller au bal en soirée, que la journée est un laps de temps sans rime ni raison. Avec le crépuscule qui tombe, avec les premières étoiles qui s'allument dans le ciel avec les premières lumières qui étincellent dans les lustres la vie s'éveille autour de moi et vient à ma rencontre dans toute sa réalité.
Le fleuve rebelle qui fonce avec fureur en criant son chantsauvage, qui ravage ses rives, s'élargit enfin et ralentit sa course. Il finira par se fondre sans bruit dans l'océan des rêves et connaitra en silence la victoire ultime qui tient dans l'abandon, la reddition. inconditionnelle.
Après l'Afrique, dans les premiers temps qui suivirent mon retour au Danemark, j'éprouvais bien des difficultés à faire le tri dans ce qui était la réalité.
Mon monde africain avait disparu au-dessous de l'horizon, la Croix du Sud était restée suspendue dans le ciel pendant un moment, telle une trace lumineuse laissée par ce monde-là, puis elle se mit à vaciller, à pâlir, pour se retirer aussi. Les paysages, les animaux et les hommes de là-bas ne pouvaient rien signifier d'autre pour mon entourage que les paysages, les animaux et les hommes de mes rêves de la dernière nuit. ll n'était pas possible d'en parler - cela aurait peut-être été de mauvaise compagnie -, leurs noms n'étaient plus que des sons, Ngong, une adresse.
Le destin avait voulu que mes invités de la ferme étaient partis, ou sur le point de partir. lls n'étaient pas à rester longtemps au même endroit. Sir Northrup MacMillan, Galbraith et Berkeley Cole et Denys Finch-Hatton étaient partis avant moi, Lord Delamere, Lord Francis Scott et Hugh Martin les avaient suivis à leur tour. Le baron suédois Erik von Otter, qui s'était distingué à la Guerre comme officier des King's African Rifles, était mort dans un poste lointain à la frontière nord, Gustav Mohr, mon fidèle jeune ami norvégien, et mon conseiller, s'était noyé pendant un safari, alors qu'il traversait un fleuve du Tanganyika. Ils étaient tous désormais là-bas, à neuf mille pieds d'altitude, en sécurité dans la terre d'Afrique dont ils ne tarderaient pas à faire partie. Et moi, j'étais ici, dans la verte forêt danoise, avec le choc des vagues de l'Oresund tout proche. Là-bas, loin, quelque part au Nord-Est, les plaines où nous avions combattu les feux de brousse durant les années de sécheresse, les villages des squatters avec le tintement des ustensiles de cuisine, avec le roucoulement des ramiers dans les grands arbres sous lesquels on palabrait, tout cela avait été morcelé en parcelles pour devenir un quartier résidentiel de Nairobi. Quant aux grandes pelouses, où, à mon arrivée, les zèbres venaient paître et jouer, elles avaient été transformées en courts de tennis. Tout cela n'était plus que de l'ordre du constat, des faits à l'effet aussi étonnant que surprenant chaque fois que l'on y songe, mais difficiles pourtant à garder clairement à l'esprit.
Qu'avais-je encore à voir avec l'Afrique? Le vieux continent secret s'en était fort bien sorti avant d'occuper mes pensées. N'allait-il pas tranquillement continuer de la sorte, comme si je n'avais jamais été là? Il m'était impossible de trouver moi-même une réponse à cette question ..." (traduction Gallimard, 2006)

"Winter’s Tales" (Contes d’hiver, Vinter-Eventyr, 1942).
Les premiers contes de Karen Blixen ont de profondes racines dans son expérience la plus intime, la fuite devant une identité contraignante, le thème du destin. Ces "Contes" furent écrits au cours des années solitaires à Rungstedlund après la mort de sa mère en 1939, alors que la guerre et l'Occupation empêchait la cosmopolite Karen Blixen de voyager et de trouver des "âmes-soeurs" en capacité de partager avec elle de nouvelles inspirations. La nostalgie unifie ces onze contes ainsi rassemblés, quoique disposés de manière légèrement différente dans les éditions américaine et danoise ...
"The Young Man with the Carnation" et "A Consolatory Tale", - avec un personnage commun, l'écrivain Charlie Despard, qui prend conscience de sa dépendance à l'égard de son public et de sa capacité à interpréter le monde au lieu de le vivre -, évoquent tous deux la fonction de l'art dans la vie humaine. C'est dans "A Consolatory Tale" que l'on sent à quel point raconter une histoire transfigure celui qui l'écrit ou qui la conte : lorsque l'homme commence ici son histoire, "il fut changé, le bailli primitif s'effaça, et à sa place s'assit une petite figure profonde et dangereuse, consolidée, alerte et impitoyable : le conteur de tous les âges..."
L'édition danoise du livre est introduite par "The Sailor-boy's Tale", l'un de ses chefs-d'œuvre, une histoire sur le pouvoir de l'archétype féminin...
Quatre des huit récits offrent des portraits de femmes exceptionnellement fortes. Dans "Sorrow-acre", - souvent considéré comme l'un des sommets de l'art de Karen Blixen -, cohabitent la jeune épouse Sophie Magdalena, qui, mariée à un homme qui a l'âge d'être son grand-père, a pris la responsabilité de lui donner un héritier mâle, et la vieille femme Anne-Marie, qui rachète son fils d'une longue peine de prison en moissonnant un grand champ en un jour: la femme s'acquittera de sa tâche, mais mourra d'épuisement peu après. Inspiré d'un conte populaire danois datant du XVIIe siècle, c'est bien l'une des œuvres les plus connues de l'auteur et sa construction magnifiquement élaborée...
Héloïse, dans "The Heroine", est une strip-teaseuse qui, lorsqu'elle et un groupe de voyageurs sont arrêtés par les Allemands pendant la guerre franco-prussienne, a le courage de résister à une demande indécente de l'un des Allemands, sauvant ainsi ses amis d'un tourment de conscience. Jensine, dans "The Pearls", entre dans un conflit de volonté avec son jeune mari, à qui elle tente d'apprendre le sens de la peur. À la fin, cependant, elle apprend à surmonter sa propre peur du rôle que la nature lui a donné, qui est de devenir la mère des générations à venir. "The Invincible Slave-owners" conte l'histoire de deux sœurs, Mizzi et Lotti, issues d'une bonne famille, mais dont la vie est marquée par la pauvreté, et qui luttent courageusement pour sauver les apparences. Quatre récits, “The Dreaming Child” “Alkmene” “The Fish” et “Peter and Rosa", content toutes des moments d'éveil, lorsqu'une vérité importante de l'existence est comprise par un ou plusieurs des personnages. Cependant, la vérité ne peut être comprise qu'à l'issu d'un combat et il arrive que celui-ci conduise à la mort, comme c'est le cas dans "Peter et Rosa", une fable remplie d'images de la mer ...

(Lettres du Danemark, trad. Gallimard)
(Tania Blixen à Ellen Dahl, fragment, mai 1946)
"... Tu soutenais durant nos conversations - si je t'ai bien comprise - que l'avancée du nazisme et l'accord du peuple allemand, ou du moins son absence de résistance au nazisme, avaient frappé l'humanité entière ces dernières années comme la révélation d'un mal jusqu'à présent inconnu ou insoupçonné, et d'un caractère borné nouveau, jusqu'à présent presque inconnu ou insoupçonné.
Pour ma part, je pensais au contraire qu'il n'y avait qu'une différence de niveau, et non d'essence, entre ces phénomènes et d'autres qui nous sont connus à travers l'histoire ou à travers notre propre expérience, à chaque fois qu'une vision fanatique et consciemment subjective s'impose par la violence. À mon avis, on ne donne qu'une explication superficielle des événements de ces douze dernières années quand on affirme que le peuple allemand tout entier a, contrairement aux autres nations, un penchant pour le "sadisme" (un terme devenu courant mais que l'on utilise souvent au hasard sans que ceux qui s'en servent ne comprennent bien ce qu'il veut dire, en réalité on utilise donc ce mot plutôt pour désigner quelque chose de mystérieux et d'affreux dont on n'a pas envie de parler plus en détail), ou encore qu'il est par nature un "peuple de laquais" qui se laisse volontiers, voire même avec joie, mener là où n'importe quel homme au pouvoir veut les mener.
Certes, on peut dire que jamais l'humanité n'a vu une vision fanatique, consciemment subjective, appliquée avec plus grande cruauté, ou supportée avec moins de résistance que ce que nous avons vu en Allemagne nazie.
Mais l'humanité l'a vu et l'a toléré, elle voit aujourd'hui la même chose pratiquée et tolérée dans d'autres conditions et dans d'autres domaines, mais avec en soi une telle part de l'essence du nazisme qu'on peut dire, du moins me semble-t-il, que nous avons su voir la poutre dans l'oeil d'Hitler et du peuple allemand, mais que nous ne voyons pas la paille dans notre propre oeil.
On désigne souvent aujourd'hui Hitler et son parti comme une bande de "gangsters". Cela semble correct, dans la mesure où, au cours de leur progression, ils ont effectivement utilisé des méthodes de "gangsters" (de même que l'on peut considérer que le gangstérisme américain, en soi un phénomène nouveau et remarquable, peut vraiment avoir servi d'inspiration et de modèle à certains mouvements politiques et sociaux contemporains).
Mais il y a une différence de taille, et dans ce cas, une différence d'essence entre les «gangs» d'Al Capone et ceux de Hitler (ou Mussolini). Les gangsters de Chicago étaient une horde de Francs Coquins, de brigands et d'assassins qui s'appropriaient tout ce qu'ils pouvaient, en se moquant éperdument de la loi et du droit. Mais je ne crois pas qu'ils aient pensé un seul instant qu'ils avaient un droit moral, ou une mission d'ordre divin, pour se comporter ainsi. Ils se préoccupaient sans doute bien peu de notions morales ou divines. Je crois qu'ils voyaient leur activité et eux-mêmes à peu près comme tout le monde les voyait. Leurs abus et leurs problèmes sont en gros de nature pratique. Avec le nazisme, c'est autre chose.
Car partout, et à toutes les époques, une grande partie de l'humanité présente un certain nombre de caractères diaboliques - soif de pouvoir, mépris des hommes, égoïsme brutal, stupidité brutale, mais Caliban lui-même, la bassesse humaine personnifiée, a beau être une espèce de diable et un individu bien dangereux, il n'est pas pour autant «démoniaque» (j'utilise ici, et dans ce que je vais dire, ce mot que tu as employé au sujet de Hitler et du nazisme, même si personnellement j'utiliserais plutôt un autre mot, car j'ai sans doute une opinion plus favorable des «démons» que toi, je crois notamment qu'ils sont sincères. Mais le fait de m'en tenir à tes propres termes facilitera sans doute la compréhension entre nous).
Et ce n'est que lorsque la passion subjective se concentre pour se manifester sous la forme d'une idée qu'elle s'élève ou descend, chez l'individu comme dans la nation, à ce qu'on appelle le «surhumain» ou le «sous-humain». Pour combattre un tel esprit, et protéger les idées et les traditions humanistes, il faut un autre type d'armes que celles qu'on utilise contre le gangstérisme.
Les phénomènes et les circonstances qui ont rendu possible la domination nazie en Allemagne sont les mêmes que celles qui ont créé les conditions et la probabilité d'autres situations d'exception dans l'histoire, les mêmes que celles qui créent les conditions et la probabilité des situations d'exception à notre propre époque :
- Une idée ou un principe, qu'on proclame et présente comme absolu et sacré en soi, avec la volonté d'appliquer cette idée ou ce principe.
-- La conviction et le fait de proclamer que les gens qui refusent de s'associer à une telle idée ou un tel principe, ou qui vont même jusqu'à s'y opposer, se sont mis ipso facto hors la loi, qu'ils n'ont plus de droits humains et qu'en gros, en ce qui concerne les individus, ils ont même cessé d'être des hommes.
- La conviction et le fait de proclamer qu'il est en soi contagieux d'essayer de comprendre la façon de penser d'un adversaire ou de quelqu'un qui pense autrement. La conviction et le fait de proclamer que, plus on évite toute connaissance et toute compréhension de l'adversaire et de sa cause de manière générale, plus on reste pur soi-même. Si on résume en un seul mot : la proclamation de la notion d'HERESIE.
II
De mon point de vue, c'est dans cette dernière étape que se trouve le point décisif de toute cette situation. C'est peut-être parce que je me sens, en toute humilité, la servante des mots, et de la pensée, que l'oppression de la libre pensée et de la libre parole m'apparaît comme l'obscurcissement final et fatal.
Aucune vision fanatique et consciemment subjective de la vie ne peut se réaliser sans faire de la notion d'hérésie une réalité dans la conscience des hommes. Mais dès que c'est le cas, dès que l'oppression de la libre pensée et de la libre parole est prônée comme un principe et un devoir, c'est « Chaos come again ». Car ce sont alors des gens fidèles aux principes et au devoir qui entrent au service des forces démoniaques et qui les servent avec d'autant plus de flamme qu'ils sont fermes dans leurs principes et fidèles à leur devoir. Ces honnêtes gens peuvent tout à fait avoir gardé suffisamment d'humanité pour regretter une situation à laquelle ils contribuent et plaindre les victimes qu'ils livrent à l'anéantissement. Mais ce qu'ils craignent et rejettent par-dessus tout, c'est la contagion qui, par une connaissance plus intime et une compréhension plus poussée de telles situations et de telles victimes, et de l'«hérésie» même, pourrait les mener eux-mêmes à la perdition. Ils peuvent se permettre de nier la vérité, au nom de l'idée sacrée, mais ils n'osent pas se risquer à renier cette idée. Ils sont « de bonne foi », dans la mesure où l'on peut décider de bonne foi d'être aveugle. Ce sont bien des gens aux principes fermes, fidèles au devoir, qui au cours de la précédente guerre mondiale ont signé la déclaration «Es ist nicht wahr !».
Dans la comédie de Heiberg, "Le potier Walter", le premier paragraphe du contrat par lequel Walter entre au service du propriétaire de la mine - c'est-à-dire le Malin - est le suivant : «Je hais la lumière et j'adore la nuit », et en acceptant ce paragraphe, il est déjà lié à tous les suivants. Car cette profession de foi est partout le premier article du Credo de la «bonne foi ». Et l'acceptation et l'abandon total à ce Credo est la « démonisation» de la masse crédule et au fond innocente. C'est la croyance au diable «chez les autres» qui, selon l'époque et le lieu, sont désignés comme papistes, abolitionnistes, bourguignons et non aryens - qui fait surgir dans l'être même des gens le diable apparent, son essence et toutes ses œuvres.
Je dois ici avouer, à mon grand regret, que j'ai toujours eu du mala considérer le nazisme comme une véritable idéologie. Je me suis rendue en Allemagne pour essayer de comprendre, en vain. Mais je ne doute pas qu'il soit apparu au grand peuple allemand comme un évangile, sous un éclairage idéologique. La nation allemande ne s'est pas - comme on semble le penser maintenant - consciemment plongée dans une série d'hallucinations arbitraires, issues de l'esprit d'un fou. Elle n'a pas non plus été dès le début contrainte de l'accepter sous la menace des armes. Car il en est sans doute du prophète Hitler comme du prophète Mohammed, selon Carlyle : «À la force de l'épée? Soit, mais d'où cet homme sortait-il les épées? Chaque nouvelle religion commence par une minorité constituée d'un seul homme - d'un côté lui, de l'autre côté tous les autres. Il ne lui servirait à rien de chercher à répandre sa foi à l'aide de l'épée. Laissez-le se procurer ses épées! »
Je pense donc qu'au tout début, pour la grande masse du peuple allemand, le nazisme a été une idée. Pour le peuple, il signifiait le redressement de l'Allemagne et la sortie du chaos, il signifiait une communauté germanique, et en quelque sorte sa mission divine, le salut et la renaissance du monde à travers l'essence germanique, c.-a.-d. à travers un retour à la nature grâce à la victoire de l'esprit le plus fort et le plus simple, peut-être la saine barbarie, sur une civilisation frivole et incapable de vivre, et à travers le triomphe de la vision héroïque du monde sur la conception mécanique, mercantile ou esthétique du monde.
Il peut y avoir eu dans cette idée - et pour le peuple qui lui a donné naissance et qui a vu sa propre victoire dans la propagation victorieuse de cette idée autour du monde - suffisamment d'inspiration pour qu'une nation non seulement soit prête à sacrifier sa vie pour la réaliser mais en arrive également a oublier et à excuser des débordements et des excès qui devaient lui paraître sans importance par rapport à la béatitude que cette réalisation apporterait à l'humanité. Tous les peuples pardonnent bien quelques sauvageries au sauveur de la patrie. On n'atteint pas les sommets par un sentier abrupt sans faire de faux pas, on ne peut espérer saisir la couronne même de la vie sans quelques fausses prises. En Allemagne, durant ces années, toute l'existence était planifiée et menée à un rythme qui laissait évidemment les scrupules des temps anciens loin derrière.
Où est donc la ligne de transition entre cette aurore chargée de tempêtes - qui tourbillonnait certes au milieu de flots de brouillards, de trombes d'eau et de foudres cachées, mais qui aux yeux de millions d'hommes apparaissait comme de la lumière et comme un présage de l'arrivée du jour béni - et les profondes ténèbres cupides dans lesquelles un grand peuple a sombré? Elle est dans le premier paragraphe du contrat du potier Walter.
Elle est dans l'acceptation sans conditions de l'«hérésie» en tant que notion et dans le rejet sans conditions de l'« hérésie », considérée comme le véritable péché mortel, le seul. La volonté du grand peuple allemand était d'avoir la foi, son cri était : «Secours mon manque de foi! » Les bourreaux de Hitler eux-mêmes - à part quelques exceptions particulières et pathologiques - auraient été incapables, sans cette volonté d'orthodoxie, de perpétrer les actes que nous venons d'apprendre avec effroi. (Je dirais que, dans l'ensemble, il est difficile pour des gens normaux d'en «bully » d'autres de tout coeur, sans avoir une certaine conviction d'avoir « raison ». La terreur d'Al Capone était certainement d'un tout autre genre, plus «business-like») Et la grande masse du peuple pourrait se frapper la poitrine et invoquer sa bonne foi et sa bonne volonté. Ce n'était pas sa faute si elle avait entendu parler une fois du communisme et du judaïsme, ou de ses conséquences : les camps de concentration et les chambres à gaz. Depuis lors, à chaque fois qu'on en avait parlé, elle s'était bouché les oreilles par loyauté pour son engagement, et à chaque fois qu'une voix intérieure ou extérieure avait suggéré en chuchotant la possibilité d'une meilleure connaissance ou d'une compréhension plus claire du communisme ou du judaïsme, des camps de concentration et des chambres à gaz, elle avait fait le signe de la croix gammée.
Qu'au nom d'Adolf Hitler cette horreur et cette misère existent réellement! - ils n'avaient pas accès au système de représentations du peuple élu! Il valait mieux que le feu détruise dans les crématoires la chair et les os des hérétiques que de voir une braise de l'un brûler un juste ! La grande masse du peuple avait signé le contrat du propriétaire de la mine au moment même du lever du soleil, et s'était à l'instant même vouée à lui de toute son existence matérielle et mentale. Le propriétaire de la mine est devenu, tel que nous voyons les choses maintenant, celui qui au bout du compte a accaparé le profit : il a attiré, comme une partie d'elle-même, la chair et les os d'une grande nation, sa vie et sa renommée, dans son propre élément.
Cette transition est abrupte, tellement abrupte qu'on est pris de vertige quand on la considère, comme on est pris de vertige quand on regarde une chute. Cette ligne de transition est parallèle à bien d'autres dans l'histoire des hommes...."

"Nouveaux contes d'hiver" (Last Tales, 1957)
Les récits et les contes qui composent ce recueil de la baronne danoise Karen Blixen furent écrits et publiés en anglais, en 1957, sous le pseudonyme d'Isak Dinesen. "Seven Gothic Tales" et "Contes d'hiver", publiés respectivement en 1934 et 1942, lui ont assuré une place de premier plan, tant aux États-Unis qu'en Europe, où l'on salua ses dons exceptionnels pour allier de façon harmonieuse la qualité et le naturel. Les sept récits donnés pour des fragments du roman "Albondocani", qui n'a jamais vu le jour, sont des illustrations parfaites du pouvoir de parer d'une grandeur légendaire des personnages proches de l'homme quotidien. Les plus pathétiques sont sans doutes les deux volets de l'histoire d'Angelo: "Le Manteau" et "Promenade de nuit". Le jeune Angelo est le disciple préféré du grand artiste Leonidas Allori, condamné à mort, et l'amant de sa femme. A la veille de l'exécution, Angelo accepte de passer la nuit en prison à la place d'Allori, pour permettre à celui-ci de rejoindre une dernière fois son épouse bien-aimée. Il sera exécuté si le prisonnier ne revient pas à l'aube. Le sentiment de sa culpabilité devient pour Angelo si douloureux, qu'il souhaite la mort. Mais au dernier moment, Allori tient sa promesse et, d'un seul regard, fait comprendre à son disciple qu'il sait...
La promenade nocturne du jeune homme qui, se sentant définitivement exclu de la communauté humaine, jure de ne plus jamais dormir et de ne trouver de paix que la nuit où il rencontrera un homme fier de ne pas dormir, est digne de Dostoïevski.
"PROMENADE DE NUIT
Après la mort de Leonidas Allori, son disciple Angelo Santasilia fut affligé d'un malheur : il cessa de dormir. Les gens qui connaissent l'insomnie par expérience personnelle croiront-ils le narrateur s'il leur dit que cette épreuve, la victime l'assuma dès le début de son plein gré ? C'est cependant ce qui se passa. Angelo franchit les grilles de la prison où il venait de passer douze heures en qualité d'otage à la place de son maître condamné et il pénétra dans un monde où, pour lui, les chemins ne menaient nulle part. Il se sentait totalement isolé, abandonné complètement dans le monde. ll sentait aussi qu'un homme frappé par une honte et un chagrin tels que les siens, passant ceux des autres hommes, devait en même temps échapper aux lois qui les gouvernent. Il décida de ne plus dormir.
Pendant cette première journée, il n'eut aucun sentiment de la durée et il prit peur lorsqu'il s'aperçut que la nuit était tombée. Les gens étaient rentrés chez eux, avaient allumé lampes et bougies ; maintenant ils les éteignaient et, étendus sur leur lit, se livraient sans crainte au sommeil. Angelo s'arrêta successivement devant chacune des maisons tandis que les rectangles de lumière disparaissaient un à un. "Au milieu de ceux-là, réfléchit-il, je n'ai rien à faire, je vais continuer à marcher, je vais aller vers ceux qui restent éveillés".
Il savait que ses amis, élèves eux aussi du maître disparu, veillaient ensemble ce soir, mais il ne voulait à aucun prix les rejoindre car ils seraient en train de parler de Leonidas Allori, ils l'entoureraient et l'accueilleraient comme le disciple préféré, celui sur qui s'était posé le dernier regard du maître. "Oui, pensa-t-il en riant, comme si j'étais Elisée, le disciple du prophète Elie, qui avant de monter sur le char de feu lui jeta son manteau". Il se rendit donc dans les tavernes et les cabarets de la ville où des gens rassemblés par le hasard criaient dans le tumulte et où l'air bruissant de musique et de chansons était lourd des vapeurs du vin, de l'odeur des vêtements et de la sueur des étrangers. Mais il ne voulait pas boire comme ceux-là dont certains, la tête appuyée sur la table, s'endormaient tandis que d'autres se levaient en chancelant pour rentrer chez eux et regagner leur lit. Mais il ne voulait pas boire comme les autres. Il quittait un cabaret pour en gagner un autre et aussi bien dans les salles des auberges que dans la rue, il se disait : "Tout cela ne me regarde pas. Moi, je ne dormirai plus".
C'est dans une de ces tavernes que, durant la nuit du lundi au mardi, il rencontra Giuseppino, ou Pino, le philosophe Pizzuti, petit homme ratatiné aussi noir de peau que si on l'avait pendu et fumé dans une cheminée et que l'on avait surnommé "Pipistrello" - la chauve-souris - en raison de son agitation continuelle mais silencieuse. Il avait possédé autrefois, bien des années auparavant, le plus beau théâtre de marionnettes de Naples, mais, dans la suite, la chance l'avait quitté. Mis en prison et enchaîné, trois doigts de sa main droite s'étaient atrophiés, de telle sorte qu'il ne pouvait plus manœuvrer ses poupées. Maintenant il errait d'un endroit à l'autre, pauvre entre les pauvres, mais c'était un être de lumière comme éclairé par l'amour d'autrui et par la sympathie compréhensive et bienveillante qu'il accordait à l'interlocuteur de hasard. Angelo passa le jour et la nuit qui suivirent en compagnie de cet homme et en le regardant, en l'écoutant, il n'eut pas de peine à rester éveillé.
L'ami des hommes comprit immédiatement qu'il se trouvait en présence d'un désespéré. Pour mettre le jeune homme en confiance, il commença par lui parler, pendant un moment, de lui-même. Il décrivait ses marionnettes, une à une, avec exactitude et enthousiasme, comme si elles eussent été de véritables amies et des camarades artistes, avec des larmes dans les yeux parce qu'elles étaient désormais perdues pour lui. "Hélas ! mes bien-aimées, gémissait-il, elles m'étaient dévouées et avaient confiance en moi. Mais elles sont maintenant dispersées ; bras et jambes flasques, avec leurs ficelles moisies, elles ont été expulsées de la scène et jetées dans les profondeurs de la mer. Car ma main gauche ne pouvait plus les faire mouvoir, ni ma main droite les tenir debout". Mais bientôt, ainsi qu'il avait toujours fait au cours des vicissitudes de son existence, il ramenait sa pensée vers la vie éternelle. "Ce n'est pas une raison pour s'attrister, dit-il, au Paradis je les retrouverai et je les embrasserai toutes. Au Paradis j'aurai dix doigts à chaque main".
Plus tard, après minuit, Pino orienta la conversation sur la vie d'Angelo, en débrouilla l'écheveau et finit par la connaître du bout des sept doigts. De fil en aiguille il arriva que, la nuit suivante, Angelo raconta toute son histoire, ce qu'il n'aurait pu faire avec personne d'autre au monde que ce vagabond infirme. Tandis qu'il l'écoutait, une grande, une solennelle harmonie se répandit sur le visage du vieil homme. "ll n'y a pas là de quoi s'affliger, dit-il. C'est bon d'être un grand pécheur. Les êtres humains auraient-ils admis que le Christ mourût sur la Croix pour couvrir nos mensonges médiocres et nos minables débauches ? Nous aurions à craindre que le Sauveur pût même en venir à penser avec dégoût à Sa fin héroïque! C'est exactement pur cette raison, comme vous le savez, qu'à l'heure même de Sa crucifixion, on prit soin qu'il eût des voleurs auprès de Lui, un à chacun de Ses côtés, et qu'Il pût porter Ses regards de l'un à l'autre. En cet instant, Il peut nous regarder l'un après l'autre, admettre sans aucun doute et Se répéter à Lui-même : "Ah, en vérité, cela était nécessaire". Un moment plus tard, Pino ajouta : "Et je suis moi-même Dysmas, le voleur crucifié auquel le Paradis a été promis".
Mais de bonne heure, le jeudi matin, Pizzuti disparut subitement comme un rat dans une bouche d'égout. Il vida les lieux pour faire une course indispensable et ne revint pas. Angelo ne revit que sept ans plus tard cet excellent homme. Après son départ le silence se fit de plus en plus profond et définitif. Alors le réprouvé comprit qu'il n'aurait plus besoin de se cramponner à sa décision. Il ne lui arriverait plus de s'endormir.
Pendant un certain temps, il continua à errer, absolument seul au milieu des hommes, décidé à poursuivre son dessein, tel un jeune ascète inexpérimenté mais ambitieux qui porte le cilice à même la peau. Afin de ne pas rencontrer ses anciens amis il changea de domicile et ne revint jamais à son ancienne chambre. Il découvrit un petit réduit sous les combles à l'autre bout de la ville. Au début il fut lui-même surpris de constater que ses nuits sans sommeil ne lui paraissaient pas longues, que le temps lui semblait simplement aboli - la nuit venait, puis le matin et cela n'avait pas de sens pour lui.
Mais d'une manière tout aussi inattendue, son corps se rebella contre son esprit et sa volonté. Vint le moment où l'orgueil l'abandonna et où il eut recours aux grandes puissances de l'univers. "Méprisez-moi, rejetez-moi, mais laissez-moi être comme les autres, laissez-moi dormir".
Alors il se procura de l'opium mais sans résultat. Il obtint par un Grec du port un autre puissant somnifère qui n'eut d'autre effet que de lui procurer une série de sensations nouvelles, tout à fait confuses de la distance, si bien que des objets et des époques éloignés lui semblaient proches alors que les objets qu'il savait être à sa portée, comme ses propres mains ou ses pieds ou les marches de l'escalier, lui paraissaient infiniment éloignés.
Quand il en arriva là, il avait l'esprit qui fonctionnait avec une extrême lenteur. Des heures ou quelquefois des jours s'écoulaient entre le moment où il remarquait une chose et celui où il en comprenait le sens. Un jour, dans la rue, il aperçut Lucrezia qui, revenue à la ville, vivait chez sa mère. Mais ce ne fut que tard dans la nuit, lorsque les carillons des tours de l'église eurent sonné minuit, qu'il se dit : "J'ai vu une femme dans la rue aujourd'hui, c'était Lucrezia". Et un moment plus tard : "Je lui avais promis d'aller vers elle, mais je ne l'ai pas fait". Pendant longtemps il resta assis immobile, retournant cette pensée, et enfin il sourit, comme un très vieil homme.
Ce fut peu après ce jour qu'il commença à se tourner vers les autres et à leur demander secours. Mais lorsqu'il sollicitait un avis il y mettait une telle ardeur qu'il faisait sourire et qu'on lui répondait en plaisantant ou en éludant complètement ses questions. ll recueillit cependant quelques remèdes de bonne femme : une fois au lit, il devait compter les moutons qui franchissaient une barrière ou marquer d'un trait à la craie chaque pierre du soubassement de la cathédrale. Il avait compté bien des milliers de moutons et avait fait cent fois le tour de la cathédrale, lorsqu'un matin il se souvint de Mariana, la vieille femme qui tenait la taverne où il avait rencontré Pizzuti. Elle n'était pas tombée de la dernière pluie et elle avait donné aussi de bons conseils à des amis à lui dont les maux étaient de son ressort : il n'était pas impossible qu'elle pût lui venir en aide. Mais le manque de sérieux qu'il avait rencontré jusqu'à présent chez ses conseillers et la futilité de leurs remèdes l'avaient dissuadé de s'adresser directement à elle et il chercha un prétexte pour aller la voir jusqu'au moment où il se souvint qu'il avait laissé chez elle son manteau pourpre aux broderies marron. Il se rendit alors droit à la taverne. La vieille Mariana le considéra un moment. "Eh bien, eh bien, Angelo, jolie tête de mort, dit-elle. Nous autres, chrétiens, nous ne devons pas nous garder rancune et je te pardonne aujourd'hui d'avoir repoussé mon tendre amour et d'avoir pensé à une autre femme lorsque je te désirais. Je vais t'aider. Maintenant écoute-moi bien et ensuite fais exactement ce que je vais te dire. Débouche de la rue la plus large de la ville dans une autre plus étroite et ainsi de suite. Si, en partant de la ruelle la plus étroite, tu peux te frayer la voie vers une ruelle plus étroite encore, pénètres-y, suis-la et respire légèrement une ou deux fois. Alors tu sombreras dans le sommeil".
Angelo remercia Mariana de son conseil et l'enfouit au plus profond de sa mémoire. Il ne voulait pas y réfléchir dans la journée car il savait, par expérience, que s'il en usait ainsi, le conseil perdrait de son efficacité.
C'est seulement la nuit venue qu'il laissa son esprit s'y arrêter. Mais, lorsque son regard tomba sur son lit défait dans son réduit, l'évocation de sa longue, de son intolérable agonie l'en éloigna. "Comment pourrais-je m'étendre ici? se demanda-t-il. Sur ce lit, nul ne peut s'endormir. Il vaudrait mieux vivre en action le conseil de Mariana. Et c'est, comprit-il soudain, parce que j'ai négligé d'appliquer de cette manière les conseils des autres qu'ils ne m'ont pas servi". Il avait déjà enlevé ses chaussures mais, sans même s'en inquiéter, il sortit dans la rue, pieds nus.
Il lui fallut d'abord atteindre le boulevard le plus large et le mieux éclairé. Il y avait longtemps qu'il ne s'était rendu dans cette partie de la ville et il fut surpris de constater combien il y avait d'êtres humains de par le monde. Ils marchaient plus vite que lui, semblaient absorbés par leurs affaires et, autant qu'il pouvait en juger, marchaient en nombre égal dans un sens et dans l'autre. "Pourquoi, se demanda-t-il, est-il nécessaire pour tous ceux qui habitent l'est d'aller vers l'ouest et à tous ceux qui habitent l'ouest d'aller vers l'est ? Cela donnerait à penser que le monde a été mal fait. Car ils continuent d'aller ainsi d'est en ouest chaque jour et chaque nuit et cependant ils n'arrivent pas à l'endroit où ils voudraient demeurer. Mais, continua-t-il en poursuivant ses observations, si l'on considère que nous n'avons aucune idée de la façon dont le monde est organisé, nous pouvons aussi bien imaginer que tout est pour le mieux ainsi. La ville de Naples tout entière est comme un immense métier à tisser dont les habitants, hommes et femmes, sont les navettes, tandis que le tisserand est ce soir au travail. Cependant ce vaste métier, réffléchit-il tout en poursuivant sa route, ne me regarde pas, à d'autres de s'en occuper. Moi je vais concentrer attentivement toutes mes pensées sur le but que je me suis proposé.
C'est alors qu'il quitta la Via de Toledo pour une rue plus petite et celle-ci pour une autre plus étroite encore. Il n'est pas impossible, pensa-t-il, l'espoir inondant étrangement son cœur, que cette fois-ci, j'ai été bien conseillé". Il était content d'être pieds nus, ce qui rendait ses pas silencieux comme si, lentement et l'esprit tendu, il suivait une piste.
Au bout d'un certain temps il se trouva dans une ruelle si étroite qu'en levant les yeux il ne vit au-dessus de lui qu'un morceau de ciel nocturne pas plus grand que la main, un peu plus clair que les toits. Ici le sol était rude et il n'y avait pas de lumières, il dut appuyer sa main sur le mur d'une maison pour pouvoir continuer à avancer. Le contact d'une matière solide lui fit du bien, il éprouva de la gratitude pour ce mur qui s'évanouit soudain sous sa main pour faire place à l'entrée d'une porte ouverte. Elle conduisait à un passage extrêmement étroit. "J'ai de la chance ce soir. J'ai de la chance d'être tombé sur un corridor aussi étroit". Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il atteignît une petite porte.
Sous cette porte brillait une faible lueur.
Pendant un moment il demeura complètement immobile.
Au-delà de cette porte le sommeil l'attendait et, avec la certitude qu'il allait dormir, la mémoire lui revint.
Dans l'obscurité il sentit que son visage durci et tiré s'adoucissait, que ses paupières s'abaissaient légèrement comme celles de quelqu'un d'heureux qui va s'endormir. Cet instant était à la fois un retour en arrière et un commencement. Il étendit la main, prit soin de respirer légèrement deux fois puis ouvrit la porte.
Assis devant une table dans une petite pièce, faiblement éclairés, un homme aux cheveux roux comptait son argent ..."
(trad. Gallimard, S. de la Baume)
Les plaisirs les plus simples et les moins naturels sont décrits par l'auteur avec une richesse de détails qui révèlent une grande aptitude au bonheur. Mais le sens du mystère et de la cruauté du destin est toujours présent. De cette œuvre d'une intensité bouleversante, il suffit de lire quelques pages pour éprouver le saisissement que donne la découverte d'un monde littéraire foncièrement original...
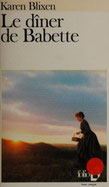
"Le Dîner de Babette" (Anecdotes of Destiny, Skæbne-Anekdoter, 1958)
Cinq récits, "The Diver", "Babett's Feast", "Tempests", "The Immortal Story", "The Ring", où évoluent cinq héroïnes, et qui participent à la fois du monde réel de la mer, de la famille, de l'art, des affaires et de l`univers du rêve, de la fantaisie et de la légende. Un pêcheur de perles s`entretient avec des poissons discoureurs et philosophes, pris de pitié pour l'homme, cette créature "toujours inquiète de la direction à suivre, et qui attache une importance vitale au fait de tomber ou de se redresser [...] Nous autres, poissons, sommes bien tranquilles... L'expérience nous a prouvé [...] que l'on peut très bien flotter sans espoir et même que l'on flotte mieux". Alors que I'homme est effrayé, au fond, par l`idée du temps, qu`il ne trouve pas son équilibre par suite de son déplacement incessant entre le passé et le futur, les habitants de l'élément liquide. écrit l`auteur, ont réuni le passé et le futur dans la maxime "Après nous le déluge". Babette, une cuisinière française réfugiée. après la Commune, en Norvège, entre au service de deux vieilles filles protestantes et chefs de file d'une secte de puritains très austères. Un jour, l'idée lui vient d`offrir à ces gens un dîner qui lui coûte sa petite fortune gagnée à une loterie. Le succès de la soirée tient du miracle. Une joie insolite envahit les convives : « Ils se rappelèrent tous la clarté céleste qui inondait la pièce... de vieilles gens taciturnes reçurent le don des langues, des oreilles sourdes depuis des années s`ouvrirent pour les écouter. Le temps lui-même se confondit dans l'éternité...".
"... Le 15 décembre, on devait fêter le centième anniversaire du pasteur. Ses filles s'étaient préparées depuis longtemps à célébrer ce grand jour, comme si leur bien-aimé père vivait encore au milieu de ses disciples. Et ce fut pour elles un grand sujet de tristesse de constater qu'au cours de cette dernière année la discorde et les dissensions avaient fait d'incompréhensibles ravages dans le petit troupeau. Elles avaient essayé de rétablir la paix, mais se rendirent bien vite compte de la vanité de leurs efforts. On eût dit que la si remarquable énergie et l'amabilité, qui caractérisaient la personnalité de leur père, s'étaient évaporées comme s'évapore la force anodine de la bouteille d'Hoffmann quand on la laisse débouchée sur une étagère. Le départ du pasteur semblait avoir ouvert la porte à des sentiments inconnus des deux sœurs, bien plus jeunes à ce moment-là que les disciples spirituels du maître vénéré.
Surgis d'un passé vieux d'un demi-siècle alors que le troupeau sans berger errait perdu dans la montagne, des hôtes sinistres, non invités, étaient entrés par l'ouverture béante, et avec eux l'obscurité et le froid pénétrèrent dans les petits foyers jadis si bien clos. Les péchés des frères et des sœurs, accompagnés d'un tardif et lancinant repentir, reparurent pareils à une rage de dents, et les offenses réciproques reparurent aussi, suscitant d'amères rancunes.
On ne peut comparer cet état de choses qu'à un empoisonnement du sang.
Deux vieilles femmes faisaient partie de la congrégation. Avant leur conversion, elles avaient médit l'une de l'autre jusqu'à empêcher d'une part un mariage, de l'autre un héritage.
Aujourd'hui, elles étaient incapables de se rappeler les événements de la veille ou de la semaine précédente, mais elles se souvenaient des torts qui leur avaient été faits quarante ans plus tôt, elles continuaient à songer à ces dettes anciennes et se regardaient de travers.
Il y avait aussi un vieux frère qui, tout à coup, se rappela qu'un autre l'avait trompé, quarante-cinq ans auparavant, en traitant avec lui une importante affaire. Il aurait voulu chasser ces images de son esprit, mais elles le blessaient toujours à nouveau comme une écharde profondément enfoncée dans la chair.
Et que dire de cet honnête marin, aux cheveux gris, et de cette pieuse veuve, ridée par l'âge, qui avaient été amants dans leur jeune temps alors qu'elle était la femme d'un autre homme.
Ils en avaient tout récemment conçu du regret, mais chacun d'eux rejeta la faute sur l'autre et s'inquiéta des terribles conséquences d'un péché dont il allait souffrir pendant l'éternité entière peut-être, à cause d'un être qui avait prétendu l'aimer. Ils pâlissaient chaque fois qu'ils se rencontraient dans la maison jaune et évitaient de se regarder.
Comme le grand jour approchait, Martine et Philippa se sentirent de plus en plus écrasées par leur responsabilité. Est-ce que leur père, qui avait été fidèle en toutes choses, ne les regarderait pas avec sévérité, les qualifiant de gardiennes infidèles de ses biens? Elles s'entretinrent de leurs inquiétudes, se répétant les paroles de leur père concernant les sentiers qui traversent même la mer salée et les montagnes couvertes de neige, où l'œil humain ne discerne aucune piste.
Un jour de l'été précédent, le facteur apporta une lettre de France à Mme Babette Hersant.
C'était un événement surprenant, car Babette n'avait reçu aucune lettre depuis douze ans.
"Que contenait cette lettre? " se demandaient les patronnes de Babette.
Elles se glissèrent à la cuisine pour voir la servante décacheter l'enveloppe et lire la missive. La lecture terminée, Babette, levant les yeux, apprit aux deux sœurs que son numéro de loterie en France venait de sortir et qu'elle avait gagné dix mille francs.
La nouvelle fit une telle impression sur Martine et Philippa qu'elles demeurèrent muettes pendant un long moment. Leur modeste pension leur était versée d'ordinaire par petites sommes. Il leur était difficile d'imaginer même ces dix mille francs et la pile énorme que constitueraient tous ces écus, tandis que, de leurs mains légèrement tremblantes, elles serraient celles de Babette. Jamais encore elles n'avaient serré des mains qui, l'instant d'auparavant, venaient d'entrer en possession d'une somme de dix mille francs.
Un peu plus tard, elles s'aperçurent que le versement les concernait autant que Babette. Ce pays de France où s'était écoulée la vie de Babette se dressait lentement au-dessus de leur horizon en même temps que leur propre existence s'enfonçait dans une sorte d'abîme brumeux. Les dix mille francs faisaient de Babette une femme riche, mais combien ils appauvrissaient le foyer où elle avait servi. Les anciens soucis, les anciennes difficultés surgirent tout à coup aux quatre coins de la cuisine.
Les paroles de félicitation moururent sur leurs lèvres, bien que les deux pieuses femmes eussent honte de leur silence.
Au cours des prochaines journées, elles annoncèrent la nouvelle à leurs amis d'un air joyeux, mais elles furent réconfortées de voir s'allonger les visages de leurs auditeurs. Personne ne pourrait, en vérité, blâmer Babette, et la communauté le comprenait bien : les oiseaux reviennent au nid et les êtres humains au pays natal. Mais cette bonne et fidèle servante comprenait-elle que son départ de Berlewaag serait une cause de détresse pour les vieillards et les pauvres? Les petites sœurs n'auraient plus le temps de soigner les malades ni les malheureux.
Certes, les loteries étaient choses impies.
L'argent arriva en temps voulu par l'entremise d'agences de Christiania et de Berlewaag. Les deux dames aidèrent Babette à compter les billets et lui donnèrent une boîte où les conserver. En maniant une aussi grosse somme, elles se familiarisèrent un peu avec ces inquiétants "chiffons de -papier". Mais elles n'osaient interroger Babette sur la date de son départ. Oseraient-elles espérer qu'elle ne les quitterait pas avant le 15 décembre?
Les patronnes de Babette n'avaient jamais été très sûres de ce que Babette comprenait quand elles parlaient entre elles. Elles furent donc très surprises lorsqu'un soir de septembre Babette entra au salon pour leur demander une faveur.
Plus humble et plus soumise que jamais, elle venait les prier de l'autoriser à préparer le dîner de fête pour l'anniversaire du pasteur. Ces dames n'avaient pas eu la moindre intention de donner un dîner. Ce qu'elles avaient imaginé de plus somptueux était un souper fort simple, arrosé d'une tasse de café.
Mais les yeux noirs de Babette brillaient de convoitise, pareils aux yeux d'un chien qui voit un os. Elles acquiescèrent donc à sa prière et aussitôt le visage de la cuisinière s'éclaircit.
Pourtant, elle déclara qu'elle n'avait pas tout dit. Elle ajouta qu'elle désirait préparer un dîner français, un vrai dîner français, pour une fois, une seule fois.
Martine et Philippa s'interrogèrent du regard : cette perspective ne leur souriait guère, elles ignoraient ce que leur acceptation impliquait. Mais l'étrangeté même de la demande les désarmait. Comment trouver les arguments nécessaires au refus de la proposition?
Babette poussa un long soupir de bonheur, mais elle ne bougea pas d'une semelle. Elle n'avait pas que cette seule prière à adresser à ces dames et voici qu'elle les supplia de la laisser payer de son propre argent le dîner français.
Les autres s'exclamèrent :
- Non, non! Babette! Comment pouvez-vous vous figurer pareille chose? Croyez-vous donc que nous vous permettrons de dilapider votre précieux trésor en nourriture et en boissons et, de plus, à notre avantage? Non, Babette, c'est impossible.
Babette fit un pas en avant, et ce mouvement eut la soudaineté et la violence d'une vague qui se dresse, formidable et menaçante. S'était-elle avancée de la même manière en 1871 pour planter le drapeau rouge sur une barricade?
Elle parla dans son norvégien maladroit, mais avec l'éloquence classique particulière aux Français : sa voix résonnait comme pour un chant :
- Mesdames, vous ai-je demandé la moindre faveur pendant ces douze années? non? et pourquoi ne l'ai-je pas fait? Vous, qui récitez vos prières chaque jour, pouvez-vous vous imaginer ce qu'éprouve un cœur humain qui n'a aucune prière à faire? Et pourquoi donc Babette devrait-elle prier? Pour rien? Ce soir, elle a une prière à faire; cette prière jaillit du fond de son cœur. Ne comprenez-vous pas, Mesdames, que ce soir il vous appartient de l'exaucer, avec la même joie que le bon Dieu éprouve à exaucer les vôtres?
Martine et Philippa gardèrent d'abord le silence.
Babette avait raison : c'était bien la première requête qu'elle leur adressait depuis douze ans et, plus que probablement, ce serait la dernière. Elles réfléchirent donc sur ce qu'il y avait lieu de faire. Après tout, se disaient-elles, leur cuisinière était maintenant dans une situation supérieure à la leur et que signifiait un dîner pour une personne qui possédait dix mille francs?
Leur consentement final transfigura Babette du tout au tout. On s'aperçut que, dans sa jeunesse, elle avait été belle; et les deux sœurs se demandèrent si, pour la première fois, elles n'avaient pas été, pour la réfugiée, les "bonnes gens" de la lettre d'Achille Papin..."
C'est en 1988 que le danois Gabriel Axel réalisa une adaptation cinématographique du Festin de Babette, avec Stéphane Audran, Brigitte Federspiel et Bodil Kjer. Auparavant, en 1968, Orson Welles avait adapté "Une Histoire immortelle", avec Orson Welles lui-même et Jeanne Moreau...
Autre héroïne, la fille d`un mystérieux capitaine de vaisseau écossais, qui incarne l'Ariel de Shakespeare, sauve un bateau et son équipage en pleine tempête, et finalement se refuse à l`homme qu'elle aime. Il y a aussi "l'éternelle histoire", racontée par tous les marins de la terre, pauvres dupes de l`éternelle illusion, et enfin la légende de "l'anneau" perdu, symbole de l'impossibIe amour. Les fables que conte Karen Blixen dans une langue précise et pure sont en fait des méditations sur la justice, la peur, la mort, l`amour. Livre transparent en apparence, mais que la mélancolie et la poésie toute nordique obscurcissent, et où chaque phrase entraîne le lecteur à réfléchir sur les rapports mal connus et mystérieux de l'être humain avec l`univers qui l'entoure, plein de menaces et de signes (trad. Gallimard, 19B8).
L'éternelle histoire ..
Mr Clay, vieux bonhomme aigri et très riche, n'aime que les livres de comptes, les faits, il déteste les rêves et les prophéties. Malade et insomniaque, il se souvient d'une histoire qu'on lui a racontée, l'histoire d'un marin qui reçoit cinq guinées en échange d'une nuit d'amour avec une jeune et belle dame. Le vieil homme décide de la transformer en réalité avec la complicité de son jeune secrétaire. Mais parfois la réalité peut dépasser la fiction...
