- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

The "Lost generation" (1920-1930) - Ernest Hemingway (1899-1961) - Gertrude Stein (1874-1946) - ...
Last update: 11/11/2016

The "Lost generation" (1920-1930)
Dans les années 20, plusieurs écrivains américains se regroupent à Paris, fuyant le vide culturel d'une Amérique bouleversée par les mutations sociales et morales, le matérialisme austère de villes comme New York et Chicago telles que décrites par des écrivains "naturalistes" comme Theodore Dreiser, Frank Norris, et Upton Sinclair (qui feront tous leur chemin vers l'Europe en temps voulu).
Le Paris de l'entre-deux guerre est alors la capitale des avants-gardes artistiques et la scène culturelle, où se côtoient tous les arts (Picasso,
Modigliani, Braque, Breton et les surréalistes, Duchamp, Stravinski, Satie, Diaghilev, Cocteau..) est pour la littérature la plus permissive et créative qui soit.
In the 1920s, several American writers gathered in Paris, fleeing the cultural void of an America disrupted by social and moral changes, the austere materialism of cities like New York and Chicago as described by "naturalist" writers like Theodore Dreiser, Frank Norris, and Upton Sinclair (who will all make their way to Europe in due course). The Paris of the interwar period was then the capital of the artistic avant-garde and the cultural scene, where all the arts (Picasso, Modigliani, Braque, Breton and the Surrealists, Duchamp, Stravinsky, Satie, Diaghilev, Cocteau...) coexisted. It was for the most permissive and creative literature there was.
En la década de 1920, varios escritores estadounidenses se reunieron en París, huyendo del vacío cultural de una América perturbada por los cambios sociales y morales, del materialismo austero de ciudades como Nueva York y Chicago, tal como lo describen escritores "naturalistas" como Theodore Dreiser, Frank Norris y Upton Sinclair (que a su debido tiempo llegarán a Europa). La París de entreguerras fue entonces la capital de la vanguardia artística y de la escena cultural, donde convivían todas las artes (Picasso, Modigliani, Braque, Bretón y los surrealistas, Duchamp, Stravinsky, Satie, Diaghilev, Cocteau...), y para la literatura más permisiva y creativa que existía.

La librairie Shakespeare and co, ouverte rue de l'Odéon par Sylvia Beach, et qui a publié l'Ulysse de Joyce, sert de point de ralliement : les Américains s'y croisent, des liens et des amitiés se forment.
Gertrude Stein, au cours d'une conversation avec Ernest Hemingway, forge l'expression de "génération perdue" (“You are all a lost generation”) pour décrire ce groupe d'auteurs américains expatriés à Paris durant l'entre-deux-guerres et en rupture avec le nouvel ordre moral et social de l'Amérique d'après-guerre. Le "mouvement" compte parmi ses membres Ernest Hemingway, le plus emblématique (qui séjourna à Paris en 1921 et en 1924), John Steinbeck, Dos Passos, F. Scott Fitzgerald (qui séjourne par quatre fois en France entre 1921 et 1931), Ezra Pound, Sherwood Anderson, Waldo Peirce, Sylvia Beach, T.S. Eliot et Gertrude Stein elle-même. F. Scott Fitzgerald en est souvent considéré comme le chef de file.
(Ernest Hemingway, Paris est une fête, A Moveable Feast, trad.1964)
"... J'avais pris la douce habitude de faire halte au 27 rue de Fleurus, vers la fin de l'après-midi, attiré par la chaleur ambiante, les oeuvres d'art
et la conversation. Souvent, il n'y avait pas d'autre visiteur que moi et Miss Stein se montrait toujours très amicale et même, pendant longtemps, elle me témoigna une réelle affection. Quand je
rentrais de voyage, après avoir assisté à diverses conférences internationales, ou avoir parcouru le Moyen-Orient ou l'Allemagne pour le compte de mon journal canadien ou pour les agences de
presse qui m'employaient alors, elle voulait que je lui raconte tous les détails amusants. Il m'était toujours arrivé quelque chose de cocasse et elle en était friande; elle appréciait aussi
l'humour noir, ce que les Allemands appellent de "bonnes histoires de gibet". Elle voulait toujours voir le monde par son côté plaisant, sans jamais se préoccuper de la réalité ni de ce qui
n'allait pas.
J'étais jeune et peu porté à la mélancolie et il m'arrivait toujours des choses étranges et comiques, même aux pires moments, et Miss Stein aimait les
entendre raconter. Le reste, je ne lui en parlais pas et m'en servais seulement lorsque j'écrivais.
Quand je n'avais pas fait de voyage récent et m'arrêtais, rue de Fleurus, après ma journée de travail, j'essayais parfois d'obtenir que Miss Stein me
parlât de littérature. Quand j'écrivais quelque chose, j'avais besoin de lire après avoir posé la plume. Si vous continuez à penser à ce que vous écrivez, en dehors des heures de travail, vous
perdez le fil et vous ne pouvez le ressaisir le lendemain. Il vous faut faire de l'exercice, fatiguer votre corps, et il vous est alors recommandé de faire l'amour avec qui vous aimez. C'est même
ce qu'il y a de meilleur. Mais ensuite, quand vous vous sentez vide, il vous faut lire afin de ne pas penser à votre oeuvre et de ne pas vous en préoccuper jusqu'au moment où vous vous remettrez
à écrire. J'avais déjà appris à ne jamais assécher le puits de mon inspiration, mais à m'arrêter alors qu'il y avait encore quelque chose au fond, pour laisser la source remplir le réservoir
pendant la nuit.
Pour tenir mon esprit éloigné de mes préoccupations littéraires propres, parfois, après avoir écrit, je lisais des auteurs qui étaient alors en pleine
production, tels qu'Aldous Huxley, D.H.Lawrence ou d'autres dont je pouvais me procurer les livres à la librairie de Sylvia Beach ou sur les quais...."

Bien que Fitzgerald soit souvent considéré comme un membre de la "Lost Generation", les trames de ses plus célèbres oeuvres se déroulent aux États-Unis et traitent de la culture américaine. Les romans d'Ernest Hemingway (1899-1961), en revanche. ont un lien beaucoup plus étroit avec l'Europe. même si leurs protagonistes sont le plus souvent Américains. Son roman "A Farewell to Arms" (L'Adieu aux armes, 1929) est inspiré de son travail avec la Croix Rouge, en Italie, pendant la Première Guerre mondiale. "The Sun also Rise" (Le Soleil se lève aussi, 1926) se concentre sur la communauté d'expatriés en France et en Espagne au début des années 1920, et rendit populaire la fameuse expression de "Lost Generation". "For Whom the Bell Tolls" (Pour qui sonne le glas, 1940) se déroule pendant la guerre Civile espagnole. Nombre de ses courts récits et travaux journalistiques évoquent également les guerres en Europe.
Le courage? "The grace under pressure"...
Les thèmes d'Hemingway revêtent toutefois une plus grande signification que ceux d'un Fitzgerald. L'idée de l'homme qui affronte seul un ennemi de taille est récurrente dans un grand nombre de ses oeuvres. Que ce soit le toréador contre le taureau dans "Death in the Afternoon" (Mort dans l'après-midi, 1932), la chasse au gros gibier dans "The Green Hills of Africa" (Les Vertes collines d'Afrique, 1935) ou l'individu seul contre les forces de la guerre, Hemingway fait le portrait d'un personnage au caractère bien trempé qui doit démontrer ce à quoi il fait référence quand il évoque la "grâce sous pression" (grace under pressure) ou le "courage". Non seulement Ernest Hemingway a cette expérience de l’idée du courage, ne serait-ce qu'en tant que chauffeur d’ambulance et journaliste de la Croix-Rouge, il a vu cinq fronts de bataille, et comme écrivain face à sa propre existence, de retour au pays après les guerres, le voici dans l'obligation de combattre son propre néant. Dans «A Clean, Well-Lighted Place», il nous montre un serveur âgé affrontant le visage de ce néant et la grâce sous cette pression qu'il lui faut mettre en oeuvre. ll semble que pour espérer pouvoir échapper à un futur décadent, au trouble moral et à l'impuissance décrite dans "Le Soleil se lève aussi", on se doit d'être individualiste et se mesurer aux forces élémentaires.
Hemingway résume cette philosophie dans son dernier grand roman, "The Old Man and the Sea" {Le Vieil nomme et la mer, 1952), une parabole sur un vieux pêcheur cubain solitaire. perdant. mais se battant héroïquement jusqu'au bout, sa bataille avec la vie.
Malgré le machisme d'un grand nombre de ses personnages, les fictions d'Hemingway sont pleines d'un lyrisme d'une grande subtilité. Son style est sobre et économe. Marqué par son expérience de journaliste, il fait des phrases courtes et évite la rhétorique, les enjolivures et les émotions au rabais. Son sens de l'objectivité lui permet de jouer sur l'ironie des litotes - qui conviennent à ses personnages stoïques. Hemingway avait en outre un sens aigu des dialogues et des effets de répétition et de rythme. Sa maîtrise d'une expression concentrée le destinait à la forme du récit court...

Au lendemain de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, pour la génération qui s'engage dans la Seconde Guerre mondiale, Ernest Hemingway est le romancier qui a su le mieux exprimer la sensibilité d'une génération traumatisée par la Première Guerre mondiale (A Farewell to Arms, 1929), le romancier qui a décrit la guerre comme l'épreuve par excellence, une épreuve au bout de laquelle le romancier atteint ses propres limites (For Whom the Bell Tolls, 1940).
Et dans la littérature, ce qu'Hemingway apporte, dans les années 1920-1930, c'est une écriture concise où, a-t-on dit, l'oeil enregistre laconiquement les images. En 1948 le critique Philip Young analyse la style Hemingway qui surprend et fait tant d'émules : un rituel obsessionnel, écrit-il, où le narrateur vit dans la peur panique de se laisser déborder par l'intensité de ses sensations...
"The way it was" - Mais si Hemingway, après la guerre, s'est bien mêlé aux expatriés américains et aux fameux pittoresques bohèmes de Montparnasse, il n'a jamais vraiment partagé leur existence, ne perdant guerre de temps à parler littérature pour, tout au contraire, la faire, dans la solitude de sa mansarde de la rue du Cardinal-Lemoine : son devoir en tant qu'écrivain est de "dire la vérité", mais qu'est-ce que cette "vérité"? "Je m'essayais alors à écrire, nous dira-t-il au début de "Mort dans l'après-midi", j'éprouvais que la plus grande difficulté (outre savoir exactement ce qu'on a ressenti en réalité et non ce qu'on aurait dû ressentir, ce qu'on a appris à ressentir) c'était de noter ce qui s'était réellement passé au moment même de l'évènement, de préciser les faits réels qui avaient produit l'émotion éprouvée. Quand on écrit pour un journal, on raconte ce qui s'est passé, et, à l'aide d'un procédé ou d'un autre, on arrive à communiquer l'émotion au lecteur, car l'actualité confère toujours une certaine émotion au récit d'un évènement du jour. Mais la chose réelle, la succession mouvante des phénomènes qui a produit l'émotion, cette réalité qui serait aussi valable dans un an ou dans dix ans, avec de la chance et assez de pureté d'expression, pour toujours, j'en étais encore loin, et je m'acharnais à l'atteindre". Le facteur subjectif doit ainsi disparaître, rien ne doit s'interposer pour le lecteur avec la façon dont les choses se sont passées (the way it was), le recul de l'auteur est nécessaire, "L'Adieu aux Armes" a été écrit près de dix ans après les évènements qui ont servi de faits générateurs, des faits générateurs qui impliquent la nécessité d'un contact physique avec le monde, puis l'écriture débute avec sa précision inexorable, longtemps travaillée, tout récit doit être situé, le lieu et l'heure de l'action, puis s'enchaînent les multiples petits faits qui tissent la toile de la réalité, les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, avec concision, loin des grandes descriptions, enfin s'imposent non pas des personnages, mais des êtres de chair et de sang, qui vont vivre intensément, leurs pensées ou réflexions importent peu, ils sont ce qu'ils font ou ressentent dans l'immédiateté...

Ernest Hemingway (1899-1961)
Autodidacte, Ernest Hemingway se lance dans le journalisme et intègre bientôt la rédaction du 'Kansas city star'. Trente-cinq ans de journalisme nourrissent
son œuvre. En 1917, il s'engage en tant qu'ambulancier sur le front, en Italie. Puis il s'établit à Paris en 1921 avec sa première femme, Hadley, rue Cardinale Lemoine et rue Descartes
où il écrivait. Il rencontre Ezra Pound, Picasso, James Joyce et surtout la romancière Gertrude Stein. Sous son influence, il opte pour une écriture concise, dépouillée. Il remplace
les développements psychologiques par le récit de l'action et du comportement. «J'écris, dit-il, jusqu'à ce que j'arrive au point où j'ai encore du jus et où je commence à avoir une idée de la
suite. Alors je m'arrête et j'essaie de vivre jusqu'au lendemain. C'est l'attente jusqu'au lendemain qui est dure à passer». Hemingway à Paris, c'est un circuit comprenant les Deux Magots
(place Saint-Germain des Prés), le Café de Flore (Boulevard Saint-Germain), la Closerie des Lilas (boulevard du Montparnasse), le jardin du Luxembourg, le Harry's New York Bar (rue Daunou),
le QG des expatriés américains dont Francis Scott et Zelda Fitzgerald, le Falstaff (bar à bière rue du Montparnasse où Hemingway prit dit-on une célèbre dérouillée), Le Dingo Bar (rue Delambre,
où Hemingway rencontra pour la première fois Scott Fitzgerald). Il revint à Paris en 1924 et y écrivit ses premières nouvelles ("In Our Time", 1925), deux romans, "The Sun Also Rises"
(1926) et "Men Without Women". En 1927, il divorce et épouse Pauline Pfeiffer et gagne avec elle Key West.

La guerre le marque profondément, comme Cummings ou Dos Passos. Adolescents, persuadés de partir pour une croisade juste qui mettrait fin aux guerres et aux injustices, ces Américains découvrent une boucherie dirigée par des généraux incompétents et des politiciens ineptes. La faillite de leur idéal les marque à jamais de désarroi.. "Le soleil se lève aussi" (1926), puis "l'Adieu aux armes" (1929) font rapidement de Hemingway le romancier américain le plus représentatif de la génération d'après la Première Guerre mondiale. En 1936, il rejoint les forces républicaines de la guerre d'Espagne, puis migre vers Cuba. "Pour qui sonne le glas" (1940) reflète les problèmes politiques et la violence engendrés par la montée du fascisme. Martha Gellhorn partage alors la vie d'Hemingway jusqu'en 1945: correspondante de guerre, auteur de "The Face of War" (1959), pacifiste convaincue et au plus près de la défense des peuples, elle est alors très liée à Eleanor Roosevelt, qu'un certain Edgar Hoover, le patron du FBI, déteste par ailleurs et qui semble avoir lancé le FBI dans les pas d'Hemingway...

Correspondant de guerre auprès de la Royal Air Force, on retrouve celui-ci dans Paris libéré lisant à l'automne 1944 ses poèmes à la terrasse des Deux Magots et dans diverses photographies qui alimenteront sa fameuse iconographie : grimpant dans un bombardier RAF, lancé dans un safari en Afrique, effectuant des passes à la muleta dans une arène d'Espagne, exposant le résultat de sa pêche à l'espadon à Cuba, etc. En 1949, Hemingway écrit, à Cortina d'Ampezzo, "Across the River and into the Trees", le fameux "traversons le fleuve et allons nous reposer à l'ombre des arbres" du général sudiste Stonewall Jackson : ici, dans l'Italie du nord, en 1946, le colonel Richard Cantwell, le corps couvert de cicatrice et sachant qu'il va mourir vit un dernier amour avec une jeune comtesse de dix-neuf ans. Il reçoit le prix Pulitzer pour "The Old Man and the Sea", son testament, en 1952, puis le prix Nobel de littérature en 1954 qui "consacre la portée d'une œuvre qui, sous une inspiration cosmopolite et réaliste, des allures de roman d'aventures et un style de reporter, cache un esthétisme subtil et une méditation morale, de nature stoïque, sur la condition humaine". Saul Below ou Norman Mailer engageront un duel par écriture et romans interposés avec cet Hemingway qui n'est au fond peut-être qu'un "faux costaud". Malade, physiquement diminué, il se suicide en 1961, suivant l'exemple de son père...


Paris est une fête (À Moveable Feast, posthume)
Introduction classique d'un ouvrage qui, en fin de compte, laisse un goût d'inachevé. Dans "Le soleil se lève
aussi" et dans "Paris est une fête ", il a capté l'esprit de la génération perdue, cette existence désœuvrée, désenchantée, inquiète. Mais lui ne flâne pas aux terrasses de Montparnasse. Dans sa
mansarde rue du Cardinal-Lemoine, puis au 113, rue Notre-Dame-des-Champs, il travaille dur, raturant inlassablement. Guidé d'abord par les conseils de Sherwood Anderson, qu'il a rencontré au
Toronto Star, puis par Gertrude Stein, il s'efforce de donner une représentation aussi précise que possible de la réalité. « La plus grande difficulté, dit-il, c'était de décrire ce qui s'était
réellement passé au moment de l'événement. Quand on écrit pour un journal, on raconte ce qui s'est passé et, à l'aide d'un procédé ou d'un autre, on arrive à communiquer l'émotion au lecteur, car
l'émotion confère toujours une certaine vérité au récit d'un événement du jour. Mais la chose réelle, la succession mouvante des phénomènes qui produit l'émotion, cette réalité qui serait valable
dans un an ou dans dix ans et, avec de la chance et assez de pureté d'expression, pour toujours, j'en étais encore loin et je m'acharnais à l'atteindre. » « J'essayais, ajoute-t-il, d'écrire en
commençant par les choses les plus simples. » (Editions Gallimard)

1925 - De nos jours (In Our Time)
Le premier grand recueil de nouvelles d'Ernest Hemingway, quinze nouvelles reliées par des visions de guerre et de tauromachie, traduisant l'initiation brutale d'un jeune homme, Nick Adams, le double de l'auteur, à la cruauté et à l'absurdité de la vie. "Indian Camp", "Soldier's Home", "Big Two-Hearted River" sont toutes trois traversées par la hantise de la guerre, de la mort, du néant.
Repris sous le titre "L'Education de Nick Adams" (Gallimard), nous retrouvons les nouvelles suivantes : "Un Village indien", "Le Docteur et la femme du Docteur", "La Fin de quelque chose", "Trois jours de tourments", "Le champion", "La Lumière du monde", "Pères et Fils", "Dix Indiens", "Là -haut dans le Michigan", "Il est né le divin enfant"..
"Là -haut dans le Michigan" (Up in Michigan, 1921),
une nouvelle écrit à une époque d'influence de Gertrude Stein, il s'agissait pour elle de rendre à l'écriture sa vitalité primitive en lui faisant exprimer la "pensée immédiate"... Hemingway a passé bien du temps dans le Michigan quand il était jeune, son premier roman, "Les Torrents du printemps", se déroule à Petoskey, et plusieurs de ses nouvelles semi-autobiographique attachées au personnage de Nick Adams, décrivent les lieux et les gens du nord du Michigan qu’Hemingway connaissait et aimait...
"Up in Michigan" fut publié en 1923 dans son premier recueil, "Three Stories and Ten Poems", puis dans son recueil de 1938 "The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories". Histoire brève, écrite avec des phrases courtes, l'engouement tragique et le viol de Liz Coates, une jeune femme qui travaille comme domestique pour la famille Smith, pour et par Jim Gilmore, un forgeron local ..
"JIM GILMORE était venu du Canada s'établir à Horton's Bay. Il avait acheté la forge au vieux Horton. Jim était un petit homme noir, avec de grandes moustaches et des mains énormes. C'était un bon ferreur de sabots et il n'avait rien d)un forgeron, même avec son tablier de cuir.
ll logeait en haut, au-dessus de l'atelier, et prenait ses repas chez D.J. Smith.
Liz Coates etait employée chez les Smith. Mrs Smith, une femme bien en chair et très propre, disait que Liz Coates était la jeune fille la plus soignée qu'elle eût jamais vue. Liz avait de jolies jambes et portait toujours des tabliers de cotonnade très propres, et Jim avait remarqué que ses cheveux étaient toujours bien arrangés par derrière. Son visage lui plaisait parce qu'il était si avenant, mais jamais il ne pensait à elle.
Liz aimait beaucoup Jim. Elle aimait bien sa démarche, quand il arrivait de l'atelier et souvent elle allait à la porte de la cuisine le regarder partir sur la route. Elle aimait bien sa moustache. Elle aimait bien comme ses dents étaient blanches quand il souriait. Elle aimait beaucoup qu'il eût pas l'air d'un forgeron. Elle aimait bien voir à quel point Jim plaisait à D. J. Smith et à Mrs Smith. Un jour, elle découvrit qu'elle aimait à regarder comme ses poils étaient noirs sur ses bras et comme ils étaient blancs au-dessus du cercle brun délimitant le hâle lorsqu'il se lavait dans la cuvette devant la maison. Cela lui fit tout drôle d'aimer ça."
(...)
"Liz Coates worked for Smith’s. Mrs. Smith, who was a very large clean woman, said Liz Coates was the neatest girl she’d ever seen. Liz had good legs and always wore clean gingham aprons and Jim noticed that her hair was always neat behind. He liked her face because it was so jolly but he never thought about her.
Liz liked Jim very much. She liked it the way he walked over from the shop and often went to the kitchen door to watch for him to start down the road. She liked it about his mustache. She liked it about how white his teeth were when he smiled. She liked it very much that he didn’t look like a blacksmith. She liked it how much A. J. Smith and Mrs. Smith liked Jim. One day she found that she liked it the way the hair was black on his arms and how white they were above the tanned line when he washed up in the washbasin outside the house. Liking that made her feel funny.
Hortons Bay, the town, was only five houses on the main road between Boyne City and Charlevoix. There was the general store and postoffice with a high false front and maybe a wagon hitched out in front, Smith’s house, Stroud’s house, Fox’s house, Horton’s house and Van Hoosen’s house. The houses were in a big grove of elm trees and the road was very sandy. There was farming country and timber each way up the road. Up the road a ways was the Methodist church and down the road the other direction was the township school. The blacksmith shop was painted red and faced the school.
A steep sandy road ran down the hill to the bay through the timber. From Smith’s back door you could look out across the woods that ran down to the lake and across the bay. It was very beautiful in the spring and summer, the bay blue and bright and usually whitecaps on the lake out beyond the point from the breeze blowing from Charlevoix and Lake Michigan. From Smith’s back door Liz could see ore barges way out in the lake going toward Boyne City. When she looked at them they didn’t seem to be moving at all but if she went in and dried some more dishes and then came out again they would be out of sight beyond the point.
All the time now Liz was thinking about Jim Gilmore. He didn’t seem to notice her much. He talked about the shop to A. J. Smith and about the Republican Party and about James G. Blaine. In the evenings he read the Toledo Blade and the Grand Rapids paper by the lamp in the front room or went out spearing fish in the bay with a jacklight with A. J. Smith. In the fall he and Smith and Charley Wyman took a wagon and tent, grub, axes, their rifles and two dogs and went on a trip to the pine plains beyond Vanderbilt deer hunting. Liz and Mrs. Smith were cooking for four days for them before they started. Liz wanted to make something special for Jim to take but she didn’t finally because she was afraid to ask Mrs. Smith for the eggs and flour and afraid if she bought them Mrs. Smith would catch her cooking. It would have been all right with Mrs. Smith but Liz was afraid."
(...)
"Jim commençait à se sentir en grande forme. Il aimait le goût et la chaleur du whisky. Il était content de retrouver un lit confortable, des repas chauds et la forge. Il but encore un coup. Les hommes étaient d'humeur hilare quand ils se présentèrent à table, mais ils avaient une allure très guindée. Après avoir apporté les plats, Liz prit place à la table et mangea avec la famille. Le dîner était très bon. Les hommes mangeaient avec gravité. Après dîner ils passèrent de nouveau dans la pièce de devant, et Liz débarrassa la table avec Mrs Smith. Ensuite Mrs Smith monta au premier et, peu après, Smith sortit de la pièce et monta lui aussi. Jim et Charly étaient toujours dans la pièce de devant. Liz était assise à la cuisine à côté de la cuisinière, faisant semblant de lire un livre et pensant à Jim. Elle ne voulait pas aller se coucher tout de suite car elle savait que Jim ne tarderait pas à sortir et elle voulait le voir passer afin d'emporter son regard au lit avec elle.
Elle pensait très fort à lui et c'est alors que Jim sortit. Il avait les yeux brillants et les cheveux légèrement ébouriffés. Liz baissa les yeux sur son livre. Jim s'approcha par derrière et se tint debout contre sa chaise; elle sentait sa poitrine se soulever à chaque respiration, et puis il
l'entoura de ses bras. Ses seins étaient gonflés et fermes au toucher et leur pointe se dressait, dure dans ses mains. Liz avait très peur, personne ne l'avait jamais caressée, mais elle se disait : "Il est enfin à moi. Il est vraiment venu."
Elle se tenait crispée parce qu'elle avait tellement peur et qu'elle ne savait pas très bien quoi faire d'autre, et alors Jim la tint serrée contre la chaise et l'embrassa. Ce fut tellement aigu, fort et douloureux comme sensation qu'elle crut qu'elle ne pourrait pas le supporter. Elle sentait Jim à travers le dossier de la chaise et elle n'en pouvait plus, et subitement il y eut un déclic en elle et la sensation fut plus chaude et plus douce. Jim la serrait fortement contre la chaise et maintenant elle en avait envie et Jim lui dit à l'oreille :
"Allons faire un tour".
She was thinking about him hard and then Jim came out. His eyes were shining and his hair was a little rumpled. Liz looked down at her book. Jim came over back of her chair and stood there and she could feel him breathing and then he put his arms around her. Her breasts felt plump and firm and the nipples were erect under his hands. Liz was terribly frightened, no one had ever touched her, but she thought, “He’s come to me finally. He’s really come.”
She held herself stiff because she was so frightened and did not know anything else to do and then Jim held her tight against the chair and kissed her. It was such a sharp, aching, hurting feeling that she thought she couldn’t stand it. She felt Jim right through the back of the chair and she couldn’t stand it and then something clicked inside of her and the feeling was warmer and softer. Jim held her tight hard against the chair and she wanted it now and Jim whispered, “Come on for a walk.”
Liz décrocha son manteau d'une patère fixée au mur de la cuisine et ils sortirent. jim avait passé son bras autour de sa taille et, à chaque instant, ils s'arrêtaient, se serraient l'un contre l'autre et jim l'embrassait. C'était par une nuit sans lune et ils marchaient sous les arbres, s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans le sable de la route, en direction de l'embarcadère et de l'entrepôt de la baie. L'eau clapotait contre les pilotis et la pointe était noire de l'autre côté de la baie. Il faisait froid, mais Liz avait chaud partout d'être avec Jim. Ils s'assirent à l'abri du toit de l'entrepôt et Jim attira Liz contre lui. Elle avait peur. Une des mains de Jim pénétra sous sa robe et lui caressa la poitrine et il mit son autre main entre ses genoux. Elle était très effrayée et ne savait pas comment il allait s'y prendre, mais elle se blottit tout contre lui. Puis la main qui lui semblait si grande au creux de ses genoux s'en alla et se posa sur sa jambe et commença de monter le long de sa cuisse.
"Non, Jim", dit Liz.
La main de Jim glissa un peu plus haut.
"Il ne faut pas, Jim. Il ne faut pas."
Ni Jim ni sa grosse main ne se soucièrent d'elle.
Les planches étaient dures. Jim avait soulevé sa robe et essayait de lui faire quelque chose. Elle avait peur, mais elle voulait, elle le voulait de toutes ses forces, mais cela l'effrayait.
"ll ne faut pas faire ça, Jim. Il ne faut pas.
- Si, il le faut. je vais le faire. Tu sais bien qu'il faut qu'on le fasse.
- Non, on n'est pas forcés, Jim. Il ne faut pas. Oh! ce n'est pas bien. Oh! c'est tellement gros et ça fait si mal. Vous ne pourrez pas. Oh! Jim, Jim. Oh!"
Les planches de sapin de l'embarcadère étaient froides, dures et pleines d'échardes, et Jim pesait lourd sur elle et il lui avait fait mal. Liz le repoussa, tellement elle se sentait endolorie et mal à l'aise. Jim dormait. Pas moyen de le remuer. Avec peine, elle se dégagea de dessous lui, s'assit, remit un peu d'ordre dans ses vêtements et essaya de faire quelque chose de ses cheveux. Jim dormait, la bouche entrouverte. Liz se pencha et l'embrassa sur la joue. Il dormait toujours. Elle prit la tête de Jim dans ses mains, la souleva légèrement et la secoua. Il roula sur lui-même, se tourna de l'autre côté et avala sa salive. Liz se mit à pleurer. Elle alla jusqu'au bord du quai et regarda l'eau du bassin, en contre-bas. Une ligne de brouillard se levait sur la baie. Elle se sentait glacée et malheureuse et tout lui semblait désespéré. Elle revint vers l'endroit où Jim était couché et de nouveau elle le secoua pour être bien sûre. Elle pleurait.
"Jim, dit-elle. Jim, je vous en prie. Jim!"
Jim remua et se roula en boule avec plus d'énergie. Liz ôta son manteau, se pencha sur lui et l'en couvrit. Elle le borda avec infiniment de soin. Ensuite, elle traversa l'embarcadère et monta la côte raide où ses pieds s'enfonçaient dans le sable, pour aller se coucher. Un brouillard glacé venant de la baie montait à travers les bois."
("Jim stirred and curled a little tighter. Liz took off her coat and leaned over and covered him with it. She tucked it around him neatly and carefully. Then she walked across the dock and up the steep sandy road to go to bed. A cold mist was coming up through the woods from the bay.")
"Big Two-Hearted River" (Grande rivière au coeur double, 1925)
Emotionnellement ébranlé par la Première Guerre mondiale, Nick Adams retourne chez lui et part, seul, pour les bois du nord du Michigan, se rapprocher de la nature, y vivre, dresser sa tente, préparer ses repas, pêcher, pour rétablir sa paix intérieure. Le train le laisse à Seney, une petite ville anéantie par un incendie et dont ne subsiste que les rails du chemin de fer (there was no town, nothing but the rails and the burned-over country) - symbole de la guerre -, et des sauterelles toutes noires qu'il finira par utiliser comme appâts pour les nombreuses truites, - symboles de vie dans les eaux profondes et si rapides de la rivière ...

1926 - Le Soleil se lève aussi (The Sun also rises)
"In the morning I walked down the Boulevard to the rue Soufflot for coffee and brioche. It was a fine morning. The horse-chestnut trees in the Luxembourg gardens
were in bloom. There was the pleasant early-morning feeling of a hot day. I read the papers with the coffee and then smoked a cigarette. The flower-women were coming up from the market and
arranging their daily stock. Students went by going up to the law school, or down to the Sorbonne. The Boulevard was busy with trams and people going to work." - Jake Barnes, Brett Ashley et
Robert Cohn, tous trois hantés par un sentiment d'aliénation. C'est le premier grand roman de Hemingway, celui qui lui apporte la notoriété, soudaine, et que confirmera "L'Adieu aux Armes" trois
ans plus tard. Il porte en épigraphe la phrase de Gertrude Stein : « Vous êtes tous la génération perdue. » Au lendemain de la Première Guerre mondiale, après sa démobilisation, l'Américain Jake
Barnes s'est installé à Paris, où il travaille comme journaliste pour le "New York Herald". Au cours d'un bal, il retrouve le romancier Robert Cohn et tout un groupe d'amis artistes. Il revoit
aussi Lady Brett Ashley, à qui le lie une amitié ambiguë depuis qu'elle l'a soigné pendant la guerre. Mais les blessures subies par Jake l'ont privé de sa virilité, empêchant leur relation de se
transformer en liaison amoureuse. Le titre est un rappel de l'Ecclésiaste (I,3,7)...
Livre I, chapitre II, Robert Cohn et Jake Barnes, deux attitudes différentes face face à un même sentiment d'aliénation ...
(..)
- Aimerais-tu aller en Amérique du Sud, Jake? dit-il.
- Non.
- Pourquoi ça?
- je ne sais pas. Ça ne m'a jamais rien dit. Trop cher. Et puis, tu peux voir tous les Sud-Américains que tu veux à Paris.
- Ce ne sont pas les vrais Sud-Américains.
- Ils me semblent rudement vrais à moi.
J'avais à envoyer, par le train spécial d'un bateau, mon courrier hebdomadaire de nouvelles, et je n'en avais écrit que la moitié.
"As-tu appris quelque scandale ? demandai-je.
- Non.
- Pas de divorces parmi tes hautes relations ?
- Non. Écoute, Jake. Si je me chargeais de toutes les dépenses, m'accompagnerais-tu en Amérique du Sud?
- Pourquoi moi ?
- Tu sais l'espagnol, Et ce serait plus amusant à deux.
- Non, dis-je. Je me plais ici et l'été je vais en Espagne.
- Toute ma vie j'ai rêvé d'un voyage comme ça, dit Cohn. (Il s'assit) je deviendrai vieux avant d'avoir pu le faire.
- Ne dis donc pas de bêtises, dis-je. Tu peux aller partout où tu veux. Tu as de l'argent plein tes poches.
- Je sais. Mais je ne peux pas me mettre en route.
- Ne t'en fais pas, dis-je. En somme, tous les pays ça ressemble au cinéma.
Mais j'avais pitié de lui. Il était salement touché.
- Je ne peux pas m'habituer à cette idée que ma vie s'écoule si vite et qu'en réalité je ne la vis pas.
- Personne ne vit complètement sa vie, sauf les toréadors.
- Les toréadors ne m'intéressent pas. C'est une vie anormale. Je veux aller a la campagne, en Amérique du Sud. Nous pourrions faire un voyage épatant.
- Tu n'as jamais songé à aller chasser dans les possessions anglaises d'Afrique?
- Non, je n'aimerais pas ça.
- C'est un endroit où j'irais bien avec toi.
- Non, ça ne m'intéresse pas.
- C'est parce que tu n'as jamais lu de livres là-dessus. Tu devrais lire un de ces livres pleins d'histoires d'amour avec de belles princesses d'un noir luisant.
- Je veux aller en Amérique du Sud.
ll avait cette caractéristique bien juive d'être très entêté.
"Descendons prendre quelque chose.
- Tu ne travailles pas ?
- Non", dis-je.
Nous descendîmes au café du rez-de-chaussée. J'avais découvert qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour se débarrasser des amis. Après avoir pris un verre, vous n'aviez qu'à dire : " Ah! maintenant, il faut que je remonte. J'ai quelques câbles à envoyer", et le tour était joué. Il est très important d'avoir ainsi d'élégantes échappatoires dans le métier de journaliste ou un des principes les plus essentiels de l'éthique consiste à avoir toujours l'air de ne rien faire. Bref, nous descendîmes au bar et nous primes un whisky-coca. Cohn regardait les bouteilles sur leurs étagères tout autour de la salle.
- C'est un bon endroit, dit-il.
- Ce n'est pas l'alcool qui manque, approuvai-je.
- Écoute, Jake. (Il se pencha sur le comptoir.) Est-ce que tu n'as jamais la sensation que toute ta vie s'écoule et que tu n'en profites pas ? Est-ce que tu te rends compte que tu as déjà vécu à peu près autant qu'il te reste à vivre ?
- Oui, de temps à autre.
- Sais-tu que, dans trente-cinq ans environ, nous serons morts ?
- Qu'est-ce que ça peut bien foutre, Robert ? Qu'est-ce que ça peut bien foutre?
- Je parle sérieusement.
- C'est une chose qui ne me préoccupe guère, dis-je.
- Ça devrait.
- Je me suis fait assez de bile autrefois. Maintenant, c'est fini. je ne m'en fais plus.
- Enfin, je veux aller en Amérique du Sud.
- Ecoute, Robert, changer de pays, ça ne sert à rien. J'ai essayé tout ça. Ce n'est pas parce que tu iras d'un endroit dans un autre que tu échapperas à toi-même. Ça ne donne aucun résultat.
- Mais, tu n'as jamais été en Amérique du Sud.
- Au diable ton Amérique du Sud. Si tu y allais dans l'état d'esprit où tu es à présent, ce serait exactement la même chose. On est très bien ici. Pourquoi ne vivrais-tu pas ta vie à Paris ?
- J'en ai marre de Paris. J'en ai marre du Quartier.
- Évite le Quartier. Vadrouille un peu tout seul. Tu verras bien ce qui arrivera.
- Il ne m'arrive jamais rien. Une fois, je me suis promené seul toute la nuit, et il ne m'est rien arrivé, sauf un agent cycliste qui m'a arrêté pour me demander mes papiers.
- Et la ville n`était pas jolie, la nuit ?
- Je n'aime pas Paris. "
Et voilà. J'avais pitié de lui, mais il n'y avait rien à faire parce que vous vous heurtiez tout de suite aux deux idées contre lesquelles il était buté : l'Amérique du Sud le guérirait et il n'aimait pas Paris, La première idée, il l'avait prise dans un livre, et c'est dans un livre aussi, probablement. qu'il avait pris la seconde.
- Ah, dis-je! il faut que je remonte. J'ai quelques câbles à envoyer.
...."
Comme l'auteur lui-même, le personnage principal du livre, un Américain nommé Jake Barnes, a participé, sur le front italien, durant la Première Guerre mondiale. ll y a, comme lui, été blessé, mais la blessure qu`il a reçue, encore plus grave, l'a laissé pour toujours sexuellement infirme. Maintenant, il lui faut vivre. assumer son malheur et s'en accommoder. Sept ans se sont écoulés. Journaliste à Paris, il mène une existence qui, à bien des égards, est assez agréable. Son travail lui plaît, la ville aussi. Mais, malgré les amis, il connaît des moments creux. Il arrive alors qu`il s'assoie à la terrasse d`un café. Passe une fille. Ils échangent un regard. Elle poursuit son chemin mais. bientôt, la voilà qui repasse. lls échangent à nouveau un regard et elle prend place à sa table. Ils parlent à bâtons rompus, mais ils n`ont que des platitudes à se dire et rien à faire. Pourtant, il l'emmène dîner. Ce n'est pas bien drôle au début mais, le vin aidant, il parvient à la faire rire. Au dessert. il aperçoit un groupe d`amis, leur présente son invitée. lls trouvent que c'est une fille amusante et comme. de son côté, elle sympathise avec eux, on se met d`accord pour aller tous ensemble danser. Mais Jake n'a guère de goût à cela. Laissant sa compagne aux autres, il va boire un pot au bar, fumer une cigarette sur le pas de la porte. Il a vaguement mal au cœur. Dans la bande figure une Anglaise de trente-quatre ans, lady Brett Ashley. Il la connaît depuis longtemps. Elle était infirmière dans un des hôpitaux où on l'a soigné, après sa blessure. On sent qu`une certaine complicité les unit. Peut-être parce qu'elle a remarqué sa tristesse, elle se rapproche de lui. Montés dans un taxi, les voici s'embrassant. Ils s'aiment, et se l'étant dit, ne peuvent que se quitter. Les quelques phrases qu`ils prononcent, des phrases tout à fait simples et tout à fait banales, rendent d'une façon saisissante le tragique de leur situation.
Tandis que la jeune femme se distrait en faisant la connaissance d`un comte grec, Jake rentre chez lui. Un journal tauromachique lui permet non d'oublier mais de refouler un moment sa peine. Il le lit de A jusqu`à Z. Puis les douloureuses pensées qu`il fuyait le submergent. Le jour. on peut crâner, mais la nuit, c`est autre chose. Il pleure. Cela le détend et il s`endort.
Mais Brett, flanquée de son nouveau soupirant, vient le réveiller. Les nuits vous désarment, mais le jour. on peut et on doit se ressaisir. Il n`y a pas que Brett, Il n`y a pas que les femmes. La sensualité se rattrape sur la nourriture et la boisson. Le besoin de se dépenser, sur le travail et la pêche, celui de s`enthousiasmer. sur les courses de taureaux. Faire contre mauvaise fortune bonne figure et bon cœur est un impératif moral, le seul, peut-être que ce livre reconnaisse, le seul sur lequel il mette l'accent. On a dit morale virile, un adjectif devenu mot clé du roman. Non seulement il définit l`attitude de Jake devant la vie, mais il rend compte de sa personnalité et de son charme...
"Ne pourrions-nous pas vivre ensemble, Brett ? " - La relation de Jake Barnes avec Brett Ashley est la préoccupation centrale du roman. C’est par l’amour de Brett que Jake tente de surmonter son sentiment d’aliénation, mais il reste sexuellement handicapé, et ne peut pas fournir sa satisfaction sexuelle, il est rempli de sentiment d’aliénation. Troublé par l’inconstance de Brett, il se sent incapable de se détacher d’elle. Ce qu'il doit dès lors apprendre, c'est être capable de vivre avec, ou de surmonter la conscience de sa déficience physique et d'aimer Brett sans le désir de la posséder. L'isolement émotionnel est une constante de ces personnages. On l'a dit, incompris et méprisés, ils supportent à eux seuls le poids d’un ordre social insensible et d’un univers hostile. Tout comme Jake Barnes, Brett Ashley a aussi été victime de la Première Guerre mondiale : après que son amant ait été tué dans la guerre, elle a épousé Lord Ashley quand la guerre était toujours en cours. Elle a maintenant 34 ans, et elle est en train de divorcer, le sexe est devenu pour elle une activité physique pure, et va épouser Mike Campbell ("Il est mon genre de chose"), tout en aimant beaucoup Jake Barnes. C'est que fondamentalement les personnages d'Hemingway ne dépasse dans leur souffrance intérieure, définitivement inaccessible, la ligne des faits existants de conventions sociales, de moralité et de religion. Ils n'iront pas au-delà. Ils ont eu le courage de défier ou de rejeter la société, de s'abstraire de la multitude humaine, et c'est dans ce courage qu'ils assument, qu'ils jettent désormais leurs dernières forces. C'est ainsi que Brett retrouve sa dignité perdue, son estime de soi, et se lève à nouveau comme le soleil...."

1927 - Hommes sans femmes (Men without Women)
C'est le deuxième recueil de nouvelles écrites par Ernest Hemingway, 14 histoires, dont 10 déjà publiés dans des magazines dont, parmi les plus connues, "Fifty Grand" (Cinquante mille dollars, histoire d'un boxeur qui parie contre lui-même les cinquante mille dollars de son dernier match), "The Killers" ("Les Tueurs" relate la tension insupportable créée par l`apparition de deux tueurs professionnels dans un bar où ils viennent attendre leur victime, en vain, une tension qui se prolonge après leur départ et sombre un noir fatalisme), "Hills Like White Elephants" (L'Espagne, catalyseur pour évoquer un dialogue sur l'avortement), "In Another Country" (de l'expérience de la convalescence de soldats américains en Italie pendant la Première guerre mondiale), "The Undefeated" (L'Invincible, un vieux torero se console de sa blessure)...
"... Le cuistot tâta les commissures de ses lèvres avec ses pouces.
"Y sont partis tous les deux? demanda-t-il.
- Ouais, fit Georges. Ils sont partis.
- J'aime pas ça, fit le cuistot. J'aime pas ça du tout du tout."
Georges se tourna vers Nick :
"Dis donc. Tu ferais bien d'aller voir Ole Andreson.
- Bon.
- Vous feriez bien mieux de ne pas fourrer le nez dans cette histoire, fit Sam le cuistot. Vous feriez bien mieux de rester le plus loin possible de cette histoire.
- N'y va pas si tu n'y tiens pas, fit Georges.
- Ça vous rapportera rien de bon, fit le cuistot. Ne vous en mêlez pas, c'est mon avis.
- J'y vais, dit Nick s'adressant à Georges. Où c'est qu'il habite?"
Le cuistot tourna le dos.
"Les jeunes gens, ça sait toujours les choses mieux que personne", fit-il.
Georges dit à Nick :
"Il habite dans le garni Hirsch.
- J'y vais."
Dehors la lampe à arc brillait a travers les branches nues. Nick suivit les rails du tramway et tourna au réverbère suivant dans une rue latérale. Le garni Hirsch était la troisième maison de la rue. Nick gravit les deux marches et poussa le bouton de sonnette. Une femme parut sur le seuil.
"Ole Andreson est là ?
- Vous voulez le voir?
- Oui, s'il est là."
Nick suivit la femme au premier et jusqu'au fond d'un corridor. Elle frappa à la porte.
« Qui va là ?
- C'est quelqu'un pour vous voir, Mister Andreson, fit la femme.
- C'est moi, Nick Adams.
- Entrez."
Nick ouvrit la porte et entra dans la chambre. Ole Andreson était étendu, tout habillé, sur son lit. Ancien poids lourd, il était trop long pour le lit. Il était couché, la tête sur deux oreillers. Il ne regarda pas Nick.
"Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
- J''étais chez Henry's, dit Nick, deux types sont entrés et m'ont attaché, moi et le cuistot, et ont dit qu'ils allaient vous tuer."
Ç'avait l'air bête, ce qu'il disait. Ole Andreson ne dit mot.
"Ils nous ont planqués dans la cuisine, reprit Nick. Ils comptaient vous tirer dessus quand vous entreriez pour diner."
Ole Andreson regardait le mur et ne disait rien.
"Georges a dit comme ça que je ferais bien de venir vous prévenir.
- J'y peux rien, fit Ole Andreson.
- Je vais vous dire comment ils sont.
- Je veux pas le savoir", dit Ole Andreson. Il regardait le mur.
"Merci tout de même d'être venu me dire ça.
- Oh! de rien. "
Nick regardait le grand corps étendu sur le lit.
"Vous voulez que j'aille prévenir la police ?
- Non, répondit Ole Andreson. Ça ne servirait è. rien.
- Je peux rien faire pour vous ?
- Non. Personne ne peut rien faire.
- Peut-être c'était du bluff ?
- Non. C'est pas du bluff."
Ole Andreson se retourna vers le mur.
"La seule chose, fit-il, parlant vers le mur, c'est que je peux pas me décider à sortir. Je suis resté à la maison toute la journée.
- Vous pourriez pas quitter la ville?
- Non, dit Ole Andreson. J'en ai marre de cavaler comme ça."
Il regardait le mur.
"Et puis y a rien à faire.
- Vous pourriez pas arranger ça?
- Non. Je m'suís mis dans mon tort."
Il parlait toujours de la même voix plate.
"Y'a rien à faire. Dans quéque temps je m'déciderai à sortir....."
(The Killers, Scribner's Magazine)

Robert Siodmak, 1946, "The Killers",
Le film noir qui lança les carrières de Burt Lancaster et d'Ava Gardner, deux tueurs pénètrent de nuit dans un restaurant, mettent sous pression le patron, le cuisinier, un client, ils viennent tuer le "suédois", ils l'attendent, en vain, il ne viendra pas, ils retrouvent sa trace, il est chez lui, indifférent, attendant sa mort, il ne résiste pas, ils tirent, il meurt ...

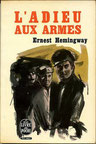
1932 - L'Adieu aux armes (A Farewell to Arms)
"If people bring so much courage to this world the world has to kill them to break them, so of course it kills them. The world breaks every one and afterward many are strong at the broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially. If you are none of these you can be sure it will kill you too but there will be no special hurry." - Parfois considéré comme le meilleur roman d'Hemingway, il reprend le thème autobiographique de la guerre, de la blessure et de l'absurdité. Le personnage du roman, le lieutenant Frédéric Henry, volontaire américain sur le front d'Italie est gravement blessé aux jambes comme l'avait été Hemingway. Il est transporté à l'hôpital de la Croix-Rouge américaine de Milan où il est soigné par une jeune infirmière anglaise, Catherine Barkley qu'il avait déjà rencontrée dans un hôpital du front à Gorizia. Ils passent un été idyllique, s'aiment clandestinement dans la chambre d'hôpital du blessé, dînent dans les cafés de la Galleria, vont aux courses de San Siro. Toutes ces expériences se rapprochent de celles que l'auteur avait lui-même connues. Lui aussi fut soigné à l'hôpital de la Croix-Rouge où il fit connaissance d'une infirmière américaine, Agnès H. von Kurowsky qui lui servit de modèle pour le personnage de Catherine Barkley. Hemingway lui demanda de l'épouser, mais elle refusa. Pris dans la débâcle de l'armée italienne, las de l'absurdité militaire, le lieutenant Henry finit par signer « sa paix séparée ». Il se réfugie en territoire neutre, mais pour y voir mourir la femme qu'il aime. Il n'y a pas d'amour heureux chez Hemingway.
Hemingway traite ici d'un sujet des plus romantiques mais d'une façon qui ne l'est pas. Au début de 1917, Henry ne croyait pas à l'amour; en revanche la guerre lui semblait être un sport assez amusant. À la fin de cette même année, il s'était rendu à I'évidence de l'amour et avait fui I'inutile et stupide cruauté de la guerre. L'auteur rend cette évolution d'autant plus sensible que, n'ayant recours ni à l'analyse ni à de grands mots, il s'en tient rigoureusement au concret et au quotidien. Si Henry a changé, c'est qu'il a vécu et appris. Le roman se borne à nous faire voir ce qu'il voit et constater ce qu'il constate; on suit le personnage pas à pas et on est ainsi amené tout doucement, sans cahots, à s'intéresser ou même à s'identifier à lui. Enfin et surtout, le style de Hemingway a une aisance qui ne sent pas l'effort. Ce style, qui était à l'époque assez révolutionnaire, a marqué beaucoup d'écrivains, notamment américains ..
CHAPTER I - "In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain to the mountains. In the bed of the river there were peb-bles and boulders, dry and white in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels. Troops went by the house and down the road and the dust they raised powdered the leaves of the trees. The trunks of the trees too were dusty and the leaves fell early that year and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, stirred by the breeze, falling and the soldiers marching and afterward the road bare and white except for the leaves. The plain was rich with crops; there were many orchards of fruit trees and beyond the plain the mountains were brown and bare.
There was fighting in the mountains and at night we could see the flashes from the artillery. In the dark it was like summer lightning, but the nights were cool and there was not the feeling of a storm coming. Sometimes in the dark we heard the troops marching under the window and guns going past pulled by motor-tractors. There was much traffic at night and many mules on the roads with boxes of ammunition on each side of their pack-saddles and gray motor-trucks that carried men, and other trucks with loads covered with canvas that moved slower in the traffic. There were big guns too that passed in the day drawn by tractors, the long barrels of the guns covered with green branches and green leafy branches and vines laid over the tractors. To the north we could look across a valley and see a forest of chestnut trees and behind it another mountain on this side of the river. There was fighting for that mountain too, but it was not successful, and in the fall when the rains came the leaves all fell from the chestnut trees and the branches were bare and the trunks black with rain. The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet and brown and dead with the autumn. There were mists over the river and clouds on the mountain and the trucks splashed mud on the road and the troops were muddy and wet in their capes; their rifles were wet and under their capes the two leather cartridge-boxes on the front of the belts, gray leather boxes heavy with the packs of clips of thin, long 6.5 mm. cartridges, bulged forward under the capes so that the men, passing on the road, marched as though they were six months gone with child.
(Livre premier, ...) « La plaine était couvertes de récoltes. Il y avait de nombreux vergers, et, à l'horizon, les montagnes étaient brunes et dénudées. On se battait dans les montagnes, et le soir, nous pouvions apercevoir les éclairs de l'artillerie. Dans l'obscurité on eût dit des éclairs de chaleur; toutefois les nuits étaient fraîches et l'on n'avait point l'impression qu'un orage menaçait. Parfois, dans l'obscurité, nous entendions des régiments passer sous nos fenêtres avec des canons traînés par des tracteurs. La nuit, le mouvement était intense. Il y avait sur les routes un grand nombre de mulets portant des caisses de munitions de chaque côté de leurs bâts, et des camions qui transportaient des hommes, et, dans tout ce va-et-vient, d'autres camions recouverts d'une bâche se mouvaient lentement. Le jour, de gros camions passaient, tirés par des tracteurs. De la gueule à la culasse, ils étaient couverts de branches vertes; des pampres et des feuillages verts recouvraient aussi les tracteurs. Au nord, au fond de la vallée, nous pouvions apercevoir une forêt de châtaigniers, et, par derrière, une autre montagne, de ce côté-ci de la rivière. On se battait également pour cette montagne, mais c'était sans résultat, et, à l'automne, quand les pluies commencèrent, les feuillles des châtaigniers se mirent à tomber, et on ne vit plus que des branches nues et des troncs noirs de pluie. Les vignes étaient clairsemées, dénudées, et toute la campagne était mouillée et brune, tuée par l'automne.
... A l'entrée de l'hiver une pluie persistante se mit à tomber, et la pluie amena le choléra. Mais on put l'enrayer et, en fin de compte, il n'y eut, dans l'armée que sept mille hommes qui en moururent.
... Nous étions chargés d'évacuer les blessés et les malades des postes de secours, de les transporter des montagnes aux gares de triage et de les diriger sur les hôpitaux indiqués sur leurs feuilles de route.
Evidemment ma présence importait peu. Les chauffeurs des ambulances britanniques étaient tués parfois. Oh ! je savais que je ne serais pas tué. Pas dans cette guerre. Elle ne m'intéressait pas personnellement et elle me semblait pas plus dangereuse qu'une guerre de cinéma..."
Automne 1916, la guerre, vue de Gorizia, petite ville située au nord de Trieste, à l'extrême limite de l'Italie, se réduit à l'écho assourdi de quelques lointains coups de canon. Le lieutenant Frederick Henry, un Américain qui, par jeunesse, insouciance et goût du sport, s'est engagé dans l'armée italienne, y mène, entre ses ambulances, son mess le vin et les femmes, une vie assez agréable. A mesure que l'hiver s'installe, les coups de canon se font de plus en plus rares. On accorde à Henry quartier libre pour l'hiver. Il en profite pour courir de plaisir en plaisir à travers la péninsule. Revenu au front, il fait la connaissance d'une infirmière anglaise. Il feint de l'aimer, mais il ment. Elle feint de le croire, mais ne le croit pas. Sur ces entrefaites, la guerre se réveille. A peine a-t-il le temps d'en parler avec ses hommes et de découvrir combien ils la haïssent : il est blessé le premier soir, alors qu'il partageait avec eux un maigre repas de macaronis et de fromage. On l'évacue dans un petit hôpital américain de Milan. Le hasard veut qu'il y retrouve son Anglaise. Il y a entre elle et lui une complicité telle qu'il se met à l'aimer. Son genou se rétablit lentement. C'est l'été. Il a de l'argent. Il réapprend à marcher. Avec des béquilles d'abord, puis avec une simple canne. Mais les plus beaux étés ont une fin. Maintenant, l'infirmière est enceinte. Maintenant, il faut qu'il retourne au front.
Là-bas les choses ont beaucoup changé. Il n'est plus du tout question de jouer. On se bat, durement. La lassitude est si profonde qu'elle accable et décourage. Hanté par le spectacle de la souffrance que cause la guerre, l'aumônier est amer, presque révolté. Le major Rinaldi, qui était le meilleur ami d'Henry, passe ses jours et ses nuits à opérer les blessés. Il craint d'avoir la syphilis. Le vin continue d'enivrer, mais n'égaie plus. Les plaisanteries traditionnelles agacent sans amuser. Pourvu au moins que les Autrichiens, l'hiver venant,
renoncent à attaquer encore. Ils vont sûrement devoir y renoncer. Mais sait-on jamais? Ils sont devenus si hargneux. Henry est envoyé en pleine montagne. Il n'y est pas plus tôt qu'un mouvement de retraite s'amorce. Ses trois chauffeurs et lui rentrent à Gorizia, où ils parviennent épuisés de fatigue. La ville achève de se vider. Il ne trouve, griffonné en hâte et épinglé à un mur du mess, qu'un mot lui enjoignant d'évacuer le reste du matériel au lieu où l'armée doit en principe se regrouper. Plus facile à ordonner qu'à faire.
Il y a sur la route une telle cohue (c'est la célèbre retraite de Caporetto) que les voitures n'avancent que par à-coups, et fort lentement. Quelle effroyable boucherie ce serait si les ennemis se mettaient à y jeter des bombes. Il paraît plus raisonnable de s'aventurer sur des
chemins de traverse que de continuer à s`exposer ainsi. Mais une des ambulances s`enlise. Les sergents qui, espérant gagner du temps, y avaient pris place, refusent d'aider à la dégager. Ils s'enfuient. Furieux, Henry en tue un.
Les chemins de traverse ne mènent ni à la ville ni à une autre route, ils se perdent dans les cours de fermes comme les fleuves dans les sables. Il faut se faire une raison, abandonner les ambulances, poursuivre à pied. Une balle perdue fauche celui qui était peut-être le meilleur des trois soldats. Pris de panique, un de ses camarades déserte. Il part vers le Nord se constituer prisonnier.
Après avoir longtemps marché au hasard, le lieutenant et le chauffeur qui lui reste retrouvent la grand-route. Sur un pont, des hommes armés arrêtent les officiers qu'ils reconnaissent. Ils les conduisent dans un pré, procèdent à un simulacre de jugement et les fusillent. Henry échappe de justesse à ce sort en se jetant dans la rivière au moment où il allait comparaître devant le soi-disant tribunal. À dater de cet instant, il considère que son contrat avec l'armée italienne est rompu. Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il se débrouille pour rejoindre son infirmière, qui passait des vacances à Stresa. Endroit innocemment, mais bien choisi puisqu'il suffit pour franchir la frontière suisse de gagner l'extrémité nord du lac.
Avant qu'Henry ait eu le loisir de mettre cette petite expédition au point, un garçon de l'hôtel, avec qui il a sympathisé, l'avertit que son arrestation est imminente et lui prête une barque. Pendant sept heures, il rame avec acharnement. À l'aube, il est au large d'une petite ville. Il se rapproche. Il distingue des uniformes suisses. Désormais c'est la tranquillité et la joie. L'hiver fait pendant à l'été. Retirés dans un chalet, l'ex-lieutenant et l'ex-infirmière attendent leur enfant. Mais celui-ci ne vivra pas et tuera sa mère, tandis que le père s'éloigne sous la pluie vers de nouvelles aventures. On sait que l'auteur écrivit plus de trente fins différentes à son roman ...
"Miss Barkley était assez grande. Elle portait ce qui pour moi était un uniforme d'infirmière. Elle avait la peau ambrée et des yeux gris. Je la trouvais très belle. Je pensais qu'elle était un peu folle. Personnellement je n'y voyais aucun inconvénient. Peu m'importait l'aventure dans laquelle je me lançais. Je n'avais nulle intention de l'aimer. C'était un peu, comme le bridge, dans lequel on disait des mots au lieu de jouer des cartes. Il fallait faire semblant de jouer pour un enjeu quelconque. Cela me convenait parfaitement. Le lendemain, on nous dit qu'il allait y avoir une attaque sur la rivière, en amont, et qu'il nous fallait envoyer quatre voitures. Je me trouvais dans la première voiture. Nous garâmes les voitures derrière une briqueterie. Les fours et de grands trous avaient été aménagés en postes de secours. Il faisait noir et, derrière nous, les longs faisceaux des projecteurs autrichiens balayaient les montagnes. Le silence dura quelques minutes, puis tous les canons derrière nous entrèrent en action. Un obus éclata tout près de la rivière. Un autre arriva sur nous, si brusquement que nous eûmes à peine le temps de l'entendre venir. Le sol était défoncé et, en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête j'entendis quelqu'un crier. J'essayai de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. Dans une éblouissante clarté je voyais les obus à étoile monter, éclater, flotter dans l'air, tout blancs. J'entendis quelqu'un crier " Mamma mia ! Oh ! Mamma mia ! " et vis Passini les jambes broyées au-dessus du genoux. Je compris que j'étais également blessé.
Les Anglais étaient arrivés avec trois ambulances, on m'apporta au poste de secours. Il y avait des odeurs fortes, odeurs de produits chimiques, et la fade odeur du sang. Le soir qui précéda mon départ Rinaldi vint me voir avec le major de notre mess. Ils me dirent que j'allais être hospitalisé à Milan dans un hôpital américain récemment installé. Il me dit également que Miss Barkley allait être envoyée à Milan elle aussi. Quand je m'éveillai le soleil entrait à flot dans ma chambre. Je ressentis une douleur aiguë dans les jambes. Je les regardai dans leurs bandages sales, et cette vue me rappela où j'étais. J'entendis des pas qui s'approchaient. Je tournai les yeux vers la porte. C'était Catherine Barkley. Elle était fraîche et belle. Il me sembla que je n'avais jamais vu de femme aussi belle. Dieu sait que je ne voulais pas tomber amoureux d'elle. Je ne voulais tomber amoureux de personne. Mais Dieu sait aussi, que, malgré cela, j'étais amoureux, et j'étais là, dans ce lit d'hôpital, à Milan, et toutes sortes de choses me passaient par la tête, et je me sentais merveilleusement bien. Catherine Barkley était fort aimée des autres infirmières parce qu'elle était toujours disposée à assurer le service de nuit. Nous passions ensemble tous les moments de loisir. Je l'aimais beaucoup et elle m'aimait. Je dormais le jour et nous nous envoyions des billets toute la journée quand nous étions éveillés. Ferguson se chargeait de les transmettre. L'été fut charmant. Dès que je pus sortir, nous fîmes des promenades en voiture dans le parc. Je me rappelle la voiture, le cheval qui marchait lentement, et, devant nous, le dos du cocher avec son haut-de-forme verni, et Catherine Barkley assise à côté de moi. Je disais à Catherine que je voulais l'épouser, mais Catherine disait que si nous étions mariés on la renverrait, et que cela bouleverserait notre vie. J'aurais voulu que nous fussions mariés, parce que, j'avais peur d'avoir un enfant, mais nous prétendions que nous étions mariés et nous ne nous préoccupions guère, et au fond j'étais peut-être heureux de n'être pas marié. C'est ainsi que s'écoula l'été. Je ne me souviens pas très bien des journées, sinon qu'elles étaient très chaudes et que les journaux ne parlaient que de victoires. Au front nous avancions sur le Carso. Nous avions pris Kuk, de l'autre côté de la Plava, et nous cherchions à nous emparer du plateau de Bainsizza. La guerre semblait devoir se prolonger. L'Amérique venait d'entrer en guerre, mais je pensais qu'il faudrait bien un an avant qu'on pût envoyer des contingents suffisant et les entraîner au combat. Il me semblait que cette guerre là c'était peut-être une nouvelle guerre de Cent ans. Un jour Catherine m'annonça : " Je vais avoir un bébé, chéri. Presque trois mois déjà. ça ne t'ennuie pas, dis ? Je t'en supplie, il ne faut pas que ça te tourmente. Pendant un instant nous restâmes tranquilles sans dire un mot. Nous étions soudain séparés comme des gens qui se trouvent embarrassés parce que quelqu'un est entré brusquement dans la chambre.
-Tu n'as pas l'impression d'être pris au piège ? -
- Peut-être un peu, mais pas par toi. On se trouve toujours pris au piège, au sens biologique
Nous étions de nouveau ensemble. Toute gêne avait disparu.
- Nous ne sommes en réalité qu'une seule et même personne et il ne faut pas faire exprès de ne pas nous comprendre
- Non il ne faut pas. Parce que nous sommes seuls, nous deux ; et dans le monde il y a tous les autres. Si quelque chose se mettait entre nous, nous serions perdus et le monde nous reprendrait -
Le soir de mon départ pour le front, je fis mes adieux à l'hôpital et je partis. Je descendis jusqu'au coin où il y avait un cabaret dans lequel j'attendis Catherine en regardant par la fenêtre. Dehors il faisait noir et froid, et il y avait du brouillard. Quand j'aperçus Catherine je frappai au carreau. Nous partîmes ensemble sur le trottoir, le long des cabarets. Nous avions dépassé la cathédrale. Elle était belle dans le brouillard.
Il y avait un hôtel face à la gare et nous y trouvâmes une chambre. Catherine s'était assise sur le lit et regardait le lustre en cristal taillé. Elle n'avait pas l'air heureux.
- C'est la première fois que j'ai l'impression d'être une grue -
Je n'avais pas prévu que les choses tourneraient ainsi.
- Tu es ma bonne petite femme -
- Ah certes oui, je suis bien à toi - dit-elle Je suis une petite femme toute simple.
Mais bientôt ce fut le temps de partir. La pluie semblait très claire et transparente dans la lumière de la gare.
- Autant se dire adieu maintenant, adieu, dis-je, prends bien soin de toi et de la petite Catherine -
- Adieu chéri -
Je descendis sous la pluie et la voiture partit. Catherine se pencha et je vis son visage dans la lumière. Elle sourit et agita la main et me fit signe d'aller m'abriter. J'obéis et restai debout, les yeux fixés sur la voiture qui tournait au coin de la rue. Alors seulement je traversai le hall et passai sur la voie. C'était l'automne. Les arbres étaient nus et les routes boueuses. D'Udine je me rendis à Gorizia sur un camion. Là je fis la connaissance de Gino qui me raconta que le San Gabriele avait été un véritable enfer et que j'avais eu de la chance d'être blessé dès le début. Il dit que les Autrichiens avaient beaucoup d'artillerie dans les bois, plus loin et au-dessus de nous, et que la nuit, ils bombardaient violemment les routes. Nous manquions de nourriture. J'ai toujours été embarrassé par les mots sacrés ; glorieux, sacrifice. Nous les avions lus sur les proclamations que les colleurs d'affiches placardaient depuis longtemps sur d'autres proclamations. Je n'avais rien vu de sacré, et ce qu'on appelait glorieux n'avait pas de gloire, et les sacrifices ressemblaient aux abattoirs de Chicago avec cette différence que la viande ne servait qu'à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots qu'on ne pouvait plus tolérer. Les mots abstrait tels que gloire, honneur, courage ou sainteté étaient indécents. Le vent s'éleva dans la nuit et, à trois heures du matin, sous une pluie torrentielle, le bombardement commença. La nuit suivante la retraite commença. Elle s'effectua, méthodique, mouillée, lugubre. Dans la nuit, sur les routes où nous avancions lentement, nous rencontrâmes des troupes qui marchaient sous la pluie, des chevaux qui tiraient des voitures, des mules, des camions, et tout cela s'éloignait du front. Il n'y avait pas plus de désordre que quand on avançait. A Gorizia je trouvai une note pour moi me recommandant de remplir mes voitures avec le matériel empilé dans le vestibule et de me diriger sur Pordenone. Quand nous nous trouvâmes sur la route, les troupes, les camions, les charrettes et les canons y formaient une large colonne qui se déplaçait lentement. La pluie s'apaisait et nous avancions. L'aube n'avait pas encore paru que nous étions de nouveau arrêtés et je compris qu'il nous faudrait abandonner la grand-route e passer à travers champs si nous voulions jamais arriver à Udine. Personne ne savait où étaient les Autrichiens, mais c'était sûr que, la pluie cessant, si les aéroplanes nous survolaient et se mettaient à arroser la colonne, c'en était fait de nous. A midi, nous nous embourbâmes dans un chemin détrempé, à environ dix Kilomètres d'Udine. Et nous ne pûmes plus traverser. La terre était trop molle et trop boueuse pour des autos. Nous le abandonnâmes dans le champ et partîmes à pied. Plus loin, le long du parapet d'un pont, des casques allemands s'avançaient, mais il nous ignorèrent. Nous suivions les rails lorsqu'un coup de fusil partit de la route. Aymo qui traversait les rails chancela, trébucha et tomba la face contre la terre. Sa respiration était irrégulière et chaque fois qu'il respirait le sang lui coulait du nez. Il mourut pendant que j'obturais les deux trous. C'étaient des Italiens qui avaient peur et tiraient sur tout ce qu'ils voyaient, ils ne nous avaient pas reconnus et avaient tiré sur nous. C'est ainsi que la mort était arrivée à l'improviste, sans raison. Et maintenant ce n'était pas seulement l'armée, mais tout le pays qui s'enfuyait. Plus tard la police des armées nous arrêta. Mon accent étranger les rendit soupçonneux. Je voyais comment leurs cerveaux fonctionnaient. Ils étaient jeunes, et ils travaillaient pour le salut de leur patrie. Ils exécutaient tous les officiers supérieurs qui avaient été séparés de leurs troupes. Nous attendions sous la pluie et, les uns et les autres, nous étions interrogés et fusillés.
Je regardai les carabiniers. Je me courbai, bousculai deux hommes et, tête baissée je m'élançai vers le fleuve. Ce fut dur mais je m'en sortis. Et maintenant, couché sur le plancher du wagon, à côté des canons sous la bâche, j'étais mouillé, j'avais froid, je mourais de faim. Mon genou était raide mais il s'était très bien comporté. Valentini avait fait du bon travail. J'avais fait la moitié de la retraite à pied et j'avais traversé une partie du Tagliamento à la nage avec ce genou-là. Je sautai du train à Milan, au moment où il ralentissait pour entrer en gare. A l'hôpital je cherchai Catherine mais on me dit qu'on l'avait envoyée à Stresa. Mon ami Simmons me fournit des habits, en civil je me faisais l'effet d'être déguisé. Le grand Hôtel des îles Borromées était ouvert. Je pris une bonne chambre. Elle était fort grande, et claire et donnait sur le lac. J'attendais ma femme dis-je. Il y avait un grand lit à deux personnes, un letto matrimoniale, avec un couvre-pied en satin. L'hôtel était très luxueux. La guerre était très loin. Au fait y avait-il bien une guerre ? Alors seulement je me rendis compte qu'elle était finie pour moi. J'avais la sensation d'un gamin qui, faisant l'école buissonnière, pense, à une certaine heure, à ce qui se passe alors en classe. J'avais retrouvé Catherine lorsqu'une nuit le barman vint m'avertir qu'on allait m'arrêter dans la matinée. Il nous proposa son bateau afin de franchir la frontière. Je ramai toute la nuit. A la fin j'avais les mains si meurtries que je pouvais à peine tenir les avirons. A plusieurs reprises nous faillîmes nous écraser contre la rive. Au petit matin je sus que la frontière était loin derrière nous et que nous nous trouvions à Brissago. C'était une petite ville d'un aspect fort joli. Il y avait beaucoup de barques de pêche, le long du quai, et des filets étendus sur des tréteaux. Une fine pluie de novembre tombait, mais malgré la pluie, tout semblait propre et gai. La Suisse, nous fournit des visas et nous nous installâmes à Montreux. La guerre me semblait aussi loin que les matchs de football de n'importe quel collège. Les journaux annonçaient que tout allait très mal partout. Vers le milieu de janvier j'avais une barbe ; et l'hiver n'était plus qu'une suite de lumineuses journées froides et de nuits glacées. Nous menions une existence délicieuse. Nous étions en mars 1918 et l'offensive allemande avait commencé en France. Catherine se préoccupait pour sa layette. Notre bébé allait bientôt arriver. Une nuit, je m'éveillai vers trois heures en entendant Catherine s'agiter dans le lit. Nous étions arrivés à l'hôpital à trois heures du matin. A midi Catherine était encore dans la salle d'accouchement. Les douleurs s'étaient de nouveau ralenties. Elle avait l'air exténué, mais elle était encore gaie. Pauvre, pauvre chère Cat ! Et c'était là le prix à payer pour coucher ensemble. C'était ça la fin du piège. C'était là tout le bénéfice qu'on retirait de l'amour. Dieu merci il y avait le chloroforme. Catherine avait eu une heureuse grossesse. C'est à peine si elle avait été indisposée. Mais c'est à la fin qu'on la guettait. Il n'y avait jamais moyen d'échapper. Echapper. J't'en fous ! il en aurait été de même si nous avions été mariés cinquante fois. Si elle allait mourir ? Non, elle ne mourra pas. On ne meurt plus en couches de nos jours. C'est l'opinion de tous les maris. Oui, mais tout de même si elle allait mourir ? Elle ne peut pas mourir… C'est tout simplement un enfant qui veut naître…le produit des belles nuits de Milan. Il cause des ennuis, il naît, on s'en occupe et on finit par l'aimer peut-être. Mais pourtant si elle mourait ? On se décida pour la césarienne. J'attendis dans le couloir. Un des docteurs sortit, suivi d'une infirmière. Dans ses deux mains il tenait quelque chose qui ressemblait à un lapin fraîchement écorché. Il le tenait par les talons et lui donnait des claques. Je me sentais tout à fait indifférent à son égard. Il me semblait complètement étranger. Je n'éprouvais aucun sentiment de paternité. Lorsque je pénétrai dans la chambre de Catherine j'eus l'impression qu'elle était morte. Son visage était livide. Elle était toute grise et faible et fatiguée. Plus tard on m'apprit que le bébé était mort. Il n'avait jamais respiré !Il n'avait jamais vécu sauf dans le sein de Catherine. Pauvre petit gosse ! Maintenant Catherine allait mourir. C'est toujours comme ça. On meurt. On ne comprend rien. On n'a jamais le temps d'apprendre. On vous pousse dans le jeu. On vous apprend les règles et, à la première faute on vous tue. Le vide s'était fait en moi. Je savais qu'elle allait mourir et je priai pour qu'elle ne mourût pas. " Oh ! mon Dieu, je vous en prie, ne la laissez pas mourir ". Mais les hémorragies s'étaient répétées. Rien n'avait pu les arrêter. Je restai avec Catherine jusqu'à sa mort. Elle ne reprit pas connaissance et il ne lui fallut pas longtemps pour mourir. Après avoir refermé la porte et avoir éteint la lumière, je compris que tout était inutile. C'était comme si je disais adieu à une statue. Au bout d'un instant, je sortis et je quittai l'hôpital. Et je rentrai à l'hôtel, sous la pluie. »

"A Farewell to Arms", une première version portée à l'écran en 1932 par Frank Borzage, avec Helen Hayes (Catherine Barkley), Gary Cooper (Lieutenant Frederic Henry), et Adolphe Menjou (Major Rinaldi), puis dans une seconde version en 1957, réalisée par Charles Vidor, avec Rock Hudson (Frederick Henry), Jennifer Jones (Catherine Barkley), Vittorio De Sica (Major Alessandro Rinaldi)....
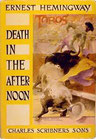
1932 - Mort dans l'après-midi (Death in the Afternoon)
"If a writer of prose knows enough about what he is writing about, he may omit things that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an iceberg is due to only one-eighth of it being above water." - Hemingway trouve dans la corrida espagnole le symbole de sa fascination pour la mort bravée. "La queue du taureau se dressa, sa tête se baissa. Il chargea, et, quand il atteignit Hernandorena, l'homme agenouillé fut enlevé d'un bloc, balancé en l'air comme un paquet, les jambes alors dans toutes les directions, puis retomba à terre... Hernandorena se leva, avec du sable sur son visage blanc, et chercha après son épée et l'étoffe. Quand il se mit debout, je vis, dans la soie lourde et le gris maculé de ses culottes de location, une ouverture nette et profonde par où l'on voyait le fémur à nu depuis la hanche et presque jusqu'au genou."
"The only place where you could see life and death, violent death now that the wars were over, was in the bull ring and I wanted very much to go to Spain where I could study it. I was trying to learn to write, commencing with the simplest things, and one of the simplest things of all and the most fundamental is violent death. It has none of the complications of death by disease, or so-called natural death, or the death of a friend or someone you have loved or have hated, but it is death, nevertheless, one of the subjects that a man may write of. I had read many books in which, when the author tried to convey it, he only produced a blur, and I decided that this was because either the author had never seen it clearly or at the moment of it, he had physically or mentally shut his eyes, as one might do if he saw a child that he could not possibly reach or aid, about to be struck by a train. In such a case I suppose he would probably be justified in shutting his eyes as the mere fact of the child being about to be struck by the train was all that he could convey, the actual striking would be an anti-climax, so that the moment before striking might be as far as he could represent. But in the case of an execution by a firing squad, or a hanging, this is not true, and if these very simple things were to be made permanent, as, say, Goya tried to make them in Los Desastres de la Guerra it could not be done with any shutting of the eyes.
"... Le seul endroit où l'on pût voir la vie et la mort, j'entends la mort violente, maintenant que les guerres étaient finíes, c'était dans les arènes à taureaux, et je désirais beaucoup aller en Espagne, où je pourrais les observer. Je m'essayais au métier d'écrivain, en commençant par les choses les plus simples, et l'une des choses les plus simples de toutes et des plus fondamentales est la mort violente. Elle n'a rien des complications de la mort par maladie, ni de la mort dite naturelle, ni de la mort d'un ami ou de quelqu'un qu'on a aimé ou haï, mais c'est la mort tout de même, un des sujets sur lesquels un homme peut se permettre d'écrire.
J'ai lu beaucoup de livres où l'auteur, lorsqu'il essayait d'en donner une idée, n'arrivait qu'à offrir une image brumeuse. C'était, je m'en suis convaincu, ou bien parce que l'auteur n'avait jamais vu le fait clairement, ou que, sur le moment même, il avait, physiquement ou mentalement, fermé les yeux, comme on peut faire si l'on voit un enfant, hors d'atteinte et de secours, sur le point d'être écrasé par un train. En pareil cas, je suis tout disposé à pardonner au témoin s'il a fermé les yeux. Très probablement, nous n'y perdons rien, car tout ce qu'íl aurait pu nous rapporter, ç'aurait été le simple fait d'un enfant sur le point d'être écrasé par un train. Le fait même de l'écrasement aurait été le point mort du récit; la seconde d'avant l'écrasement aurait peut-être été l'extrême limite de ce qu'il pouvait nous représenter. Mais dans le cas d'une exécution par un feu de salve, ou d'une pendaison, il n'en va pas de même; et si l'on voulait fixer ces très simples faits d'une manière durable, comme, par exemple, Goya a essayé de le faire dans "Los Desastres de la guerra", on ne pourrait y arriver si l'on avait fermé les yeux, si peu que ce fût.
J'ai vu certains faits, certains faits très simples de ce genre, et j'ai pu m'en souvenir. Parfois j'y étais acteur; d'autres fois, j'étais chargé d'en rédiger le récit sur-le-champ, et j'avais donc dû remarquer les détails nécessaires pour un compte rendu immédiat. Pourtant, je n'avaís jamais été capable de les observer, comme un homme pourrait, par exemple, observer la mort de son père ou, si l'on veut, la pendaison d'un inconnu, sans être obligé d'en faire un compte rendu immédiat, pour la première édition d`un journal du soir.
Ainsi j'allai en Espagne pour voir des courses de taureaux et essayer d'écrire sur elles pour moi-même. Je pensais les trouver simples, barbares, cruelles, et ne pas les aimer. Mais j'espérais y voir une forme d'action bien définie, capable de me donner ce sentiment de vie et de mort qui était l'objet de mes efforts. Je trouvai bien la forme d'action définie; mais les courses de taureaux m'apparurent si peu simples et me plurent tellement qu'il eût été beaucoup trop compliqué de m'y attaquer avec mon équipement littéraire d'alors. A part quatre esquisses très courtes, je fus incapable d'en rien écrire pour cinq ans - et j'aurais aimé pouvoir en attendre dix. Il est vrai que si j'avais attendu aussi longtemps, je n'aurais sans doute rien écrit du tout. En effet, lorsqu'on commence à s'instruire réellement sur un sujet, on a quelque répugnance à écrire tout de suite; on voudrait plutôt continuer d'apprendre toujours. A aucun moment on ne se sent en mesure de dire : maintenant, je sais tout ce qu'il faut savoir sur mon sujet, écrivons donc; à moins qu'on ne soit très infatué de soi, ce qui, j'en conviens, peut rendre compte de bien des livres.
Certes, je ne dis pas aujourd'hui que j'en sais suffisamment. Chaque année, je vois qu'il y a toujours plus à apprendre. Mais je sais dès maintenant certaines choses qui peuvent être intéressantes à dire, et je resterai peut-être longtemps sans voir encore des courses de taureaux. Pourquoi donc n'écrírais-je pas dès à présent ce que j'en sais? Et de plus, il ne serait peut-être pas mauvais d'avoir un livre en anglais sur les courses de taureaux. Un livre sérieux sur un sujet aussi peu moral peut avoir quelque valeur.
Pour moi, sur les questions de morale, je ne sais qu'une chose : est moral ce qui fait qu'on se sent bien, et immoral ce qui fait qu'on se sent mal. Jugées à ces critères moraux que je ne cherche pas à défendre, les courses de taureaux sont très morales pour moi; en effet, durant ces courses je me sens très bíen, j'ai le sentiment de vie et de mort, du mortel et de l'immortel, et, le spectacle terminé, je me sens très triste mais à merveille..."
Une arène inondée de lumière (el soles el mejor torero), un "toro" brave, un homme qui connaît son métier ... "Mort dans l'après-midi" n'est pas un traité de tauromachie, bien qu'il explique au demeurant pourquoi on peut aimer les courses de taureaux ou. au contraire. à cause de leur cruauté, les détester. Il explique ensuite quels sont les accessoires du spectacle et quelle place choisir aux arènes. Où les taureaux sont élevés et comment. ce qu'ils doivent être et ce qu'ils valent en réalité. Quelle est la tâche des picadors. des banderilleros et des matadors. ll évoque les grandes figures d`un passé récent et trace d'incisifs portraits des gloires du moment. Il décrit avec précision les principales passes qui peuvent être exécutées, et les règles qui président à la mise à mort. On peut être impressionné par le nombre de conditions à réunir pour que l'affrontement de l`homme et du taureau soit un spectacle exaltant aux yeux de ces connaisseurs que la couleur, le mouvement, l'apparente virtuosité et l'à-peu-près ne sauraient suffire à satisfaire. D'abord le taureau irréprochable est rare parce que même un pur-sang soigneusement sélectionné. ayant l'âge et le poids requis, ne possédant aucune expérience du combat et se présentant en parfaite condition physique, ne se montre pas forcément "brave", c'est-a-dire impétueux et dépourvu d'astuce. ll est souvent fantasque ou trop intelligent. Surtout si le hasard le favorise. Il ne charge pas droit. Il adopte un emplacement de l`arène, comprend rapidement que '`étoffe est un leurre et, s`en désintéressant, ne pense plus qu'à charger l`homme. ...
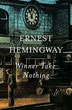
1933 - Le gagnant ne gagne rien (Winner Takes Nothing)
Un recueil de quatorze nouvelles célèbres pour leur concision et leur efficacité et montrant un Hemingway pour qui l'idée de l`échec est inévitable et le néant tout-puissant. "Un endroit propre et bien éclairé" (A Clean, Well-Lighted Place) est considéré comme la nouvelle la plus révélatrice du recueil. On la retrouve parmi les nouvelles réunies sous le titre de "L'Education européennes de Nick Adams" dans l'intégrale des éditions Gallimard avec une traduction de Henri Robillot...
"A Clean, Well-Lighted Place" ("Un endroit propre et bien éclairé")
"IL était tard et il ne restait plus dans le café qu'un vieil homme assis à l'ombre d'un arbre. Au milieu de la journée, la rue était pleine de poussière, mais le soir, la rosée rabattait la poussière et le vieillard aimait à s'attarder car il était sourd et d'autant plus sensible au calme de la nuit.
Dans la salle, les deux garçons savaient que le vieux était un peu saoul, et bien qu'il fût bon client, ils savaient que s'il buvait trop, il partirait sans payer. Ils le surveillèrent donc.
"La semaine dernière, il a essayé de se suicider, dit l'un des garçons.
- Pourquoi?
- Par désespoir.
- Pour quelle raison?
- Pour rien.
- Comment sais-tu que c'était pour rien ?
-ll est riche."
Ils étaient assis à une table contre le mur près de la porte du café et regardaient la terrasse aux tables désertes à l'exception de celle où le vieil homme s'était assis, à l'ombre des feuilles doucement agitées par le vent. Une fille et un soldat passèrent dans la rue. La lumière du lampadaire fit scintiller sur son col le numéro de cuivre de son unité. La fille était nu-tête et pressait le pas à ses côtés.
"Il va se faire ramasser par la patrouille, dit un des garçons.
- Qu'est-ce que ça peut faire, s'il obtient ce qu'il veut ?
- Il ferait bien de ne pas rester dans la rue. La patrouille va lui tomber dessus. Y a pas cinq minutes qu'elle est passée. >›
Le vieil homme assis dans l'ombre tapa sur sa soucoupe avec son verre. Le plus jeune des garçons approcha.
"Vous désirez? "
Le vieux leva les yeux sur lui.
"Un autre cognac, dit-il.
- Vous allez être saoul, dit le garçon. Le vieux le regarda fixement. Le garçon s'éloigna.
"Il va passer toute la nuit ici, dit-il à son collègue.
- Je crève de sommeil, moi. J'arrive jamais à me coucher avant trois heures du matin. S'il avait seulement pu se tuer la semaine dernière."
Le garçon prit sur le comptoir du café la bouteille de cognac et une autre soucoupe et se dirigea vers la table du vieux. ll posa la soucoupe et remplit le verre.
"Malheureux que vous ne vous soyez pas tué la semaine dernière ", dit-il. Le vieil homme agita le doigt.
"Encore un petit peu", dit-il. Le garçon remplit le verre et continua à verser; le cognac déborda, coula le long du verre et s'étala dans la dernière soucoupe de la pile.
"Merci bien ", dit le vieux. Le garçon remporta la bouteille et se rassit à côté de son collègue.
"Il est noir, maintenant, dit-il.
- ll est noir tous les soirs.
- Pourquoi a-t-il voulu se tuer ?
- Je n'en sais rien, moi.
- Comment a-t-il fait ?
- Il s'est pendu avec une corde.
- Qui l'a dépendu ?
- Sa nièce.
- Pourquoi ont-ils fait ça ?
- Pour sauver son âme.
- Il est riche ?
- Tu parles.
- Il doit avoir près de quatre-vingts ans.
- En tout cas, il les porte bien.
- Quand va-t-il se décider à rentrer chez lui. Jamais je ne me couche avant trois heures du matin. C'est pas une heure pour se mettre au lit.
- S'il reste là, c'est qu'il s'y trouve bien.
- Il s'ennuie. Pas moi. Moi, j'ai une femme qui m'attend dans mon lit.
- Lui aussi, il avait une femme.
- A quoi une femme lui servirait-elle, maintenant ?
- On ne sait jamais. Ça lui ferait peut-être beaucoup de bien.
- Il a sa nièce pour s'occuper de lui.
- Je sais. Tu m'as dit qu'elle l'avait dépendu.
- Ça ne me plairait pas de devenir aussi vieux. Un vieux, c'est répugnant.
- Pas toujours. ll est propre, ce vieux-là. Il boit sans renverser une goutte. Même quand il est saoul. Regarde-le.
- Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est qu'il rentre chez lui. ll se fout pas mal des types qui travaillent. "
Le vieil homme leva le nez de son verre, regarda vers la place, puis se retourna vers les garçons.
"Un autre cognac", dit-il en montrant son verre.
Le garçon qui était pressé vint vers lui.
"Fini, dit-il en négligeant volontairement la syntaxe comme le font les imbéciles en s'adressant aux ivrognes ou aux étrangers. Plus rien ce soir. Fermé maintenant.
- Un autre", répéta le vieil homme.
Le garçon essuya le bord de la table avec son torchon en secouant la tête.
"Non. Fini", dit-il.
Le vieil homme se leva, compta lentement les soucoupes, tira de sa poche une bourse de cuir et paya, laissant une demi-peseta de pourboire.
Le garçon regarda s'éloigner le long de la rue le vieillard à la démarche incertaine, mais digne.
"Pourquoi ne l'as-tu pas laissé rester", demanda le garçon qui avait tout son temps. Ils étaient en train de baisser les rideaux de fer. "Il n'est même pas deux heures et demie.
- Je veux aller me coucher.
- Une heure de plus ou de moins, est-ce que ça compte ?
- Plus pour moi que pour lui.
- Une heure, c'est toujours une heure.
- Tu parles comme un vieux toi-même. Il n'a qu'à se payer une bouteille et boire chez lui.
- Ce n'est pas la même chose.
- Non, évidemment, admit le garçon marié. Il ne voulait pas être injuste. ll était seulement pressé.
"Et toi? Tu n'as pas peur de rentrer chez toi plus tôt que d'habitude?
..."
"Un endroit propre et bien éclairé" (A Clean, Well-Lighted Place) - On a vu dans cette nouvelle, exprimée à travers les pensées et les paroles d’un serveur de café espagnol d’âge moyen, toute la philosophie existentielle d'Hemingway, une existence dénuée de sens qui nous conduit inévitablement à la mort, et plus on vieillit, plus ces vérités deviennent claires, au moins peut-on tenter, malgré l'inéluctable, d’imposer n’importe quel ordre sa vie, ou de la maintenir à flot par n’importe quelle sorte de positivité possible...
Deux serveurs dans un café en Espagne veillent sur leur dernier client de la soirée, un vieil habitué du café et des boissons à l’excès. Ils discutent du fait qu’il a essayé de se suicider la semaine précédente, puis en viennent à se disputer, le plus jeune des serveurs est impatient de fermer le café et de rentrer chez lui retrouver sa femme, le plus âgé défend le vieil habitué, s'il reste si tard au café tous les soirs c'est parce qu’il n’a personne qui l'attend chez lui. Le jeune serveur refuse de servir à nouveau le vieux client, qui paie et s’en va. Le plus âgé des serveurs regrette ce départ et avoue qu'l hésite toujours à fermer le café, le soir, parce que quelqu’un peut «avoir besoin», parce qu’il est propre et bien éclairé .Les deux serveurs se séparent, le plus jeune rentre chez lui, le plus âgé se rend dans un bar et s'abandonne à une série de réflexions introspectives, révélant que chaque soir il affronte sa solitude, et qu'il sent la présence d’un grand vide, d’un néant dont il a peur. La vie, dit-il, est un grand rien et un homme est un rien, Dieu, sous-entend-il, n’est rien, et le voici récitant une prière et sa litanie du "nada".
"..
- Je suis de ceux qui aiment bien rester tard au café, reprit le plus âge, de ceux qui n'ont pas envie d'aller se coucher et qui ont besoin de lumière la nuit.
- Moi je veux rentrer en vitesse et me fourrer au lit.
- Nous ne sommes pas de la même espèce, dit le vieux garçon. ll était eu train de s'habiller pour partir. "Ce n'est pas seulement une question de jeunesse et de confiance - bien que ce soient deux très belles choses. Mais toutes les nuits, j'hésite à fermer en pensant un au client qui pourrait espérer trouver le café ouvert.
- Hombre, il y a des bodegas ouvertes toute la nuit.
- Tu ne comprends pas. Le café-ci est propre, agréable et bien éclairé. La lumière est jolie, sans parler de l'ombre des feuilles.
- Bonsoir, dit le plus jeune.
- Bonsoir, fit l'autre.
En éteignant l'électricíté, il continuait à marmonner tout seul.
"Bien entendu, c'est la question de la lumière, mais il faut aussi que l'endroit soit propre et agréable. Pas besoin de musique. Pour ça, il est certain qu'on n'a pas besoin de musique. Et il est impossible de conserver sa dignité en restant planté devant un bar, bien qu'il n'y ait plus d'autres endroits ouverts à ces heures-là."
Que craignait-il donc ? Il ne s'agissait ni de crainte ni de peur, mais de ce rien qu'il ne connaissait que trop bien. Car tout était rien, vide et l'homme aussi était du vide. Ce n'était que cela et pas autre chose et la lumière était tout ce qu'il lui fallait, plus un minimum d'ordre et de propreté. Quelques-uns vivaient dedans sans s'en apercevoir, mais il savait que tout n'était que "nada y pues nada y nada y pues nada" (néant et puis néant). "Notre nada qui êtes au nada, que votre nom soit nada, que votre règne nada, que votre volonté soit nada sur le nada comme au nada. Donnez-nous aujourd'hui notre nada quotidien..."
Ce dont il a besoin, dit-il, c’est de lumière, de propreté et d’ordre, un environnement comme le café où il travaille, pour traverser chaque jour. Il se promène et se rend compte à nouveau que son café lui manque et sait qu’il aura de la difficulté à s’endormir. Peut-être sa dépression n'est-elle due qu’à l’insomnie. Il parvient enfin à s'étendre sans plus de réflexion. "Cela arrive à bien des gens". ..

1935 - Vertes collines d'Afrique (Green Hills of Africa)
"Ecrire aussi bien que je peux et apprendre tout en vivant" - Non pas roman, mais récit d'une expédition de chasse en Afrique noire au long duquel Hemingway nous dit avoir "essayé d'écrire un livre absolument sincère pour voir si l'aspect d'un pays et un exemple de l'activité d'un mois pouvaient, s'ils sont représentés sincèrement, rivaliser avec une œuvre d'imagination". L'auteur nous fait ainsi assister à ses randonnées à travers la brousse en compagnie de sa femme, d'un guide professionnel, Jackson Phillips dit Pop et de quelques guides et porteurs indigènes dont Droopy, M'Cola et Cham. À côté de pages célébrant l'exaltation de la chasse et la beauté des paysages africains, se mêlent dialogues de l'auteur avec ses compagnons ou avec des gens de rencontre et réflexions sur la nature, la vie, la mort. Il s'agit bien de rechercher ce "présent perpétuel", cette réconciliation de l'éphémère et de l'éternel qui peut surgir, par exemple, au détour d'un affût et de cette extase de sensations qu'il produit. L'auteur s'est refusé à inventer une intrigue et à y intégrer des épisodes mélodramatiques, et pour autant réussit à tenir l'attention de son lecteur au gré de quatre parties, "poursuite et conversation", "la poursuite remémorée", "poursuite et échec", et "poursuite, ce bonheur", une poursuite qui a pour ultime objet, dès le début du livre, l'antilope koudou que le chasseur a en vain recherchée pendant dix jours et qu'en raison de la saison des pluies imminente il n'a plus que trois jours pour atteindre. Le chapitre XII sur lequel s'ouvre la dernière partie du récit est savamment amené pour constituer le point culminant et nous ramener sur terre ...
"La route n'était qu'une piste et la plaine avait un aspect très décourageant. Nous vîmes au passage quelques sveltes gazelles de Grant blanches sur le jaune brûlé de l'herbe et sur les arbres gris. Ma joie s'évanouissait devant l'étendue de cette plaine, caractéristique de la région pauvre en gibier, et tout commença à paraître très impossible et romanesque et entièrement faux. Le Wanderobo avait une très forte odeur et je regardais la façon dont les lobes de ses oreilles étaient distendus et puis soigneusement repliés sur eux-mêmes et son visage étrange, peu négroïde, aux lèvres minces. Quand il me vit examiner son visage, il sourit aimablement et se gratta la poitrine. Je me tournai pour regarder dans le fond de la voiture. M'Cola dormait. Talma était assis tout droit, exagérant son air éveillé, et le vieux essayait de voir la route.
Maintenant il n'y avait plus de route, une simple piste de bétail, mais nous arrivions au bord de la plaine. Puis la plaine fut derrière nous et devant il y avait de grands arbres et nous entrâmes dans le plus joli pays que j'aie vu en Afrique. L'herbe était verte et égale, courte comme une prairie qui a été tondue et vient de repousser et les arbres étaient grands, avec des branches hautes, vieux sans végétation dessous mais seulement le vert égal de l'herbe comme dans un parc aux cerfs et nous roulions dans la pénombre tachée de soleil, en suivant une piste vague indiquée par le Wanderobo. Je ne pouvais pas croire que nous fussions soudain arrivés dans un pays aussi merveilleux. C'était un pays qui ressemblait à un rêve, qu'on est heureux en se réveillant d'avoir rêvé et, pour voir s'il allait disparaître, je tendis la main et touchai l'oreille du Wanderobo. Il sursauta et Kamau eut un ricanement. M'Cola me donna un coup de coude et fit un geste et là, debout dans un espace à découvert entre les arbres, la tête levée, nous fixant, les poils de son dos hérissés, avec de longues cornes blanches, épaisses, recourbées, les yeux très brillants, ll y avait un très grand phacochère qui nous regardait à moins de vingt mètres. Je fis signe à Kamau d'arrêter et nous restâmes là à le regarder, tandis qu'il nous regardait. Je levai ma carabine et visai sa poitrine. Il regarda et ne bougea pas. Alors je fis signe à Kamau de remettre le contact et nous continuâmes et décrivîmes une courbe sur la gauche et laissâmes le phacochère qui n'avait pas fait un geste, ni donné de signes de frayeur en nous voyant.
Je voyais que Kamau était très excité et, quand je me retournai, M'Cola hochait la tête de bas en haut pour montrer son approbation. Aucun de nous n'avait jamais vu un phacochère qui ne prenne la fuite, dans un trot rapide, la queue en l'air. C'était une région vierge, une poche qui n'avait pas été explorée dans ces millions de kilomètres de cette foutue Afrique. J'étais prêt à m'arrêter et à dresser le camp n'importe où.
C'était le plus beau pays que j'aie vu, mais nous continuâmes notre route, à travers les grands arbres sur le sol mollement ondulé. Puis, en avant et sur la droite, nous vîmes la haute palissade d'un village masaï. C'était un très grand village et il en sortait en courant des hommes bruns, aux longues jambes, aux gestes souples qui semblaient tous être du même âge et portaient leurs cheveux tresses en une sorte de lourde queue en forme de massue qui battait leurs épaules pendant qu'ils couraient. Ils atteignirent la voiture et l'entourèrent, tous riant, souriant et parlant. Ils étaient tous grands, leurs dents blanches et saines, et leurs cheveux étaient teints en brun rouge et disposés en frange bouclée sur leur front. Ils portaient des lances et ils étaient très beaux et extrêmement gais, ni maussades ni méprisants comme les Masaïs du Nord et ils désiraient savoir ce que nous venions faire. Le Wanderobo leur dit évidemment que nous chassions le koudou et étions très pressés. Ils avaient entouré l'auto de sorte que nous ne pouvions pas bouger. L'un dit quelque chose et trois ou quatre autres se joignirent à lui et Kamau m'expliqua qu'ils avaient vu deux koudous mâles suivre la piste dans l'après-midi.
"Cela ne peut être vrai, me dis-je en moi-même. C'est impossible."
Je dis à Kamau de partir et nous les poussâmes lentement, tandis qu'ils riaient et essayaient d'arrêter l'auto, presque au risque de se faire écraser. C'étaient les gens les plus grands, les plus beaux, les mieux bâtis que j'eusse jamais vus et les seuls êtres vraiment heureux et gais que j'eusse vus en Afrique. Finalement, pendant que nous avancions, ils se mirent à courir à côté de l'auto, souriant et riant et nous montrant avec quelle facilité ils couraient et puis, comme la route devenait meilleure, en remontant la pente lisse d'un cours d'eau, cela devint une compétition et l'un après l'autre ils abandonnèrent la course, agitant les bras et souriant quand ils nous quittaient jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que deux qui courussent avec nous, les meilleurs coureurs de la bande qui suivaient facilement l'allure de l'auto en avançant avec leurs longues jambes, aisément, souplement et avec fierté.
Ils couraient à l'allure d'un coureur de vitesse, portant aussi leur lance. Puis il nous fallut tourner à droite et sortir de l'herbe de la vallée unie comme celle d'un boulingrin, pour monter dans une prairie ondulée et, comme nous ralentissions, passant en première, toute la bande nous rattrapa, riant et s'efforçant de ne pas paraître essoufflée. Nous traversâmes des broussailles et un petit lapin déboucha, zigzaguant follement avec tous les Masaïs lancés derrière dans une course effrénée. Ils attrapèrent le lapin et le plus grand coureur l'apporta à la voiture et me le tendit. je le tenais et pouvais sentir les battements de son cœur à travers son corps chaud, doux, couvert de fourrure et, tandis que je le caressais, le Masai me tapota le bras. Le tenant par les oreilles je le lui rendis. Non, non, il était à moi. C'était un cadeau.. Je le tendis à M'Cola. M'Cola ne le prit pas au sérieux et le remit à un des Masaïs. Nous étions en marche et ils couraient de nouveau maintenant. Le Masai se baissa et posa le lapin par terre et, comme il s'échappait, libre, ils se mirent tous à rire. M'Cola secoua la tête. Nous étions tous très frappés par ces Masaïs.
"Bons Masaïs, dit M'Cola très ému. Masaïs beaucoup bétail. Masaïs pas tuer pour manger. Masaïs tuer hommes."
Le Wanderobo se tapota la poitrine.
"Wanderobo, Masaï", dit-il très fièrement, revendiquant une parenté. Ses oreilles étaient retroussées de la même manière que les leurs. Les voir courir et si fichtrement beaux et si heureux nous rendait tous heureux. Je n'avais jamais vu une amitié aussi spontanée et aussi
désintéressée, ni des êtres d'aussi bel aspect.
"Bons Masaïs, répéta M'Cola, hochant la tête avec insistance. Bons, bons Masaïs." Seul Talma paraissait ressentir des émotions différentes. Malgré ses vêtements kaki et sa lettre de B'wana Simba, je crois que ces Masaïs effrayaient quelque chose de très vieux en lui. Ils étaient nos amis, pas les siens. Pourtant, ils étaient certainement nos amis. Ils avaient cette attitude qui fait les frères, cette conviction inexprimée mais instantanée et totale que vous devez être masaï d'où que vous veniez. On trouve cette attitude seulement chez les meilleurs Anglais, les meilleurs Hongrois et les meilleurs Espagnols; c'est la chose qui était jadis la preuve la plus évidente de la noblesse quand la noblesse existait. C'est une attitude ignorante et les gens qui l'observent ne survivent pas, mais il vous arrive très peu de choses plus agréables que de la rencontrer.
Et maintenant il ne restait plus de nouveau que deux d'entre eux qui couraient et ils avaient du mal, la machine les battait. Ils couraient encore bien et en souplesse et à longues enjambées, mais la machine était un cruel entraîneur. Aussi dis-je à Kamau d'accélérer et d'en finir, parce qu'une brusque augmentation de la vitesse n'était pas aussi humiliante qu'un épuisement régulier. Ils coururent, furent battus, rirent et puis nous nous penchâmes,
faisant des signes, et ils étaient là, appuyés sur leur lance et agitant la main. Nous étions encore amis, mais maintenant nous étions seuls de nouveau et il n'y avait pas de piste, simplement la direction générale à suivre en contournant des bouquets d'arbres et en longeant cette vallée verte.
Un peu plus tard, les arbres devinrent plus serrés et nous laissâmes derrière nous cette région idyllique et cherchions maintenant notre chemin le long d'une piste vague à travers des fourrés épais. Quelquefois nous arrivions à un point mort et devions descendre et ôter un tronc du passage ou couper un arbre qui bloquait la carrosserie. Quelquefois, il nous fallait sortir à reculons des broussailles et chercher le moyen de contourner l'obstacle pour revenir sur la piste, nous frayant un passage avec ces longs couteaux a couper les broussailles qui s'appellent "pangas". Le Wanderobo était un bûcheron pitoyable et Talma ne valait guère mieux. M'Cola faisait bien tout ce qui nécessitait l'emploi d'un couteau et il balançait la panga avec un coup rapide et pourtant fort et vengeur. Je m'en servais très mal. C'était trop une question de poignet pour qu'on pût apprendre vite; votre poignet fatiguait et la lame semblait avoir un poids qu'elle n'avait pas. Je regrettais de ne pas avoir une de ces haches à double tranchant du Michigan, aiguisée comme un rasoir, pour pouvoir tailler les lianes au lieu de sabrer ainsi les arbres.
Nous frayant ainsi un passage quand nous étions arrêtés, évitant tout ce que nous pouvions, Kamau conduisant avec intelligence et un profond sentiment du pays, nous sortîmes de la région difficile et entrâmes dans une autre étendue de prairies à découvert et vîmes une chaîne de collines à notre droite. Mais là, il avait beaucoup plu dernièrement et il nous fallait faire très attention aux parties en contrebas de la prairie, là où les pneus s'enfonçaient dans l'herbe et glissaient et patinaient dans la boue gluante. Nous coupâmes les broussailles et nous servîmes de la pelle deux fois et puis, ayant appris à nous méfier des bas-fonds; nous regagnâmes la partie haute de la prairie et rentrâmes dans les bois.
Comme nous en sortions, après avoir décrit (plusieurs grands cercles dans la forêt pour trouver des endroits par où nous pourrions faire passer la voiture, nous nous trouvâmes sur la berge d'un ruisseau où il y avait une sorte de pont de broussailles en travers du lit du cours d'eau construit comme une digue de castor et évidemment destiné à contenir l'eau. De l'autre côté, se trouvait un champ de blé entouré d'une haie d'épines, une berge abrupte, jonchée de souches d'arbres, avec du maïs planté partout dessus et des corrals d'aspect abandonné ou des enclos entourés d'une haie épineuse avec des constructions de boue et de branches et, sur la droite, se trouvaient des huttes d'herbe en forme de cônes qui dépassaient une épaisse haie d'épines. Nous descendîmes tous, car ce ruisseau était un problème ..."
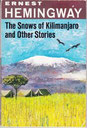
1936 - Les Neiges du Kilimandjaro (The Snows of Kilimanjaro)
Harry, l'écrivain raté, le chasseur moribond qui n'atteindra jamais les neiges sacrées du Kilimandjaro, marque un tournant de l'œuvre de Hemingway. Les années folles sont mortes avec le krach économique de 1929. La génération perdue rentre d'exil et s'engage dans la politique. Comme Dos Passos, Caldwell et Steinbeck, Hemingway semble un moment séduit par le socialisme. En 1935, il fait un grand reportage pour la revue communiste New Masses.
A partir de 1936 et de la publication d'En avoir ou pas, Hemingway abandonne anarchisme et désespoir pour se préoccuper de justice et d'engagement social: il ne publiera plus désormais que quatre nouvelles dont deux. "Les Neiges du Kilimandjaro" (The Snows of Kilimandjaro) et "L'Heure triomphale de Francis Macomber" (The Short, Happy Life of Francis Macomber) vont lui permettre d'acquérir une grande notoriété.
Dans "Les Neiges du Kilimandjaro", le personnage principal est un écrivain américain, Harry. Au cours d'une expédition de chasse en Afrique, il s'est blessé à la jambe, et la gangrène s'est déclarée, foudroyante. À travers son délire, Harry pense à toutes les histoires qu`il n`a pas écrites et qui auraient fait de lui autre chose qu'un écrivain raté. La mort est proche et il
le sait. Il rêve alors que l'avion qui doit le sauver est arrivé, mais cet avion, au lieu de se diriger vers la ville, vole tout droit vers l'immense et fascinante masse blanche du Kilimandjaro. Harry comprend soudain que cette blancheur est son but. Relativement long, ce récit est mené avec une économie de moyens et une puissance ramassée qui lui confèrent une tension tragique digne des grandes oeuvres.
THE MARVELLOUS THING IS THAT IT’S painless," he said. "That's how you know when it starts."
"Is it really?"
"Absolutely. I'm awfully sorry about the odor though. That must bother you."
"Don't! Please don't."
"Look at them," he said. "Now is it sight or is it scent that brings them like that?"
The cot the man lay on was in the wide shade of a mimosa tree and as he looked out past the shade onto the glare of the plain there were three of the big birds squatted obscenely, while in the sky a dozen more sailed, making quick-moving shadows as they passed.
"They've been there since the day the truck broke down," he said. "Today's the first time any have lit on the ground. I watched the way they sailed very carefully at first in case I ever wanted to use them in a story. That's funny now.""I wish you wouldn't," she said.
"I'm only talking," he said. "It's much easier if I talk. But I don't want to bother you."
"You know it doesn't bother me," she said. "It's that I've gotten so very nervous not being able to do anything. I think we might make it as easy as we can until the plane comes."
"Or until the plane doesn't come."
"Please tell me what I can do. There must be something I can do.
"You can take the leg off and that might stop it, though I doubt it. Or you can shoot me. You're a good shot now. I taught you to shoot, didn't I?"
"Please don't talk that way. Couldn't I read to you?"
"Read what?"
"Anything in the book that we haven't read."
"I can't listen to it," he said." Talking is the easiest. We quarrel and that makes the time pass."
"I don't quarrel. I never want to quarrel. Let's not quarrel any more. No matter how nervous we get. Maybe they will be back with another truck today. Maybe the plane will come."
"I don't want to move," the man said. "There is no sense in moving now except to make it easier for you."
"That's cowardly."
"Can't you let a man die as comfortably as he can without calling him names? What's the use of clanging me?"
"You're not going to die."
"Don't be silly. I'm dying now. Ask those bastards." He looked over to where the huge, filthy birds sat, their naked heads sunk in the hunched feathers. A fourth planed down, to run quick-legged and then waddle slowly toward the others.
"They are around every camp. You never notice them. You can't die if you don't give up."
"Where did you read that? You're such a bloody fool."
"You might think about some one else."
"For Christ's sake," he said, "that's been my trade."
He lay then and was quiet for a while and looked across the heat shimmer of the plain to the edge of the bush. There were a few Tommies that showed minute and white against the yellow and, far off, he saw a herd of zebra, white against the green of the bush. This was a pleasant camp under big trees against a hill, with good water, and close by, a nearly dry water hole where sand grouse flighted in the mornings....
(I) "Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas douloureux, dit-il. C'est à cela qu'on sait que ça commence.
- Vraiment ?
- Absolument. je suis désolé pour l'odeur pourtant. Ça doit te gêner ?
- Cesse! Je t'en prie, cesse.
- Regarde-les, dit-il. On se demande si c'est la vue ou l'odeur qui les attire comme cela."
Le lit de camp sur lequel l'homme était allongé se trouvait dans la grande ombre d'un acacia et comme son regard passait de l'ombre à la clarté aveuglante de la plaine, trois des oiseaux se tenaient accroupis, obscènes à voir; une douzaine d'autres planaient dans le ciel, plaquant des ombres rapides quand ils passaient.
"Ils sont là depuis le jour où la camionnette est tombée en panne, dit-il. C'est aujourd'hui la première fois que j'en vois un se poser à terre. Au début, j'avais soigneusement étudié leur vol, au cas où l'envie aurait pu me prendre de les utiliser dans une nouvelle. C'est drôle,
maintenant.
- Je voudrais bien que tu cesses.
- Ce que j'en dis, c'est pour parler, dit-il. Cela me soulage de parler. Mais je ne voudrais pas t'ennuyer.
- Tu sais très bien que cela ne m'ennuie pas, dit-elle. C'est seulement que cela m'a rendue terriblement irritable de ne pouvoir rien faire. je crois que nous devrions nous arranger pour aplanir les choses, jusqu'à ce que l'avion arrive.
- Ou jusqu'à ce que l'avion n'arrive pas.
- Dis-moi ce que je peux faire, je t'en prie. Il y a bien quelque chose que je dois pouvoir faire.
- Tu peux enlever la jambe et peut-être que ça s'arrêtera, bien que j'en doute. Ou tu peux m'abattre. Tu tires bien maintenant. Je t'ai appris à tirer, n'est-ce pas?
- Ne parle pas comme cela, je t'en prie. Tu ne veux pas que je te fasse la lecture?
- La lecture de quoi ?
- N'importe quoi que nous n'ayons pas encore lu, dans le sac à livres.
- Je ne pourrais pas écouter, dit-il. Parler c'est ce qu'il y a de plus facile. Nous nous disputons et cela fait passer le temps.
- Je ne me dispute pas. Jamais je n'ai envie de me disputer. Ne nous disputons plus. Quel que soit l'état de nos nerfs. Peut-être vont-ils revenir avec une autre camionnette aujourd'hui. Peut-être l'avion va-t-il s'amener.
- Je n'ai pas envie de bouger, dit l'homme. Cela ne rime à rien de déménager maintenant, sauf pour que cela te soit moins pénible. .
- C'est lâche.
- Tu ne peux donc pas laisser un homme mourir aussi tranquillement qu'il le peut, sans l'engueuler? A quoi bon m'engueuler ? .
- Tu ne vas pas mourir.
- Ne dis pas de bêtises. Je suis en train de mourir. Demande à ces salauds-là."
Il leva les yeux vers l'endroit où les oiseaux énormes et répugnants étaient assis, leur tête chauve enfouie dans l'engoncement des plumes. Un quatrième descendit en planant, courut d'abord à petits pas rapides, puis s'approcha lentement des autres en se dandinant.
"Il y en a autour de tous les camps. On n'y fait jamais attention. On ne peut pas mourir si on ne se laisse pas aller.
- Où as-tu lu cela ? Quelle fichue idiote tu fais.
- Tu pourrais penser à quelqu'un d'autre.
- Oh! bon Dieu! dit-il. Ça été mon métier."
Ensuite il s'allongea et se tut un moment, regardant la lisière de la brousse, par-delà le miroitement de la chaleur sur la plaine. Il y avait quelques tommies qui se détachaient minuscules et blancs sur le jaune et, très loin, il aperçut un troupeau de zèbres, blanc contre le vert de la brousse. C'était un campement agréable que celui-là, planté sous de grands arbres, contre une colline, avec de l'eau potable et, tout près, un trou d'eau presque tari où les gangas des sables volaient le matin.
"Tu n'aimerais pas que je te fasse la lecture?" demanda-t-elle.
Elle était assise sur un fauteuil de toile, à côté de son lit de camp. "Voilà le vent qui se lève.
- Non, merci.
- La camionnette va peut-être venir.
- Je me fous éperdument de la camionnette.
- Moi pas.
- Il y a tellement de choses dont tu ne te fous pas, et dont je me fous.
- Pas tellement, Harry. ,
- On peut boire un coup?
- C'est censé être mauvais pour toi. Il est dit dans le Black d'éviter tous les alcools. Tu ne devrais pas boire.
- Molo! cria-t-il.
- Oui, B'wana.
- Tu as tort, dit-elle. C'est cela que je veux dire quand je parle de se laisser aller. On te dit que cela te fait du mal. Je sais que cela te fait du mal.
- Non, dit-il. Ça me fait du bien."
Alors c'était fini, maintenant, pensait-il. Il n'aurait plus jamais l'occasion de terminer ça maintenant. C'était donc ainsi que cela finissait, par des chicanes à propos d'un verre. Depuis que la gangrène s'était mise dans sa jambe droite, il ne souffrait plus, et avec la souffrance
l'horreur était partie et tout ce qu'il ressentait à présent c'était une grande fatigue et de la colère à l'idée que c'était là la fin. A l'égard de ceci qui maintenant allait venir, il n'éprouvait que peu de curiosité. Pendant des années, cela l'avait obsédé, mais maintenant la chose en
soi n'avait plus de signification. C'était bizarre comme cela aidait d'être suffisamment fatigué.
Maintenant, jamais il n'écrirait les choses qu'il avait gardées pour les écrire lorsqu'il en saurait assez pour les écrire bien. En tout cas, cela lui éviterait d'échouer dans sa tentative. Peut-être n'arrivera-t-on jamais à les écrire, et peut-être était-ce pour cela qu'on les remettait à plus tard et qu'on ne pouvait pas se résoudre à commencer. Eh bien, il ne le saurais jamais, maintenant..."
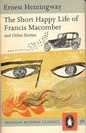
Chasses en Afrique, nouvelles...
"L'Heure triomphale de Francis Macomber" (The Short, Happy Life of Francis Macomber) est une nouvelle qui a également pour cadre une chasse en Afrique. Francis Macomber a connu au cours d'un safari son heure de gloire. Après avoir eu peur toute une journée en chassant un lion, "suant des aisselles, la bouche sèche, une sensation de vide au creux de l'estomac", et s'être enfui "comme un lapin" devant un fauve blessé qui fonçait sur lui, il va sentir brusquement le lendemain sa peur le quitter. Quelque chose s'est passé en lui, "comme une digue qui aurait crevé". Cette fois-ci, lorsqu'un buffle le charge, il ne bouge pas d'un pouce et attend pour l'abattre que la tête de la bête soit à quelques centimètres de sa poitrine. Sa femme, possessive et dominatrice, qui comptait utiliser la lâcheté de son mari pour le soumettre totalement à sa volonté, et avait commencé, le soir même, en partageant le lit de leur compagnon de chasse. Wilson, fera sembler de tirer sur la bête qui le menace, et lui tirera une balle dans la tête...
En 1938, Hemingway retourne en Espagne, les "rebelles" sont passés à l'offensive, il arrive à Barcelone pour voir le flot des réfugiés, assiste à Tortosa aux bombardements de la route vers Valence, visite Lerida que les rebelles tentent alors de prendre, nous sommes en avril, il n'y retournera qu'à la fin du mois d'août pour assister à la défaite des républicains sur l'Ebre. A la fin de novembre 1938, alors qu'il a publié à New York "To Have and have not", la guerre d'Espagne va s'achever au profit des fascistes. "Pour qui sonne le glas" sera publié en 1940, entretemps Hemingway aura séjourné entre Key West et La Havane, à l'hôtel Ambos Mundos où vient lui rendre visite Martha Gellhorn (1908-1998), correspondante de guerre et romancière, "a cocky, raspy-voiced maverick who saw herself as a champion of ordinary people trapped in conflicts created by the rich and powerful" (New-York Times) célèbre notamment pour son mariage avec avec Ernest Hemingway, de 1940 à 1945..

1940 - Pour qui sonne le glas (For whom the Bell tolls)
"How little we know of what there is to know. I wish that I were going to live a long time instead of going to die today because I have learned much about life in these four days; more, I think than in all other time. I’d like to be an old man to really know. I wonder if you keep on learning or if there is only a certain amount each man can understand. I thought I knew so many things that I know nothing of. I wish there was more time." - Le titre du roman est tiré d'un poème de John Donne exprimant la solidarité universelle. On y a vu la somme de l'idéalisme des intellectuels des années trente et de leur besoin d'engagement et de rachat. C'est aussi le premier grand succès populaire de son auteur qui, justement, tentait de se racheter de son ancienne réputation de cynisme.
Le héros Robert Jordan, professeur américain, s'engage dans un maquis républicain de la région de Ségovie, par idéal antifasciste. On l'a chargé de faire sauter un pont stratégique. Ce maquis est domine par la figure de Pilar, incarnation de I`Espagne et de sa volonté de liberté. Les hommes : Pablo, mari de Pilar, Augustin, Fernando. le Gitan, Rafael et Andrès sont des personnages secondaires. Mais il y a aussi Maria. une jeune fille que Pilar a sauvée après qu'elle eut été violée par les franquistes. Jordan partage la vie du maquis et tombe amoureux de Maria. La mort plane. Pilar, Jordan et Maria la sentent toute proche. Il leur faut donc vivre en quelques jours toute leur vie. Hemingway tire de leur proximité une intensité bouleversante. Les franquistes attaquent et déciment le maquis voisin, et Jordan comprend que faire sauter le pont ne servira plus à rien, toutefois l`état-major décide l'offensive. Jordan accomplit sa mission mais se casse une jambe au cours de l'opération. Il ordonne aux autres de fuir et reste seul à la lisière de la forêt, attendant l'ennemi, acceptant une mort qui servira peut-être à quelque chose. On hésite parfois entre lyrisme, romantisme sentimental, sentiment d'absurdité : sous les apparences de l'engagement, les erreurs des anarchistes, l'incompétence de l'état-major républicain, les rivalités des chefs des brigades internationales – en particulier André Marty, caricaturé sous le nom de Massart – font de la mort du héros un sacrifice inutile....
"... Parce que, maintenant, Robert Jordan n'était plus là. Il marchait à côté d'elle, mais son esprit était occupé par le problème du pont; tout était clair, dur et net comme lorsque l'objectif d'un appareil photographique est mis au point. Il voyait les deux postes et Anselmo et le Gitan qui veillaient. Il voyait la route vide et la voyait peuplée. Il voyait où il placerait les deux armes automatiques pour obtenir le meilleur champ de tir. Et qui les servira ? Moi, à la fin, songea-t-il, mais qui pour commencer ? Il plaçait les charges, les équilibrait et les attachait, déroulait ses fils, les accrochait et revenait à l'endroit où il avait placé la vieille boîte du détonateur; puis il se mit à penser à tout ce qui pourrait survenir, à tout ce qui pourrait aller de travers. Suffit, se dit-il. Tu as fait l'amour avec cette fille, et maintenant tu as la tête claire, bien claire et tu te mets à t'inquiéter. On peut réfléchir sans s'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Tu sais tout ce que tu peux avoir à faire, et tu sais ce qui peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver.
Tu t'es lancé en sachant pourquoi tu te battais. On se bat et on fait ce qu'il faut faire pour avoir une chance de gagner.
C'est ainsi que Robert Jordan était obligé maintenant d'employer ces gens qu'il aimait, comme on emploie des soldats envers lesquels, si l'on veut réussir, il ne faut éprouver aucun sentiment. Pablo était évidemment le plus intelligent de tous. Il avait immédiatement compris combien l'affaire était mauvaise. La femme avait été entièrement favorable à l'entreprise, elle l'était encore, mais elle avait pris peu à peu conscience de ce qu'elle impliquait véritablement et cela l'avait déjà beaucoup changée. Sordo avait compris tout de suite, et il ferait ce qu'il faudrait, mais sans plus d'enthousiasme que Robert Jordan lui-même.
Alors, songeait-il, tu dis que ce n'est pas ce qui t'arrivera à toi, mais ce qui peut arriver à la femme et à la jeune fille et aux autres, qui te préoccupe ? Soit. Qu'est-ce qui leur serait arrivé si tu n'étais pas venu ? Qu'est-ce qui leur arrivait avant que tu sois là ? Il ne faut pas penser à ça. Tu n'es pas responsable d'eux dans l'action. Les ordres ne viennent pas de toi. Ils viennent de Golz. Et qui est Golz? Un bon général. Le meilleur sous lequel tu aies jamais servi. Mais un homme doit-il exécuter des ordres impossibles en sachant à quoi ils mènent? Même s'ils émanent de Golz qui est le parti en même temps que l'armée? Oui. Il devait les exécuter, parce que c'était seulement en les exécutant qu'on pourrait prouver leur impossibilité. Comment savoir, tant qu'on n'avait pas essayé ? Si chacun se mettait à dire que les ordres étaient impossibles à exécuter au moment où on les recevait, où irait-on? Où irions-nous tous, si on se contentait de dire "impossible", en recevant des ordres ?
Il en avait vu, des chefs pour lesquels tous les ordres étaient impossibles. Ce salaud de Gomez en Estrémadure. Il avait vu assez d'attaques où les flancs n'avançaient pas, parce qu'avancer était impossible. Non, il exécuterait les ordres, mais c'était malheureux d'aimer les gens avec qui il fallait travailler.
Avec leur travail, eux, les partisans, apportaient un surcroît de danger et de malchance aux gens qui les abritaient etles aidaient. A quelle fin? Afin que, tout compte fait, le pays fût libéré de tout danger et qu'il y fît bon vivre. C'était vrai, aussi banal que cela pût sembler.
Si la République perdait, il serait impossible pour ceux qui croyaient en elle de vivre en Espagne. Mais était-ce bien sûr ? Oui, il le savait d'après ce qui se passait dans les régions que les fascistes avaient déjà prises.
Pablo était un salaud, mais les autres étaient des gens épatants, et n'était-ce pas les trahir tous que de leur faire faire ce travail? Peut-être. Mais, s'ils ne le faisaient pas, deux escadrons de cavalerie viendraient les chasser de ces montagnes avant une semaine.
Non. Il n'y avait rien à gagner à les laisser tranquilles. Sauf qu'on devrait laisser tout le monde tranquille et ne déranger personne. Alors, tu crois ça, vraiment, se disait-il; tu crois que l'idéal, c'est de laisser tout le monde tranquille ? Oui, il croyait cela. Mais alors, la société organisée et tout le reste ? Ça, c'était le boulot des autres. Lui, il avait autre chose à faire après cette guerre. Il combattait à présent dans cette guerre, parce qu'elle avait commencé dans un pays qu'il aimait, et parce qu'il croyait à la République et que si elle était détruite la vie serait impossible pour tous ces gens qui croyaient en elle. Il était sous le commandement communiste pour la durée des opérations. Ici, en Espagne, c'étaient les communistes qui fournissaient la meilleure discipline, la plus raisonnable et la plus saine pour la poursuite de la guerre. Il acceptait leur commandement pour la durée des opérations parce que, dans la conduite de la guerre, ils étaient le seul parti dont le programme et la discipline lui inspirassent du respect.
Et quelles étaient ses opinions politiques ? Il n'en avait pas pour l'instant. Mais ne raconte ça à personne, songea-t-il. Ne l'avoue jamais. Et qu'est-ce que tu feras après ? Je rentrerai et je gagnerai ma vie a enseigner l'espagnol comme avant, et j'écrirai un livre vrai. J'ai l'impression, songea-t-il, j'ai l'impression que ce sera facile. Il faudrait qu'il parle politique avec Pablo. Il serait sûrement intéressant de connaître son évolution. Le mouvement classique de gauche à droite, probablement; comme le vieux Lerroux! Pablo ressemblait beaucoup à Lerroux. Prieto ne valait pas mieux.
Pablo et Prieto avaient une foi à peu près égale dans la victoire finale. Ils avaient tous une politique de voleurs de chevaux. Lui croyait à la République comme à une forme de gouvernement, mais la République devrait se débarrasser de cette bande de voleurs de chevaux qui l'avaient menée dans l'impasse où elle se trouvait quand la rébellion avait commencé. Y avait-il jamais eu un peuple dont les dirigeants eussent été a ce point ses ennemis?
Ennemis du peuple. Voilà une expression dont il pourrait se dispenser, un cliché qu'il faudrait abandonner. Ça, c'était le résultat d'avoir couché avec Maria. Ses idées politiques étaient devenues, depuis quelque temps, aussi étroites et conformistes que celles d'un vieux bigot, et des expressions comme "ennemis du peuple" lui venaient à l'esprit sans qu'il prit guère la peine de les examiner. Toutes sortes de clichés révolutionnaires et patriotiques. Sa pensée les adoptait sans critique. Certes, ils étaient vrais, mais on s'y habituait trop facilement. Cependant, depuis la nuit dernière et cet après-midi, il avait l'esprit beaucoup plus clair et plus pur à l'égard de ces questions. Drôle de chose que le fanatisme. Pour devenir fanatique, il faut être absolument sûr d'avoir raison, et rien ne vous donne plus cette certitude, ce sentiment d'avoir raison, que la continence. La continence est l'ennemie de l'hérésie.
Cette idée résisterait-elle à l'examen? C'était probablement en vertu d'elle que les communistes accusaient tant les bohèmes. Quand on est saoul ou quand on commet le péché de chair ou d'adultère, on découvre sa propre faillibilité jusque dans ce succédané si variable de la foi des apôtres : la ligne du parti. A bas la bohème, le péché de Maïakovsky.
Mais Maïakovsky était redevenu un saint. Parce qu'il était mort et enterré, bien entendu. Toi aussi, tu te trouveras mort et enterré, un de ces jours, se dit-il. Allez, assez! Pense à Maria.
Maria attaquait puissamment son fanatisme. Jusqu'ici, elle n'avait pas affecté sa résolution, mais il préférait de beaucoup ne pas mourir. Il eût renoncé avec joie à une fin de héros ou de martyr. Il n'aspirait pas aux Thermopyles, il ne désirait être l'Horatius d'aucun pont, ni le petit garçon hollandais, avec son doigt dans le trou de la digue. Non. Il aurait aimé passer quelque temps avec Maria. C'était là l'expression la plus simple de ce qu'il souhaitait. Il aurait aimé passer très longtemps, une éternité avec elle...."

Sam Wood, 1943, "For whom the Bell tolls"
avec Gary Cooper (Robert Jordan), Ingrid Bergman (Maria), Akim Tamiroff (Pablo), Arturo de Córdova (Agustín), Vladimir Sokoloff (Anselmo), Mikhail Rasumny (Rafael), Fortunio Bonanova (Fernando). On a souvent considéré que l'arrière-plan politico-historique a été trop rapidement brossé et que par contre la dimension sentimentale, admirablement interprétée par Gary Cooper et Ingrid Bergman, est une réussite de finesse...

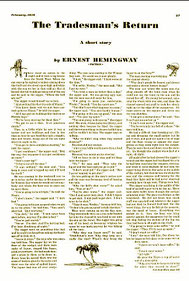
EN AVOIR OU PAS - "L'histoire de la publication de "To Have and Have Not" est relativement compliquée, car ce roman ne prit corps que peu à peu dans l'esprit de Hemingway. Ce n'est qu'après avoir écrit deux nouvelles sur Harry Morgan à plus d'un an d'intervalle qu'il décida de lui consacrer tout un livre et qu'il ajouta, pour faire le poids en quelque sorte, un certain nombre d'épisodes supplémentaires.
La première nouvelle était intitulée "One Trip Across" et fut écrite à Madrid en septembre 1955. Elle fut publiée dans Cosmopolitan en avril 1934. On y voyait Harry Morgan, ancien agent de police de Miami, devenu patron d'un bateau de pêche à Key West, préférer se livrer à a contrebande de l'alcool pour nourrir sa femme et ses filles plutôt que de s'inscrire au chômage. La seconde nouvelle fut écrite à Key West en novembre 1955 et publiée dans Esquire en février 1956 sous le titre de "The Tradesman's Return". Hemingway y racontait comment, au cours d'une de ses expéditions de contrebande, Harry Morgan perdait à la fois un bras et son bateau.
Peu après cela, Hemingway décida d'englober ces deux nouvelles dans un ensemble plus vaste qui lui permettrait, grâce à l'adjonction d'un troisième épisode, d'étudier la mentalité et la tactique des révolutionnaires. Mais là-dessus éclata en juillet 1956 la Guerre civile espagnole. Hemingway, qui avait tant d'amis dans le camp républicain, tenait absolument à aller voir sur place ce qui se passait, mais il voulut auparavant terminer son roman. Il partit donc en août dans le Montana pour travailler à son livre dans l'isolement le plus complet. Au début de novembre, il avait écrit 354 pages. Il retourna à Key West, son travail fini, au début de 1937.
Mais sur l'histoire de Harry Morgan s'était greffée dans l'intervalle l'histoire des malheurs d'un écrivain nommé Richard Gordon que Hemingway voulait raconter parallèlement à l'autre pour donner plus de relief à la virilité de son héros - selon une technique que Faulkner devait utiliser à sa manière quelques années plus tard dans "Wild Palm" (1939). Mais l'harmonisation des deux thèmes causa à Hemingway plus de soucis qu'il n'avait prévu et, lorsqu'il partit pour l'Espagne, le 27 février 1937, il n'avait pas encore résolu tous les problèmes qu'elle posait.
Une fois en Espagne, il fut absorbé par ses taches de journaliste et par la réalisation de son film documentaire sur "la Terre espagnole" (The Spanish Earth). Aussi se demanda-t-il à son retour aux États-Unis en juin s'il ne vaudrait pas mieux publier seulement l'histoire en trois épisodes de Harry Morgan, mais il se laissa tenter par l'idée de publier le tout et relut donc hâtivement les épreuves de son roman sous la forme que nous lui connaissons maintenant entre le 18 juillet et le 7 août. Lorsque le livre parut le 15 octobre 1937, il était déjà de retour en Espagne.
L'histoire quelque peu chaotique de la composition de ce roman explique pourquoi il est si inégal et si peu homogène. Il ne manque pas de puissance cependant, ni d'unité malgré son apparente discontinuité, et il mérite d'être défendu. On peut considérer tout d'abord, ainsi qu'y invite le titre, qu'il est tout entier fondé sur une série de contrastes amèrement ironiques entre ceux qui en ont (et qu'on appelait familièrement "the haves") et ceux qui n'en ont pas ("the have-nots"), entre, d'une part, les exploiteurs capitalistes (Mr Johnson), les fonctionnaires à mentalité fasciste (Frederick Harrison), les riches désœuvrés (Helen Bradley) et d'autre part les anciens combattants de la Grande Guerre réduits à vivre de leur indemnité de chômage, Harry Morgan, le gangster, et Richard Gordon, l'écrivain. A cette opposition de classes d'inspiration marxiste se superpose une opposition non moins ironique entre ceux qui en ont (ceux qui ont des "cojones") et ceux qui n'en ont pas, entre Harry
Morgan, l'homme d'action, et Richard Gordon, l'homme de pensée, mais tous deux sont peu à peu tragiquement broyés par la société américaine et pour la même raison en dernière analyse, à savoir leur individualisme. Cette communauté de destin confère au roman son unité profonde, mais, ce qui gêne constamment le lecteur, c'est la gratuité des oppositions.
Pourquoi les riches ont-ils tous les torts et les opprimés toutes les vertus ? Pourquoi faut-il que Richard Gordon soit si lamentable dans sa vie sexuelle et que Harry Morgan se comporte comme un champion dans le lit conjugal? Que seuls les riches se rendent coupables d'adultère et pratiquent la masturbation ou l'homosexualité? La fatalité qui entraîne ces personnages à leur perte est-elle purement extérieure? Ne pourrait-elle pas s'expliquer aussi par des facteurs psychologiques que l'auteur se refuse à analyser? On a donc souvent une impression de malaise devant le caractère arbitraire et artificiel de maints épisodes.
Mais l'impression de puissance l'emporte grâce à la présence - dans tous les sens du mot - de Harry Morgan qui incarne avec une vitalité extraordinaire l'individualiste américain, l'homme de la frontière, le rebelle, qui, comme Thoreau, n'hésite pas a recourir à sa façon à la désobéissance civile lorsque les pouvoirs, au lieu de respecter sa liberté, l'oppriment. Il ne se contente pas de résistance passive, il va jusqu'à la révolte armée. Ce n'est pas pour rien qu'il porte le nom d'un boucanier célèbre. Il lutte jusqu'à la mort et meurt sans une plainte, en se contentant de constater que "de quelque façon qu'il s'y prenne, un homme seul est foutu d*avance". Cette phrase sonne comme le glas de l'individualisme américain en général et de l'individualisme de Hemingway en particulier...." (Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade)

1945 - En avoir ou pas (To have and have not)
"Vous savez ce que c'est, à La Havane, de bonne heure le matin, avec les clochards encore endormis le long des murs des édifices, avant même que ne s'amènent les
voitures des glaciers avec la glace pour les bars? " - Après Frédéric Henry, dans "L'Adieu aux armes", et Robert Jordan, dans "Pour qui sonne le glas", Hemingway semble, face au néant, ne
plus tant exalter la virilité, la valeur de l'instant, l'individu isolé, porté par une écriture sèche et brutale, mais part d'une collectivité et cherchant une issue dans un monde en proie à la
déchéance. En 1937, Hemingway raconte l'histoire d'un chômeur conduit au gangstérisme par la misère. Attiré par les « raisins de la colère », il semble abjurer son scepticisme, son individualisme
désespéré et découvrir la solidarité. Harry Morgan, qui loue son bateau à de riches hivernants qu'il emmène
pêcher en mer, a tout perdu : équipement coûteux et argent, le touriste amateur de pêche sportive qui loue depuis une quinzaine ses services et son bateau s'étant éclipsé sans lui payer ni son dû
ni le matériel tombé à la mer. Pour Morgan, c'est dramatique car, s'il y a des riches dont le yacht luxueux vient s'ancrer dans le port de Key West ou des favorisés comme l'écrivain Gordon qui
traîne de bar en bar son âme vaine en quête d'une vérité qu'il ne sait pas voir, les autres se débattent dans la crise des années 30 qui raréfie le travail et multiplie le chômage. Key West étant
située à l'extrême Sud de la Floride en face de Cuba, la contrebande est une ressource pour ne pas mourir de faim. Jeu dangereux. Morgan y perd un bras et son bateau. Le mot défaite n'existant
pas dans son vocabulaire, il prépare une nouvelle expédition. Mais il sera finalement tué au cours d'une bagarre survenue entre de jeunes révolutionnaires cubains qu'il transportait à La Havane.
Et si la leçon est confuse, Hemingway conserve ce style dépouillé qui en fait l'un des maîtres de la prose américaine...
(CHAPITRE XI)
"LE lendemain marin à Key West, Richard Gordon rentrait chez lui, après une visite chez Freddy, où il était allé se renseigner sur l'attaque de la banque. Avec sa bicyclette, il croisa une grande femme massive aux yeux bleus et aux cheveux blonds décolorés dépassant de dessous le chapeau de feutre de son homme, qui se hâtait sur le chemin, les yeux rouges d'avoir pleuré. Regardez-moi cette grosse vache, se dit-il. Qu'est-ce que ça peut bien penser une femme comme celle-là? Qu'est-ce que ça doit donner au lit ? Et le mari, qu'est-ce qu'il peut éprouver pour elle quand elle devient comme ça? Avec qui peut-il bien chasser dans ce patelin ? Effrayante à voir, cette femme, non? Un vrai cuirassé.
Terrifiante.
Il était presque chez lui. Il laissa sa bicyclette contre la véranda et pénétra dans le vestibule, fermant derrière lui la porte d'entrée rongée et minée par les termites.
"Qu'as-tu appris, Dick ? cria sa femme dans la cuisine.
- Ne me parle pas, dit-il, je vais travailler. Tout est là ans ma tête.
- Parfait, dit-elle, je te laisse tranquille. "
Il s'assit à la grande table, dans la pièce donnant sur la rue. Il écrivait un roman dont le sujet était une grève dans une usine de textiles. Dans le chapitre d'aujourd'hui, il comptait utiliser la grosse femme aux yeux rougis par les larmes qu'il venait de croiser sur le chemin de la maison. Lorsqu'il rentrait chez lui, le soir, son mari était dégoûté d'elle, dégoûté de voir comme elle s'était épaissie, alourdie, rebuté par ses cheveux décolorés, ses seins trop gros, son apathie, l'indifférence qu'elle témoignait pour son travail d'organisateur. Il la comparaît en pensée à la petite juive si jeune, aux seins si fermes, aux lèvres si pleines, qui avait pris la parole ce soir-là au meeting. C'était bien. C'était, cela pourrait aisément être formidable, et c'était véridique. Il avait vu, dans un éclair intuitif, toute la vie intérieure de ce genre de
femme : son indifférence, tôt manifestée, aux caresses de son mari. Son désir de sécurité, d'avoir des enfants. Son manque d'intérêt à l'égard des aspirations de son mari. Ses efforts pour faire semblant de s'intéresser à l'acte sexuel qui, en réalité, lui répugnait. Ce serait un chapitre épatant.
La femme qu'il avait rencontrée était Marie, la femme de Harry Morgan, qui rentrait chez elle, en revenant de chez le shérif.
(CHAPITRE XII)
LE bateau de Freddy Wallace, le Queen-Conch, un treize mètres, portant comme numéro le V de Tampa, était peint en blanc. Le pont avant étai vert, d'un vert très gai et l'intérieur du cockpit était d'un vert très gai. Le haut du rouf était de la même couleur. Son nom et le
nom de son port d'attache, Key West, Fla., étaient peints en noir en travers de la poupe. Il n'avait pas de mât et pas de voilure. Il était muni de deux pare-brise en verre dont l'un, celui qui protégeait le gouvernail était cassé. Plusieurs trous avaient percé la coque, écaillant les bordées fraîchement peintes. L'on voyait un certain nombre de ces éraflures des deux côtés de la coque, à environ un pied au-dessous du plat-bord et légèrement en avant du milieu du cockpit. Il y en avait un autre groupe, de ces éraflures, presque à hauteur de la ligne de flottaison, sur la coque côté tribord, juste en face du support arrière du toit de cabine. De la plus basse quelque chose de noir avait coulé, laissant pendre des filets visqueux sur la coque fraîchement peinte.
Il dérivait en travers sous la légère brise du nord, à dix milles environ des routes empruntées par les pétroliers remontant vers le nord, se détachant gaiement en vert et blanc frais, sur le bleu sombre du Gulf Stream. Des plaques d'algues, des sargasses jaunies par le soleil,
flottaient dans l'eau contre ses flancs, lentement chassées par le courant vers le nord et l'est, pendant que le vent contrecarrait en partie la dérive qui sans répit le poussait plus avant dans le Gulf Stream. Aucun signe de vie à bord, bien qu'un corps d'homme, paraissant gonflé, apparût au-dessus du plat-bord, étendu sur le siège surplombant le réservoir d'essence de bâbord et que, dépassant de la banquette aménagée le long du plat-bord de tribord, un homme semblât se pencher en avant pour tremper ses doigts dans la mer. Il avait la tête et les cheveux au soleil et, à l'endroit où ses doigts touchaient presque l'eau, évoluait un banc de petits poissons d'environ cinq centimètres de long, ovales, dorés, striés de raies pourpres à peine perceptibles, qui avaient déserté les algues du courant pour s'abriter à l'ombre de la chaloupe en dérive et chaque fois que quelque chose s'égouttait dans la mer, ces poissons se ruaient sur la goutte dans un grouillement et une bousculade intense, jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Deux poissons, des porte-écuelle gris d'une taille d'environ quarante centimètres, tournaient sans répit autour du bateau, tandis qu'au sommet de leur tête, leur bouche fendue s'ouvrait et se refermait; mais ils ne semblaient pas comprendre la régularité de l'égouttement dont les petits poissons faisaient leur nourriture et il y avait autant de chance pour qu'ils se trouvassent de l'autre côté de la coque, lorsque la goutte tombait, qu'à proximité. Ils avaient depuis longtemps sucé les caillots et les filets carminés et visqueux qui pendaient aux déchirures des trous les plus bas et traînaient leur extrémité dans l'eau, et à chaque mouvement des nageoires ils secouaient leur hideuse tête coiffée d'une ventouse et leur corps allongé, fuselé, terminé par une queue étroite et mince. Ils répugnaient à quitter cet endroit où ils s'étaient si bien régalés et de façon tellement inattendue.
A l'intérieur du cockpit de la chaloupe, il y avait trois autres hommes. L'un, mort, était couché sur le dos à l'endroit même où il était tombé, sous la roue du gouvernail. Un autre, mort, gisait en un tas volumineux contre le dalot à hauteur de l'épontille de tribord avant. Le troisième, encore en vie, mais depuis longtemps en proie au délire, était couché sur le côté, la tête au creux du bras.
L'essence avait envahi tout le fond de la chaloupe, et clapotait lourdement au moindre roulis. L'homme, Harry Morgan, croyait que le bruit provenait de son ventre et il lui semblait maintenant que son ventre était grand comme un lac et que cela déferlait sur les deux rives en même temps. Cela tenait à ce qu'il venait de se mettre sur le dos, les genoux relevés et la tête en arrière. L'eau de ce lac qu'était son ventre était très froide; si froide que lorsqu'il voulut poser le pied sur son bord un engourdissement le saisit, et il avait très froid maintenant et tout avait un goût d'essence, comme s'il avait aspiré dans un tuyau de caoutchouc pour siphonner un réservoir. Il savait qu'il n'y avait pas de réservoir, bien qu'il eût l'impression qu'un tuyau glacé, pénétrant par sa bouche, était maintenant lové, énorme, lourd et froid, tout au fond de lui-même. Chaque fois qu'il respirait, le rouleau se resserrait et se refroidissait dans son bas-ventre, et il le sentait là, pareil à un gros serpent aux mouvements lents et doux dominant le déferlement fangeux du lac. Il en avait peur, mais bien qu'il fût en lui, il lui semblait très loin et ce qui lui importait, pour le moment, c'était le froid.
Le froid était partout en lui, un froid cuisant qui l'engourdissait tout entier sans vouloir lâcher prise nulle part, alors maintenant il se tenait immobile et le subissait. Un moment l'idée lui était venue que s'il réussissait à se tirer sur lui-même, cela le couvrirait comme une couverture et, l'espace d'un instant, il crut bien avoir réussi et eut l'impression qu'il commençait a se réchauffer. Mais cette chaleur n'était en réalité que l'hémorragie qu'il avait provoquée en levant ses genoux; et maintenant que la chaleur s'enfuyait, il se rendait compte que l'on ne peut pas se tirer sur soi-même et qu'en ce qui concerne le froid, la seule chose à faire, c'est de l'encaisser. Il était là couché, tout entier tendu dans l'effort de ne pas mourir, longtemps après avoir cessé d'être capable de penser. A présent, il était à l'ombre, et plus le bateau dérivait, plus le froid devenait intense.
La chaloupe dérivait depuis dix heures du soir la veille et il commençait à être tard dans l'après-midi. Sur toute la surface du Gulf Stream il n'y avait rien d'autre en vue que les algues, quelques bulles roses, distendues et membraneuses de physalies, nonchalamment penchées sur l'eau, et la lointaine fumée d'un pétrolier chargé, venant de Tampico et faisant route vers le nord."
(CHAPITRE XIII)
"ALORS? dit Richard Gordon à sa femme.
- Tu as du rouge sur ta chemise, fit-elle. Et sur l'oreille.
- Et ça alors ?
- Quoi ça ?
- Eh bien, le fait que je te trouve couchée sur le sofa, en compagnie de ce tocard de poivrot?
- Ce n'est pas vrai.
- Où vous ai-je trouvés?
- Tu nous as trouvés assis sur le sofa.
- Dans le noir.
- D'où viens-tu ?
- De chez les Bradley.
- Oui, dit-elle. je sais. Ne t'approche pas de moi. Tu es plein de l'odeur de cette femme. Tu empestes.
- Et toi, qu'est-ce que tu empestes ?
- Rien. Je suis restée assise, à causer avec un ami.
- Tu l'as embrassé ?
- Non.
- Et lui, t'a embrassée ?
- Oui, et ça m'a plu.
- Salope.
- Traite-moi encore comme cela et je te quitte.
- Salope.
- Très bien, dit-elle. C'est fini. Si tu n'avais pas été si vaniteux et moi si gentille avec toi, tu te serais depuis longtemps rendu compte que c'était fini.
- Salope.
- Non, dit-elle, je ne suis pas une salope. J'ai essayé d'être une bonne épouse, mais tu es aussi égoïste et aussi vaniteux qu'un coq de basse-cour. Toujours en train de chanter : "Regarde ce que j'ai fait. Vois comme je te rends heureuse. Maintenant sauve-toi, va caqueter ailleurs". Eh bien, tu ne me rends pas heureuse, je ne veux plus te voir. J'en ai assez de caqueter.
- Tu aurais tort de caqueter. Tu n'as jamais rien produit qui justifiait tes caquetages.
- A qui la faute? Est-ce que je ne voulais pas avoir des enfants ? Mais nous n'avions jamais les moyens. Par contre nous avions les moyens d'aller nager au cap d'Antibes et de faire du ski en Suisse. Nous avons les moyens de venir ici à Key West. J'en ai assez de toi. Tu me dégoûtes. Cette Bradley, aujourd'hui, Ça été la dernière goutte.
- Oh! laisse-la en dehors de cette histoire.
- Rentrer chez soi avec du rouge à lèvres partout. Tu aurais pu au moins t'essuyer. Tu en as sur le front, aussi.
- Tu l'as embrassé, cette espèce de fausse couche d'ivrogne ?
- Non. je ne l'ai pas embrassé. Mais je l'aurais fait si j'avais su ce que tu faisais.
- Pourquoi lui as-tu permis de t'embrasser ?
- J'étais furieuse après toi. Nous avions attendu, attendu, attendu. Tu n'es pas venu une seule fois près de moi. Tu es sorti avec cette femme et tu es resté des heures parti. John m'a ramenée à la maison.
- Il ne t'épouserait pas.
- Oh ! si. Il m'a demandé de l'épouser cet après-midi."
Richard Gordon ne répliqua rien. Un grand vide venait de pénétrer en lui, à la place même où avait été son cœur, et tout ce qu'il entendait ou disait lui semblait être une conversation surprise par hasard...."

Howard Hawks , 1944, "To Have and Have Not" (Le Port de l'angoisse)
avec Humphrey Bogart, Walter Brennan et Lauren Bacall.
Lorsque les États-Unis rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, Faulkner retourne alors à Hollywood écrivant entre autres pour Howard Hawks et en collaboration avec Francis Scott Fitzgerald le scénario du film "Le Grand Sommeil", tiré du livre de Raymond Chandler, ainsi que celui du film "Le Port de l'angoisse", tiré du livre d'Ernest Hemingway "En avoir ou pas". Le film est d'autant plus célèbre qu'il est celui de la première rencontre à l'écran du couple Humphrey Bogart-Lauren Bacall, et va contenir bien des répliques restées célèbres : «You know how to whistle don't ya? Just put your lips together and blow» (Lauren Bacall) et «Have you ever been bitten by a dead bee?» (Walter Brennan).




1950 - Au-delà du fleuve et sous les arbres (Across the River and into the Trees)
Après dix années de silence, Hemingway reprend la plume, la critique n'y trouva son compte. Un colonel américain, Richard Cantwell, revient mourir en Italie, à Venise, où il a combattu. D'abord parce qu`il aime cette ville et cette terre chargées pour lui de souvenirs (il fut blessé en Vénétie. en 1918, durant la déroute de Caporetto), et surtout parce qu'il vient de rencontrer la jeune comtesse Renata et qu'un amour éperdu les unit, un amour qu'il sait être le dernier. La conscience de sa mort prochaine lui révèle non pas l'amertume d'avoir à se séparer bientôt du monde, mais la nécessité d`accueillir avec émerveillement et ferveur tout ce que le présent apporte jusqu'à la dernière heure. Ses trois derniers jours, il les passe donc à aimer Renata, à se promener avec elle, à chasser dans les lagunes et à converser avec ses amis. Quand. après une bonne partie de chasse, il sent venir l'attaque qui va le terrasser, il se contente de grimper dans sa voiture, de griffonner un message pour que l'on remette ses fusils à leur propriétaire, et il meurt sans un mot inutile de plainte ou de révolte. On risque ici sans arrêt de sombrer dans le romantisme le plus voyant, mais la sobriété de l'écriture nous incite à entrevoir une dimension intérieure pour chaque être, chaque évènement, chaque chose qui livre son poids d'existence...
"... Ils restèrent assis à leur table dans le coin. Des gens sortirent, d'autres entrèrent. Le colonel avait la tête qui lui tournait un peu, c'était le médicament et il attendit que ça se passe. Cela me fait toujours ça, pensa-t-il. Et merde.
Il vit que la jeune fille l'observait, et il lui sourit. C'était un vieux sourire qui avait cinquante ans d'usage déjà, depuis la toute première fois, mais qui tenait toujours le coup, comme la fameuse carabine du grand-père. Ça doit être mon frère aîné qui l'a, pensa-t-il. Bah, c'est normal : il a toujours été meilleur tireur que toi.
- Écoute, ma fille, dit-il. Ne sois pas triste pour moi.
- Mais je ne le suis pas. Pas du tout. Je t'aime simplement.
- Ce n'est pas un métier, hein? - il dit "oficio" au lieu de métier, parce qu'ils parlaient aussi l'espagnol ensemble, quand ils lâchaient le français et ne voulaient pas de l'anglais devant les autres. L'espagnol est une langue rude, pensa le colonel, plus rude q'u'un épi de maïs, quelquefois. Mais on peut dire ce qu'on veut, avec, et ça tient.
- "Es un oficio bastante malo", répéta-t-il, de m'aimer.
- Oui. Mais je n'en ai pas d'autre.
- Tu n'écris plus de vers?
- C'étaient des vers de jeune fille. Comme la peinture de jeune fille. Tout le monde a du talent, à un certain âge.
A quel âge devient-on vieux dans ce pays? songea le colonel. Les gens ne vieillissent pas à Venise, mais ils mûrissent très vite. Moi-même j'ai eu tôt fait de mûrir, en Vénétie, et je n'ai jamais été aussi vieux qu'à vingt et un ans.
- Comment va ta mère? s'enquit-il tendrement.
- Elle va très bien. Elle ne reçoit pas et ne voit presque personne à cause de son chagrin.
- Crois-tu que ça lui déplairait que nous ayons un bébé?
- Je ne sais pas. Elle est très intelligente, tu sais. Mais il faudrait que j'épouse quelqu'un, il me semble. Et cela ne me dit pas grand-chose, au fond.
- Nous pourrions nous marier.
- Non, dit-elle. J 'y ai longtemps réfléchi et je crois qu'il ne faut pas. C'est une décision, tout comme de ne pas pleurer.
- Peut-être te trompes-tu dans tes décisions. Dieu sait que ça m'est arrivé pas mal de fois, et trop de types ont payé mes erreurs de leur vie.
- Je crois que tu dois exagérer. Cela m'étonnerait que tu aies fait beaucoup d'erreurs.
- Pas beaucoup, dit le colonel. Mais assez comme ça. Trois fois c'est énorme dans mon métier, et j'en ai fait trois.
- Je voudrais bien que tu me racontes.
- Ça t'ennuierait, dit le colonel. Ça me fait suer moi-même rien que d'y penser. Qu'est-ce que ce serait pour quelqu'un qui n'est pas dans le coup?
- Je ne suis pas dans le coup?
- Si. Tu es mon véritable amour. Mon dernier et seul et véritable amour.
- C'était il y a longtemps ou récemment? Les décisions.
- C'était il y a longtemps. Vers le milieu. Et récemment.
- Tu ne veux pas me raconter? J'aimerais tant avoir ma part de ton triste métier.
- Au diable ces histoires, dit le colonel. C'est du passé et la note est réglée. Mais c'est le genre de chose qui ne peut pas se payer.
- Peux-tu me raconter et m'expliquer?
- Non, dit le colonel.
Et cela régla la question.
- Alors, amusons-nous.
- Amusons-nous, dit le colonel. Payons-nous-en pour notre seule et unique vie.
- Il y en a peut-être d'autres.
- Je ne pense pas, dit le colonel. Tourne la tête de côté, beauté.
- Comme ceci?
- Comme cela, dit le colonel. Comme cela, c'est parfait.
Ainsi, songea le colonel, nous voici arrivés au dernier round et je ne sais même pas à combien nous en sommes. Je n'ai aimé que trois femmes et je les ai perdues toutes
les trois. Les femmes ça se perd comme des bataillons; par suite de fautes de jugement, d'ordres impossibles à exécuter et de conditions intolérables. Et par brutalité aussi. J'ai perdu trois bataillons dans ma vie et trois femmes, et maintenant c'est la quatrième et la plus adorable, et où diable cela mène-t-il? ..."

1952 - Le Vieil Homme et la mer (The Old Man and the Sea)
"Le Vieil Homme et la mer "reprend le thème traité vingt ans plus tôt dans l'Invincible. Le vieux pêcheur, qui n'a rien pris depuis quatre-vingt-quatre
jours, est semblable au torero vieilli. Les requins dévorent l'énorme espadon qu'il prend. Le vieil homme rentre au port avec un plat d'arêtes. Personne ne sera témoin de sa victoire, qui est à
la fois une défaite et son unique richesse. Seul avec la mer, il a fait son devoir, parce que cette force morale est sa seule certitude. C'est le dernier roman publié du vivant de Hemingway."
(Editions Gallimard)
Histoire relativement courte d'une lutte épique entre un vieux pêcheur aguerri et la plus belle prise de sa vie, histoire écrite avec le style caractéristique de l'écrivain, des phrases brèves, précises, histoire très "physique", puissance et silence de la mer, puissance de l'énorme marlin qui entraîne le bateau au plus loin de l'océan, puissance des requins prédateurs arrachant des monceaux de chair, et souffrance du corps et de l'âme d'un vieil homme qui lutte contre un adversaire devenu son égal, qui lutte contre les prédateurs pour sauvegarder l'intégrité d'un adversaire qu'il admire. Hemingway nous montre l'homme qui ne renonce jamais et se battra jusqu'à la mort pour sauver ce qui doit l'être : "man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated..."
"He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty- four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat.
The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face and his hands had the deep- creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless desert.
Everything about him was old except his eyes and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated.
"Santiago," the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was hauled up. "I could go with you again. We've made some money."
The old man had taught the boy to fish and the boy loved him.
"No," the old man said. "You're with a lucky boat. Stay with them."
"But remember how you went eighty- seven days without fish and then we caught big ones every day for three weeks."..
"I remember/' the old man said. "I know you did not leave me because you doubted."
"It was papa made me leave. I am a boy and I must obey him."
"I know/' the old man said. "It is quite normal."
"He hasn't much faith."
[ 10] "No/' the old man said. "But we have. Haven't we?"
'Yes/' the boy said. "Can I offer you a beer on the Terrace and then we'll take the stuff home."
"Why not?" the old man said. "Between fishermen."
They sat on the Terrace and many of the fishermen made fun of the old man and he was noteangry. Others, of the older fishermen, looked at him and were sad. But they did not show it and they spoke politely about the current and the depths they had drifted their lines at and the steady good weather and of what they had seen. The successful fishermen of that day were already in and had butchered their marlin out and carried them laid full length across two planks, with two men staggering at the end of each plank, to the fish house where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana. Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove where they were hoisted on a block and tackle, their livers removed, their fins cut off and their hides skinned out and their flesh cut into strips for salting.
When the wind was in the east a smell came across the harbour from the shark factory; but today there was only the faint edge of the odour because the wind had backed into the north and then dropped off and it was pleasant and sunny on the Terrace.
IL était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. En quatre-vingt-quatre jours, il n'avait pas pris un poisson. Les quarante premiers jours, un jeune garçon l'accompagna; mais au bout de ce temps, les parents du jeune garçon déclarèrent que le vieux était décidément et sans remède "salao", ce qui veut dire aussi guignard qu'on peut l'être. On embarqua donc le gamin sur un autre bateau, lequel, en une semaine, ramena trois poissons superbes.
Chaque soir le gamin avait la tristesse de voir le vieux rentrer avec sa barque vide. Il ne manquait pas d’aller à sa rencontre et l’aidait à porter les lignes serrées en spirale, la gaffe, le harpon, ou la voile roulée autour du mât. La voile était rapiécée avec de vieux sacs de
farine ; ainsi repliée, elle figurait le drapeau en berne de la défaite.
Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Les taches brunes de cet inoffensif cancer de la peau que cause la réverbération du soleil sur la mer des Tropiques marquaient ses joues ; elles couvraient presque entièrement les deux côtés de son visage ; ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent les lourds poissons. Mais aucune de ces entailles n’était récente : elles étaient vieilles comme les érosions d’un désert sans poissons.
Tout en lui était vieux, sauf son regard, qui était gai et brave, et qui avait la couleur de la mer.
- Santiago, dit le gamin tandis qu’ils escaladaient le talus après avoir tiré la barque à sec, je pourrais revenir avec toi maintenant. On a de l’argent.
Le vieux avait appris au gamin à pêcher et le gamin aimait le vieux.
- Non, dit le vieux, t’es sur un bateau qu’a de la veine. Faut y rester.
- Mais rappelle-toi quand on a passé tous les deux vingt-sept jours sans rien attraper, et puis tout d'un coup qu'on en a ramené des gros tous les jours pendant trois semaines.
- Je me rappelle, dit le vieux. Je sais bien que c'est pas par découragement que tu m'as quitté.
- C'est papa qui m'a fait partir. Je suis pas assez grand. Faut que j'obéisse, tu comprends.
- ]e sais, dit le vieux. C'est bien naturel.
- Il a pas confiance.
- Non, dit le vieux. Mais on a confiance, nous autres, hein ?
- Oui, dit le gamin. Tu veux-t-y que je te paye une bière à la Terrasse ? On remisera tout ça ensuite.
- C'est ça, dit le vieux. Entre pêcheurs."
Ils s'assirent à la Terrasse où la plupart des pêcheurs se moquèrent du vieux, mais cela ne l'irrita nullement. Les autres vieux le regardaient et se sentaient tristes. Toutefois ils ne firent semblant de rien et engagèrent une conversation courtoise sur les courants, les fonds où ils avaient traîné leurs lignes, le beau temps persistant et ce qu'ils avaient vu. Les pêcheurs dont la journée avait été bonne étaient déjà rentrés; leurs poissons ouverts étaient étalés sur deux planches, que quatre hommes, un à chaque bout, portaient en vacillant jusqu'à la pêcherie; le camion frigorifique viendrait chercher cette marchandise pour l'amener au marché de La Havane. Ceux qui avaient attrapé des requins les avaient livrés à "l'usine à requins", de l'autre côté de la baie, ou l'on pend les squales à un croc, pour leur enlever le foie, leur couper les ailerons, et les écorcher. Après quoi leur chair débitée en filets va au saloir.
Quand le vent soufflait de l'est, l'odeur de "l'usine à requins" remplissait le port; ce jour-là il n'en arrivait qu'un faible relent, car le vent, après avoir tourné au nord, était tombé. Il faisait bon, au soleil, sur la Terrasse....

Depuis quatre-vingt-quatre jours, un vieux pêcheur cubain, Santiago, est parti en mer, en vain. Réputé malchanceux, solitaire dans sa cabane délabrée, il n'y a plus que son ancien apprenti, Manolin, pour l'aider chaque soir. Santiago pense que la chance va tourner et décide de naviguer plus loin que d'habitude le jour suivant. Le lendemain, il s'aventure donc au-delà des eaux côtières peu profondes, dans le Gulf Stream. A midi, un gros poisson de dix-huit pieds, qu'il sait être un marlin, mord à l'appât, mais Santiago ne parvient pas à le tirer, et le voici qui entraîne le bateau. - "The old man knew he was going far out and he left the smell of the land behind and rowed out into the clean early morning smell of the ocean..." - De crainte que le poisson ne rompe la ligne, le vieil homme supporte la tension de la ligne avec ses épaules, son dos et ses mains, la douleur se fait d'autant plus vive que le poisson ne cesse d'entraîner le bateau tout au long de la journée, de la nuit, du jour suivant. Epuisé et meurtri, au bord de la rupture, Santiago ne peut s'empêcher de ressentir une profonde empathie pour ce poisson qui souffre et s'épuise autant que lui. -"The fish is my friend too, he said aloud. I have never seen or heard of such a fish. But I must kill him. I am glad we do not have to try to kill the stars..."
Le troisième jour, il parvient à tirer le marlin assez près pour le tuer d'un coup de harpon, à l'amarrer à son bateau, et se prépare en regagner le port. Mais le sang du marlin laisse une trace dans l'eau et attire les requins. Une nouvelle lutte s'engage au cours de laquelle Santiago tente de repousser comme il peut les prédateurs qui ne cessent de dévorer la chair du marlin. A la tombée de la nuit, il ne reste qu'un squelette de cet adversaire qu'il a fond sacrifié à son ambition. Le lendemain matin, une foule de pêcheurs se rassembleront autour de la carcasse du poisson, le vieil homme épuisé dort et rêve au fond de sa cabane ...
"... Comme il n'avait rien à lire et point de radio, il méditait sans trêve. Ses pensées revinrent au péché. C'est pas parce que tu crevais de faim que t'as tué ce poisson-là, se dit-il. Ni pour le vendre. Tu l'as tué par orgueil. Tu l'as tué parce que t'es né pêcheur. Ce poisson-là tu
l'aimais quand il était en vie, et tu l'as aimé aussi après. Si tu l'aimes, c'est pas un péché de l'avoir tué. Ou c'est-y encore plus mal ?
"Tu réfléchis trop, bonhomme, prononça-t-il. N'empêche que t'as été bien content d'estourbir le "dentuso", pensa-t-il. Pourtant ça, c'est un animal qui se nourrit de poissons vivants, comme toi. C'est pas un charognard, c'est pas un estomac à nageoires comme certains requins. C'est beau le "dentuso", c'est noble. Ça ne connaît pas la peur.
"J'étais en état de légitime défense, dit le vieil homme tout haut. Et je l'ai rudement bien tué."
D'ailleurs, pensa-t-il, tout le monde tue d'une manière ou de l'autre. La pêche me tue au moins autant qu'elle me fait vivre. Le gamin me fait vivre, lui, pensa-t-il. Faut pas que je raconte d'histoires.
Se penchant par-dessus bord, il détacha un morceau de la chair du poisson à l'endroit où le requin avait mordu. Il le mastiqua longuement, appréciant sa finesse et son goût agréable. C'était une chair ferme et juteuse, comme de la viande, encore qu'elle ne fût pas rouge. Ce n'était pas filandreux non plus, et le vieux songea qu'il en tirerait le meilleur prix au marché. Mais il n'existait aucun moyen d'empêcher son odeur de pénétrer la mer, et il s'attendait aux pires ennuis de ce côté-là.
La brise continuait à souffler. Elle avait appuyé encore un peu plus au nord-est, ce qui signifiait qu'elle ne tomberait pas. Le vieux scrutait l'horizon devant lui : pas la moindre voile, pas la moindre fumée, nul bateau en vue.
Rien que des poissons volants qui jaillissaient à la proue de sa barque et s'en allaient tomber à côté des herbes jaunes du Gulf. On ne voyait même pas d'oiseaux.
Il navigua ainsi deux heures, accoté à l'arrière, mangeant de temps à autre un morceau d'espadon, tâchant de se reposer et de conserver ses forces. Tout à coup il aperçut le premier des deux requins.
« Ay », s'écria-t-il. Ce mot est intraduisible; peut-être même n'est-ce qu'un son, une de ces exclamations qui vous échappent, malgré vous, quand un clou vous traverse la main et s'enfonce dans le bois.
« Galanos », s'écria-t-il. Il venait de voir le second aileron derrière le premier.
Ces requins appartenaient à l'espèce dite « museau en spatule ». Il les reconnaissait à l'aileron brun et triangulaire et au coup de balai de la queue. Ils avaient flairé la trace du poisson, mais la faim les mettait dans un tel état d'affolement qu'ils la perdaient et la reperdaient sans arrêt. Ils ne cessaient toutefois de se rapprocher.
Le vieux attacha l'écoute de la voile et immobilisa la barre, puis il saisit la rame où il avait fixé son couteau. Il la souleva aussi légèrement qu'il put, parce que ses paumes le faisaient horriblement souffrir. Il ouvrit et ferma les mains plusieurs fois sur le manche afin de les
assouplir. Enfin, d'un coup sec, il les referma pour que la plus grande douleur fût passée quand il faudrait agir, et il attendit les requins. Il apercevait leur larges museaux plats terminés en spatule, et les pointes blanches de leurs nageoires pectorales. C'étaient des animaux immondes, puants, plus charognards encore que chasseurs.
Quand ces requins-là ont faim, ils vont jusqu'à mordre les rames ou le gouvernail des barques, à sectionner les pattes des tortues endormies à la surface, à attaquer l'homme, celui-ci ne portât-il sur le corps la moindre odeur de poisson ou de sang.
« Ay, dit le vieux. Galanos. Allons-y, Galanos. »
Ils attaquèrent, mais pas de la même façon que le Mako. L'un vira et disparut sous le bateau. A chaque secousse qu'il donnait en tirant sur le poisson, l'embarcation oscillait. L'autre requin surveillait le vieux du coin de son sale petit oeil jaune. Soudain, les mâchoires béantes, il se jeta sur la partie de l'espadon qui était déjà entamée. La ligne imaginaire se dessinait nettement du sommet de sa tête noirâtre à l'endroit où la cervelle rejoint l'épine dorsale : c'est là qu'avec le couteau fixé à la rame le vieux frappa. Il releva son arme et l'enfonça à nouveau dans l'oeil de chat du requin. Celui-ci, presque en même temps, lâcha le poisson, retomba, avala le morceau qu'il avait arraché et mourut.
La barque oscillait toujours sous les attaques de l'autre bête. Le vieux laissa aller l'écoute. La barque fit une embardée et le requin apparut. Aussitôt qu'il l'aperçut, le vieux se pencha par-dessus bord et lui porta un coup de couteau. Mais il n'atteignit que la chair, qu'il entama à peine, à cause de l'épaisseur de la peau. Le coup retentit douloureusement dans ses mains, et dans son épaule. Le requin revint immédiatement à la charge, la tête hors de l'eau. Au moment où son nez émergea et se posa sur le poisson, le vieux frappa le sommet de la tête plate. Relevant l'arme, il frappa une seconde fois exactement au même point. Le requin cependant restait accroché au poisson de toute sa mâchoire : le vieux lui creva l'oeil gauche. Le requin ne bougea pas.
« Ça te suffit pas ? » dit le vieux. Il plongea la lame entre les vertèbres et la cervelle, coup facile, au point où en étaient les choses. Il sentit le cartilage se fendre. Il retira son couteau et essaya de le pousser entre les mâchoires du requin, afin de les écarter. Il retourna la lame plusieurs fois sur elle-même; quand enfin le requin lâcha prise et s'enfonça, il lui dit :« Fous le camp, galano. Dégringole à mille mètres de profondeur. Va-t'en rejoindre ton copain, à moins que ça soit ta mère..»
Le vieux essuya la lame du couteau, reposa l'aviron et rattrapa l'écoute; la voile se gonfla et la barque repartit, dans la bonne direction.
« Ils ont mangé au moins un quart du poisson, et le meilleur, dit-il tout haut. Si seulement c'était un rêve! Si seulement je l'avais jamais ferré! Ça me fait chagrin, tout ça, poisson. Ça démolit tout ce qu'on a fait.. » Il se tut et ne voulut plus regarder son poisson. Exsangue et ballotté sur les vagues, celui-ci avait pris cette couleur gris plombé qu'a le tain des glaces et l'on distinguait encore ses rayures...."

La Maison-Musée d’Ernest Hemingway, située à Key West, 907 Whitehead Street, Florida, USA.
Ernest Hemingway s'y installa à la fin des années 1920, y vécut pendant plus de dix ans, y écrivit sans doute "A Farewell to Arms", "For Whom The Bell Tolls", "Green Hills of Africa", "The Snows of Kilimanjaro", "Death in the Afternoon". Emprunter depuis Miami la fameuse route au dessus de l'océan (the Overseas Highway) de 204 km...
