- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

John Steinbeck (1902-1968), "Tortilla Flat" (1935), "Of Mice and Men" (1937), "The Grapes of Wrath" (1939), "East of Eden" (1952) - ...
Last update : 09/09/2017

"Des types comme nous, y a pas plus seuls au monde." - "The Grapes of Wrath" est le "grand roman américain" symbole de ces sombres années de la Dépression qui voit la famille Joad s'entasser dans un vieux camion avec ce qui lui reste de meubles et prendre la fameuse route 66 qui conduit vers l'Ouest ... et qui deviendra le chemin des opprimés et des déracinés de l'Amérique.
Avec John Steinbeck, la masse des hommes empoignés par la peur ou la colère, décrite en fonds de mythologie biblique, de forces élémentaires et de primitivisme, entre avec fracas en littérature.
On lui reprochera certes tour à tour un sentimentalisme facile, un symbolisme excessif et mal contrôlé, une psychologie trop stéréotypée, une vision marxiste, mais Steinbeck marque à sa façon la fin d'une époque de l'histoire américaine : le temps de la Frontière est terminé, l'individualisme forcené du pionnier est devenu totalement impuissant face à ces nouvelles forces économiques et sociales qui s'emparent brutalement et inexorablement de nos moyens d'existence. Que leur impose-t-on en retour, la tentative de la "masse", "we are the people..", mais une tentative qui est reste lettre morte : "le bien le plus précieux de l'homme est bien le cerveau isolé de l'homme...". L'individu est bien plus que ce qu'il paraît, et bien plus que ses préjugés peuvent laisser deviner. Fondamentalement "l'esprit de l'homme ne peut se contenter de vivre avec son temps comme le fait son corps.." (A l'est d'Eden)
La nation américaine est à l'orée des années trente plus troublée qu'à toute autre époque antérieure de son Histoire depuis la guerre de Sécession. Le krach de Wall Street traduit, après octobre 1929, l'effondrement du système capitaliste américain, dont la cupidité et les profits exorbitants des années vingt conduisaient inéluctablement à cette catastrophe tant morale qu'économique. L'idéalisme de l'opulent Gatsby devient soudain une incroyable fiction. Rares sont les écrivains alors enclins à brosser du busínessman américain une image flatteuse. Le capitalisme est désormais ressenti comme au-delà du bien et du mal, évoqué comme une gigantesque abstraction, anonyme et insondable, une force opaque et secrète échappant au contrôle moral et économique de tout agent humain ...
(Thomas Hart Benton (April 15, 1889-January 19, 1975) - Departure of the Joads (1939) - lithograph - SDMA San Diego Museum of Art)


John Steinbeck reproduit dans le chapitre 5 de "The Grapes of Wrath" (1939) la réaction de gens frustrés et désemparés. Un métayer spolié de l'Oklahoma, qui menace de tirer sur le représentant du propriétaire foncier, se rend bientôt compte que le propriétaire est en réalité un monstre tentaculaire appelé la Banque ou la Firme, qui à son tour "gets orders from the East". La leçon est implacable et tragique : cela ne sert à rien de tirer sur une banque. Steinbeck glisse en outre un trait révélateur dans le défi qui, naissant de cet esprit de résistance individuel et collectif qui tentait de prendre forme, engage l'agriculteur en lutte à proclamer la dignité humaine par ces mots : "We”ve got a bad thing made by men, and by God that's something we can change"...
(V) "Les propriétaires terriens s'en venaient sur leurs terres, ou le plus souvent, c'étaient les représentants des propriétaires qui venaient. Ils arrivaient dans des voitures fermées, tâtaient la terre sèche avec leurs doigts et parfois ils enfonçaient des tarières de sondage dans le sol pour en étudier la nature. Les fermiers, du seuil de leurs cours brûlées de soleil, regardaient, mal à l'aise, quand les autos fermées longeaient les champs. Et les propriétaires finissaient par entrer dans les cours, et de l'intérieur des voitures, ils parlaient par les portières, Les fermiers restaient un moment debout près des autos, puis ils s'asseyaient sur leurs talons et trouvaient des bouts de bois pour tracer des lignes dans la poussière.
Par les portes ouvertes les femmes regardaient, et derrière elles, les enfants - les enfants blonds comme le maïs, avec de grands yeux, un pied nu sur l'autre pied nu, les orteils frétillants. Les femmes et les enfants regardaient leurs hommes parler aux propriétaires. Ils se taisaient.
Certains représentants étaient compatissants parce qu'ils s'en voulaient de ce qu'ils allaient faire, d'autres étaient furieux parce qu'ils n'aimaient pas être cruels, et d'autres étaient durs parce qu'il y avait longtemps qu'ils avaient compris qu'on ne peut être propriétaire sans être dur. Et tous étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Il y en avait qui haïssaient les mathématiques qui les poussaient à agir ainsi; certains avaient peur, et d'autres vénéraient les mathématiques qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs sentiments. Si c'était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait : " La banque ou la compagnie... a besoin... veut... insiste... exige... "› comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres doués de pensée et de sentiment qui les avaient eux-mêmes subjugués. Ceux-là se défendaient de prendre des responsabilités pour les banques ou les compagnies parce qu'ils étaient des hommes et des esclaves, tandis que les banques étaient à la fois des machines et des maîtres.
Il y avait des agents qui ressentaient quelque fierté d'être les esclaves de maitres si froids et si puissants. Les agents assis dans leurs voitures expliquaient : "Vous savez que la terre est pauvre. Dieu sait qu'il y a assez longtemps que vous vous échinez dessus."
Les fermiers accroupis opinaient, réfléchissaient, faisaient des dessins dans le sable. Eh oui, Dieu sait qu'ils le savaient. Si seulement la poussière ne s'envolait pas. Si elle avait voulu rester par terre, les choses n'auraient peut-être pas été si mal.
Les agents poursuivaient leur raisonnement :
- Vous savez bien que la terre devient de plus en plus pauvre. Vous savez ce que le coton fait à la terre; il la vole, il lui suce le sang.
Les fermiers opinaient... Dieu sait qu'ils s'en rendaient compte. S'ils pouvaient seulement faire alterner les cultures, ils pourraient peut-être redonner du sang à la terre. Oui, mais c'est trop tard. Et le représentant expliquait comment travaillait, comment pensait le monstre qui était plus puissant qu'eux-mêmes. Un homme peut garder sa terre tant qu'il a de quoi manger et payer ses impôts; c'est une chose qui peut se faire.
Oui, il peut le faire jusqu'au jour où sa récolte lui fait défaut, alors il lui faut emprunter de l'argent à la banque. Bien sûr... seulement, vous comprenez, une banque ou une compagnie ne peut pas faire ça, parce que ce ne sont pas des créatures qui respirent de l'air, qui mangent de la viande. Elles respirent des bénéfices; elles mangent l'intérêt de l'argent. Si elles n'en ont pas, elles meurent, tout comme vous mourriez sans air, sans viande. C'est très triste, mais c'est comme ça. On n'y peut rien.
Les hommes accroupis levaient les yeux pour comprendre.
- Est-ce qu'on ne pourrait pas nous laisser continuer?
L'année prochaine sera peut--être une bonne année. Dieu sait combien on pourra faire de coton l'année prochaine. Et avec toutes ces guerres... Dieu sait à quel prix le coton va monter. Est-ce qu'on ne fait pas des explosifs avec le coton? Et des uniformes? Qu'il y ait seulement assez de guerres et le coton fera des prix fous. L'année prochaine, peut-être.
Ils levaient des regards interrogateurs.
- Nous ne pouvons pas compter là-dessus. La banque... le monstre, a besoin de bénéfices constants. Il ne peut pas attendre. Il mourrait. Non, il faut que les impôts continuent. Quand le monstre s`arrête de grossir, il meurt. Il ne peut pas s`arrêter et rester où il est.
Des doigts aux chairs molles commençaient à tapoter le bord des portières, et des doigts rugueux à se crisper sur les bâtons qui dessinaient avec nervosité. Sur le seuil des fermes brûlées de soleil, les femmes soupiraient puis changeaient de pied, de sorte que celui qui avait été dessous se trouvait dessus, les orteils toujours en mouvement. Les chiens venaient renifler les voitures des agents et pissaient sur les quatre roues, successivement. Et les poulets étaient couchés dans la poussière ensoleillée et ils ébouriffaient leurs plumes pour que le sable purificateur leur pénétrât jusqu'à la peau. Dans leurs petites étables, les cochons grognaient, perplexes, sur les restes boueux des eaux de vaisselle.
Les hommes accroupis rabaissèrent les yeux.
- Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Nous ne pouvons pas diminuer notre part des récoltes... nous crevons déjà à moitié de faim. Nos gosses n'arrivent pas à se rassasier. Nous n'avons pas de vêtements, tout est en pièces. Si nos voisins n'étaient pas tout pareils, nous aurions honte de nous montrer aux services.
Et finalement les représentants en vinrent au fait.
- Le système de métayage a fait son temps. Un homme avec un tracteur peut prendre la place de douze à quinze familles. On lui paie un salaire et on prend toute la récolte. Nous sommes obligés de le faire. Ce n'est pas que ça nous fasse plaisir. Mais le monstre est malade. Il lui est arrivé quelque chose, au monstre.
- Mais vous allez tuer la terre avec tout ce coton.
- Nous le savons. A nous de nous dépêcher de récolter du coton avant que la terre ne meure. Après on vendra la terre. Il y a bien des familles dans l'Est qui aimeraient avoir un lopin de terre.
Les métayers levèrent les yeux, alarmes.
- Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Comment allons-nous manger?
- Faut que vous vous en alliez. Les charrues vont labourer vos cours.
Là-dessus les hommes accroupis se levèrent, en colère.
- C`est mon grand-père qui a pris cette terre, et il a fallu qu'il tue les lndiens, qu'il les chasse. Et mon père est né sur cette terre, et il a brûlé les mauvaises herbes et tué les serpents. Et puis y a eu une mauvaise année, et il lui a fallu emprunter une petite somme. Et nous on est nés ici. Là, sur la porte... nos enfants aussi sont nés ici. Et mon père a été forcé d'emprunter de l'argent. La banque était propriétaire à ce moment-là, mais on nous y laissait et avec ce qu`on cultivait on faisait un petit profit.
- Nous savons ça... Nous savons tout ça. Ce n'est pas nous, c'est la banque. Une banque n'est pas comme un homme. Pas plus qu'un propriétaire de cinquante mille arpents, ce n'est pas comme un homme non plus. C'est ça le monstre.
- D`accord, s'écriaient les métayers, mais c'est notre terre. C'est nous qui l'avons mesurée, qui l'avons défrichée. Nous y sommes nés, nous nous y sommes fait tuer, nous y sommes morts. Quand même elle ne serait plus bonne à rien, elle est toujours à nous. Cest ça qui fait qu'elle est à nous... d'y être nés, d'y avoir travaillé, d'y être enterrés. C'est ça qui donne le droit de propriété, non pas un papier avec des chiffres dessus.
- Nous sommes désolés. Ce n`est pas nous. C'est le monstre. Une banque n'est pas comme un homme.
- Oui, mais la banque n'est faite que d'hommes.
- Non, c'est là que vous faites erreur... complètement.
La banque ce n'est pas la même chose que les hommes. ll se trouve que chaque homme dans une banque hait ce que la banque fait, et cependant la banque le fait. La banque est
plus que les hommes, je vous le dis. C'est le monstre. C'est les hommes qui l'ont créé, mais ils sont incapables de le diriger.
Les métayers criaient :
- Grand-père a tué les Indiens, Pa a tué les serpents pour le bien de cette terre. Peut-être qu'on pourrait tuer les banques. Elles sont pires que les Indiens, que les serpents. Peut-être qu'i1 faudrait qu'on se batte pour sauver nos terres comme l'ont fait Grand-père et Pa.
Et maintenant les représentants se fâchaient :
- Il faudra que vous partiez.
- Mais c'est à nous, criaient les rnétayers. Nous...
- Non. C'est la banque, le monstre, qui est le propriétaire. Il faut partir.
- Nous prendrons nos fusils comme Grand-père quand les Indiens arrivaient. Et alors?
- Alors... d'abord le shérif, puis la troupe. Vous serez des voleurs si vous essayez de rester et vous serez des assassins si vous tuez pour rester. Le monstre n'est pas un homme mais il peut faire faire aux hommes ce qu'il veut.
- Mais si nous partons, ou irons-nous? Comment irons-nous? Nous n'avons pas d'argent.
- Nous regrettons, disaient les représentants. La banque, le propriétaire de cinquante mille arpents ne peuvent pas être considérés comme responsables. Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas. Une fois partis vous trouverez peut-être à cueillir du coton à l'automne. Vous pourrez peut-être recevoir des secours du fonds de chômage. Pourquoi n`allez-vous pas dans l'Ouest, en Californie? Il y a du travail là-bas, et il n'y fait jamais froid. Mais voyons, vous avez des oranges partout, il suffit d`étendre la main pour les cueillir. Mais voyons, il y a toujours quelque récolte en train là-bas. Pourquoi n'y allez-vous pas? ....."

John Steinbeck (1902-1968)
Steinbeck n'a pas commencé sa carrière littéraire avant que Lewis et Fitzgerald n'aient atteint leur apogée : il semblait alors venir d'un autre monde, celui de la Great Depression, le monde de la "poverty" de masse, un monde totalement éloigné de celui de Lewis que de celui de Fitzgerald. Né à Salinas en Californie, d'un père trésorier municipal et d'une mère institutrice, John Steinbeck vécut en Californie toute son enfance et son adolescence, dans la «Grande Vallée» de Salinas, région encore exclusivement rurale à l'époque. En 1919, il s`inscrit à l`Université de Standford, étudie la biologie, mais les ranches de Salinas l'intéressent plus que les salles de cours, c`est l`amour de la lecture va l`amène à l`écriture tandis qu'il exerce tous les métiers : il est successivement ouvrier agricole, matelot, travaille sur le chantier du Madison Square Garden à New York, et retourne en Californie où il trouve un poste de gardien dans les montagnes près du lac Tahoe. Il a appris à connaître les pauvres, en particulier les travailleurs agricoles migrants, américains et mexicains, et il a écrit de leur point de vue.
C'est pour Steinbeck une première période littéraire panthéiste et lyrique, et c'est là qu'il écrit son premier roman, "Cup of Gold" (1929), récit d'aventures mettant en scène un boucanier gallois du XVIIe siècle, à la recherche à la fois de la femme idéale et du trésor de Panama. En 1930, il se marie et s'installe à Pacific Grove où il rencontre un biologiste, Edward Ricketts, qui aura une très grande influence sur sa pensée. En 1932 paraissent "Les Pâturages du ciel" (The Pastures of Heaven), chronique de familles de fermiers entre Salinas et Monterey réalisant un rêve intimement lié à la terre et aux saisons; en 1933, " Au Dieu inconnu" (To a God Unknown) qui retrace les difficultés des pionniers du début du siècle sous les traits de Joseph Wayne et de ses frères exploitent une grande ferme en Californie. Ses trois premiers romans ne rencontrent que l'indifférence du public.
La crise de 1930 engage Steinbeck dans une seconde période, celui du roman réaliste et prolétarien dans lequel des hommes sans caractère tentent en vain de sortir de leur condition misérable. C'est avec "Tortilla Flat" (1935) que Steinbeck rencontre son premier succès. Le roman met en scène à Monterey, petit port de pêche californien, une bande de «paisanos» nés d'un «assortiment de sang espagnol, indien, mexicain et caucasien», vivant en marge de la société, insouciants et réfractaires à tout travail. Autant 'Tortilla Flat" est une histoire humoristique sur cette colonie mexico-américaine, autant "In Dubious Battle" est une œuvre sérieuse sur une grève des ouvriers agricoles migrants.
"Des souris et des hommes" (Of Mice and Men) en 1937 connaît un tel succès que Steinbeck en réalise une adaptation théâtrale : le milieu des journaliers agricoles lui permet d'évoquer la force physique, mais aussi l'amitié entre hommes et la fatalité de la sexualité, qui conduit au meurtre. Le roman contient l`essentieI de la pensée et du mode d`expression de l`auteur., la pensée d`écrivain qui ressent et dit la profonde inégalité des chances des êtres face à la vie. Et si dans d`autres œuvres, il fera de ce thème de grandes fresques à caractère social, ici. c'est à un niveau plus intimiste qu'il montre cette injustice immanente que seule les ressources d'amitíé peuvent amender.
"Les Raisins de la colère" (The Grapes of Wrath) en 1939 relate l'exode vers la Californie de fermiers endettés de l'Oklahoma, les Joad, chassés par les grandes banques pour une Californie qui ne sera que déception. Le roman ne fait que transcrire l'une des dénonciations de Steinbeck de la situation des journaliers en Californie suite à la fameuse "Dust Bowl" des années trente qui s'abat sur la grande plaine de l'Oklahoma. Steinbeck montre que les pauvres peuvent survivre en s'aidant les uns les autres, et qu'ils ne peuvent attendre aucune aide de quiconque...
S'ouvre la période des œuvres « engagées» : "En un combat douteux" (In Dubious Battle), publié en 1936, a pour thème la grève et l'action syndicale des ouvriers agricoles de Torgas Valley. "Cannery Row" (1945) marque un retour à la chronique sentimentale des petites gens de Monterey.
"À l'est d'Éden" (East of Eden, 1952), dernier grand roman de Steinbeck, engage une nouvelle et dernière étape, le symbolisme biblique sur fond de saga familiale torturée, - deux fils qui s'opposent à l'image d'Abel et de Caïn - , porte la crise sociale et la crise de culture d'un monde moderne qui livre chacun à la névrose. Le roman sera adapté au cinéma par Elia
Kazan et le rôle principal interprété par un James Dean extraordinaire dans un rôle d'écorché vif. En 1952, John Steinbeck est le scénariste d'Elia Kazan pour "Viva Zapata !", avec Marlon Brandon. Son dernier roman, "L'Hiver de notre mécontentement" (The Winter of Our Discontent, 1961), marque un désenchantement et déclin de l'écrivain...


"TORTILLA FLAT" (1935)
A Monterey, petit port de pêche californien, le quartier populaire de Tortilla Flat est le domaine incontesté des paisanos. Un "paisano", c'est "le produit d`un assortiment de sang espagnol, indien. mexicain et caucasien". L`un des plus misérables de ces paisanos, Danny, hérite de deux masures. Il s`installe dans l'une et loue l'autre à son ami Pilon qui, aussi pauvre que lui, ne sera jamais en mesure de payer le moindre loyer. Pilon prend à son tour comme sous-locataires deux miséreux, Pablo et Jesus-Maria. Une nuit où les trois hommes sont ivres. la maison est entièrement détruite par un incendie. Danny se sent alors délivré du fossé que sa situation de propriétaire commençait à creuser entre lui et ses amis. Après avoir manifesté la colère que la bienséance exige, c`est avec des sentiments fraternels qu'il accepte d`héberger les rescapés de l`incendie. Aux quatre hommes se joignent bientôt le Pirate qu`accompagnent ses cinq chiens, et Big Joe Portagee, dont l`existence se partage habituellement entre la familière prison de Monterey et de pénibles périodes de vagabondage.
Tortilla Flat est la chronique de la vie de ces six hommes unis un moment en une fraternelle communauté. Tous, sauf le brave Pirate, ont un vaste mépris pour le travail. Ils vivent de rapines et des déchets que le Pirate quémande, pour ses chiens, aux portes des restaurants. Le temps qu'ils ne consacrent pas à chaparder. à faire la cour aux prostituées du quartier ou à dormir se passe en énormes beuveries. Aussi leur principale préoccupation est-elle d`obtenir du bootlegger Torrelli le vin dont ils sont si friands. Pour parvenir à leurs fins, ils inventent nombre de stratagèmes, généralement aussi malhonnêtes qu`ingénieux.
Pourtant nos paisanos ne se considèrent pas comme de méchants hommes. Ils se sont créés une religion à eux, mi-chrétienne, mi-païenne, et avant de commettre leurs mauvais coups se lancent -grands moments de bonheurs - dans de grandes palabres casuistiques à l'issue desquelles vols et escroqueries se transforment en actions bonnes et justes.
Cependant la réussite du groupe va produire sa désagrégation : Danny finit par se lasser d`une vie qui devient trop facile et monotone. Après avoir cherché à secouer l`apathie naissante de ses compagnons, il va au-devant d`une mort mystérieuse. Ses amis détruisent alors la maison qui les avait abrités ct se dispersent à nouveau sur les chemins....

En 1942, la MGM et Victor Fleming réalisaient une adaptation de "Tortilla Flat' avec Hedy Lamarr, Spencer Tracy, John Garfield, Frank Morgan.

EN UN COMBAT DOUTEUX (In Dubious Battle, 1936)
L'ouvrage marque un tournant important de la carrière de Steinbeck. Auteur de la romantique "Coupe d'or", du lyrique "A un dieu inconnu" et conteur de "Tortilla Flat", il va donner avec "En un combat douteux" un volumineux roman social, de ton constamment grave et indigné. La richesse de la vallée de Torgas est constituée par l'exploitation de la pomme. Les grands propriétaires ont réduit le salaire des hommes qui louent leurs bras pour la cueillette, et le parti communiste s`efforce d`organiser une grève. Deux militants sont envoyés sur place : Mac, un vétéran, et le jeune Jim, qui vient d`adhérer au parti. Mac et Jim parviennent à déclencher la grève et à organiser les travailleurs. Mais la riposte de l`association des propriétaires, qui dispose de la force publique, est aussi prompte que brutale. La grève échoue après des bagarres où le sang coule, et Jim est abattu. Mais le but principal de la grève était de susciter la combativité des opprimés, et la défaite. en ce "combat douteux", n'est peut-être que provisoire.
L'ouvrage, représentatif du "roman prolétarien" des années 30, est parcouru par un souffle véhément d`indignation, constituant un véritable document sur le climat social de l`époque. Mais on a pu considérer qu'autant la psychologie du groupe était parfaitement rendue, autant celle des individus marquée par une certaine faiblesse ...
AT last it was evening. The lights in the street outside came on, and the Neon restaurant sign on the corner jerked on and off, exploding its hard red light in the air. Into Jim Nolan’s room the sign threw a soft red light. For two hours Jim had been sitting in a small, hard rocking-chair, his feet up on the white bedspread. Now that it was quite dark, he brought his feet down to the floor and slapped the sleeping legs. For a moment he sat quietly while waves of itching rolled up and down his calves j then he stood up and reached for the unshaded light. The furnished room lighted up — the big white bed with its chalk-white spread, the golden-oak bureau, the clean red carpet worn through to a brown warp.
Jim stepped to the washstand in the corner and washed his hands and combed water through his hair with his fingers. Looking into the mirror fastened across the corner of the room above the washstand, he peered into his own small grey eyes for a moment. From an inside pocket he took a comb fitted with a pocket clip and com.bed his straight brown hair, and parted it neatly on the side. He wore a dark suit and a grey flannel shirt, open at the throat. With a towel he dried the soap and dropped the thin bar into a paper bag that stood open on the bed. A Gillette razor was in the bag, four pairs of new socks and another grey flannel shirt. He glanced about the room and then twisted the mouth of the bag closed. For a moment more he looked casually into the mirror, then turned off the light and went out the door.
He walked down narrow, uncarpeted stairs and knocked at a door beside the front entrance. It opened a little. A woman looked at him and then opened the door wider — a large blonde woman with a dark mole beside her mouth.
She smiled at him. “Mis-ter Nolan,” she said.
“I'm going away,” said Jim.
“But you’ll be back, you’ll want me to hold your room?”
“No. I’ve got to go away for good. I got a letter telling me.”
“You didn’t get no letters here,” said the woman suspiciously.
“No, where I work. I won’t be back. I’m paid a week in advance.”
Her smile faded slowly. Her expression seemed to slip toward anger without any great change. “You should of give me a week’s notice,” she said sharply. “That’s the rule. I got to keep that advance because you didn’t give me no notice.”
“I know,” Jim said. “That’s all right. I didn’t know how long I could stay.”
The smile was back on the landlady’s face. “You been a good quiet roomer,” she said, “even if you ain’t been here long. If you’re ever around again, come right straight here. I’ll find a place for you. I got sailors that come to me every time they’re in port. And I find room for them. They wouldn’t go no place else.”
“I’ll remember, Mrs. Meer. I left the key in the door.”
“Light turned out?”
“Yes.”
C'était enfin le soir. Les lumières de la rue s'allumèrent, et le néon du restaurant au coin de la rue s'alluma et s'éteignit, faisant exploser sa lumière rouge dans l'air. Dans la chambre de Jim Nolan, l'enseigne projetait une douce lumière rouge. Depuis deux heures, Jim était assis dans un petit fauteuil en bois dur, les pieds sur le couvre-lit blanc. Maintenant qu'il faisait nuit, il a ramené ses pieds sur le sol et a tapé sur les jambes endormies. Pendant un moment, il est resté assis tranquillement, tandis que des vagues de démangeaisons montaient et descendaient le long de ses mollets, puis il s'est levé et a attrapé la lumière sans ombre. La pièce meublée s'éclaira - le grand lit blanc avec sa couverture blanche comme de la craie, le bureau en chêne doré, le tapis rouge propre et usé jusqu'à la chaîne brune.
Jim s'est approché du lavabo dans le coin, s'est lavé les mains et a passé de l'eau dans ses cheveux avec ses palmes. En regardant dans le miroir fixé dans le coin de la pièce au-dessus du lavabo, il a regardé dans ses propres petits yeux gris pendant un moment. Il a sorti d'une poche intérieure un peigne muni d'un clip de poche et a coiffé ses cheveux bruns et raides, puis les a séparés proprement sur le côté. Il portait un costume sombre et une chemise en flanelle grise, ouverte à la gorge. Avec une serviette, il a séché le savon et a déposé la fine barre dans un sac en papier qui se trouvait ouvert sur le lit. Un rasoir Gillette était dans le sac, quatre paires de chaussettes neuves et une autre chemise en flanelle grise. Il a jeté un coup d'oeil dans la pièce, puis a refermé le sac ...

"DES SOURIS ET DES HOMMES" (Of Mice and Men, 1937)
"Now what the hell ya suppose is eatin' them two guys?" (Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal, ces deux-là, t'as idée, toi?) - Deux journaliers agricoles, Lennie, un géant sans cervelle et George, qui se vouent l'un et l'autre ne vivent une amitié de chiens fidèles, rêvent du jour improbable où ils auront une ferme, un champ de trèfles, une flopée de lapins. Mais un jour, sans l'avoir réellement voulu, Lennie étrangle la femme de son patron et pour lui éviter d'être lynché, George le tue d'une balle dans la nuque....
"A FEW MILES south of Soledad, the Salinas River drops in close to the hillside bank and runs deep and green. The water is warm too, for it has slipped twinkling over the yellow sands in the sunlight before reaching the narrow pool. On one side of the river the golden foothill slopes curve up to the strong and rocky Gabilan mountains, but on the valley side the water is lined with trees - willows fresh and green with every spring, carrying in their lower leaf junctures the debris of the winter’s flooding; and sycamores with mottled, white, recumbent limbs and branches that arch over the pool. On the sandy bank under the trees the leaves lie deep and so crisp that a lizard makes a great skittering if he runs among them. Rabbits come out of the brush to sit on the sand in the evening, and the damp flats are covered with the night tracks of ’coons, and with the spread pads of dogs from the ranches, and with the split-wedge tracks of deer that come to drink in the dark.
There is a path through the willows and among the sycamores, a path beaten hard by boys coming down from the ranches to swim in the deep pool, and beaten hard by tramps who come wearily down from the highway in the evening to jungle-up near water. In front of the low horizontal limb of a giant sycamore there is an ash pile made by many fires; the limb is worn smooth by men who have sat on it.
"À quelques milles au sud de Soledad, la Salinas descend tout contre le flanc de la colline et coule, profonde et verte. L'eau est tiède aussi, car, avant d'aller dormir en un bassin étroit, elle a glissé, miroitante au soleil, sur les sables jaunes.
D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts Gabilan, mais, du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres : des saules, d'un vert jeune quand arrive le printemps, et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver; des sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûte au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment, sous les arbres, un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins, quittant les fourrés, viennent s'asseoir sur le sable, et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs, les grosses pattes des chiens des ranches, et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire dans l'obscurité.
Il y a un sentier à travers les saules et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranches pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui, le soir, descendent de la grand-route, fatigués, pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendre atteste les nombreux feux de bivouac; et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis.
Evening of a hot day started the little wind to moving among the leaves. The shade climbed up the hills toward the top. On the sand banks the rabbits sat as quietly as little gray, sculptured stones. And then from the direction of the state highway came the sound of footsteps on crisp sycamore leaves. The rabbits hurried noiselessly for cover. A stilted heron labored up into the air and pounded down river. For a moment the place was lifeless, and then two men emerged from the path and came into the opening by the green pool.
Au soir d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines. Sur les rives sablonneuses, les lapins s'étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises, sculptées. Et puis, du côté de la grand-route, un bruit de pas se fit entendre, parmi les feuilles sèches des sycomores. Furtivement, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un héron guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant, puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière, au bord de l'eau verte.
Ils avaient descendu le sentier à la file indienne, et, même en terrain découvert, ils restaient l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleue à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couvertures.
L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini: des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, en traînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés.
They had walked in single file down the path, and even in the open one stayed behind the other. Both were dressed in denim trousers and in denim coats with brass buttons. Both wore black, shapeless hats and both carried tight blanket rolls slung over their shoulders. The first man was small and quick, dark of face, with restless eyes and sharp, strong features. Every part of him was defined: small, strong hands, slender arms, a thin and bony nose. Behind him walked his opposite, a huge man, shapeless of face, with large, pale eyes, with wide, sloping shoulders; and he walked heavily, dragging his feet a little, the way a bear drags his paws. His arms did not swing at his sides, but hung loosely.
Le premier homme s'arrêta net dans la clairière, et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il enleva son chapeau et en essuya le cuir avec l'index qu'il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son camarade laissa tomber ses couvertures et, se jetant à plat ventre, se mit à boire à la surface de l'eau verte. Il buvait à grands coups, en renâclant dans l'eau comme un cheval. Le petit homme s'approcha de lui nerveusement.
- Lennie, dit-il sèchement, Lennie, nom de Dieu, ne bois pas tant que ça.
Lennie continuait à renâcler dans l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule.
- Lennie, tu vas te rendre malade comme la nuit dernière.
Lennie plongea toute la tête sous l'eau, y compris le chapeau, puis il s'assit sur la rive, et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans le dos.
- C'est bon, dit-il. Bois-en un peu, George. Bois-en une bonne lampée.
Il souriait d'un air heureux. George détacha son ballot et le posa doucement par terre.
- J'suis point sûr que cette eau soit bonne, dit-il. Elle m'a l'air d'avoir de l'écume.
Lennie trempa sa grosse patte dans l'eau et, agitant les doigts, la fit légèrement éclabousser. Des cercles s'élargirent jusque sur l'autre rive et revinrent vers leur point de départ. Lennie les observait.
- Regarde, George, regarde ce que j'ai fait.
George s'agenouilla sur le bord de l'eau et but dans sa main, à petits coups rapides.
- Au goût, elle a l'air bonne, admit-il. Pourtant, elle n'a pas l'air courante. Tu devrais jamais boire d'eau qu'est pas courante, Lennie, dit-il d'un ton découragé. Tu boirais dans un égout si t'avais soif.
Il se jeta de l'eau à la figure, et se débarbouilla, avec la main, sous le menton et autour de la nuque. Puis il remit son chapeau, s'éloigna un peu du bord de l'eau, releva les genoux qu'il entoura de ses deux bras. Lennie, qui l'avait observé, imita George en tous points. Il se recula, remonta les genoux, les prit dans ses mains et regarda George pour voir s'il avait bien tout fait comme il fallait. Il rabattit un peu plus son chapeau sur ses yeux, afin qu'il fût exactement comme le chapeau de George.
(trad. M-E.Coindreau, Gallimard)
George stared morosely at the water. The rims of his eyes were red with sun glare. He said angrily,
"We could just as well of rode clear to the ranch if that bastard bus driver knew what he was talkin’ about. ‘Jes’ a little stretch down the highway,’ he says. ‘Jes’ a little stretch.’ God damn near four miles, that’s what it was! Didn’t wanta stop at the ranch gate, that’s what. Too God damn lazy to pull up. Wonder he isn’t too damn good to stop in Soledad at all. Kicks us out and says, ‘Jes’ a little stretch down the road.’ I bet it wasmore than four miles. Damn hot day."
Lennie looked timidly over to him. "George?"
"Yeah, what ya want?"
"Where we goin’, George?"
The little man jerked down the brim of his hat and scowled over at Lennie. "So yon forgot that awready, did you? I gotta tell you
again, do I? Jesus Christ, you’re a crazy bastard!"
"I forgot," Lennie said softly. "I tried not to forget. Honest to God !
did, George."
"O.K.- O.K. [ll tell ya again. I ain’t got nothing to do. Might jus’ as well spen’ all my time tellin’ you things and then you forget "em, and I tell you again."
"Tried and tried," said Lennie, "but it didn’t do no good. I remember about the rabbits, George."
"The hell with the rabbits. That’s all you ever can remember is them rabbits. O.K.! Now you listen and this time you got to remember so we don’t get in no trouble. You remember settin’ in that gutter on Howard Street and watchin’ that blackboard?"
Lennie’s face broke into a delighted smile. "Why sure, George. I remember that.... but.... what’d we do then? I remember some girls come by and you says.... you say."
"The hell with what I says. You remember about us goin’ into Murray and Ready’s, and they give us work cards and bus tickets?"
"Oh, sure, George. I remember that now." His hands went quickly into his side coat pockets. He said gently, "George.... I ain’t got mine. I musta lost it," He looked down at the ground in despair.
"You never had none, you crazy bastard. I got both of ’em here. Think Id let you carry your own work card?"
Lennie grinned with relief. "I.... I thought I put it in my side pocket." His hand went into the pocket again.
George looked sharply at him. "What'd you take outa that pocket?"
"Ain't a thing in my pocket," Lennie said cleverly.
George, mélancoliquement, regardait l'eau. Le soleil lui avait rougi le bord des yeux. Il dit, furieux :
- Nous aurions pu tout aussi bien rouler jusqu'au ranch, si ce salaud de conducteur avait
su ce qu'il disait. "Vous avez plus qu'un petit bout de chemin à faire sur la grand-route, qu'il disait, plus qu'un petit bout de chemin." Bon Dieu, près de quatre milles, c'est ça qu'il y avait. Seulement, la vérité, c'est qu'il n'voulait pas s'arrêter à la grille du ranch. Bien trop feignant pour ça. J'me demande s'il n'croit pas au-dessous de lui de s'arrêter à Soledad. Il nous fout dehors, et puis il dit : Plus qu'un petit bout de chemin sur la grand-route! J 'parie qu'il y avait plus de quatre milles. Il fait bougrement chaud.
Lennie le regardait timidement.
- George?
- Oui, qué que tu veux?
- Où c'est-il qu'on va, George?
D'une secousse le petit homme rabattit le bord de son chapeau et jeta sur Lennie un regard
menaçant.
- Alors, t'as déjà oublié ça, hein? Il va falloir encore que je te le redise ? Nom de Dieu, ce que tu peux être con tout de même!
- J 'ai oublié, dit Lennie doucement. J'ai essayé d'pas oublier. Vrai de vrai, j'ai essayé, George.
- Cest bon, c'est bon. J'vais te l'redire: J'ai rien à faire. Autant passer mon temps à te dire les
choses, et puis tu les oublies, et puis faut que je te les redise.
- J'ai essayé et essayé, dit Lennie, seulement ça a servi de rien. J 'me rappelle les lapins, George.
- Fous-moi la paix avec tes lapins. Y a que ça que tu peux te rappeler, les lapins. Allons! Main-
tenant, écoute, et, cette fois, tâche de te rappeler pour qu'on ait pas des embêtements. Tu te rappelles quand t'étais assis sur le bord du trottoir, dans Howard Street, et que tu regardais ce tableau noir?
Un sourire ravi éclaira le visage de Lennie.
- Pour sûr, George, que j'me rappelle ça... mais... qu'est-ce qu'on a fait après? J'me rappelle
qu'il y a des femmes qu'ont passé et que t'as dit... t'as dit...
- T'occupe pas de ce que j'ai dit. Tu te rappelles que nous sommes allés chez Murray and
Ready , et qu'on nous y a donné des cartes de travail et des billets d'autobus ?
- Oui, bien sûr, George, je m'rappelle ça, maintenant.
Ses mains disparurent brusquement dans les poches de côte de sa veste.
Il dit doucement :
- George... J'ai pas la mienne. J'dois l'avoir perdue.
Désespéré, il regardait par terre.
- Tu l'as jamais eue, bougre de couillon. Je les ai toutes les deux ici. Tu te figures que j'te laisserais porter ta carte de travail?
Lennie fit une grimace de soulagement.
- Je... je croyais que j'l'avais mise dans ma poche.
Sa main disparut de nouveau dans sa poche. George lui jeta un regard aigu.
- Qu'est-ce que tu viens de tirer de cette poche ?
- Y a rien dans ma poche, dit Lennie, avec astuce.
- Je l'sais bien. Tu l'as dans ta main. Qu'est-ce que t'as dans la main, que tu caches?
- J'ai rien, George. Bien vrai.
_ Allons, donne-moi ça.
Lennie tenait sa main fermée aussi loin que possible de George.
- C'est rien qu'une souris, George.
- Une souris? Une souris vivante?
- Euh... Rien qu'une souris morte, George. J'l'ai pas tuée. Vrai! J'l'ai trouvée. J'l'ai trouvée
morte.
- Donne-la-moi! dit George.
- Oh! laisse-la-moi, George.
- Donne-la-mol?
La main fermée de Lennie obéit lentement. George prit la souris et la lança de l'autre côté de
la rivière, dans les broussailles.
- Qu'est-ce que tu peux bien faire d'une souris morte ?
- J'pouvais la caresser avec mon pouce pendant qu'on marchait, dit Lennie.
- Ben, tu te dispenseras de caresser des souris quand tu marches avec moi. Tu te rappelles où on va maintenant?
Lennie eut l'air étonné, puis confus; il se cacha la figure sur les genoux.
- J'ai encore oublié...."
George et Lennie sont deux journaliers qui louent leurs bras à travers la Californie dans l'espoir de pouvoir acheter un jour une petite ferme. George est "petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués". Son compagnon, tout au contraire, est "un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes". Ce colosse à l'âge mental d'un enfant; sa seule passion est de caresser des matières soyeuses et douces, les peaux de souris par exemple. Mais il est si fort qu'il finit toujours par tuer les souris en les caressant. Sans George, qui s'est attaché à lui, il ne pourrait vivre. Un jour les deux hommes s'engagent dans le ranch des Curley. La présence de la bru du patron, fille ardente et provocante, et la jalousie exacerbée de son époux font peser une atmosphère tendue sur la communauté. George devine l`imminence de quelque catastrophe sans pouvoir la prévenir...
(le drame, Lennie, la femme de Curley ...)
She laughed "George giving you orders about everything?"
Lennie looked down at the hay. "Says I can't tend no rabbits if I talk to you or anything."
She said quietly, "He's scared Curley'll get mad. Well, Curley got his arm in a sling-an' if Curley gets tough, you can break his other han'. You didn't put nothing over on me about gettin' it caught in no machine."
But Lennie was not to be drawn. "No, sir. I ain't gonna talk to you or nothing."
She knelt in the hay beside him. "Listen," she said "All the guys got a horseshoe tenement goin' on. It' on'y about four o'clock. None of them guys is goin to leave that tenement. Why can't I talk to you? I never get to talk to nobody. I get awful lonely."
Lennie said, "Well, I ain't supposed to talk to you or nothing." "I get lonely," she said. "You can talk to people, but I can't talk to nobody but Curley. Else he gets mad. How'd you like not to talk to anybody?"
Lennie said, "Well, I ain't supposed to. George's scared I'll get in trouble."
She changed the subject. "What you got covered up there?"
"Elle rit :
- C'est George qui te dit toujours ce qu'il faut faire?
Lennie baissa les yeux vers le foin.
-- Il dit que je soignerai pas les lapins si je vous parle, ou autre chose.
Elle dit tranquillement :
- Il a peur que Curley s'mette en colère. Ben. Curley a le bras en écharpe... et si Curley fait le méchant, t'auras qu'à lui écraser l'autre main. J'me suis pas laissé prendre à ton histoire de
machine.
Mais Lennie ne se laissait pas faire :
- Non, non. Sûr que j'vous parlerai pas, ni rien.
Elle s'agenouilla dans le foin, près de lui.
- Écoute, dit-elle. Tout le monde est à jouer aux fers. Il est à peine quatre heures. Ils font un concours. Personne ne partira. Pourquoi donc que je te causerais pas? J'cause jamais à personne. J'me sens horriblement seule.
Lennie dit :
- Enfin, je suis pas supposé vous parler, ni rien.
- J'me sens seule, dit-elle. Toi, tu peux causer aux gens, mais, moi, y a qu'à Curley que j'peux causer. Sans ça, il s'fout en rogne. T'aimerais ça, toi, parler à personne?
Lennie dit :
- J'suis pas supposé le faire. George a peur qu'il m'arrive des ennuis.
Elle changea de sujet :
- Qu'est-ce que c'est que t'as là, recouvert?
Alors, toute la douleur de Lennie lui remonta :
- Mon petit chien, dit-il tristement. Rien que mon petit chien.
Et, d'un coup de main, il balaya le foin qui le recouvrait.
- Mais il est mort! s'écria-t-elle.
- Il était si petit, dit Lennie. On jouait ensemble... et il a fait semblant de me mordre... et j'ai fait semblant de le calotter... et... j'l'ai fait. Et puis, il était mort.
Elle le consola :
- Te tourmente pas, va. C'était qu'un petit cabot. T'en trouveras facilement un autre. Des cabots, y en a plein le pays.
- C'est pas tant ça, expliqua Lennie misérablement, mais, maintenant, George n'me laissera plus soigner les lapins.
- Pourquoi ça?
- Ben, parce qu'il a dit que, si je faisais encore quelque chose de mal, il m'laisserait pas soigner les lapins.
She moved closer to him and she spoke soothingly. "Don't you worry about talkie’ to me. Listen to the guys yell out there. They got four dollars bet in that tenement. None of them ain't gonna leave till it's over."
"If George sees me talkin' to you he'll give me hell," Lennie said cautiously. "He tol’ me so."
Her face grew angry. "Wha's the matter with me?" she cried. "Ain't I got a right to talk to nobody? Whatta they think I am, anyways? You're a nice guy. I don't know why I can't talk to you. I ain't doin' no harm to you." "Well, George says you'll get us in a mess."
"Aw, nuts!" she said. "What kinda harm am I doin' to you? Seems like they ain't none of them cares how I gotta live. I tell you I ain't used to livin' like this. I coulda made somethin' of myself." She said darkly, "Maybe I will yet." And then her words tumbled out in a passion of communication, as though she hurried before her listener could be taken away. "I lived right in Salinas," she said. "Come there when I was a kid. Well, a show come through, an' I met one of the actors. He says I could go with that show. But my of lady- wouldn' let me. She says because I was on'y fifteen. But the guy says I coulda. If I'd went, I wouldn't be livin' like this, you bet."
Lennie stroked the pup back and forth. "We gonna have a little place-an' rabbits," he explained.
She went on with her story quickly, before she should be interrupted. "Nother time I met a guy, an' he was in pitchers. Went out to the Riverside Dance Palace with him. He says he was gonna put me in the movies. Says I was a natural. Soon's he got back to Hollywood he was gonna write to me about it." She looked closely at Lennie to see whether she was impressing him. "I never got that letter," she said. "I always thought my of lady stole it. Well, I wasn't gonna stay no place where I couldn't get nowhere or make something of myself, an' where they stole your letters. I ast her if she stole it, too, an' she says no. So I married Curley. Met him out to the Riverside Dance Palace that same night." She demanded, "You listenin'?"
"Me? Sure."
"Well, I ain't told this to nobody before. Maybe I ought'n to. I don'like Curley. He ain't a nice fella." And because she had confided in him, she moved closer to Lennie and sat beside him.
Elle se rapprocha de lui et lui parla d'un ton câlin:
- Aie pas peur de me causer. Écoute-les tous qui gueulent, là-bas. Y a quatre dollars d'enjeu dans ce concours. Ils n's'en iront pas avant que ça soit fini.
- Si George me trouve en train de vous causer, il m'engueulera, dit Lennie prudemment. Il me l'a dit.
-- Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? dit-elle, le visage furieux. J'ai donc pas l'droit de parler à quelqu'un? Pour qui me prend-on, après tout? T'es gentil garçon. J'vois pas pourquoi j'pourrais pas te causer. J'te fais pas de mal.
- Ben, c'est que George dit que vous nous ferez avoir des histoires.
- Bah! dit-elle. Quel mal veux-tu que je te fasse ? Y en a pas un seul qui ait l'air de s'inquiéter de la vie que je mène ici. Tu peux me croire, j'ai pas été habituée à mener une vie pareille. J'aurais pu devenir quelqu'un.
Elle continua d'une voix sombre :
- Il n'est pas dit que ça n'arrive pas.
Puis, ses mots se précipitèrent dans un désir passionné d'épanchement, comme si elle eût craint qu'on lui enlevât son auditoire.
- J'habitais Salinas, dit-elle. J 'étais toute gosse quand j'y suis venue. Et, un jour, un théâtre s'est amené en ville, et j'ai fait la connaissance d'un des acteurs. Il m'a dit que je pourrais faire partie de la troupe. Mais ma mère n'a pas voulu. Parce que j'avais juste quinze ans, qu'elle disait. Mais le type m'avait dit que j'pourrais. Si je l'avais fait, tu parles que j'mènerais un autre genre de vie.
Lennie caressait le petit chien.
- Nous, on aura une petite ferme... et des lapins, expliqua-t-il.
Elle continua son histoire, rapidement, avant qu'il eût pu l'ínterrompre.
- Une autre fois, j'ai rencontré un type qu'était dans le cinéma. J'suis allée danser avec lui au Riverside Dance Palace. Il m'a dit qu'il me ferait faire du cinéma. Il m'a dit que j'étais née actrice. Dès son retour à Hollywood, il devait m'écrire.
Elle regarda Lennie de tout près, pour voir si elle l'impressionnait.
- J'ai jamais reçu la lettre, dit-elle. J'ai toujours eu dans l'idée que ma mère l'avait chipée. Bref, j'allais pas rester dans un trou où j'arriverais à rien, où j'pourrais pas m'faire un nom, et où on me volait mes lettres. J'lui ai demandé si c'était elle qui me l'avait volée, et elle m'a dit que non. Alors, j'ai épousé Curley. J'l'avais rencontré, ce même soir, au Riverside Dance Palace.
Elle demanda :
- Tu m'écoutes?
- Moi! Bien sûr.
- J'ai encore jamais raconté ça à personne. J'devais peut-être pas. Je n'aime pas Curley. C'est un mauvais garçon.
Et parce qu'elle s'était confiée à lui, elle se rapprocha de Lennie et s'assit près de lui.
- J'aurais pu faire du cinéma, et avoir de belles toilettes... toutes ces jolies toilettes qu'elles portent. Et j'aurais pu m'asseoir dans ces grands hôtels, et on aurait tiré mon portrait. Le premier soir qu'on aurait passé les films, j'aurais pu y aller, et j'aurais parlé à la sans-fil et ça n'm'aurait pas coûté un sou, parce que j'aurais joué dans le film. Et toutes ces belles toilettes qu'elles portent. Parce que le type m'a dit que j'étais née actrice.
Elle leva les yeux vers Lennie et elle esquissa un grand geste du bras et de la main pour montrer qu'elle pouvait jouer. Ses doigts suivaient son poignet conducteur, le petit doigt noblement séparé des autres. Lennie poussa un profond soupir. Au-dehors, un fer tinta sur le métal et des acclamations s'élevèrent.
- Y en a un qu'a encerclé la fiche, dit la femme à Curley.
"Coulda been in the movies, an' had nice clothes-all them nice clothes like they wear. An'I coulda sat in them big hotels, an' had pitchers took of me. When they had them previews I coulda went to them, an' spoke in the radio, an' it wouldn'ta cost me a cent because I was in the pitcher. An' all them nice clothes like they wear. Because this guy says I was a natural." She looked up at Lennie, and she made a small grand gesture with her arm and hand to show that she could act. The fingers trailed after her leading wrist, and her little finger stuck out grandly from the rest.
Lennie sighed deeply. From outside came the clang of a horseshoe on metal, and then a chorus of cheers. "Somebody made a ringer," said Curley's wife.
Now the light was lifting as the sun went down, and the sun streaks climbed up the wall and fell over the feeding racks and over the heads of the horses.
La lumière changeait maintenant que le soleil baissait, et les rais de soleil escaladaient le mur, tombaient sur les râteliers et au-dessus de la tête des chevaux.
Lennie dit :
- Peut-être bien que si j'allais jeter ce petit chien dehors, George ne s'en apercevrait pas. Et alors, j'n'aurais plus de difficultés pour soigner les lapins.
La femme de Curley s'écria, en colère :
- Tu n'peux donc pas penser à autre chose qu'à ces lapins ?
- On aura une petite ferme, expliqua Lennie patiemment. On aura une maison et un jardin, et un carré de luzerne, et cette luzerne sera pour les lapins, et je prendrai un sac, et je le remplirai de luzerne, et puis je l'apporterai aux lapins.
Elle demanda :
- Pourquoi donc que t'aimes tant les lapins?
Lennie dut réfléchir longuement avant d'arriver à une conclusion. Prudemment, il s'approcha d'elle, jusqu'à la toucher.
- J'aime caresser les jolies choses. Un jour, à la foire, j'ai vu de ces lapins à longs poils. Et ils étaient jolis, pour sûr. Des fois même, j'caresse des souris, mais c'est quand j'peux rien trouver de mieux.
Curley's wife moved away from him a little. "I think you're nuts," she said.
"No I ain't," Lennie explained earnestly. "George says I ain't. I like to pet nice things with my fingers, sof" things. "
She was a little bit reassured. "Well, who don't?" she said. "Ever'body likes that. I like to feel silk an' velvet. Do you like to feel velvet?"
Lennie chuckled with pleasure. "You bet, by God," he cried happily. "An' I had some, too. A lady give me some, an' that lady was--my own Aunt Clara. She give it right to me-'bout this big a piece. I wisht I had that velvet right now." A frown came over his face. "I lost it," he said. "I ain't seen it for a long time."
Curley's wife laughed at him. "You're nuts," she said. "But you're a kinda nice fella. Jus' like a big baby. But a person can see kinda what you mean. When I'm doin' my hair sometimes I jus' set an' stroke it 'cause it's so soft." To show how she did it, she ran her fingers over the top of her head. "Some people got kinda coarse hair," she said complacently. "Take Curley. His hair is jus' like wire. But mine is soft and fine. 'Course I brush it a lot. That makes it fine. Here-feel right here." She took Lennie's hand and put it on her head. "Feel right aroun' there an' see how soft it is."
La femme de Curley se recula un peu.
- J 'crois que t'es piqué, dit-elle.
- Non, j'suis pas piqué, expliqua Lennie consciencieusement. George dit que j'le suis pas. J'aime caresser les jolies choses avec mes doigts, les choses douces.
Elle était un peu rassurée.
- Tout le monde est comme ça, dit-elle. Tout le monde aime ça. Moi, j'aime toucher la soie et le velours. Est-ce que t'aimes toucher le velours?
Lennie gloussa de plaisir :
- Vous parlez, bon Dieu! s'écria-t-il avec joie. Et même que j'en ai eu un morceau. C'est une dame qui me l'avait donné, et cette dame, c'était ma tante Clara. Elle me l'a donné, à moi, un morceau grand comme ça, à peu près. J 'voudrais bien l'avoir, ce velours, en ce moment même.
Sa figure se rembrunit.
- J'l'ai perdu, dit-il. Y a bien longtemps que j'l'ai pas vu.
La femme de Curley se moqua de lui :
- T'es piqué, dit-elle. Mais t'es gentil tout de même. On dirait un grand bébé. Mais, on peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux, parce qu'ils sont si soyeux.
Pour montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête.
- Y a des gens qui ont des gros cheveux raides, continua-t-elle avec complaisance, Curley, par
exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. Mais les miens sont fins et soyeux. C'est parce que je les brosse souvent. Cest ça qui les rend fins. Ici... touche, juste ici.
Elle prit la main de Lennie et la plaça sur sa tête.
- Touche là, autour, tu verras comme c'est doux.
De ses gros doigts, Lennie commença à lui caresser les cheveux.
- Ne m'décoiffe pas, dit-elle.
Lennie dit :
- Oh! c'est bon. - Et il caressa plus fort. - Oh! c'est bon.
- Attention, tu vas me décoiffer.
Puis, elle s'écria avec colère :
- Assez, voyons, tu vas toute me décoiffer.
D'une secousse elle détourna la tête, et Lennie serra les doigts, se cramponna aux cheveux.
- Lâche-moi, cria-t-elle. Mais, lâche-moi donc.
Lennie était affolé. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et, de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez.
- Non, j'vous en prie, supplia-t-il. Oh! j'Vous en prie, ne faites pas ça. George se fâcherait.
Elle se débattait vigoureusement, sous ses mains. De ses deux pieds elle battait le foin, et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lennie commença à crier de frayeur.
- Oh! je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. George va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il m'laissera pas soigner les lapins.
Il écarta un peu la main et elle poussa un cri rauque. Alors Lennie se fâcha.
- Allons, assez, dit-il. J'veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires, tout comme a dit George. N'faites pas ça, voyons.
Et elle continuait à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua, et il était furieux contre elle.
- Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant, et le corps s'affaissa comme un poisson...."
Lennie was in a panic. His face was contorted. She screamed then, and Lennie's other hand closed over her mouth and nose. "Please don't," he begged. "Oh! Please don't do that. George'll be mad."
She struggled violently under his hands. Her feet battered on the hay and she writhed to be free; and from under Lennie's hand came a muffled screaming. Lennie began to cry with fright. "Oh! Please don't do none of that," he begged. "George gonna say I done a bad thing. He ain't gonna let me tend no rabbits." He moved his hand a little and her hoarse cry came out. Then Lennie grew angry. "Now don't," he said. "I don't want you to yell. You gonna get me in trouble jus' like George says you will. Now don't you do that." And she continued to struggle, and her eyes were wild with terror. He shook her then, and he was angry with her. "Don't you go yellin'," he said, and he shook her; and her body flopped like a fish.
La femme de Curley fait des avances à Lennie, puis prend peur, et l`idiot, en voulant l'empêcher de crier, la tue. Pour lui éviter le lynchage ou l'asile, George abat lui-même son ami, par-derrière et tout en lui parlant de cette ferme, de ces lapins qu`ils ne posséderont jamais : ainsi s`explique le titre du livre, emprunté à un poème de Robert Bums : "Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas" ...
Poème de l'extrême misère et de la solitude humaine, l'œuvre est coulée dans une forme sans digressions, parfaitement linéaire. Le ton est constamment objectif, sans froideur ni vaine émotion, et tout le récit empreint d'une sobriété grave. Le roman obtint un immense succès des sa publication, et l'adaptation dramatique que l'auteur fit représenter la même année fut accueillie avec la même ferveur ...

Dès 1939, Lewis Milestone réalise une adaptation de "Of Mice and Men" avec Burgess Meredith (George), Lon Chaney Jr. (Lennie), Betty Field (Mae), Charles Bickford (Slim), Bob Steele (Curley), Roman Bohnen (Candy)...
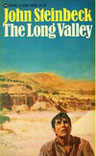
"LA GRANDE VALLÉE" (The Long Valley, 1938)
Dans ce recueil, toutes les nouvelles ont pour cadre la Californie centrale. pays natal de Steinbeck. "La Rafle", qui ouvre le recueil, contient le portrait de deux militants ouvriers d`extrême gauche, un vétéran et son jeune camarade, qui tentent d'organiser une réunion clandestine et sont agressés par la police privée des patrons, puis livrés à la police officielle pour être incarcérés pour "incitation à l`émeute". "Les Chrysanthèmes" et le "Harnais" nous font passer du domaine social à celui de la psychologie individuelle avec deux récits subtils et mesurés. Dans "La Caille blanche" et "Le Serpent", l`écrivain s'abandonne à ce goût quelque peu morbide des cas bizarres et quasi pathologiques dont le précédent recueil, "Les Pâturages du ciel" montrait de trop fréquents exemples. "Johnny l'ours" conjugue insolite et réalisme. Dans un pauvre village entouré de tourbières, un bar rudimentaire constitue l`ensemble des bâtiments publics et, pour les hommes, qui s`y réunissent chaque soir. l`unique source de distraction. Un idiot, "Johnny l'ours", vient y mendier des verres de whisky. Pour obtenir sa boisson, il fait des démonstrations de sa monstrueuse et stupide facilité à répéter avec une précision mécanique les conversations qu'il a pu surprendre. C`est ainsi qu`il rapportera, dans une atmosphère toujours plus tendue, des bribes du drame qui a éclaté dans la plus respectable maison du pays...
L`une des plus belles nouvelles de "La Grande Vallée" a pour héros un garçon de dix-neuf ans indolent et dégingandé, Pépé. Etant un jour allé faire à la ville des commissions pour sa mère, Pépé tue un homme dans une rixe et doit s`enfuir dans la montagne, où il sera abattu après une farouche résistance : le garçon n'est devenu un homme que pour mourir ..
Mais le morceau considéré comme le plus remarquable du recueil est constitué par la longue nouvelle intitulée "Le Poney rouge", qui est assurément l'une des œuvres les plus réussies de l`auteur. Le héros est un enfant, Jody, qui vit avec ses parents et le vacher Billy Buck dans un ranch proche des montagnes. Carl, le père, a offert à Jody un poney roux, que l'enfant, dirigé par Billy Buck, grand spécialiste des chevaux, entreprend de dresser. Mais, un jour, le poney prend froid et meurt malgré les soins de Jody et de Billy. Quelques mois plus tard, Carl propose à son fils de gagner par son travail dans le ranch un poulain de la jument Nellie. La vie de l`enfant est dès lors dominée par l'attente de la naissance du poulain et par les soins à donner à la jument. Son espoir se nuance d`ailleurs d`inquiétude, car sa croyance en l'infaillibilité de Billy Buck a été sérieusement ébranlée par la mort du poney. Pour ne pas décevoir Jody et sauver son poulain, Billy devra d`ailleurs sacrifier la jument lors de la mise bas. A travers les grands événements de la vie d`un enfant, c`est toute la vie d`un ranch que Steinbeck évoque ici avec une simplicité admirable ...

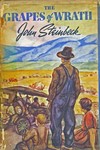
"LES RAISINS DE LA COLERE" (The Grapes of Wrath, 1939)
Tom Joad revient à la petite ferme de son père après quatre ans de pénitencier et entraîne clan familial, avec leurs maigres économies, sur la route de ce nouvel Eden qu'est la Californie : mais à destination, ils doivent affronter l'hostilité des migrants et le combat quotidien de la survie. Tom Joad doit fuir pour avoir vengé son ami le prédicateur Jim Casey, et son discours d'adieu à sa mère, qui clôt le récit, est resté célèbre : "Je serai là dans l'obscurité. Je serai toujours là, où que tu regardes. Partout où on se bagarre pour que les gens qui ont faim puissent manger, je serai là." Mais le roman suscita des réactions violentes, on lui reprocha son obscénité et son évocation de la lutte des classes ...
To the red country and part of the grey country of Oklahoma the last rains came gently, and they did not cut the scarred earth. The ploughs crossed and recrossed the rivulet marks. The last rains lifted the corn quickly and scattered weed colonies and grass along the sides of the roads so that the grey country and the dark red country began to disappear under a green cover. In the last part of May the sky grew pale and the clouds that had hung in high puffs for so long in the spring were dissipated. The sun flared down on the growing corn day after day until a line of brown spread along the edge of each green bayonet. The clouds appeared, and went away, and in a while they did not try any more. The weeds grew darker green to protect ihentselves, and they did not spread any more. I'he surface of the earth crusted, a thin hard crust, and as the sky became pale, so the earth became pale, pink in the red country and white in the grey country.
In the water-cut gullies the earth dusted down in dry little streams. Gophers and ant lions started small avalanches. And as the sharp sun struck day after day, the leaves of the young com became less stiff and erect; they bent in a curve at first, and then, as the central ribs of strength grew weak, each leaf tilted down- ward. Then it was June, and the sun shone more fiercely. The brown lines on the corn leaves widened and moved in on the cen- tral ribs. The weeds frayed and edged back toward their roots. The air was thin and the sky more pale; and every day the earth paled.
(I) "Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de I'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent I'herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un manteau vert. A la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps se dissipèrent. Jour après jour le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liséré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s'éloignaient. Bientôt ils n'essayèrent même plus. Les herbes, pour se protéger, s'habillèrent d'un vert plus foncé et cessèrent de se propager. La surface de la terre durcit, se recouvrit d'une croûte mince et dure, et de même que le ciel avait pâli, de même la terre prit une teinte rose dans la région rouge, et blanche dans la grise.
Dans les ornières creusées par l'eau, la terre s'éboulait en poussière et coulait en petits ruisseaux secs. Mulots et fourmis-lions déclenchaient de minuscules avalanches. Et comme le soleil ardent frappait sans relâche, les feuilles du jeune maïs perdirent de leur rigidité de flèches; elles commencèrent par s'incurver puis, comme les nervures centrales fléchissaient, chaque feuille retomba toute flasque.
Puis ce fut juin et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs le liséré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger et le ciel plus pâle; et chaque jour, la terre pâlissait aussi.
In the roads where the teams moved, where the wheels milled the ground and the hooves of the horses beat the ground, the dirt crust broke and the dust formed. Every moving thing lifted the dust into the air; a walking man lifted a thin layer as high as his waist, and a wagon lifted the dust as high as the fence tops, and an automobile boiled a cloud behind it. The dust was long in settling back again.
When June was half gone, the big clouds moved up out of Texas and the Qulf, high heavy clouds, rain-heads. The men in the fields looked up at the clouds and sniffed at them and held wet fingers up to sense the wind. And the horses were nervous while the clouds were up. The rain-heads dropped a little spattering, and hurried on to some other country. Behind them the sky was pale again and the sun flared. In the dust there were drop craters where the rain had fallen, and there were clean splashes on the com, and that was alK
A gentle wind followed the rain clouds, driving them on north- ward, a wind that softly clashed the drying com, A day went by and the wind increased, steady, unbroken by gusts. The dust from the roads fluffed up and spread out and fell on the weeds beside the fields, and fell into the fields a little way. Now the wind grew strong and hard and it worked at the rain emst in the com-fields. Little by little the sky was darkened by the mixing dust, and the wind felt over the earth, loosened the dust, and carried it away. The wind grew stronger. The rain crust broke and the dust lifted up out of the fields and drove grey plumes into the air like sluggish smoke. The corn threshed the wmd and made a dry, rushing sound. The finest dust did not settle back to earth now, but dis- appeared into the darkening sky.
The wmd grew stronger, whisked under stones, carried up straws and old lcdve.s, and even little clods, marking its course as it sailed across the fields. The air and the sky darkened and through them the sun shone redly, and there was a raw sting in the air. During the night the wind raced faster over the land, dug cun- ningly among the rootlets of the coin, and the corn fought the wind with Its weakened leaves until the roots were freed by the prying wind and then each stalk settled wearily sideways toward the earth and pointed the direction of the wind.
Sur les routes où passaient les attelages, où les roues usaient le sol battu par les sabots des chevaux, la croûte se brisait et la terre devenait poudreuse. Tout ce qui bougeait sur la route soulevait de la poussiere : un piéton en soulevant une mince couche à la hauteur de sa taille, une charrette faisait voler la poussière à la hauteur des haies, une automobile en tirait de grosses volutes après elle. Et la poussière était longue à se recoucher.
A la mi-juin les gros nuages montèrent du Texas et du Golfe, de gros nuages lourds, des pointes d'orage. Dans les champs, les hommes regardèrent les nuages, les reniflèrent et mouillèrent leur doigt pour prendre la direction du vent. Et tant que les nuages furent dans le ciel les chevaux se montrèrent nerveux. Les pointes d'orage laissèrent tomber quelques gouttelettes et se hâtèrent de fuir vers d'autres régions. Derrière elles, le ciel redevenait pâle et le soleil torride. Dans la poussière, les gouttes formèrent de petits cratères ; il resta des traces nettes de taches sur le maïs, et ce fut tout.
Une brise légère suivit les nuages d'orage, les poussant vers le nord, une brise qui fit doucement bruire le maïs en train de sécher. Un jour passa et le vent augmenta, continu, sans que nulle rafale vint l'abattre. La poussière des routes s'éleva, s'étendit, retomba sur les herbes au bord des champs et un peu dans les champs. C'est alors que le vent se fit dur et violent et qu'il attaqua la croûte formée par la pluie dans les champs de maïs. Peu à peu le ciel s'assombrit derrière le mélange de poussières et le vent frôla la terre, fit lever la poussière et l`emporta. Le vent augmenta. La croûte se brisa et la poussière monta au-dessus des champs, traçant dans l`air des plumets gris semblables à des fumées paresseuses. Le maïs brassait le vent avec un froissement sec.
Maintenant, la poussière la plus fine ne se déposait plus sur la terre, mais disparaissait dans le ciel assombri. Le vent augmenta, glissa sous les pierres, emporta des brins de paille et des feuilles mortes et même de petites mottes de terre, marquant son passage à travers les champs.
A travers l'air et le ciel obscurcis le soleil apparaissait tout rouge et il y avait dans l'air une mordante âcreté. Une nuit, le vent accéléra sa course à travers la campagne, creusa sournoisement autour des petites racines de maïs et le maïs résista au vent avec ses feuilles affaiblies jusqu'au moment où, libérées par le vent coulis, les racines lâchèrent prise.
Alors chaque pied s'affaissa de côté, épuisé, pointant dans la direction du vent.
The dawn came, but no day. In the grey sky a red sun appeared, a dim red circle that gave a little light, like dusk; and as that day advanced, the dusk slipped back towards darkness, and the wind cried and whimpered over the fallen corn.
Men and women huddled in their houses, and they tied hand- kerchiefs over their noses when they went out, and wore goggles to protect their eyes.
When the night came again it was black night, for the stars could not pierce the dust to get down, and the window lights could not even spread beyond their own yards. Now the dust was evenly mixed with the air, an emulsion of dust and air. Houses were shut tight, and cloth wedged around doors and windows, but the dust came in so thinly that it could not be seen in the air, and it settled like pollen on the chairs and tables, on the dishes. The people brushed it from their shoulders. Little lines of dust lay at the door sills.
In the middle of that night the wind passed on and left tne land quiet. The dust-filled air muffled sound more completely than fog does. The people, lying in their beds, heard the wind stop. They awakened when the rushing wind was gone. They lay quietly and listened deep into the stillness. Then the roosters crowed, and their voices were muffled, and the people stirred restlessly in their beds and wanted the morning. They knew it would take a long time for the dust to settle out of the air. In the morning the dust hung like fog, and the sun was as red as ripe new blood. AH day the dust sifted down from the sky, and the next day it sifted down. An even blanket covered the earth. It settled on the com, piled up on the tops of the fence posts, piled up on the wires; it settled on roofs, blanketed the weeds and trees.
L'aube se leva, mais non le jour. Dans le ciel gris, un soleil rouge apparut, un disque rouge et flou qui donnait une lueur faible de crépuscule; et à mesure que le jour avançait, le crépuscule redevenait ténèbres et le vent hurlait et gémissait sur le mais couché.
Hommes et femmes se réfugièrent chez eux, et quand ils sortaient ils se nouaient un mouchoir sur le nez et portaient des lunettes hermétiques pour se protéger les yeux.
Quand la nuit revint, ce fut une nuit d`encre, car les étoiles ne pouvaient pas percer la poussière et les lumières des fenêtres n'éclairaient guère que les cours. A présent, la poussière et l'air, mêlés en proportions égales, formaient un amalgame poudreux. Les maisons étaient hermétiquement closes, des bourrelets d'étoffe calfeutraient portes et fenêtres, mais la poussière entrait, si fine qu'elle était imperceptible ; elle se déposait comme du pollen sur les chaises, les tables, les plats. Les gens l'époussetaient de leurs épaules.
De petites raies de poussière soulignaient le bas des portes. Au milieu de cette nuit-là le vent tomba et le silence s'écrasa sur la terre. L'air saturé de poussière assourdit les sons plus complètement encore que la brume. Les gens couchés dans leur lit entendirent le vent s'arrêter. Ils s'éveillèrent lorsque le vent hurleur se tut. Retenant leur souffle, ils écoutaient attentivement le silence. Puis les coqs chantèrent, et leur chant n'arrivait qu'assourdi, alors les gens se tournèrent et se retournèrent dans leurs lits, attendant l'aube avec impatience. Ils savaient qu'il faudrait longtemps à la poussière pour se déposer sur le sol. Le
lendemain matin, la poussière restait suspendue en l'air ...."
"Les Raisins de la colère" ont pour cadre la grande crise économique des années 30. Dans le centre-ouest et le sud-ouest des Etats-Unis, les petits fermiers sont ruinés par l'appauvrissement du sol et la mécanisation de l'agriculture. Alors, leurs créanciers, les banques, s'emparent de leurs terres pour les exploiter directement; avec un tracteur et un conducteur salarié, on peut labourer et ensemencer le territoire sur lequel travaillaient et vivaient des dizaines de familles. Chassés de leurs maisons, les paysans sont condamnés à l'émigration. Des prospectus abondamment répandus prétendent que la riche Californie a besoin de main-d`oeuvre et paie de gros salaires. Ils prennent alors par centaines de milliers, la route de l'Ouest.
Mais, le grand voyage accompli au prix de mille peines, ils découvrent qu'ils sont victimes d'une monstrueuse escroquerie. Le seul travail pour lequel on ait besoin de travailleurs est la cueillette des fruits et du coton, qui ne dure que quelques semaines.
Cependant. en attirant dans le pays une masse de travailleurs très supérieure à leurs besoins réels, les grands propriétaires sont maîtres des salaires et parviennent à faire cueillir leurs récoltes à des tarifs de famine. En outre, les plus grands propriétaires, qui sont généralement des banques. possèdent aussi les conserveries. ce qui leur permet de contrôler le cours des fruits et légumes. En maintenant ces cours très bas, ils ruinent les petits propriétaires, lesquels doivent souvent renoncer à faire cueillir leurs produits. On assiste alors au spectacle hallucinant d`un pays où des milliers de familles d`émigrants meurent de faim, tandis que les tonnes de fruits et de légumes qui leur permettraient de se nourrir sont détruites pour que les cours tiennent.
Menacées sur le marché du travail par l'afflux des nouveaux arrivants, les classes pauvres, loin de se solidariser avec les "étrangers", se laissent aisément manipuler par les grandes puissances financières et se chargent, avec la police locale, de "maintenir l`ordre". Alors, affamés, exploités, traqués par les shérifs et leurs acolytes, les émigrants voient la Terre promise se transformer en un vaste pénitencier. "Les Raisins de la colère" brossent un large tableau de cette situation....
Pour peindre le sort des petits fermiers du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, Steinbeck nous fait suivre l`une de ces familles, les Joad, qui vivaient dans l`Oklahoma. L`un des fils, Tom, a tué, au cours d'une bagarre. un homme qui lui avait porté un coup de couteau. Après quatre ans de prison. il est libéré sur parole. Le roman s`ouvre sur son retour chez lui. Achevant la route à pied, il rencontre un vieil ami de sa famille, un ancien pasteur de la secte du Buisson ardent, Jim Casy, qui a renoncé à prêcher en raison de ses appétits charnels et des doutes qu'il entretient sur la validité de sa mission.
C`est en compagnie de Casy que Tom arrive à la ferme paternelle. A sa grande surprise, il découvre que celle-ci est abandonnée. Un voisin. Muley Graves, lui apprend que tous les fermiers de la région ont été chassés de leurs terres et que ses parents ont gagné la maison de son oncle John, d'où ils s'apprêtent à gagner la Californie. Muley est le seul homme du coin qui s'obstine à ne pas vouloir partir ..
Le lendemain matin, Tom et Jim se rendent chez l'oncle John de Tom, où Muley leur assure qu'ils trouveront le clan Joad. À leur arrivée, Tom trouve les parents Joad en train d'emballer les quelques biens de la famille... Le chapitre 8 nous présente la famille Joad. Steinbeck esquisse un bon nombre de personnages mémorables en l'espace d'un seul chapitre. Pa apparaît comme un chef de famille compétent, impartial et au grand cœur, qui guide les Joad dans leurs périples, tandis que Ma apparaît comme la "citadelle" de la famille, qui les ancre et les protège. Steinbeck ne fera pas des Joad des personnages particulièrement complexes. Les courts chapitres développent l'un des thèmes majeurs du livre, en accusant vendeurs de voitures et prêteurs sur gages véreux, l'auteur illustre l'inhumanité de l'homme envers l'homme, une force contre laquelle les Joad luttent comme ils peuvent. À maintes reprises, les personnes en position de pouvoir cherchent à profiter de ceux qui sont en dessous d'elles. Même lorsque l'abandon d'une parcelle de terre pourrait sauver une famille, les privilégiés refusent de mettre en péril leur richesse. Plus tard nous verrons combien les propriétaires californiens craignent autant que de céder leurs précieuses terres aux fermiers dans le besoin. Ce comportement va ç l'encontre des croyances d'un Jim Casy selon laquelle les êtres humains doivent agir pour le bien de tous. Dans Les Raisins de la colère, l'ordre moral dépend de ce genre d'altruisme et de charité, sans ces vertus, suggère le livre, il n'y a aucun espoir d'un monde vivable....
Chapitre 12, de longues files de voitures empruntent la route 66, remplies de métayers en route pour la Californie, un voyage qui n'est pas sans dangers, lorsque ils s'arrêtent pour acheter des pièces pour leurs voitures, les vendeurs tentent de les escroquer, de station-service en station-service, ils ne rencontrent qu'hostilité et suspicion....
(Chap.13, seconde partie du roman) Le voyage vers la Californie dans un vieux camion branlant est long et pénible. Granpa Joad, un vieil homme fougueux qui se plaint amèrement de ne pas vouloir quitter sa terre, meurt sur la route peu après le départ de la famille. Des voitures et des camions délabrés, chargés de biens de fortune, encombrent la route 66 : il semble que le pays tout entier soit en fuite vers la Terre promise de Californie. Les Joad rencontrent Ivy et Sairy Wilson, un couple qui, ayant des problèmes de voiture, se joint à eux. Sairy Wilson est malade et, près de la frontière californienne, incapable de poursuivre le voyage...
(XV) "Petits bistrots de fortune le long de la 66 - Chez Al et Suzy - Chez Carl, sur le pouce - Restaurant Joe et Minnie - Au casse-croûte. Bicoques en planches bâties de bric et de broc. Deux pompes à essence devant la façade, une porte en toile métallique, un long bar avec tabourets et barre pour les pieds. Près de la porte trois appareils à sous, montrant sous la vitre la fortune en pièces de cinq cents qu'une main experte peut rafler. Et à côté, le phonographe automatique avec des disques empilés comme des crêpes, prêts à glisser sur le plateau et à jouer un air de danse : Ti-pi-zi-pi-tin, Thanks for the Memory. Bing Crosby, Benny Goodman. A un des bouts du comptoir une vitrine couverte; pastilles pour la toux, comprimés de sulfate de caféine appelés Dorpas, Anti-somme; bonbons, cigarettes, lames de rasoir, aspirine, Bromo-Seltzer, Alka-Seltzer. Les murs décorés d'affiches, baigneuses blondes en maillots blancs avec de gros seins, des hanches minces et des visages de cire, tenant à la main une bouteille de Coca-Cola... avec le sourire... voilà ce qu'on gagne à prendre du Coca-Cola. Long bar avec salières, poivrières, pots à moutarde et serviettes en papier. Barils de bière derrière le comptoir et dans le fond, les percolateurs reluisants et fumants, avec des tubes de verre pour marquer le niveau du café. Et des tartes dans leurs cages en fil de fer et des oranges en pyramides de quatre. Et des petits tas de gâteaux secs, de flocons de maïs échafaudés en dessins variés.
Cartons-réclames rehaussés de mica brillant : "Tartes à la mode de chez nous", "Le Crédit crée des ennemis, soyons amis", "Les Dames sont autorisées à fumer, mais attention aux mégots", "Venez manger ici et gardez votre femme comme objet d'agrément", "Isywybad" (If will you, will you buy a drink)?"
A l'un des bouts du comptoir, les plaques chauffantes, du terrines de ragoût, pommes de terre, bœuf bouilli, rôti de bœuf, rôtis de porc gris attendant d'être coupés en tranches.
Derrière le comptoir, Minnie, Susy ou Mae, entre deux âges, cheveux bouclés, rouge et poudre sur une face en sueur. Prenant les commandes d`une voix douce et les transmettant au cuisinier avec un cri de paon. Essuyant le comptoir à grands coups de torchon circulaires, astiquant les grands percolateurs brillants. Le cuisinier s`appelle Joe ou Carl ou Al. ll a chaud sous son veston blanc et son tablier ; gouttes de sueur perlant sur son front blanc, sous son bonnet blanc de cuisinier; lunatique, peu parleur, il lève les yeux une seconde chaque fois qu'entre un client. Il torche le gril, flanque le steak haché sur la plaque. Il répète à mi-voix les commandes de Mae, racle son gril, le torche avec un morceau de serpillière. Lunatique et silencieux.
Mae établit le contact, souriante, irritée, prête à éclater, souriante tandis que son regard se perd dans un passé lointain... sauf pour les camionneurs. Cest sur eux que repose la boîte. Où les camions s'arrêtent c'est là que viennent les clients. Pas moyen de rouler les conducteurs de camions, ils s'y connaissent. lls amènent la clientèle. Ils s`y connaissent. Donnez-leur du café pas frais et ils ne remettent plus les pieds dans la boîte. Si on les traite bien, ils reviennent. Mae sourit de toutes ses dents quand elle voit entrer des camionneurs. Elle se redresse un peu, arrange ses cheveux par-derrière afin que ses seins se tendent en suivant le mouvement de ses bras levés, fait un bout de causette et parle de grandes choses, de bon temps, de bonnes blagues.
Al ne parle jamais. Il n'établit pas le contact. Parfois il sourit..."
Des scènes dramatiques ou pathétiques se succèdent rapidement, mais le drame ne tourne jamais au mélodrame ou le pathétique à la sensiblerie, ainsi la scène suivante : un travailleur migrant, désespérément pauvre, s'arrête avec ses deux garçons à un casse-croûte au bord de la route pour acheter une miche de pain. La serveuse ne veut pas être dérangée ; elle attend deux camionneurs qui sont certainement de meilleurs clients. Mais elle cède et finit par laisser à chaque garçon un peu de bonbon à cinq cents pour un penny. La scène est discrète, une courte scène dans laquelle chacun exprime un peu de son humanité ..
The Grapes of Wrath Chapter 15
". . .The transport truck, a driver and relief. How ’bout stoppin’ for a cup a Java? I know this dump.
How’s the schedule?
Oh, we’re ahead!
Pull up, then. They’s a of war horse in here that’s a kick. Good Java, too.
The truck pulls up. Two men in khaki riding trousers, boots, short jackets, and shiny-visored military caps. Screen door-slam.
H’ya, Mae!
Well, if it ain’t Big Bill the Rat! When’d you get back on this run?
Week ago.
The other man puts a nickel in the phonograph, watches the disk slip free and the turntable rise up under it. Bing Crosby’s voice-golden. “Thanks for the memory, of sunburn at the shore - You might have been a headache, but you never were a bore - ” And the truck driver sings for Mae’s ears, you might have been a haddock but you never was a whore -
Mae laughs. Who’s ya frien’, Bill? New on this run, ain’t he?
The other puts a nickel in the slot machine, wins four slugs, and puts them back. Walks to the counter.
Well, what’s it gonna be?
Oh, cup a Java. Kinda pie ya got?
Banana cream, pineapple cream, chocolate cream - an’ apple.
Make it apple. Wait - Kind is that big thick one?
Mae lifts it out and sniffs it. Banana cream.
Cut off a hunk; make it a big hunk.
Man at the slot machine says, Two all around.
Two it is. Seen any new etchin’s lately, Bill?
Well, here’s one.
Now, you be careful front of a lady.
Oh, this ain’t bad. Little kid comes in late to school. Teacher says, “Why ya late?” Kid says, “Had a take a heifer down - get ’er bred.” Teacher says, “Couldn’t your of man do it?” Kid says, “Sure he could, but not as good as the bull.”
Mae squeaks with laughter, harsh screeching laughter. Al, slicing onions carefully on a board, looks up and smiles, and then looks down again. Truck drivers, that’s the stuff. Gonna leave a quarter each for Mae. Fifteen cents for pie an’ coffee an’ a dime for Mae. An’ they ain’t tryin’ to make her, neither.
Sitting together on the stools, spoons sticking up out of the coffee mugs. Passing the time of day. And Al, rubbing down his griddle, listening but making no comment. Bing Crosby’s voice stops. The turntable drops down and the record swings into its place in the pile. The purple light goes off. The nickel, which has caused all this mechanism to work, has caused Crosby to sing and an orchestra to play - this nickel drops from between the contact points into the box where the profits go. This nickel, unlike most money, has actually done a job of work, has been physically responsible for a reaction.
Steam spurts from the valve of the coffee urn. The compressor of the ice machine chugs softly for a time and then stops. The electric fan in the corner waves its head slowly back and forth, sweeping the room with a warm breeze. On the highway, on 66 , the cars whiz by.
“They was a Massachusetts car stopped a while ago,” said Mae.
Big Bill grasped his cup around the top so that the spoon stuck up between his first and second fingers. He drew in a snort of air with the coffee, to cool it. “You ought to be out on. Cars from all over the country. All headin’ west. Never seen so many before. Sure some honeys on the road.”
“We seen a wreck this mornin’,” his companion said. “Big car. Big Cad, a special job and a honey, low, cream color, special job. Hit a truck. Folded the radiator right back into the driver. Must a been doin’ ninety. Steerin’ wheel went right on through the guy an’ lef him a-wigglin’ like a frog on a hook, Peach of a car. A honey. You can have her for peanuts now. Drivin’ alone, the guy was.”
Al looked up from his work. “Hurt the truck?”
“Oh, Jesus Christ! Wasn’t a truck. One of them cut-down cars full a stoves an’ pans an’ mattresses an’ kids an’ chickens. Goin’ west, you know. This guy come by us doin’ ninety — r’ared up on two wheels just to pass us, an’ a car’s cornin’ so he cuts in an whangs this here truck. Drove like he’s blin’ drunk. Jesus, the air was full a bed clothes an’ chickens an’ kids. Killed one kid. Never seen such a mess. We pul- led up. Of man that’s drivin’ the truck, he jus’ stan’s there lookin’ at that dead kid. Can’t get a word out of ’im. Jus’ rum-dumb (slang, not saying a word). God Almighty; the road is full a them families goin’ west. Never seen so many. Gets worse all a time. Wonder where the hell they all come from?” ‘‘Wonder where they all go to,” said Mae. “Come here for gas sometimes, but they don’t hardly never buy nothin’ else. People says they steal. We ain’t got nothin’ layin’ around. They never stole nothin’ from us.”
Big Bill, munching his pie, looked up the road through the screened window. “Better tie your stuff down. I think you got some of ’em cornin’ now.”
A 1926 Nash sedan pulled wearily off the highway. The back seat was piled nearly to the ceiling with sacks, with pots and pans, and on the very top, right up against the ceiling, two boys rode. On the top of the car, a mattress and a folded tent; tent poles tied along the running board.
The car pulled up to the gas pumps. A dark-haired, hatchet- faced man got slowly out. And the two boys slid down from the load and hit the ground.
Mae walked around the counter and stood in the door. The man was dressed in gray wool trousers and a blue shirt, dark blue with sweat on the back and under the arms. The boys in overalls and nothing else, ragged patched overalls. Their hair was light, and it stood up evenly all over their heads, for it had been roached. Their faces were streaked with dust. They went directly to the mud puddle under the hose and dug their toes into the mud.
The man asked, “Can we git some water, ma’am?”
A look of annoyance crossed Mae’s face. “Sure, go ahead.” She said softly over her shoulder, “I’ll keep my eye on the hose.” She watched while the man slowly unscrewed the radiator cap and ran the hose in.
A woman in the car, a flaxen-haired woman, said, “See if you can’t git it here.” The man turned off the hose and screwed on the cap again. The little boys took the hose from him and they upended it and drank thirstily. The man took off his dark, stained hat and stood with a curious humility in front of the screen.
Une Nash 1926 se mettait pesamment sur le bord de la route. I'arrière était plein, presque jusqu'en haut, de sacs, de batterie de cuisine, et tout à fait au sommet, tout contre le toit, il y avait deux petits garçons. Sur le dessus de la voiture, un matelas et une tente pliée; piquets de tente attachés le long du marchepied. L'auto roula jusqu'aux pompes à essence. Un homme aux cheveux noirs et au visage en lame de couteau en descendit lentement. Et les deux enfants se laissèrent glisser du haut du chargement et mirent pied à terre.
Mae fit le tour du comptoir et resta sur la porte. L'homme portait un pantalon de laine grise et une chemise bleue que la sueur avait foncée sur le dos et sous les bras. Les petits garçons ne portaient que des bleus et rien d'autre, des bleus dépenaillés et rapiécés. Leurs cheveux blonds se dressaient tout droits et régulièrement sur leurs crânes, car ils avaient été rasés court. Ils avaient la figure striée de poussière. Ils se rendirent directement à la flaque d'eau sale sous le tuyau et enfoncèrent leurs orteils dans la boue.
L'homme demanda :
- Pouvons-nous prendre de l'eau, madame?
Le visage de Mae prit une expression ennuyée :
- Allez-y, servez-vous. (Et doucement, par-dessus son épaule elle dit :) J' vais surveiller mon tuyau.
Elle regarda attentivement l'homme dévisser son bouchon de radiateur et adapter le tuyau.
Une femme dans la voiture, une femme aux cheveux de lin, dit :
- Vois si on ne pourrait pas t'en donner ici.
L'homme ferma le robinet et revissa le bouchon. Les petits garçons lui prirent le tuyau des mains, en soulevèrent l'extrémité et burent avidement. L'homme enleva son chapeau noir tout taché et resta debout, étrangement humble, devant le châssis de la porte.
“Could you see your way to sell us a loaf of bread, ma’am?”
Mae said, “This ain’t a grocery store. We got bread to make san’widges.”
“I know, ma’am.” His humility was insistent. “We need bread and there ain’t nothin’ for quite a piece, they say.”
“ ’F we sell bread we gonna run out.” Mae’s tone was faltering.
“We’re hungry,” the man said.
“Whyn’t you buy a san’widge? We got nice san’widges, hamburgs.”
“We’d sure admire to do that, ma’am. But we can’t. We got to make a dime do all of us.” And he said embarrassedly, “We ain’t got but a little.”
Mae said, “You can’t get no loaf a bread for a dime. We only got fifteen-cent loafs.” From behind her Al growled, “God Almighty, Mae, give ’em bread.”
“We’ll run out ’fore the bread truck comes.”
“Run out, then, goddamn it,” said Al.
And he looked sullenly down at the potato salad he was mixing.
Mae shrugged her plump shoulders and looked to the truck drivers to show them what she was up against.
She held the screen door open and the man came in, bringing a smell of sweat with him. The boys edged in behind him and they went immediately to the candy case and stared in — not with craving or with hope or even with desire, but with a kind of wonder that such things could be. They were alike in size and their faces were alike. One scratched his dusty ankle with the toe nails of his other foot. The other whispered some soft message and then they straightened their arms so that their clenched fists in the overall pockets showed through the thin blue cloth.
Mae opened a drawer and took out a long waxpaperwrappered loaf. “This here is a fifteen-cent loaf.”
The man put his hat back on his head. He answered with inflexible humility, “Won’t you — can’t you see your way to cut off ten cents’ worth?”
Al said snarlingly, “Goddamn it, Mae. Give ’em the loaf.”
The man turned toward Al. “No, we want ta buy ten cents’ worth of it. We got it figgered awful close, mister, to get to California.”
Mae said resignedly, “You can have this for ten cents.”
“That’s be robbin’ you, ma’am.”
“Go ahead — Al says to take it.” She pushed the waxpapered loaf across the counter. The man took a deep leather pouch from his rear pocket, untied the strings, and spread it open. It was heavy with silver and with greasy bills.
“May soun’ funny to be so tight,” he apologized. “We got a thousan’ miles to go, an’ we don’ know if we’ll make it.” He dug in the pouch with a forefinger, located a dime, and pinched in for it. When he put it down on the counter he had a penny with it. He was about to drop the penny back into the pouch when his eye fell on the boys frozen before the candy counter. He moved slowly down to them. He pointed in the case at big long sticks of striped pep- permint. “Is them penny candy, ma’am?”
Mae moved down and looked in. “Which ones?”
“There, them stripy ones.”
The little boys raised their eyes to her face and they stopped breathing; their mouths were partly opened, their half-naked bodies were rigid.
“Oh — them. Well, no — them’s two for a penny.”
“Well, gimme two then, ma’am.” He placed the copper cent carefully on the counter. The boys expelled their held breath softly. Mae held the big sticks out.
“Take ’em,” said the man.
They reached timidly, each took a stick, and they held them down at their sides and did not look at them. But they looked at each other, and their mouth corners smiled rigidly with embarrassment.
“Thank you, ma’am.” The man picked up the bread and went out the door, and the little boys marched stiffly behind him, the red-stripecl sticks held tightly against their legs. They leaped like chipmunks over the front seat and onto the top of the load, and they burrowed back out of sight like chipmunks.
The man got in and started his car, and with a roaring motor and a cloud of blue oily smoke the ancient Nash climbed up on the highway and went on its way to the west.
From inside the restaurant the truck drivers and Mae and Al stared after them.
Big Bill wheeled back. “Them wasn’t two-for-a-cent candy,” he said.
“What’s that to you?” Mae said fiercely.
“Them was nickel apiece candy,” said Bill.
“We got to get goin’,” said the other man. “We’re dropping time.” They reached in their pockets. Bill put a coin on the counter and the other man looked at it and reached again and put down a coin. They swung around and walked to the door.
“So long,” said Bill.
Mae called, “Hey! Wait a minute. You got change.”
“You go to hell,” said Bill, and the screen door slammed.
Mae watched them get into the great truck, watched it lumber off in low gear, and heard the shift up the whining gears to cruising ratio. “Al — ” she said softly.
He looked up from the hamburger he was patting thin and stacking between waxed papers. “What ya want?”
“Look there.” She pointed at the coins beside the cups — two half-dollars. Al walked near and looked, and then he went back to his work.
“Truck drivers,” Mae said reverently...'
- Des fois, vous ne pourriez pas nous vendre une miche de pain, madame?
Mae dit :
- Ce n'est pas une boulangerie ici. Nous avons du pain pour faire des sandwiches.
- Je sais, madame. Son humilité se faisait tenace. Il nous faut du pain et on nous a dit qu`on ne trouverait rien d'ici un bout de temps sur la route.
- Si nous vendons du pain, nous nous trouverons à court. Mae commençait à faiblir.
- Nous avons faim, dit l'homme.
- Pourquoi que vous ne prenez pas des sandwiches? Nous avons de bons sandwiches, aux saucisses.
- Sûr qu”on aimerait faire ça, madame. Mais on peut pas. On n'a plus que dix cents pour nous tous. (Et il ajouta embarrassé :) Nous n'avons que bien peu de chose.
Mae dit :
-- Vous ne pouvez pas avoir une miche de pain pour dix cents. Nos miches sont à quinze cents.
Derrière elle Al grogna :
- Eh bon Dieu, Mae, donne-leur du pain.
- Nous serons à court, avant que le boulanger passe.
- Eh bien, nous serons à court, qu'est-ce que ça fout? dit Al, et il s'absorba de nouveau d'un air renfrogné dans la salade de pommes de terre qu'il était en train de préparer.
Mae haussa ses épaules dodues et regarda les camionneurs pour les prendre à témoin des difficultés contre lesquelles elle avait à lutter. Elle tint le châssis métallique ouvert et l'homme entra dans une odeur de sueur. Les enfants se faufilèrent derrière lui et allèrent immédiatement à la vitrine des bonbons qui leur fit ouvrir de grands yeux, des yeux où ne se lisait ni l'envie, ni l'espoir, ni même le désir, mais une espèce d'émerveillement que de semblables choses pussent exister. Ils étaient de la même taille et se ressemblaient physiquement. L'un d'eux grattait sa cheville poussiéreuse avec les ongles de l'autre pied. L'autre murmura quelque chose à voix basse puis ils raidirent leurs bras de sorte que leurs poings fermés dans les poches de leurs salopettes se dessinaient à travers la fine étoffe bleue.
Mae ouvrit un tiroir et en tira une miche de pain enveloppée de papier glacé.
- Voilà une miche de quinze cents.
L'homme repoussa son chapeau sur sa tête. Il répondit avec une inflexible humilité :
- Est-ce que vous ne voudriez pas... est-ce que vous ne pourriez pas trouver moyen de nous en couper pour dix cents ?
Al dit hargneusement :
- Mae, donne-leur donc cette miche, nom de Dieu !
L'hornme se tourna vers Al :
- Non, nous voulons en acheter pour dix cents. Nous avons calculé au plus juste pour arriver en Californie.
Mae, résignée, dit :
- Vous pouvez prendre cette miche pour dix cents.
-- Ça serait vous voler, madame.
- Allez... c'est Al qui vous dit de la prendre.
Elle poussa le pain dans son papier glacé sur le comptoir.
L'homme sortit de sa poche de derrière une grande bourse en cuir, en défit les cordons et l'ouvrit. Elle était lourde d'argent et de billets crasseux.
- Ça peut avoir l'air drôle d'être si près de ses sous, dit-il en manière d'excuse. Nous avons mille milles à faire et nous ne savons pas si nous pourrons les faire.
Il plongea l'index et le pouce dans la bourse, trouva dix cents et s'en saisit. Quand il posa la pièce sur le comptoir il avait également un penny. Il était sur le point de remettre le sou dans la bourse quand il vit les yeux des enfants rivés sur la vitrine des bonbons. Il s'approcha d'eux lentement. Il montra du doigt de longs sucres d'orge à la menthe, ornés de raies.
- Est-ce que ces bonbons sont à un sou, madame?
Mae s'approcha et regarda dans la vitrine :
- Lesquels?
- Ceux-là, les rayés.
Les petits enfants levèrent les yeux vers elle et cessèrent de respirer; leurs bouches étaient entrouvertes et leurs corps demi-nus étaient rigides.
- Oh... ceux-là. Hmm, non... ceux-là sont deux pour un sou.
- Alors, donnez-m'en deux, madame.
Il déposa le sou en bronze soigneusement sur le comptoir. Les enfants laissèrent échapper doucement la respiration qu'ils retenaient. Mae leur tendit les gros sucres d'orge.
- Prenez, dit Fhomme.
Ils avancèrent timidement la main, se saisirent chacun d'un bâton et le tinrent au bout de leurs bras ballants, sans le regarder. Mais ils se regardaient mutuellement, avec un petit sourire au coin des lèvres, un sourire crispé, embarrassé.
- Merci, madame.
L'homme prit le pain et sortit, et les petits garçons le suivirent d”un pas rapide, les sucres d'orge rayés bien serres contre leurs jambes. Ils bondirent comme des écureuíls par-dessus le siège avant, se faufilèrent au haut du chargement et, comme des écureuils, ils disparurent dans leur trou.
L'homme monta et mit en marche, et dans un bruit de tonnerre et un nuage bleu de fumée d'huile, la vieille Nash remonta sur la grand-route et s'éloigna vers l'Ouest.
De l'intérieur du restaurant les camionneurs, Mae et Al les suivirent des yeux.
Le grand Bill se retourna :
- C'était pas des bonbons à deux pour un sou, dit-il.
- Qu'est-ce que ça peut vous faire? dit sauvagement Mae.
- C'était des sucres d'orge à cinq cents pièce, dit Bill.
- Faut nous mettre en route, dit l'autre homme. Nous perdons notre temps.
Ils fouillèrent dans leurs poches. Bill posa une pièce sur le comptoir et l'autre la regarda et fouillant de nouveau posa lui aussi une pièce. Ils firent demi-tour et se dirigèrent vers la porte.
- Au revoir, dit Bill.
Mae appela :
- Hé! Une minute... et votre monnaie?
- Allez vous faire foutre, dit Bill, et le châssis métallique claqua en se refermant.
Mae les regarda monter dans le grand camion, les regarda démarrer en première et entendit le grincement du changement de vitesse quand il prit son allure de route.
-- Al... dit-elle doucement.
Il leva les yeux du steak haché qu'il aplatissait et mettait entre deux couches de papier glacé.
- Qu'est-ce que tu veux?
- Regarde.
Elle montra les pièces près des tasses, deux demi-dollars. Al s'approcha et regarda, puis il se remit au travail.
-- Des conducteurs de camion, dit Mae avec respect, et après ces merdeux...
Les mouches se heurtaient contre le grillage de la porte et s`éloignaient en bourdonnant. Le compresseur ronfla un instant et se tut. Sur la nationale 66 le mouvement continuait : camions, jolies voitures aérodynamiques, vieux tacots; et tous passaient avec un chuintement mauvais. Mae prit les assiettes et fit tomber la croûte des tartes dans un baquet. Elle prit son torchon humide et essuya le comptoir à grands coups circulaires. Et ses yeux étaient sur la route où la vie passait à fond de train...."
Alors que les Joad approchent de la Californie, ils entendent des rumeurs inquiétantes sur l'épuisement du marché du travail. Un migrant raconte à Pa que 20 000 personnes se présentent pour 800 emplois et que ses propres enfants sont morts de faim.
Chapitre 18 - Après avoir traversé les montagnes du Nouveau-Mexique et le désert de l'Arizona, les Joad et les Wilson arrivent en Californie, mais ils doivent encore traverser le désert qui se trouve entre eux et les vallées luxuriantes qu'ils attendent ...
Bien que les Joad poursuivent leur route, leurs premiers jours en Californie s'avèrent tragiques : Granma Joad meurt. Les autres membres de la famille se déplacent d'un camp sordide à l'autre, cherchant en vain du travail, luttant pour trouver de la nourriture et essayant désespérément de maintenir la cohésion de leur famille. Noah, l'aîné des enfants Joad, abandonne bientôt la famille, tout comme Connie, une jeune rêveuse mariée à la sœur enceinte de Tom, Rose de Sharon.
Les Joad rencontrent beaucoup d'hostilité en Californie. Les camps sont surpeuplés et remplis de migrants affamés, qui ne cessent de se quereller entre eux. Les habitants craignent ces nouveaux arrivants, qu'ils appellent avec dérision "Okies". Il est presque impossible de trouver du travail ou le salaire est si maigre qu'une journée entière de travail ne permet pas à une famille de s'acheter de quoi se nourrir suffisamment. Craignant un soulèvement, les grands propriétaires terriens font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les migrants restent pauvres et dépendants. Alors qu'ils séjournent dans un camp délabré connu sous le nom de "Hooverville", Tom et plusieurs hommes se disputent vivement avec un shérif adjoint pour savoir si les travailleurs doivent s'organiser en syndicat. Lorsque la dispute devient violente, Jim Casy assomme le shérif et est arrêté. Des policiers arrivent et annoncent leur intention de brûler le Hooverville.
(Chap.22) Un camp géré par le gouvernement s'avère beaucoup plus accueillant pour les Joad, et la famille trouve rapidement de nombreux amis et un peu de travail. Cependant, un jour, alors qu'il travaille à la pose de tuyaux, Tom apprend que la police prévoit d'organiser une émeute dans le camp, ce qui lui permettra de fermer les installations. En alertant et en organisant les hommes du camp, Tom contribue à désamorcer le danger. Cependant, aussi supportable que soit la vie dans le camp du gouvernement, les Joad ne peuvent pas survivre sans un travail régulier et doivent se tourner vers une autre direction. Ils trouvent un emploi dans la cueillette des fruits, mais apprennent rapidement que s'ils gagnent enfin un salaire décent, c'est uniquement parce qu'ils ont été engagés pour briser une grève. C'est durant cet épisode que Tom rencontre à nouveau Jim Casy : celui-ci, après avoir été libéré de prison, a commencé à organiser les travailleurs ; ce faisant, Casy s'est fait de nombreux ennemis parmi les propriétaires terriens. Lorsque la police le traque et le tue en présence de Tom, ce dernier riposte en tuant un policier.
Tom se cache, tandis que la famille s'installe dans un wagon dans une ferme de coton. Un jour, Ruthie, la plus jeune des filles Joad, révèle à une fille du camp que son frère a tué deux hommes et se cache à proximité. Craignant pour sa sécurité, Ma Joad trouve Tom et l'envoie au loin. Tom s'en va accomplir la tâche de Jim, qui est d'organiser les travailleurs migrants. La fin de la saison du coton signifie la fin du travail, et la nouvelle se répand dans tout le pays qu'il n'y aura pas de travail pendant trois mois. Les pluies s'installent et inondent la terre. Rose de Saron donne naissance à un enfant mort-né, et Ma, désespérée de mettre sa famille à l'abri des inondations, la conduit dans une grange sèche non loin de là. Là, ils trouvent un jeune garçon agenouillé devant son père, qui meurt lentement de faim. Il n'a pas mangé depuis des jours et a donné tout ce qu'il avait à son fils. Réalisant que Rose of Sharon produit maintenant du lait, Ma envoie les autres dehors, afin que sa fille puisse allaiter le mourant.
A destination, nos héros ont été dans l'obligation d'affronter l'hostilité des migrants et le combat quotidien de la survie. Tom Joad a du fuir pour avoir vengé son ami le prédicateur Jim Casey, et son discours d'adieu à sa mère, qui clôt le récit, est resté célèbre : "Je serai là dans l'obscurité. Je serai toujours là, où que tu regardes. Partout où on se bagarre pour que les gens qui ont faim puissent manger, je serai là..."
(XXVIII)
"And then a wind stirred the willows delicately, as though it tested them, and a shower of golden leaves coasted down to the ground. Sud- denly a gust boiled in and racked the trees, and a cricking downpour of leaves fell. Ma could feel them on her hair and on her shoulders. Over the sky a plump black cloud moved, erasing the stars. The fat drops of rain scattered down, splashing loudly on the fallen leaves, and the cloud moved on and unveiled the stars again. Ma shivered. The wind blew past and left the thicket quiet, but the rushing of the trees went on down the stream. From back at the camp came the thin penetrating tone of a violin feeling about for a tune...
... Une légère brise agita doucement les saules, comme pour les mettre à l'épreuve, et une pluie de feuilles d'or s'en vint doucement joncher la terre. Et soudain une rafale inattendue secoua les arbres, provoquant une avalanche de feuilles tourbillonnantes. Ma les sentait tomber sur ses cheveux et sur ses épaules. Un épais nuage noir passa dans le ciel, effaçant les étoiles. Les grosses gouttes de pluie s'écrasèrent avec fracas sur les feuilles mortes, tandis que le nuage, poursuivant sa route, découvrait de nouveau les astres. Ma frissonna. Le vent avait fui et le calme était revenu dans le fourré, mais le bruissement des feuilles continuait plus bas, au bord de Peau. Du campement, vint le son aigu, pénétrant, d'un violon en quête d'une mélodie.
Ma entendit des pas furtifs au loin sur sa gauche. Elle se figea, les nerfs tendus. Elle libéra ses genoux et releva la tête pour mieux entendre. Le mouvement s'arrêta, mais reprit au bout d`un long moment. Il y eut un crissement rêche d'herbe sur les feuilles séchées. Ma vit une forme sombre se détacher du couvert et se couler vers l'entrée du tuyau. Le trou rond et noir fut un instant dérobé à ses yeux, puis l'ombre réapparut et se remit en mouvement.
- Tom! appela-t-elle à voix basse.
La silhouette s'immobilisa, se figea si près du sol qu'on eût pu la prendre pour une souche. Elle appela de nouveau :
- Tom! Tom!
Alors la silhouette remua.
- C'est toi, Ma?
-- Par ici.
Elle se redressa et s'avança à sa rencontre.
- T'aurais pas dû venir, dit-il.
- Fallait que je te voie, Tom. J'ai à te parler.
- Le sentier est tout près. Il pourrait passer quelqu'un.
-- Tu n'as pas une cachette, Tom ?
- Si... mais... enfin, admettons que quelqu'un te voie en train de me parler... Toute la famille serait dans le pétrin.
- Il le faut, Tom.
- Alors viens. Mais ne fais pas de bruit.
Il traversa le ruisseau, poussant négligemment ses longues jambes dans le courant, et Ma le suivit. Puis il se glissa à travers les broussailles et suivit la trace des sillons. Les branches noirâtres des cotonniers découpaient sur le sol leur profil heurté; quelques flocons pendaient çà et là. Tom suivit le bord du champ pendant près d`un quart de mille puis il s'enfonça de nouveau dans la brousse. Il se dirigea vers un haut fourré de ronces et de mûriers sauvages, se courba et écarta un matelas d'herbes.
- Faut que tu te mettes à quatre pattes, dit-il.
Ma obéit. Ses mains touchèrent du sable, la masse des ronces ne l'enveloppait plus, et elle sentit sous elle la couverture de Tom. ll remit en place le matelas d`herbes. L'obscurité était complète dans la caverne.
- Où es-tu, Ma?
- Ici. Tiens, ici. Parle bas, Tom.
- N'aie pas peur, Ma. Ça fait un bout de temps que je fais le lapin de garenne.
Elle l'entendit déballer l'assiette de fer-blanc.
- Des côtes de porc, dit-eile. Et des frites.
- Dieu Tout-Puissant ! Encore toutes chaudes!
Ma ne le voyait pas dans le noir, mais elle l'entendait mastiquer, mordre à même la viande et avaler.
- C'est pas mal comme terrier, dit-il.
Man lui dit, gênée :
- Tom... Ruthie a bavardé... sur toi.
Il faillit s'étrangler.
- Ruthie? Comment ça se fait?
- Ben, c'était pas sa faute. Elle s'est battue avec d'aut' gosses et elle s`est vantée que son frère flanquerait une raclée au frère de Faut' fille. Tu sais comment ça se passe. Et elle a
dit que son frère avait tué un homme et se cachait.
Tom rigolait doucement.
- Moi, de mon temps, je les menaçais toujours d'envoyer l'oncle John à leurs trousses, mais il n'a jamais voulu s'en mêler. C'est des histoires de gosses, Ma. C'est pas grave.
- Si, c`est grave, dit Ma. Tous ces gamins vont aller le raconter à droite et à gauche, ça viendra aux oreilles des gens, les gens en parleront... et on ne sait jamais... ils sont capables d'envoyer des hommes voir si y a pas du vrai là-dedans. Tom, il faut que tu partes.
- C'est ce que j'avaís dit dès le début. Je craignais toujours que quelqu'un ne te voie poser des trucs dans le tuyau et ne se mette à l'affût.
- Je sais. Mais je voulais t'avoir près de moi. ]'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne t'ai pas encore vu. Je ne peux pas te voir en ce moment. Comment va ta figure?
- Ça guérit vite.
- Approche-toi, Tom. Laisse-moi te toucher. Viens tout près.
A quatre pattes, il vint près d'elle. La main de Ma tâtonna, trouva sa tête dans le noir et ses doigts se glissèrent sur son visage, le long du nez, puis sur sa joue gauche.
- Tu as une profonde cicatrice, Tom. Et ton nez est tout de travers.
- C'est peut-être une bonne chose. Comme ça personne ne me reconnaîtra, peut-êt' bien. Si on n'avait pas pris nos empreintes digitales, je serais plus content.
Il se remit à manger.
- Chut! dit-elle. Ecoute!
- C'est le vent, Ma. Rien que le vent.
Une rafale courut dans le creux du ruisseau, soulevant un léger bruissement sur son passage.
Se guidant sur sa voix, elle se rapprocha.
- Laisse-moi te toucher encore, Tom. J'ai l'impression d'être aveugle, il fait tellement sombre. Je veux pouvoir me rappeler, même si c'est que mes doigts qui se rappellent. Il faut que tu partes, Tom.
- Ouais! Je le savais depuis le début.
- Nous avons gagné pas mal, dit-elle. J'ai pu gratter un peu et en mettre de côté. Donne ta main, Tom, j'ai là sept dollars.
- Je ne veux pas de ton argent, dit-il. Je me débrouillerai.
- Ouvre ta main, Tom. Je ne pourrai pas dormir si tu pars sans argent. Il se peut que t'aies besoin de prendre l'autobus, ou aut' chose. Il faut que tu t'en ailles très loin, à trois ou quatre cents milles d'ici.
- J' le prendrai pas.
- Tom, dit-elle sévèrement. Prends cet argent, Tu entends? Tu n`as pas le droit de me faire du mal.
- C'est pas loyal c' que tu fais là, Ma.
- Je me suis dit que tu pourrais peut-êt' aller dans une grande ville. A Los Angeles, par exemple. Il ne viendrait à l'idée de personne d'aller te chercher là-bas.
“Hm-m,” he said. “Lookie, Ma. I been all day an’ all night hidin’ alone. Guess who I been thinkin’ about? Casy! He talked a lot. Used ta bother me. But now I been thinkin’ what he said, an’ I can remember— all of it. Says one time he went out in the wilderness to find his own soul, an’ he foun’ he didn’ have no soul that was his’n. Says he foun’ he jus’ got a little piece of a great big soul. Says a wilderness ain’t no good, ’cause his little piece of a soul wasn’t no good ’less it was with the rest, an’ was whole. Funny how I remember. Didn’ think I was even listenin’. But I know now a fella ain’t no good alone.”
“He was a good man,” Ma said.
Tom went on, “He spouted out some Scripture once, an’ it didn’ soun’ like no hell-fire Scripture. He tol’ it twicet, an’ :I remember it. Says it’s from the Preacher.”
“How’s it go, Tom?”
- Hum, fit-il. Ecoute voir, Ma. Ça fait des jours et des nuits que je suis là caché tout seul. Devine un peu à quoi je pensais? A Casy! Il causait tout le temps. Ça me tracassait, je me rappelle. Mais là j'ai réfléchi à ce qu'il disait, et je me le suis rappelé... tout. Il disait qu'une fois il était allé dans le désert pour tâcher de trouver son âme, et qu'il avait découvert qu'il n`avait pas d'âme à lui tout seul. Il disait qu'il avait découvert que tout ce qu'il avait, c'était un petit bout d'une grande âme. Disait que le désert et la solitude, ça ne rimait à rien, à cause que ce petit bout d'âme c'était zéro s'il ne faisait pas partie du reste, s'il ne formait pas un tout.
Drôle que j'aie souvenance de tout ça. J' me rendais même pas compte que je l'écoutais. Maintenant je sais qu'on ne peut arriver à rien tout seul.
- C'était un brave homme, dit Ma.
Tom reprit :
- Une fois il nous a sorti des trucs de l'Ecriture Sainte, mais ça ressemblait pas du tout à l'Ecriture où il est toujours question du Feu de l'Enfer. Deux fois il l'a répété, je m'en souviens bien. Il disait que c'était tiré du Prédicateur.
- Comment que ça dit, Tom?
- Ça dit : "Deux valent mieux qu'un, car ils sont mieux payés de leurs peines. Car s'ils tombent, l'un aidera l'autre à se relever. Mais malheur à qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever." En voilà un bout.
- Continue, dit Ma. Continue, Tom.
- Y en a plus qu'un peu. Et encore : "Si deux sont couchés côte à côte, ils se réchauffent, mais comment se réchauffer lorsqu'on est seul? Et si un l'emporte sur lui, deux le soutiendront, et une corde à trois brins ne se rompt pas aisément."
- Et c'est dans les Saintes Ecritures?
- C'est ce que disait Casy, Il appelait ça "Le Prédicateur".
- Chut... Ecoute.
“On’y the wind, Ma. I know the wind. An’ I got to think- in’, Ma— most of die preachin’ is about the poor we shall have a,lways with ,us, an’ if you got nothin’, why, jus’ fol’ youi hands an’ to hell with it, you gonna git ice cream on goF'- plates when you’re dead. An’ then this here Preacher says two get a better reward for their work.”
“Tom,” she said. “What you aimin’ to do?”
He w^as quiet for a long time. “I been thinkin’ how it was in that gov’ment camp, how our folks took care a theirselves, an’ if they was a fight they fixed it theirself; an’ they wasn’t no cops wagglin’ their guns, but they was better order than them cops ever give. I been a-wonderin’ why we can’t do that all over. Throw out the cops that ain’t our people. All work together for our own thing— all farm our own Ian’.”
"TTom,” Ma repeated, “what you gonna do?”
“What Casy done,” he said.
“But they lolled him.”
“Yeah,” said Tom. “He didn’ duck quick enough. He wasn’ doing nothin’ against the law, Ma. I been thinkin’ a hell of a lot, thinkin’ about our people livin’ like pigs, an’ the good rich Ian’ layin’ fallow, or maybe one fella wdth a million acres, while a hunderd thousan’ good farmers is starvin’. An' I been wonderin’ if all our folks got together an’ yelled, like them fellas yelled, only a few of ’em at the Hooper ranch — ”
Ma said, “Tom, they’ll drive you, an’ cut you down like they done to young Floyd.”
- Ce n'est que le vent, Ma. Je connais le vent. Alors j`ai réfléchi, Ma... que presque tous les sermons c'est toujours sur les pauvres et la pauvreté. Si vous ne possédez rien, eh ben, joignez les mains, ne vous occupez pas du reste; quand vous serez mort, vous mangerez des ortolans dans de la vaisselle en or. Et voilà que le Prédicateur en question, il dit que deux sont mieux payés de leur peine.
- Tom, fit-elle. Qu'est-ce que t'as dans l`idée de faire ?
Il resta longtemps silencieux :
- J'ai pensé à ce qui se passait là-bas au camp du Gouvernement... Les nôtres s'arrangeaient très bien tout seuls; quand il y avait une bagarre, ils liquidaient l'affaire eux-mêmes; et y avait pas de flics qui venaient vous secouer leur revolver sous le nez, et pourtant il y avait beaucoup moins de grabuge qu'avec toute cette police et toutes leurs histoires. Je me suis demandé pourquoi on ne pourrait pas refaire la même chose en grand. Foutre à la porte tous ces flics qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne sont pas des nôtres. Travailler tous pour une même chose - cultiver notre propre terre.
- Tom, répéta Ma. Qu'est-ce que tu vas faire?
- Ce qu'a fait Casy, répondit-il.
- Mais ils l'ont tué !`
- Ouais, dit Tom. ll n'a pas esquivé assez vite. Il ne faisait rien d'illégal, Ma. T' sais, j'ai réfléchi un sacré bout à la question - à me dire que les nôtres vivaient comme des cochons avec toute cette bonne terre qu'était en friche, ou dans les mains d'un type qu'en a p'têt` bien un million d'arpents, pendant que plus de cent mille bons fermiers crèvent de faim. Et ie me suis dit que si tous les nôtres s'unissaient tous ensemble et commençaient à gueuler comme les autres à la grille l'aut' jour - et ils n`étaient que quèq' z' uns, note bien, à la ferme Hooper...
Ma dit :
- Tom, tu seras pourchasse, traqué et coincé comme le garçon des Fioyd.
- Ils me pourchasseront de toute façon. Ils pourchassent tous les nôtres.
- T'as pas dans l'idée de tuer quelqu'un, Tom?
- Non, j'avais pensé... tant qu`à faire, puisque j' suis hors-la-loi, que j'pourrais peut-être... Bon Dieu, c`est pas encore bien clair dans ma tête, Ma. Ne me tourmente pas. Laisse-moi réfléchir.
Ils restèrent silencieusement accroupis dans le trou noir, au creux du buisson de ronces. Ma dit enfin :
.- Comment que j'aurais de tes nouvelles ? Ils pourraient te tuer que j' en saurais rien. Il pourrait t'arriver du mal. Comment que je le saurais?
Tom eut un rire gêné :
-Ben, peut-êt' que, comme disait Casy, un homme n'a pas d'âme à soi tout seul, mais seulement un morceau de l'âme unique; à ce moment-là...
They sat silent in the coal-black cave of vines. Ma said, "How’m I gonna know ’bout you? They might kill ya an’ I wouldn’ know. They might hurt ya. How’m I gonna know?”
Tom laughed uneasily, "Well, maybe like Casy says, a fella ain’t got a soul of his own, but on’y a piece of a big one— an'then—
“Then what, Tom?”
“Then it don’ matter. Then Fll be all aroun’ in the dark. I'lI be ever’where - wherever you look. Wherever they’s a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever they’s a cop bearin’ up a guy, I'll be there. If Casy knowed, why, I’ll be in the way; guys yell when they’re mad an’— I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry an’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in, the houses they build— why, I’ll be there. See? God, - I'm talkin’ like Casy. Comes of thinkin’ about him so much. Seems like I can see him sometimes.”
"I don'un’erstan’,” Ma said. “I don’ really know.”
“Me neither,” said Tom.“It’s jus’ stuff I been thinkin’ about. Get thinkin’ a lot when you ain’t movin’ aroun’. You got to get back, ,Ma.”'
- A ce moment-là, quoi, Tom?
- A ce moment-là, ça n'a plus d'importance. Je serai toujours là, partout, dans l'ombre. Partout ou tu porteras les yeux. Partout où y aura une bagarre pour que les gens puissent avoir à manger, je serai là. Partout où y aura un flic en train de passer un type à tabac, je serai là. Si c'est comme Casy le sentait, eh ben dans les cris des gens qui se mettent en colère parce qu'ils n'ont rien dans le ventre, je serai là, et dans les rires des mioches qu'ont faim et qui savent que la soupe les attend, je serai là. Et quand les nôtres auront sur leurs tables ce qu'ils auront planté et récolté, quand ils habiteront dans les maisons qu'ils auront construites... eh ben, je serais là. Comprends-tu ? Ça y est, bon sang, v'là que je cause comme Casy. Ça vient de tant penser à lui. Des fois, j'ai comme l'impression qu'il est là, que je le vois.
- Je ne peux pas te dire... fit Ma. Je ne comprends pas assez bien.
- Moi non plus, fit Tom. C'est simplement des trucs à quoi j'ai réfléchi. C'est que la cervelle travaille dur quand on est là à ne rien faire. Il est temps que tu rentres, Ma.
- Alors prends l'argent.
Il resta un instant silencieux.
- C'est bon, dit-il finalement.
- Et dis-moi, Tom... Plus tard... Quand tout se sera tassé, tu nous reviendras. Tu saurais nous retrouver?
- Tu peux et' sûre, fit-il. Maintenant va vite. Tiens, donne-moi la main.
Il la guida vers l'entrée. Les doigts de Man agrippaient son poignet. Il écarta les herbes et sortit avec elle.
- Suis le bord du champ jusqu'au sycomore qu`est au bout, et là, tu passeras le ruisseau. Au revoir.
-" Good-by,” she said, and she walked quickly away. Her eyes were wet and burning, but she did not cry. Her foot-steps were loud and careless on the leaves as she went through the brush. And as she went, out of the dim sky the rain began to fall, big drops and few, splashing on the dry leaves heavily. Ma stopped and stood still in the dripping thicket. She turned about— took three steps back toward the mound of vines; and then she turned quickly and went back toward the boxcar camp. She went straight out to the culvert and climbed up on the road. The rain had passed now, but the sky was overcast. Behind her on the road she heard footsteps, and she turned nervously. The blinking of a dim flashlight played on the road. Ma turned back and started for home. In a moment a man caught up with her. Politely, he kept his light on the ground and did not play it in her face.
- Au revoir, dit-elle,
Et elle s'éloigna rapidement. Ses yeux étaient humides et la piquaient, mais elle ne pleura pas. Elle s'avançait pesamment à travers les broussailles, insoucieuse du bruit que faisaient ses souliers sur les feuilles sèches. Et tandis qu'elle s'acheminait vers le camp, du ciel sombre la pluie se mit à tomber, en grosses gouttes isolées qui s'écrasaient lourdement sur les feuilles. Ma s'arrêta et se tint immobile au cœur du fourré ruisselant. Elle fit demi-tour,... fit trois pas vers la masse sombre du buisson de ronces; puis elle se retourna brusquement et se remit en marche vers le camp aux wagons. Elle prit directement par la conduite et grimpa sur la route. La pluie avait cessé ; mais le ciel restait couvert.
Elle entendit des pas derrière elle et se retourna, pas très rassurée. La faible lueur d`une lampe de poche clignotait sur la route. Ma continua son chemin. L'instant d'après, un homme la rattrapa. Poliment, il tint le jet de la lampe par terre, s'abstenant de lui éclairer le visage.
- Soir, fit-il.
- Salut bien, dit Ma.
- M'est avis que nous allons avoir un peu de pluie...."
(trad. M.Duhamel et M.-E.Coindreau, Gallimard)
La fin des Raisins de la colère est l'un des chapitres de conclusion les plus mémorables de la littérature américaine. Tom perpétue l'héritage de Jim Casy en promettant de vivre sa vie en se consacrant à une âme plus grande que la sienne. Reconnaissant la vérité dans les enseignements du Christ Casy, Tom se rend compte que la plus grande vocation d'une personne est de se mettre au service du bien collectif. En quittant sa famille pour se battre pour la justice sociale, Tom achève la transformation amorcée plusieurs chapitres plus tôt. Alors qu'il n'avait au départ ni la patience ni l'énergie nécessaires pour envisager l'avenir, il s'engage dans la lutte pour que cet avenir soit plus doux et plus agréable....

C'est en 1939-1940 que John Ford adapte "The Grapes of Wrath", le chef-d'oeuvre littéraire de la Dépression, toujours incontesté, et l'adaptation cinématographique va égaler puissance son modèle romanesque. Cette épopée américaine pétrie de références implicites aux mythes de la Frontière, à l'exode biblique et à l'aspiration transcendantale du moi américain, a singulièrement éclipsé le reste de son oeuvre.
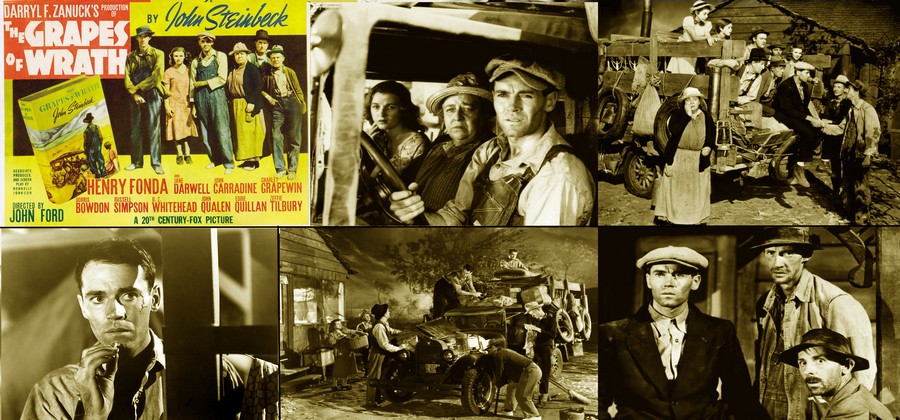

Lorsque fut décerné à Steinbeck le prix Nobel de littérature en 1962 (a life's work in the agony and sweat of the human spirit"), ses détracteurs firent ironiquement observer que l'oeuvre de sa vie s'était achevée vingt-trois années auparavant sur un superbe roman. Sa gloire littéraire est en partie redevable au génie qu'il manifeste, dans la diversité de l'expérience de son engagement social, à puiser aux sources de l'individualisme américain quand le Rêve était alors exposé à des dangers sans précédent. On se rappelle que le poète Walt Whitman avait entrepris d'écrire un récit épique "Song of Myself" (Leaves of Grass, 1892), en définissant trois étapes du développement individuel, le bien-être physique dans le contact étroit avec la terre, la perception aiguë d'une identité génétique dans le sentiment filial, la conscience progressive d'une appartenance à l'oversoul émersonienne et à la famille humaine, un triptyque que l'on retrouve dans l'évolution de Tom Joad. En faisant accéder ce dernier à l'individualisme de Ralph Waldo Emerson et de Whitman, Steinbeck semble signifier dans son roman le triomphe de l'esprit humain sur la tyrannie multiforme du capitalisme. Celui-ci a trahi les idéaux démocratiques traditionnels de l'homme du peuple contre qui se sont dressés les milieux de la finance, les grandes exploitations agricoles et autres pouvoirs disposant, face aux travailleurs, de moyens illégaux ou paramilitaires...

"RUE DE LA SARDINE" (Cannery Row, 1945)
"La Rue de la Sardine, à Monterey en Californie, c'est un poème ; c'est du vacarme, de la puanteur, de la routine, c'est une certaine irisation de la lumière, une vibration particulière, c'est de la nostalgie, c'est du rêve. La Rue de la Sardine, c'est le chaos. Chaos de fer, d'étain, de rouille, de bouts de bois, de morceaux de pavés, de ronces, d'herbes folles, de boîtes au rebut, de restaurants, de mauvais lieux, d'épiceries bondées et de laboratoires. Ses habitants, a dit quelqu'un : «ce sont des filles, des souteneurs, des joueurs de cartes et des enfants de putains» ; ce quelqu'un eût-il regardé par l'autre bout de la lorgnette, il eût pu dire : «ce sont des saints, des anges et des martyrs», et ce serait revenu au même. " (Editions Gallimard)
Lee Chong’s grocery, wliile not a model of neatness, was a miracle of supply. It was small and crowded but within its single room a man could find everything he needed or wanted to live and to be happy — clothes, food, both fresh and canned, liquor, tobacco, fishing equipment, machinery, boats, cordage, caps, pork-diops. You could buy at Lee Chong’s a pair of slippers, a silk kimono, a quarter-pint of whisky and a cigar. You could work out combinations to fit almost any mood. The one commodity Lee Chong did not keep could be had across the lot at Dora’s.
The grocery opened at dawn and did not close until the last wandering vagrant dime had been spent or retired for the night. Not that Lee Chong was avaricious. He wasn’t, but if one wanted to spend money, he was available. Lee’s position in the community surprised him as much*as he could be surprised. Over the course of the years everyone in Cannery Row owed him money. He never pressed his clients, but when the bill became too large, Lee cut o£E credit. Rather than walk into the town up the hill, the client usually paid or tried to.
Lee was roumd-faced and courteous. He spoke a stately English without ever using the letter R. When the tong wars were going on in California, it happened now and then that Lee found a price on his head. Then he would go secretly to San Francisco and enter a hospital until the trouble blew over. What he did with his money, no one ever knew. Perhaps he didn’t get it. Maybe his wealth was entirely in unpaid bills. But he lived well and he had the respect of all his neighbours. He trusted his clients until further trust became ridiculous. Sometimes he made busi- ness errors, but even these he turned to advantage in good will if in no other way. It was that way with the Palace Flophouse and Grill. Anyone but Lee Chong would have considered the transaction a total loss...
La "Rue de la Sardine" se déroule à Monterey, port de la côte californienne qui avait déjà servi de cadre au célèbre "Tortílla Flat" du même auteur. La populeuse et peu respectable rue de la Sardine, proche de la mer, abrite mille vies misérables, industrieuses et souvent étonnantes. Aucune intrigue suivie ne relie donc les divers récits qui composent le volume. Mais les mêmes personnages reparaissent d'une histoire à l'autre et l'ouvrage ne tombe jamais dans le disparate. Les événements contés gravitent autour de trois points principaux : l'épicerie de Lee Chong, le "Laboratoire biologique de l'Ouest", le domaine de "Doc", le "Palais des coups", masure qui sert d'abri à Mack et à sa bande de joyeux lurons. Lee Chong, dont la boutique contient les produits les plus hétéroclites, est le créancier de tous les gens du quartier. Commerçant tout-puissant et astucieux, il n'est cependant pas insensible aux drames qu'il côtoie. « Doc ››, lui, exporte à travers les Etats-Unis toute la faune terrestre et sous-marine de la côte du Pacifique. C'est un amateur de grande musique et un cœur généreux; il est vénéré et admiré par tous les habitants de la rue de la Sardine. Mack et ses copains, les personnages de premier plan du roman, vivent de chapardages et de petits travaux occasionnels, refusant l'esclavage de tout travail suivi. Ce sont des anarchistes sans théorie ni aigreur, de grands indivídualistes et, comme nous le laisse entendre l'auteur, de véritables sages. Leurs aventures, comme celles des héros de Tortilla Flat, sont aussi nombreuses que variées et savoureuses. Truculentes, picaresques, cocasses, les histoires de Rue de la Sardine témoignent d'une sensibilité aux choses de la nature, d'une grande tendresse envers les humbles ....
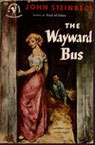
"LES NAUFRAGES DE L'AUTOCAR" (The Wayward Bus, 1947)
"Une panne oblige les voyageurs d'un autocar à passer la nuit dans une station-service, sur la grande autoroute de Californie. La panne réparée, un nouvel incident immobilise pendant des heures les voyageurs en pleine montagne. De chacun des naufragés de l'autocar, Steinbeck trace un portrait étonnant, dévoilant le drame ou la comédie de son existence entière. Chacun des voyageurs perd la tête, est assailli par des tentations sexuelles, nous livre un instant son âme secrète." (Editions Gallimard)
En Californie. entre San Ysidro et San Juan, au lieu-dit "Le Coin-des-Rebelles", se dresse l` "épicerie-restaurant-garage-station service" du ménage Chicoy, lequel exploite également la ligne d`autocar reliant San Ysidro à San Juan. Juan Chicoy, qui frise la cinquantaine, est le fils d`un Mexicain et d`une Irlandaise. ll y a bien des années, il a quitté le Mexique parce que "là-bas, à moins d`être très riche, il faut travailler trop dur pour gagner trop peu". C`est un homme d'expérience, dont la vie a connu bien des vicissitudes, mais qui garde une flamme de jeunesse, un humour peut-être irlandais et la mâle beauté de ses ancêtres indiens. Sa femme, Alice, en est éperdument amoureuse; mais, se sentant vieillir et devinant l`indifférence de Juan, elle s`aigrit et ne parvient à oublier ses rides que dans l`alcool. Un soir, la "Bien-Aimée", le vieil autocar de Juan, tombe en panne au Coin-des-Rebelles, et patron et employés doivent céder leurs chambres aux cinq voyageurs qui se rendaient à San Juan : un homme d`affaires cossu, M. Pritchard, sa femme, Bernice, et sa fille. Mildred, qui vont tous trois en vacances au Mexique; un représentant en farces et attrapes, Ernest Horton, et un vieillard acariâtre, M. Van Brunt. Le lendemain, lorsque l'autocar est réparé, une autre voyageuse se joint au groupe : c'est une très jolie fille, qui prétend s`appeler Camille Oaks et être aide-dentiste. mais. en fait, gagne sa vie en exécutant des numéros de strip-tease.
Cependant, nous sommes en pleine saison des pluies et la rivière San Ysidro menace d`emporter le pont que doit traverser la "Bien-Aimée".
Apres avoir consulté ses passagers, Juan Chicoy doit donc emprunter une vieille piste défoncée qui évite la rivière. Tout en roulant, Juan est envahi par un grand dégoût pour sa vie régulière, bourgeoise, et envisage de fuir le Coin-des-Rebelles, Alice et le confort californien pour rejoindre à pied le Mexique. Il décide finalement de remettre son sort entre les mains de la Vierge de la Guadeloupe. dont la figurine est fixée à son pare-brise : si l`autocar atteint San Juan sans encombre, il retournera auprès d`Alice, mais si une difficulté surgit, ce sera le signe qu`il peut reprendre sa liberté. Mais dans son exaltation, Juan ne peut s`empêcher de tricher et il enlise volontairement la "Bien-Aimée" dans le sol détrempé.
Alors. sous le prétexte d`aller chercher du secours, il abandonne ses passagers.
Au cours des heures suivantes, ceux-ci, livrés à eux-mêmes dans une nature hostile, laissent tomber le masque des conventions et montrent leur vrai visage. Le conformiste M. Pritchard se révèle, sous des dehors autoritaires, un homme timoré. pusillanime et naïf, qui, sans en être conscient, se laisse entièrement diriger par son épouse. Frigide. égoïste et bornée, celle-ci ne cesse de faire planer sur les siens la menace des fameuses crises de migraine qui bouleversent leur vie. Mildred Pritchard, qui a vingt et un ans, s`efforce d`échapper à l`atmosphère étouffante de son milieu familial. Ernest Horton. qui vient d'être démobilisé, reste, malgré son bagou et son esprit d`entreprise, profondément troublé par la guerre. Van Brunt, qui a déjà eu deux attaques, est obnubilé par l`approche de la mort et, dans sa terreur, prend en haine la bonne santé de ses compagnons. Camille, qui exerce une violente attraction sur les hommes, est une fille à la tête froide, qui a pour ambition de faire un bon mariage ou, au moins, de se faire entretenir par un riche et respectable protecteur. Cependant, Juan Chicoy, dés qu`il s`est retrouvé seul sur la route, a perdu son enthousiasme et n`a pas tardé à s`endormir dans une grange. C'est là que, bientôt, Mildred Pritchard le découvre et se donne à lui. A la tombée du jour, Chicoy. de retour auprès de l`autocar, parvient à désembourber son véhicule et à reprendre le chemin de San Juan...
En 1957, Twentieth Century Fox et Victor Vicas réalisent une adaptation de "The Wayward Bus", avec Joan Collins, Jayne Mansfield et Dan Dailey ...


"À L'EST D'EDEN" (East of Eden, 1952)
Vaste fresque qui en quatre parties retracent de génération en génération l'histoire de la vallée de la Salinas, en Californie du Nord, et des familles Trask et Hamilton, traversés par les rapports complexes du bien et du mal. Dans la dernière partie, que reprendra le film de Kazan, Adam Trask vit avec ses deux fils, Cal, convaincu que son père ne l’aime pas, et Aaron, qui est fiancé à Abra. En arrière-plan, la mère, qui n'est pas morte mais a fui dans une maison close la naissance des jumeaux...
L'ouvrage est considéré par beaucoup comme le roman le plus ambitieux de Steinbeck : "Il contient, écrira l'écrivain, tout ce que j'ai pu apprendre sur mon métier ou ma profession au cours de toutes ces années", puis plus tard : "Je pense que tout ce que j'ai écrit d'autre a été, en un sens, un entraînement pour celui-ci." Le roman était à l'origine adressé aux jeunes fils de Steinbeck, Thom et John. Steinbeck voulait leur décrire en détail la vallée de Salinas : les vues, les sons, les odeurs et les couleurs...
(2e partie, XXII) Face à face, Adam-Samuel. Sa femme partie, après avoir tiré sur lui et abandonné leurs jumeaux, Adam s'interroge, perdu, tandis que Samuel l'exhorte à se reprendre en mains et à s'occuper de ses fils, le livre de la Génèse, l'histoire de Caïn et d'Abel, est, on le sait au coeur du roman ..
"Now that Samuel and Adam were seated together and the barriers were down, a curtain of shyness fell on Samuel. What he had beaten in with his fists he could not supplement easily. He thought of the virtues of courage and forbearance, which become flabby when there is nothing to use them on. His mind grinned inward at itself.
The two sat looking at the twin boys in their strange bright-colored clothes. Samuel thought, Sometimes your opponent can help you more than your friend. He lifted his eyes to Adam.
“Tt’s hard to start,” he said. “And it’s like a put-off letter that gathers difficulties to itself out of the minutes. Could you give me a hand?”
Adam looked up for a moment and then back at the boys on the ground. “There’s a crashing in my head,” he said. “Like sounds you hear under water. I’m having to dig myself out of a year.”
“Maybe you'll tell me how it was and that will get us started.”
Adam tossed down his drink and poured another and rolled the glass at an angle in his hand. The amber whisky moved high on the side and the pungent fruit odor of its warming filled the air. “It’s hard to remember,” he said. “It was not agony but a dullness. But no—there were needles in it. You said I had not all the cards in the deck—and I was thinking of that. Maybe I’ll never have all the cards.”
“Ts it herself trying to come out? When a man says he does not want to speak of something he usually means he can think of nothing else.”
“Maybe it’s that. She’s all mixed up with the dullness, and I can’t remember much except the last picture drawn in fire.”
“She did shoot you, didn’t she, Adam?”
His lips grew thin and his eyes black.
Samuel said, “There’s no need to answer.”
“There’s no reason not to,” Adam replied. “Yes, she did.”
“Did she mean to kill you?”
“T’ve thought of that more than anything else. No, I don’t think she meant to kill me. She didn’t allow me that dignity. There was no hatred in her, no passion at all. I learned about that in the army. If you want to kill a man, you shoot at head or heart or stomach. No, she hit me where she intended. I can see the gun barrel moving over. I guess I wouldn’t have minded so much if she had wanted my death. That would have been a kind of love. But I was an annoyance, not an enemy.”
“You’ve given it a lot of thought,” said Samuel.
“T’ve had lots of time for it. I want to ask you something. I can’t remember behind the last ugly thing. Was she very beautiful, Samuel?”
“To you she was because you built her. I don’t think you ever saw her—only your own creation.”
Adam mused aloud, “I wonder who she was—what she was. I was content not to know.”
“And now you want to?”
Adam dropped his eyes. “It’s not curiosity. But I would like to know what kind of blood is in my boys. When they grow up—won’t I be looking for something in them?”
“Yes, you will. And I will warn you now that not their blood but your suspicion might build evil in them. They will be what you expect of them.”
“But their blood—”
“T don’t very much believe in blood,” said Samuel. “I think when a man finds good or bad in his children he is seeing only what he planted in them after they cleared the womb.”
(....)
"Adam baissa les yeux.
« Ce n'est pas de la curiosité, mais j'aimerais savoir quel sang coule dans les veines de mes garçons. Lorsqu'ils grandiront, ne chercherai-je pas quelque chose en eux ?
- Si, certainement. Et je vous mets en garde: ce n'est pas le sang, mais vos soupçons qui risquent de déchaîner le mal en eux. Ils seront ce que vous attendez qu'ils soient.
- Mais le sang...
- Je ne crois pas beaucoup à l'hérédité, dit Samuel. Lorsqu'un homme découvre le bien ou le mal dans ses enfants, il ne voit que ce qu'il a semé chez eux depuis le jour où ils ont quitté le ventre de leur mère.
- On ne peut pas faire un cheval de course d'un porc.
- Non, répondit Samuel, mais on peut en faire un porc de course.
- Personne ici ne serait d'accord avec vous. Pas même Mrs. Hamilton.
- C'est tout à fait exact. Elle serait profondément en désaccord. Aussi ne le lui dirai-je pas, de crainte de déchaîner le tonnerre de son argumentation. Elle gagne toujours, car son arme est la véhémence et elle considère qu'une opinion différente de la sienne est une injure personnelle. C'est une femme merveilleuse, mais il faut savoir s'y prendre avec elle. Parlons des garçons.
- Voulez-vous un autre verre ?
- Cela, avec plaisir. Les noms sont un grand mystère. Je n'ai jamais su si le nom avait une influence sur l'enfant ou si l'enfant se transformait pour s'adapter à son nom. Mais soyez sûr d'une chose : chaque fois qu'un homme a un surnom, c'est que le nom qu'on lui a donné ne lui convenait pas. Que pensez-vous des noms courants : Jean, Jacques ou Charles ? »
Adam était en train de regarder les jumeaux. Et, soudain, en entendant mentionner le dernier prénom, il vit apparaître les traits de son frère sur le visage d'un des garçons. Il se pencha en avant.
« Qu'y a-t-il ? demanda Samuel.
- Ces enfants ne se ressemblent pas !
- Evidemment, ce ne sont pas de vrais jumeaux.
- Celui-ci ressemble à mon frère, je viens de le voir. Je me demande si l'autre me ressemble.
- Ils vous ressemblent tous les deux. Un visage possède en lui tous les traits de celui qui lui a donné le jour.
- L'illusion a disparu, dit Adam, mais pendant un moment j'ai cru voir un fantôme.
-- Peut-être les fantômes ne sont-ils que cela ? » observa Samuel.
Lee apporta des assiettes et les posa sur la table.
« Les Chinois ont-ils des fantômes ? demanda Samuel.
- Des millions, répondit Lee. C'est même embarrassant. Je crois que, en Chine, rien ne meurt jamais. C'est très encombré chez nous. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue lorsque je suis allé là-bas.
- Asseyez-vous, Lee, dit Samuel. Nous essayons de trouver des noms.
- J'ai mis un poulet à frire, il ne va pas tarder à être prêt. »
Adam, qui regardait les jumeaux, leva les yeux et son regard était chaud et adouci.
« Voulez-vous boire avec nous, Lee ?
- J'ai mon ng-ka-py à la cuisine », dit Lee.
Et il repartit vers la maison. Samuel se pencha en avant, prit l'un des garçons et l'assit sur son genou. '
« Prenez l'autre, dit-il à Adam. Nous allons voir si quelque chose chez eux appelle un nom.»
Adam prit maladroitement l'autre enfant et l'assit sur sa cuisse.
« Ils se ressemblent, dit-il. Mais beaucoup moins lorsqu'on les regarde de près. Celui-ci a les yeux plus ronds que celui-là.
- Oui, il a aussi la tête plus ronde et les oreilles plus grandes, ajouta Samuel, mais il ressemble plus - comment dire ? -- à une balle. Il ira peut-être plus loin, mais pas aussi haut. Il aura les cheveux et la peau plus foncés. Il sera malin, et c'est une qualité qui limite le développement de l'esprit. Elle freine et entrave. Voyez comme il se tient de lui-même. Il est déjà plus avancé que l'autre, plus développé. N'est-il pas étrange de voir comme ils sont différents lorsqu'on les regarde de près ? »
Le visage d'Adam était transformé comme si la lumière avait à nouveau pénétré en lui et qu'il eût quitté le fond du son marais aux eaux glauques. Il tendit un doigt. L'enfant fit un geste pour s'en emparer, mais il le manqua et faillit tomber de son siège.
« Hé là ! dit Adam. Fais attention. Veux-tu donc tomber ?
- Ce serait une erreur que de les appeler en fonction des qualités que nous croyons voir en eux, dit Samuel. Nous pourrions nous tromper lourdement. Peut-être serait-il bon de leur donner un nom qui soit un but, un nom qui les conduise. L'homme dont je porte le nom s'est
entendu appeler clairement par le Seigneur. J'ai tendu l'oreille toute ma vie et une fois ou deux j'ai cru entendre appeler mon nom, mais c'était faiblement et sans clarté. »
Adam, en retenant l'enfant par l'épaule, se pencha et versa du whisky dans les deux verres.
« Merci d'être venu, Samuel, dit-il. Je vous remercie de m'avoir frappé. C'est une étrange chose à dire.
- C'était pour moi une étrange chose à accomplir: Liza ne me croira pas. Aussi ne le lui dirai-je jamais. Une vérité incroyable peut faire plus de mal qu'un mensonge. Il faut une grande foi pour défendre une vérité inacceptable. Il y a un châtiment pour cela et c'est, en général, la crucifixion. Et je ne me sens pas la force de la supporter. »
Adam dit :
« Je me suis longtemps demandé comment un homme aussi cultivé que vous pouvait travailler dans ces collines désertíques.
- Parce que je n'ai pas de courage, dit Samuel. Je n'ai jamais su accepter les responsabilités. Lorsque j'ai compris que le Seigneur n'appellerait pas mon nom, j'aurais pu appeler le sien, mais je ne l'ai pas fait. C'est là que réside la différence entre la grandeur et la médiocrité. C'est une maladie assez commune. Mais il est agréable pour l'homme médiocre de savoir que la grandeur est sans doute l'état le plus solitaire du monde.
“Td think there are degrees of greatness,” Adam said.
“T don’t think so,” said Samuel. “That would be like saying there is a little bigness. No. I believe when you come to that responsibility the hugeness and you are alone to make your choice. On one side you have warmth and companionship and sweet understanding, and on the other—cold, lonely greatness. There you make your choice. I’m glad I chose mediocrity, but how am I to say what reward might have come with the other? None of my children will be great either, except perhaps Tom. He’s suffering over the choosing right now. It’s a painful thing to watch. And somewhere in me I want him to say yes. Isn’t that strange? A father to want his son condemned to greatness! What selfishness that must be.”
Adam chuckled. “This naming is no simple business, I see.”
“Did you think it would be?”
“T didn’t know it could be so pleasant,” said Adam.
- Il y a des degrés dans la grandeur, dit Adam.
- Je ne crois pas, répondit Samuel. Cela reviendrait à dire qu'il y a une petite grandeur. Non. Lorsque l'on en arrive à ce point, la grandeur et l'individu sont seuls en face du choix. D'un côté, il y a la chaleur et la promiscuité de l'homme, la douceur d'être compris et, de l'autre, il y a la grandeur, la solitude et le froid. C'est là qu'est le choix. Je suis heureux d'avoir choisi la médiocrité, mais j'ignorerai toujours quelle récompense j'aurais obtenue si j'avais choisi différemment. Aucun de mes enfants ne sera grand, à part Tom peut-être. Actuellement il souffre, car il est à I'époque du choix. C'est un conflit pénible à observer. Pourtant quelque chose en moi souhaite qu'il réponde oui...."
Le titre, "East of Eden", est extrait d'une phrase de La Bíble et a valeur de symbole : il désigne la région où Caïn se réfugia après avoir tué son frère. L'action se déroule dans la vallée de la Salinas, en Californie du Nord, à l`époque où le pays était quasiment désert et où chaque pionnier, riche ou pauvre selon la qualité du sol, n`en régnait pas moins sur des milliers d`hectares. L'un d'eux, Samuel Hamilton, lrlandais au cerveau inventif mais dépourvu du sens des affaires, élève avec sa femme Liza, austère presbytérienne. une nombreuse famille, quatre fils (Georges, Will, Tom et Joseph), et cinq filles 'Una, Lizzie, Dessie, Olive (mère du narrateur) et Mollie). Samuel, figure sortie de La Bible, éclaire tout le livre de sa bonté, sa droiture, sa vitalité, encore que tous ces bons sentiments n`aillent pas sans beaucoup de lieux communs.
En face de cette incarnation du Bien, Steinbeck a campe l`incarnation du Mal avec le personnage de Catherine, la femme d'Adam Trask, qui lui aussi s'est installé dans la vallée et s'est lié d'amitié avec Samuel Hamilton : elle a par le passé pousser son fiancé au suicide, fait périr ses parents dans un incendie, empoisonner sa bienfaitrice et s'est prostituée. Le malheureux Adam Trask, qu`elle épousera, sera trompé dès le soir des noces.
La première partie raconte la vie des deux familles, Samuel Hamilton et Adam Trask, jusqu'à la fin du siècle, la seconde partie conte les différents conflits que vivent Adam et Charles à l'aube du XXe siècle. La troisième partie marquera le déménagement en Californie, et les liens qui se tissent entre les deux familles...
Avant de déménager en Californie, Adam vivait dans une ferme du Connecticut avec son demi-frère, Charles, sombre et lunatique. À sa mort, Cyrus, leur père, leur laisse une fortune importante et inattendue, probablement volée lorsqu'il était administrateur dans l'armée américaine. Malgré leur nouvelle fortune, Adam et Charles ne s'entendent toujours pas. Charles ne supporte pas le mariage de son frère avec Cathy, et tout en la méprisant, couche avec elle après qu'elle ait drogué Adam lors de leur nuit de noces. Adam et Cathy déménagent donc en Californie, - Adam ne pouvant cohabiter avec Charles dans le Connecticut. A Salinas, Cathy apprend qu'elle est enceinte et tente d'avorter pour ne plus avoir de liens avec son mari : elle veut en effet absolument échapper à Adam, même s'il l'aime et subvient à ses besoins. L'avortement échoue, et Cathy donne finalement naissance à des jumeaux, Aron et Caleb (Cal).
Leurs fils jumeaux, Caleb et Aron, reproduisent la dualité manichéenne de Caïn et Abel, non sans une certaine complaisance. Steinbeck n`use d`ailleurs pas d`autres moyens pour peindre la Sagesse sous les traits de Lee, le serviteur chinois, mais sans doute est-ce à cette complaisance dans le conformisme que cet énorme roman a dû son succès, et soutenu par la critique ...
Et le malheureux Adam Trask représente l'Homme, avec ses faiblesses, ses tourments, son appétit du Bien contrecarré par la Tentation...
(XVIII-XIX-XX-XXI) Un jour, Cathy tire sur Adam, s'enfuit de la maison et s'installe à Salinas, pour reprendre sa vie de prostituée. Adam continue de protéger sa femme et ne la dénonce pas. Cathy, qui se fait appeler Kate, gagne la confiance de Faye, la tenancière d'une maison close locale, puis l'empoisonne et fait croire aux médecins et aux autres prostituées que Faye est morte naturellement. Elle prend ainsi le contrôle de la maison close et commence à faire chanter les hommes puissants de Salinas. Pour protéger Adam et ses jumeaux, ni Samuel Hamilton ni Lee, la gouvernante d'Adam, ne disent à Adam ou aux jumeaux que Cathy travaille dans un bordel...
On the Trask place Adam drew into himself. The unfinished Sanchez house lay open to wind and rain, and the new floorboards buckled and warped with moisture. The laid-out vegetable gardens rioted with weeds.
Adam seemed clothed in a viscosity that slowed his movements and held his thoughts down. He saw the world through gray water. Now and then his mind fought its way upward, and when the light broke in it brought him only a sickness of the mind, and he retired into the grayness again. He was aware of the twins because he heard them cry and laugh, but he felt only a thin distaste for them. To Adam they were symbols of his loss. His neighbors drove up into his little valley, and every one of them would have understood anger or sorrow—and so helped him. But they could do nothing with the cloud that hung over him. Adam did not resist them. He simply did not see them, and before long the neighbors stopped driving up the road under the oaks.
CHAPITRE XXII
Adam Trask vivait retiré sur lui-même. La maison des Sanchez, à demi terminée, restait ouverte au vent et à la pluie et les nouveaux planchers se gondolaient et moisissaient. Le potager était mangé par les mauvaises herbes.
Adam semblait englué dans une boue qui ralentissait ses gestes et le mouvement de sa pensée. Il voyait le monde à travers une eau glauque. Parfois, il luttait pour remonter à la surface, mais, lorsqu'il arrivait à la lumière, un malaise le prenait et il retournait dans sa demeure submergée. Il entendait rire et pleurer les jumeaux mais il n'éprouvait pour eux qu'inimitié. Ils étaient le symbole de ce qu'il avait perdu. Au début, les voisins montèrent jusqu'au vallon, pensant soulager Adam d'un fardeau de douleur ou de colère. Mais il était trop loin d'eux. Il ne résistait pas à l'amitié, il l'ignorait. Rapidement les voisins n'empruntèrent plus la route sous les chênes.
Lee essaya de le stimuler et de le rendre à la vie, mais il avait d'autres occupations. Il faisait la cuisine et la lessive, il lavait etnourrissait les jumeaux. Malgré cette tâche pénible et constante, il se prit à aimer les deux petits garçons. Il leur parlait cantonais et les premiers mots qu'ils reconnurent et essayèrent de répéter étaient des mots chinois. Samuel retourna deux fois à la ferme pour essayer d'arracher Adam à sa torpeur, mais bientôt Liza l'en dissuada.
"Je ne veux pas que tu y retournes, dit-elle. Lorsque tu reviens, tu n'es plus le même. Tu ne le changes pas. Samuel, c'est lui qui te change. Je reconnais son visage sur le tien.
- As-tu pensé aux deux petits garçons, Liza ?
- Je pense à ta famille. Lorsque tu reviens de là-bas, notre maison est en deuil pour plusieurs jours.
- Très bien, maman", répondit Samuel.
Mais cela l'attristait, car il ne pouvait rester à l'écart lorsqu'un homme souffrait. Il lui était difficile d'abandonner Adam à sa désolation. Adam l'avait payé pour son travail. Il avait même payé les moulins à vent et n'en avait pas voulu. Samuel revendit le matériel et lui envoya l'argent. Il ne reçut aucune réponse.
Bientôt, l'attitude d'Adam l'irrita. Il lui semblait que Trask se complaisait dans sa douleur. Mais Samuel n'avait pas le temps de s'y attarder. Joe était au collège - celui que Leland Stanford avait fait bâtir sur sa terre de Palo Alto. Tom inquiétait son père, car il se perdait de plus en plus dans les livres. Il accomplissait ses tâches, mais Samuel sentait que son fils ne montrait pas assez de joie. Will et George réussissaient dans leurs affaires et Joe envoyait des lettres en vers où il attaquait de front tous les bastions de la société.
Samuel répondit à Joe : "J'aurais été désappointé si tu n'étais pas devenu athée et je lis avec plaisir que tu cueilles les fruits de la libre pensée avec toute la sagesse que te donne ton grand âge. Mais mon cœur compréhensif te serait très reconnaissant de ne pas essayer de convertir ta mère. En recevant ta dernière lettre, elle a cru que tu étais malade. Ta mère ne croit pas qu'il y ait beaucoup de maux qui résistent à une bonne tasse de bouillon. Et, lorsque tu attaques bravement la structure de notre civilisation, elle est persuadée que tu souffres de l'estomac. Cela l'inquiète. Sa foi est une montagne, et toi, mon fils, tu n'es même pas encore en possession d'une pelle."
Liza vieillissait, elle cédait sous les coups du temps. Samuel ne pouvait pas se sentir vieux, barbe blanche ou pas. Il y avait eu une époque où Liza considérait les projets et les prophéties de Samuel comme des folies enfantines. Maintenant elle pensait que c'était inconvenant chez un homme mûr. Ils étaient seuls à la ferme, Liza et Tom et Samuel. Una s'était mariée à un étranger et les avait quittés. Dessie avait son magasin de couture à Salinas. Olive avait épousé son jeune architecte et Mollie aussi s'était mariée et, croyez-le ou non, vivait dans un appartement à San Francisco. Elle se parfumait, il y avait devant sa cheminée une peau d'ours blanc et avec son café elle fumait des cigarettes à bout doré.
Un jour, Samuel attrapa un tour de reins en soulevant une balle de foin, et la vexation fut plus grande que la douleur, car il ne pouvait pas admettre que Samuel Hamilton abandonnât le privilège de soulever une balle de foin.
Il se sentit insulté par son propre dos comme il l'aurait été si un de ses enfants avait commis une malhonnêteté.
Il alla consulter le docteur Tilson à King City. Avec les années, le docteur se faisait de plus en plus irascible.
"Vous avez un tour de reins.
- Ça, je le sais, dit Samuel.
- Et vous avez fait tout ce chemin pour me demander ce que vous saviez déjà et me donner deux dollars ?
- Voici vos deux dollars.
- Et vous voulez que je vous dise ce qu'il faut faire ?
- Exactement.
- Eh bien, ne vous tournez plus les reins. Maintenant, reprenez votre argent. Vous n'êtes pas un imbécile, Samuel. A moins que vous ne retombiez en enfance.
- Mais je souffre.
- Evidemment que vous souffrez. Comment sauriez-vous que vous avez un tour de reins si vous ne souffriez pas ?"
Samuel rit.
"Excellente consultation, dit-il. Elle vaut beaucoup plus de deux dollars. Gardez l'argent."
Le médecin scruta le visage de Samuel.
" J'espère que vous dites la vérité. Je garderai l'argent."
Samuel alla rendre visite à Will dans son nouveau magasin. Il eut du mal à reconnaître son fls, prospère et gras, portant veste et gilet et bague au doigt.
- "J'ai préparé un paquet pour maman. Des petites boîtes de conserves de France : des champignons, du pâté de foie et des sardines si petites que l'on a du mal à les voir."
- Elle les enverra à Joe, dit Samuel.
-- Tu ne peux pas lui dire de les manger ?
- Non, répondit-son père. Cela lui fera beaucoup plus plaisir de les envoyer à Joe. »
Lee entra dans la boutique et son visage s'éclaira.
" Monsieur aller bien ? demanda-t-il.
- Bonjour; Lee. Comment vont les enfants ?
- Bien.
- Je vais prendre un verre de bière à côté, Lee. Venez donc me rejoindre."
Ils s'assirent à la petite table ronde et Samuel dessina quelque chose sur le bois sec de la table avec la mousse qui avait débordé du verre.
" J'ai bien pensé aller vous voir, ainsi que Adam, mais je ne crois pas être utile à grand-chose.
- En tout cas, vous ne lui feriez pas de mal. Je croyais qu'il reprendrait le dessus, mais il continue d'errer comme un fantôme.
- Cela fait plus d'un an ? demanda Samuel.
- Un an et trois mois.
- Que puis-je faire ?
- Je ne sais pas. Peut-être qu'un choc le réveillerait. Jusqu'ici rien n'a réussi.
-- Je ne sais pas m'y prendre, je risquerais de me faire mal. Au fait, comment s'appellent les jumeaux ?
- lls n'ont pas de nom.
- Vous voulez rire, Lee.
- Pas du tout.
- Comment les appelle-t-il ?
- Il les appelle "eux".
- Je veux dire quand il s'adresse à eux.
- Quand il s'adresse à eux, il dit "-toi" à l'un ou à l'autre.
- Ça ne tient pas debout, dit Samuel en colère.
- Je voulais venir vous prévenir. Si vous ne le réveillez pas, c'est un homme mort.
- Je vais venir, dit Samuel. Et avec mon fouet ! Pas de nom ? Ah ! oui, je vais venir.
- Quand ?
- Demain !
- Je tuerai un poulet. Les jumeaux vous plairont, Mr. Hamilton. Ce sont deux beaux bébés. Je ne préviendrai pas Mr. Trask de votre visite."
Shyly Samuel told his wife he wanted to visit the Trask place. He thought she would pile up strong walls of objection, and for one of the few times in his life he would disobey her wish no matter how strong her objection. It gave him a sad feeling in the stomach to think of disobeying his wife. He explained his purpose almost as though he were confessing. Liza put her hands on her hips during the telling and his heart sank. When he was finished she continued to look at him, he thought, coldly.
Finally she said, “Samuel, do you think you can move this rock of a man?”
“Why, I don’t know, Mother.” He had not expected this. “I don’t know.”
“Do you think it is such an important matter that those babies have names right now?”
“Well, it seemed so to me,” he said lamely.
“Samuel, do you think why you want to go? Is it your natural incurable nosiness? Is it your black inability to mind your own business?”
“Now, Liza, I know my failings pretty well. I thought it might be more than that.”
“It had better be more than that,” she said. “This man has not admitted that his sons live. He has cut them off mid-air.”
“That’s the way it seems to me, Liza.”
“Tf he tells you to mind your own business—what then?”
“Well, I don’t know.”
Samuel dit timidement à sa femme qu'il voulait aller à la ferme de Trask. Il pensait voir s'élever devant lui une muraille d'objections. Pour une fois dans sa vie, il était prêt à désobéir à Liza, à passer outre. Cette décision le mettait mal à l'aise. Pendant tout le temps que dura son explication qui ressemblait à une confession, Liza garda les mains sur les hanches, et Samuel sentit son cœur le lâcher. Lorsqu'il eut fini, elle continua de le regarder du même regard, froid pensa-t-il.
Enfin elle dit :
« Crois-tu, Samuel, que tu puisses éveiller cet homme de pierre ?
- Je n'en sais rien, maman. »
Il n'avait pas prévu cette question.
« Crois-tu qu'il soit tellement important que ces deux bébés aient un nom ?
- Il me semble, dit-il maladroitement.
- Samuel, sais-tu ce qui te pousse à aller là-bas ? Est-ce ton besoin incurable d'aller fourrer ton nez partout ? Est-ce ton inaptitude à te mêler de ce qui te regarde ?
- Liza, je crois connaître mes défauts. Mais cette fois, je crois qu'il s'agit d'autre chose.
- Je l'espère pour toi, dit-elle. Cet homme n'a pas admis que ses fils étaient des créatures du Seigneur. Il les laisse vivre comme des plantes.
- C'est bien ce qu'il me semble, Liza.
-- Et s'il te dit de te mêler de ce qui te regarde, que feras-tu ?
- Je l'ignore. »
Liza Hamilton referma sa mâchoire et il y eut un claquement sec.
« Ne t'avise pas de te présenter devant moi si ces enfants ne sont pas baptisés. N'aie pas l'audace de revenir en geignant qu'il a refusé ou qu'il t'a renvoyé, car dans ce cas, il faudrait que j'y aille moi-même.
- Je lui ferai tâter de mes poings, dit Samuel.
- Tu ne le feras pas. Tu es doux. Je te connais, tu te contenteras de lui assener de jolies phrases, tu reviendras en te lamentant et tu essaieras de me faire oublier que tu y es allé.
- Je lui casserai la figure », lança Samuel.
Il bondit dans sa chambre et Liza sourit à la porte claquée qui vibrait encore.
Samuel ressortit bientôt avec son costume noir, sa chemise blanche à col dur. Il se pencha vers sa femme pour qu'elle lui nouât sa cravate noire. Il avait tant brossé sa barbe qu'elle brillait.
« Tu ferais bien de donner un coup de chiffon à tes chaussures. »
Pendant qu'il se livrait à ce travail, Samuel jeta un regard de côté.
« Puis-je emmener la Bible ? demanda-t-il. C'est encore là que l'on trouve les meilleurs noms de baptême.
- Je n'aime pas beaucoup que la Bible quitte la maison, répondit Liza, embarrassée. Si tu reviens tard, que liai-je? Et il y a les noms de nos neuf enfants sur la couverture. »
Elle vit le visage de son mari s'assombrir. Elle entra à son tour dans la chambre et revint avec une petite Bible usée, écornée, dont la couverture était renforcée par du papier brun et de la colle.
« Prends celle-ci, dit-elle.
- Mais c'est celle de ta mère.
- Ma mère ne trouverait rien à redire, et tous les noms qui y sont inscrits ont déjà leurs deux dates, sauf un.
- Je l'envelopperai pour qu'elle ne soit pas souillée», dit Samuel.
Liza lui dit vertement :
«La couverture ne craint rien. Je te demande de ne pas souiller le contenu et de laisser le Testament en paix. Il faut toujours que tu l'épluches et que tu l'interroges. On dirait un raton qui examine sa nourriture avant de la manger, et cela m'irrite.
- J'essaie de le comprendre, maman.
- Qu'y a-t-il à comprendre ? Contente-toi de le lire. C'est écrit noir sur blanc. Qui te demande de comprendre ? Si Dieu voulait que tu comprennes, il t'aurait donné de quoi comprendre ou alors il l'aurait écrit différemment.
- Mais, maman...
- Samuel, dit-elle, tu es l'homme le plus présomptueux que le monde ait jamais connu.
- Oui, maman.
- Et n'abonde pas toujours dans mon sens. C'est un manque de sincérité. Dis donc ce que tu penses ! »
Elle regarda la silhouette sombre qui s'éloignait dans le boghei.
« C'est un bon mari, dit-elle tout haut, mais il est présomptueux. »
Et Samuel pensait avec étonnement : « Alors que je crois la connaître, elle me fait une chose comme ça ! . »
On the last half-mile, turning out of the Salinas Valley and driving up the unscraped road under the great oak trees, Samuel tried to plait a rage to take care of his embarrassment. He said heroic words to himself.
Adam was more gaunt than Samuel remembered. His eyes were dull, as though he did not use them much for seeing. It took a little time for Adam to become aware that Samuel was standing before him. A grimace of displeasure drew down his mouth.
Samuel said, “I feel small now—coming uninvited as I have.”
Adam said, “What do you want? Didn’t I pay you?”
“Pay?” Samuel asked. “Yes, you did. Yes, by God, you did. And Ill tell you that pay has been more than I’ve merited by the nature of it.”
“What? What are you trying to say?”
Samuel’s anger grew and put out leaves. “A man, his whole life, matches himself against pay. And how, if it’s my whole life’s work to find my worth, can you, sad man, write me down instant in a ledger?”
Adam exclaimed, “I'll pay. I tell you I'll pay. How much? I'll pay.”
“You have, but not to me.”
“Why did you come then? Go away
“You once invited me.”
“T don’t invite you now.”
Samuel put his hands on his hips and leaned forward. “I'll tell you now, quiet. In a bitter night, a mustard night that was last night, a good thought came and the dark was sweetened when the day sat down. And this thought went from evening star to the late dipper on the edge of the first light—that our betters spoke of. So I invite myself.”
“You are not welcome.”
Lorsqu'il s'engagea sur la route cahoteuse qui menait chez les Trask, après avoir quitté la route de la Vallée, Samuel s'essaya à la colère pour dissimuler son embarras. ll se dit à lui-même des phrases héroïques.
Adam n'était plus que l'ombre de lui-même. Son regard était morne comme s'il ne s'en servait plus. Il lui fallut un moment pour sentir la présence de Samuel à côté de lui. Les coins de sa bouche s'abaissèrent.
Samuel dit :
« Je me sens gêné en venant alors que je ne suis pas invité. . »
Adam répondit :
« Que voulez-vous ? Ne vous ai-je pas payé ?
- Payé ? demanda Samuel. Par le Ciel, si ! Et croyez-moi, le paiement était trop fort et je ne l'avais pas mérité.
- Comment ? Qu'entendez-vous par là ? . »
La colère de Samuel germa, puis bourgeonna.
« Toute sa vie, l'homme se demande ce qu'il vaut. De quel droit, petit homme triste, inscrivez-vous mon prix sur le livre des fournisseurs, alors que je ne sais pas moi-même
ce que je vaux ? »
Adam s'exclama :
« Je paie. Combien ? Dites-moi et je paie.
- C'est fait, mais vous n'êtes pas quitte.
- Allez-vous-en.
- Il fut un temps où vous m'invitiez.
- Plus maintenant. »
Samuel posa les mains sur ses hanches et se pencha en avant :
« Ecoutez-moi, alors que je suis encore calme. Par une nuit amère, sulfureuse, et c'était la nuit dernière, une pensée blanche a troué l'obscurité. Elle a brillé de l'étoile du berger aux premiers rayons de l'aurore. Il faut que le meilleur de nous-mêmes s'exprime. Aussi, me suis-je invité.
- Vous n'êtes pas le bienvenu.
- Je me suis laissé dire que, par une grâce singulière, des jumeaux vous étaient nés.
- Mêlez-vous de vos affaires ! »
En entendant cette grossièreté, une sorte de joie illumina les yeux de Samuel. Il vit Lee, à l'intérieur de la maison, qui l'épiaít.
« Pour l'amour du Ciel, n'éveillez pas la violence en moi. J'espère laisser le souvenir d'un homme pacifique au jour de mes funérailles.
- Je ne vous comprends pas.
“How could you? Adam Trask, a dog wolf with a pair of cubs, a scrubby rooster with sweet paternity for a fertilized egg! A dirty clod!”
A darkness covered Adam’s cheeks and for the first time his eyes seemed to see. Samuel joyously felt hot rage in his stomach. He cried, “Oh, my friend, retreat from me! Please, I beg of you!” The saliva dampened the corners of his mouth. “Please!” he cried. “For the love of any holy thing you can remember, step back from me. I feel murder nudging my gizzard.”
Adam said, “Get off my place. Go on—get off. You’re acting crazy. Get off. This is my place. I bought it.”
- Comment le pourriez-vous ? Qui est Adam Trask ? Un loup avec deux louveteaux, un coq déplumé qui a cloqué un œuf? Grossière motte d'argile ! »
Une rougeur envahit le visage d'Adam et ses yeux, pour la première fois, semblèrent voir. Samuel sentit avec plaisir la colère bouillir en lui. Il cria : « Ami, fuis loin de moi, je t'en prie, fuis. »
La salive mouillait les coins de sa bouche.
« Je t'en prie sur tout ce que tu as de plus sacré, écarte-toi de mon chemin, je sens la mort dans chacune de mes mains.
- Allez-vous-en, dit Adam. Partez. Vous êtes fou. Cette terre est à moi, je l'ai achetée.
- Avez-vous acheté vos yeux et votre nez ? ricana Samuel. Avez-vous acheté votre équilibre ? Ecoutez-moi, car ce sont peut-être les dernières paroles que vous entendrez. Ce que vous avez acheté, comment l'avez-vous acheté ? Adam, méritez-vous vos enfants ?
- Les mériter ? Ils vivent : c'est tout. Je ne vous comprends pas. »
Samuel lança au ciel :
« Dieu ait pitié de moi, Liza ! Vous ne le méritez pas, Adam. Ecoutez-moi avant que mes pouces trouvent le chemin de votre gorge. Vous ne méritez pas les jumeaux à la valeur sans égale - dissimulés, trahis, trompés et, je le dis alors que mes poings ne sont pas encore refermés, souillés.
- Partez, dit Adam d'une voix rauque. Un fusil, Lee, cet homme est fou.»
Les mains de Samuel enserrèrent la gorge d'Adam. le sang battit aux tempes de celui-ci, un voile rouge passa devant ses yeux exorbités. Samuel dit en se moquant :
« Vos doigts affaiblis ne desserreront pas mon étreinte. Vous n'avez pas acheté ces enfants, pas plus que vous ne les avez volés, pas plus que vous ne les avez mérités. Ils sont un étrange et merveilleux cadeau que vous avez reçu. »
Puis, soudain, ses pouces quittèrent la gorge d'Adam. Ce dernier passa ses doigts là où les mains du maréchal-ferrant avaient laissé leurs traces.
Adam stood panting. He felt his throat where the blacksmith hands had been. “What is it you want of me?”
“You have no love.”
“T had—enough to kill me.”
“No one ever had enough. The stone orchard celebrates too little, not too much.”
“Stay away from me. I can fight back. Don’t think I can’t defend myself.”
“You have two weapons, and they not named.”
“T’ll fight you, old man. You are an old man.”
Samuel said, “I can’t think in my mind of a dull man picking up a rock, who before evening would not put a name to it—like Peter. And you—for a year you’ve lived with your heart’s draining and you’ve not even laid a number to the boys.”
Adam said, “What I do is my own business.”
Samuel struck him with a work-heavy fist, and Adam sprawled out in the dust. Samuel asked him to rise, and when Adam accepted struck him again, and this time Adam did not get up. He looked stonily at the menacing old man.
The fire went out of Samuel’s eyes and he said quietly, “Your sons have no names.”
Adam replied, “Their mother left them motherless.”
“And you have left them fatherless. Can’t you feel the cold at night of a lone child? What warm is there, what bird song, what possible morning can be good? Don’t you remember, Adam, how it was, even a little?”
“T didn’t do it,” Adam said.
« Que voulez-vous de moi ?
- Vous n'avez pas d'amour.
- J' en avais, assez pour en mourir.
- Personne n'en a jamais assez. La pierre elle-même n'en a pas assez.
- N' approchez pas, je puis me défendre.
- Vous aviez deux armes et vous ne leur avez pas donné de nom.
-- Je me battrai contre vous, vieillard. Car vous êtes un vieillard. »
Samuel dit :
« Vous aviez une pierre et vous n'avez pas bâti d'église. Vous avez vécu avec une plaie au cœur et vous n'avez pas su donner même un numéro à vos fils.
- Ce que je fais me regarde », dit Adam.
Alors Samuel le frappa de son poing noueux de forgeron et Adam roula dans la poussière. Samuel lui dit de se relever et, lorsque Adam eut accepté, Samuel le frappa à nouveau, et cette fois Adam resta à terre. Il jeta un regard perdu sur le vieil homme menaçant. La flamme s'éteignit dans les yeux de Samuel et il dit calmement :
« Vos fils n'ont pas de nom. »
Adam répondit :
« Leur mère les a laissés sans mère.
- Et vous les avez laissés sans père. Connaissez-vous le froid de la nuit pour un enfant solitaire ? Quelle chaleur, quel chant d'oiseau, quel matin peut-il connaître ? Ne vous
rappelez-vous pas, Adam ?
- Ce n'est pas ma faute, dit Adam.
- Qu'avez-vous fait pour y remédier ? Vos fils n'ont pas de nom. »
Il se pencha, glissa ses mains sous les aisselles d'Adam et l'aida à se relever.
« Nous leur donnerons un nom, dit-il. Nous y penserons longtemps et nous trouverons pour chacun un nom qui le vêtira.»
Il brossa la poussière qui maculait la chemise d'Adam. Un regard intense mais lointain habitait les yeux d'Adam, comme s'il eût prêté l'oreille à une musique apportée par le vent. Ses yeux n'étaient plus morts. Il dit :
« Je ne savais pas qu'un jour je remercierais un homme pour m'avoir insulté et secoué comme un vieux tapis. Mais je suis reconnaissant. C'est un merci douloureux, mais un merci. »
Samuel sourit, les yeux à demi fermés.
« Ai-je eu l'air naturel ? Ai-je fait cela comme il fallait ?
- Comment cela ?
- D'une certaine manière, j'avais promis à ma femme. Elle ne croyait pas que j'en serais capable. Je suis un homme pacifique. La dernière fois que j'ai levé la main sur un être humain c'était à l'école pour les beaux yeux d'une petite fille au nez rouge. »
Adam regardait Samuel, mais il voyait le visage sombre et hostile de Charles. Puis l'image se brouilla et ce fut Cathy qui apparut, avec le regard qu'elle avait eu en pointant son arme.
« Je n'ai pas eu peur, dit Adam. C'était plutôt comme une grande lassitude.
- Je n'étais pas assez en colère.
- Samuel, je ne vous poserai cette question qu'une seule fois : avez-vous entendu dire quelque chose ? A-t-on des nouvelles d'elle, quelque nouvelle que ce soit ?
- Je n'ai rien entendu dire.
- C'est presque un soulagement, dit Adam.
“Do you have hatred?”
“No. No—only a kind of sinking in the heart. Maybe later I'll sort it out to hatred.
There was no interval from loveliness to horror, you see. I’m confused, confused.”
- Eprouvez-vous de la haine ?
- Non. C'est comme une sorte d'engourdissement du cœur. Peut-être plus tard éprouverai-je de la haine. Je suis passé sans transition du ravissement à l'horreur. Je ne sais plus où j'en suis. » ...
Au fur et à mesure que les jumeaux grandissent, Aron s'avère proche du caractère de son père, tandis que Cal reproduit le caractère manipulateur et impitoyable de sa mère. Cependant, lorsqu'ils atteignent l'adolescence, Cal lutte activement contre son côté sombre et prie Dieu de le rendre plus semblable à Aron. Adam, quant à lui, reste mélancolique et apathique pendant des années après le départ de Cathy. Pour sortir Adam de son découragement, Samuel finit par lui dire la vérité sur Cathy.
(XXV-XXVI-XXVII-XXVIII) Samuel meurt peu après. Après les funérailles de Samuel, Adam rend visite à Cathy au bordel, et se rend compte qu'il ne peut que se détacher d'elle, ce que Cathy n'accepte pas. Elle est prête à tout pour conserver son pouvoir sur lui. Ayant triomphé de sa femme, Adam devient un père plus proche de ses garçons et décide de déménager à Salinas pour qu'Aron et Cal puissent aller à l'école (XXXV-XXXVI). Aron entame une relation avec Abra, la fille au grand cœur d'un superviseur de comté corrompu tandis que Cal continue de lutter contre son côté sombre, et lorsqu'il découvre enfin la vérité sur sa mère, il croit que son mal lui a été transmis.
Mais la gouvernante d'Adam, Lee, qui a fait des recherches approfondies sur l'histoire biblique de Caïn et Abel, conseille à Cal que Dieu veut que chaque individu choisisse sa propre destinée morale plutôt que d'être contraint par l'héritage de ses parents. Cette idée, résumée par le mot hébreu "timshe"l (qui signifie "tu peux"), s'oppose à l'idée fataliste de Cal selon laquelle il a hérité du mal et du péché de sa mère. Aron se replie progressivement dans une ferveur religieuse sensée le protéger de la corruption du monde. Adam, quant à lui, dilapide la fortune familiale dans une entreprise de transport réfrigéré de légumes.
(XLI-XLIV) Aron obtient son baccalauréat et part pour l'université de Stanford, il manque terriblement à son père. Cal, en collaboration avec Will Hamilton, l'un des fils de Samuel, travaille secrètement pour regagner la fortune que son père a perdue dans l'entreprise de réfrigération qui a échoué. Cal espère également gagner suffisamment d'argent pour payer les frais de scolarité d'Aron à Stanford. Dans l'économie tendue de la Première Guerre mondiale, Will et Cal achètent des haricots aux agriculteurs locaux à un prix injustement bas et les revendent à leur tour à des acheteurs britanniques désespérés à un prix injustement élevé. Cette entreprise rapporte à Cal des milliers de dollars, qu'il compte offrir à son père à l'occasion de Thanksgiving...
(XLVI-L) Aron, qui est malheureux à Stanford, rentre à la maison pour Thanksgiving. Adam est ravi de voir Aron mais consterné par le cadeau d'argent de Cal. Adam considère que l'argent a été gagné de façon malhonnête et dit à Cal de le rendre aux fermiers à qui il l'a volé. Enragé et jaloux de la préférence évidente d'Adam pour Aron, Cal perd tout contrôle et révèle sans réfléchir à Aron la vérité sur leur mère, Cathy. Lorsque Cal emmène Aron au bordel pour lui montrer que Cathy est toujours en vie, la révélation écrase le fragile Aron, qui pousse des cris incohérents et s'enfuit. Le lendemain, Aron, brisé, s'engage dans l'armée, tandis que Cathy, horrifiée par la réaction de son fils à son égard, se suicide en faisant une overdose de morphine. Elle laisse à Aron toute sa fortune, héritée en partie de Charles et en partie gagnée par le chantage et la prostitution.
Quand Adam découvre qu'Aron s'est engagé dans l'armée, il est en état de choc. Lee parle à Cal de la notion de timshel et l'exhorte à se rappeler que, malgré sa culpabilité, il est un être humain normal et imparfait, et non une incarnation aberrante du mal. Cette discussion permet à Cal de se sentir un peu mieux, et il peut entamer une relation avec Abra, qui n'est plus amoureuse d'Aron.
(LI-LV) Un télégramme arrive pour informer la famille qu'Aron a été tué pendant la Première Guerre mondiale. Adam a une attaque en entendant la nouvelle, et Lee amène Abra et Cal voir Adam sur son lit de mort. Lee informe Adam que Cal, qui s'est senti coupable, a parlé à Aron de leur mère uniquement parce que Cal était convaincu que leur père aimait Aron plus que lui. Lee demande à Adam d'offrir sa bénédiction à Cal avant qu'il ne meure. Adam lève la main et murmure un seul mot, "Timshel!", "ses yeux se fermèrent et il dormit".
En 1955, Elia Kazan réalisa une adaptation de "East of Eden" (centrée sur la 4e partie de l'ouvrage) avec James Dean (Cal Trask), Julie Harris (Abra) et Raymond Massey (Adam Trask)...
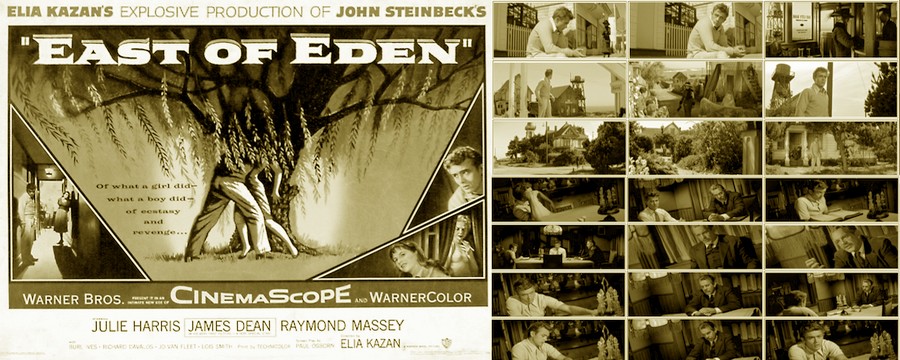

"Sweet Thursday" (1954)
"When the war came to Monterey and to Cannery Row everybody fought it more or less, in one way or another. When hostilities ceased everyone had his wounds.
The canneries themselves fought the war by getting the limit taken off fish and catching them all. It was done for patriotic reasons, but that didn’t bring the fisli back. As with the oysters in Alice, “They’d eaten every onc\ ’ It was the same noble impulse that stripped the forests of the West and right now is pumping water out of California’s earth faster than it can rain back in. When the desert crimes, people will be sad; just as Cannery Row was sad when all the pilchards were caught and canned and eaten. The pearl-grey canneries of corrugated iron were silent and a pacing watchman was their only life. The street that once roared with trucks was quiet and empty.
Yes, the war got into everybody. Doc was drafted. He put a friend known as Old Jinglcballicks in charge of Western Biological Laboratories and served out his time as a tech, sergeant in a V. D. section ..."
Suite de "Cannery Row" qui se déroule dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui commente indirectement l'art et la manière de l'auteur avec un peu de recul, conscient de son ambivalence auprès de nombre de lecteurs de l'époque, le critique social des années 1930 - dénoncé parfois comme un propagandiste efficace maniant la parabole et l'ironie -, et l'auteur de comédie picaresque parvenant à goûter les plaisirs de la pauvreté et de l'anarchie...
"Well, I like a lot of talk in a book, and I don't like to have nobody tell me what the guy that's talking looks like. I want to figure out what he looks like from the way he talks. And another thing— I kind of like to figure out what the guy's thinking by ivhat he says. I like some description too," he went on. "I like to know what colour a thing is, how it smells and maybe how it looks, and maybe how a guy feels about it— but not too much of that." (Prologue) - Une nuit, Mack, allongé sur son lit du Palace Flop House s'ouvre à son copain Whitey et entreprend une véritable critique, à chaud et sur la forme, de "Cannery Row". J'aime qu'on parle beaucoup dans un livre, et je n'aime pas qu'on me dise à quoi ressemble le type qui parle. Je veux savoir à quoi il ressemble d'après sa façon de parler. Et une autre chose - j'aime bien comprendre ce que le gars pense par ce qu'il dit. J'aime aussi les descriptions, j'aime savoir de quelle couleur est une chose, comment elle sent et peut-être à quoi elle ressemble, et peut-être ce que le gars ressent à ce sujet, et parfois, j'ai envie qu'un livre se détache de tout ce qui n'est pas clair, et si le gas ajoute un peu de gribouillage, vaut mieux les mettre en premier, ça me permettra de les sauter et d'y revenir pour peut-être les lire quand je sais comment l'histoire se termine. "Mack, if the guy that wrote Cannery Row comes in, you going to tell him all that?"...
