- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty

Arthur Koestler (1905 - 1983), "Dialogue with Death" (1937), "Spanish Testament"
(1938), "Darkness at Noon" (1940, Le Zéro et l'infini), "Scum of the Earth" (1941), "Arrival and Departure" (1943), "The Yogi And The Commissar" (1945), "Thieves in the Night" (1942), "Arrow in
the Blue" (1952), "The Invisible Writing" (1954), "The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe" (1959), "The Lotus and the Robot" (1960), "The Act of Creation" (1964),
"The Ghost in the Machine" (1967), - ....
Last update : 11/11/2016

Dans les années 1940 et au début des années 1950, Arthur Koestler fut peut-être le romancier politique le plus lu de la seconde moitié du XXe siècle : "Darkness at Noon", considéré comme son chef-d'œuvre, qui révèle le trouble mécanisme des procès de Moscou et la manipulation idéologique à une époque où la critique du stalinisme était de fait violemment condamnée par nombre d'intellectuels, lui valut l'un des plus grands succès de librairie dans les années qui suivirent la Libération. Né à Budapest en 1905, hongrois de culture germanique, étudiant à Vienne, futur britannique de plume, Arthur Koestler plongea très tôt dans les grands conflits idéologiques et sociaux de son époque, alternant toute sa vie entre l'homme d'action et l'homme de lettres, cherchant sa "foi" et de grandes "causes" , à étancher sa soif d'utopie et de fraternité, et entretenant avec la mort des relations bien singulières ...
Et dans "Darkness at Noon", Arthur Koestler se demande comment un mouvement dont le but originel était d’améliorer les conditions des « masses » a pu aboutir à l'instauration d'une telle logique de la terreur, se retournant même contre ses propres serviteurs. Le roman suit l’un de ces serviteurs, Nicholas Salmanovitch Rubashov, pendant le dernier mois de sa vie, qu’il passe en prison puis en procès jusqu’à ce qu’il soit finalement exécuté ...
Koestler n’est certes pas un penseur original, mais un homme qui sait, pur l'avoir vécue, que si la souffrance seule ne produit pas la sagesse, la grande ligne de démarcation qui semble maintenant s'imposer est "entre ceux qui ont souffert et ceux qui sont restés relativement intacts" (between those who have suffered and those who have remained relatively untouched) ..
« Notre existence se déroule sur deux plans qu’on pourrait appeler la « vie tragique » et la « vie triviale »… Un des malheurs de la condition humaine est que nous ne pouvons vivre en permanence ni sur un plan, ni sur l’autre, mais que nous oscillons entre les deux. Quand nous sommes sur le plan trivial, les réalités du plan tragique paraissent absurdes. Quand nous vivons sur le plan tragique, les joies et les souffrances du plan trivial nous semblent superficielles, frivoles, sans importance… Il arrive que, dans des circonstances exceptionnelles, dans des moments de danger ou d’exaltation, on se trouve pour ainsi dire à la ligne d’intersection des deux plans ; situation curieuse qui oblige à marcher sur la corde raide du système nerveux. Il est un type d’homme condamné à marcher constamment sur cette corde raide : c’est l’artiste et, particulièrement, l’écrivain. » (Le Yogi et le Commissaire.)
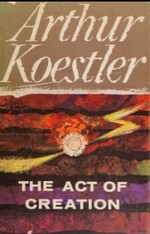








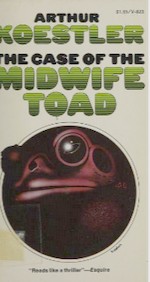

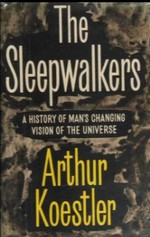
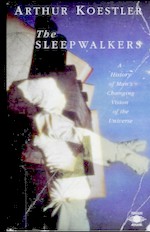
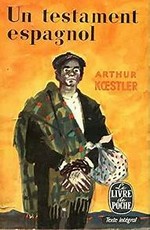


Arthur Koestler (1905 - 1983)
Natif de Budapest, c'est entre 1922 et 1926 qu'Arthur Koestler étudie à Vienne, se familiarise avec le judaïsme, adhère à la cause sioniste qui veut créer en Palestine un État juif moderne et démocratique, puis gagne en 1926 la Palestine, y exerce de nombreux métiers (cf. "Thieves in the Night") et devient journaliste. En 1930, il est à Paris puis à Berlin, s'embarque à bord du Graf Zeppelin lors de son expédition polaire.
"... J’arrivai à Berlin le jour des élections fatales du Reichstag, le 14 septembre 1930. J’atteignais le troisième tournant de mon âge adulte. Chacun avait été marqué par une date symbolique. J’avais quitté la maison familiale et m’étais mis en route pour la Palestine en 1926, le jour des poissons d’avril. J’étais arrivé à Paris le 14 juillet 1929, et j’arrivai à Berlin le jour qui annonçait la fin de la République de Weimar et l’avènement en Europe de l’âge de la barbarie. Jusqu’au 14 septembre, le parti national-socialiste disposait de douze sièges au parlement ; à dater de ce jour, il en posséda cent sept. Les partis du centre étaient écrasés. Le parti démocrate avait à peu près disparu. Les socialistes avaient perdu neuf sièges. Le nombre des votes communistes avait augmenté de 40 p. 100 ; celui des votes nazis, de 800 p. 100. La finale approchait. Elle eut lieu trente mois plus tard ..."
En 1931, il adhère au Parti communiste allemand et fait plusieurs séjours en Union soviétique dans les années qui suivent, tombe dans le cercle des agents du Komintern et s'installe à Paris en 1933, alors qu'Hitler accède au pouvoir en Allemagne.
En 1937, correspondant de guerre pour le compte du News Chronicle en Espagne, il est capturé par les troupes franquistes et emprisonné et condamné à mort (cf. "Dialogue with Death"). Il est finalement libéré grâce à l'intervention du gouvernement britannique et retourne à Londres, se lie d’amitié avec George Orwell. De cet épisode naît le livre, "Spanish Testament", dont le succès est immédiat. Et c'est en Espagne, qu'il cesse, ajoutera-t-il, de croire en ce dogme fondamental du marxisme révolutionnaire que la fin justifie les moyens ...
En 1938, il quitte le Parti communiste et écrit un roman, "The Gladiators". En 1939-1940, il est en France, rapidement jugé comme un étranger indésirable et interné (cf. "Scum of the earth", récit des persécutions du gouvernement français contre les étrangers, en 1939-1940), s'engage au cours de l'exode dans la Légion étrangère et fuit à Londres. Il y publie en 1940, "Darkness at noon" (traduit en fançais en 1945 sous le titre "Le Zéro et l'Infini"), une œuvre anti-totalitaire qui lui vaut une renommée internationale. En 1942-1943, ayant rejoint l'armée britannique, il est affecté un temps au ministère de l'Information, époque à laquelle il écrit "Arrival and Departure" (1943) et plusieurs essais réunis dans "The Yogi and the Commissar" (1945), dont "On Disbelieve Atrocities" (initialement publié dans le New York Times) consacré aux atrocités nazies perpétrées contre les Juifs, enfin "Spartacus" (1944), roman d'une révolution qui échoue. Il séjourne en Palestine en 1944 et 1945, alors correspondant spécial du Times, et soutient la création de l'Etat d'Israël. En 1949, il acquert enfin le nationalité britannique et dès les débuts de la guerre froide sert la propagande anticommuniste menée par les services de renseignements britanniques.
"Arrow in the Blue" (1952, La Corde raide) et "The Invisible Writing" (1954, Les Hiéroglyphes), son autobiographie en deux volumes (1931, 1932-1940) contant les voyages de Koestler à travers la Russie et des régions reculées de l’Asie centrale soviétique et de sa vie en exil, et comment il a survécu dans les prisons de Franco et dans les camps de concentration en France occupée : et se termine avec son évasion en 1940 vers l'Angleterre ..
"Thieves in the Night" (1946, La tour d'Ezra) et "The Age of Longing" (1951) vont achever cette première et foisonnante période. En 1955, il crée en Angleterre la Campagne nationale pour l'abolition de la peine de mort ("Reflections on Hanging", 1955). Les années 1960 sont conscacrées à bien des expérimentations personnelles, et un nombre de lectures impressionnant touchant toutes les connaissances de l'époque ...
Au temps des romans, succède donc celui des essais, souvent contestés quant au fond, dominé par la science et l'inexplicable tentation qui conduit l'être humain à se détruire tout en défiant la mort ("The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe", 1959 (Les Somnambules); "The Lotus and the Robot" (1960), "The Act of Creation", 1964 (Le Cri d'Archimède), tentative d'exploration de la créativité humaine, fut-elle scientifique ou artistique. Dans "The Ghost in the Machine" (1967), une fois de plus, Koestler fait appel à toutes les ressources scientifiques et philosophiques, peu importe les frontières, pour tenter de comprendre, au-delà de notre tendance autodestructrice, qu'elle soit collective ou individuelle, la complexité de notre conscience. Les discussions de l'époque autour de l'interconnexion esprit / corps, dualisme ré-interprété par le philosophe Gilbert Ryle, lui fournisse matière à postuler que nos êtres ne sont pas uniquement régis par des lois physiques, mais par une essence intangible, énigmatique, le "fantôme", en une structure construite sur une hiérarchie d' "holons"...
Au cours de la première moitié des années 1970, toujours plongé dans les questions de science que viennent enrichir mysticisme et paranormal, voyageant beaucoup, des Etats-Unis en Inde et au Japon, Koestler publiera "The Case of the Midwife Toad" (1971, L'Étreinte du crapaud), "The Roots of Coincidence" (1972, Les Racines du hasard), dans lequel Koestler postule des liens entre la physique moderne, leur interaction avec le temps et les phénomènes paranormaux, ...
et "The Call-Girls" (1972), et "The Thirteenth Tribe" (1976, L'Empire khazar et son héritage), autres sujets, autres thèmes.
Des essais politiques, psychologiques ou littéraires qui révèlent une pensée brillante autant qu'originale : mais l’intellectuel déraciné qu'il est devenu, dépourvu de tradition religieuse vers laquelle se tourner, semble devoir se réfugier dans un mysticisme personnel qui ne peut rester qu'indéfini ...
À la fin de sa vie, Koestler a souffert de leucémie et de la maladie de Parkinson, et décide de se donner la mort avec sa femme Cynthia....
"Koestler : the literary and political odyssey of a twentieth-century skeptic", de Michael Scammell (2009) est l'une des premières biographie autorisées de l’un des intellectuels les plus influents et controversés du XXe siècle ...

"Spanish Testament" (1938, Un Testament espagnol)
Oeuvre autobiographique de l'écrivain Arthur Koestler : alors qu'il était correspondant en Espagne du journal libéral anglais News Chronicle, l`auteur fut arrêté par les nationalistes après la prise de Malaga et condamné à mort. Il attendit son exécution durant près de quatre mois, à Malaga puis à Séville, et vit périr sous les balles des pelotons franquistes presque tous ses compagnons de prison.
Ce livre, commencé comme un reportage, finit donc en "Variations sur la mort ou plutôt sur la peur de mourir", partie II du livre ensuite été publiée seule, avec des modifications mineures, sous le titre "Dialogue with Death".
De fait, Koestler fit trois voyages en Espagne pendant la guerre civile; la troisième fois, il fut capturé, condamné à mort et emprisonné par les forces nationalistes du général Franco. Koestler travaillait comme agent d’espionnage pour le compte du Komintern (Koestler devait travailler sous la direction de Willy Muenzenberg à un ouvrage écrit en français, "L'Espagne ensanglantée") et comme agent de l’agence de presse officielle de la Seconde République espagnole, utilisant pour la couverture l’accréditation du quotidien britannique News Chronicle : la campagne pour sa libération insistait particulièrement sur le fait que c'est un journaliste anglais "libéral" qui avait été ainsi capturé et menacé de mort ...
Et l'auteur prit le parti de publier ces pages écrites en attendant la mort parce que pareille expérience, outre son intérêt psychologique, n'a guère l'occasion d'être vécue et rapportée par un écrivain professionnel. Koestler s'efforce de la rendre avec le maximum d'exactitude, sans céder au "vaniteux désir de faire bonne figure".
Ce livre, dédié à un jeune républicain espagnol fusillé à dix-huit ans, porte donc témoignage à la fois sur la brutalité de la répression franquiste et sur l'homme devant la mort. Semblable en cela à Dostoïevski, Koestler restera profondément marqué par cette attente de la mort. Seize ans plus tard, en 1955, il lancera en Angleterre la campagne nationale pour l`abolition de la peine de mort et publiera en 1957, en collaboration avec Albert Camus, ses "Réflexions sur la peine capitale" (Reflexions on Hanging) afin de lutter toujours et partout pour la même cause.

"Darkness at Noon" (1940, Le Zéro et l'infini)
Roman de l`écrivain Arthur qui s`inspire de l'expérience personnelle de l'auteur qui adhéra au parti communiste en 193l et y resta huit ans. De même que "Croisade sans croix", c`est un livre d`amertume et de déception, et c`est d'ailleurs pourquoi on ne saurait le considérer seulement comme un témoignage.
L’intrigue se déroule pendant les procès de purge de Joseph Staline dans les années 1930 et nous montre l'homme aux prises avec le Parti. Un ancien dirigeant, un bolchevique de la vieille garde, Roubachoff (Rubashov), qui s`est dévoué totalement à la cause du communisme russe, est arrêté, traduit en justice et exécuté. Roubachoff est accusé de trahison et de déviationnisme et ses propres paroles se retournent contre lui.
"Le Parti n`a jamais tort, camarade. Toi et moi, nous pouvons nous tromper. Mais pas le Parti. Le Parti est quelque chose de plus grand que toi et moi et que mille autres que toi et moi. Le Parti est l`incarnation de l'idée révolutionnaire dans l`Histoire. L`Histoire ne connaît ni scrupule ni hésitation. lnerte et infaillible, elle coule vers son but. A chaque courbe de son cours, elle dépose la boue qu`elle charrie et les cadavres des noyés. L`Histoire connaît son chemin. Elle ne commet pas d`erreurs".
Nicholas Rubashov nie d’abord, puis avoue, les crimes qu’il n’a pas commis. Reflétant le propre désenchantement de Koestler envers le communisme, l’intrigue examine le dilemme d’un révolutionnaire vieillissant qui ne peut plus tolérer les excès d’un régime qu’il a contribué à établir. Le Parti va exécuter Roubachoff parce qu'il sait que celui-ci ne marche plus aveuglément dans le chemin de l'Histoire, mais ose juger son action et la condamner.

« La première audience » (The First Hearing), relate l’arrestation de Rubashov et sa première semaine en prison. À travers ses flashbacks et ses conversations avec Ivanov, le vieil ami de Rubashov et premier examinateur, nous rencontrons Vassilij, le portier de l’immeuble de Rubashov (que nous reverrons dans la quatrième audience). Nous sont relatés les détails entourant l’implication de Rubashov dans l’expulsion de deux membres du Parti, Richard en Allemagne et Little Loewy en Belgique. Les destins de ces deux hommes, la mort vraisemblable de l'un et le suicide de l'autre, pèsent lourdement sur la conscience de Rubashov et sont la motivation sous-jacente de son opposition à la politique du Parti.
(...) XIV - "Il était onze heures du matin lorsqu'ils vinrent le chercher. A l'expression solennelle du geôlier, Roubachof devina tout de suite où ils allaient. Il suivit le gardien avec la nonchalante sérénité, effet d'une miséricorde inattendue, qui le prenait toujours à l'heure du danger. Ils suivirent le même chemin que trois jours plus tôt lorsqu'ils allaient chez le docteur. La porte de ciment s'ouvrit de nouveau et se referma bruyamment; chose étrange, pensa Roubachof, comme on s'habitue vite à un milieu intense; il lui semblait respirer l'air de ce corridor depuis des années, comme si l'atmosphère empestée de toutes les prisons qu'il avait connues était emmagasinée là-dedans.
Ils passèrent devant le coiffeur et la porte fermée du docteur, devant laquelle attendaient trois prisonniers sous la garde d'un geôlier léthargique. Après cette porte, Roubachof découvrit des régions inconnues. Ils passèrent auprès d'un escalier en colimaçon plongeant dans des profondeurs. Qu'y avait-il là-dessous? des magasins? des cellules disciplinaires? Avec tout l'intérêt d'un expert, Roubachof s'efforçait de le deviner. La mine de cet escalier ne lui disait rien de bon.
Ils traversèrent une cour étroite et sans fenêtres; c'était un puits intérieur, mais au-dessus on voyait une grande échappée de ciel. De l'autre côté de cette cour, les corridors étaient plus gais; les portes n'étaient plus en ciment, mais en bois peint, avec des boutons de cuivre; des fonctionnaires affairés les croisèrent; derrière une porte, on entendait une radio; derrière une autre, une machine à écrire. Ils étaient dans les bureaux de l'administration.
Ils s'arrêtèrent à la dernière porte, au bout du couloir; le gardien frappa. Dedans, quelqu'un téléphonait; une voix calme cria : “ Un moment, s'il vous plaît ” et continua patiemment de répondre “ Oui ” et “ Bien sûr ” dans l'appareil.
La voix paraissait familière à Roubachof, mais il ne la situait pas. C'était une voix agréablement mâle, légèrement enrouée; il était sûr de l'avoir déjà entendue quelque part. “ Entrez ”, dit la voix; le gardien ouvrit la porte et la referma immédiatement sur Roubachof. Roubachof vit une table; derrière cette table était assis son vieil ami d'université et son ancien chef de bataillon, Ivanof; il le regardait en souriant, et remit en place le récepteur.
- Comme on se retrouve, dit Ivanof.
Roubachof restait debout près de la porte.
- Quelle agréable surprise, répondit-il sèchement.
- Assieds-toi, dit Ivanof avec un geste poli. Il s'était levé; debout, il avait une demi-tête de plus que Roubachof. Il le regardait en souriant. Tous deux s'assirent - Ivanof derrière le pupitre, Roubachof devant. Ils se regardèrent pendant quelques instants, donnant libre cours à leur curiosité. Il y avait presque de la tendresse dans le sourire d'Ivanof. Roubachof restait sur une vigilante expectative. Son regard se porta sous la table vers la jambe droite d'Ivanof.
- Oh! ça marche, dit Ivanof. Jambe artificielle avec articulations automatiques en acier chromé inoxydable; je nage, je monte à cheval, je conduis une auto et je danse. Veux-tu une cigarette?
Il tendit à Roubachof un étui à cigarettes en bois. Roubachof regarda les cigarettes et songea à sa première visite à l'hôpital militaire après l'amputation de la jambe d'Ivanof. Ivanof lui avait demandé de lui procurer du véronal, et, au cours d'une discussion qui s'était prolongée pendant tout l'après-midi, avait essayé de lui démontrer que tout homme a droit au suicide. Roubachof avait fini par lui demander le temps de réfléchir, et le soir même avait été transféré dans un autre secteur du front. Des années s'étaient écoulées avant qu'il revit Ivanof. Il regarda les cigarettes dans l'étui de bois. Elles étaient roulées à la main, et faites de tabac américain blond et frisé.
- S'agit-il encore des compliments d'usage ou les hostilités sont-elles ouvertes? demanda Roubachof. - Dans la seconde hypothèse, je n'en prends pas. Tu connais l'étiquette.
- Tu fais la bête, dit Ivanof.
- Alors, bon, faisons la bête, dit Roubachof. Il alluma une des cigarettes d'Ivanof. Il aspirait longuement la fumée, en essayant de ne pas montrer combien il y éprouvait de plaisir.
_ Et comment vont tes rhumatismes aux épaules? demanda-t-il.
- Très bien, merci, dit Ivanof; et comment va ta brûlure?
Il sourit et désigna innocemment du doigt la main gauche de Roubachof. Sur le dos de la main, entre les veines bleuâtres, à l'endroit où trois jours auparavant il avait éteint sa cigarette, il y avait une ampoule de la grosseur d'un sou en bronze. Pendant une minute, tous deux regardèrent la main de Roubachof posée sur ses genoux. "Comment sait-il? se demanda Roubachof. Il m'a fait espionner." Il en éprouva plus de honte que de colère; il aspira une dernière bouffée de sa cigarette et la jeta.
- En ce qui me concerne, les compliments d'usage sont terminés, dit-il.
Ivanof fit des ronds avec la fumée de sa cigarette et l'observa avec le même sourire tendrement ironique.
- Ne fais donc pas d'histoires, dit-il.
- Si je comprends bien, répliqua Roubachof, c'est vous qui me faites des histoires. Qui de nous deux a arrêté l'autre? Est-ce toi ou moi?
- C'est bien nous qui t'avons arrêté, dit Ivanof.
Il éteignit sa cigarette, en alluma une autre et tendit la boîte à Roubachof, qui ne broncha pas.
- Le diable t'emporte ! dit Ivanof. Tu te souviens de l'affaire du véronal?
Il se pencha en avant et soufflala fumée de sa cigarette au visage de Roubachof:
- Je ne veux pas qu'on te fusille, dit-il lentement. Il se renversa dans son fauteuil. Le diable t'emporte ! repéta-t-il, avec un sourire.
-- Très gentil de ta part, dit Roubachof. Et pourquoi au juste avez-vous l'intention de me faire fusiller, vous autres?
lvanof laissa s'écouler quelques secondes. Il fumait et faisait des dessins sur le buvard avec son crayon. Il semblait chercher ses mots.
-- Écoute, Roubachof, dit-il enfin. Il y a une chose que je voudrais te faire observer. Tu viens à plusieurs reprises de dire “ vous ” et “ vous autres ” - pour désigner l'État et le Parti, par opposition à “je ” - c'est-à-dire Nicolas Salmanovitch Roubachof. Pour le public, il faut, naturellement, un procès et une justification légale. De moi à toi, ce que je viens de te dire devrait suffire.
Roubachof retourna cela dans sa tête; il était plutôt interloqué. Pendant un instant, ce fut comme si Ivanof avait frappé un diapason auquel son esprit répondait spontanément. Tout
ce qu'il avait cru et prêche, tout ce pour quoi il avait lutté depuis quarante ans lui envahit l'esprit en une marée irrésistible. L'individu n'était rien, le Parti tout ; la branche qui se détachait de l'arbre devait se dessécher... Roubachof frotta son binocle sur sa manche. Ivanof, appuyé au dossier de sa chaise, fumait et ne souriait plus. Soudain, l'œil de Roubachof fut attiré sur le mur par un carré plus clair que le reste du papier de tenture. Il sut immédiatement que la photographie aux visages barbus et aux noms numérotés avait été accrochée là. Ivanof suivit son regard sans changer d'expression.
- Ton argument est tant soit peu anachronique, dit Roubachof. Comme tu me l'as très justement fait observer, nous avions coutume d'employer toujours le pluriel “ nous ” et d'éviter autant que possible la première personne du singulier.
J'ai plutôt perdu l'habitude de cette façon de parler; tu l'as conservée. Mais qui est ce “ nous ” au nom duquel tu parles aujourd'hui? Il a besoin d'être déffiní. Voilà ce qu'il en est.
- Tout à fait mon opinion, dit Ivanof. Je suis heureux que nous en soyons venus si vite au cœur du sujet. En d'autres termes : tu es convaincu que “ nous ” - c'est-à-dire le Parti, l'Etat et les masses qui sont derrière eux -- ne représentons que les intérêts de la Révolution.
- Je ne mêlerai as les masses à cela, dit Roubachof.
- Depuis quand montres-tu ce sublime mépris pour la plèbe? demanda Ivanof. Est-ce que cela aurait aussi quelque rapport avec le changement grammatical en faveur de la première personne du singulier? »
Il se pencha sur son pupitre avec un air de bienveillante raillerie. Sa tête cachait maintenant la tache claire du mur, et tout à coup la scène du musée fut présente à l'esprit de Roubachof; la tête de Richard était venue se placer entre lui et les mains jointes de la Pietà. Au même instant, un élancement lui traversa la mâchoire, le front et l'oreille. Pendant une seconde, il ferma les yeux.
-“ Maintenant, je paie ”, pensa-t-il. Tout de suite après, il ne se rappelait plus s'il n'avait pas parlé tout haut.
- Que veux-tu dire? demanda la voix d'Ivanof. Elle semblait toute proche de son oreille, railleuse et légèrement surprise. La douleur s'en alla; le silence et la tranquillité régnèrent dans son esprit.
_ N'y mêlons pas les masses, reprit-il. Vous ne savez rien d'elles. Ni moi non plus, sans doute. Naguère, lorsque existait encore le grand “ nous ”, nous les comprenions comme personne ne les avait encore comprises. Nous avions pénétré dans leurs profondeurs, nous travaillions sur la matière première de l'histoire elle-même...
Sans s'en rendre compte, il avait pris une cigarette dans l'étui d'Ivanof, resté ouvert sur la table. Ivanof se pencha vers lui et la lui alluma.
- Dans ce temps-là, poursuivit Roubachof, on nous appelait le Parti de la Plèbe. Les autres, que connaissaient-ils de l'histoire? Des rides passagères, de petits remous et des vagues qui déferlent. Ils s'étonnaient des formes changeantes de la surface et ne savaient pas les expliquer. Mais nous étions descendus dans les profondeurs, dans les masses amorphes et anonymes, qui en tous temps constituent la substance de l'histoire; et nous étions les premiers à découvrir les lois qui en régissent les mouvements - les lois de son inertie, celles des lentes transformations de sa structure moléculaire, et celles de ses soudaines éruptions. C'était la grandeur de notre doctrine. Les Jacobins étaient des moralistes; nous étions des empiriques. Nous avons creusé dans la boue primitive de l'histoire et nous y avons découvert ses lois. Nous connaissions l'humanité mieux qu'aucun homme ne l'a jamais connue; voilà pourquoi notre révolution a réussi. Et maintenant, vous avez tout fait rentrer sous terre...
Ivanof, assis très en arrière, les jambes allongées, écoutait en faisant des dessins sur son buvard.
- Continue, dit-il. Je suis curieux de savoir où tu veux en venir.
Roubachof fumait avec délices. La nicotine lui donnait un léger vertige après sa longue abstinence.
- Comme tu vois, j'en dis assez pour qu'on me coupe la tête, dit-il avec un sourire, en regardant au mur le carré clair, là où avait jadis été accrochée la photographie de la vieille garde. Cette fois-ci, Ivanof ne suivit pas son regard. Mais soit, dit Roubachof. Qu'importe un de plus ou de moins? Tout est enseveli, les hommes, leur sagesse et leurs espérances. Vous avez tué le “ Nous ”; vous l'avez détruit. Prétendez-vous vraiment que les masses soient toujours derrière vous? D'autres usurpateurs en Europe affirment la même chose avec- autant de justification que vous...
Il prit encore une cigarette et l'alluma tout seul cette fois, car Ivanof ne bougea pas.
- Excuse ma suffisance, poursuivit-il, mais crois-tu vraiment que le peuple soit toujours derrière vous? Il vous supporte, muet et résigné, comme il en supporte d'autres dans d'autres pays, mais il ne réagit plus dans ses profondeurs. Les masses sont redevenues sourdes et muettes, elles sont de nouveau la grande inconnue silencieuse de l'histoire, indifférente comme la mer aux navires qu'elle porte. Toute lumière qui passe se reflète sur sa surface, mais au-dessous tout est ténèbres et silence. Il y a longtemps nous avons soulevé les profondeurs, mais cela est fini. En d'autres termes - il s'arrêta et remit son pince-nez - dans ce temps-là, nous avons fait de l'histoire; à présent, vous faites de la politique. Voilà toute la différence.
Ivanof s'enfonça dans son fauteuil et fit des ronds de fumée.
- Je regrette, mais la différence n'est pas tout à fait claire à mes yeux, dit-il. Sans doute auras-tu la bonté de me l'expliquer.
- Certainement, dit Roubachof. Un mathématicien a dit une fois que l'algèbre était la science des paresseux - on ne cherche pas ce que représente x, mais on opère avec cette inconnue comme si on en connaissait la valeur. Dans notre cas, x représente les masses anonymes, le peuple. Faire de la politique, c'est opérer avec x sans se préoccuper de sa nature réelle. Faire l'histoire, c'est reconnaître x à sa juste valeur dans l'équation.
- Joli, dit Ivanof, mais malheureusement un peu abstrait. Pour en revenir à des choses plus concrètes : tu veux dire, par conséquent, que “ nous ” - c'est-à-dire Parti et Etat - ne représentons plus les intérêts de la Révolution, des masses, ou, si tu préfères, le progrès humain.
- Cette fois-ci tu as compris, dit Roubachof avec un sourire. Ivanof ne répondit pas à son sourire.
- Quand as-tu contracté cette opinion?
- Assez graduellement : au cours de ces dernières années, dit Roubachof.
-- Tu ne peux pas me dire plus exactement? Un an? Deux? Trois ans?
- Voilà une question stupide, dit Roubachof. A quel âge es-tu devenu adulte? à dix-sept ans? à dix-huit ans et demi? à dix-neuf ans?
- C'est toi qui fais semblant d'être stupide, dit Ivanof. Chaque étape de notre développement intellectuel est le résultat d'événements précis. Si tu veux vraiment savoir : je suis devenu homme à dix-sept ans, la première fois que j'ai été envoyé en exil.
- Dans ce temps-là, tu étais un type assez convenable, dit Roubachof. Mais n'y pense plus. Il donna un coup d'œil à la tache claire et jeta sa cigarette.
- Je répète ma question, dit Ivanof en se penchant légèrement en avant. Depuis quand appartiens-tu à l'opposition organisée ?
Le téléphone sonna. Ivanof souleva le récepteur, dit : “Je suis occupé” et le raccrocha. Il se rencogna dans son fauteuil, la jambe allongée, et attendit la réponse de Roubachof.
- Tu sais aussi bien que moi, dit Roubachof, que je n'ai jamais fait partie d'une opposition organisée.
- Comme tu voudras, dit Ivanof. Tu m'infliges le pénible devoir de faire le bureaucrate.
Il mit la main sur un tiroir et en tira un paquet de dossiers.
- Commençons en 1935, dit-il en déployant les papiers devant lui. Commencement de la dictature et écrasement du Parti dans le pays où précisément la victoire semblait plus proche. On t'y envoie illégalement, chargé d'épurer et de réorganiser les cadres...
Roubachof s'appuyait au dossier de sa chaise en écoutant sa biographie. Il songeait à Richard, et au crépuscule dans l'avenue devant le musée, là où il avait appelé le taxi.
-- Trois mois plus tard : tu es arrêté. Deux ans de prison. Conduite exemplaire, ils ne peuvent rien prouver contre toi. Tu es élargi et tu fais un retour triomphal...
Ivanof s'interrompit, lui lança un rapide coup d'oeil et poursuivit :
- Tu as été très fêté à ton retour. Nous ne nous sommes pas vus; tu étais sans doute trop occupé... Et à propos, je ne m'en suis pas froissé. Après tout, on ne pouvait pas s'attendre à ce que tu ailles rendre visite à tous tes vieux amis. Mais je t'ai vu à deux réunions, sur l'estrade. Tu marchais encore avec des béquilles et tu avais l'air éreinté. Il aurait été logique d'aller passer quelques mois dans un sanatorium, puis de prendre quelque poste dans le Gouvernement - après quatre ans en mission à l'étranger. Mais au bout de quinze jours, tu demandais déjà une nouvelle mission à l'étranger...
Il se pencha tout à coup en avant, rapprochant son visage tout près de celui de Roubachof :
- Pourquoi? - demanda-t-il, et pour la première fois sa voix était âpre. Tu ne te sentais pas à ton aise, ici, je suppose? Pendant ton absence certains changements s'étaient produits dans le pays, et évidemment tu ne les appréciais pas.
Il attendit que Roubachof dît quelque chose; mais Roubachof était assis tranquillement sur sa chaise et frottait son pince-nez sur sa manche; il ne répondit pas.
- C'était peu de temps après que la première fournée de l'opposition eut été reconnue coupable et liquidée. Tu y avais des amis intimes ..."

"Deuxième audience" ((The Second Hearing), cinquième jour de prison .....
Trois éléments principaux sont ici relatés : le souvenir que Rubashov a d'Arlova, la maîtresse qu'il a trahie et qui a été exécutée, la mort de son vieil ami Bogrov traîné devant la porte de la cellule de Rubashov en gémissant son nom, et le long interrogatoire de Rubashov par Ivanov, dont le but ultime est de convaincre Rubashov, par le biais d'une discussion philosophique, de rétablir sa complète soumission au Parti. Rubashov semble, à la fin de cette "audience", en grande partie convaincu par Ivanov, il en expose pas moins sa critique de la politique du Parti et un sentiment de complicité active avec es mécanismes répressifs de celui-ci ...
"II - Le lendemain du premier interrogatoire de Roubachof, le juge d'instruction, Ivanof et son collègue Gletkin étaient assis à la cantine après le dîner. Ivanof était là; il avait calé sa jambe artificielle sur une chaise et défait le col de sa tunique. Il remplit les verres de cette piquette que l'on vendait à la cantine, et s'émerveilla en silence à la vue de Gletkin, assis droit sur sa chaise dans son uniforme, empesé à chacun de ses mouvements. Il n'avait même pas enlevé son ceinturon et son revolver; et pourtant, il devait lui aussi être fatigué. Gletkin vida son verre; la cicatrice qui attirait les regards sur son crâne rasé avait légèrement rougi. A part eux deux, il n'y avait dans la cantine que trois officiers assis à une table à quelque distance; deux d'entre eux jouaient aux échecs, le troisième les regardait.
- Que va-t-on faire de Roubachot? demanda Gletkin.
- Il va plutôt mal, répondit Ivanof, mais il est aussi logicien que jamais. Donc, il capitulera.
- Je ne le pense pas, dit Gletkin.
- Si, dit Ivanof. Quand il aura suivi toutes ses idées jusqu'à leur aboutissement logique, il capitulera. Il faut donc avant tout le laisser tranquille et ne pas le déranger. Je lui ai accordé du papier, un crayon et des cigarettes - pour accélérer la marche de la pensée.
- J'estime que c'est une erreur, dit Gletkin.
- Il te déplaît, dit Ivanof. Tu as eu une scène avec lui il y a quelques jours?
Gletkin se souvint de la scène où Roubachof assis sur sa couchette enfilait son soulier sur sa chaussette en loques.
- Ça ne compte pas, dit-il. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est la méthode que je trouve mauvaise. Cela ne le fera jamais céder.
- Roubachof capitulera, dit Ivanof, ce ne sera pas par lâcheté, mais par logique. Rien ne sert d'essayer la manière forte avec lui. Il est fabriqué d'un métal qui ne fait que durcir plus on frappe dessus.
- Balivernes, dit Geltkin. Il n'existe pas d'être humain capable de résister à une pression physique illimitée. Je n'en ai jamais rencontré. L'expérience montre que la résistance du système nerveux humain a des limites naturelles.
- Je n'aimerais pas tomber entre tes pattes, dit Ivanof avec un sourire où se mêlait un soupçon d'inquiétude. En tout cas, tu es la vivante réfutation de ta propre théorie.
Son regard souriant s'arrêta un instant sur la cicatrice de Geltkin. L'histoire de cette cicatrice était célèbre. Pendant la Guerre civile, Gletkin était tombé entre les mains de l'ennemi; pour lui arracher certains renseignements, on avait attaché à son crane rasé une mèche de chandelle allumée. Quelques heures plus tard, les siens reprenaient la position et le trouvaient sans connaissance. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. Gletkin n'avait pas parlé. Il regarda Ivanof de ses yeux impassibles.
- Balivernes aussi, dit-il. Si je n'ai pas cédé, c'est parce que je me suis évanoui. Si j'avais gardé ma connaissance un moment de plus, je parlais. C'est une affaire de tempérament physique.
Il vida son verre d'un geste mesuré; ses manchettes crissèrent lorsqu'il posa le verre sur la table.
- Quand j'ai repris connaissance, j'étais d'abord persuadé que j'avais parlé. Mais les deux sous-officiers libérés en même temps que moi ont affirmé le contraire. Alors, j'ai été décoré. C'est une affaire de tempérament physique; tout le reste, c'est de la légende.
Ivanof vida son verre. Il avait déjà bu pas mal de piquette.
Il haussa les épaules.
- Depuis quand soutiens-tu cette remarquable théorie physiologique? Après tout, pendant les premières années, ces méthodes-là n'existaient pas. Nous étions encore remplis d'illusions. Abolition de la théorie du châtiment et de la loi du talion; des sanatoria avec jardins d'agrément pour les éléments asociaux. Des foutaises.
- Je ne suis pas d'accord, dit Gletkin. Tu es un cynique. Dans cent ans, nous aurons tout cela. Mais, d'abord, il nous faut passer le cap.. Plus vite ça ira, mieux ça vaudra. La seule illusion était de croire que le temps était déjà venu. Quand on m'a envoyé ici, au début, j'ai partagé cette illusion. Nous voulions commencer tout de suite avec les jardins d'agrément. C'était une erreur. Dans cent ans, nous serons à même de faire appel à la raison et aux instincts sociaux du criminel. Aujourd'hui, nous devons encore travailler sur son tempérament
physique, et au besoin l'craser physiquement et moralement.
Ivanoff se demandait si Gletkin était ivre. Mais il vit à ses yeux calmes et impassibles qu'il ne l'était pas. Ivanof lui souriait d'un air vague.
- En somme, c'est moi le cynique et toi le moraliste.
Gletkin ne dit rien. Il se tenait raide sur sa chaise dans son uniforme empesé; son ceinturon sentait le cuir neuf.
- Il y a plusieurs années, dit Gletkin au bout d'un moment, on m'amena un petit paysan à interroger. C'était en province, dans le temps où nous croyions encore à la théorie du jardin d'agrément, comme tu dis. Les interrogatoires se faisaient de façon très comme il faut. Mon paysan avait enterré sa récolte; c'était au commencement de la collectivisation de la terre. Je m'en suis tenu strictement aux formes protocolaires. Je lui ai expliqué amicalement que nous avions besoin du blé pour nourrir la population croissante des villes et pour l'exportation, afin de mettre sur pied notre industrie; il serait bien gentil de me dire où il avait caché sa récolte. Le paysan, s'attendant à une rossée, rentrait la tête dans ses épaules quand on l'avait amené dans mon bureau. Je connaissais ces bougres : je suis de la campagne. Quand, au lieu de le rosser, je me suis mis à raisonner avec lui, à lui parler d'égal à égal et à l'appeler "citoyen", il m'a pris pour un idiot. je 'ai vu dans son regard. Je lui ai parlé une demi-heure. Il n'a jamais ouvert la bouche et il se grattait tour à tour le nez et les oreilles. Je continuais de parler, tout en m'apercevant qu'il prenait tout cela pour une superbe rigolade et ne m'écoutait pas. Les arguments ne lui entraient tout bonnement pas dans les oreilles. Elles étaient obturées par le cérumen de siècles innombrables de paralysie mentale patriarcale. Je m'en suis tenu rigoureusement au règlement; je n'ai même jamais songé qu'il y avait d'autres méthodes...
"Dans ce temps-là, j'avais chaque jour vingt ou trente de ces cas-là. Mes collègues également. La Révolution courait le risque de sombrer sur les petits paysans replets. Les ouvriers étaient sous-alimentés; des régions entières étaient ravagées par le typhus dû à la famine; nous manquions de crédits pour développer notre industrie de guerre, et nous nous attendions à être attaqués d'un mois à l'autre. Deux cents millions d'or étaient cachés dans les bas de laine de ces gars-là et la moitié des récoltes était ensevelie. Et en les interrogeant, nous les appelions "citoyens" ; eux, ils nous regardaient en clignotant de leurs petits yeux sournois; ils voyaient dans tout cela une magnifique plaisanterie et ils se grattaient le nez.
"Le troisième interrogatoire de mon type eut lieu à deux heures du matin; j'avais travaillé dix-huit heures sans arrêt. On l'avait réveillé : il était abruti de sommeil et avait peur; il s'est trahi. Depuis lors, j'ai interrogé mes gens surtout la nuit... Une fois, une femme se plaignit d'avoir été gardée debout toute la nuit devant mon bureau à attendre son tour. Ses jambes tremblaient, elle était épuisée; elle s'est endormie en plein interrogatoire. Je la réveille; elle continue de parler, d'une voix endormie et en marmottant, sans bien se rendre compte de ce qu'elle disait, et elle se rendort. Je la réveille encore une fois; elle a tout avoué, et elle a signé sa déposition sans la lire, pour que je la laisse dormir. Son mari avait caché deux mitrailleuses dans sa grange et persuadé les fermiers de son village de brûler leur blé parce que l'Antéchrist lui était apparu en songe. Si sa femme était restée debout à m'attendre toute la nuit, c'était dû à la négligence de mon sergent; depuis lors, j'ai encouragé les négligences de ce genre; les entêtés devaient rester debout au même endroit jusqu'à quarante-huit heures. Après cela, le cérumen fondait dans leurs oreilles, et on pouvait causer..."
Les deux joueurs d'échecs à l'autre coin de la salle renversèrent leurs pièces et recommencèrent une partie. Le troisième était déjà parti. Ivanof observait Gletkin : sa voix restait toujours égale et impassible.
- Mes collègues ont fait les mêmes expériences. C'était la seule façon d'obtenir des résultats. On respectait le règlement; jamais un prisonnier n'a été touché. Mais il se trouvait qu'ils devaient assister - pour ainsi dire accidentellement - à l'exécution d'autres prisonniers. L'effet de pareilles scènes est en partie psychique , en partie physique. Autre exemple : pour des raisons hygiéniques, il y a dans les prisons des douches et des bains. Si en hiver le chauffage et l'eau chaude ne fonctionnaient pas toujours, cela tenait à des difficultés techniques; et la durée du bain dépendait des surveillants. Ou bien, des fois, le chauffage et la machinerie d'eau chaude ne fonctionnaient que trop bien; cela dépendait aussi des surveillants. C'étaient tous de vieux camarades; pas besoin de leur donner des instructions détaillées; ils comprenaient de quoi il s'agissait.
- Je crois que ça suffit, dit Ivanof.
- Tu m'as demandé comment j'ai découvert ma théorie et je te l'explique, dit Gletkin. Ce qui compte, c'est de garder présent à l'esprit la nécessité logique de tout cela; sinon on devient cynique, comme toi. Il est tard, il faut que je m'en aille.
Ivanof vida son verre et déplaça sa jambe artificielle sur la chaise où elle reposait; ses rhumatismes lui faisaient mal dans le moignon. Il s'en voulait d'avoir engagé cette conversation. Gletkin paya la note. Quand le garçon fut parti, il demanda :
- Que va-t›on faire de Roubachof?
- Je t'ai dit mon opinion, dit Ivanof. Il faut le laisser tranquille.
Gletkin se leva. Ses bottes grincèrent. Il était debout près de la chaise sur laquelle était allongée la jambe d'Ivanof.
- Je reconnais ses mérites passés, dit-il. Mais, aujourd'hui, il est devenu aussi nuisible que mon gros paysan; seulement plus dangereux.
Ivanoff leva les yeux vers le regard impassible de Gletkin.
- Je lui ai donné une quinzaine pour réfléchir, dit-il. Pendant ce temps-là, je veux qu'on le laisse tranquille.
Ivanof avait parlé de son ton officiel. Gletkin était son subordonné. Il salua et quitta la cantine en faisant grincer ses bottes. Ivanof demeura assis. Il but encore un verre, alluma une cigarette et en souffla la fumée devant lui. Au bout d'un moment, il se leva et se dirigea en boitant vers les deux officiers pour les regarder jouer.
III
Depuis la première audience, Roubachof avait vu son niveau de vie s'améliorer comme par miracle. Dès le lendemain, le vieux porte-clefs lui avait apporté du papier, un crayon, du savon et une serviette. Il avait en même temps donné à Roubachof des bons de la prison d'une valeur équivalente à l'argent qu'il avait sur lui lors de son arrestation, et il lui avait expliqué qu'il avait maintenant le droit de commander du tabac et des suppléments de vivres à la cantine.
Roubachof se commanda des cigarettes et de quoi manger. Le vieux était tout aussi bourru et monosyllabique, mais il arrivait promptement avec les commandes. Roubachof songea un instant à réclamer un docteur de l'extérieur, mais il oublia de le faire. Sa dent ne lui faisait pas mal pour le moment, et après s'être débarbouillé et avoir mangé il se sentit beaucoup mieux. La neige avait été déblayée dans la cour, et des groupes de prisonniers y tournaient en rond pour leur exercice quotidien. Cette promenade avait été interrompue à cause de la neige; seuls Bec-de-lièvre et son compagnon avaient été autorisés à prendre dix minutes d'exercice, peut-être à la suite de recommandations spéciales du docteur; chaque fois qu'ils entraient dans la cour ou en sortaient, Bec-de-lièvre avait levé les yeux vers la fenêtre de Roubachof. Son geste était si précis que toute possibilité de doute était exclue.
Lorsque Roubachof ne travaillait pas à prendre des notes ou ne se promenait pas de long en large dans sa cellule, il se tenait devant la fenêtre, le front contre le carreau, et observait les prisonniers à la promenade. Elle se faisait par groupes de douze, qui tournaient en rond dans la cour, deux par deux, à dix pas de distance les uns des autres. Au milieu de la cour, se tenaient quatre personnages en uniforme qui s'assuraient que les prisonniers ne se parlaient pas; ils formaient l'axe de ce manège qui tournait avec lenteur et régularité pendant exactement vingt minutes. Puis les prisonniers étaient reconduits l'intérieur par la porte de droite, tandis que simultanément un nouveau groupe entrait dans la cour par la porte de gauche, et commençait le même circuit monotone jusqu'à la relève suivante ...
Pendant les premiers jours, Roubachof avait cherché des visages de connaissance, mais il n'en avait pas trouvé. Cela le soulagea : pour le moment, il voulait éviter tout ce qui pouvait lui rappeler le monde extérieur, tout ce qui pourrait le distraire de sa tâche. Cette tâche consistait à aller au bout de ses pensées, à se mettre en règle avec le passé et l'avenir, avec les vivants et les morts. Il lui restait dix jours du délai fixé par Ivanof.
Il ne pouvait concentrer ses pensées qu'en les notant; mais il se fatiguait d'écrire, si bien qu'il ne pouvait guère s'y forcer que pendant une heure ou deux par jour. Le reste du temps son cerveau travaillait tout seul.
Roubachof avait toujours pensé qu'il se connaissait assez bien. Dépourvu de préjugés moraux, il n'avait pas d'illusions sur le phénomène appelé "première personne au singulier".
Il avait admis, sans émotion particulière, le fait que ce phénomène était doué de certains mouvements impulsifs que les humains éprouvent généralement quelque répugnance à avouer. A présent, lorsqu'il collait son front contre la vitre ou qu'il s'arrêtait soudain sur le troisième carreau noir, il faisait des découvertes inattendues. Il s'apercevait que le processus incorrectement désigné du nom de "monologue" est réellement un dialogue d'une espèce spéciale; un dialogue dans lequel l'un des partenaires reste silencieux tandis que l'autre, contrairement à toutes les règles de la grammaire, lui dit “je ” au lieu de “ tu ”, afin de s'insinuer dans sa confiance et de sonder ses intentions; mais le partenaire muet garde tout bonnement le silence, se dérobe à l'observation et refuse même de se laisser localiser dans le temps et dans l'espace.
Mais maintenant, il semblait à Roubachof que le partenaire habituellement muet parlait de temps en temps, sans qu'on lui adressât la parole et sans prétexte apparent; sa voix paraissait totalement étrangère à Roubachof qui l'écoutait avec un sincère émerveillement et qui s'apercevait que c'étaient ses lèvres à lui qui remuaient. Il n'y avait là rien de mystique ni de mystérieux; il s'agissait de faits tout concrets; et ses observations persuadèrent peu à peu Roubachof qu'il y avait dans cette première personne du singulier un élément bel et bien tangible qui avait gardé le silence pendant toutes les années écoulées et qui se mettait maintenant à parler.
Cette découverte préoccupait Roubachof bien plus que les détails de son entretien avec Ivanof. Il estimait que c'était chose faite, qu'il n'accepterait pas les propositions d'Ivanof, qu'il se refuserait à continuer la partie. Donc ses jours étaient comptés; cette conviction servait de base à ses réflexions.
Il ne pensait pas le moins du monde à cette absurde histoire de complot contre la vie du No 1; il s'intéressait bien davantage à la personnalité d'Ivanof. Ivanof avait dit que leurs rôles auraient tout aussi bien pu être intervertis. En quoi il avait certainement raison. Ivanof et lui étaient des frères jumeaux par leur développement; ils ne sortaient pas du même œuf, mais ils avaient été nourris par le même cordon ombilical, celui de leurs communes convictions; le milieu intense du Parti avait gravé et moulé leur caractère à tous deux pendant les années décisives de leur développement. Ils avaient la même morale, la même philosophie, ils pensaient dans les mêmes termes. Ils auraient tout aussi bien pu changer de rôle.
Alors, c'est Roubachof qui aurait été assis derrière la table et Ivanof devant; et de cette position, Roubachof aurait probablement avancé les mêmes arguments qu'Ivanof. Les règles du jeu étaient fixes. Elles ne toléraient que des variations de détail.
Ce vieux penchant qui le poussait à penser avec l'esprit des autres s'était à nouveau emparé de lui; il était assis à la place d'lvanof et se voyait avec les yeux d'Ivanof, en posture d'accusé, comme jadis il avait vu Richard et le petit Loewy. Il voyait ce Roubachof dégénéré, l'ombre du compagnon d'autrefois, et il comprenait le mélange de tendresse et de mépris avec lequel Ivanof l'avait traité. Pendant leur discussion, il s'était plusieurs fois demandé si Ivanof était sincère ou hypocrite; s'il lui tendait des pièges ou s'il voulait vraiment lui montrer une façon de s'en tirer. Maintenant qu'il se mettait à la place d'Ivanof, il se rendait compte qu'Ivanof était sincère - tout autant, ou tout aussi peu, que lui-même l'avait été envers Richard et le petit Loewy.
Ces réflexions prenaient aussi la forme d'un monologue, mais selon une ligne familière; le partenaire muet, cette entité qu'il venait de découvrir, n'y prenait aucune part. Bien qu'il fût censé être la personne à qui l'on parlait dans tous les monologues, il gardait le silence, et son existence se bornait à n'être qu'une abstraction grammaticale nommée "première personne du singulier". Des questions directes et des méditations logiques ne l'amenaient pas à parler; ses propos survenaient sans cause visible et, chose étrange, étaient toujours accompagnés d'une forte crise de dents. Son ambiance mentale semblait composée d'éléments divers et sans rapports entre eux, comme les mains jointes de la Píetà, les chats du petit Loewy, une mélodie, la cadence d'un vers comme "O Mort, vieux capitaine..." ou quelque phrase prononcée un jour par Arlova. Ses moyens d”expression étaient également fragmentaires : par exemple, la nécessité de frotter son pince-nez sur sa manche, le besoin de toucher la tache claire au mur du bureau d'Ivanof, les mouvements irrésistibles des lèvres murmurant des phrases dénuées de sens comme “ je paierai ”, et cet état d'hébétude provoqué par les rêveries sur des épisodes passés de sa vie.
Au cours de ses promenades dans sa cellule, Roubachof essaya d'étudier au fond cette entité qu'il venait à peine de découvrir; hésitant avec la pudeur coutumière au Parti en cette matière à marcher sur la première personne du singulier, il l'avait baptisée la “fiction grammaticale”. Il ne lui restait probablement plus que quelques semaines à vivre, et il se sentait irrésistiblement poussé à tirer la chose au clair, à aller jusqu'au bout de sa pensée. Mais le royaume de la "fiction grammaticale" semblait commencer précisément là où finissait la "pensée suivie jusqu'au bout". Un aspect essentiel de son être consistait évidemment à rester hors de portée de la pensée logique, et à vous prendre soudain au dépourvu, comme dans une embuscade, et à vous attaquer avec des rêveries et des rages de dents. Ainsi Roubachof passa toute sa septième journée de prison, la troisième après son interrogatoire, à revivre une période passée de son existence - celle de ses relations avec Arlova, la jeune fusillée.
A quel moment, malgré ses résolutions, s'était-il laissé glisser dans la rêverie? Il était aussi impossible de le déterminer par la suite que de dire à quel moment on s'est endormi. Dans la matinée du septième jour, il avait travaillé à ses notes, puis vraisemblablement, il s'était levé pour se dégourdir un peu les jambes. Ce fut seulement lorsqu'il entendit le bruit de la clef dans la serrure qu'il s'aperçut qu'il était déjà midi, et qu'il avait fait les cent pas dans sa cellule pendant des heures entières. Il avait même jeté la couverture sur ses épaules parce
que, sans doute aussi, pendant plusieurs heures, il avait été secoué périodiquement par une sorte de fièvre intermittente et avait senti battre dans ses tempes le nerf de sa dent. Il vida distraitement la jatte que les valets avaient remplie avec leurs louches, et il continua de marcher. Le geôlier, qui l'observait de temps à autre par le judas, vit qu'il s'était enfoncé la tête dans les épaules comme un homme qui a le frisson, et que ses lèvres remuaient.
Roubachof respirait à nouveau l'air de son ancien bureau de la Délégation Commerciale, rempli du parfum singulièrement familier du grand corps harmonieux et paresseux d'Arlova; il revoyait sur sa blouse blanche la courbe de sa nuque penchée sur son carnet tandis qu'il dictait, et ses yeux ronds qui le suivaient tandis qu'il se promenait dans le bureau pendant les intervalles entre les phrases. Elle portait toujours des blouses blanches comme en portaient chez lui les sœurs de Roubachof, des blouses brodées de petites fleurs à l'encolure montante, et toujours les mêmes boucles d'oreilles de pacotille, qui s'écartaient de ses joues quand elle se penchait sur son carnet. Avec ses manières lentes et passives, elle semblait faite pour ce travail, et elle avait un effet très calmant sur les nerfs de Roubachof quand il était surmené. Il avait rejoint son poste comme chef de la Délégation Commerciale en B. immédiatement après l'affaire du petit Loewy, et il avait foncé sur le travail ; il était reconnaissant au Comité central de lui fournir cette activité bureaucratique. Il était extrêmement rare que des leaders de l'Internationale fussent transférés au service diplomatique. Sans doute le N° 1 avait-il pour lui des intentions spéciales, car d'ordinaire les deux hiérarchies étaient tenues strictement séparées, n'étaient pas autorisées à entrer en contact, et suivaient même parfois des politiques opposées. Seule, la perspective supérieure des sphères environnant le N° 1 permettait de voir se résoudre les contradictions apparentes et s'éclairer les motifs.
Il fallut quelque temps à Roubachof pour s'accoutumer à son nouveau mode de vie; cela l'amusait d'avoir maintenant un passeport diplomatique, un vrai passeport établi à son vrai nom; cela l'amusait de devoir assister à des réceptions en habit de cérémonie; de voir des agents de police se mettre devant lui au garde-à-vous, et de penser que les messieurs, discrètement vêtus et coiffés de melons noirs, qui le suivaient parfois le faisaient uniquement par tendre souci pour sa sécurité.
Il se sentit d'abord légèrement dépaysé dans l'atmosphère des bureaux de la Délégation Commerciale, attachée à la légation. Il comprenait bien que dans le monde bourgeois il fallait représenter et jouer leur jeu à eux, mais il estimait qu'ici on le jouait presque trop bien, si bien qu'íl était presque impossible de distínguer l'apparence de la réalité. Lorsque le Premier Secrétaire de la légation attira l'attention de Roubachof sur certaines modifications qu'il était nécessaire d'apporter à son costume et à sa façon de vivre - le Premier Secrétaire, avant la Révolution, avait fabriqué de la fausse monnaie au service du Parti - il ne l'avait pas fait en camarade et avec humour, mais avec des égards et un tact si étudiés que la scène en était devenue embarrassante et avait agacé Roubachof.
Son personnel se composait de douze collaborateurs dont chacun avait son rang nettement défini; il y avait des Assistants de Première et de Deuxième Classe, des Comptables de Première et de Deuxième Classe; de même pour les Secrétaires et les Secrétaires Adjoints. Roubachof avait le sentiment que tous le considéraient comme un mélange de héros national et de chef de bande. Ils le traitaient avec un respect exagéré et une indulgence hautaine et tolérante. Lorsque le Secrétaire de la légation devait lui faire un rapport sur un document, il faisait effort pour s'exprimer en ces termes simples que l'on emploierait pour parler à un sauvage ou à un enfant. La secrétaire particulière de Roubachof, Arlova, était celle qui l'énervait le moins; mais il ne comprenait pas pourquoi, avec ses charmantes blouses et ses jupes toutes simples, elle mettait des souliers vernis aux talons rídiculement hauts.
Un mois environ s'écoula avant qu'il prononçât la première remarque personnelle. Il était fatigué de dicter en marchant de long en large, et tout à coup il s'aperçut du silence qui régnait dans son bureau.
- Pourquoi ne dites-vous jamais rien, camarade Arlova? demanda-t-il, et il s'assit dans le confortable fauteuil placé derrière sa table de travail.
- Si vous voulez, répondit-elle de sa voix endormie, je répéterai toujours le dernier mot de la phrase.
Chaque jour elle s'asseyait devant la table, avec sa blouse brodée, sa gorge lourde et bien faite penchée sur son carnet, la tête baissée et ses boucles d'oreilles parallèles à ses joues. Le seul élément discordant était les souliers vernis aux talons pointus, mais jamais elle ne se croisait les jambes, comme Ie faisaient la plupart des femmes que connaissait Roubachof.
Comme il se promenait toujours de long en large en dictant, il la voyait ordinairement de derrière ou de trois quarts, et ce qu'il se rappelait le plus clairement, c'était la courbe de sa nuque penchée. Cette nuque était ni duveteuse ni rasée; la peau était blanche et tendue au-dessus des vertèbres; au-dessous, il y avait les fleurs brodées sur l'encolure de sa blouse blanche. Dans sa jeunesse, Roubachof n'avait pas eu grand-chose à faire avec les femmes; presque toujours c'étaient des camarades, et presque toujours cela avait commencé par une discussion prolongée si tard dans la nuit que celui ou celle qui était chez l'autre avait manqué le dernier tram...."

"Troisième audience" (The Third Hearing) ...
Dans cette troisième audience Rubashov se retrouve face à Gletkin : celui-ci remplace donc Ivanov, relevé de ses fonctions, arrêté et exécuté pour sa mauvaise gestion de l’affaire Rubashov. Rubashov n’a pas de lien particulier avec Gletkin, mais il est totalement représentatif des personnalités types générées par le régime créé par la Révolution : rigidité de la posture, attitude sans expression, plus machine qu'être humain. Les interrogations que mène Gletkin à l'encontre de Rubashov, relayées par les pressions physiques de la privation de sommeil et de la lumière blanche aveuglante, piègent Rubashov dans ses « vérités logiques» (truths) incapable d'exprimer avec précision toute sa réalité individuelle. Il en est ainsi, par exemple, de la « vérité » que la conclusion logique de l’opposition de Rubashov au Parti ait pu être une tentative d’assassinat de son chef. Le fait que Rubashov ne soit pas réellement coupable de ce crime ne fait aucune différence, et compte tenu de son adhésion à l’idéologie de la « logique conséquente » (consequent logic), il se sent obligé de reconnaître cette « vérité » (truth). À la fin de cette partie, la logique implacable et inhumaine de Gletkin et la conscience coupable et le désir intense de sommeil de Rubashov ont conduit à sa confession complète des crimes qu’il n’a pas commis, mais, en toute "logique", aurait dû commettre ...
I - Extrait du journal de N.S. Roubachof, vingtième jour de prison -
"... Vladimir Bogrof est tombé de la balançoire. Il y a cent cinquante ans, le jour de la prise de la Bastille, la balançoire européenne, longtemps inactive, s'est remise en mouvement. Elle avait quitté la tyrannie avec allégresse ; d'un élan qui semblait irrésistible, elle s'était élancée vers le ciel bleu de la liberté. Pendant cent ans elle avait monté de plus en plus haut dans les sphères du libéralisme et de la démocratie. Mais voilà que peu à peu elle ralentissait son allure; la balançoire arrivait près du sommet et du moment critique de sa course ; puis, après une seconde d'immobilité, elle se mit à marcher en arrière, avec une vitesse sans cesse accélérée. Du même élan que pour monter, la balançoire ramenait ses passagers de la liberté à la tyrannie. Quiconque regardait en l'air au lieu de tenir ferme était prie de vertige et tombait.
"Quiconque veut éviter le vertige doit essayer de découvrir LA LOI QUI REGIT LE MOUVEMENT DE LA BALANCOIRE. Nous semblons nous trouver, dans l'histoire, en face d'un mouvement de pendule, d'un balancement de l'absolutisme à la démocratie, de la démocratie à la dictature absolutiste.
"La quantité de liberté individuelle qu'un peuple peut conquérir et conserver dépend de son degré de maturité politique. Ledit mouvement de pendule paraît indiquer que la marche des masses vers la maturité ne suit pas une courbe régulièrement ascendante, comme fait la croissance d'un individu, mais qu'elle est gouvernée par des lois plus complexes.
"La maturité des masses consiste en leur capacité de reconnaître leurs propres intérêts. Mais cela présuppose une certaine compréhension du processus de production et de distribution des biens. La capacité d'un peuple de se gouverner démocratiquement est donc proportionnelle à son degré de compréhension de la structure et du fonctionnement de l'ensemble du corps social.
"Or tout progrès technique crée de nouvelles complications dans la machine économique, fait apparaître de nouveaux facteurs et de nouveaux procédés, que les masses mettent un certain temps à pénétrer. Chaque bond en avant du progrès technique laisse le développement intellectuel relatif des masses d'un pas en arrière, et cause donc une chute du thermomètre de la maturité politique. Il faut parfois des dizaines d'années, parfois des générations, pour que le niveau de compréhension d'un peuple s'adapte graduellement au nouvel état des choses, jusqu'à ce que ce peuple ait recouvré la même capacité de gouvernement de soi-même qu'il possédait déjà à une étape inférieure de sa civilisation. Partant la maturité politique des masses ne saurait se mesurer par un chiffre absolu, mais seulement de façon relative, c'est-à-dire proportionnellement au niveau de la civilisation au moment donné.
"Lorsque le niveau de la conscience des masses rattrape l'état de choses objectif, il en résulte inévitablement pour la démocratie une victoire soit paisible, soit remportée par la force. Jusqu'à ce que le bond suivant de la civilisation technique - par exemple l 'invention du métier à tisser mécanique - rejette les masses dans un état d'immaturité relative, et rende possible ou même nécessaire l'établissement, sous une forme ou une autre, d'une autorité absolue...."

"La Fiction grammaticale" (The Grammatical Fiction)
"Quand on lui demanda s'il plaidait coupable, l'accusé Roubachof répondit "Oui" d'une voix nette. Le procureur de la République lui ayant ensuite demandé s'il avait agi au service de la contre-révolution, l'accusé répondit encore, "Oui", d'une voix plus basse ..."
Cette dernière partie raconte le procès et l’exécution de Rubashov. La « fiction grammaticale » fait référence à un concept que Rubashov a développé tout au long du livre. Il se réfère d’abord à celle-ci comme son « partenaire silencieux » (silent partner), qui existe en dehors de toute logique : une présence le plus souvent accompagnée de maux de dents. Ce « partenaire silencieux » ou cette « fiction grammaticale » est la conscience de Rubashov, le « Moi » qui n’a pas sa place dans la politique de la Révolution ou du Parti. Rubashov nomme son « je » la « fiction grammaticale » en raison de la façon dont la « première personne au singulier » a été retirée du langage du Parti. S’il n’y a pas de « je », l’individu n’a pas besoin d’entrer dans l’équation philosophique du bien et du mal. S’il n’y a pas de « je », l’humanité d’un individu n’a pas besoin d’être prise en considération ni même de pitié. Une fois que Rubashov a rempli son devoir envers le Parti - en confessant publiquement sa culpabilité sans attente de pitié ou de récompense -, il ne lui reste que quelques heures avant son exécution pour retrouver, une dernière fois, sa « première personne singulière » (first person singular), c’est-à-dire son individualité ...

"Scum of the Earth" (1941)
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Koestler vivait dans le sud de la France et travaillait sur son livre "Darkness at Noon". Réfugié à Paris, il fut rapidement détenu par le gouvernement français, jugé en tant qu' "étranger indésirable". "Scum of the Earth" est plus que l’histoire de la survie de Koestler face à cette nouvelle épreuve, il y expose l’effondrement de la détermination française à résister au cours de l’été 1940 ...

"Arrival and Departure" (1943, Croisade sans croix)
Roman de l'écrivain Arthur Koestler qui, avec "Le Zéro et l'Infini", "Un testament espagnol" et "La Tour d'Ezra" fait partie des meilleurs livres "engagés" de l'auteur. C'est aussi le premier qu’il ait écrit en anglais. Le thème central, le conflit entre la moralité et l’opportunisme, travaillé en termes de psychologie individuelle. Peter Slavek ente dans le roman comme un jeune révolutionnaire, courageux, mais souffrant d’une dépression. Sur le canapé de l’analyste, il est amené à découvrir, selon les propres mots de Koestler, "que son zèle sadique était dérivé d’une culpabilité inconsciente" (that his crusading zeal was derived from unconscious guilt) ....
"L’auto, ses phares en veilleuse ne projetant qu’un mince rayon lumineux, s’arrêta à la grille de l’aérodrome. La sentinelle sortit de sa guérite, darda la lumière de sa lampe à travers la vitre de la portière et, reconnaissant l’officier assis à côté de Peter, salua. Elle ne posa pas de question sur l’identité de Peter. La grille de fer s’ouvrit et se referma derrière eux. Ils roulèrent encore quelques centaines de mètres, passèrent devant de sombres bâtiments et s’arrêtèrent devant une construction basse en ciment à toit de tôle ondulée.
— Nous y voilà, dit l’officier en descendant de la voiture.
C’était la première phrase qu’il prononçait depuis le moment où, vingt minutes plus tôt, ils avaient renoncé à l’effort d’entretenir la conversation.
Peter descendit derrière lui. Une pluie fine tombait l’obscurité autour d’eux était complète et saturée par le lointain bourdonnement d’un avion qui devait voler très haut au-dessus des nuages. L’officier ouvrit une des portes du bâtiment. Ils entrèrent dans une pièce qui contenait deux fauteuils de cuir usé et une table recouverte d’un tapis vert..."
Printemps 1941 - Peter Slavek, un jeune Hongrois de dix-huit ans, enthousiasmé par le communisme, est arrêté et torturé. Il n'avoue rien et ne livre pas ses camarades. Ayant réussi à s'évader après trois ans passés en prison, Peter s'embarque clandestinement sur un bateau qui le conduit en pays neutre (Lisbonne). Il est sauvé, mais il n'a qu'une idée : repartir. Reprendre la lutte. Pourtant les choses ne sont pas si simples. Il avait compté sans la paperasserie et les formalités administratives. Comme tous ceux qui sont là, brûlant du désir de se sacrifier, il lui faut attendre. Contraint de se cacher, il voit ses ressources s'amoindrir. Pourquoi ne pas suivre le conseil des autorités et faire une tentative du côté des Américains? La rencontre de Sonia, compatriote médecin psychanalyste, influe sur sa décision. Elle lui offre un toit et son aide. Il fait chez elle la connaissance d'une jeune fille éprouvée par la guerre, Odette, et s'en éprend. Son départ soudain lui causera un choc terrible.
Trop de contradictions se heurtent dans sa tête. Son désir d'héroïsme ne reposerait-il, comme le prétend Sonia, que sur un complexe de culpabilité? Durant quinze jours, il se débat contre la maladie, mais le médecin veille. Sonia l'aide à débrouiller l'écheveau, à remonter aux sources, à affronter ce qu'il ne voulait pas regarder en face, et la guérison vient à grands pas. Il va abandonner l'héroïsme qui le poussait vers les "causes perdues", les croisades donquichottesques qui ne servent à rien, se dépouiller de ses illusions, rejeter les obligations fictives, les dettes imaginaires.
Avec la lucidité et la connaissance des véritables intentions qui guidaient ses actes, la guérison se fait totale, peu avant le départ de Sonia. Il ne lui reste désormais que peu de temps à attendre. Il a pris la ferme décision de rejoindre en Amérique celle qu'il aime. Mais ces trois semaines de solitude lui sont fatales. Ses anciennes obsessions le reprennent et la devise du Parti, qu'il fait sienne, lui revient en mémoire, toujours plus impérieuse : "Partout où il y a un plus fort, toujours du côté du plus faible". Dérision suprême, la veille de son départ, un fasciste qui s'embarque également tente de le gagner à ses idées. Peter n'en peut supporter davantage. Il fuit le bateau qui vogue vers l'indifférence et la sécurité, pour partir à nouveau affronter les dangers, la torture et la mort, et défendre cette cause absurde en laquelle il croit de toutes ses forces : la Liberté ...
(XI) "... Et il s’apercevait aussi, à ses heures les plus lucides, que, sous l’influence de Sonia, l’orgueilleuse échelle de ses valeurs s’était écroulée, et que des points d’exclamation impérieux s’étaient courbés en points d’interrogation. Qu’était-ce, en somme, que le courage ? Affaire de glandes, de nerfs, ensemble de réactions déterminées par l’hérédité et les premières expériences de l’individu. Une goutte d’iode de moins dans le corps thyroïde, une gouvernante sadique ou une tante trop tendre, une légère variation dans la résistance électrique des ganglions de la moelle, et le héros devenait un lâche, le patriote un traître. Sous la baguette magique du principe de causalité, les actions des hommes se vidaient de leur prétendu contenu moral comme une bouteille de Leyde se décharge au contact d’un corps conducteur.
Mais alors pourquoi le Mauvais Rêve l’avait-il poursuivi ; pourquoi, puisque Sonia lui avait découvert la vanité et le don quichottisme de son passé, les racines cachées de ses actions, pourquoi tout ne devenait-il pas à présent clair et simple ; pourquoi sa jambe était-elle coupée par le tranchant de l’épée ? Et comment cette épée, épée d’un dieu furieux et jaloux, s’intégrait-elle dans le système de Sonia ? En admettant ce que disait Sonia et que son véritable désir fût d’oublier Jérusalem, en admettant, pour un instant, qu’il eût décidé d’abandonner la Cause et de suivre Odette, sa jambe reprenait-elle vie à cette affirmation ? Non pas.
Mais, à cela aussi, Sonia avait réponse.
— Tu vois les choses trop simplement, disait-elle. Quand tu décharges cette bouteille de Leyde, ça ne se passe pas doucement. Il y a des étincelles, des détonations, des chocs. Tu en as éprouvé un petit nombre, mais il reste encore une tension cachée.
— Je vous ai dit tout ce dont il me souvient.
— Mais il ne te souvient pas encore de tout.
Peter ne répondit pas. Il éprouvait envers Sonia une soudaine hostilité, plus que cela : de la haine. Il détestait son profil, sa broderie, son tailleur blanc, ses hanches et ses cuisses abondantes, les marques de son sexe. Plante carnivore… l’image lui répugnait. Il avait horreur de son corps et de son esprit, de son détachement hautain, de sa façon de labourer et de fouiller le plus intime de son être comme s’il s’agissait d’un terrain public. Il avait chaud d’une colère contenue. Elle l’avait conduit tout le temps par la bride comme un cheval docile, mais maintenant il refusait, il n’irait pas plus loin.
— Tu ne parles jamais de ton frère, dit soudain Sonia en levant la tête de dessus son ouvrage.
— Mon frère ? Qu’est-ce qu’il vient faire là-dedans ?
Son cœur battait vite ; il s’était assis et la regardait avec appréhension, avec crainte.
Mais Sonia continuait à broder.
— Oh ! je pensais seulement… dit-elle, et ce fut tout.
Peu à peu, il se calma et s’étendit de nouveau. Le seul bruit de la chambre était le son ténu de l’aiguille perçant l’étoffe et tirant le fil derrière elle. Il s’avisa que, quelque profond que devînt le silence de la chambre, on n’entendait jamais la respiration de Sonia. C’était curieux à quel point elle pouvait s’effacer, disparaître dans une espèce d’impersonnalité et, comme par un mimétisme protecteur, se confondre avec le mobilier. Les cigales chantaient de nouveau dans le jardin ; le dessin d’ombres projeté par les volets avait commencé son lent voyage à travers le plafond, et, une fois de plus, il se laissa aller à l’illusion que c’était sa mère qui était assise à la place de Sonia, absorbée par son travail devant le rideau de cretonne et le pot de fleurs. Le puits s’était ouvert, exhalant l’odeur légère et musquée du passé, et, avant d’avoir consciemment décidé de le faire, il se trouva en train de parler de son rêve à Sonia.
— C’est un rêve idiot, dit-il de sa voix somnolente. J’avais rêvé ça en prison, et ce rêve me revient encore… Cela se passait dans ma chambre d’enfant. Il faisait sombre et étouffant ; je voulais ouvrir les volets, bien que cela me fût défendu. Pour y atteindre, je devais grimper sur le rebord de la fenêtre ; je grimpai, un pied dans le pot de fleurs, sachant que je faisais quelque chose de terriblement mal. Je sentis avec un délice coupable la terre humide et molle céder sous mon pied et, avec un égal délice, l’écrasement des petites pousses vertes. J’atteignis les volets et les ouvris ; une rafale de vent semblable à une tempête des tropiques souffla dans la chambre ; je trébuchai sous sa violence et le pot de fleurs tomba par la fenêtre, descendit, descendit dans le vide. Il y avait des gens qui couraient et criaient dans la rue ; ils s’étaient rassemblés sous la fenêtre, formant un cercle autour des débris du pot de fleurs, agenouillés et la tête penchée comme en prière. Je les regardais, et, derrière moi, il y avait un mur de verre ; derrière le mur de verre, ma mère était couchée sur une espèce de table ou dans une bière, les yeux fermés, très calme, immobile ; je baisais sa main à travers le mur de verre et la trouvais froide ; et je savais qu’à présent je devais rester toujours dans la chambre sombre pour expier mon crime…
Il y eut un silence. Peter regardait les ombres au plafond ; il n’entendait plus le son de l’aiguille de Sonia, couvert qu’il était par le bruit régulier de son propre souffle ; la main de Sonia montait et descendait avec l’aiguille, comme celle d’un violoniste conduisant son archet. Au bout d’un moment, elle dit :
— Qu’est-ce que tu crois que ça signifie ?
— Ça signifie, dit Peter, que j’ai causé la mort de ma mère. Elle était le pot de fleurs avec la tendre terre qui porte les graines. Elle aurait voulu me garder toujours dans l’ombre préservée de la chambre d’enfant ; elle me barrait la route, m’empêchait d’aller au Mouvement, dans la rue ; j’ai marché sur elle et je l’ai détruite.
Il se tut. Il y avait en lui une grande tristesse, mais celle-ci avait perdu son venin ; c’était une tristesse paisible, consolante, comme un amen prononcé tout bas après la prière des morts.
(XII)
Le lendemain, à la même heure, Sonia dit en enfilant son aiguille :
— Tu as appris beaucoup sur toi-même, ..."
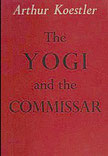
"The Yogi And The Commissar" (1945)
Koestler publiait quatre ans après son départ du parti communiste (1942) un recueil d'essais comportant trois parties, "Meanderings" (The Yogi and the Commissar, The French Flu, In Memory of Richard Hillary, The Intelligentsia) , "Exhortations" (Scum of the earth - The fraternity of pessimists) et "Explorations" (anatomy of a myth, soviet myth and reality, the end of an illusion). Les deux premières parties furent écrites de 1942 à 1945 et la troisième partie spécialement pour ce livre.
Dans l’essai qui vaut titre (The Yogi and the Commissar), Koestler propose une représentation des attitudes possibles pour réaliser la fameuse promesse du "le ciel sur terre" (heaven on earth), du Commissaire, extrémité matérialiste et scientifique du spectre, au Yogi, extrémité spirituelle, métaphysique. Le Commissaire veut changer la société en utilisant tous les moyens nécessaires, tandis que le Yogi veut changer l’individu, en mettant l’accent sur la pureté éthique plutôt que sur les résultats...
Toutes les attitudes humaines possibles face à la vie peuvent ainsi être classées sous la forme d'un "spectre", utilisant ici la métaphore des spectres de rayonnement pour montrer que les deux extrémités de celui-ci échappent totalement au domaine de la lumière visible : c'est dire que la dynamique complète de l’histoire et de la culture se dérobe d'emblée à notre conscience ...
«À l'une des extrémités du spectre, évidemment à l'extrémité infrarouge, nous verrions le commissaire » (On one end of the spectrum, obviously on the infra-red end, we would see the Commissar ). Le "commissaire" représente ceux qui croient en ce que Koestler appelle le « changement de l'extérieur » (Change from Without), c'est-à-dire ceux qui croient que le remède à tous les maux de l'humanité se trouve dans une réorganisation de la base matérielle de la vie humaine, en particulier des moyens de production et de distribution matérielle, et qui croient que la réalisation de cette réorganisation justifie toutes les méthodes et tous les types de comportement à l'égard de ceux qui se mettent en travers du chemin.
A l'autre bout du spectre de Koestler, il y a « le Yogi qui se fond dans l'ultra-violet » (the Yogi, melting away in the ultra-violet). Pour lui, « rien ne peut être amélioré par l'organisation extérieure et tout par l'effort individuel de l'intérieur » (nothing can be improved by exterior organization and everything by the individual effort from within).
Entre ces deux extrêmes, Koestler voyait « dans une séquence continue les lignes spectrales des attitudes humaines plus sédentaires » (in a continuous sequence the spectral lines of the more sedate human attitudes). Dans l'ensemble, cependant, il trouve la partie centrale du spectre assez floue ; ce qu'il voit le plus clairement, c'est le contraste entre les deux extrémités du spectre : « la vraie question reste entre le Yogi et le Commissaire, entre la conception fondamentale du Changement de l'extérieur et du Changement de l'intérieur » (the real issue remains between the Yogi and the Commissar, between the fundamental conception of Change from Without and Change from Within).
En 1942, le "yogi" semblait être le symbole le plus évident de l’attitude à concevoir face à la montée des régimes totalitaires. Mais nombreux furent les intellectuels désillusionnés par cette attitude empreinte de noble spiritualité, détachée et pure, libre de toute implication mondaine ou politique. C’était une spiritualité conçue par des philosophes idéalistes indiens qui écrivaient en anglais, principalement pour les lecteurs occidentaux, à l'encontre du matérialisme brut de l’Occident. Entre-temps, la grande majorité des classes instruites indiennes, soutenues par des masses de leurs compatriotes, s'étaient engagées dans une lutte très réelle pour renverser le pouvoir politique britannique en Inde et atteindre l’indépendance nationale indienne (et pakistanaise).
Dans « The Fraternity of Pessimists », Koestler formulera sa propre confession de foi, à savoir que « dans cette guerre, nous nous battons contre un mensonge total au nom d'une demi-vérité ». Il ne voit dans notre victoire aucune solution durable aux problèmes des minorités en Europe, ni aucun remède « à la maladie inhérente au système capitaliste » (for the inherent disease of the capitalistic system). Il jette un regard sceptique sur la façon dont l'Amérique traitera à l'avenir le racisme, car il pense que le fascisme est le même à Varsovie, à Calcutta ou à Detroit. À une époque où nous aimerions penser que cette guerre est la dernière, Koestler envisage l'avenir avec inquiétude. Il estime que « le seul atout qui reste sur un continent en faillite » réside dans les hommes d'action et de sensibilité des mouvements de résistance, ces « pionniers de la lutte pour la sauvegarde de la dignité de l'homme » (those pioneers in the fight to safeguard the dignity of man) ...

"Thieves in the Night" (1942, La Tour d'Ezra)
Avec "Un testament espagnol" et "Le Zéro et I`Infini", c'est un des livres les plus connus de l'écrivain Arthur Koestler : il y relate tout simplement la naissance de l`Etat d`lsraël à travers d'innombrables difficultés au bout desquelles un peuple errant retrouve enfin sa patrie perdue, après deux mille ans d`absence. Etablie sur une colline caillouteuse et aride, la communauté socialiste d'Ezra doit lutter pied à pied contre les Arabes d'abord, pour conserver cette maigre parcelle de sol achetée à prix d`or, puis contre les éléments, la fatigue, la maladie, la solitude et le découragement. Il faut à tout prix survivre afin de montrer aux autres nations qu`il est possible de faire surgir un pays du néant. Tel est le but des habitants du kibboutz d'Ezra, des volontaires venus de partout, fuyant la persécution et la haine des autres peuples, animés d'une volonté farouche et indomptable. Koestler nous retrace leur lutte en des pages que traverse un souffle d'épopée. ll dénonce par ailleurs la criminelle indifférence de l`Angleterre et des pays européens, la montée du fascisme, l`horreur des persécutions nazies et il élève enfin avec les Juifs d`lsraël, qu'il a aidés de toutes ses forces, un chant de liberté et d'espoir ...

"The Age of Longing" (1951, Les Hommes ont soif)
Un roman de l'écrivain Arthur Koestler tout imprégné de l`expérience communiste de l'auteur qui fut membre du Parti durant huit ans. On y sent percer l'amertume qu'il éprouva en se voyant contraint d`abandonner une cause en laquelle il avait mis tant de foi. "La Foi", tel est le thème central du livre. Les hommes ont soif d`une foi, ils ont la nostalgie du Paradis perdu. En conséquence, chaque fois qu'il meurt un Dieu, il y a des difficultés dans l'Hístoire. Les gens ont l'impression de s'être laissé duper par ses promesses, de se trouver avec un chèque sans provision dans leur poche, et ils courent après tous les charlatans qui leur promettent de le payer. "La dernière fois qu`un Dieu mourut, dit Koestler, fut le 14 juillet 1789. Le peuple a été dépouillé de son seul bien : l'illusion de posséder une âme immortelle. Seule demeure la Nostalgie du Royaume". La soif instinctive, sourde, inexprimée, sans connaissance de sa source ni de son objet.
Tels sont les thèmes que Koestler met en scène dans ce roman, dont l'action se situe peu avant la dernière guerre. Il met en parallèle Heydie, jeune femme jolie et désœuvrée, au tempérament mystique et passionné, fille d'un colonel américain, parfait exemple féminin de la société occidentale décadente, et Nikitine, attaché culturel à l'ambassade soviétique, occupé à une mystérieuse besogne. Mais ce qui précipite la jeune femme dans les bras du Russe entêté et persévérant, c`est la soif. Nikitine croit au Parti. Il a en lui la foi absolue que cherchent tous les êtres. Pour lui, il est prêt à sacrifier sans hésitation et les autres et lui-même. Heydie n'aura qu`une envie : se brûler à ce feu comme les papillons de nuit s`approchent des lampes. Et pourtant, à la fin, quand elle sait en quoi consistent cette foi et le travail de Nikitine, une seule solution lui paraît possible : tuer Nikitine, anéantir les êtres qui croient en un tel idéal.
Koestler nous montre dans ce roman ce qu`il appelle "des individus pré-pubertiens", et il les étudie un à un, tel un sociologue qui se penche sur les cas types d`une civilisation. Mais sous l'ironie transparaît l'amertume de l'homme qui a cru et qui a été déçu. "Si vous êtes optimiste, dit-il, vous penserez qu'un jour, quelque mutation biologique guérira la race humaine. Mais il semble infiniment plus probable que nous suivions le destin du dinosaure...".
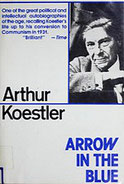
"Arrow in the Blue" (1952, La Corde raide)
Oeuvre autobiographique publiée en 1952. À la suite de sa condamnation à mort durant la guerre d'Espagne (cf. Un testament espagnol), Arthur Koestler se promit d'écrire un dialogue avec sa propre vie. C'est ce qu'il réalise dans ce livre, qui éclaire la formation d'un caractère complexe et raconte les multiples aventures d'un être exceptionnellement sensible à travers les guerres, les révolutions et les luttes politiques qu'il vécut. En migration constante, Koestler s'arrête à Vienne, dans les villes et les kibboutzim de Palestine, à Paris, à Berlin. À la recherche de certitudes, il ne trouve jamais que des causes et il faudrait s'abandonner à chacune d'elles. Enfin, il rencontre la cause du communisme qu'il servira pendant sept ans. Le livre s'achève sur son entrée au Parti. En Allemagne, en Russie, en France, et en Espagne, dans sa cellule de condamné à mort, il découvre l'existence de l'écriture invisible du destin et entreprend de déchiffrer ce texte en "hiéroglyphes".
Seconde partie de sa biographie, "The Invisible Writing" (1954, Hiéroglyphe) est un livre de découverte. L'infatigable pèlerin découvre l'une après l'autre des réalités et, à travers elles, il se découvre lui-même. Dans l'Ukraine meurtrie par la famine de l'hiver 1932-33, en Russie, au Caucase, dans les lointaines républiques de l'U.R.S.S., il se lance dans des expéditions continuelles où s'use sa foi de militant. Et rien ne s'effacera plus de ce qu'il connaît alors, telle situation troublante, tel homme humilié, ne cessant plus de hanter ses souvenirs.
"Hiéroglyphes" révèle toute la "matière première" des romans de Koestler, notamment du "Zéro et l'Infiní" et de "Croisade sans croix". Ce livre expose les motifs les plus profonds qui ont décidé l'auteur à rester, après la défaite de l'armée républicaine, à Malaga, et à y affronter le risque de la mort. C'est aussi un extraordinaire livre d'aventures mené avec la maîtrise et la sincérité qui caractérisent Koestler. Ces aventures, il les a vécues lui-même, mais leurs significations telles qu'il les relève dans "Hiéroglyphes" dépassent de loin le cas individuel. Elles concernent la grandeur et la servitude de toute une époque et l'emploi qu'elle fait de ce qui est le meilleur et de ce qui est le pire dans l'être humain ...
CINQUIÈME PARTIE - LA RECHERCHE DE MARX - 1930-1931 - XXVII - Psychologie de la conversion.
C’est dans ces circonstances que j’entrepris l’étude de la littérature communiste.
"Lorsque j’eus terminé le Feuerbach d’Engels et État et Révolution de Lénine, je sentis un déclic dans mon cerveau et fus secoué comme par une explosion mentale. En disant qu’on a « vu la lumière », l’on ne rend compte que bien faiblement du ravissement spirituel du converti (quelle que soit la foi à laquelle on se convertit). La nouvelle lumière semble converger sur le cerveau de tous les points de l’espace, et l’univers entier ressemble alors aux pièces éparses d’un puzzle qui se trouveraient rassemblées comme par magie. Désormais, plus de problèmes sans réponse ; les doutes et les débats font partie d’un passé de déchirement, de l’époque déjà lointaine où l’on vivait dans la triste ignorance et l’univers insipide de ceux qui ne savent pas. Désormais, plus rien ne saurait troubler la paix intérieure et la sérénité du converti, sauf, de temps à autre, la peur de perdre cette foi, qui seule rend la vie digne d’être vécue, et de retomber dans les ténèbres extérieures avec leurs lamentations et leurs grincements de dents."
Le paragraphe qui précède figure dans mon chapitre de "Le Dieu des ténèbres", ouvrage dans lequel six écrivains qui avaient cru au communisme (Louis Fischer, André Gide, Ignazio Silone, Stephen Spender, Richard Wright et moi) avaient exposé les raisons pour lesquelles nous nous étions convertis à la foi nouvelle. Il me semble, après avoir relu ce livre, qu’aucun de nous n’a réussi à donner une réponse totale à cette question cruciale de notre temps qui a divisé la planète en deux camps et causera peut-être la perte de notre civilisation. Les pages qui suivent sont une tentative de plus pour analyser l’attrait mental de la religion marxiste-léniniste-staliniste.
Je ne puis décrire l’effet premier et décisif qu’eut sur moi l’étude du marxisme qu’en disant que j’étais passé, sans m’en rendre compte, d’un monde intellectuellement ouvert dans un monde intellectuellement fermé.
Le marxisme, comme le freudisme orthodoxe, comme le catholicisme, est un SYSTEME CLOS.
Par « système clos », j’entends, premièrement, une méthode universelle de pensée qui prétend expliquer tous les phénomènes sous le soleil et porter remède à tous les maux de l’humanité ; deuxièmement, un système qui refuse de se laisser modifier par des faits nouvellement observés, mais qui possède assez de résistance élastique pour neutraliser leur attaque, c’est-à-dire pour les inclure dans le dessin voulu au moyen d’une casuistique extrêmement développée ; troisièmement, un système qui sape de toute base solide les facultés critiques de quiconque a accepté d’entrer dans son cercle magique.
Ce troisième point est peut-être le plus important. À l’intérieur du système fermé de la pensée freudienne, vous ne pouvez pas, par exemple, émettre un doute sur l’existence du soi-disant « complexe de castration ». La réplique immédiate sera que vos arguments sont la rationalisation d’une résistance inconsciente, qui révèle que vous souffrez vous-même du complexe en question. Vous êtes pris dans un cercle vicieux dont il n’y a pas d’évasion logique. De même, si vous êtes marxiste et prétendez que l’ordre donné par Lénine de marcher sur Varsovie en 1920 fut une faute, on vous expliquera qu’il ne faut pas en croire votre propre jugement déformé par les vestiges de votre ancienne conscience de classe petite-bourgeoise. Bref, le système clos exclut toute possibilité de discussion, au moyen de deux procédés : a) les faits sont dépouillés de leur valeur de témoignage par une interprétation scholastique ; b) on déclare les objections sans valeur, en faisant remonter la discussion au motif psychologique qui commande soi-disant l’objection. Le procédé est légitime, selon les règles du jeu du système clos, lesquelles, si absurdes qu’elles puissent paraître vues de l’extérieur, n’en possèdent pas moins une grande cohérence interne.
L’atmosphère à l’intérieur du système clos est chargée d’électricité ; c’est une serre de passions. L’absence d’objectivité dans le débat est largement compensée par sa ferveur. Le disciple reçoit un entraînement rigoureux à la doctrine et à la méthode de raisonnement particulier au système. À la suite de cet entraînement, il acquiert une technique d’argumentation généralement supérieure à celle de n’importe quel adversaire de l’extérieur. Il connaît à fond les grands débats passés entre les apôtres et les incrédules ; il est au courant de l’histoire des hérésies et des schismes ; il a étudié les controverses classiques entre jansénistes et jésuites, entre Freud et Jung, entre Lénine et Kautsky. Ainsi reconnaît-il du premier coup le type et l’attitude de son adversaire, est-il capable de classer les objections de ce dernier dans des catégories familières, sait-il les questions et les réponses comme si elles étaient les variantes d’une ouverture aux échecs. Le théologien, le psychanalyste ou le marxiste à l’esprit « fermé » et exercé réduira en chair à pâté son adversaire d’esprit « ouvert » et prouvera ainsi au monde et à lui-même la supériorité de son système.
Cette supériorité permet à l’initié du système clos de manifester envers le non-initié une tolérance patiente. Dans la discussion avec les païens, les malades ou les bourgeois réactionnaires, il est calme, paternel et imposant. Sa supériorité, son assurance, le rayonnement de sa foi sincère créent une relation particulière entre l’initié et le néophyte virtuel. C’est la relation entre le guru et le disciple, entre le confesseur et le pénitent, entre le psychanalyste et le malade, entre le militant du parti et le sympathisant séduit, rempli d’admiration.
Cette situation de « transfert », pour employer un terme freudien, constitue une phase essentielle du processus de conversion qui a été curieusement négligée dans la littérature consacrée à ce sujet. Je crois que personne ne s’est jamais converti sans passer par la phase de dévotion admirative, de « béguin » sublimé pour la personne qui opère la conversion et joue le rôle d’apôtre.
Dans le cas des conversions au catholicisme et au freudisme — pour citer de nouveau les deux cas parallèles les plus évidents — l’importance du directeur de conscience ou de l’analyste est franchement avouée. Dans le cas de la conversion au communisme, au contraire, cette phase s’efface dans la mémoire du converti, car le système nie catégoriquement l’importance des rapports individuels. Pourtant les relations personnelles, émotives, ont toujours joué un rôle prépondérant dans l’histoire du mouvement marxiste.
Marx le prophète ne tolérait point d’égaux, mais seulement des disciples — qui, dans la plupart des cas, commencèrent par l’adorer et finirent par le rejeter. Les relations de Freud avec ses élèves suivirent un dessin étrangement analogue ; lui aussi fut constamment « abandonné » et « trahi » par eux — car les désaccords qui, dans le monde normal, se règlent par la discussion deviennent, dans l’atmosphère de « tout ou rien » qui caractérise le système clos, des actes de trahison, d’hérésie, de schisme. Jung et Adler sont à Freud ce que Lassalle et Bakounine sont à Marx.
Tout système clos crée inévitablement une hiérarchie apostolique. Le maître originel, dont la parole est révélation, délègue son autorité spirituelle et temporelle à ses élus : les apôtres, les porteurs des « sept anneaux » de Freud, les membres éprouvés d’un « comité central » ou d’un « politburo ».
Chaque membre du cercle intérieur rayonne à son tour de cette autorité apostolique et délègue un peu de sa substance magique à ses subordonnés du niveau immédiatement inférieur de la hiérarchie, et ainsi de suite vers la périphérie. Le membre le plus humble de la hiérarchie se sent le porteur d’une torche dont la flamme lui a été transmise du saint des saints. Ainsi, tout « militant du parti » qui entreprend une conversion est investi du prestige d’un ordre ésotérique. Ce n’est pas un instructeur vulgaire, mais le messager d’un monde différent et fascinant, environné de mystérieuse lumière ; un être consacré, plus pur, plus admirable, qu’on voudrait bien prendre pour modèle.
La séduction du pêcheur d’âmes communiste consiste en partie dans le secret qui entoure sa personne. Il n’est connu que par son prénom ou par un pseudonyme. Il n’a pas d’adresse, et l’on ne peut l’atteindre que par des intermédiaires ou « contacts ». C’est le cas non seulement des membres de l’« appareil » du parti, mais des militants en général, que leur parti soit légal ou clandestin dans le pays à l’époque considérée. La tradition de conspiration remonte à la Russie tsariste et est devenue l’étiquette rigide de tous les partis communistes du monde. Il suffit d’un contact superficiel pour donner à l’innocent catéchumène l’impression que les membres du parti mènent une vie à part, baignée de mystère, de danger et de sacrifice constants.
La fascination de ce monde mystérieux est considérable, même sur des gens possédant un esprit adulte et pondéré. En outre, le sympathisant est flatté de se voir trouvé digne d’une certaine confiance, de se voir autorisé à rendre de menus services au militant traqué. Lionel Trilling, dans "The Middle of the Journey", a tracé une excellente étude psychologique des relations entre l’apôtre militant et le sympathisant séduit. Ce type de relations explique en partie les étonnantes conversions de fonctionnaires à tête froide du State Department comme Alger Hiss ; ou de diplomates anglais de la vieille école comme Guy Burgess et Donald MacLean ; de millionnaires névrosés comme Frederick Vanderbilt Field ; de savants sérieux comme Bernal, Fuchs et Joliot-Curie. En partie seulement, certes, car le mélange et le dosage de ce facteur et d’autres éléments psychologiques diffèrent d’un cas à l’autre.
Dans les milieux communistes, la tradition de conspiration est devenue un culte avec ses rites, ses manies, son jargon. Au bout de quelques années de cette atmosphère, la plupart des membres du parti commencent à présenter les symptômes de ce qu’on pourrait appeler « conspiratite », état qui confine parfois à la paranoïa proprement dite. Mais cette tendance pathologique elle-même a un attrait singulier pour le néophyte, comme le montrera peut-être l’épisode suivant :
L’un des deux gurus qui jouèrent un rôle prépondérant dans ma conversion fut un jeune homme que je ne connus d’abord que sous le nom d’Otto. Je ne savais rien à l’époque ni de sa profession ni de lui-même, sinon que c’était un « camarade important du front de la culture ». Quelques semaines plus tard, j’appris qu’il écrivait des articles littéraires dans les journaux marxistes sous le nom de plume de Paul Berlin, et aussi qu’il jouait un certain rôle dans la Ligue allemande des écrivains prolétariens révolutionnaires, la faction des écrivains communistes directement affiliée au Komintern.
Cela se passait en 1931. Nous nous retrouvâmes en 1934, en exil à Paris, après l’avènement de Hitler. Nous travaillâmes ensemble dans un bureau du parti, devînmes amis intimes, et, quelque temps après, mon premier mariage fit de nous des beaux-frères. J’appris ainsi — après quatre ans d’étroite amitié — que son véritable patronyme n’était ni Otto ni Paul, mais Peter Maros.
Pourtant j’ignorais encore le nom qui figurait sur son passeport et dont il m’avait laissé entendre que ce n’était, bien entendu, aucun des trois. Otto, alias Paul Berlin, alias Peter Maros, avait une personnalité très marquée. Il était maigre, svelte, fin. L’expression de son visage captivait dès le premier regard. Il en émanait une sainteté calme et ascétique. Il avait les lèvres minces, le front haut, et des pupilles anormalement dilatées dont le regard lumineux dominait le vôtre, sans rien d’agressif, avec un rayonnement de pur amour fraternel. Je découvris plus tard que ce regard remarquable était dû à un léger dérèglement du corps thyroïde, mais il avait, comme toute la personnalité de Peter, un effet irrésistible sur les sympathisants. À cette époque du Front populaire, le Parti recherchait à fond l’appui bourgeois. Je vis Peter en action, auprès de Français — universitaires, professeurs, écrivains, banquiers — dont il sollicitait la participation à quelque comité ..."

"The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe" (1959, Les Somnambules)
Dans cette synthèse assez magistrale, Arthur Koestler efface toute distinction entre sciences et sciences humaines pour donner vie, à sa façon, à toute une histoire de la cosmologie, des Babyloniens à Newton. Il entend montrer ici comment la rupture (dramatique) entre la science et la religion s'est imposée et comment, en particulier, la vision du monde moderne a remplacé la vision du monde médiévale dans la révolution scientifique du XVIIe siècle. Il fournit également des portraits à vif d’une série de grands scientifiques, mais surtout nous raconte que les plus grandes et fondamentales découvertes scientifiques découleraient d’un processus semblable au somnambulisme : le scientifique ne serait jamais pleinement conscients de ce qui guide ses recherches, ni même des implications de ce qu’il découvre ...
"... Le paradoxe humain ...
Si le progrès avait été continu et organique, tout ce que nous savons par exemple en théorie des nombres ou en géométrie analytique aurait pu se découvrir après Euclide en quelques générations. Car ce développement ne dépendait ni de la technique ni de la domination de l'homme sur la Nature : les mathématiques sont tout entières en puissance sans les dix milliards de neurones de la machine à calculer qu'abrite chaque crâne humain.
Et l'on admet que le cerveau n'a pas changé, anatomiquement, depuis au moins cent mille ans. LE PROGRES SACCADE ET FONCIEREMENT IRRATIONNEL DU SAVOIR est sans doute lié au fait que l'évolution a doué l'homo sapiens d'un organe dont il ne pouvait se servir convenablement.
Les neurologues estiment que même au stade actuel nous n'utilisons que deux ou trois pour cent du potentiel des "circuits" de cet organe. A ce point de vue, l'évolution de l'histoire des découvertes raconte les explorations faites au hasard dans les terres inconnues des lobes du cerveau.
C'est d'ailleurs un curieux paradoxe. Les sens et les organes de toutes les espèces évoluent (par mutation et sélection, à ce que l'on suppose), selon les besoins d'adaptation; et les innovations de la structure anatomique sont généralement déterminées par ces besoins. La Nature répond aux désirs de ses clients en procurant des cous assez longs pour brouter la cime des arbres, des sabots et des dents assez robustes pour résister à l'herbe dure des steppes en voie de dessèchement; en rapetissant le cerveau olfactif et en agrandissant le cortex visuel des oiseaux, des arboricoles, des bipèdes, à mesure qu'ils relèvent la tête, peu à peu, au-dessus du sol.
Mais il est absolument sans précédent que la Nature aille doter une espèce d'un organe de luxe, extrêmement complexe, dépassant de très loin ses besoins réels et immédiats, et dont cette espèce n'apprendra à se servir qu'après des millénaires, à supposer qu'elle y arrive jamais.
L'évolution est censée pourvoir à des demandes d'adaptation; en ce cas, la livraison a précédé la demande avec toute une période géologique d'avance.
Le comportement et les possibilités d'apprentissage, dans toutes les espèces, ne peuvent dépasser les étroites limites que fixe la structure de leurs systèmes nerveux et de leurs organes; chez l'homme il semble qu'il n'y ait point de limites, parce que précisément les usages possibles de cette innovation évolutionniste dans son crâne étaient absolument hors de proportion avec les exigences de son milieu naturel.
L'évolution génétique ne pouvant expliquer comment une race plus ou moins stable biologiquement peut évoluer mentalement de l'homme des cavernes au voyageur intersidéral, on est forcé de conclure que les mots «évolution mentale» sont plus qu'une métaphore, et qu'il s'agit d'un processus dans lequel interviennent des facteurs dont nous ne savons encore rien. Nous voyons seulement que l'évolution mentale ne peut se comprendre comme un développement linéaire cumulatif, ni comme un phénomène de "croissance organique", comparable à la maturation de l'individu, et qu'il vaudrait mieux la considérer à la lumière de l'évolution biologique, dont elle est une continuation...." (trad. Calmann-Levy, 1960)

"Janus: A Summing Up" (1978)
Écrit au cours de sa lutte contre la maladie de Parkinson, l'ouvrage se veut réflexion sur les trente dernières années d'Arthur Koestler, abordant des sujets tels que l’intelligence humaine, la créativité, la biologie et la philosophie. L'auteur va jusqu'à tenter d’organiser les sciences physiques et sociales dans un unique cadre métaphysique de référence. Certes, on peut effectivement parler, une fois de plus, d'écrit pseudo-scientifique, mais les questions et l'approche peut générer bien des interrogations.
La première partie de "Janus" résume près de deux douzaines de livres et de nombreux autres essais que Koestler a publiés au cours de sa carrière prolifique. «Yogi and the Commissar» aborde les limites du libre arbitre et les structures de pouvoir incontournables dans lesquelles les humains vivent et travaillent; «Insight and Outlook» tente réunir dans une même intention d'influence mutuelle l’éthique, l’esthétique et la science. «Trail of the Dinosaur» se tourne vers l’écologie, l’avenir de la Terre compte tenu de la progression du changement climatique. «The Sleepwalkers» discute des origines de la créativité en explorant la vie de quelques génies scientifiques, tandis que «The Act of Creation» porte sur le processus de créativité lui-même. "Beyond Reductionism" et "The Ghost in the Machine" critiquent la réduction qui est priviligiée des phénomènes physiques dans le langage de la Science, préconisant plutôt un écosystème interdisciplinaire de production de connaissances. Enfin, "The Heel of Achilles" et "The Roots of Coincidence" explorent les phénomènes paranormaux une théorie alors émergeante, la physique quantique.
Dans une deuxième partie, Koestler va s'attacher à relier les différents thèmes abordés dans l'ensemble de ses ouvrages sous le terme d' « holarchie ». Selon lui, tous les phénomènes observés par les êtres humains invitent à la création de théories qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui, en fin de compte, influencent la façon dont nous percevons ces mêmes phénomènes. Chaque niveau d'organisation, ou « holon », participe à l'augmentation de la complexité à mesure que nous passons du micro au macro, de l'atome à la molécule, des organes au corps, et ainsi de suite. Chaque holon est un système relativement complet, doté de ses propres propriétés et obéissant à ses propres règles. En même temps, chaque niveau d'organisation est également dépendant du système dans lequel il est intégré. Et Koestler d'utiliser ici la métaphore de Janus, le dieu grec à deux visages, les holons sont à la fois tournés vers l'intérieur et vers l'extérieur...
Et c'est donc presque naturellement que Koestler, déduit de sa théorie des holarchies, que la nature ne peut pas être réduite à la connaissance scientifique, ou du moins que la méthode scientifique doit être simplement considérée dans sa capacité à forger des outils permettant aux êtres humains d'interagir entre eux. Retenons que, comme d'autres intellectuels d'une extraordinaire curiosité intellectuelle, Koestler nous rappelle que la science n'est peut-être pas la seule voie d'exploration, mais incontournable, qui nous est offerte dans la compréhension de la nature, humaine ou non ...
