- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor

Mexique - Juan Rulfo (1918-1986), "El llano en llamas" (La plaine en flammes, 1953), "Pedro Paramo" (1955) - Octavio Paz (1914-1998) "El laberinto de la soledad" (Le Labyrinthe de la solitude, 1950), "Libertad bajo palabra" (Liberté sur paroles, 1958) - Adolfo Gilly (1918-2023), "La revolución interrumpida", (1971) - Rosario Castellanos (1925-1974), "Oficio de tinieblas" (1962) - ..
Last update : 03/03/2017

"Pedro Paramo" (1955), du mexicain Juan Rulfo (1918-1986) infuencera fortement des écrivains comme Gabriel Garcia Marquez ou José Saramago en tissant un récit énigmatique sur le pouvoir, la rancoeur, le deuil, et la complexité des relations humaines. Le narrateur, Juan Preciado, se rend à Comala, dans le Nord de l'Etat mexicain, pour accomplir la dernière volonté de sa mère, retrouver Pedro Paramo, son père. A travers les souvenirs, ragots et hallucinations des fantômes qui peuplent le village, il découvre le véritable visage de celui-ci, un petit notable local qui tyrannisait la population. La littérature hispano-américaine va renouer avec la scène internationale avec un autre écrivain mexicain qui, sept années plus tard, avec Carlos Fuentes et "La Muerte de Artemio Cruz", retrace 60 ans de l'histoire du Mexique et dévoile au passage la corruption et la trahison des idéaux révolutionnaires. Entouré d'une famille cupide, d'un prête autoritaire et d'une secrétaire particulièrement tortueuse, Artemio Cruz, un parvenu qui a combattu pour la révolution, se trouve sur son lit de mort et évoque les souvenirs les plus marquants de sa vie ...
Pedro Paramo y El Llano en llamas representan dos aportaciones fundamentales a la literatura contemporanea en lengua castellana. Tanto en la novela como en la coleccion de relatos, Juan Rulfo nos transporta con gran maestria de lo real a lo fantastico por medio de un estilo vigoroso y poetico. Profundamente enraizada en lo popular, la narrativa de Juan Rulfo describe con conmovedora fuerza la cotidiana realidad de un mundo a la vez violento y lirico. Si los cuentos de El llano en llamas describen, con exquisita sobriedad, el mundo de los campesinos de Jalisco, Pedro Paramo lleva el dolor mexicano a su forma mas universal, trascendiendo -sin olvidarla- la historia real. De ahi que, en su conjunto, la obra de Rulfo sea un clasico de las letras hispanoamericanas contemporaneas...
De "La Muerte de Artemio Cruz" (1962) à "La Cabeza de la hidra" (1978), Carlos Fuentes évoquera, quant à lui, l’histoire mexicaine comme un cycle récurrent de trahison et de sacrifice de sang de la conquête à la guerre d’indépendance et de la révolution mexicaine à nos jours, une vision sombre influencée par celle d' Octavio Paz qui dans "El laberinto de la soledad" (1950) soulignait que la première trahison dans l’histoire mexicaine est celle des dieux aztèques, qui ont abandonné leur peuple à la merci des conquistadors. Quatre grands types de déterminisme caractérisent la région : historique, socioéconomique, psychologique et mythique. Le déterminisme socioéconomique est considéré comme opérant le plus fortement sur la vie de ceux au bas de la hiérarchie sociale, dont beaucoup ne peuvent pas trouver une place dans la nouvelle société mexicaine postrévolutionnaire dont le progrès commercial et technologique est si arrogant vanté par un Frederico Robles...



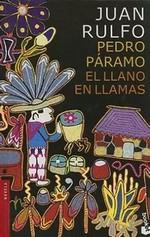


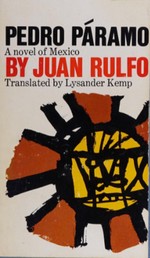

"Pedro Paramo" (1955), du mexicain Juan Rulfo (1918-1986)
"Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague” - Natif d'Acapulco, Juan Rulfo vécut dans le petit village de San Gabriel puis fut placé très tôt dans un orphelinat de Guadalajara : il fut ainsi marqué dès son enfance par les retombées de la révolution mexicaine (1910-1920) et par cette guérilla dite "cristera" contre le gouvernement fédéral profondément anticatholique, de 1926 à 1929, qui enflamma l'état déjà si misérable de Jalisco et provoqua près de cent mille morts de part et d'autre des protagonistes. Les années qui suivent le voient se former à l'histoire de l'art à l'université de Lettres et Philosophie à l'université de Mexico, faire de nombreux voyages dans le pays dans les années 30 et 40 et publier ses contes tout en se passionnant pour la photographie. Il est l'homme de deux grands monuments de la littérature mexicaine, un recueil de nouvelles, "El llano en llamas" (La plaine en flammes,1953), centré sur l'existence misérable des paysans de l'aride région de Jalisco, et le roman "Pedro Paramo" (1955), son seul et unique roman qu'il écrivit sur près de trente ans. Les dernières années de sa vie le voient se consacrer à l'édition d'une importante collection d'anthropologie pour l'Instituto Nacional Indigenista de México. "¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido..."

"El llano en llamas" (La plaine en flammes, 1953)
A classic of Mexican modern literature about a haunted village. As one enters Juan Rulfo’s legendary novel, one follows a dusty road to a town of death. Time shifts from one consciousness to another in a hypnotic flow of dreams, desires, and memories, a world of ghosts dominated by the figure of Pedro Páramo – lover, overlord, murderer. Rulfo’s extraordinary mix of sensory images, violent passions, and unfathomable mysteries has been a profound influence on a whole generation of Latin American writers, including Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, and Gabriel García Márquez. To read Pedro Páramo today is as overwhelming an experience as when it was first published in Mexico back in 1955.
"En écrivant "On nous a donné la terre", "Macario" ou "La nuit où on l'a laissé seul", Rulfo invente un langage qui n'appartient qu'à lui seul, comme l'ont fait Giono, Céline ou Faulkner à partir de leur connaissance de la guerre ou du racisme. La langue de Rulfo porte en elle tout son passé, l'histoire de son enfance. Comme l'a dit son ami des débuts, Efrén Hernández, Juan Rulfo est un "escritor nato", un écrivain-né. Son oralité n'est pas une transcription, elle est un art, qui incube le réel et le réinvente. C'est cette appropriation qui donne à son écriture la force de la vérité. Le Llano en flammes brûle dans la mémoire universelle, chacun de ses récits laisse en nous une marque indélébile, qui dit mieux que tout l'absurdité irréductible de l'histoire humaine, et fait naître la ferveur de l'émotion, notre seul espoir de rédemption", écrit en introduction J.M.G. Le Clézio (Trad. de l'espagnol par Gabriel Iaculli, éditions Gallimard). Ce recueil de quatorze nouvelles (La cuesta de las comadres, Diles que no me maten, El Hombre, Luvina, En la Madrugada, Paso del Norte, Es que somos muy pobres, La noche que lo dejaron solo, Macario...) est ainsi reconnu pour son intensité dramatique admirable, le style est laconique, neutre, indifférent, épouse le décor sauvage et aride du sud de l'État de Jalisco, atmosphère de monotonie écrasante, d'irrémédiable ennui où se déroule l'existence des personnages sans espoir, la dimension métaphysique y est présente dès le monologue de Macario, un jeune orphelin, toujours tenaillé par la faim entre sa marraine acariâtre et la servante Felipa qui pour lui se transforme en nourrice: l'indigence, la saleté, les araignées, les scorpions, les cafards ou les grillons, la besogne rebutante et les terreurs de chaque jour, tout est dit d'une voix monocorde qui n'est même pas une plainte....
"ESTOY sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso: que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a tablazos... Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen; pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas.
Pero a todo esto, es mi madrina la que me manda a hacer las cosas... Yo quiero mas a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa sólo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella , hace con sus manos dos montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por mas que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso... Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa..."
Je suis assis près de la gouttière et j'attends que les grenouilles sortent. Hier soir, alors que nous étions en train de dîner, elles ont commencé à faire un grand bruit et n'ont cessé de chanter jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ma marraine dit aussi que le cri des grenouilles l'a effrayée et qu'elle s'est endormie. Et maintenant, elle aimerait beaucoup dormir. C'est pourquoi elle m'a envoyé m'asseoir ici, près de la gouttière, et m'a mis une planche à la main pour que toute grenouille qui sauterait de la gouttière, je puisse la réduire en bouillie..... Les grenouilles sont vertes sur toute leur surface, sauf sur le ventre. Les crapauds sont noirs. Même les yeux de ma marraine sont noirs. Les grenouilles sont bonnes pour faire de la nourriture. Les crapauds ne se mangent pas ; mais j'en ai mangé aussi, même si on ne les mange pas, et ils ont le même goût que les grenouilles. C'est Felipa qui dit que ce n'est pas bon de manger des crapauds. Felipa a des yeux verts comme ceux des chats. C'est elle qui me donne à manger dans la cuisine chaque fois que c'est mon tour de manger. Elle ne veut pas que je fasse du mal aux grenouilles.
Mais de toute façon, c'est ma marraine qui m'envoie faire des choses.... J'aime Felipa plus que ma marraine. Mais c'est ma marraine qui sort l'argent de son sac pour que Felipa achète toute la nourriture. Felipa est seulement dans la cuisine en train de préparer la nourriture pour nous trois. Elle ne fait rien d'autre depuis que je la connais. C'est mon tour de faire la vaisselle. Je suis aussi chargée de porter le bois pour allumer la cuisinière. Ensuite, c'est ma marraine qui nous donne à manger. Après avoir mangé, elle fait deux petits tas avec ses mains, un pour Felipa et un pour moi. Mais parfois, Felipa n'a pas envie de manger et les deux tas sont pour moi. C'est pour cela que j'aime Felipa, parce que j'ai toujours faim et que je ne suis jamais rassasié, même si je mange sa nourriture. Même si on dit qu'on est rassasié en mangeant, je sais très bien que je ne suis pas rassasié, même si je mange tout ce qu'on me donne. Et Felipa le sait aussi... Dans la rue, on dit que je suis folle parce que je ne suis jamais rassasiée. Ma marraine a entendu dire que c'est ce qu'on dit. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ma marraine ne me laisse pas sortir seule dans la rue. Quand elle me promène, c'est pour m'emmener à l'église écouter la messe...
Recueil de nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo (1917-1986), "El Ilano en llamas" a pour cadre la région rurale natale de l`auteur, Jalisco. Leurs protagonistes sont souvent des âmes élémentaires, vivant avec une violence instinctive la solitude de l'isolement géographique...
Dans "Macario", un simple d'esprit, assis au bord d'une mare, attend pour les tuer les grenouilles qui finiront bien par sortir et qui gênent par leurs cris le sommeil de sa marraine. Avec la faim au ventre, il poursuit une rêverie partagée entre la crainte du châtiment céleste parce qu`il est "plein de démons" et le désir de boire aux seins de la servante Felipa un lait "bon et doux comme le miel qui coule des fleurs de magnolia".
Dans "La Côte des commères" (La cuesta de las comadres), un vieillard cède sans résistance à son instinct et tue à coups d'aiguille de bourrelier son ami et riche voisin qui le menaçait.
Dans "L`Homme" (El hombre), un primitif qui joue les justiciers massacre pendant qu'elle dort toute une famille. à l'exception d'un survivant qui s'élance à sa poursuite à travers la montagne et lui troue la nuque au moment où il se croit sauvé.
Dans "Dis-leur de ne pas me tuer" (Diles que no me maten), c'est encore un justicier, le colonel Terreros. qui fait attacher à une fourche et fusiller par ses soldats un vieillard qui autrefois a assassiné son père car il refusait d`ouvrir ses pâturages à ses troupeaux.
"No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él...."
"Ils n'avaient même pas eu à l'attacher pour qu'il les suive. Il avait marché seul, sans autres menottes que la peur. Ils s'étaient rendu compte qu'il ne pouvait pas courir, avec sa vieille carcasse, ces jambes maigres et sèches comme des baguettes, raidies par la peur de la mort. Parce que c'était là qu'il allait. Vers la mort. On le lui avait dit. Il a tout de suite compris. Il a senti cette brûlure au creux de 1'estomac qui le tourmentait toujours dès qu”il voyait la mort
de près et que l'angoisse lui sortait par les yeux, que sa bouche se remplissait de cette eau amère qu'il devait bien ravaler malgré lui. Il l'a sentie, cette chose qui lui donnait des pieds de plomb tandis que sa tête se ramollissait et que son cœur cognait de toute sa force contre ses côtes. Non, il ne pouvait se faire à l'idée qu'ils allaient le tuer. Il fallait bien qu'il y ait un peu d'espoir. Quelque part, il devait bien rester un peu d'espoir. Peut-être s'étaient-ils trompés. Peut-être recherchaient-ils un autre Juvencio Nava et pas le Juvencio Nava qu'il était. Il avait marché entre ces hommes en silence, les bras le long du corps. Le petit matin était sombre, sans étoiles. Le vent soufflait doucement, emportait la terre poudreuse chargée de cette odeur de pisse qu'a la poussière des chemins, et il en rapportait toujours plus. Ses yeux, qui s'étaient gonflés avec les années, voyaient venir à lui la terre, là, sous ses pieds, malgré l'obscurité. Cette terre, c'était toute sa vie. Soixante ans, il avait vécu là, sur elle, à la prendre dans ses mains, à la goûter comme on goûte la viande. Pendant tout ce long chemin, il n'avait fait que la dévorer des yeux, qu'en savourer chaque morceau comme si c'était le dernier, à peu près sûr que ce serait le dernier. Puis, il avait regardé les hommes qui marchaient près de lui comme s'il voulait dire quelque chose ..."
Dans "Tu n'entends pas les chiens aboyer" (No oyes ladrar los perros) ou dans "L'héritage de Mathilde Arcangel" (La herencia de Matilde Arcángel), Rulfo explore les mécanismes du pouvoir et les visages de la violence souvent dans le cadre de relations familiales en plein déchirement...
Chez tous ces êtres dits primitifs. la violence semble être le seul moyen d`exorciser le spectre quotidien de la misère. Au Mexique. la Révolution a passé. elle s`est officialisée, mais elle a laissé en suspens bien des problèmes. comme ceux de l'emploi et de l'éducation dans les Etats éloignés ou déshérités. Quand elle décide, par exemple, d'appliquer la réforme agraire, son action prend la forme d'une douloureuse supercherie.
Ainsi, dans "Ils nous ont donné la terre" (Nos han dado la tierra), quatre paysans marchent dans la plaine pour aller prendre possession du sol que le délégué du gouvernement leur a attribué. Lorsque quelques gouttes d'eau se mettent à tomber, grosses comme des crachats, elles s`enfoncent et disparaissent dans la couche poussiéreuse qui les environne, et les nouveaux propriétaires comprennent alors qu`ici rien ne pourra jamais pousser.
Certains, comme dans "Paso del Norte", tentent d`entrer clandestinement aux Etats-Unis mais sont les victimes de passeurs criminels. À aucun moment les villages évoqués dans "Talpa" ou "Anacleto Morones" n`ont pu se débarrasser des superstitions du passé ou des excès d'un catholicisme archaïque.
La Révolution elle-même, qui avait jusqu'alors inspiré tant de romans historiques et mythifié plusieurs figures comme Pancho Villa, est elle aussi démystifiée. Dans "Le Llano en flammes", il n`en reste plus que les horreurs : les prisonniers fédéraux avec lesquels on fait la "corrida", les vainqueurs toréant à coups d`aiguillon les vaincus, et leur chef, monté sur son cheval, les mettant à mort; les trains que l'on fait dérailler et les voyageurs que l`on carbonise en les imbibant de pétrole; les partisans que l'on pend par les pieds à un gibet et que les vautours dévorent "par-dedans en les étripant, "ne laissant que la peau" .... (Trad. Lettres nouvelles/Denoël, 1966).

"El gallo de oro" (Le coq d'or et autres textes pour le cinéma , 1993)
"Le coq d'or (nouvelle écrite entre 1956 et 1958) raconte l'ascension et la chute de Dionisio Pinzón, dont la destinée se joue sur un coq doré, puis sur une cantadora, La Caponera, qui sont pour lui, comme dans la fable de La poule aux œufs d'or, des talismans porteurs de richesses. De foire en foire, Dionisio passe de l'arène où ont lieu les combats de coqs au tapis vert des jeux de cartes. Sa vie est suspendue aux faveurs du hasard comme celle de la figure allégorique qui en tournant sur la roue de la fortune, se métamorphose : le pauvre hère s'enrichit, devient don Dionisio, tandis qu'éprise de liberté, La Caponera chante, jusqu'à ce que la main désormais impérieuse de Dionisio se referme sur elle..." (Trad. de l'espagnol par Gabriel Iaculli, éditions Gallimard).

"Pedro Paramo" (1955)
Proche du réalisme magique, "Pedro Paramo montre ce lien indissoluble entre mondes des vivants et des morts si particulier dans la mentalité mexicaine. Tout comme Kafka et Faulkner, Rulfo a su mettre en scène une histoire fascinante, sans âge et d'une beauté rare : la quête du père qui mène Juan Preciado dans son village de Cómala et à la rencontre de son destin, un voyage vertigineux raconté par un chœur de personnages insolites qui nous donnent à entendre la voix profonde du Mexique, au-delà des frontières entre la mémoire et l'oubli, le passé et le présent, les morts et les vivants." (Editions Gallimard, trad. de l'espagnol par Gabriel Iaculli). Car ces récits sont ceux des fantômes des habitants du village, âmes en peine errantes qui n'ont pu trouver la paix, et l'un des passages les plus célèbres, et troublants, est la révélation de la réelle condition de Juan Preciado, mort et enterré, contant dans sa tombe à un de ses compagnons d'infortune son arrivée à Cómala, et l'histoire du père se substitue alors à celui du fils, un père cacique impitoyable qui a ôté toute vie et toute dignité à ces êtres humains devenus fantômes errant dans un village entre vie et mort...
"Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus
manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo —me recomendó—. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte». Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
Todavía antes me había dicho:
—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro.
—Así lo haré, madre.
Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.
Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias.
El camino subía y bajaba: «Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja».
—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
—Comala, señor.
—¿Está seguro de que ya es Comala?
—Seguro, señor.
—¿Y por qué se ve esto tan triste?
—Son los tiempos, señor.
Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: «Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche». Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma… Mi madre.
—¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? —oí que me preguntaban.
—Voy a ver a mi padre —contesté.
—¡Ah! —dijo él.
Y volvimos al silencio..."
Je suis venu à Comala parce qu’on m’a dit que mon père, Pedro Páramo, vivait ici. Ma mère me l’a dit. Et je lui ai promis que je viendrais le voir après sa mort. Je lui serrai la main en signe qu’il le ferait; car elle était sur le point de mourir, et moi sur le point de tout promettre. «Ne manquez pas d’aller le voir, m’a-t-il recommandé. Il s’appelle autrement et de cette autre façon. Je suis sûre qu’il sera heureux de vous rencontrer». Alors je ne pus rien faire d’autre que lui dire que je le ferais, et à force de lui dire, je continuai à lui dire même après que mes mains eurent eu du mal à se débarrasser de ses mains mortes.
Il m’avait encore dit :
- Ne lui demande rien. Oublie ce qu’il a dû me donner. Ce qu’il ne m’a jamais donné... l’oubli qu’il nous a fait, mon fils, Ça coûte cher.
- Je le ferai.
Mais je ne pensais pas tenir ma promesse. Jusqu’à ce moment-là, j’ai commencé à me remplir de rêves, à donner vie aux illusions. Et de cette façon s’est formé pour moi un monde autour de l’espérance qu’était ce seigneur appelé Pedro Páramo, le mari de ma mère. C’est pour ça que je suis venu à Comala.
C’était ce temps de la canicule, quand l’air d’août souffle chaud, empoisonné par l’odeur pourrie des saponarias.
La route montait et descendait : "Elle monte ou descend comme on va ou comme on vient. Pour celui qui va, elle monte ; pour celui qui vient, elle descend".
Quel est le nom du village que vous voyez là-bas ?
-Comala, monsieur.
Es-tu sûr que c'est Comala ?
-Sûr, monsieur.
Et pourquoi ce village a-t-il l'air si triste ?
-C'est l'époque, monsieur.
J'ai imaginé le voir à travers les souvenirs de ma mère ; à travers sa nostalgie, entre des bribes de soupirs. Elle a toujours vécu en se languissant de Comala, du retour ; mais elle n'est jamais revenue. Maintenant, je viens à sa place. J'apporte les yeux avec lesquels elle regardait ces choses, parce qu'elle m'a donné ses yeux pour voir : "Il y a là, après le port de Los Colimotes, une très belle vue d'une plaine verte, un peu jaunie par le maïs mûr. De là, on peut voir Comala, qui blanchit la terre et l'illumine la nuit". Et sa voix était secrète, presque étouffée, comme si elle se parlait à elle-même... Ma mère.
Et pourquoi allez-vous à Comala, si je puis me permettre ? -Je les ai entendus me le demander.
Je vais voir mon père, répondis-je.
-Ah, il a dit.
Et le silence revint ..."
"Pedro Paramo", un bref roman considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature latino-américaine contemporaine. Il appartient au courant dit du réalisme magique ou fantastique. et a pour thème le caciquisme féodal d`avant la Révolution. Sur une route désolée de la province de Jalisco, un homme s'avance sur son âne. ll s'appelle Juan Preciado et, pour répondre à une promesse faite à sa mère sur son lit de mort, il est parti à la recherche de son père, Pedro Páramo, cacique du village de Comala, qui autrefois les a abandonnés. Un muletier au langage étrange auquel il demande son chemin accepte de le conduire jusqu'au village. Mais celui-ci semble désert, et l`inconnu, avant de disparaître, révèle à Preciado que Pedro Páramo, dont il peut voir sur une colline l'immense propriété, est mort depuis longtemps. Quelques heures plus tard, une vieille femme, l'unique habitante de Comala, qui héberge Juan Preciado, lui apprendra que le muletier qu`il a rencontré est mort lui aussi et qu'il s`est adressé à un fantôme... Peu importe. car bientôt, à la suite du muletier, d'autres morts vont surgir et raconter à Preciado, par bribes, leur aventure humaine au service de Pedro Páramo. Et peu à peu l`histoire du cacique est reconstituée.
"EN LA DESTILADERA las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores ; pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado.
« ¡Despierta ! » , le dicen.
Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es ; pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas, y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz.
«¡Despiértate ! », vuelven a decir.
La voz sacude los hombros. Hace enderezar el cuerpo. Entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen de la destiladera sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran. . . Y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó : un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos.
Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando.
- ¿Por qué lloras, mamá? -preguntó ; pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre.
-Tu padre ha muerto - le dijo.
Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo.
Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Sólo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche.
Afuera en el patio, los pasos, como de gente que ronda. Ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral; su cuerpo impidiendo la llegada del día ; dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de cielo, y debajo de sus pies regueros de luz ; una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo.
- Han matado a tu padre.
-¿ Y a ti quién te mató, madre ?
Les gouttes dégoulinent l`une après l`autre dans le filtre. Il entend l'eau claire, sortie de la pierre, tomber dans la cruche. Il entend. Il entend des bruits; des pieds qui raclent le sol, se déplacent, vont et viennent. Les gouttes tombent sans arrêt. La cruche déborde et l'eau va rouler sur le sol mouillé.
"Réveille-toi!" lui dit-on.
Il reconnaît le timbre de la voix. Il essaie de deviner de qui il s'agit, mais son corps se dérobe et il sombre dans la torpeur, écrasé par le poids du sommeil. Des mains viennent tirer les couvertures sous lesquelles le corps se tapit dans la chaleur, cherchant la paix, et elles s'y agrippent.
"Réveille-toi!" dit-on encore.
La voix fait tressaillir les épaules, force le corps à se tendre, les yeux à s'entrouvrir. Des gouttes d`eau qui tombent du filtre dans la cruche pleine, des pas traînants se font entendre... Puis une plainte. Alors, il a entendu une plainte. C'est ce qui l'a réveillé : une plainte égale et grêle qui, peut-être parce qu'elle est si grêle, a pu traverser l'écheveau du sommeil et atteindre l'endroit où nichent les alertes. Il s'est relevé tout doucement et a vu le visage d'une femme en larmes, appuyée contre le jambage de la porte et encore enténébrée par la nuit.
"Pourquoi pleures-tu, maman? a-t-il demandé en posant les pieds par terre, quand il a reconnu les traits de sa mère.
- Ton père est mort", lui a-t-elle dit.
Puis, comme si les ressorts de sa douleur avaient lâché, elle a tourné sur elle-même plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que des mains la saisissent par les épaules et parviennent à arrêter l'agitation de son corps.
Par la porte, on voyait l"aurore au firmament. Il n'y avait pas d'étoiles, seulement un ciel plombé, gris, que n'éclairait pas encore l'éclat du soleil, et un éclat sourd qui semblait annoncer non pas le lever du jour mais la tombée de la nuit.
Dehors, dans la cour, il y avait ces bruits de pas, bruits étouffés de gens qui guettent, et là, debout sur le seuil, cette femme dont le corps empêchait le jour d`entrer mais laissait passer, à travers ses bras, des lambeaux de ciel et, sous ses pieds, des traînées de lumière, une lumière qui ruisselait comme si le sol, au-dessous d'elle, était inondé de larmes. Puis, il y avait cette plainte.
Une fois encore, ce sanglot égal mais aigu, cette douleur qui la faisait se tordre.
"On a tué ton père.
- Et toi, maman, qui t'a tuée?"
"Il y a là-haut le vent et le soleil; les nuages.
Tout là-haut, au-dessus de nous, il y a un ciel bleu et, derrière lui, peut-être des chants, peut-être des voix sans pareilles... Il y a l'espérance, en somme. Pour nous, malgré notre fardeau, il y a l'espérance."
"Mais pas pour toi, Miguel Páramo, qui es mort sans absolution et qu`aucune grâce ne pourra toucher."
Le père Rentería a tourné le dos au corps et considéré que la messe était dite. Il s'est hâté d'en finir et il est sorti sans donner la bénédiction aux fidèles qui emplissaient l'église.
"Père, il faut nous le bénir!
- Non! a-t-il lancé en secouant énergiquement la tête. Non, je ne le ferai pas. Ç'a été un méchant homme et il n'entrera pas au royaume des cieux. Dieu le prendrait mal, si j'intercédais en sa faveur."
Voilà ce qu'il a dit, en tentant de dissimuler le tremblement de ses mains. Et il l'a pourtant fait. Ce défunt pesait très lourd sur l'esprit de tout le monde. Il reposait sur un catafalque, au
milieu de l'église, avec autour de lui des cierges neufs, des fleurs, et derrière lui, seul, son père qui attendait la fin de l`absoute.
Le père Rentería est passé à côté de Pedro Páramo en essayant de ne pas frôler son épaule.
Il a levé le goupillon et, avec des mouvements mesurés, a aspergé la dépouille d'eau bénite, de la tête aux pieds, tandis que de sa bouche sortait un murmure, peut-être une prière. Puis il s'est agenouillé et tout le monde a fait comme lui.
"Aie pitié de ton serviteur, Seigneur.
- Qu'il repose en paix, amen", ont répondu les voix.
Tandis qu'il sentait la colère le gagner de nouveau, il a vu tout le monde quitter l'église avec le cadavre de Miguel Páramo.
Pedro Páramo s'est approché et s`est agenouillé à côté de lui...."
Dominateur cupide et sensuel, Pedro Páramo règne sur un vaste domaine qu`il a développé grâce à des alliances intéressées - son mariage avec la mère de Preciado, par exemple - ou des procédés d'intimidation souvent criminels. Autour de lui, les haines et les rancunes s'accumulent, mais, dominateur incontrôlé, il asservit le village entier, terrifiant les humbles, soudoyant les forts. Comala se prête à ses appétits sexuels comme à ses caprices de tyran.
Lorsque l`heure de la vengeance semble avoir sonné, lorsque la Révolution éclate, Páramo met sur pied une armée de révolutionnaires à sa solde, qui le protègent au détriment des humiliés. La mort seule le vaincra, mais sa personnalité est telle qu'au moment où, à demi paralysé et obsédé par l'image d'une femme qu'il a aimée, il s'éteint, le village s`éteint avec lui, ayant perdu son terrible animateur. Une fois encore, la mort mène le jeu comme elle le fait si souvent au Mexique où elle hante l'imagination populaire ...

Carlos Velo réalisa en 1967 une adaptation cinématographique très fidèle de "Pedro Paramo", malgré l'énorme difficulté de retranscrire à l'écran l'atmosphère si étrange et troublante du roman, avec John Gavin, Ignacio López Tarso et Pilar Pellicer.

Octavio Paz (1914-1998) "El laberinto de la soledad" (Le Labyrinthe de la solitude, 1950), "Libertad bajo palabra" (Liberté sur paroles, 1958)
Le père d'Octavio Paz fut, pendant la révolution mexicaine, le conseiller d'Emiliano Zapata, promoteur de la réforme agraire et sa mère d'une famille andalouse. Après de premières études aux États-Unis, Paz étudie le droit au Mexique, publie en 1937 des poèmes, "Raíz del hombre", rencontre Pablo Neruda, César Vallejo, Vicente Huidobro, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Luis Cernuda pendant la guerre civile espagnole (1936-1939), y écrit "Bajo tu sombra clara", publié en 1937, fonde à Mexico en 1938 la revue Taller, afin de promouvoir un renouveau poétique, et s'engage politiquement. Il se rapproche par la suite du surréalisme, via Benjamin Péret, rencontre aux États-Unis R. Frost, E. E. Cummings, découvre Yeats. En 1945, il entre dans la diplomatie, - il est secrétaire d'ambassade à Paris de 1946 à 1951. Il y fait la connaissance d'Alejo Carpentier et d'André Breton. "El Laberinto de la soledad" (Le Labyrinthe de la solitude, 1950), analyse de l'âme de son pays ...
"... LA SOLEDAD, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten solos; y más: todos los hombres están solos. Vivir, es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro.
Su naturaleza —si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que, precisamente, se ha inventado a sí mismo al decirle "no" a la naturaleza— consiste en un aspirar a realizarse en otro.El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo se siente como carencia de otro, como soledad. Uno con el mundo que lo rodea, el feto es vida pura y en bruto, fluir ignorante de sí. Al nacer, rompemos los lazos que nos unen a la vida ciega que vivimos en el vientre materno, en donde no hay pausa entre deseo y satisfacción. Nuestra sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída en un ámbito hostil o extraño. A medida que crecemos esa primitiva sensación se transforma en sentimiento de soledad. Y más tarde, en conciencia: estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida...."
LA SOLITUDE, le fait de se sentir et de se savoir seul, détaché du monde et étranger à soi-même, séparé de soi-même, n'est pas une caractéristique exclusive du Mexicain. Tous les hommes, à un moment ou à un autre de leur vie, se sentent seuls ; et plus encore : tous les hommes sont seuls. Vivre, c'est se séparer de celui que l'on était pour entrer dans celui que l'on sera, futur étranger pour toujours. La solitude est l'essence même de la condition humaine. L'homme est le seul être qui se sente seul et le seul qui soit à la recherche d'un autre.
Sa nature - si l'on peut parler de nature à propos de l'homme, l'être qui, précisément, s'est inventé en disant "non" à la nature - consiste en une aspiration à se réaliser dans un autre. L'homme est nostalgie et recherche de communion. C'est pourquoi, chaque fois qu'il se sent lui-même, il ressent un manque d'autrui, une solitude. Un avec le monde qui l'entoure, le fœtus est la vie pure et brute, fluide, ignorante d'elle-même. À la naissance, nous rompons les liens qui nous unissent à la vie aveugle que nous vivons dans le ventre de notre mère, où il n'y a pas de pause entre le désir et la satisfaction. Notre sens de la vie s'exprime par la séparation et la rupture, l'impuissance, la chute dans un monde hostile ou étranger. En grandissant, cette sensation primitive se transforme en sentiment de solitude. Et plus tard, en conscience : nous sommes condamnés à vivre seuls, mais nous sommes aussi condamnés à transcender notre solitude et à retisser les liens qui, dans un passé paradisiaque, nous unissaient à la vie.
(...)
Au milieu du XXe siècle, le Mexique se voit confronter aux déceptions de la révolution de 1910 dans un monde qui connaît une transformation radicale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Paz, en essayiste, sait que l’identité, ainsi qu’un labyrinthe, est un problème à résoudre, et pour le Mexique, c’est le labyrinthe de la solitude, condition ultime de l’être mexicain. Dans les quatre premiers chapitres, Octavio Paz tente de découvrir cette identité hors de ses frontières avant de se tourner vers le cœur du Mexique lui-même, de ses pratiques et rituels, de ses fêtes et de son culte de la mort, perçu comme une revanche sur la vie, à travers la texture de son histoire, la conquête et la colonie, l'indépendance et la révolution, l'intelligence mexicaine et les jours contemporains, Paz donne une forme narrative à la solitude faite corps dans l'imaginaire collectif du Mexique ...
" ... EL HOMBRE contemporáneo ha racionalizado los Mitos, pero no ha podido destruirlos. Muchas de nuestras verdades científicas, como la mayor parte de nuestras concepciones morales, políticas y filosóficas, sólo son nuevas expresiones de tendencias que antes encarnaron en formas míticas. El lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a los antiguos Mitos. La Utopía, y especialmente las modernas utopías políticas, expresan con violencia concentrada, a pesar de los esquemas racionales que las enmascaran, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro de la que el grupo social fue arrancado y a la que volverán los hombres el Día de Días. Las fiestas modernas —reuniones políticas, desfiles, manifestaciones y demás actos rituales— prefiguran al advenimiento de ese día de Redención. Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva pureza. Entonces la Historia cesará. El tiempo (la duda, la elección forzada entre lo bueno y lo malo, entre lo injusto y lo justo, entre lo real y lo imaginario) dejará de triturarnos. Volverá el reino del presente fijo, de la comunión perpetua: la realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes.
L'homme contemporain a rationalisé les mythes, mais il n'a pas pu les détruire. Beaucoup de nos vérités scientifiques, comme la plupart de nos conceptions morales, politiques et philosophiques, ne sont que de nouvelles expressions de tendances qui s'incarnaient autrefois dans des formes mythiques. Le langage rationnel de notre époque masque à peine les vieux mythes. L'utopie, et surtout les utopies politiques modernes, expriment avec une violence concentrée, malgré les schémas rationnels qui les masquent, cette tendance qui conduit toute société à imaginer un âge d'or dont le groupe social a été arraché et auquel les hommes reviendront au Jour des Jours. Les festivités modernes - rassemblements politiques, défilés, manifestations et autres événements rituels - préfigurent l'avènement de ce Jour de la Rédemption. Tous attendent que la société retrouve sa liberté originelle et les hommes leur pureté primitive. L'histoire s'arrêtera alors. Le temps (le doute, le choix forcé entre le bien et le mal, entre l'injuste et le juste, entre le réel et l'imaginaire) cessera de nous broyer. Le règne du présent fixe, de la communion perpétuelle reviendra : la réalité tombera ses masques et nous pourrons enfin la connaître et connaître nos semblables.
Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad tiende a salvarse creando un mito de redención, que es también un mito de fertilidad, de creación. Soledad y pecado se resuelven en comunión y fertilidad. La sociedad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una nueva Forma de participación creadora. Tal es, para decirlo con la frase de Ortega y Gasset, el "tema de nuestro tiempo": la sustancia de nuestros sueños y el sentido de nuestros actos. El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá, entonces, empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados."
Toute société mourante ou stérile tend à se sauver en créant un mythe de rédemption, qui est aussi un mythe de fertilité, de création. La solitude et le péché se résolvent dans la communion et la fécondité. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a également engendré son propre mythe. La stérilité du monde bourgeois conduit au suicide ou à une nouvelle forme de participation créative. C'est, pour reprendre l'expression d'Ortega y Gasset, le "thème de notre temps" : la substance de nos rêves et le sens de nos actions. L'homme moderne a la prétention de penser éveillé. Mais cette pensée éveillée nous a conduits dans les couloirs d'un cauchemar sinueux, où les miroirs de la raison multiplient les salles de torture. Lorsque nous émergerons, peut-être découvrirons-nous que nous avons rêvé les yeux ouverts et que les rêves de la raison sont atroces. Peut-être alors recommencerons-nous à rêver les yeux fermés.
Après un nouveau séjour à Paris de 1959 à 1962, Paz est nommé ambassadeur à New Delhi. L'art, la politique, la philosophie, les religions lui inspirent de nombreux essais. Son recueil de poèmes, "Libertad bajo palabra", publié en 1960, évoque tant ses espoirs révolutionnaires déçus que la nécessité de tenter de renouveler la parole poétique qui seule peut dépasser les blessures de l'histoire... En 1968, il démissionne avec éclat de son poste pour protester contre les massacres d'étudiants à Tlatelolco (le 2 octobre 1968, quelques jours avant le début des Jeux olympiques d'été de Mexico, l'armée mexicaine tirait sur une foule de plus de 8 000 étudiants désarmés pendant une de ces manifestations qui constellaient alors un monde en pleine effervescence). Il devient professeur aux États-Unis et en Angleterre. Revenu au Mexique en 1971, il fonde la revue Plural. Chargé de conférence à l'université Harvard, il expose la matière de ce qui constituera la matière de "Los Hijos del limo" (Point de convergence), touchant l'art poétique. Reconnu comme un maître à penser au Mexique, célèbre à l'étranger, Octavio Paz, après 1971, publie de multiples livres d'essais ou de poésie, et fonde dans les années 1970 une revue, Vuelta, où se rassemblent beaucoup d'écrivains opposés notamment aux dictatures d'Amérique latine...

"La revolución interrumpida", Adolfo Gilly (1971)
Publiée pour la première fois en espagnol en 1971, "La revolución interrumpida" a été saluée par l’auteur mexicain Octavio Paz, lauréat du prix Nobel et l'un des plus grands poètes de langue espagnole du XXe siècle, comme une « contribution notable » à l’histoire et est largement reconnue comme un compte rendu fondateur de la révolution mexicaine. Écrit alors que Adolfo Gilly (1928-2023) était prisonnier politique dans le célèbre pénitencier de Lecumberri au Mexique, l'ouvrage s'est vendu des milliers d’exemplaires dans sa première édition, a connu plus de trente éditions au Mexique et a été traduit en plusieurs langues. Une édition entièrement révisée et mise à jour du texte original ("The Mexican Revolution")est maintenant disponible depuis 2005 avec une préface du chercheur d’histoire latino-américain Friedrich Katz et une nouvelle préface de l’auteur. Véritable « histoire du peuple », la Révolution mexicaine est le récit émouvant et ascendant d’un événement dont les échos se font encore sentir en Amérique latine et dans le reste du monde...
"Bien plus que tout autre pays d’Amérique latine, le Mexique a obtenu son indépendance de l’Espagne par une guerre populaire dont les principaux dirigeants, les ecclésiastiques Miguel Hidalgo et José Maria Morelos, étaient également des représentants de l’aile jacobine de la révolution.
Comme ailleurs en Amérique latine, cependant, ce n’est pas cette aile qui a consommé la victoire ou a commencé la tâche d’organiser le pays nouvellement indépendant, mais plutôt les tendances conservatrices qui au cours de la lutte ont été en mesure d’éliminer l’aile radicale à la suite du déclin de l’intervention du peuple dans la guerre.
« La révolution de l’indépendance était une guerre de classe, et sa nature ne peut être comprise correctement à moins que nous reconnaissions le fait que, contrairement à ce qui s’est passé en Amérique du Sud, il s’agissait d’une révolte agraire en gestation. C’est pourquoi l’armée (avec ses criollos comme [Augustin de] Iturbide), l’Église et les grands propriétaires fonciers ont soutenu la couronne espagnole, et ce sont les forces qui ont vaincu Hidalgo, Morelos et Javier Mina », écrit Octavio Paz dans "Le labyrinthe de la solitude".
Le Mexique a également subi le plein poids de la première poussée expansive du capitalisme américain.
En 1847, suivant une évolution historique entamée des années plus tôt avec la guerre du Texas, les États-Unis ont envahi le pays et ont pris possession de la moitié de son territoire — environ deux millions de kilomètres carrés, comprenant les États actuels du Texas, du Nevada, de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, Arizona et Californie. Bien que la domination britannique s’accroisse alors dans le monde, et particulièrement en Amérique latine, le jeune capitalisme nord-américain a pu ainsi acquérir son « espace de vie » en s’emparant des terres mexicaines à la manière des anciennes guerres de conquête. Ce pillage, qui a laissé sa marque dans la mémoire du peuple mexicain, a ensuite été légalisé par le traité de Guadalupe Hidalgo, signé en février 1848. Une dizaine d’années s’écoulèrent avant la montée des forces nationales centrées sur Benito Juárez et son groupe de politiciens libéraux qui devaient organiser les fondations du Mexique moderne. Leur base sociale était ces sections de la bourgeoisie émergente qui cherchaient un nouveau mode d’entrée dans le commerce mondial et une restructuration du marché mexicain et de l’espace intérieur...."
Rappelons ici les quelques écrivains de la Révolution mexicaine tels que Mariano Azuela (1873-1952), qui, avec "Los de abajo" (Ceux d'en bas, 1916), le premier roman de la révolution mexicaine, et "Los Fracasados" (Les Ratés de la vie, 1908), dénonce, non sans ironie, les injustices politiques et sociales, voire la réalité de la révolution elle-même, et Martín Luis Guzmán (1887-1977), avec "El Águila y la Serpiente" (1928), "La Sombra del Caudillo" (1929)...

"Oficio de tinieblas" (Le Christ des ténèbres, 1962)
Oeuvre puissante, bouleversante, de l'écrivain mexicain Rosario Castellanos (1925-1974), publié en 1962 qui se déroule vers 1940 dans le sud du Mexique, dans le triangle que forment la ville coloniale de Ciudad Real, le bourg commercial de Comitán et la vallée indigène de Chamula. Une stratification socio-ethnique particulièrement rigide compartimente la société de la région et bloque toute évolution sociale. Au sommet, les fameux propriétaires terriens, aristocrates ou nouveaux riches, soutenus par l'institution ecclésiastique; tout autour, de nombreux intermédiaires métis qui tirent de solides profits du commerce local; au bas de l'échelle, le peuple chamula, maintenu dans la misère, l'alcoolisme et l'ignorance.
S'inspirant d`une authentique révolte indienne du XIXe siècle noyée dans le sang, Castellanos nous entraîne de l'intérieur à la naissance et au développement d'un grand mouvement messianique dont la prophétesse est la femme désignée par les dieux puisque stérile, Catalina. N`ayant d`autres moyens d'exprimer leur désespoir et leur révolte, les Chamulas vont jusqu'à crucifer un de leurs enfants pour avoir, eux aussi, leur Christ; ils se lancent ensuite dans la lutte armée, convaincus d'être désormais invulnérables. Désemparés dès leurs premiers échecs, les Indiens seront rapidement décimés et la vie reprendra son cours, comme avant. (trad. Gallimard, 1971)
