- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee

Vassili Grossman (1905-1964), "In the Town of Berdichev" (1934), "The Hell of Treblinka" (1944), "For a Just Cause" (Stalingrad, 1952), "Life and Fate" (Vie et Destin, 1962, 1980) - "The Bones of Berdichev: The Life and Fate of Vassily Grossman", by John Garrard and Carol Garrard - "War and Peace", by Leo Tolstoy - "The War: 1941–1945", by Ilya Ehrenburg - 'Stalingrad: The Fateful Siege: 1942–1943", by Antony Beevor - ...
Last update : 11/11/2023

«L’histoire humaine n’est pas la bataille du bien qui lutte pour vaincre le mal », écrit un des personnages de Grossman. «C’est une bataille menée par un grand mal qui lutte pour écraser un petit grain de bonté humaine». Vassili Grossman a écrit dans "Vie et Destin" certaines des pages les plus puissantes sur la Seconde Guerre mondiale, il est surtout celui qui a osé, sans doute le premier, rapprocher nazisme et stalinisme et dénoncer l'antisémitisme que portaient en eux ces deux totalitarismes du XXe siècle, mais un ouvrage dont le manuscrit fut confisqué par le KGB et qui ne sera publié en Russie qu’après sa mort, survenue en 1964, dans la solitude et la pauvreté, et après la disparition de l’URSS ...
"Le roman de Vassili Grossman explore la réalité soviétique à un moment crucial de son histoire, écrit E. Etkind dans la préface de la version française. Stalingrad, c'est à la fois la plus sévère défaite subie par l'Armée Rouge contrainte de reculer jusqu'à la Volga, et la victoire la plus convaincante de l'Etat soviétique, qui réussit à tenir tête aux Allemands, au moment même où ils remportent les victoires les plus éblouissantes. Stalingrad, c'est un moment décisif de l'histoire nouvelle, un tournant déterminant pour le destin du monde et de l'humanité. Stalingrad, c'est un immense espoir pour tous - et avant tout, pour la Russie - car c'est la fin du nazisme et le triomphe de la démocratie. Vassili Grossman nous permet d'assister à ce moment-charnière, par l'intermédiaire des multiples acteurs de ce moment historique : un physicien, de simples soldats, russes ou allemands, un colonel des blindés dans l'armée soviétique, un important SS, bâtisseur d'Auschwitz, des fonctionnaires du parti, de vieux bolcheviks-léninistes, les chefs des deux camps : Hitler et Staline. Et voilà que le lecteur commence par découvrir que tous les espoirs de justice et de démocratie sont sans fondement. On s'aperçoit, en effet, qu'il n'y a pas de différence de principe entre le nazisme de Hitler et le bolchévisme de Staline, fanatisme de classe ou fanatisme de race se rejoignent. Dans les deux cas, il s'agit seulement de trouver un vague et illusoire fondement théorique à la contrainte imposée au peuple pour assurer son pouvoir..."
En 1962, Vasily Grossman écrivit une longue lettre à Nikita Khrouchtchev, plaidant pour la publication de son livre, "Vie et Destin": « Il n’y a aucun sens, aucune vérité, dans la situation actuelle, où je suis physiquement libre, mais mon livre, auquel j’ai donné ma vie, reste en prison », a-t-il protesté. « Je vous demande de publier mon livre. » Grossman espérait que le dégel de la répression russe inauguré par la lente divergence du nouveau premier ministre par rapport à l’orthodoxie stalinienne, pouvait laisser espérer quelques gains de liberté, mais Souslov, l’idéologue en chef du PC soviétique de l’époque le convoqua et lui qu'un tel livre ne pourrait pas paraître avant un ou deux siècles. Grossman avait été pourtant le correspondant de guerre le plus célèbre du pays, ses dépêches du front pendant la Seconde Guerre mondiale avaient fait de lui une légende, il avait a été parmi les premiers à décrire l’Holocauste et la famine ukrainienne, son article de 1944 « L’enfer de Treblinka » qui figure dans le recueil "Carnets de guerre", avait été utilisé lors du Procès de Nuremberg. Mais le Livre noir sur l’effroyable extermination des Juifs ne fut jamais publié en URSS, la ligne politique avait alors changé... Grossman avait confié une copie de son manuscrit à un ami et "Vie et Destin" fut publié en Occident en 1980 ...

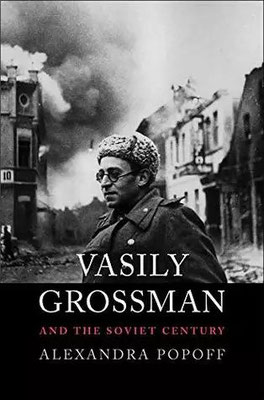
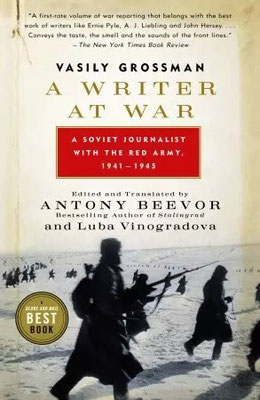
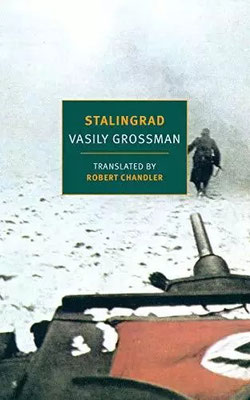
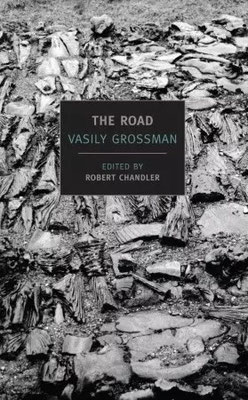
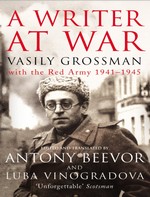
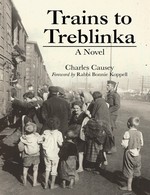
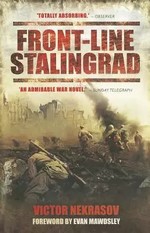
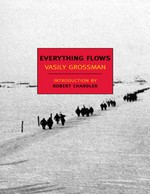

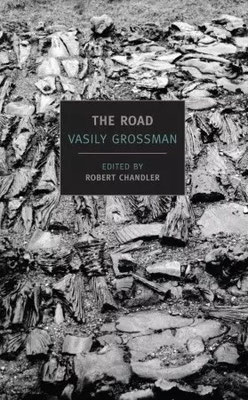

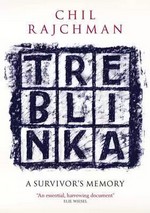
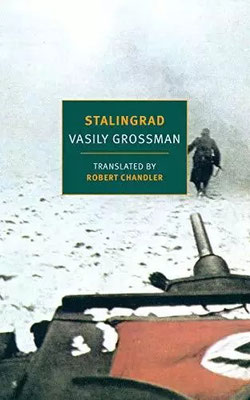
L`essence de "Vie et Destin" est une réflexion sur les systèmes totalitaires, les points communs qui les réunissent au moment même où ils se combattent (c`est l`objet du dialogue entre le vieux bolchevik Mostovskoï et le S.S. Liss), sur la liberté que les communistes ont oubliée (la discussion entre les deux bolcheviks Magar et Abramtchouk dans un camp stalinien); la simple bonté humaine face à tous les systèmes inhumains (les réflexions de l' "innocent" lkonnikov ...
"les hommes qui veulent le bien de l'humanité sont impuissants à réduire le Mal sur terre")...
(...) «La cruauté de la vie fait naître le bien dans les grands cœurs, ils portent ce bien dans la vie, brûlant du désir de transformer le monde à l'image du bien qui vit en eux. Mais ce ne sont pas les cercles de la vie qui se transforment à l'image du bien, c'est l'idée du bien qui, engluée dans le marécage de la vie, se fragmente, perd son universalité, se met au service du moment présent et ne modèle pas la vie à sa merveilleuse mais immatérielle image.
«L'homme perçoit toujours la vie comme une lutte entre le bien et le mal, mais il n'en est pas ainsi. Les hommes qui veulent le bien de l'humanité sont impuissants à réduire le mal sur terre.
«Les grandes idées sont nécessaires pour frayer de nouvelles voies, déplacer les rochers, abattre les falaises; les rêves d'un bien universel pour que les grandes eaux puissent couler en un seul flot. Si la mer pouvait penser, l'idée et l'espoir du bonheur naîtraient dans ses eaux à l'occasion de chaque tempête; et la vague, en se brisant contre les rochers, penserait qu'elle périt pour le bien des eaux de la mer, il ne lui viendrait pas à l'idée qu'elle est soulevée par la force du vent, que le vent l'a soulevée comme il en a soulevé des milliers avant elle et comme il en soulèvera des milliers après elle.
«Des milliers de livres ont été écrits pour indiquer comment lutter contre le mal, pour définir ce que sont le bien et le mal.
«Mais le triste en tout cela est le fait suivant, et il est incontestable : là où se lève l'aube du bien, qui est éternel mais ne vaincra jamais le mal, qui lui aussi est éternel mais ne vaincra jamais le bien, là où se lève l'aube du bien, des enfants et des vieillards périssent, le sang coule. Non seulement les hommes mais même Dieu n'a pas le pouvoir de réduire le mal sur terre.
«Une voix a été ouïe à Rama, des lamentations et des pleurs et de grands gémissements. Rachel pleure ses enfants; et elle ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Et il lui importe peu, à la mère qui a perdu ses enfants, ce que les sages estiment être le bien et ce qu'ils estiment être le mal.
«Mais alors, peut-être que la vie, c'est le mal?
«J 'ai pu voir en action la force implacable de l'idée de bien social qui est née dans notre pays. Je l'ai vue au cours de la collectivisation totale; je l'ai vue encore une fois en 1937. J 'ai vu qu'au nom d'une idée du bien, aussi belle et humaine que celle du christianisme, on
exterminait les gens. J 'ai vu des villages entiers mourant de faim, j'ai vu, en Sibérie, des enfants de paysans déportés mourant dans la neige, j'ai vu les convois qui emmenaient en Sibérie des centaines et des milliers de gens de Moscou, de Leningrad, de toutes les villes de
la Russie, des gens dont on avait dit qu'ils étaient les ennemis de la grande et lumineuse idée du bien social.
Cette grande et belle idée tuait sans pitié les uns, brisait la vie des autres, elle séparait les femmes et les maris, elle arrachait les pères à leurs enfants.
«Maintenant, l'horreur du fascisme allemand est suspendue au-dessus du monde. Les cris et les pleurs des mourants emplissent l'air. Le ciel est noir, la fumée des fours crématoires a éteint le soleil.
«Mais ces crimes inouïs, jamais vus encore dans l'univers entier, jamais vus même par l'homme sur terre, ces crimes sont commis au nom du bien.
« Il y a longtemps, alors que je vivais dans les forêts du Nord, je m'étais imaginé que le bien n'était pas dans l'homme, qu'il n'était pas dans le monde des animaux et des insectes, mais qu'il était dans le royaume silencieux des arbres. Mais non! J 'ai vu la vie de la forêt, la lutte cruelle que mènent les arbres contre les herbes et les taillis pour la conquête de la terre. Des milliards de semences, en poussant, étouffent l'herbe, font des coupes dans les taillis solidaires; des milliards de pousses auto-semencées entrent en lutte les unes contre les autres. Et seules celles qui sortent victorieuses de la compétition forment une frondaison où dominent les essences de lumière. Et seuls ces arbres forment une futaie, une alliance entre égaux. Les sapins et les hêtres végètent dans un bagne crépusculaire, dans l'ombre du dôme de verdure que forment les essences de lumière. Mais vient, pour eux, le temps de la sénescence et c'est au tour des sapins de monter vers la lumière en mettant à mort les bouleaux.
«Ainsi vit la forêt dans une lutte perpétuelle de tous contre tous. Seuls des aveugles peuvent croire que la forêt est le royaume du bien. Est-il vraiment possible que la vie soit le mal?
«LE BIEN N'EST PAS DANS LA NATURE, il n'est pas non plus dans les prédications des prophètes, les grandes doctrines sociales, l'éthique des philosophes...
Mais LES SIMPLES GENS portent en leur cœur l'amour pour tout ce qui est vivant, ils aiment naturellement la vie, ils protègent la vie; après une journée de travail, ils se réjouissent de la chaleur du foyer et ils ne vont pas sur les places allumer des brasiers et des incendies.
«C'est ainsi qu'il existe, à côté de ce grand bien si terrible, la bonté humaine dans la vie de tous les jours. C'est la bonté d'une vieille, qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. C'est la bonté de ces gardiens de prison, qui, risquant leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus adressées aux femmes et aux mères.
«Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoins, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou social.
«Mais, si nous y réfléchissons, nous voyons que cette bonté privée, occasionnelle, sans idéologie, est éternelle. Elle s'étend sur tout ce qui vit, même sur la souris, même sur la branche cassée que le passant, s'arrêtant un instant, remet dans une bonne position pour qu'elle puisse cicatriser et revivre.
«En ces temps terribles où la démence règne au nom de la gloire des Etats, des nations et du bien universel, en ce temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s'agiter comme des branches d'arbre, rouler comme des pierres qui, s'entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés ..."

Le Bien, le Mal, mais aussi la SOUMISSION", cet effroyable moyen d'action sur les êtres humains ...
(...) la première moitié du XXe siècle entrera aussi dans l'histoire de l'humanité comme la période de l'extermination totale d'énormes masses de la population juive, extermination qui s'est fondée sur des théories sociales ou raciales. Le monde actuel le tait avec une discrétion fort compréhensible. Une des propriétés les plus extraordinaires de la nature humaine qu'ait révélée cette période est la SOUMISSION. On a vu d'énormes files d'attente se constituer devant les lieux d'exécution et les victimes elles-mêmes veillaient au bon ordre de ces files. On a vu des mères prévoyantes qui, sachant qu'il faudrait attendre l'exécution pendant une longue et chaude journée, apportaient des bouteilles d'eau et du pain pour leurs enfants. Des millions d'innocents, pressentant une arrestation prochaine, préparaient un paquet avec du linge et une serviette et faisaient à l'avance leurs adieux. Des millions d'êtres humains ont vécu dans des camps qu'ils avaient construits et qu'ils surveillaient eux-mêmes.
Et ce ne furent pas des dizaines de milliers, ni même des dizaines de millions, mais d'énormes masses humaines qui assistèrent sans broncher à l'extermination des innocents. Mais ils ne furent pas seulement des témoins résignés; quand il le fallait, ils votaient pour l'extermination, ils marquaient d'un murmure approbateur leur accord avec les assassinats collectifs. Cette extraordinaire soumission des hommes révéla quelque chose de neuf et d'inattendu.
Bien sûr, il y eut la résistance, il y eut le courage et la ténacité des condamnés, il y eut des soulèvements, il y eut des sacrifices, quand, pour sauver un inconnu, des hommes risquaient leur vie et celle de leurs proches. Mais, malgré tout, la soumission massive reste un fait incontestable.
Que nous apprend-elle ? Est-ce un aspect nouveau et surprenant de la nature humaine? Non, cette soumission nous révèle l'existence d'un nouveau et effroyable moyen d'action sur les hommes. La violence et la contrainte exercées par les systèmes sociaux totalitaires ont été capables de paralyser dans des continents entiers l'esprit de l'homme.
En se mettant au service du fascisme, l'âme de l'homme proclame que l'esclavage, ce mal absolu, porteur de malheur et de mort, est le seul et unique bien. L'homme ne renonce pas aux sentiments humains, mais il proclame que les crimes commis par le fascisme sont une forme supérieure de l'humanisme, il consent à partager les gens en purs et impurs, en dignes et indignes. La volonté de survivre à tout prix a eu pour résultat la compromission de l'âme avec l'instinct.
L'instinct reçoit l'aide de la puissance hypnotique qu'exercent des systèmes idéologiques globaux. Ils appellent à tous les sacrifices, ils invitent à utiliser tous les moyens au nom du but suprême : la grandeur future de la patrie, le progrès mondial, le bonheur de l'humanité, de la nation, d'une classe.
A côté de ces deux premières forces (l'instinct de conservation et la puissance hypnotique des grandes idées), il y en a une troisième : l'effroi provoqué par la violence sans limites qu'exerce un Etat puissant, par le meurtre érigé en moyen de gouvernement. La violence exercée par un Etat totalitaire est si grande qu'elle cesse d'être un moyen pour devenir l'objet d'une adoration quasi mystique et religieuse ...."

VASILY SEMYONOVICH GROSSMAN was born on December 12, 1905, in Berdichev, a Ukrainian town that was home to one of Europe’s largest Jewish communities. In 1934 he published both “In the Town of Berdichev”—a short story that won the admiration of such diverse writers as Isaak Babel, Maksim Gorky, and Boris Pilnyak—and a novel, "Glyukauf", about the life of the Donbass miners. During the Second World War, Grossman worked as a war correspondent for the army newspaper Red Star, covering nearly all of the most important battles from the defense of Moscow to the fall of Berlin. His vivid yet sober “The Hell of Treblinka” (late 1944), one of the first articles in any language about a Nazi death camp, was translated and used as testimony in the Nuremberg Trials. His novel For a Just Cause (originally titled Stalingrad) was published in 1952 and then fiercely attacked. A new wave of purges— directed against the Jews—was about to begin; if not for Stalin’s death, in March 1953, Grossman would almost certainly have been arrested. During the next few years Grossman, while enjoying public success, worked on his two masterpieces, neither of which was to be published in Russia until the late 1980s: Life and Fate and Everything Flows. The KGB confiscated the manuscript of "Life and Fate" in February 1961. Grossman was able, however, to continue working on "Everything Flows", a novel even more critical of Soviet society than "Life and Fate", until his last days in the hospital. He died on September 14, 1964, on the eve of the twenty-third anniversary of the massacre of the Jews of Berdichev, in which his mother had died ...
VASILY SEMYONOVICH GROSSMAN est né le 12 décembre 1905 à Berdichev, une ville ukrainienne qui abritait l’une des plus grandes communautés juives d’Europe. En 1934, il publia à la fois « In the Town of Berdichev », une nouvelle qui suscita l’admiration d’écrivains aussi divers que Isaak Babel, Maksim Gorky et Boris Pilnyak, et un roman, «Glyukauf», sur la vie des mineurs du Donbass. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Grossman travaille comme correspondant de guerre pour le journal militaire Red Star, couvrant presque toutes les batailles les plus importantes, de la défense de Moscou à la chute de Berlin. Son article à vif mais si sobre « L’enfer de Treblinka » (fin 1944), l’un des premiers articles jamis écrit sur un camp de la mort nazi, a été traduit et utilisé comme témoignage dans les procès de Nuremberg. Son roman «For a Just Cause» (intitulé à l’origine «Stalingrad») a été publié en 1952, puis violemment attaqué. Une nouvelle vague de purges — dirigées contre les Juifs — était sur le point de commencer; sans la mort de Staline, en mars 1953, Grossman aurait presque certainement été arrêté. Au cours des années suivantes, Grossman, tout en profitant du succès public, a travaillé sur ses deux chefs-d’œuvre, dont aucun ne devait être publié en Russie jusqu’à la fin des années 1980 : "Life and Fate" (Vie et Destin) et "Everything Flows" (Tout passe). Le KGB confisqua le manuscrit de Vie et Destin en février 1961. Grossman a cependant pu continuer à travailler sur "Everything Flows", un roman encore plus critique de la société soviétique, et jusqu’à ses derniers jours à l’hôpital. Il mourut le 14 septembre 1964, à la veille du vingt-troisième anniversaire du massacre des Juifs de Berdichev, au cours duquel sa mère était morte...

"Vie et Destin" ( Life and Fate, 1962, 1980)
"VIE ET DESTIN" fut publié en Occident en 1980 et en U.R.S.S. en 1988, deuxième volet d`une œuvre en deux parties, - la première, "Pour une juste cause", avait été publiée en 1961 -, constitue un roman autonome, tant est grande la différence qui sépare les deux livres. L`audace idéologique de "Vie et Destin" l'a fait confisquer par le K.G.B. en 1961. Un manuscrit, conservé en secret par les amis de Grossman, est passé en Occident à la fin des années 1970. Le livre est construit selon le principe du roman-épopée tolstoïen. Comme dans "Guerre et Paix" nous avons une famille centrale, les Chapochnikov (la mère, les sœurs, leurs maris et les petits-enfants), et une multitude de personnages qui gravite autour d`elle. Par une série d'actions parallèles, nous pénétrons aussi bien dans les camps soviétiques qu`hitlériens, dans l`armée Rouge à Stalingrad que dans les arrières, dans les laboratoires de recherche que dans les cuisines.
L'action se déroule pendant la bataille de Stalingrad et la contre-offensive victorieuse des armées soviétiques. Nous voyons des généraux réels (Rodimtsev, Tchouikov) et des personnages fictifs : le commandant Beriozkine qui, par son courage et son humanité dans la guerre, rappelle le capitaine Touchine de "Guerre et Paix". Le commissaire politique Krymov (le premier mari de Génia, une des sœurs Chapochnikov) veut remettre au pas un groupe armé russe qui combat dans les ruines de Stalingrad sans se soumettre aux ordres du commandement politique ; dans l`affrontement entre Krymov et Grekov, c'est la question de la liberté dans la guerre qui est posée.
Evacuée à Kazan, la famille du physicien Strum (qui semble être un alter ego de l`auteur) connaît les difficultés et les malheurs de la guerre. Lioudmila (la femme de Strum, née Chapochnikov) part pour Saratov où son fils, né d'un premier mariage, est mort de ses blessures. Strum poursuit ses recherches et fait une découverte fondamentale en physique nucléaire. ll se heurte, surtout après son retour à Moscou, aux premières manifestations d'antisémitisme. Le vide se fait autour de lui mais un coup de fil de Staline lui donne reconnaissance et gloire; c`est à ce moment qu'il fait preuve de faiblesse et signe une lettre collective qui le déshonore. ll reçoit une missive de sa mère, coincée dans un ghetto, sur les derniers moments des Juifs de la ville.
Le thème de l`Holocauste se retrouve dans la description du voyage dans un train de la mort de Sofia Levintone, un médecin ami des Chapochnikov. Elle périt avec tous ses compagnons de voyage dans une chambre à gaz. À la même époque, Krymov, un vieux bolchevik, qui n`est plus de son temps, est dénoncé pour trotskisme et connaît toutes les horreurs du chemin qui mène de l'arrestation au camp.
Parmi toutes les autres figures du roman, il faut relever celle de Guetmanov, le responsable du Parti qui, sous une allure populaire, est prêt à tout au nom de "l'esprit de parti". Devenu commissaire politique du colonel de chars Novikov (le nouvel amour de Génia), il le dénoncera pour avoir retardé de quelques minutes une offensive, bien que ce retard ait
permis de remporter le combat. Enfin. Abartchouk, le premier mari de Lioudmila. détenu dans un camp soviétique, périra sans avoir compris qu'il est la victime d'un système qu'il a lui-même contribué à construire.
Les pages sur l`espoir né de la reddition des Allemands à Stalingrad, les actes de compassion de certains Russes, les moments de bonheur du major Beriozkine en permission avec sa femme, la joie de la découverte scientifique chez Strum, l'amour naissant entre deux jeunes gens dans les ruines de Stalingrad permettent d`affirmer. malgré toutes les horreurs évoquées. la confiance de l'auteur dans l'homme. (Trad. Julliard/L`Age d'Homme, 1983).


"Vie et Destin" commence à l’automne 1942 dans Stalingrad assiégée et va rassembler presque toutes les strates de la société soviétique dans un même destin narratif qui voit se succéder et converger deux systèmes, nazis et communistes, et qui pourtant s'affrontent. Comme dans « Guerre et Paix», les évènements relatifs à la "grande" Histoire" viennent percuter l'existence d’une famille - les Shaposhnikov - et le cercle élargi de leurs amis et de leurs relations, mais a contrario de Tolstoï, Grossman travaille à plus petite échelle, des dizaines de personnages racontent des histoires d’amour et de conflit, de fidélité et d’infidélité, de courage et de lâcheté, de brutalité et de tendresse. Et si le récit de la violence observée à Stalingrad est plus que fascinante, c’est l’évocation par Grossman des suites de la victoire russe - quand les ruines de la ville ont perdu tout symbole de résistance et ne sont plus que simples ruines - qui est véritablement dévastatrice: "une âme peut vivre dans la tourmente pendant des années et des années, voire des décennies, alors qu’elle construit lentement, pierre par pierre, un monticule au-dessus d’une tombe; alors qu’elle se dirige vers l’appréhension de la perte éternelle et s’incline devant la réalité..."
1 - "Le brouillard recouvrait la terre. Les phares de la voiture se reflétaient dans les lignes à haute tension qui s'étiraient le long de la route. Il n'avait pas plu mais, à l'aube, l'humidité s'abattit sur la terre et les feux dessinaient des taches rougeâtres sur l'asphalte mouillé. On sentait la respiration du camp à de nombreux kilomètres : les fils électriques, les routes, les voies de chemin de fer se dirigeaient tous vers lui, toujours plus denses. C'était un espace rempli de lignes droites, un espace de rectangles et de parallélogrammes qui fendaient la terre, le ciel automnal, le brouillard. Des sirènes lointaines poussèrent un hurlement doux
et plaintif.
La route venait se serrer contre la voie, et la colonne de camions chargés de sacs de ciment roula un certain temps à la hauteur du train de marchandises interminable. Les chauffeurs en uniforme ne regardaient pas les wagons, les taches pâles des visages.
La clôture du camp sortit du brouillard : des rangs de barbelés tendus sur des poteaux en béton. Les alignements de baraques formaient des rues larges et rectilignes. Leur uniformité exprimait le caractère inhumain du camp.
Parmi les millions d'isbas russes, il n'y a et il ne peut y avoir deux isbas parfaitement semblables. Toute vie est inimitable. L'identité de deux êtres humains, de deux buissons d'églantines est impensable... La vie devient impossible quand on efface par la force les différences et les particularités.
L'œil rapide mais attentif du vieux machiniste suivait le défilement des poteaux de béton, des grands mâts surmontés de projecteurs pivotants, des miradors au sommet desquels on voyait, derrière les vitres, les sentinelles auprès des mitrailleuses. Le mécanicien fit un signe à son aide et la locomotive lança un coup de sifflet d'avertissement. Ils entrevirent une guérite brillamment éclairée, une file de camions arrêtés par la barrière baissée du passage à niveau, l'œil rouge du feu clignotant.
Ils entendirent les sifflets d'un convoi qui venait à leur rencontre. Le mécanicien se tourna vers son aide : - C'est Zucker, je le reconnais à sa voix délurée, il a livré la marchandise et file à vide vers Munich.
Le convoi vide croisa dans un bruit assourdissant celui qui, chargé, allait vers le camp, l'air déchiré criait, les lumières grises entre les wagons se succédaient, et soudain l'espace et la lumière grise de l'automne déchiqueté en lambeaux se réunirent à nouveau en une voie
qui filait régulièrement. L'aide-mécanicien sortit une petite glace de poche et examina sa joue salie. Le mécanicien la lui demanda d'un mouvement de la main.
Son aide dit d'une voix tendue :
- Ah! Genosse Apfel, croyez-moi, nous aurions pu rentrer pour le dîner au lieu de rentrer à 4 heures du matin, en y laissant nos dernières forces, s'il n'y avait pas cette maudite désinfection des wagons. Comme s'il n'était pas possible de l'effectuer chez nous, au
dépôt.
Le vieux en avait plus qu'assez de ces éternelles discussions à propos de la désinfection.
- Donne un coup de sifflet, dit-il, on nous aiguille directement vers la plate-forme de déchargement principale.
2
Dans le camp de concentration allemand, Mikhaïl Sidorovitch Mostovskoï eut l'occasion, pour la première fois depuis le Deuxième Congrès du Komintem, d'utiliser sa connaissance des langues étrangères. Avant-guerre, à Leningrad, les occasions de parler à des étrangers étaient rares. Il se souvenait maintenant de ses années d'émigration à Londres et à Genève, où, dans les milieux révolutionnaires, on parlait, discutait, chantait dans presque toutes les langues d'Europe. Son voisin de châlit, un prêtre italien du nom de Guardi, avait annoncé à Mostovskoï que la population du camp comptait cinquante-six nationalités. Le sort, le teint du visage, la tenue, la démarche traînante, la soupe à base de rutabaga et de sagou artificiel que les détenus russes avaient surnommée œil de poisson, tout cela était commun aux dizaines de milliers de personnes qui habitaient les baraquements du camp.
Pour le commandement du camp, les détenus se distinguaient par leur numéro et par la couleur de la bande de tissu cousue à leur veste : rouge pour les politiques, noire pour les saboteurs, verte pour les voleurs et les assassins.
La différence de langues empêchait ces hommes de se comprendre, mais ils étaient liés par une destinée commune ..."
(...)
Vassili Grossman naquit en 1905 à Berditchev, capitale juive de l’Ukraine, dans une famille juive totalement assimilée, après des études d’ingénieur chimiste, s'oriente vers la littérature, apprécié par Gorki, il devient rapidement un écrivain professionnel, représentant convaincu du réalisme soviétique, glorifiant la révolution bolchevique, ses réalisations et ses dirigeants, à commencer par Staline, puis va progressivement se métamorphoser politiquement et humainement pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Correspondant de l’Étoile rouge, journal de l’Armée Rouge, dont il a couvert la plupart des grandes batailles depuis la débâcle de l’été 41 jusqu’à la chute de Berlin en 1945, en passant par Stalingrad, il y acquiert sa renommée, partage les souffrances et la ténacité des simples soldats du front, mais il est aussi le premier écrivain à découvrir les camps d’extermination nazis et à en rendre compte; et apprend, a posteriori, l’assassinat de sa mère en 1941 à Berditchev par les Einsatzgruppen. Confronté à la shoah, il se découvre juif, et prend conscience de cet antisémitisme latent qui persiste et gagne son propre pays après la guerre : il en prend toute la mesure dramatique lorsqu'il écrit "Vie et Destin" ...
(Partie II - 29-32)
Liss rencontra Eichmann de nuit.
Eichmann avait environ trente-cinq ans. Ses gants, sa casquette et ses bottes, incarnation matérielle de la poésie, de l'arrogance et de la supériorité de l'armée allemande, ressemblaient à ceux que portait le Reichsführer Himmler. Liss connaissait la famille des Eichmann déjà avant la guerre, car ils étaient de la même ville. Lorsqu'il étudiait à l'université de Berlin, tout en travaillant successivement pour un quotidien puis pour une revue philosophique, il revenait de temps à autre dans sa ville natale et apprenait ce que devenaient ses compagnons de lycée. Les uns avaient été portés par la vague vers le faîte de la société, puis la vague refluait, la chance disparaissait et c'est à d'autres qu'allaient sourire la célébrité et la réussite matérielle. Le jeune Eichmann, lui, vivait invariablement la même vie terne et uniforme. Le fracas des armes de Verdun, la victoire peut-être imminente, la défaite et l'inflation, la lutte politique au Reichstag, le tourbillon des forces de gauche et d'extrême gauche, en peinture, au théâtre, en musique, les modes et leurs naufrages, rien n'atteignait son régime de vie uniforme.
Il travailla comme agent d'une firme de province. En famille et avec les gens en général, il était à la fois modérément brutal et modérément attentionné. Il se heurtait, dans sa vie, à une foule bruyante, gesticulante et hostile. Il se voyait repoussé de partout par des gens vifs et lestes, aux yeux sombres et brillants, habiles et expérimentés, qui le considéraient tous avec un sourire condescendant.
A Berlin, après le lycée, il ne réussit pas à trouver de travail. Les chefs de service et les patrons d'entreprises lui répondaient que, malheureusement, le poste était déjà occupé, mais Eichmann apprenait par ailleurs que la place avait été offerte à je ne sais quel avorton
pourri de nationalité indéfinie, polonaise ou italienne. Il tenta d'entrer à l'Université, mais l'injustice qui y régnait l'en empêcha. Il constatait que les examinateurs, en voyant son visage rond aux yeux clairs, ses cheveux blonds coiffés en brosse, son nez droit et court, se renfrognaient. Il avait l'impression que leur préférence allait aux étudiants à longue face, aux yeux sombres, aux épaules voûtées et étroites, bref, aux dégénérés. Il n'était du reste pas le seul à être ainsi rejeté vers la province. Ce fut le lot de bien d'autres. Cette race de gens qui régnait à Berlin se rencontrait à tous les niveaux de la société. Mais elle pullulait surtout dans cette intelligentsia cosmopolite ayant perdu tout caractère national et incapable de faire la différence entre un Allemand et un Italien, un Allemand et un Polonais.
C'était une race particulière, étrange, qui écrasait tous ceux qui tentaient de lui faire concurrence dans le domaine de l'esprit, de la culture et de l'indifférence ironique. Le pire, c'était de sentir leur intelligence supérieure, si pleine de vie et de joie; cette puissance
spirituelle s'exprimait dans les goûts étranges de ces gens, dans leur genre de vie, avec ce mélange de respect de la mode et de négligence ou même d'indifférence pour celle-ci, dans leur amour pour les animaux allié à un style de vie parfaitement citadin, dans leur don pour la spéculation abstraite allié à une passion pour le brut dans la vie et dans l'art.
C'étaient ces mêmes gens qui faisaient avancer pour l'Allemagne la chimie des colorants et la synthèse de l'azote, les recherches sur les rayons gamma et la production d'acier fin. C'était pour les voir, eux, que venaient en Allemagne des savants étrangers, des artistes, des philosophes et des ingénieurs. Et c'étaient pourtant eux qui ressemblaient moins que tout autre à des Allemands : ils circulaient à travers le monde entier, leurs amitiés n'étaient pas des amitiés allemandes et leurs origines allemandes très incertaines.
Dans ces conditions, quelle chance pouvait bien avoir un fonctionnaire de province de progresser vers une vie meilleure : encore heureux qu'il n'ait pas souffert de la faim.
Et le voici maintenant sortant de son bureau, après avoir enfermé dans son coffre des papiers dont seuls trois hommes au monde connaissent la teneur : Hitler, Himmler et Kaltenbrunner. Une grosse voiture noire l'attend à la porte. Les sentinelles le saluent, l'officier d'ordonnance lui ouvre grande la portière de la voiture : l'Obersturmbannführer Eichmann prend la route. Le chauffeur démarre en trombe et la puissante limousine de la Gestapo, respectueusement saluée par la police civile qui s'empresse de mettre le feu vert, après avoir franchi les rues de Berlin, s'élance sur l'autoroute.
Pluie, brouillard, panneaux de signalisation, virages en douceur de l'autoroute.
A Smolévitchi, il y a des petites maisons paisibles parmi les jardins et l'herbe pousse sur les trottoirs. Dans les rues des bas quartiers de Berditchev, des poules sales courent dans la poussière, avec leurs pattes d'un jaune sulfureux marquées d'encre violette et rouge. A Kiev, dans le quartier du Podol et sur l'avenue Vassilievskaia, dans les grands immeubles aux fenêtres sales, les marches des escaliers sont usées par des millions de chaussures d'enfants et de savates de vieillards.
Dans les cours d'0dessa, il y a des platanes aux troncs écaillés, des draps, des chemises et des caleçons qui sèchent, des bassines de confiture de cornouilles qui fument sur les réchauds, des nouveau-nés vagissants dans des berceaux, dont la peau bistre n'a pas encore vu le soleil.
A Varsovie, dans les six étages d'un immeuble osseux et étroit d'épaules vivent des couturières, des relieurs, des précepteurs, des chanteuses de cabaret, des étudiants, des horlogers. A Stalindorf, le soir, on allume le feu dans les isbas, le vent souffle de Pérékop, ça sent le sel et la poussière chaude et les vaches meuglent en secouant leurs lourdes têtes...
A Budapest comme à Fastov, à Vienne comme à Melitopol et à Amsterdam vivaient, dans des hôtels particuliers aux fenêtres étincelantes ou dans des maisons noyées dans les fumées d'usines, les hommes appartenant à la nation juive.
Les barbelés du camp, les murs de la chambre à gaz, la terre glaise du fossé antichar unissaient désormais des millions de gens d”âge, de profession, de langue, d'intérêts matériels et spirituels différents; des croyants fanatiques et de fanatiques athées, des ouvriers, des parasites, des médecins et des marchands, des sages et des idiots, des voleurs, des idéalistes, des rêveurs, des bons vivants, des saints et des escrocs. Tous étaient promis à l'extermination.
La limousine de la Gestapo filait et virait le long des autoroutes d'automne.
30
Ils se rencontrèrent donc de nuit. Eichmann entra directement dans le bureau : avant même de s'asseoir dans le fauteuil, il avait déjà commencé à poser ses questions ...
(...)
Ils se séparèrent. Liss regarda la voiture s'éloigner. Il avait sa propre vision des relations humaines au sein d'un Etat. Dans un Etat national-socialiste, la vie ne pouvait pas se dérouler librement, il fallait diriger chacun de ses pas. Et pour diriger les gens dans leur respiration, dans leur sentiment maternel, dans leurs cercles de lecture, dans leurs usines, dans leurs chants, dans leur armée, dans leurs randonnées d'été, il fallait des chefs. La vie ne pouvait plus se permettre de pousser comme l'herbe et d'onduler au vent comme la houle. Liss pensait qu'il y avait, en gros, quatre types de chefs.
Le premier type comportait des natures entières, le plus souvent sans intelligence ni finesse. Ils prenaient leurs slogans et leurs formules dans les journaux, dans les discours d'Hitler et les articles de Goebbels, dans les livres de Franck et de Rosenberg. Etant dépourvus de bases, ils étaient très vite perdus. Ils ne réfléchissaient pas à ce qui relie les différents phénomènes entre eux et se montraient cruels et intolérants à tout propos. Ils prenaient tout au sérieux, que ce soit la philosophie ou la science nationale-socialiste, de vagues découvertes ou les réalisations du théâtre moderne, la musique moderne ou la campagne électorale du Reichstag. Ils se réunissaient en groupes pour bûcher Mein Kampf et, comme des écoliers, mettaient en fiches exposés et brochures. Ils menaient, en général, une vie modeste, parfois difficile, et se laissaient plus facilement enrôler dans le parti et arracher à leurs familles que les autres catégories de chefs. Liss avait eu l'impression, au premier abord, que c'était précisément à cette catégorie qu'appartenait Eichmann.
Le second type était celui des cyniques intelligents, qui connaissaient l'existence de la baguette magique. Entre amis sûrs ils se moquaient d'un tas de choses, de l'ignorance des professeurs et maîtres de conférences fraîchement émoulus, des bêtises et des mœurs des Leiter et des Gauleiter. La seule chose dont ils ne se moquaient pas était le Führer et les grands idéaux. Ils menaient, en général, grand train de vie et buvaient beaucoup. On rencontrait davantage de gens de ce type en haut de la hiérarchie du parti qu'en bas, où régnaient les caractères du premier type.
Tout en haut régnait le troisième type de chefs : il n'y avait place là que pour huit à dix personnes, qui en accueillaient quinze à vingt autres. C'est là que vivait un monde affranchi de tout dogme et jugeant de tout en toute liberté. Plus d'idéaux, rien d'autre qu'une certaine mathématique, les réjouissances et de grands maîtres parfaitement étrangers à la pitié.
Liss avait parfois l'impression que tout, en Allemagne, tournait autour d'eux et de leur bien-être.
Liss avait également remarqué que l'apparition au sommet de gens aux facultés limitées annonçait toujours des événements néfastes. Les maîtres du mécanisme social élevaient à des grades supérieurs des hommes du dogme afin de leur confier les tâches les plus sanglantes. Ces sots cédaient pour un temps à l'ivresse du pouvoir, mais, une fois leur tâche accomplie, ils disparaissaient, quand ils ne partageaient pas le destin de leurs propres victimes. Tout en haut, les joyeux maîtres demeuraient en place.
Les naïfs, appartenant au premier type, offraient un avantage inappréciable, celui de sortir du peuple. Ils savaient citer les classiques du national-socialisme, mais ils parlaient aussi la langue du peuple, dont leur grossièreté les rapprochait. Leurs plaisanteries faisaient rire les assemblées de paysans ou d'ouvriers.
Le quatrième type était celui des exécutants, parfaitement indifférents au dogme, aux idées, à la philosophie, étrangers à toute faculté d'analyse. Le national-socialisme les payait : ils le servaient. Leur unique grande passion était les services de vaisselle, les costumes, les maisons de campagne, les bijoux, les meubles, les voitures et les réfrigérateurs. Ils n'aimaient pas beaucoup l'argent, car ils ne croyaient pas à sa stabilité.
Liss aspirait à se trouver parmi les hauts dirigeants, il rêvait de .leur compagnie et de leur intimité, de ce royaume de l'intelligence et de l'ironie, d'une logique élégante, où il se sentait si léger, si naturel, si à l'aise. Mais il apercevait à une hauteur effrayante, au-dessus des plus hauts dirigeants, au-dessus de la stratosphère, un monde de brouillard, incompréhensible, d'un illogisme troublant, celui du Führer Adolf Hitler.
Ce qui effrayait Liss en Hitler, c'était cet inconcevable assemblage d'éléments opposés : il était le chef de tous les maîtres, le grand mécanicien, investi d'une cruauté mathématique supérieure à celle de tous ses compagnons les plus proches pris ensemble. Mais, en même temps, il avait cette frénésie du dogme, cette foi fanatique et aveugle, cet illogisme bovin que Liss n'avait rencontré qu'aux étages les plus bas, quasi souterrains, de la direction du parti. Créateur de la baguette magique, premier entre les prêtres, il était en même temps un fidèle obscur et frénétique.
Et voilà que maintenant, en regardant s'éloigner la voiture d'Eichmann, Liss s'apercevait que ce dernier lui inspirait brusquement ce sentiment terrifiant et inexplicable que n'avait provoqué jusque-là en lui qu'un seul homme au monde, le Führer du peuple allemand Adolf Hitler.
31
L'antisémitisme peut se manifester aussi bien par un mépris moqueur que par des pogromes meurtriers. Il peut prendre bien des formes : idéologique, interne, caché, historique, quotidien, physiologique; divers aussi sont ses aspects : individuel, social étatique.
L'antisémitisme se rencontre aussi bien sur un marché qu'au Praesidium de l'Académie des sciences, dans l'âme d'un vieillard que dans les jeux d'enfants. L'antisémitisme est passé sans dommage pour lui de l'époque de la lampe à huile, de la navigation à voile et des quenouilles à l'époque des réacteurs, des piles atomiques et des ordinateurs. L'antisémitisme n'est jamais un but, il n'est qu'un moyen, il est la mesure des contradictions sans issues. L'antisémitisme est le miroir des défauts d'un homme pris individuellement, des sociétés civiles, des systèmes étatiques. Dis-moi ce dont tu accuses les Juifs et je te dirai ce dont tu es, toi-même, coupable. La haine contre le servage dans sa patrie se muait, même chez le détenu de Schliesselbourg, même chez ce combattant de la liberté qu'était le paysan Oleinitchouk, en haine contre les Polacks et les Youpins. Et même le génie qu'était Dostoïevski a vu un usurier juif là où il aurait dû voir l'impitoyable entrepreneur, le propriétaire de serfs et le capitaine d'industrie russes.
Le national-socialisme, quand il prêtait à un peuple juif qu'il avait lui-même inventé des traits comme le racisme, la volonté de dominer le monde, l'indifférence cosmopolite pour sa patrie allemande, a doté les Juifs de ses propres caractéristiques. Mais ce n'est là qu'un des aspects de l'antisémitisme.
L'antisémitisme est l'expression du manque de talent, de l'incapacité de vaincre dans une lutte à armes égales; cela joue dans tous les domaines, dans les sciences comme dans le commerce, dans l'artisanat comme en peinture. L'antisémitisme est la mesure du manque de talent dans l'homme. Les Etats cherchent des explications à leurs échecs dans les menées de la juiverie internationale. Mais ce n'est là qu'un des aspects de l'antisémitisme.
L'antisémitisme est aussi une manifestation de l'absence de culture dans les masses populaires, incapables d'analyser les causes de leurs souffrances. Les hommes incultes voient les causes de leurs malheurs dans les Juifs et non dans l'ordre social et étatique. Mais cet antisémitisme des masses n'est qu'un de ses aspects.
L'antisémitisme est la mesure des préjugés religieux qui couvent dans les bas-fonds de la société. Mais cela aussi n'est qu'un des aspects de l'antisémitisme.
L'aversion pour l'aspect extérieur du Juif, pour sa manière de parler, sa façon de se nourrir, n'est pas, bien évidemment, la cause réelle de l'antisémitisme physiologique.
(...)
L’antisémitisme tient une place à part parmi les persécutions que subissent les minorités nationales. C’est un phénomène particulier parce que la destinée historique des Juifs a été particulière.
De même que l’ombre d’un homme nous donne une idée de ce qu’il est, de même l’antisémitisme nous donne une idée sur les chemins et la destinée historiques des Juifs. L’histoire du peuple juif s’est trouvée liée et mêlée à bien des problèmes politiques et religieux à travers le monde. Cela est le premier trait distinctif de la minorité nationale juive. Les Juifs habitent dans pratiquement tous les pays du monde. Une telle dispersion d’une minorité nationale dans les deux hémisphères constitue un deuxième trait distinctif des Juifs.
Au moment de l’apogée du capital marchand, des marchands et usuriers juifs firent leur apparition. À l’époque du plein développement de l’industrie, de nombreux Juifs se révélèrent dans les domaines techniques et industriels. À l’ère atomique, plus d’un Juif travaille dans le domaine de la physique nucléaire. Lors de luttes révolutionnaires, de nombreux Juifs furent d’éminents révolutionnaires. Les Juifs constituent une minorité nationale qui ne se marginalise pas mais s’efforce de jouer son rôle au centre du développement des forces idéologiques et productives. C’est là le troisième trait distinctif de la minorité nationale juive.
Une partie de la minorité juive s’assimile, elle se dissout dans la population autochtone, mais la base populaire conserve ses traits nationaux dans sa langue, sa religion, ses formes de vie. L’antisémitisme a adopté pour règle d’accuser les Juifs assimilés de projets nationalistes et religieux secrets. Il rend responsables les Juifs non assimilés, de petits artisans pour la plupart, de ce que font les autres Juifs, ceux qui prennent part à une activité révolutionnaire, qui dirigent l’industrie, qui créent des réacteurs nucléaires, qui siègent dans les conseils d’administration.
L’un des traits évoqués peut appartenir à telle ou telle minorité nationale, mais, me semble-t-il, seule la nation juive réunit tous ces traits.
L’antisémitisme, lui aussi, reflète ces particularités, lui aussi est lié aux grands problèmes politiques, économiques, idéologiques, religieux de l’histoire du monde. C’est une particularité funeste de l’antisémitisme dont les bûchers ont éclairé les périodes les plus terribles de l’Histoire.
Quand la Renaissance a fait irruption dans le Moyen Âge catholique, les forces obscures ont allumé les bûchers de l’Inquisition. Leurs feux n’ont pas seulement éclairé la force du mal, ils ont aussi éclairé le spectacle de sa perte.
Au XXe siècle, les formes nationales dépassées de régimes condamnés ont allumé les bûchers d’Auschwitz, les feux des fours crématoires de Treblinka et de Maïdanek. Leurs flammes ont éclairé le bref triomphe du fascisme, mais elles ont également indiqué au monde que le fascisme était condamné. Des époques historiques, mais aussi des gouvernements réactionnaires malchanceux, des particuliers qui cherchent à améliorer leur sort ont recours à l’antisémitisme pour tenter d’échapper à leur destin.
Y a-t-il eu, au cours de ces deux millénaires, des cas où la liberté, l’humanisme aient utilisé l’antisémitisme pour parvenir à leurs fins ? S’il y en a eu, je n’en ai pas eu connaissance.
L’antisémitisme quotidien est un antisémitisme qui ne fait pas couler de sang. Il atteste qu’il existe sur terre des idiots envieux et des ratés. Un antisémitisme de la société peut prendre naissance dans des pays démocratiques ; il se manifeste dans la presse, qui représente certains groupes réactionnaires, dans les agissements de ces groupes, par exemple par le boycott de la main-d’œuvre ou de la marchandise juives ; il peut se manifester dans les systèmes idéologiques des réactionnaires.
Dans les États totalitaires, où la société civile n’existe pas, l’antisémitisme ne peut être qu’étatique.
L’antisémitisme étatique est le signe que l’État cherche à s’appuyer sur les idiots, les réactionnaires, les ratés, sur la bêtise des superstitions, la vindicte des affamés. À son premier stade, cet antisémitisme est discriminatoire : l’État limite les possibilités de choix du lieu d’habitation, de la profession, il limite l’accès des Juifs aux postes élevés, à l’Université, aux titres universitaires, etc.
Puis l’antisémitisme étatique passe à l’étape de l’extermination.
À une époque où la réaction entre dans une lutte fatale pour elle contre les forces de la liberté, l’antisémitisme devient pour elle une idéologie de parti et d’État : c’est ce qui s’est passé au XXe siècle avec le fascisme. »
(...)
"Vie et Destin" se déroule donc sur plusieurs plans simultané et l'intrigue, très ramifiée, se situe à divers niveaux de la réalité. Au centre, on trouve les deux sœurs Evguénia et Lioudmila Chapochnikov, leurs destins terribles et si dissemblables.
Evguénia quitte son mari, Krymov, un vieux bolchevik, pour le colonel Novikov. Mais elle reviendra à Krymov quand celui-ci sera arrêté.
Lioudmila, elle, est mariée au physicien Strum.
Autour des deux sœurs, ce ne sont que destins tragiques, et pourtant si habituels, de Soviétiques, tous, à leur manière, fidèles au régime ou, au moins, au pays. Il y a d'abord Krymov, communiste et intellectuel, qui n'a jamais douté un seul instant du bien-fondé du socialisme soviétique. Mais il se retrouve dans les geôles de la Tchéka, où il commence à comprendre ce grand mystère de notre temps : le mécanisme psychologique des procès de Moscou. Il y a Strum, physicien, théoricien de talent qui, au moment même où il fait une découverte d'une importance capitale ouvrant à la science des perspectives insoupçonnées, voit s'abattre sur lui le fléau d'un antisémitisme que jamais il n'aurait imaginé, tant il paraît absurde dans une société qui se dit "socialiste". Il y a l'histoire de Krymov, capitulant devant la logique satanique des juges d'instruction de la Tchéka qui, à force de coups, d'humiliations, de tortures, de démagogie font de ce commissaire aux armées, si fier de sa pureté idéologique, une véritable loque. Strum, lui, résiste malgré les quolibets, la trahison de ses amis et proches collaborateurs, au danger d'être anéanti physiquement, mais, au meilleur moment de sa vie et de sa carrière, alors que, par la vertu d'un coup de téléphone de Staline, il se retrouve au sommet de la gloire, il s'écroule... Le colonel Novikov, commandant glorieux d'une division blindée, héros de la bataille de Stalingrad, va, pour sauver des hommes et du matériel, retarder l'attaque de huit minutes, ce qui lui vaudra d'être sanctionné et de frôler la mort de près... Mais il y a aussi l'histoire de traîtres resplendissants, de conformistes, de délateurs, de larbins, tels le professeur Sokolov, d'académiciens tremblant devant la loi, ou les généraux Néoudobnov et Guetmanov. .. Tout cela s'organise en un tableau précis de la société soviétique, où ceux qui survivent se cassent la tête contre le mur de la bureaucratie et de la police, tandis que l'inertie est vouée à l'emporter toujours, en bonne logique, sur le vivant....
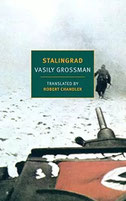
"Stalingrad" (1952)
"Vie et Destin" n’est que la deuxième moitié d’un ouvrage en deux parties, dont la première moitié a été publiée en 1952. Grossman a voulu appeler ce travail antérieur "Stalingrad", comme il le sera dans sa première traduction anglaise, mais il a été publié sous le titre de "For a Just Cause". Les personnages des deux romans sont en grande partie les mêmes, tout comme la ligne de l’histoire; "Vie et Destin" reprend là où Stalingrad se termine, fin septembre 1942. Le premier roman n’est en rien inférieur, les chapitres sur la famille Shaposhnikov sont à la fois tendres et pleins d’esprit, et les scènes de bataille, vives et émouvantes. L’un des chapitres les plus mémorables de "Vie et Destin" est la dernière lettre écrite dans un ghetto juif par la mère de Viktor Shtrum – un puissant appel pour les Juifs d’Europe de l’Est. Les paroles de cette lettre n’apparaissent pas dans "Stalingrad", pourtant la présence de la lettre y est mentionnée plusieurs fois...

"The Road: Stories, Journalism, and Essays" (1987)
"The Road" rassemble des nouvelles, des articles, des essais et des lettres de Vasily Grossman, offrant un nouvel aperçu de sa vie et de son œuvre. On y trouve cinq parties, "The 1930s", avec "In the Town of Berdichev", - un texte qui fit sa renommée, qui se déroule au moment de la guerre polono-soviétique (de février 1919 à mars 1921), une guerre menée contre la Pologne par la Russie soviétique et l’Ukraine soviétique -, "A Small Life", "A Young Woman and an Old Woman"; une seconde partie qui sous le titre de "The war, the Shoah", rassemble "The Old Man", "The Old Teacher", "The Hell of Treblinka", - le texte complet de l'article décrivant la réalité la plus terrible du fonctionnement d’un camp de la mort, en l'état, tel quel -, "The Sistine Madonna". La troisième partie, "Late Stories" compte "Mama", - histoire d'une jeune fille adoptée en pleine Grande Terreur par le chef du NKVD -, puis "The Elk", "Living Space", "The Road", "The Dog", "In Kislovodsk". La quatrième et cinquième s'intitulent respectivement "Three Letters", - dont deux lettres déchirantes que Grossman a écrites à sa mère après sa mort entre les mains des nazis et qu’il a emportées avec lui tout le reste de sa vie (" I learned about your death in the winter of 1944. I arrived in Berdichev, entered the house where you lived...") -, et "Eternal Rest", une méditation sur les cimetières et sur la relation entre les vivants et les morts....

L'Enfer de of Treblinka ...
1. "À l'est de Varsovie, le long du Bug occidental, s'étendent des sables et des marécages, ainsi que d'épaisses forêts de feuillus et de conifères. Ces endroits sont lugubres et déserts ; il y a peu de villages. Les voyageurs essaient d'éviter les routes étroites, où il est difficile de marcher et où les roues de charrette s'enfoncent jusqu'à l'essieu dans le sable profond.
C'est ici, sur la ligne secondaire de Siedlce, que se trouve la gare isolée de Treblinka. Elle se trouve à un peu plus de soixante kilomètres de Varsovie et non loin de la gare de jonction de Małkinia, où se rejoignent les lignes de Varsovie, Białystok, Siedlce et Łomza.
Beaucoup de ceux qui ont été emmenés à Treblinka en 1942 ont peut-être eu des raisons de passer par là en des temps paisibles. En contemplant abstraitement le paysage terne - des pins, du sable, du sable et encore des pins, de la bruyère et des arbustes secs, les bâtiments lugubres de la gare et les intersections de voies - les passagers gagnés par l'ennui ont pu laisser leur regard se poser un instant sur une ligne à voie unique qui partait de la gare et s'enfonçait au milieu de la dense forêt de pins qui l'entourait. Cet embranchement menait à une carrière d'où l'on extrayait du gravier pour des projets de construction industriels et municipaux.
Cette carrière se trouve à environ quatre kilomètres de la station, dans une zone sauvage entourée de pins. Le sol est pauvre et stérile, et les paysans ne le cultivent pas. C'est pourquoi la nature est restée sauvage. Le sol est en partie recouvert de mousse, avec de maigres pins ici et là. De temps en temps, un choucas passe ou une huppe fasciée aux couleurs vives. C'est dans cette misérable région sauvage qu'un fonctionnaire a choisi, avec l'approbation du Reichsführer Himmler, de construire un vaste bloc de bourreaux - un bloc de bourreaux tel que l'humanité n'en a jamais vu, depuis l'époque de la barbarie primitive jusqu'à ces jours d'une si grande cruauté. Un bloc de bourreaux, probablement, tel que l'univers entier n'en a jamais vu. C'est là que se trouvait le principal lieu d'exécution des SS, qui surpassait ceux de Sobibor, Majdanek, Bełzec et Auschwitz.
Il y avait deux camps à Treblinka : Treblinka I, un camp pénal pour les prisonniers de diverses nationalités, principalement des Polonais, et Treblinka II, le camp juif.
Treblinka I, un camp de travail ou de prisonniers, était situé à côté de la carrière, non loin de la lisière de la forêt. C'est un camp ordinaire, l'un des centaines et des milliers de camps de ce type que la Gestapo a établis dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Il est apparu en 1941. De nombreux traits du caractère allemand, déformés par le terrible miroir du régime hitlérien, s'expriment dans ce camp. Ainsi, les délires provoqués par la fièvre sont le reflet hideux et déformé de ce que le patient pensait et ressentait avant d'être malade. Ainsi, les actes et les pensées d'un fou sont le reflet déformé des actes et des pensées d'une personne normale. C'est ainsi qu'un criminel commet un acte de violence ; son coup de marteau sur l'arête du nez de sa victime exige non seulement un sang-froid inhumain, mais aussi l'œil vif et la poigne ferme d'un ouvrier de fonderie expérimenté. L'économie, la précision, le calcul et la propreté dogmatique sont des qualités communes à de nombreux Allemands, et elles ne sont pas mauvaises en soi. Elles donnent de bons résultats lorsqu'elles sont appliquées à l'agriculture ou à l'industrie. Le régime d'Hitler, cependant, a mis ces qualités au service d'un crime contre l'humanité. Dans ce camp de travail polonais, les SS agissaient comme s'ils faisaient quelque chose qui ne sortait pas plus de l'ordinaire que de cultiver des choux-fleurs ou des pommes de terre.
Le camp est aménagé en rectangles uniformes et soignés, les baraquements sont construits en rangées droites, des bouleaux bordent les chemins sablonneux. Des asters et des dahlias poussent dans le sol fertilisé. Il y a des étangs en béton pour les canards et les oies ; il y a de petits bassins, avec des marches pratiques, où le personnel peut faire sa lessive. Il y avait des services pour le personnel allemand : une excellente boulangerie, un barbier, un garage, une pompe à essence avec une boule de verre sur le dessus, des magasins. Le camp de Majdanek, à l'extérieur de Lublin, est organisé selon les mêmes principes - comme des dizaines d'autres camps de travail dans l'est de la Pologne où les SS et la Gestapo ont l'intention de s'installer pour longtemps ; on y trouve les mêmes petits jardins, les mêmes fontaines, les mêmes routes en béton. Efficacité, calcul précis, souci dogmatique de l'ordre, amour des tableaux et des plannings détaillés, toutes ces qualités allemandes se retrouvent dans l'aménagement et l'organisation de ces camps.
Les personnes étaient envoyées dans les camps de travail pour des périodes variables, parfois de quatre à six mois seulement. Il y avait des Polonais qui avaient enfreint les lois du gouvernement général - il s'agissait généralement d'infractions mineures, car les infractions majeures étaient passibles de la peine de mort immédiate. Un lapsus, une parole entendue dans la rue, une livraison non effectuée, une dénonciation au hasard, le refus de céder une charrette ou un cheval à un Allemand, l'audace d'une jeune fille de refuser les avances d'un SS, le moindre soupçon non prouvé d'être impliqué dans un acte de sabotage dans une usine, telles sont les infractions qui conduisent des milliers d'ouvriers, de paysans et d'intellectuels polonais, vieux et jeunes, mères, hommes et jeunes filles, dans ce camp de prisonniers. Au total, environ cinquante mille personnes ont franchi ses portes. Les Juifs ne se retrouvaient dans ce camp que s'ils étaient des artisans particulièrement qualifiés : boulangers, cordonniers, ébénistes, tailleurs de pierre, tailleurs. Il y avait toutes sortes d'ateliers dans le camp, dont un important atelier de fabrication de meubles qui fournissait les quartiers généraux des armées allemandes en tables, chaises à dossier droit et fauteuils.
Treblinka I a existé de l'automne 1941 au 23 juillet 1944. Lorsqu'il fut entièrement détruit, les prisonniers pouvaient déjà entendre le grondement lointain de l'artillerie soviétique. Tôt dans la matinée du 23 juillet, les SS et les Wachmänner se sont fortifiés avec un schnaps et se sont mis au travail pour effacer toute trace du camp. À la tombée de la nuit, tous les prisonniers ont été tués et enterrés. Max Levit, un charpentier de Varsovie, réussit à survivre ; il resta blessé sous les cadavres de ses camarades jusqu'à la tombée de la nuit, puis s'enfonça dans la forêt. Il nous a raconté comment, alors qu'il était allongé dans la fosse, il a entendu trente garçons du camp chanter "Broad Is My Motherland !" juste avant d'être fusillés. Il a entendu l'un d'entre eux crier : "Staline nous vengera !". Il nous a raconté comment le rouquin Leib - l'un des prisonniers les plus populaires et le chef de ce groupe de garçons - est tombé sur lui après la première salve, a levé un peu la tête et a crié : "Panie Wachman, tu ne m'as pas tué. Tirez encore, s'il vous plaît ! Tirez encore !"
Il est maintenant possible de décrire en détail le régime de ce camp de travail ; nous disposons des témoignages de dizaines de Polonais et de Polonaises qui se sont évadés ou qui ont été libérés à un moment ou à un autre. Nous connaissons le travail dans la carrière ; nous savons que ceux qui ne remplissaient pas leur quota de travail étaient jetés par-dessus le bord d'une falaise dans un abîme en contrebas. Nous connaissons la ration alimentaire quotidienne : 170 à 200 grammes de pain et un demi-litre d'une bouillie qui passait pour de la soupe. Nous connaissons les morts d'inanition, les malheureux affamés que l'on emmenait hors du camp dans des brouettes et que l'on fusillait. Nous connaissons les orgies sauvages, nous savons que les Allemands violaient les jeunes femmes et les fusillaient immédiatement après. Nous savons que des personnes ont été jetées d'une fenêtre de six mètres de haut. Nous savons qu'un groupe d'Allemands ivres prenait parfois dix ou quinze prisonniers dans une baraque la nuit et leur montrait calmement différentes méthodes de mise à mort, leur tirant dans le cœur, la nuque, les yeux, la bouche et la tempe. Nous connaissons les noms des SS du camp, nous connaissons leur caractère et leurs particularités. Nous savons que le chef du camp était un Allemand néerlandais nommé van Euppen, un meurtrier insatiable et un pervers sexuel passionné de bons chevaux et d'équitation rapide. Nous connaissons l'existence d'un énorme jeune homme nommé Stumpfe qui éclatait d'un rire incontrôlable chaque fois qu'il assassinait un prisonnier ou qu'un prisonnier était exécuté en sa présence. Il était connu sous le nom de "Mort qui rit". La dernière personne à l'avoir entendu rire fut Max Levit, le 23 juillet de cette année, lorsque trente garçons furent fusillés sur les ordres de Stumpfe et que Levit gisait au fond de la fosse. Nous connaissons Svidersky, un Allemand borgne d'Odessa connu sous le nom de "Maître Marteau" en raison de son expertise suprême en matière de "meurtre à froid", c'est-à-dire de meurtre sans arme à feu. Il lui suffit de quelques minutes - sans autre arme qu'un marteau - pour tuer quinze enfants, âgés de huit à treize ans, déclarés inaptes au travail. On connaît Preifi, un SS maigre qui ressemblait à un gitan et dont le surnom était "le Vieux". Il était maussade et taciturne. Il soulageait sa mélancolie en s'asseyant sur la décharge du camp et en attendant qu'un prisonnier se faufile à la recherche d'épluchures de pommes de terre ; il tirait alors une balle dans la bouche du prisonnier, après l'avoir forcé à garder la bouche ouverte. Nous connaissons les noms des tueurs professionnels Schwarz et Ledeke. Ils s'amusaient à tirer sur les prisonniers qui rentraient du travail au crépuscule. Ils en tuaient vingt, trente, quarante chaque soir. Aucun de ces êtres n'était humain. Leurs cerveaux, leurs cœurs et leurs âmes déformés, leurs paroles, leurs actes et leurs habitudes étaient comme une caricature - une terrible caricature des qualités, des pensées, des sentiments, des habitudes et des actes d'Allemands normaux. L'ordre du camp, la documentation des meurtres, l'amour des farces monstrueuses qui rappellent les plaisanteries d'étudiants allemands ivres, les chansons sentimentales que les gardiens chantaient à l'unisson au milieu des mares de sang, les discours qu'ils prononçaient constamment à leurs victimes, les exhortations et les paroles pieuses imprimées proprement sur des morceaux de papier spéciaux - tous ces dragons et reptiles monstrueux étaient la progéniture du chauvinisme allemand traditionnel.
Ils étaient nés de l'arrogance, de la vanité et de l'égoïsme, d'une obsession pédante pour son propre petit nid, d'une indifférence farouche au sort de tout ce qui vit, d'une conviction féroce et aveugle que la science, la musique, la poésie, la langue, les pelouses, les toilettes, le ciel, la bière et les maisons allemandes étaient ce qu'il y avait de mieux dans l'univers tout entier. Les vices et les crimes de ces gens sont nés des vices du caractère national allemand et de l'État allemand.
Telle était la vie dans ce camp, qui ressemblait à un Majdanek de moindre importance, et l'on aurait pu penser que rien au monde ne pouvait être plus terrible.
Mais ceux qui vivaient à Treblinka I savaient bien qu'il y avait en effet quelque chose de plus terrible - cent fois plus terrible - que ce camp. En mai 1942, à trois kilomètres du camp de travail, les Allemands avaient commencé la construction d'un camp juif, un camp qui était en fait un vaste bloc de bourreaux. La construction s'est déroulée rapidement, avec plus d'un millier d'ouvriers. Dans ce camp, rien n'est adapté à la vie, tout est adapté à la mort. Himmler voulait que l'existence de ce camp reste un profond secret ; pas une seule personne ne devait en sortir vivante. Et personne, pas même un maréchal, n'était autorisé à s'en approcher. Toute personne s'approchant à moins d'un kilomètre du camp est fusillée sans sommation. Les avions allemands n'ont pas le droit de survoler la zone. Les victimes amenées en train par l'embranchement du village de Treblinka ne savent qu'au dernier moment ce qui les attend.
Les gardes qui avaient accompagné les prisonniers pendant le voyage n'étaient pas autorisés à entrer dans le camp, ni même à franchir son périmètre extérieur. À l'arrivée des trains, des SS remplacent les anciens gardiens. Les trains, généralement composés de soixante wagons de marchandises, sont divisés en trois parties pendant qu'ils sont encore dans la forêt, et la locomotive pousse vingt wagons à la fois jusqu'à la plate-forme du camp. La locomotive poussait toujours par l'arrière et s'arrêtait près de la clôture, de sorte que ni le conducteur ni le pompier ne franchissaient jamais les limites du camp. Une fois les wagons déchargés, l'Unteroffizier SS de service fait signe aux vingt wagons suivants, qui attendent deux cents mètres plus loin. Lorsque les soixante wagons ont été entièrement déchargés, la Kommandantur du camp téléphone à la gare pour dire qu'ils sont prêts pour le transport suivant. Le train vide se rendait ensuite à la carrière, où les wagons étaient chargés de gravier avant de retourner à Treblinka, puis à Małkinia.
Treblinka était bien situé ; il était possible de faire venir des transports des quatre points cardinaux : le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les trains venaient des villes polonaises de Varsovie, Międzyrzecze, Częstochowa, Siedlce et Radom, de Łomza, Białystok, Grodno et d'autres villes biélorusses, d'Allemagne, de Tchécoslovaquie et d'Autriche, ainsi que de Bulgarie et de Bessarabie. Chaque jour, pendant treize mois, les trains amènent des personnes au camp. Dans chaque train, il y avait soixante wagons, et un nombre inscrit à la craie sur le côté de chaque wagon - 150, 180, 200 - indiquait le nombre de personnes à l'intérieur...."
(A ne JAMAIS oublier...)
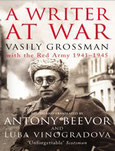
"A Writer at War : Vasily Grossman with the Red Army" (2005)
Édité et traduit pour la première fois en anglais par Antony Beevor et Luba Vinogradova Knopf. Lorsque les Allemands ont envahi la Russie en 1941, Vasily Grossman est devenu correspondant spécial pour l’Étoile rouge, le journal de l’Armée rouge. "A Writer at War" est basé sur les carnets dans lesquels Grossman a rassemblé la matière première pour ses articles. Il y décrit les conditions écrasantes du front de l’Est, la vie et la mort de soldats et de civils, et comprend certains des premiers reportages sur l’Holocauste. Dans les trois années qu’il a passées en mission, Grossman a assisté à certains des combats les plus sauvages de la guerre : les défaites effroyables de l’Armée rouge, les combats de rue à Stalingrad, la bataille de Koursk (le plus grand engagement de chars de l’histoire), la défense de Moscou, les batailles en Ukraine, et bien plus encore. L’historien Antony Beevor a pris ces carnets bruts et les a ordonnés en un récit fournissant l’une des descriptions les plus impartiales que nous ayons jamais eues de ce qu’il a appelé « la vérité impitoyable de la guerre » (the ruthless truth of war) ...

"Tout passe" (Everything Flows, Forever Flowing)
Ecrit entre 1955 et 1963, publié d`abord en Occident (1970) puis, grâce à la levée de la censure en U.R.S.S., en 1989, bien que défini comme un roman, il s'agit bien plus d`une succession de nouvelles relativement autonomes ou de réflexions directes de Vassili Grossman ayant pour thème principal le stalinisme et l`histoire de la Russie. Lors de la libération des prisonniers des camps staliniens, le héros, Igor Grigorievitch, rentre à Moscou après des décennies de détention. Il se rend d`abord chez son cousin, un scientifique choyé par le régime. Il gagne ensuite sa ville natale, Leningrad, où vit encore la femme qu`il aimait et qui l`a abandonné dans le malheur; il y rencontre l`homme responsable de son arrestation. Incapable de rentrer dans le monde d`autrefois, Igor Grigorievitch quitte tout et s`arrête dans une petite ville de province, où il trouve un travail de comptable dans un atelier d`invalides. ll loue un "coin" chez une veuve de guerre, Anna Sergueïevna. Mais à peine ont-ils le temps de comprendre qu`ils s`aiment qu`Anna Sergueïevna meurt d`un cancer. On le voit : il s`agit là d`un simple canevas.
L`intérêt du livre est fait avant tout des récits des personnages comme celui d`Anna Sergueïevna, qui relate la terrible famine de 1933 en Ukraine, au cours de laquelle tout son village a péri. Mais il y a aussi des "nouvelles indépendantes", incluses dans le cours de l`histoire : une famille morte de faim, une jeune femme arrachée à son enfant, envoyée en camp, prise par le chef du camp et libérée par la mort; le fanatique de la révolution, qui a sacrifié père et mère, et qui périt dans un camp, etc.
En fait, tous ces épisodes sont réunis par la réflexion de l'auteur qui cherche à déterminer la source de toutes ces souffrances. Dans des pages pénétrantes, Vassili Grossman montre comment l'idéal communiste, malgré toute sa beauté et son attrait, a ignoré une chose essentielle : la liberté de l`homme. C'est pour cette raison que des aspects secondaires (l'idéalisme des premiers bolcheviks, les traits humains de Lénine) ont eu vite fait de disparaitre et que n'est resté que l'essentiel : l'Etat-Léviathan. Vassili Grossman y voit une logique de l`histoire russe, qui, à l`inverse de l'histoire des pays occidentaux, a connu un asservissement toujours plus fort des individus. Mais il n`en tombe pas pour autant dans un pessimisme absolu, où l`histoire ne serait plus qu'un chaos de violences absurdes, car il place au centre de sa réflexion la bonté irréductible de l`homme.
Ce livre constitue une des descriptions les plus impitoyables du régime soviétique, - chaque personnage tente de plaider sa cause -, et une des réflexions les plus profondes sur sa nature. L`auteur a su trouver une forme inhabituelle, entre roman et essai, qui s'est révélée être la plus adéquate à son propos. (Trad. Stock, 1972).
(..) "C’était étrange. Quand Ivan Grigoryevich se souvenait de l’année 1937, et des femmes qui avaient été condamnées à des travaux forcés à cause de leurs maris; quand il se rappelait le récit d’Anna Sergeyevna sur la collectivisation totale et la famine dans la campagne ukrainienne; quand il pensait aux lois selon lesquelles les travailleurs ont été envoyés en prison pour s'être rendu au travail avec vingt minutes de retard et des paysans condamnés à huit ans dans les camps pour avoir caché quelques grains de blé; quand Ivan Grigoryevich a réfléchi à ces choses, ce n’était pas un homme avec une moustache, ni un homme portant une tunique militaire et des bottes, qu’il voyait dans son esprit. Non, ce n’était pas Staline qu’il voyait dans son esprit, mais Lénine. C’était comme si la vie de Lénine n’avait pas pris fin le 21 janvier 1924.
De temps en temps, Ivan Grigoryevich écrivait ses pensées sur Lénine et Staline dans un livre d’exercices scolaires laissé par Alyosha. Toutes les victoires du Parti et de l’État étaient associées au nom de Lénine. Mais Lénine semblait aussi responsable de toutes les terribles cruautés qui avaient été commises dans le pays. Les tragédies de la campagne, l’année 1937, la nouvelle bureaucratie, la nouvelle bourgeoisie, le travail forcé, tout cela trouve sa justification dans la passion révolutionnaire de Lénine, dans les discours, les articles et les appels de Lénine.
Et peu à peu, au fil des ans, les traits de Lénine ont changé. L’image du jeune étudiant appelé Volodya Oulianov, du jeune marxiste qui s’appelait Tulin, de l’exil sibérien, de l’émigré révolutionnaire, de l’écrivain politique et penseur appelé Vladimir Ilitch Lénine; l’image de l’homme qui avait proclamé l’ère de la révolution socialiste mondiale; l’image du créateur d’une dictature révolutionnaire en Russie, l’homme qui avait liquidé tous les partis révolutionnaires en Russie, sauf celui qui lui semblait le plus révolutionnaire de tous; l’image de l’homme qui avait dissous l’Assemblée constituante, qui représentait toutes les classes et tous les partis de la Russie postrévolutionnaire, et qui avait créé des soviets où seuls les ouvriers et les paysans révolutionnaires devaient être représentés, cette image a changé. Les traits familiers des portraits ont changé; l’image du premier chef d’État soviétique a changé.
Le travail de Lénine se poursuivit, et comme il acquit de nouvelles caractéristiques, l’image de Lénine mort acquit de nouvelles caractéristiques.
Lénine était un intellectuel. Sa famille appartenait à l’intelligentsia ouvrière. Ses frères et sœurs appartenaient au mouvement révolutionnaire. Son frère aîné, Alexandre, est devenu un héros et un saint martyr de la Révolution. Les auteurs des mémoires disent tous que, même en tant que chef de la Révolution, en tant que créateur du Parti, en tant que chef du gouvernement soviétique, il est resté quelqu’un de modeste et de simple. Il ne fumait ni ne buvait et, selon toute probabilité, il n’a jamais, de sa vie, maudit et juré sur quelqu’un dans un langage vraiment grossier. Il y avait une pureté d’étudiant sur son idée des loisirs : la musique, le théâtre, les livres, les promenades. Il s’habillait toujours démocratiquement, presque comme s’il était pauvre. La petite Volodya tant aimée par sa mère et ses sœurs, le jeune homme qui écoutait l’Appassionata et lisait et relisait Guerre et Paix, le jeune homme qui portait une cravate froissée et une vieille veste et qui était assis dans la galerie du théâtre — est-ce vraiment l’homme qui a fondé un État qui a choisi d’orner les coffres de Yagoda, Yezhov, Beria, Merkulov et Abakumov de son plus grand honneur, avec son propre ordre de Lénine? À l’anniversaire de la mort de Lénine, l’ordre de Lénine a été décerné à Lydia Timashuk. Était-ce une indication que la cause de Lénine avait séché et flétri, ou qu’elle triomphait vraiment?
Les plans quinquennaux ont passé. Les décennies ont passé. Les événements d’immédiateté incandescente ont refroidi et durci. Enfermés dans le ciment du temps, ils se sont transformés en grandes dalles, dans l’histoire de l’État soviétique.
(...)
Les auteurs des mémoires ne disent rien sur l’aspect du caractère de Lénine qui l’a amené à ordonner une fouille de l’appartement de Georgy Plekhanov alors qu’il était mourant, mais c’est cet aspect du caractère de Lénine — l’aspect qui a déterminé son intolérance totale à la démocratie politique — qui s’est avéré dominant.
(...)
Tout au long de son histoire, le mouvement révolutionnaire russe y a inclus les qualités les plus contradictoires. L’amour authentique pour le peuple que l’on retrouve chez de nombreux révolutionnaires russes — des hommes dont la douceur et la disponibilité à endurer la souffrance n’ont été vues que chez les premiers chrétiens — coexistait avec un mépris féroce de la souffrance humaine, une vénération extrême des principes abstraits, et une implacable détermination à détruire non seulement ses ennemis mais aussi ses compagnons d’armes, si leur interprétation de ces principes diffère le moins du monde de la sienne. Cette unicité sectaire, cette disposition à réprimer la liberté de vivre d’aujourd’hui au nom d’une hypothétique liberté future, à transgresser la moralité ordinaire et quotidienne au nom d’un principe futur — tout cela se trouve dans Pestel, dans Bakounine et Nechaev, et dans certains de ce qui a été dit et fait par les membres de la Volonté du Peuple.
Non, ce n’était pas seulement l’amour, ni seulement la compassion qui a conduit ces gens sur le chemin de la révolution. Pour trouver ce qui a engendré ces gens, il faut regarder loin dans les profondeurs millénaires de l’histoire russe.
Des figures similaires existaient dans les siècles précédents, mais c’est le XXe siècle qui les a sortis des ailes et les a placés au centre de la scène.
Ce genre de personne est comme un chirurgien dans un hôpital. Son intérêt pour les patients et leur famille, ses blagues, les arguments auxquels il participe, ses luttes pour les enfants sans abri et son souci pour les travailleurs qui ont atteint l’âge de la retraite — tout cela est sans importance, insignifiant, une simple enveloppe. Son âme est dans le couteau de son chirurgien.
Le plus important chez cet homme est sa foi fanatique dans la toute-puissance du couteau du chirurgien. C’est le couteau du chirurgien qui est le véritable théoricien du XXe siècle, son plus grand chef philosophique.
Pendant les cinquante-quatre années de sa vie, Lénine ne se contenta pas d’écouter l’Appassionata, de relire Guerre et Paix, d’avoir des entretiens à cœur avec les délégués paysans, d’admirer le paysage russe et de s’inquiéter de savoir si son secrétaire avait un bon manteau d’hiver. Cela va de soi; il ne faut pas s’étonner que Lénine ait un vrai visage, pas seulement une image.
Et on peut imaginer que Lénine exprime un certain nombre de traits de caractère et de particularités différents dans sa vie quotidienne — dans cette vie quotidienne que nous menons tous inévitablement, que nous soyons dentistes, dirigeants de nations ou tailleurs dans un atelier de vêtements pour femmes.
Ces traits peuvent se manifester à tout moment de la nuit ou du jour, comme un homme se lave le visage le matin, comme il mange son porridge, comme il regarde par la fenêtre à une jolie femme dont la jupe a été attrapée par le vent, comme il utilise une allumette pour choisir ses dents, comme il se sent jaloux de sa femme ou essaie de la rendre jalouse de lui, comme il regarde ses jambes nues dans le bain et se gratte les aisselles, comme il lit des bouts de journaux dans les toilettes, en essayant de découper une page déchirée ensemble, Il pète et essaie de masquer le son en toussant ou en fredonnant.
De tels moments se produisent dans la vie des grands et des petits, et ils peuvent, bien sûr, être trouvés dans la vie de Lénine.
Peut-être que Lénine a développé une pause parce qu’il a mangé trop de macaroni et de beurre, préférant cela aux légumes.
Peut-être que lui et sa femme ont eu des disputes, inconnues du monde, sur la fréquence à laquelle il se lavait les pieds ou se brossait les dents, ou sur sa réticence à changer une chemise usée avec un col sale.
Et il peut en effet être possible de percer les fortifications entourant une image prétendument humaine mais en réalité irréelle et exaltée du chef. Il peut être possible, en rampant silencieusement sur votre estomac ou avec des élans rapides et soudains, d’atteindre un vrai, authentique Lénine qu’aucun mémorialiste n’a décrit.
Mais que gagnerions-nous à connaître la vérité cachée du comportement de Lénine dans la salle de bain, la chambre ou la salle à manger? Cela nous aiderait-il à mieux comprendre Lénine, le chef de la nouvelle Russie, le fondateur d’un nouvel ordre mondial ? Pourrions-nous trouver une corrélation réelle entre la vraie nature de Lénine et la nature de l’État qu’il a fondé ? Pour établir une telle corrélation, il faudrait supposer que Lénine s’est comporté de la même manière qu’un dirigeant politique dans sa vie quotidienne. Cette hypothèse, cependant, serait arbitraire et erronée; après tout, de telles corrélations sont aussi susceptibles d’être inverses que directes — les gens se comportent différemment dans différentes sphères de leur vie.
(...)
L’intolérance de Lénine, sa volonté inébranlable d’atteindre son but, son mépris pour la liberté, sa brutalité envers ceux qui ne partageaient pas ses vues, sa volonté inébranlable d’effacer la surface de la terre non seulement des forteresses mais aussi des quartiers entiers, les régions et les provinces qui ont contesté sa vision de la vérité — tout cela faisait partie de Lénine bien avant octobre. Tout cela était profondément enraciné; tous ces aspects du caractère et du comportement de Lénine étaient présents dans la jeune Volodya Oulianov.
Toutes ses capacités, toute sa volonté et sa passion étaient orientées vers une seule fin : la prise du pouvoir. À cette fin, il a tout sacrifié. Pour prendre le pouvoir, il a sacrifié ce qui était le plus saint en Russie : sa liberté. Cette liberté était puérilement impuissante, inexpérimentée et naïve. Comment ce bébé de huit mois, né dans un pays aux mille ans d’esclavage, a-t-il pu acquérir de l’expérience?
Le côté cultivé et intellectuel de Lénine — qui semblait autrefois ce qu’il y avait de plus profond et de plus vrai chez lui — se retirait toujours à l’arrière-plan dès que la situation devenait difficile. Le vrai caractère de Lénine se manifestait alors dans sa volonté de fer, dans sa force de volonté frénétique et inflexible.
Qu’est-ce qui a conduit Lénine sur la voie de la révolution? L’amour pour les gens? Une volonté de mettre fin à la misère de la paysannerie, à la pauvreté ouvrière et au manque de droits ? Une foi dans la vérité du marxisme, dans la rectitude de son propre parti ?
La révolution russe, pour lui, n’avait rien à voir avec la liberté russe. Mais le pouvoir auquel il aspirait si passionnément n’était pas quelque chose dont il avait personnellement besoin.
Et nous arrivons ici à quelque chose d’unique chez Lénine : la simplicité de son caractère a engendré une certaine complexité.
Pour aspirer si ardemment au pouvoir, il faut être doté d’une énorme ambition politique. Cet amour du pouvoir est quelque chose de brut et de simple. Mais ce personnage déterminé, qui était capable de tout dans sa poursuite du pouvoir, était modeste dans sa vie privée et ne cherchait pas le pouvoir pour lui-même. C’est à ce moment que la simplicité de Lénine se termine et que sa complexité commence.
Si nous essayons d’imaginer un Lénine privé qui est un équivalent exact du Lénine politique, nous serons confrontés à un dogmatiste cinglant — quelqu’un de dur et primitif, autoritaire, impitoyable, incroyablement ambitieux.
(...)
Lénine... Il y a d’abord l’image déifiée. Ensuite, il y a l’image créée par ses ennemis — une image toute d’une pièce, une image qui le fait se comporter aussi durement et cruellement dans sa vie quotidienne que dans son rôle de leader du nouvel ordre mondial. Enfin, il y a une troisième image, une image qui me semble plus proche de la réalité, mais qui n’est pas facile à comprendre.
Dans son ascétisme et sa modestie naturelle, Lénine avait une affinité avec les pèlerins russes. Dans sa foi et sa franchise, il répondait à l’idéal populaire d’un enseignant religieux. Dans son attachement à la nature russe, à ses forêts et ses prairies, il était semblable à la paysannerie russe. Sa réceptivité à Hegel et Marx et à la pensée occidentale dans son ensemble, sa capacité à absorber et à exprimer l’esprit de l’Occident, était la manifestation d’un trait profondément russe d’abord souligné par Chaadaev. C’est la même sympathie universelle, la même capacité étonnante d’entrer profondément dans l’esprit d’une autre nation, que Dostoïevski a connue à Pouchkine. Cette réceptivité rend Lénine semblable à Pouchkine et à Pierre le Grand.
Le fanatique de Lénine, la qualité possédée est semblable à la foi religieuse, la frénésie religieuse d’Avvakum. Et Avvakum est un phénomène russe entièrement natif.
Au XIXe siècle, les penseurs russes se sont tournés vers le caractère national russe, l’âme russe et la nature religieuse russe pour une explication du chemin historique de la Russie.
Chaadaev, l’une des figures les plus intelligentes de ce siècle, a souligné la qualité ascétique et sacrificielle du christianisme russe, sa pureté byzantine non diluée.
Dostoïevski voyait l’universalité, une aspiration à l’humanité universelle, comme le véritable fondement de l’âme russe.
La Russie du XXe siècle aime répéter les prédictions faites à ce sujet par les penseurs et prophètes russes précédents : Gogol, Chaadaev, Belinsky, Dostoïevski.
Mais qui ne voudrait pas répéter de telles choses sur lui-même?
Les prophètes du dix-neuvième siècle ont prédit que la Russie dirigerait à l’avenir l’évolution spirituelle non seulement de l’Europe, mais aussi du monde entier.
Ces pronostiqueurs ne parlaient pas de la gloire militaire russe, mais de la gloire du cœur russe, de la foi russe, de l’exemple que la Russie donnerait.
(...)
La suppression implacable de la personnalité individuelle — sa soumission totale et servile au souverain et à l’État — a été une constante de l’histoire russe. Cela aussi a été vu et reconnu par les prophètes russes. Mais avec la suppression de l’individu par le prince, le propriétaire foncier, le souverain et l’État, les prophètes russes ont senti une pureté, une profondeur et une clarté inconnues du monde occidental. Ils ont vu une puissance semblable à Christ — la puissance de l’âme russe — et ils ont prophétisé un grand et brillant avenir pour cette âme. Ces prophètes ont tous convenu que l’idéal chrétien avait été incarné dans l’âme russe dans un ascète, D’une manière byzantine, antioccidentale — d’une manière assez indépendante de l’État — et que les forces inhérentes à l’âme russe se manifesteraient comme une puissante influence sur les peuples d’Europe. Ils croyaient que ces forces purifieraient et transformeraient la vie du monde occidental, l’éclairant dans un esprit de fraternité, et que le monde occidental suivrait avec joie et confiance cet homme russe si universel dans son humanité. Ces prophéties des esprits et des cœurs les plus puissants de la Russie avaient un défaut fatal en commun. Ils ont tous vu la puissance de l’âme russe et sa signification pour le monde, mais ils ont tous échoué à voir que cette âme avait été un esclave pendant mille ans, que ses particularités avaient été engendrées par l’absence de liberté. Quel que soit votre pouvoir, que pouvez-vous donner au monde si vous êtes esclave depuis mille ans ?
Le XIXe siècle, cependant, semblait enfin avoir rapproché le temps prédit par les prophètes russes, le temps où la Russie, toujours si réceptive à d’autres enseignements et d’autres exemples, toujours si avide d’absorber d’autres influences spirituelles, se préparait à agir sur le monde.
Pendant cent ans, la Russie avait bu dans une idée empruntée de liberté. Pendant cent ans, à travers les lèvres de Pestel, Ryleyev, Herzen, Chernyshevsky, Lavrov, Bakounine; à travers les lèvres de ses écrivains; à travers les lèvres de martyrs comme Zhelyabov, Sofya Perovskaya, Timofey Mikhailov et Kibalchich; à travers les lèvres de Plekhanov, Kropotkine et Mikhaïlovski; à travers les lèvres de Sazonov et de Kalyaev; à travers les lèvres de Lénine, Martov et Tchernov; à travers les lèvres de son intelligentsia sans classe; par les lèvres de ses étudiants et de ses travailleurs progressistes — depuis cent ans, la Russie s’imprègne du travail des penseurs et des philosophes de la liberté occidentale. Cette pensée était portée par les livres, par les facultés universitaires, par les jeunes hommes qui avaient étudié à Paris et à Heidelberg. Elle était portée par les bottes des soldats de Napoléon. Elle était portée par les ingénieurs et les marchands éclairés. Il a été porté par les Occidentaux pauvres qui sont venus en Russie pour travailler et dont le sens de leur propre dignité humaine innée a évoqué l’étonnement envieux des princes russes.
Et ainsi, fécondée par les idées de liberté et de dignité de l’homme, la Révolution russe a suivi son cours.
(...)
Le regard de l’esclave, le regard de la grande esclave qui cherchait, doutait, évaluait s’arrêta sur Lénine. C’est lui qu’elle choisit....

"An Armenian Sketchbook" (1965)
Peu d’écrivains ont dû affronter autant de tragédies de masse du siècle dernier que Vassily Grossman, qui a écrit avec une clarté terrifiante sur la Shoah, la bataille de Stalingrad et la famine de la terreur en Ukraine. Ce carnet de croquis arménien, cependant, nous montre un Grossman très différent, remarquable pour sa tendresse et sa chaleur. Après que le gouvernement soviétique eut confisqué — ou, comme Grossman l’a toujours dit, «emprisonné» — Vie et Destin, il se chargea de réviser une traduction russe d’un long roman arménien. Le roman ne l’intéressait guère, mais il avait besoin d’argent et était évidemment heureux d’avoir trouvé une excuse pour voyager en Arménie. Ce carnet de croquis est son récit des deux mois qu’il y a passés dans cette région, il y parle simplement de ses impressions sur ses montagnes, ses églises anciennes, son peuple, tout en examinant ses propres pensées et humeurs....
