- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee

Sylvia Plath (1932-1963), "The Colossus and Other Poems" (1960), "The Bell Jar" (La Cloche de verre, 1963), ), "Ariel" (1965), "Collected Poems" (1981) - Anne Sexton (1928-1974), "To Bedlam and Part Way Back" (1960), "All My Pretty Ones" (1962), "Live or Die" (1966), "Transformations" (1971), "The Death Notebooks" (1974) - ...
Last update : 03/03/2018

"I took a deep breath and listened to the old brag of my heart. I am, I am, I am" - Sylvia Plath se cramponne à l'existence malgré ses tourments psychologiques. - Bien qu'elle ait publié son premier recueil, "The Colossus and Other Poems", en 1960, et son roman, "The Bell Jar", juste avant sa mort, l'immense et durable renommée de Sylvia Plath allait être posthume : la publication d' "Ariel" (1965), deux ans après sa mort tragique la révéla au public comme une poétesse d'une rare intensité émotionnelle, capable de transcender la souffrance personnelle pour en faire une œuvre d'art universelle.
Ce recueil, celui de la maturité, a marqué un tournant dans la poésie moderne, et pour tout dire singulièrement dans la poésie américaine, en donnant une place centrale à l’introspection, à l'émotion brute et à la puissance de l’imaginaire : introduisant des récits plus intimistes et psychologiquement complexes. Plath y explore en effet des thèmes liés à la souffrance psychologique, la dépression, la mort, l'aliénation, la féminité et la renaissance personnelle, avec une force qui frappera le lecteur. Les poèmes tels que "Daddy", "Lady Lazarus", et "Ariel" sont devenus des classiques pour leur traitement brutal et parfois dérangeant de la douleur personnelle, tout en étant d'une grande beauté formelle. Le recueil restera une œuvre fondatrice, non seulement pour la reconnaissance de Plath comme une figure majeure de la littérature américaine, mais aussi pour son rôle dans la transformation de la poésie "confessionnelle" et féministe.
Jusque-là, elle avait survécu en tant que poète de la manière la plus singulière qui soit, une voix poétique unique qui portait en elle quelque chose qui n'était pas encore apparu aussi radical, à savoir l'expérience d'être une femme. Plath écrivit sur le genre, la maternité et le mariage, la trahison et la maladie qui mène au suicide, dans des poèmes illuminés par l'amour et la fureur. Elle avait été influencée par le système américain des ateliers de création littéraire 'the American creative writing workshop system) et par des "poètes de la confession" (Confessional poets) tels que Robert Lowell et Anne Sexton. Elle fut alors reconnue comme une figure féministe dans la littérature, ouvrant la voie à une plus grande reconnaissance des expériences féminines dans un monde souvent dominé par des perspectives essentiellement masculines. Son roman "The Bell Jar" (1963), à la fois semi-autobiographique et critique sociale, raconte l’histoire d’une jeune femme aux prises avec la dépression et la pression des attentes sociétales. C’est un texte fondateur qui aborde la question de la santé mentale des femmes dans une société patriarcale, et devenu un classique féministe.
Les journaux intimes de Sylvia Plath, publiés après sa mort, ont également contribué à la compréhension de sa démarche artistique et de ses luttes personnelles. Ces journaux révélèrent le processus créatif derrière ses œuvres littéraires, tout en offrant un regard poignant sur ses souffrances intérieures. Ses écrits intimes inspirèrent ainsi de nombreuses écrivaines et écrivains à intégrer des formes de journaux personnels ou autobiographiques dans leur propre travail.
Mais plus encore, l'influence de Sylvia Plath fut considérable sur la manière dont la littérature américaine et mondiale aborde des sujets comme la santé mentale, le genre, et les relations familiales conflictuelles. Est-ce sans doute pour cela que son œuvre continue d’être étudiée, et analysée pour sa modernité et sa profondeur psychologique.
La mort tragique de Sylvia Plath par suicide en 1963, à l'âge de 30 ans, a ajouté certes une dimension tragique et emblématique à sa figure littéraire. Sa vie et son œuvre sont souvent interprétées à la lumière de son combat contre la dépression, ce qui a, d'une part, contribué à son mythe, mais a aussi, parfois, a eu tendance à réduire sa réception à une fascination pour son seul destin personnel...
Et dans cette Amérique des années 1950, se rencontrèrent Sylvia Plath et Anne Sexton, toutes deux étaient des poètes émergents et des femmes extrêmement ambitieuses, d'une immense sensibilité, exacerbée, dans un contexte culturel qui ne savait pas comment traiter les femmes ambitieuses....





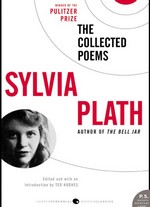
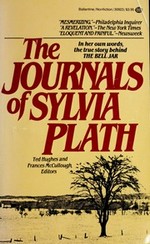

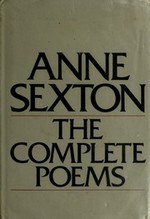

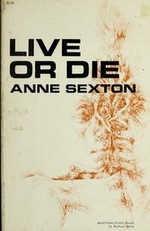
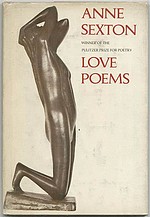

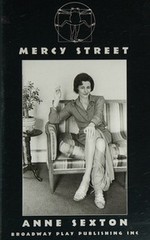

Sylvia Plath (1932-1963)
Née à à Jamaica Plain, dans la banlieue de Boston, Sylvia Plath écrit des poèmes dès son plus jeune âge et ne se remettra jamais de la mort de son père alors qu'elle n'a que huit ans. Brillante, intellectuelle remarquée,ses troubles bipolaires cohabitent avec le sentiment de ne pouvoir se réaliser pleinement dans une société par trop conformiste. En 1953, refusée à un atelier d'écriture qui lui était promis suite à un concours organisé par la revue Mademoiselle, elle sombre dans la dépression, est traitée aux électrochocs puis aux somnifères et touche le fonds de son existence. Elle épouse en 1956, en Angleterre le poète britannique Ted Hughes (1930-1998), renommé pour ses conquêtes et pour deux recueils, "Hawk in the Rain" (1957) et "Crow" (1970) qui feront de lui le plus célèbre poète britannique de l'après-guerre. Ils ont deux enfants . Après la publication de "The Colossus" (1960), le couple se sépare, Ted Hugues voit une autre femme. Sylvia Plath écrit alors, au bord de la rupture, ses plus beaux poèmes, des monologues aux images oniriques et violentes (Lady Lazarus, Daddy, The Moon and the Yew Tree, You’re, Morning Song, Poppies in October, Ariel, Edge, Waking in Winter, Crossing the Water..) : mais solitaire et si vulnérable, elle se suicide le 11 février 1963 à 32 ans dans sa demeure de Londres...

"The Bell Jar" (La Cloche de verre, 1963)
"Un mauvais rêve. Pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde lui-même n'est qu'un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Je me souvenais de tout. Je me souvenais des cadavres, de Doreen, de la parabole du figuier, du diamant de Marco, du marin sur le boulevard, de l'infirmière binoclarde du Dr Gordon, des thermomètres brisés, du Noir avec ses deux sortes de haricots, des dix kilos pris à cause de l'insuline, du rocher qui se dressait entre ciel et mer comme un gros crâne marin. Peut-être que l'oubli, comme une neige bienfaisante, allait les recouvrir et les atténuer. Mais ils faisaient partie de moi. C'était mon paysage..." - Dans ce roman d'inspiration autobiographique Sylvia Plath décrit en détail les circonstances de sa première dépression, au début de sa vie d'adulte : I was supposed to be having the time of my life... Le seul roman de Sylvia Plath fut écrit dans l'urgence, c'est celui de la quête d'un être qui tente de traduire son identité en tant que femme, à distance des conventions et des conservatismes, un des textes fondateurs du féminisme anglo-américain, a-t-on dit (la même année paraissait "The Feminine Mystique" de Betty Friedan, et "Snapshots of a Daughter-in-Law", d'Adrienne Rich), le désir de transgression, de s'ouvrir à tout vent, la mort et le sexe obsèdent chacune des pages, jusqu'à la descente en spirale, “what I’ve done is to throw together events from my own life, fictionalising to add colour – it’s a potboiler really, but I think it will show how isolated a person feels when he is suffering a breakdown… I’ve tried to picture my world and the people in it as seen through the distorting lens of a bell jar...”
"It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn’t know what I was doing in New York... C'était un été étrange et étouffant, l'été où ils ont électrocuté les Rosenberg, et je savais pas ce que je venais faire à New York. Je deviens idiote quand il y a des exécutions. L'idée de l'électrocution me rend malade, et les journaux ne parlaient que de ça. La Une en caractères gros comme des boules de loto me sautait aux yeux à chaque carrefour, à chaque bouche de métro fleurant le renfermé et les cacahuètes. Cela ne me concernait pas du tout, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander quel effet cela fait de brûler vivant tout le long de ses nerfs.
Je pensais que ce devait être la pire chose au monde.
New York était déjà assez moche comme ça. Dès neuf heures du matin la fausse fraîcheur humide et campagnarde qui s'était infiltrée on ne sait comment pendant la nuit, s'évaporait comme la fin d'un rêve agréable. D'un gris de mirage au fond de leurs canyons de granit, les rues brûlantes flottaient dans le soleil, les toits des voitures bouillaient et étincelaient, la poussière sèche et cendreuse m'emplissait les yeux et la gorge. Je continuais à entendre parler des Rosenberg à la radio et au bureau, je n'arrivais plus à me les sortir de la tête. C'était comme la première fois que j'ai vu un cadavre. Pendant des semaines, la tête du cadavre - ou plutôt ce qu'il en restait - flottait derrière les œufs au bacon de mon petit-déjeuner, derrière le visage de Buddy Willard qui était responsable en premier lieu de cette découverte. Très vite j'ai eu la sensation de trimbaler cette tête de cadavre partout avec moi, au bout d'une ficelle, comme une sorte de ballon noir sans nez, puant le vinaigre.
Je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose en moi qui ne collait pas cet été. Je ne pouvais penser qu'aux Rosenberg ou comme j'avais été idiote d'acheter tous ces vêtements inconfortables et chers qui pendaient comme des poissons morts dans mon placard, ou bien comme tous ces petits succès que j'avais accumulés joyeusement au College se réduisaient à néant devant les façades de verre ou de marbre scintillant de Madison Avenue.
J'étais censée être on ne peut plus heureuse.
J'étais censée être jalousée dans toute l'Amérique par des milliers d'autres collégiennes comme moi. Leur plus beau rêve est de se balader dans les mêmes chaussures en cuir verni, pointure 7, achetées chez Bloomingdale's à l'heure du déjeuner, avec une ceinture de cuir noir verni et un sac en cuir noir verni assorti. Lorsque le magazine pour lequel nous étions en train de travailler toutes les douze a publié ma photo - buvant un martini dans un corsage étriqué en simili lamé argent, planté sur un gros nuage dodu de tulle blanc, dans un jardin suspendu, entourée de jeunes gens anonymes à l'allure typiquement américaine, prêtés ou loués pour l'occasion - tout le monde a dû penser que j'étais prise dans un véritable tourbillon. Il y en aurait pour dire: "Regardez ce qui arrive dans ce pays. Une fille vit pendant dix-neuf ans dans une ville perdue, elle est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas se payer un magazine, et puis elle reçoit une bourse pour aller au College, elle gagne un prix ici, remporte un concours là, et la voilà aux commandes de New York, comme s'il s'agissait de sa propre voiture." Seulement, je ne contrôlais rien du tout Je ne me contrôlais même pas moi-même. Je ne faisais que cahoter comme un trolleybus engourdi, de mon hôtel au bureau, du bureau à des soirées, puis des soirées à l'hôtel et de nouveau au bureau. Je suppose que j'aurais dû être emballée comme les autres filles, mais je n'arrivais même pas à réagir. Je me sentais très calme, très vide, comme doit se sentir l'oeil d'une tornade qui se déplace tristement au milieu du chaos généralisé...
"..Je n'acceptais pas l'idée que la femme soit condamnée à vivre une vie chaste alors qu'il serait permis à l'homme de mener une double vie, l'une pure et l'autre pas. Finalement je me suis dit que puisqu'il était si difficile de trouver un homme intelligent, vigoureux et encore vierge à vingt et un ans, alors, autant oublier tout de suite l'idée de rester vierge moi-même et épouser quelqu'un qui ne l'était plus non plus. Comme ça, quand il commencerait à me faire la vie dure, je pourrais lui rendre la pareille. Quand j'avais dix-neuf ans, la virginité était une chose importante. Au lieu que le monde soit divisé entre catholiques et protestants, entre démocrates et républicains, entre Blancs et Noirs, ou même entre hommes et femmes, je le voyais divisé entre les gens qui avaient couché avec quelqu'un et ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Cela me semblait la seule différence fondamentale qui distingue les gens les uns des autres.
Je pensais que des changements spectaculaires allaient se produire le jour où je franchirais la barrière...
Je croyais que je me sentirais comme ça, si jamais je visitais l'Europe. Je rentrerais chez moi et, en scrutant tout près dans le miroir, je pourrais distinguer des petites Alpes blanches au fond de mes yeux. Alors, je pensais que si demain, je me regardais dans une glace, je verrais un petit Constantin de la taille d'une poupée, assis dans mon œil et qui me sourirait. Nous avons flemmardé sur le balcon pendant environ une heure, allongés dans les deux chaises longues avec le Victrola qui tournait, une pile de disques de balalaïka entre nous. Il y avait une vague lueur provenant des lampadaires, de la demi-lune, des voitures ou des étoiles, je n”aurais su dire, mais si ce n'est qu'il me tenait la main, Constantin ne montrait aucune velléité de me séduire. Je lui ai demandé s'il était fiancé, s'il avait une petite amie, que sais-je... Je pensais que peut-être c'était ça la cause du problème, mais il me répondit que non, il était fier d'être libre.
Finalement, j'ai senti une profonde lassitude couler dans mes veines, à cause de tout le vin d'écorce de pin que j'avais bu.
- Je crois que je vais m'allonger un moment.
Je me suis négligemment rendue dans la chambre à coucher et je me suis penchée pour défaire mes chaussures, le lit tout propre se balançait devant moi comme un canot de sauvetage. Je me suis complètement allongée et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu Constantin soupirer et quitter le balcon. L'une après l'autre ses chaussures sont tombées par terre et il s'est allongé à coté de moi. Je le regardais secrètement à travers une mèche de cheveux. Il était allongé sur le dos, les mains sous la nuque, fixant le plafond. Les manches amidonnées de sa chemise blanche étaient remontées jusqu'aux coudes, elles scintillaient mystérieusement dans la pénombre et sa peau bronzée paraissait presque noire. J'ai pensé que c'était le plus bel homme que j'aie jamais vu. Je me disais que si seulement j'avais un visage plus vif, plus harmonieux, si seulement je savais discuter politique avec perspicacité, si seulement j'étais une femme de lettres célèbre... sûrement Constantin me trouverait suffisamment passionnante pour coucher avec moi.
Et puis, je me suis demandé si une fois qu'il m'aimerait il ne sombrerait pas dans l'ordinaire, si je ne lui trouverais pas alors défaut après défaut, comme j'avais fait pour Buddy Willard et avant lui bien d'autres. C'était toujours pareil. J'avais en mire dans le lointain l'homme idéal, mais des qu'il s'approchait, je voyais tout de suite qu'il ne ferait pas l'affaire. C'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas me marier. La dernière chose que je souhaitais, c'était bien la sécurité infinie et être l'endroit d'où part la flèche... Je voulais des changements, du nouveau, je voulais tirer moi-même dans toutes les directions, comme les fusées du 4 juillet.
Je me suis réveillée au son de la pluie.
Il faisait noir comme dans un four. Après un moment j'ai aperçu les contours flous d'une fenêtre inconnue. De temps en temps un rayon de lumière traversait l'air, traversait le mur comme un fantôme, comme un doigt explorateur et il disparaissait à nouveau dans le néant.
J'ai entendu quelqu'un respirer.
D'abord, j'ai cru que c'était moi, que j'étais couchée à l'hôtel dans l'obscurité après mon empoisonnement. J'ai retenu mon souffle, mais la respiration a continué. Un œil vert luisait faiblement à côté de moi sur le lit. Il était divisé en quarts comme les boussoles. J'ai tendu la main doucement et je l'ai saisi. Je l'ai soulevé, un bras a suivi, lourd comme un bras de cadavre, mais chaud de sommeil.
La montre de Constantin indiquait trois heures.
Il était allongé en chemise et pantalon, avec ses chaussettes, exactement comme je l'avais laissé quand je m'étais endormie. Mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai pu discerner ses paupières pâles, son nez droit, sa bouche bien dessinée et avenante, mais ils semblaient irréels, comme modelés dans le brouillard. Pendant quelques minutes je me suis penchée sur lui pour mieux l'étudier. C'était la première fois que je m'endormais à côté d'un homme. J'ai essayé d'imaginer ce que serait ma vie si Constantin était mon mari. Cela signifierait qu'il faudrait que je me lève à sept heures pour lui préparer des œufs au bacon, des toasts, du café, lambiner en chemise de nuit et bigoudis pour faire la vaisselle et le lit une fois qu'il serait parti travailler. Et quand il reviendrait après une journée dynamique et exaltante, il voudrait un bon dîner, et moi je passerais la soirée à laver d'autres assiettes sales jusqu'à ce que je m'effondre dans le lit, à bout de forces. Cela me semblait une vie triste et gâchée pour une jeune fille qui avait passé quinze ans de sa vie à ramasser des prix d'excellence... Mais je savais que c'était ça le mariage. Du matin au soir les seules occupations de Mrs Willard étaient le lavage, la cuisine et la vaisselle. Elle était femme de professeur à l'université et elle-même avait été professeur dans une école privée. Lors d'une visite rendue à Buddy, j'avais trouvé Mrs Willard tressant un plaid avec des morceaux de laine provenant de vieux costumes de Mr Willard. Elle avait passé des semaines sur ce plaid, j'avais admiré les carreaux de tweed, marron, verts et bleus qui composaient le plaid, mais une fois achevé, au lieu de l'accrocher au mur comme je pensais qu'elle allait le faire, elle l'avait jeté par terre pour remplacer le paillasson de la cuisine. En quelques jours il était souillé, terne, et il était impossible de le distinguer d'un paillasson ordinaire acheté pour moins d'un dollar dans n'importe quel bazar. Je n'ignorais pas que derrière les roses, les baisers, les soupers au restaurant que les hommes déversent sur une femme avant de l'épouser, ce qu'ils souhaitent réellement une fois la cérémonie achevée, c'est qu'elle s'écrase sous leurs pieds comme la serpillière de cuisine de Mrs Willard. Ma mère m'avait raconté que des qu'ils avaient quitté Reno pour leur lune de miel - mon père ayant déjà été marié avait dû régler son divorce - mon père lui avait dit: «Enfin! Quel soulagement! Maintenant on va cesser de jouer la comédie et enfin être nous-mêmes !» - à partir de ce jour, ma mère n'avait plus connu une minute de liberté.
Je me souvenais aussi de Buddy Willard affirmant de sa voix sinistre et assurée qu'une fois que j'aurais des enfants, je me sentirais différente, je n'aurais plus envie d'écrire des poèmes. J'ai donc commencé à croire que c'était peut-être vrai, que quand on est mariée et qu'on a des enfants, c'est comme un lavage de cerveau, après, on vit engourdie comme une esclave dans un État totalitaire.
Je regardais attentivement Constantin, comme on observe un cristal inaccessible un fond d'un puits très profond. Ses paupières se sont soulevées, il m'a regardée sans me voir, ses yeux étaient remplis d'amour. Je regardais sans dire un mot, quand au milieu de son halo de tendresse son regard m'a reconnue et ses pupilles dilatées sont redevenues brillantes et superficielles comme du cuir verni.
Constantin s'est assis et a bâillé.
- Quelle heure est-il?
- Il est trois heures, ai-je répondu d'une voix éteinte. Il vaut mieux que je rentre, je dois être au bureau à la première heure ce matin.
- Je vais te reconduire.
Pendant que dos à dos, chacun de notre côté du lit, nous bataillions pour enfiler nos chaussures sous la lumière affreusement crue et gaie de la lampe de chevet, j'ai senti que Constantin se retournait.
- Tes cheveux sont toujours comme ça?
-- Comment, comme ça?
ll n'a pas répondu, mais il a tendu la main vers les racines de mes cheveux et a laissé glisser ses doigts jusqu'au bout des mèches, comme un peigne. J'ai ressenti une décharge électrique et je suis restée sans bouger. Depuis que je suis toute petite, j'adore que quelqu'un me peigne les cheveux. Ça m'endort, ça m'apaise.
- Ah... je sais ce que c'est, tu viens de les laver!
Et il s'est à nouveau baissé pour lacer ses chaussures de tennis. Une heure plus tard, à l'hôtel, j'étais couchée dans mon lit. J'écoutais tomber la pluie, on n'aurait même pas dit que c'était de la pluie, plutôt un robinet grand ouvert. La douleur de mon tibia gauche s'est réveillée et j'ai abandonné tout espoir de dormir d'ici sept heures quand mon réveil radio me réveillerait avec des interprétations martiales de Sousa.
Chaque fois qu'il pleuvait, la vieille fracture se réveillait et elle ravivait une douleur sourde.
J'ai pensé: "C'est Buddy Willard qui est responsable de cette jambe cassée ! "
Et puis: "Non, je me la suis cassée moi-même. Je me la suis cassée exprès pour me punir d'être une gourde pareille"...

Seule œuvre de fiction publiée par la poétesse américaine Sylvia Plath, "The Bell Jar" fut publié l'année de la mort de son auteur : c'est la chronique d'une descente aux enfers, et Sylvia Plath y parle surtout d'elle-même ...
Au début du livre, Esther Greenwood, étudiante dans un collège universitaire huppé de la côte est, dans lequel on pourra reconnaître Smith College, arrive à New York pour quelques semaines, car elle est la lauréate d'un concours offrant un stage à la rédaction d`un grand magazine de mode. Elle découvre avec naïveté la vie sociale, et son arrivée à New York est le début d'une vie sentimentale chaotique et vouée à l'échec. Hésitant entre la sociologie et la psychologie, Esther Greenwood s'est endurcie dans sa virginité, qu'elle traine de son propre aveu comme un boulet. Vient la rencontre d'un dénommé Buddy Willard, personnage falot et sentimental, que l'intelligence des rapports humains n'écrase pas. Etudiant en médecine à Yale, il est promis à un bel avenir, d'autant plus qu'il est athlétique et séduit les demoiselles : bref, un cliché ambulant. Sa rencontre avec Esther Greenwood ne sera guère fructueuse. ll en devient tuberculeux, par ce secret de la fiction qui renvoie au corps les faiblesses de l'âme. Il quitte l'université Yale pour gagner un sanatorium dans la région montagneuse des Adirondacks. C`est lors d'une visite à ce malade que - c'est symbolique - Esther Greenwood se casse la jambe en faisant du ski en sa compagnie ...
La deuxième partie du roman prendra un tour plus tragique. Esther Greenwood est admise dans un hôpital psychiatrique et y subit un électrochoc dévastateur. Alors qu'elle est pensionnaire d'un second hôpital psychiatrique, elle fait la connaissance d`un étudiant sur le grand escalier de la bibliothèque de l`université Harvard. Second échec sentimental. Ensuite, c'est un voyage linéaire vers l'aliénation, sans espoir de retour ni attente de rémission.
L'œuvre de Sylvia Plath est sensible, axée sur l'essentiel, hantée par la souffrance et la vision tragique d'une mort lente montée de l'intérieur de soi (Trad. Gallimard.1987).
Dans cet extrait, Plath aborde la question des choix impossibles dans la vie d’une femme et le sentiment de paralysie face aux multiples attentes de la société. L'image de l'arbre aux figues symbolise les différentes voies qui s'offrent à Esther, mais aussi la peur de faire un mauvais choix....
"I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, and another fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions. And beyond and above these figs were many more figs I couldn’t quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn’t make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet."
« J'ai vu ma vie se ramifier devant moi comme le figuier vert de l'histoire. À l'extrémité de chaque branche, comme une grosse figue violette, un avenir merveilleux s'annonçait et clignotait. Une figue était un mari, un foyer heureux et des enfants, une autre un poète célèbre, une autre un professeur brillant, une autre Ee Gee, l'incroyable éditeur, une autre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, une autre Constantin, Socrate, Attila et un tas d'autres amants aux noms bizarres et aux professions décalées. Et au-delà et au-dessus de ces figues, il y avait beaucoup d'autres figues que je n'arrivais pas à distinguer. Je me voyais assis dans le creux de ce figuier, mourant de faim, simplement parce que je n'arrivais pas à décider laquelle de ces figues je choisirais. Je voulais chacune d'entre elles, mais en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et tandis que j'étais assis là, incapable de me décider, les figues commencèrent à se rider et à devenir noires, et, une à une, elles tombèrent par terre à mes pieds ».

"Collected Poems", recueil posthume de poèmes de Sylvia Plath publié à Londres en 1981, sous la responsabilité éditoriale de Ted Hughes, qui fut l'époux de la poétesse. On notera que la version d'Ariel que le public a découverte en 1965 n'est pas exactement celle que Plath avait prévue avant sa mort. Ted Hughes, qui a supervisé la publication posthume, a en effet modifié l’ordre des poèmes et en a omis certains, tout en en ajoutant d'autres qui n’étaient pas dans le manuscrit original de Plath.
Ces changements ont contribué à façonner la manière dont le recueil "Ariel" fut perçu, en mettant davantage l'accent sur la trajectoire tragique de Plath, menant du désespoir à sa mort. Cela a pu accentuer la lecture biographique de l'œuvre, bien que Plath ait toujours vu ses poèmes comme des œuvres artistiques indépendantes, et non uniquement autobiographiques.
Ce recueil rassemble des poèmes écrits dans les dernières années de sa vie, une période où elle a produit certains de ses textes les plus puissants et les plus intenses. C'est dans "Ariel" que Sylvia Plath atteint l'apogée de sa maturité artistique, avec une maîtrise inégalée du langage poétique, une richesse d'images percutantes, et un ton beaucoup plus personnel et introspectif que dans ses œuvres précédentes..
Le célèbre poème de Plath intitulé "Daddy" est une exploration sans concession de son rapport conflictuel avec son père décédé, dans un style qui combine une émotion viscérale avec une maîtrise technique remarquable. Elle y explore la complexité de sa relation avec son père, en utilisant des images à la fois provocantes et déroutantes (notamment des allusions au nazisme et à l'Holocauste). Ce poème, comme beaucoup d'autres dans Ariel, est à la fois un cri de colère et une tentative de libération personnelle. La violence des images et des émotions a fait sensation, en marquant une rupture avec les conventions poétiques plus formelles de l’époque...
You do not do, you do not do
Any more, black shoe
In which I have lived like a foot
For thirty years, poor and white,
Barely daring to breathe or Achoo.
Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time———
Marble-heavy, a bag full of God,
Ghastly statue with one gray toe
Big as a Frisco seal
And a head in the freakish Atlantic
Where it pours bean green over blue
In the waters off beautiful Nauset.
I used to pray to recover you.
Ach, du.
In the German tongue, in the Polish town
Scraped flat by the roller
Of wars, wars, wars.
But the name of the town is common.
My Polack friend
Says there are a dozen or two.
So I never could tell where you
Put your foot, your root,
I never could talk to you.
The tongue stuck in my jaw.
It stuck in a barb wire snare.
Ich, ich, ich, ich,
I could hardly speak.
I thought every German was you.
And the language obscene
An engine, an engine
Chuffing me off like a Jew.
A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.
I began to talk like a Jew.
I think I may well be a Jew.
The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna
Are not very pure or true.
With my gipsy ancestress and my weird luck
And my Taroc pack and my Taroc pack
I may be a bit of a Jew.
I have always been scared of you,
With your Luftwaffe, your gobbledygoo.
Née dans le monde intellectuel de Boston, où son père, d`origine allemande, enseignait la biologie, c`est contre lui que Sylvia Plath cherche ses repères, en particulier dans le poème intitulé "Daddy" ..
"J 'ai toujours eu peur de toi / Avec ta Luftwaft`e, ton charabia. / Et ta petite moustache. / Et ton œil aryen, bleu vif."
La tension est extrême. Sylvia Plath se sent mal-aimée, incomprise, et soumise aux humeurs d`un père autoritaire. Sa poésie va enregistre sans effets littéraires des états psychologiques, ceux d'un univers mental sans issue. De même que "La Cloche de détresse" rapporte les circonstances d`une descente aux enfers, en l'occurrence un internement psychiatrique, la métaphore de la damnation n`est pas absente de l'œuvre poétique ...
"Les flammes de l'enfer/Sont ténébreuses comme les triples / Flammes du ténébreux et gros Cerbère qui râle à la porte."
Seule la nature trouve grâce aux yeux de Sylvia Plath. Le poète évoque parfois la campagne du Massachusetts, où elle a passé sa jeunesse, non loin de Wellesley, près de Boston. Des heures d`émerveillement sont retranscrites. comme dans « La Cueillette des mûres ››.
Cependant, cette nature. d'abord accueillante. devient un lieu rocailleux, loin de tout romantisme, où est ressentie la force destructrice du néant. Le regard de l`écrivain a pris le dessus, projetant sa noirceur : il a chassé la plénitude un instant embrassée du monde...
And your neat mustache
And your Aryan eye, bright blue.
Panzer-man, panzer-man, O You
Not God but a swastika
So black no sky could squeak through.
Every woman adores a Fascist,
The boot in the face, the brute
Brute heart of a brute like you.
You stand at the blackboard, daddy,
In the picture I have of you,
A cleft in your chin instead of your foot
But no less a devil for that, no not
Any less the black man who
Bit my pretty red heart in two.
I was ten when they buried you.
At twenty I tried to die
And get back, back, back to you.
I thought even the bones would do.
But they pulled me out of the sack,
And they stuck me together with glue.
And then I knew what to do.
I made a model of you,
A man in black with a Meinkampf look
And a love of the rack and the screw.
And I said I do, I do.
So daddy, I’m finally through.
The black telephone’s off at the root,
The voices just can’t worm through.
If I’ve killed one man, I’ve killed two
The vampire who said he was you
And drank my blood for a year,
Seven years, if you want to know.
Daddy, you can lie back now.
There’s a stake in your fat black heart
And the villagers never liked you.
They are dancing and stamping on you.
They always knew it was you.
Daddy, daddy, you bastard, I’m through.
« Daddy, daddy, you bastard, I’m through» (Papa, papa, salaud, j'en ai fini), conclut Plath, mais le fait de parler de sa relation semble avoir exacerbé la douleur. Il y a des poètes confessionnels qui découvrent la paix, la libération thérapeutique dans les disciplines de l'écriture et ceux, tout aussi disciplinés, dont l'écriture ne fait que les pousser plus loin dans leurs retranchements. Plath est clairement une illustration cette dernière tendance : dans l'intérêt de son art, elle s'est engagée, s'est aventurée jusqu'au point où il ne restait plus que le précipice et peu, voire aucune chance de retour.
"Lady Lazarus" (from Collected Poems, HarperCollins Publishers, Ariel et autres poèmes, 1962, traduction Gallimard), "Lazare", qui dans l'Évangile selon Jean sera ressuscité par Jésus Christ, offre la trame des nombreuses tentatives de suicide de Sylvia Plath, "dying is an art..", "Out of the ash, I rise with my red hair And I eat men like air"...
Lady Lazarus
"I have done it again.
One year in every ten
I manage it—
A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot
A paperweight,
My face a featureless, fine
Jew linen.
Peel off the napkin
O my enemy.
Do I terrify?—
The nose, the eye pits, the full set of teeth?
The sour breath
Will vanish in a day.
Soon, soon the flesh
The grave cave ate will be
At home on me
And I a smiling woman.
I am only thirty.
And like the cat I have nine times to die.
This is Number Three. "
Dame Lazare
"Ça y est, je l'ai encore fait.
Tous les dix ans, c'est réglé,
Je réussis -
Comme un miracle ambulant, ma peau devient
Aussi lumineuse qu'un abat-jour nazi,
Mon pied droit
Un presse-papiers,
Mon visage un délicat
Mouchoir juif.
Ôtez-moi ce linge blanc,
Ô mon ennemi.
Le nez, les orbites, la denture complète _
N'est-ce pas parfaitement effroyable?
L'aigreur de Phaleine
Aura disparu en une journée
Et très vite la chair
Que le gouffre du tombeau avait dévorée
Se remettra d'elle-même en place
Sur moi, femme souriante.
Je n”ai que trente ans.
Et comme les chats je dois mourir neuf fois.
Ceci est ma mort Numéro Trois."
"What a trash
To annihilate each decade.
What a million filaments.
The peanut-crunching crowd
Shoves in to see
Them unwrap me hand and foot—
The big strip tease.
Gentlemen, ladies
These are my hands
My knees.
I may be skin and bone,
Nevertheless, I am the same, identical woman.
The first time it happened I was ten.
It was an accident.
The second time I meant
To last it out and not come back at all.
I rocked shut
As a seashell.
They had to call and call
And pick the worms off me like sticky pearls.
Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.
I do it so it feels like hell.
I do it so it feels real.
I guess you could say I’ve a call.
It’s easy enough to do it in a cell.
It’s easy enough to do it and stay put.
It’s the theatrical
Comeback in broad day
To the same place, the same face, the same brute
Amused shout:
‘A miracle!’
That knocks me out.
There is a charge
For the eyeing of my scars, there is a charge
For the hearing of my heart——
It really goes.
And there is a charge, a very large charge
For a word or a touch
Or a bit of blood..."
"Quel saccage
Pour anéantir chaque décennie.
Quelle multitude de filaments.
La foule qui croque ses cacahuètes
Se bouscule pour me les voir
Enlever un à un -
C'est le strip-tease intégral.
Messieurs, mesdames,
Voici mes mains,
Voilà mes genoux.
Si je n'ai que la peau et les os,
Je n'en suis pas moins véritable, la même femme.
La première fois j'avais dix ans.
C'était un accident.
La deuxième fois j'étais bien résolue
A en finir, ne jamais revenir.
Je me suis scellée
Comme un coquillage.
lls ont appelé, appelé, ils ont
Retiré les asticots gluants comme des perles.
Mourir
Est un art, comme tout le reste.
Je m'y révèle exceptionnellement douée,
On dirait l'enfer tellement.
On jurerait que c'est vrai.
On pourrait croire que j'ai la vocation.
C'est assez facile à réaliser dans une cave.
C'est assez facile de rester là et dattendre.
C'est le retour
Théátral en plein jour
Au même lieu, au même visage, à la même clameur
Primitive amusée:
"Miracle!"
Qui me foudroie.
Il faut payer
Pour regarder mes cicatrices, il faut payer
Pour entendre mon coeur -
Il bat pour de bon.
Il faut payer et payer très cher
Pour avoir un mot, un geste,
Un peu de sang...."
On peut penser que "Dame Lazare" (Lady Lazarus) est l'autoportrait de Sylvia Plath. Comme le Lazare biblique, entre deux traitements psychiatriques Sylvia Plath a connu la renaissance et a été ressuscitée d`entre les morts. ..

"Ariel" (Collected Poems, HarperCollins Publishers, traduction Gallimard) publié en octobre 1962, quatre mois seulement avant le suicide de Plath, décrit une promenade matinale à cheval vers le soleil...
"Stasis in darkness.
Then the substanceless blue
Pour of tor and distances.
God’s lioness,
How one we grow,
Pivot of heels and knees!—The furrow
Splits and passes, sister to
The brown arc
Of the neck I cannot catch,
Nigger-eye
Berries cast dark
Hooks—
Black sweet blood mouthfuls,
Shadows.
Something else
Hauls me through air—
Thighs, hair;
Flakes from my heels.
White
Godiva, I unpeel—
Dead hands, dead stringencies.
And now I
Foam to wheat, a glitter of seas.
The child’s cry
Melts in the wall.
And I
Am the arrow,
The dew that flies
Suicidal, at one with the drive
Into the red
Eye, the cauldron of morning."
"Un moment de stase dans l'obscurité.
Puis l'irréel écoulement bleu
Des rochers, des horizons.
Lionne de Dieu,
Nous ne faisons plus qu'un,
Pivot de talons, de genoux! - Le sillon
S'ouvre et va, frère
De l'arc brun de cette nuque
Que je ne peux saisir,
Yeux nègres
Les mûres jettent leurs obscurs
Hameçons -
Gorgées de doux sang noir -
Leurs ombres.
C'est autre chose
Qui m'entraîne fendre l'air -
Cuisses, chevelure;
Jaillit de mes talons.
Lumineuse
Godiva, je me dépouille -
Mains mortes, mortelle austérité.
Je deviens
L'écume des blés, un miroitement des vagues
Le cri de l'enfant
Se fond dans le mur.
Et je
Suis la flèche,
La rosée suicidaire accordée
Comme un seul qui se lance et qui fonce
Sur cet œil
Rouge, le chaudron de l'aurore."
Et nombre de poèmes ne sont pas loin d`un autre célèbre interné, Antonin Artaud, tant par la facture, sèche et tout en cassures, que par le ton désespéré. Trois ou quatre mots dans chaque vers, une grande simplicité, des phrases courtes : dans ces conditions, on ne sera pas surpris de constater que même la création artistique n`est pas un recours, et qu'en elle Sylvia Plath ne recherche jamais le salut. Mais alors, pourquoi écrire? Une part de son audience est due à son contexte, en des temps d`antipsychiatrie et de lutte contre l'enfermement. au sein d`une culture américaine fascinée jusqu'à l`ivresse par la psychologie, surtout dans les années soixante. Mais, parmi ces multiples témoignages de douleur, celui de Sylvia Plath se distingue par la beauté de l`écriture, sa rigueur rythmique, une rudesse, ajoute-t-on, de propos due à l`intelligence qui jauge l`émotion mais ne parvient jamais à la juguler tout à fait. On ne peut enfin oublier le destin funeste de Sylvia Plath, poète parmi les plus doués de sa génération, et qui s`est donné la mort à l'âge de trente et un ans, en pleine gloire, et femme devenue mythe littéraire, à l`heure où. grâce au féminisme naissant, les femmes commençaient à prendre la parole dans le monde intellectuel ...
"Tulips" (1961) - "The tulips are too excitable, it is winter here..." - Plath évoque son expérience à l'hôpital après une opération. Les tulipes, symboles de vie et de couleur, contrastent avec la blancheur stérile et froide de l'hôpital, ce qui reflète l'angoisse intérieure de Plath (First published in 1962 and collected in Ariel in 1965. Reprinted in The Collected Poems, 1981)
The tulips are too excitable, it is winter here.
Look how white everything is, how quiet, how snowed-in.
I am learning peacefulness, lying by myself quietly
As the light lies on these white walls, this bed, these hands.
I am nobody; I have nothing to do with explosions.
I have given my name and my day-clothes up to the nurses
And my history to the anesthetist and my body to surgeons.
They have propped my head between the pillow and the sheet-cuff
Like an eye between two white lids that will not shut.
Stupid pupil, it has to take everything in.
The nurses pass and pass, they are no trouble,
They pass the way gulls pass inland in their white caps,
Doing things with their hands, one just the same as another,
So it is impossible to tell how many there are.
My body is a pebble to them, they tend it as water
Tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently.
They bring me numbness in their bright needles, they bring me sleep.
Now I have lost myself I am sick of baggage
My patent leather overnight case like a black pillbox,
My husband and child smiling out of the family photo;
Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks.
I have let things slip, a thirty-year-old cargo boat
stubbornly hanging on to my name and address.
They have swabbed me clear of my loving associations.
Scared and bare on the green plastic-pillowed trolley
I watched my teaset, my bureaus of linen, my books
Sink out of sight, and the water went over my head.
I am a nun now, I have never been so pure.
I didn’t want any flowers, I only wanted
To lie with my hands turned up and be utterly empty.
How free it is, you have no idea how free
The peacefulness is so big it dazes you,
And it asks nothing, a name tag, a few trinkets.
It is what the dead close on, finally; I imagine them
Shutting their mouths on it, like a Communion tablet.
The tulips are too red in the first place, they hurt me.
Even through the gift paper I could hear them breathe
Lightly, through their white swaddlings, like an awful baby.
Their redness talks to my wound, it corresponds.
They are subtle : they seem to float, though they weigh me down,
Upsetting me with their sudden tongues and their color,
A dozen red lead sinkers round my neck.
Nobody watched me before, now I am watched.
The tulips turn to me, and the window behind me
Where once a day the light slowly widens and slowly thins,
And I see myself, flat, ridiculous, a cut-paper shadow
Between the eye of the sun and the eyes of the tulips,
And I have no face, I have wanted to efface myself.
The vivid tulips eat my oxygen.
Before they came the air was calm enough,
Coming and going, breath by breath, without any fuss.
Then the tulips filled it up like a loud noise.
Now the air snags and eddies round them the way a river
Snags and eddies round a sunken rust-red engine.
They concentrate my attention, that was happy
Playing and resting without committing itself.
The walls, also, seem to be warming themselves.
The tulips should be behind bars like dangerous animals;
They are opening like the mouth of some great African cat,
And I am aware of my heart: it opens and closes
Its bowl of red blooms out of sheer love of me.
The water I taste is warm and salt, like the sea,
And comes from a country far away as health.
"Morning Song" (1961) - Un poème qui explore les sentiments complexes liés à la maternité. Plath y parle de la naissance de son premier enfant, mêlant un amour protecteur avec un certain détachement et un sentiment d'aliénation (from Collected Poems).
Love set you going like a fat gold watch.
The midwife slapped your footsoles, and your bald cry
Took its place among the elements.
Our voices echo, magnifying your arrival. New statue.
In a drafty museum, your nakedness
Shadows our safety. We stand round blankly as walls.
I’m no more your mother
Than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow
Effacement at the wind’s hand.
All night your moth-breath
Flickers among the flat pink roses. I wake to listen:
A far sea moves in my ear.
One cry, and I stumble from bed, cow-heavy and floral
In my Victorian nightgown.
Your mouth opens clean as a cat’s. The window square
Whitens and swallows its dull stars. And now you try
Your handful of notes;
The clear vowels rise like balloons.
"The Applicant" (1962) - Un poème et satire sociale mordante sur le rôle des femmes et les attentes de la société, notamment en ce qui concerne le mariage et les normes patriarcales. Plath y adopte un ton ironique et cynique. “First, are you our sort of a person?" Portez-vous un œil de verre, de fausses dents ou une béquille, un appareil orthopédique ou un crochet, des seins en caoutchouc ou un entrejambe en caoutchouc, des points de suture pour montrer qu'il manque quelque chose ? Non, non ? Alors comment pouvons-nous vous donner quelque chose ? ... (First published in 1963 and collected in Ariel, 1965. Reprinted in The Collected Poems, 1981)
"First, are you our sort of a person?
Do you wear
A glass eye, false teeth or a crutch,
A brace or a hook,
Rubber breasts or a rubber crotch,
Stitches to show something's missing? No, no? Then
How can we give you a thing?
Stop crying.
Open your hand.
Empty? Empty. Here is a hand
To fill it and willing
To bring teacups and roll away headaches
And do whatever you tell it.
Will you marry it?
It is guaranteed
To thumb shut your eyes at the end
And dissolve of sorrow.
We make new stock from the salt.
I notice you are stark naked.
How about this suit
Black and stiff, but not a bad fit.
Will you marry it?
It is waterproof, shatterproof, proof
Against fire and bombs through the roof.
Believe me, they'll bury you in it.
Now your head, excuse me, is empty.
I have the ticket for that.
Come here, sweetie, out of the closet.
Well, what do you think of that ?
Naked as paper to start
But in twenty-five years she'll be silver,
In fifty, gold.
A living doll, everywhere you look.
It can sew, it can cook,
It can talk, talk , talk.
It works, there is nothing wrong with it.
You have a hole, it's a poultice.
You have an eye, it's an image.
My boy, it's your last resort.
Will you marry it, marry it, marry it."
"Edge" (1963) - L'un de ses derniers poèmes écrits avant son suicide, "Edge" est empreint d'une profonde tristesse. Il traite du désespoir, de la mort, et semble illustrer une conclusion tragique sur la vie. La femme est la perfection même, son corps mort porte le sourire de l'accomplissement, l'illusion d'une nécessité grecque coule dans les volutes de sa toge, ses pieds nus semblent dire : Nous sommes allés si loin, c'est fini... (First published in Ariel, 1965. Reprinted in The Collected Poems, 1981)
"The woman is perfected.
Her dead
Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity
Flows in the scrolls of her toga,
Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over.
Each dead child coiled, a white serpent,
One at each little
Pitcher of milk, now empty.
She has folded
Them back into her body as petals
Of a rose close when the garden
Stiffens and odors bleed
From the sweet, deep throats of the night flower.
The moon has nothing to be sad about,
Staring from her hood of bone.
She is used to this sort of thing.
Her blacks crackle and drag."

"Three-Martini Afternoons at the Ritz: The Rebellion of Sylvia Plath and Anne Sexton", written by Gail Crowther (2021)
"Introduction - Kicking at the Door of Fame.
In 1950s America, women were not supposed to be ambitious.
When Sylvia Plath graduated from Smith College in 1955, her commencement speaker, Adlai Stevenson, praised the female graduates and pronounced the purpose of their education was so they could be entertaining and well-informed wives when their husbands returned home from work. The postwar ideals of domesticity, the nuclear family, and the white middle-class woman who stayed at home dominated American thought until the mid-1960s. For those with enough privilege, a woman’s place was ensuring that a strong family unit would mean a strong, united society. Women were respected for not pursuing their own careers or ambitions. So, they had a lot to look forward to then.
Dans l'Amérique des années 1950, les femmes n'étaient pas censées être ambitieuses.
Lorsque Sylvia Plath a reçu son diplôme du Smith College en 1955, Adlai Stevenson, l'orateur qui lui a remis son diplôme, a fait l'éloge des femmes diplômées et a déclaré que le but de leur éducation était qu'elles puissent être des épouses divertissantes et bien informées lorsque leurs maris rentreraient du travail. Les idéaux d'après-guerre de la domesticité, de la famille nucléaire et de la femme blanche de la classe moyenne qui reste à la maison ont dominé la pensée américaine jusqu'au milieu des années 1960. Pour les personnes suffisamment privilégiées, la place de la femme était de veiller à ce qu'une unité familiale forte soit synonyme d'une société forte et unie. Les femmes étaient respectées parce qu'elles ne poursuivaient pas leur propre carrière ou leurs propres ambitions. Elles avaient donc beaucoup à espérer à l'époque...."
Gail Crowther nous conte ici comment deux femmes talentueuses, Sylvia Plath (1932) et Anne Sexton (1928) ont navigué à travers des défis similaires, tout en ayant des approches différentes envers leur art et leurs luttes personnelles, l'histoire des deux femmes marquée par la tragédie de leurs suicides respectifs (Plath en 1963, Sexton en 1974), deux femmes qui ont souffert de dépression et qui ont en fin de compte trouvé une certaine forme de reconnaissance à travers la poésie confessionnelle. Plath avait une approche plus introspective et rigoureuse, souvent centrée sur ses luttes internes et les pressions sociales. Sexton, quant à elle, avait un style plus brut, avec un langage direct et souvent choquant, abordant des sujets comme la sexualité, la mort et la folie. Le titre du livre fait référence aux célèbres rencontres entre Sylvia Plath et Anne Sexton au Ritz-Carlton à Boston, où elles partageaient des cocktails tout en discutant de poésie et de leurs combats personnels. Cette amitié intellectuelle est centrale dans le livre, et Crowther montre comment elle a façonné les deux poétesses ...
Six ans après l'obtention de son diplôme, alors qu'elle écrivait "The Bell Jar", Plath écrivait: « Ce qu'est un homme, c'est une flèche vers l'avenir, et ce qu'est une femme, c'est l'endroit d'où part la flèche ». Et la narratrice de Plath, l'impertinente et ironique Esther Greenwood, d'ajouter : « Le problème, c'est que je détestais l'idée de servir les hommes de quelque manière que ce soit ».
JUST ONCE
Just once I knew what life was for.
In Boston, quite suddenly, I understood;
walked there along the Charles River,
watched the lights copying themselves,
all neoned and strobe-hearted, opening
their mouths as wide as opera singers;
counted the stars, my little campaigners,
my scar daisies, and knew that I walked my love
on the night green side of it and cried
my heart to the eastbound cars and cried
my heart to the westbound cars and took
my truth across a small humped bridge
and hurried my truth, the charm of it, home
and hoarded these constants into morning
only to find them gone.
JUSTE UNE FOIS
Juste une fois j’ai su à quoi la vie servait.
À Boston, tout à coup, j’ai compris ;
marché là le long du fleuve Charles,
regardé les lumières s’imitant,
leurs cœurs stroboscopiques de néon palpitant, ouvrant
leurs bouches aussi grand que des chanteurs d’opéra ;
compté les étoiles, mes petites militantes,
mes marguerites cicatricielles, et su que je promenais mon amour
sur son côté vert nuit et pleuré
à fendre l’âme sur les voitures partant vers l’est et pleuré
à fendre l’âme sur les voitures partant vers l’ouest et mené
ma vérité sur un petit pont bosselé
et brusqué ma vérité, ses séductions, pour qu’elles rentrent
à la maison et amassé ces constantes jusqu’au matin
seulement pour constater qu’elles avaient disparu.

Anne Sexton (1928-1974)
Anne Sexton est une poétesse américaine reconnue pour son style confessionnel audacieux et son exploration de sujets intimes et tabous. Comme Sylvia Plath, Sexton fait partie de la tradition de la "poésie confessionnelle", qu'inspire des expériences personnelles souvent douloureuses, la dépression, le suicide, la maladie mentale, la sexualité, la maternité, et la mort, des sujets rarement abordés avec autant de franchise dans la poésie avant elle.
Anne Sexton a commencé à écrire des poèmes à l'âge de vingt-neuf ans pour endiguer un désir de suicide. Elle s'est accrochée au langage pour survivre et, malgré l'alcoolisme et la maladie mentale qui l'a finalement conduite à se donner la mort, elle a réussi à créer une œuvre qui a remporté un prix Pulitzer et qui passionne encore des milliers de lecteurs et de lectrices. Dans l'une de ses biographies, elle parvient à réconcilier les nombreuses Anne Sexton qu'elle fut, la femme au foyer des années 1950, l'enfant maltraitée qui devint une mère abusive, la séductrice, la suicidaire qui transportait dans son sac à main des « pilules qui me tuent » comme d'autres femmes transportent du rouge à lèvres, et la poétesse qui transforma la confession en un art poétique qui ne s'efface pas ...
MUSIC SWIMS BACK TO ME
Wait Mister. Which way is home?
They turned the light out
and the dark is moving in the corner.
There are no sign posts in this room,
four ladies, over eighty,
in diapers every one of them.
La la la, Oh music swims back to me
and I can feel the tune they played
the night they left me
in this private institution on a hill.
Imagine it. A radio playing
and everyone here was crazy.
I liked it and danced in a circle.
Music pours over the sense
and in a funny way
music sees more than I.
I mean it remembers better;
remembers the first night here.
It was the strangled cold of November;
even the stars were strapped in the sky
and that moon too bright
forking through the bars to stick me
with a singing in the head.
I have forgotten all the rest.
They lock me in this chair at eight a.m.
and there are no signs to tell the way,
just the radio beating to itself
and the song that remembers
more than I. Oh, la la la,
this music swims back to me.
The night I came I danced a circle
and was not afraid.
Mister?
LA MUSIQUE ME REVIENT À LA NAGE
Attendez, monsieur. C’est par où la maison ?
Ils ont éteint la lumière
et dans le coin les ténèbres remuent.
Pas de panneaux dans cette chambre,
juste quatre dames, octogénaires,
portant toutes des couches.
La la la, oh ! la musique me revient à la nage
et je perçois la mélodie qu’ils jouaient
la nuit où ils m’ont laissée
dans cet établissement privé sur une colline.
Imaginez ceci. Une radio allumée
et tout le monde ici était fou.
Cela me plaisait et j’ai dansé en rond.
La musique coule sur les sens,
en outre, étrangement,
la musique voit plus que moi.
Je veux dire qu’elle se souvient mieux,
se souvient de la première nuit ici.
C’était le froid mordant de novembre ;
même les étoiles étaient rivées au ciel
et cette lune trop brillante
se faufilait à travers les barreaux
pour me coller cet air dans la tête.
J’ai oublié tout le reste.
Ils m’attachent à cette chaise à huit heures du matin
et il n’y a pas de panneaux pour indiquer le chemin,
juste la radio battant la mesure pour elle-même
et la chanson qui se souvient
davantage que moi. Oh ! la la la,
cette musique me revient à la nage.
La nuit de mon arrivée j’ai dansé en rond
et je n’avais pas peur.
Monsieur ?

Née Anne Gray Harvey le 9 novembre 1928 à Newton, Massachusetts, elle a grandi dans une famille bourgeoise, se marie jeune avec Alfred "Kayo" Sexton, mais son rôle de mère au foyer la rend malheureuse. Elle souffre de dépression sévère et traverse des crises émotionnelles tout au long de sa vie. Après plusieurs épisodes de dépression et une tentative de suicide, Sexton commence à écrire de la poésie à la suggestion de son thérapeute, qui pensait que cela pourrait être une forme de thérapie. - "Puisque tu le demandes, souvent je ne m’en souviens pas. / Vêtue je marche, vierge de ce voyage. / Puis le désir presque innommable revient. / Même là, je n’ai rien contre la vie. / Je connais bien les brins d’herbe dont tu parles, / les meubles que tu as disposés au soleil. / Mais les suicidés ont leur langue à eux. / Comme les menuisiers, ils veulent savoir quels outils. / Ils ne demandent jamais pourquoi construire. / Par deux fois je me suis révélée si simplement / j’ai possédé l’ennemi, mangé l’ennemi, / ai fait miens son art et sa magie'" - Elle suit des cours de poésie et commence rapidement à être reconnue pour son talent. Sa poésie est souvent une manière pour elle d'exorciser ses douleurs et ses troubles psychologiques.
Sexton publie son premier recueil de poèmes, "To Bedlam and Part Way Back" (1960), qui traite de son séjour dans un hôpital psychiatrique. Sa poésie est à la fois lyrique et brutale, explorant des thèmes profondément personnels avec un langage direct et souvent choquant. Elle connaît un succès rapide, remportant notamment le prestigieux Prix Pulitzer de poésie en 1967 pour son recueil "Live or Die" (1966).
Elle continuera à publier plusieurs recueils influents, parmi lesquels "All My Pretty Ones" (1962), "Transformations" (1971), - dans lequel elle réécrit des contes de fées traditionnels, comme ceux des frères Grimm, en leur donnant une touche sombre, moderne et souvent cynique -, et "The Death Notebooks" (1974), tout en enseignant la poésie dans diverses institutions. Malgré son succès, Sexton reste tourmentée par la dépression et tente plusieurs fois de se suicider. Le 4 octobre 1974, elle met fin à ses jours par intoxication au monoxyde de carbone....
SAID THE POET TO THE ANALYST
My business is words. Words are like labels,
or coins, or better, like swarming bees.
I confess I am only broken by the sources of things;
as if words were counted like dead bees in the attic,
unbuckled from their yellow eyes and their dry wings.
I must always forget how one word is able to pick
out another, to manner another, until I have got
something I might have said...
but did not.
Your business is watching my words. But I
admit nothing. I work with my best, for instance,
when I can write my praise for a nickel machine,
that one night in Nevada: telling how the magic jackpot
came clacking three bells out, over the lucky screen.
But if you should say this is something it is not,
then I grow weak, remembering how my hands felt funny
and ridiculous and crowded with all
the believing money.
A DIT LA POÉTESSE À SON ANALYSTE
Mon affaire, ce sont les mots. Les mots sont comme des étiquettes,
ou des pièces de monnaie, ou mieux, un essaim d’abeilles.
J’avoue que seules les sources des choses arrivent à me briser ;
comme si les mots étaient comptés telles des abeilles mortes dans le grenier,
détachées de leurs yeux jaunes et de leurs ailes sèches.
Je dois toujours oublier comment un mot est capable d’en choisir
un autre, d’en façonner un autre, jusqu’à ce que j’aie
quelque chose que j’aurais pu dire…
mais sans l’avoir fait.
Votre affaire, c’est de surveiller mes mots. Mais moi
je n’admets rien. Je travaille avec ce que j’ai de mieux, par exemple,
quand je parviens à écrire l’éloge d’une machine à sous,
cette nuit-là dans le Nevada : en racontant comment le jackpot magique
est arrivé alors que trois cloches claquetaient sur l’écran de la chance.
Mais si vous disiez de cette chose qu’elle n’existe pas,
alors je perdrais mes moyens, en me rappelant la drôle de sensation
dans mes mains, ridicules et encombrées par tout
l’argent de la crédulité.

Sa "poésie confessionnelle" apparaît à l'époque choquante et transgressive. Des poèmes comme « Housewife » et « The Abortion » abordent les pressions imposées aux femmes en tant que mères et épouses. Elle n'hésite pas non plus briser les tabous en parlant de manière ouverte du corps, des désirs sexuels, et de la sexualité féminine. Beaucoup de ses poèmes tournent autour de l’idée de la mort comme une délivrance ou une solution à ses souffrances. Dans « Wanting to Die », elle parlera de manière poignante de son désir de mourir...
CONSORTING WITH ANGELS
I was tired of being a woman,
tired of the spoons and the pots,
tired of my mouth and my breasts,
tired of the cosmetics and the silks.
There were still men who sat at my table,
circled around the bowl I offered up.
The bowl was filled with purple grapes
and the flies hovered in for the scent
and even my father came with his white bone.
But I was tired of the gender of things.
Last night I had a dream
and I said to it . . .
"You are the answer.
You will outlive my husband and my father."
In that dream there was a city made of chains
where Joan was put to death in man's clothes
and the nature of the angels went unexplained,
no two made in the same species,
one with a nose, one with an ear in its hand,
one chewing a star and recording its orbit,
each one like a poem obeying itself,
performing God's functions,
a people apart.
"You are the answer,"
I said, and entered,
lying down on the gates of the city.
Then the chains were fastened around me
and I lost my common gender and my final aspect.
Adam was on the left of me
and Eve was on the right of me,
both thoroughly inconsistent with the world of reason.
We wove our arms together
and rode under the sun.
I was not a woman anymore,
not one thing or the other.
0 daughters of Jerusalem,
the king has brought me into his chamber.
1 am black and I am beautiful.
I've been opened and undressed.
I have no arms or legs.
I'm all one skin like a fish.
I'm no more a woman
than Christ was a man.
February 1963
FRICOTER AVEC LES ANGES
J’étais lasse d’être une femme,
lasse des cuillères et des casseroles,
lasse de ma bouche et de mes seins,
lasse du maquillage et de la soie.
Il restait encore des hommes à ma table,
qui se tenaient autour du bol que j’offrais.
Le bol était rempli de raisins pourpres
dont l’odeur faisait léviter les mouches
et même mon père est venu avec son os blanc.
Mais j’étais lasse du genre des choses.
La nuit dernière j’ai fait un rêve
et je lui ai dit…
« Tu es la réponse
tu survivras à mon mari et à mon père. »
Dans ce rêve il y avait une cité formée de chaînes
où Jeanne habillée en homme a été exécutée
et la nature des anges est restée inexpliquée,
il n’y en avait pas deux de la même espèce,
l’un avec un nez, l’un avec une oreille dans sa main,
l’un mâchant une étoile et notant son orbite,
chacun comme un poème n’obéissant qu’à lui-même,
exerçant les fonctions de Dieu,
un peuple à part.
« Tu es la réponse »,
j’ai dit et je suis entrée
et je me suis allongée aux portes de la cité.
Puis ils m’ont ceinte de chaînes
et j’ai perdu mon genre courant et mon aspect final.
Adam se trouvait à ma gauche
et Ève à ma droite,
tous deux juraient totalement avec le monde de la raison.
Nous avons tressé nos bras ensemble
et nous sommes partis sous le soleil.
Je n’étais plus une femme,
plus une chose ou une autre.
Ô filles de Jérusalem,
le roi m’a menée à sa chambre.
Je suis noire et je suis belle.
On m’a ouverte et déshabillée.
Je n’ai ni bras ni jambes.
Comme les poissons je ne suis que peau.
Je ne suis pas plus une femme
que le Christ n’était un homme.

"Her Kind" est un de ses poèmes les plus célèbres : il aborde le thème de la marginalisation des femmes, la narratrice s’identifie à une sorcière, une figure de femme rebelle et inadaptée à la société...
HER KIND
I have gone out, a possessed witch,
haunting the black air, braver at night;
dreaming evil, I have done my hitch
over the plain houses, light by light:
lonely thing, twelve-fingered, out of mind.
A woman like that is not a woman, quite.
I have been her kind.
I have found the warm caves in the woods,
filled them with skillets, carvings, shelves,
closets, silks, innumerable goods;
fixed the suppers for the worms and the elves:
whining, rearranging the disaligned.
A woman like that is misunderstood.
I have been her kind.
I have ridden in your cart, driver,
waved my nude arms at villages going by,
learning the last bright routes, survivor
where your flames still bite my thigh
and my ribs crack where your wheels wind.
A woman like that is not ashamed to die.
I have been her kind.
SA PAREILLE
Je suis sortie, sorcière possédée,
hantant l’air noir, plus hardie la nuit ;
rêvant de faire le mal, au-dessus des banals
pavillons de banlieue, de lumière en lumière :
créature solitaire, à douze doigts et folle.
Ce genre de femme n’est pas tout à fait femme.
J’ai été sa pareille.
J’ai trouvé les grottes chaudes dans les bois,
les ai garnies de poêles, de sculptures, d’étagères,
d’armoires, de soies, de biens innombrables ;
j’ai préparé le bouillon des asticots et des lutins :
me lamentant, j’ai remis de l’ordre dans le fouillis.
Ce genre de femme est incompris.
J’ai été sa pareille.
J’ai roulé dans ton diable, phaéton,
salué de mes bras nus les villages traversés,
assimilant les dernières routes claires, survivante
là où tes flammes mordent encore ma cuisse
et mes côtes craquent sous la force de tes roues.
Ce genre de femme n’a pas honte de mourir.
J’ai été sa pareille.
(trad. 2022, des femmes-Antoinette Fouque)
"The Abortion" traite de l'expérience d'une femme qui subit un avortement, un sujet qui n'a cessé d'être extrêmement controversé (Quelqu'un qui aurait dû naître est parti. / Tout comme la terre a froncé sa bouche, / chaque bourgeon sortant de son nœud, / j'ai changé de chaussures, puis j'ai roulé vers le sud ..)
"Somebody who should have been born is gone.
Just as the earth puckered its mouth,
each bud puffing out from its knot,
I changed my shoes, and then drove south."
"Wanting to Die" - "But suicides have a special language. / Like carpenters they want to know which tools. / They never ask why build" - Son rapport au suicide conté avec une simplicité poignante, une lucidité tragique, soulignant le désespoir omniprésent dans sa vie...
WANTING TO DIE
Since you ask, most days I cannot remember.
I walk in my clothing, unmarked by that voyage.
Then the almost unnameable lust returns.
Even then I have nothing against life.
I know well the grass blades you mention,
the furniture you have placed under the sun.
But suicides have a special language.
Like carpenters they want to know which tools.
They never ask why build.
Twice I have so simply declared myself,
have possessed the enemy, eaten the enemy,
have taken on his craft, his magic.
In this way, heavy and thoughtful,
warmer than oil or water,
I have rested, drooling at the mouth-hole.
I did not think of my body at needle point.
Even the cornea and the leftover urine were gone.
Suicides have already betrayed the body.
Still-born, they don't always die,
but dazzled, they can't forget a drug so sweet
that even children would look on and smile.
To thrust all that life under your tongue! —
that, all by itself, becomes a passion.
Death's a sad bone; bruised, you'd say,
and yet she waits for me, year after year,
to so delicately undo an old wound,
to empty my breath from its bad prison.
Balanced there, suicides sometimes meet,
raging at the fruit, a pumped-up moon,
leaving the bread they mistook for a kiss,
leaving the page of the book carelessly open,
something unsaid, the phone off the hook
and the love, whatever it was, an infection.
(February 3,1964)
VOULOIR MOURIR
Puisque tu le demandes, souvent je ne m’en souviens pas.
Vêtue je marche, vierge de ce voyage.
Puis le désir presque innommable revient.
Même là, je n’ai rien contre la vie.
Je connais bien les brins d’herbe dont tu parles,
les meubles que tu as disposés au soleil.
Mais les suicidés ont leur langue à eux.
Comme les menuisiers, ils veulent savoir quels outils.
Ils ne demandent jamais pourquoi construire.
Par deux fois je me suis révélée si simplement,
j’ai possédé l’ennemi, mangé l’ennemi,
ai fait miens son art et sa magie.
Ainsi, lourde et pensive,
plus chaude que l’huile ou l’eau,
je me suis reposée, bavant devant l’orifice.
Je n’ai pas pensé à mon corps sous la pointe de l’aiguille.
Même la cornée et ce qui restait d’urine avaient disparu.
Les suicidés ont déjà trahi le corps.
Morts-nés, ils ne s’éteignent pas toujours,
mais éblouis, ils ne peuvent oublier une drogue si douce
qui attirerait et ferait sourire jusqu’aux enfants.
Fourrer toute cette vie sous ta langue ! —
cela, en soi, devient une passion.
La mort est un os triste ; meurtri, dirais-tu,
elle m’attend pourtant, année après année,
pour défaire si délicatement une vieille blessure,
débarrasser mon souffle de sa prison mauvaise.
Là, en funambules, les suicidés se croisent parfois,
rageant contre le fruit, une lune gonflée,
délaissant le pain qu’ils ont pris pour un baiser,
laissant le livre ouvert par inadvertance,
une phrase en suspens, le téléphone décroché
et l’amour, peu importe lequel, une infection.
(trad. 2022, des femmes-Antoinette Fouque)

"The Ballad of the Lonely Masturbator" , - "The end of the affair is always death./ She's my workshop. / Slippery eye, /out of the tribe of myself my breath / finds you gone. / I horrify / those who stand by." -, traite explicitement de la sexualité solitaire et explore les thèmes du désir et de la frustration. Sexton y décrit avec une franchise brute les aspects physiques et émotionnels de l'acte, tout en révélant une profonde solitude derrière l'acte lui-même ...
THE BALLAD OF THE LONELY MASTURBATOR
The end of the affair is always death.
She's my workshop. Slippery eye,
out of the tribe of myself my breath
finds you gone. I horrify
those who stand by. I am fed.
At night, alone, I marry the bed.
Finger to finger, now she's mine.
She's not too far. She's my encounter.
I beat her like a bell. I recline
in the bower where you used to mount her.
You borrowed me on the flowered spread.
At night, alone, I marry the bed.
Take for instance this night, my love,
that every single couple puts together
with a joint overturning, beneath, above,
the abundant two on sponge and feather,
kneeling and pushing, head to head.
At night alone, I marry the bed.
I break out of my body this way,
an annoying miracle. Could I
put the dream market on display?
I am spread out. I crucify.
My little plum is what you said.
At night, alone, I marry the bed.
Then my black-eyed rival came.
The lady of water, rising on the beach,
a piano at her fingertips, shame
on her lips and a flute's speech.
And I was the knock-kneed broom instead.
At night, alone, I marry the bed.
She took you the way a woman takes
a bargain dress off the rack
and I broke the way a stone breaks.
I give back your books and fishing tack.
Today's paper says that you are wed.
At night, alone, I marry the bed.
The boys and girls are one tonight.
They unbutton blouses. They unzip flies.
They take off shoes. They turn off the light.
The glimmering creatures are full of lies.
They are eating each other. They are overfed.
At night, alone, I marry the bed.
LA BALLADE DE LA MASTURBATRICE SOLITAIRE
La fin d’une liaison c’est toujours la mort.
C’est mon atelier. L’œil glissant,
mon souffle, une fois hors
de la tribu de moi-même, te trouve absent.
Horrifiant ceux qui sont là, je suis assouvie.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Doigt contre doigt elle est à moi maintenant.
Elle n’est pas trop loin. Ma rencontre c’est elle.
Je la bats comme une cloche. Je m’étends
là où tu la montais, sous la tonnelle.
Tu disposais de moi sur l’étoffe fleurie.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Prends par exemple cette nuit, mon amour,
que chaque couple composait
en un renversement conjoint, tour à tour
les deux se répandant sur l’éponge et le duvet,
à genoux et poussant, bille contre bille.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Je jaillis hors de mon corps de cette manière,
un miracle embêtant, m’est-il permis
d’exposer le marché des chimères ?
Je m’étale les bras en croix. Je crucifie.
Ma petite prune, tu m’appelais ainsi.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Puis ma rivale aux yeux noirs a surgi.
La dame de l’eau, sur la plage s’est dressée,
un piano au bout des doigts, l’infamie
sur les lèvres avec des paroles flûtées.
Alors que j’étais juste cagneuse et raidie.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Elle t’a pris comme une femme arrache
une robe en solde d’un présentoir
et je me suis brisée comme une roche.
Je t’ai rendu ton attirail de pêche et tes grimoires.
Ton mariage a fait la une aujourd’hui.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
Ce soir ils ne font qu’un, les garçons et les filles.
Corsages et braguettes ouverts, débraillés
ils se déchaussent, soufflent les bougies.
Les créatures luisantes manquent de sincérité.
Elles se dévorent. Elle sont remplies.
La nuit, seule, j’épouse le lit.
"In Celebration of My Uterus" (Love Poems, 1969), "Everyone in me is a bird. / I am beating all my wings" - un poème qui célèbre le corps féminin et la sexualité avec une intensité qui frôle l'érotisme. Sexton y aborde la question de la féminité et de la puissance reproductive, mais aussi le plaisir qui découle de cette puissance ...
IN CELEBRATION OF MY UTERUS
Everyone in me is a bird.
I am beating all my wings.
They wanted to cut you out
but they will not.
They said you were immeasurably empty
but you are not.
They said you were sick unto dying
but they were wrong.
You are singing like a school girl.
You are not torn.
Sweet weight,
in celebration of the woman I am
and of the soul of the woman I am
and of the central creature and its delight
I sing for you. I dare to live.
Hello, spirit. Hello, cup.
Fasten, cover. Cover that does contain.
Hello to the soil of the fields.
Welcome, roots.
Each cell has a life.
There is enough here to please a nation.
It is enough that the populace own these goods.
Any person, any commonwealth would say of it,
"It is good this year that we may plant again
and think forward to a harvest.
A blight had been forecast and has been cast out."
Many women are singing together of this:
one is in a shoe factory cursing the machine,
one is at the aquarium tending a seal,
one is dull at the wheel of her Ford,
one is at the toll gate collecting,
one is tying the cord of a calf in Arizona,
one is straddling a cello in Russia,
one is shifting pots on the stove in Egypt,
one is painting her bedroom walls moon color,
one is dying but remembering a breakfast,
one is stretching on her mat in Thailand,
one is wiping the ass of her child,
one is staring out the window of a train
in the middle of Wyoming and one is
anywhere and some are everywhere and all
seem to be singing, although some can not
sing a note.
Sweet weight,
in celebration of the woman I am
let me carry a ten-foot scarf,
let me drum for the nineteen-year-olds,
let me carry bowls for the offering
(if that is my part).
Let me study the cardiovascular tissue,
let me examine the angular distance of meteors,
let me suck on the stems of flowers
(if that is my part).
Let me make certain tribal figures
(if that is my part).
For this thing the body needs
let me sing
for the supper,
for the kissing,
for the correct
yes.
POUR FÊTER MON UTERUS
Chaque être en moi est un oiseau.
Je bats toutes mes ailes.
Ils voulaient te retrancher de moi
mais ils ne le feront pas.
Ils disaient que tu étais infiniment vide
mais tu ne l’es pas.
Ils disaient que tu étais si malade que tu agonisais
mais ils avaient tort.
Tu chantes comme une écolière.
Tu n’es pas déchirée.
Poids délicieux,
pour fêter la femme que je suis
et l’âme de la femme que je suis
et la créature au centre et son plaisir
je chante pour toi. J’ose vivre.
Salut, esprit. Salut, calice.
Attache, abrite. Un abri qui contient bien.
Salut à la terre des champs.
Bienvenue, racines.
Chaque cellule est dotée d’une vie.
Il y en a assez ici pour satisfaire une nation.
Il suffit que la plèbe possède ces biens.
N’importe qui, n’importe quel État dirait de cela :
« Il est bon cette année que nous puissions semer à nouveau
et espérer une récolte.
Un fléau avait été annoncé mais il a été repoussé. »
De nombreuses femmes chantent ensemble à ce sujet :
l’une d’elles insulte une machine dans une usine à chaussures,
une autre s’occupe d’un phoque à l’aquarium,
une autre est morne au volant de sa Ford,
une autre perçoit la taxe au poste de péage,
une autre attache le cordon d’un veau dans l’Arizona,
une autre chevauche un violoncelle en Russie,
une autre déplace des marmites sur un fourneau en Égypte,
une autre peint les murs de sa chambre d’une couleur lunaire,
une autre se meurt mais en se remémorant un petit-déjeuner,
une autre s’étire sur sa natte en Thaïlande,
une autre torche les fesses de son enfant,
une autre regarde par la fenêtre d’un train
au cœur du Wyoming et une autre est
n’importe où et quelques-unes sont partout et toutes
semblent chanter, bien que certaines soient incapables de
chanter une seule note.
Poids délicieux,
pour fêter la femme que je suis
laisse-moi porter une écharpe longue de trois mètres,
laisse-moi jouer du tambour pour les jeunes de dix-neuf ans,
laisse-moi porter des bols pour les offrandes
(si tel est mon rôle).
Laisse-moi étudier les tissus cardiovasculaires,
laisse-moi examiner la distance angulaire des météores,
laisse-moi sucer la tige des fleurs
(si tel est mon rôle).
Laisse-moi formuler certaines figures tribales
(si tel est mon rôle).
Pour cette chose dont le corps a besoin
laisse-moi chanter
pour le dîner,
pour les baisers,
pour le bon
oui.
"The Touch" - "Your hands, / larger than mine, / touch the cloth of my simple dress. / They plunge like a lizard's tongue / into the fullness of an ear of corn" - Un poème qui évoque la sensualité et l'intimité physique dans un ton à la fois délicat et puissant. Sexton y explore le contact physique et le plaisir sensuel avec une attention particulière aux sensations corporelles ...
THE TOUCH
For months my hand had been sealed off
in a tin box. Nothing was there but subway railings.
Perhaps it is bruised, I thought,
and that is why they have locked it up.
But when I looked in it lay there quietly.
You could tell time by this, I thought,
like a clock, by its five knuckles
and the thin underground veins.
It lay there like an unconscious woman
fed by tubes she knew not of.
The hand had collapsed,
a small wood pigeon
that had gone into seclusion.
I turned it over and the palm was old,
its lines traced like fine needlepoint
and stitched up into the fingers.
It was fat and soft and blind in places.
Nothing but vulnerable.
And all this is metaphor.
An ordinary hand — just lonely
for something to touch
that touches back.
The dog won't do it.
Her tail wags in the swamp for a frog.
I'm no better than a case of dog food.
She owns her own hunger.
My sisters won't do it.
They live in school except for buttons
and tears running down like lemonade.
My father won't do it.
He comes with the house and even at night
he lives in a machine made by my mother
and well oiled by his job, his job.
The trouble is
that I'd let my gestures freeze.
The trouble was not
in the kitchen or the tulips
but only in my head, my head.
Then all this became history.
Your hand found mine.
Life rushed to my fingers like a blood clot.
Oh, my carpenter,
the fingers are rebuilt.
They dance with yours.
They dance in the attic and in Vienna.
My hand is alive all over America.
Not even death will stop it,
death shedding her blood.
Nothing will stop it, for this is the kingdom
and the kingdom come.
LE TOUCHER
Pendant des mois ma main est restée scellée
dans une boîte en fer-blanc. Rien là-dedans,
à part des rambardes de métro.
Peut-être est-elle meurtrie, me suis-je dit,
et c’est pourquoi ils l’ont enfermée.
Mais en jetant un œil, j’ai vu qu’elle y était
allongée gentiment.
On peut lire l’heure, me suis-je dit,
dans ses cinq phalanges pointant comme les aiguilles
d’une horloge et ses fines veines en filigrane.
Couchée là comme une femme inconsciente
nourrie par sonde sans même le savoir.
La main s’était racornie,
petit pigeon de bois
replié dans l’isolement.
Je l’ai retournée, sa paume avait vieilli,
ses lignes finement tracées semblaient
être brodées jusqu’aux doigts.
Elle était replète et douce et aveugle par endroits.
Rien d’autre que cette vulnérabilité.
Et tout cela n’est que métaphore.
Une main ordinaire – juste solitaire
qui se languit de toucher
et d’être touchée.
La chienne ne fait pas l’affaire.
Sa queue remue dans le marais pour une grenouille.
Je ne vaux pas mieux à ses yeux qu’une gamelle de croquettes.
Sa faim lui appartient.
Mes sœurs ne font pas l’affaire.
Leur vie est à l’école, sauf qu’elles ne tiennent qu’à un bouton
leurs larmes coulant comme de la limonade.
Mon père ne fait pas l’affaire.
Il est fourni avec la maison et même la nuit
il vit dans une machine faite par ma mère
et bien huilée par son travail, son travail.
Le problème c’est que
j’avais laissé mes gestes geler.
Le problème ne résidait pas
dans la cuisine ou dans les tulipes
mais seulement dans ma tête, ma tête.
Tout cela est alors entré dans l’histoire.
Ta main a trouvé la mienne.
La vie a galopé dans mes doigts comme un caillot sanguin.
Ô mon charpentier,
les doigts sont reconstruits.
Ils dansent avec les tiens.
Ils dansent dans le grenier et à Vienne.
Ma main est vivante dans toute l’Amérique.
Même la mort ne l’arrêtera pas,
la mort versant son sang.
Rien ne l’arrêtera, car ceci est le règne
et que le règne vienne.
"The Breast" - "A woman is her mother. / That's the main thing" - De l’érotisme lié aux seins féminins, explorant leur sexualité mais aussi leur symbolisme plus large, en lien avec la maternité et la toute puissance du corps féminin.
THE BREAST
This is the key to it.
This is the key to everything.
Preciously.
I am worse than the gamekeeper's children,
picking for dust and bread.
Here I am drumming up perfume.
Let me go down on your carpet,
your straw mattress — whatever's at hand
because the child in me is dying, dying.
It is not that I am cattle to be eaten.
It is not that I am some sort of street.
But your hands found me like an architect.
Jugful of milk! It was yours years ago
when I lived in the valley of my bones,
bones dumb in the swamp. Little playthings.
A xylophone maybe with skin
stretched over it awkwardly.
Only later did it become something real.
Later I measured my size against movie stars.
I didn't measure up. Something between
my shoulders was there. But never enough.
Sure, there was a meadow,
but no young men singing the truth.
Nothing to tell truth by.
Ignorant of men I lay next to my sisters
and rising out of the ashes I cried
my sex will be transfixed!
Now I am your mother, your daughter,
your brand new thing — a snail, a nest.
I am alive when your fingers are.
I wear silk — the cover to uncover —
because silk is what I want you to think of.
But I dislike the cloth. It is too stern.
So tell me anything but track me like a climber
for here is the eye, here is the jewel,
here is the excitement the nipple learns.
I am unbalanced — but I am not mad with snow.
I am mad the way young girls are mad,
with an offering, an offering . . .
I burn the way money burns.
LE SEIN
C’est la clef.
C’est la clef de tout.
Précieusement.
Je suis pire que les enfants du garde-chasse,
picorant la poussière et le pain.
Me voici en train de créer un parfum.
Laisse-moi m’allonger sur ton tapis,
ton matelas de paille – ce qui est à portée de main
car l’enfant en moi se meurt, se meurt.
Ce n’est pas que je sois du bétail destiné à être mangé.
Ce n’est pas que je sois une espèce de rue.
Mais tes mains m’ont tracée comme un architecte.
Pichet empli de lait ! À toi il y a des années
quand je vivais dans la vallée de mes ossements,
des os muets dans le marais. Des jouets de rien du tout.
Un xylophone peut-être, avec une peau
maladroitement tendue dessus.
Ce n’est que plus tard que je suis devenue réelle.
Plus tard je me suis mesurée aux étoiles de cinéma.
Je n’étais pas à la hauteur. Quelque chose était bien
là entre mes épaules. Mais jamais assez.
Bien sûr, il y avait une prairie,
mais sans jeunes hommes chantant la vérité.
Rien pour reconnaître la vérité.
Ignorant tout des hommes, je suis couchée près de mes sœurs
et surgissant des cendres j’ai crié
mon sexe sera subjugué !
Maintenant je suis ta mère, ta fille,
ta chose toute neuve – un escargot, un nid.
Je suis en vie quand tes doigts le sont.
Je porte de la soie – qui couvre pour que l’on découvre –
car je veux que tu penses à la soie.
Mais je n’aime pas ce tissu. Il est trop austère.
Ainsi, dis-moi tout mais explore-moi comme un grimpeur
car voici l’œil, voici le joyau,
voici l’excitation apprise par le téton.
Je suis déséquilibrée – mais pas folle de la neige.
Je suis folle comme les jeunes filles sont folles,
d’une offrande, d’une offrande…
Je brûle comme l’argent brûle.
"For My Lover, Returning to His Wife" - "She is so naked and singular/ She is the sum of yourself and your dream." - Un poème qui traite plus de l'infidélité que de l'érotisme pur, mais aborde les sentiments complexes d'une amante trahie. La passion, le désir et la douleur y sont entremêlés, créant une tension érotique dans cette situation de triangle amoureux...
FOR MY LOVER, RETURNING TO HIS WIFE
She is all there.
She was melted carefully down for you
and cast up from your childhood,
cast up from your one hundred favorite aggies.
She has always been there, my darling.
She is, in fact, exquisite.
Fireworks in the dull middle of February
and as real as a cast-iron pot.
Let's face it, I have been momentary.
A luxury. A bright red sloop in the harbor.
My hair rising like smoke from the car window.
Littleneck clams out of season.
She is more than that. She is your have to have,
has grown you your practical your tropical growth.
This is not an experiment. She is all harmony.
She sees to oars and oarlocks for the dinghy,
has placed wild flowers at the window at breakfast,
sat by the potter's wheel at midday,
set forth three children under the moon,
three cherubs drawn by Michelangelo,
done this with her legs spread out
in the terrible months in the chapel.
If you glance up, the children are there
like delicate balloons resting on the ceiling.
She has also carried each one down the hall
after supper, their heads privately bent,
two legs protesting, person to person,
her face flushed with a song and their little sleep.
I give you back your heart.
I give you permission —
for the fuse inside her, throbbing
angrily in the dirt, for the bitch in her
and the burying of her wound —
for the burying of her small red wound alive —
for the pale flickering flare under her ribs,
for the drunken sailor who waits in her left pulse,
for the mother's knee, for the stockings,
for the garter belt, for the call —
the curious call
when you will burrow in arms and breasts
and tug at the orange ribbon in her hair
and answer the call, the curious call.
She is so naked and singular.
She is the sum of yourself and your dream.
Climb her like a monument, step after step.
She is solid.
As for me, I am a watercolor.
I wash off.
POUR MON AMANT, QUI RETOURNE AUPRÈS DE SA FEMME
Elle est là tout entière.
Elle a été fondue avec soin pour toi
et moulée à partir de ton enfance,
moulée à partir de tes cent agates préférées.
Elle a toujours été là, mon chéri.
Elle est, en vérité, exquise.
Des feux d’artifice en pleine morosité de février
et aussi tangible qu’une marmite en fonte.
Soyons francs, j’ai toujours été temporaire.
Un luxe. Un voilier rouge vif dans le port.
Mes cheveux s’échappant en fumerolles de la vitre
de la voiture. Un festin de palourdes hors saison.
Elle est plus que cela. Elle est incontournable,
avec elle ton sens pratique atteint des proportions tropiques.
Ceci n’est pas une expérience. Elle est toute harmonie.
Elle s’occupe des rames et dames de nages pour la barque,
place des fleurs sauvages à la fenêtre au petit-déjeuner,
s’assied derrière le tour du potier à midi,
a mis au monde trois enfants sous la lune,
trois chérubins dessinés par Michel-Ange,
l’a fait les jambes écartées
dans la chapelle durant de terribles mois.
Si tu lèves les yeux, tu verras les enfants
collés au plafond comme des ballons délicats.
Elle porte chacun d’eux le long du couloir
après le dîner, chaque tête sobrement courbée,
les deux jambes protestant, un enfant puis l’autre,
ses joues rouges d’avoir chanté des berceuses.
Je te rends ton cœur.
Je te donne la permission
– pour le détonateur en elle, qui palpite
de rage dans la poussière, pour la chienne en elle
et l’enterrement de sa blessure –
pour sa petite blessure rouge enterrée vivante
– pour le clignotement pâle sous ses côtes,
pour le marin ivre patientant dans son pouls gauche,
pour les genoux de la mère, pour les bas,
pour le porte-jarretelles, pour l’appel –
l’appel surprenant
quand tu t’enfouiras dans des bras et des seins
et tireras sur le ruban orange dans ses cheveux
et répondras à l’appel, l’appel surprenant.
Elle est tellement nue et singulière.
Elle est la somme de ta personne et de ton rêve.
Monte-la comme un monument, un pas après l’autre.
Elle est solide.
Quant à moi, je suis une aquarelle.
Diluée je disparais.
"Song for a Lady" - "Un poème qui évoque le désir sexuel, un érotisme palpable dans la manière dont Sexton décrit la relation charnelle entre les amants ..
SONG FOR A LADY
On the day of breasts and small hips
the window pocked with bad rain,
rain coming on like a minister,
we coupled, so sane and insane.
We lay like spoons while the sinister
rain dropped like flies on our lips
and our glad eyes and our small hips.
"The room is so cold with rain," you said
and you, feminine you, with your flower
said novenas to my ankles and elbows.
You are a national product and power.
Oh my swan, my drudge, my dear wooly rose,
even a notary would notarize our bed
as you knead me and I rise like bread.
CHANT POUR UNE DAME
Le jour des seins et des hanches étroites,
la fenêtre grêlée par la méchante pluie,
la pluie grondant comme un prêtre,
nous nous sommes unies, si prudentes et si folles.
Étendues, emboîtées comme des cuillères, et la sinistre
pluie tombait comme des mouches sur nos lèvres
et nos yeux rieurs et nos hanches étroites.
« La chambre pénétrée de pluie est si froide », as-tu dit,
et toi, toi si féminine, avec ta fleur,
tu offrais des neuvaines à mes chevilles et à mes genoux.
Tu es un produit national, une puissance.
Ô mon cygne, ma serve, ma chère rose laineuse,
même un notaire certifierait conforme notre lit
tandis que tu me pétris et que je lève comme du pain.
"Eighteen Days Without You" - L'absence et le manque comme autant d'éléments érotiques dans une évocation du désir charnel et du besoin de contact physique...
EIGHTEEN DAYS WITHOUT YOU
December ist
As we kissed good-bye
you made a little frown.
Now Christ's lights are
twinkling all over town.
The cornstalks are broken
in the field, broken and brown.
The pond at the year's end
turns her gray eyelid down.
Christ's lights are
twinkling all over town.
A cat-green ice spreads
out over the front lawn.
The hemlocks are the only
young thing left. You are gone.
I hibernated under the covers
last night, not sleeping until dawn
came up like twilight and the oak leaves
whispered like money, those hangers on.
The hemlocks are the only
young thing left. You are gone....
(...)
"Mercy Street" - (1976) "In my dream, / drilling into the marrow / of my entire bone, / my real dream, / I'm walking up and down Beacon Hill / searching for a street sign - / namely MERCY STREET." - Inspiré par un lieu, ce poème évoque la sensualité et la relation charnelle avec un ton à la fois doux et brûlant. Il met en scène l'intimité physique avec une réflexion plus large sur l'amour et le désir ...
In my dream,
drilling into the marrow
of my entire bone,
my real dream,
I'm walking up and down Beacon Hill
searching for a street sign —
namely MERCY STREET.
Not there.
I try the Back. Bay.
Not there.
Not there.
And yet I know the number.
45 Mercy Street.
I know the stained-glass window
of the foyer,
the three flights of the house
with its parquet floors.
I know the furniture and
mother, grandmother, great-grandmother,
the servants.
I know the cupboard of Spode,
the boat of ice, solid silver,
where the butter sits in neat squares
like strange giant's teeth
on the big mahogany table.
I know it well.
Not there.
Where did you go?
45 Mercy Street,
with great-grandmother
kneeling in her whale-bone corset
and praying gently but fiercely
to the wash basin,
at five A.M.
at noon
dozing in her wiggy rocker,
grandfather taking a nip in the pantry,
grandmother pushing the bell for the downstairs maid,
and Nana rocking Mother with an oversized flower
on her forehead to cover the curl
of when she was good and when she was . . .
And where she was begat
and in a generation
the third she will beget,
me,
with the stranger's seed blooming
into the flower called Horrid.
I walk in a yellow dress
and a white pocketbook stuffed with cigarettes,
enough pills, my wallet, my keys,
and being twenty-eight, or is it forty-five?
I walk. I walk.
I hold matches at the street signs
for it is dark,
as dark as the leathery dead
and I have lost my green Ford,
my house in the suburbs,
two little kids
sucked up like pollen by the bee in me
and a husband
who has wiped off his eyes
in order not to see my inside out
and I am walking and looking
and this is no dream
just my oily life
where the people are alibis
and the street is unfindable for an
entire lifetime. ....
Et pour ne pas conclure, "The Room of My Life" - Toute l'intimité de son environnement personnel nimbé d'une atmosphère de sensualité latente ...
THE ROOM OF MY LIFE
Here,
in the room of my life
the objects keep changing.
Ashtrays to cry into,
the suffering brother of the wood walls,
the forty-eight keys of the typewriter
each an eyeball that is never shut,
the books, each a contestant in a beauty contest,
the black chair, a dog coffin made of Naugahyde,
the sockets on the wall
waiting like a cave of bees,
the gold rug
a conversation of heels and toes,
the fireplace
a knife waiting for someone to pick it up,
the sofa, exhausted with the exertion of a whore,
the phone
two flowers taking root in its crotch,
the doors
opening and closing like sea clams,
the lights
poking at me,
lighting up both the soil and the laugh.
The windows,
the starving windows
that drive the trees like nails into my heart.
Each day I feed the world out there
although birds explode
right and left.
I feed the world in here too,
offering the desk puppy biscuits.
However, nothing is just what it seems to be.
My objects dream and wear new costumes,
compelled to, it seems, by all the words in my hands
and the sea that bangs in my throat.
