- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee

Philip Roth (1933-2018), "Goodbye, Columbus"(1959), "Let Go" (1962), "When She Was Good" (1967), "Portnoy’s Complaint" (1969), "My Life as a Man" (1974), "The Counterlife" (1986), "American Pastoral" (1997), "The Human Stain" (2000), "Everyman" (2006) - Stanley Elkin (1930-1995), "A Bad Man" (1965), "The Living End" (1979) - ...
Last update : 11/11/2016

Philip Roth est monté en puissance sur la scène de la littérature mondiale avec quatre ouvrages, "Goodbye, Columbus" (1959; film 1969), "Let Go" (1962), "When She Was Good" (1967) et "Portnoy’s Complaint" (1969; film 1972). Lorsque "Portnoy's Complaint" est paru en 1969, le livre a immédiatement été jugé scandaleux.C'était en partie dû à son contenu explicite, inventif, mais aussi à la sexualité qui y est évoquée, liée à une sorte de diagnostic du mâle américain de l'époque. La situation de Portnoy - sa fixation sur sa mère, ses difficultés avec les membres du sexe opposé, son apitoiement sur soi parfois larmoyant, décrivait et définissait un syndrome qui était connu de nombreux lecteurs (masculins) de Roth. À cela s'ajoutait la judaïcité de Portnoy, décrite ici comme une exacerbation des orthodoxies répressives contre lesquelles s'élèvaient le livre et son héros. En fait, le roman ne raconte pas une histoire, mais dépeint un état. Portnoy est prisonnier d'un monde qui ne peut satisfaire ses fantasmes extrêmes et bizarres, le tout traversé par de brefs éclairs de lucidité. À la lumière de la présence de plus en plus explicite de la sexualité depuis les années 1960, Portnoy et son complexe nous paraît peut-être moins extrême qu'à l'époque, et finalement, ce sont le personnage central et le caractère universel de ses complexes et de ses humiliations donnent toute sa force à l'oeuvre.
Grand maître de l'autofiction, les héros de Philip Roth lui ressemblaient tant qu'il en vint à se forger un alter ego littéraire, Nathan Zuckerman, qu'il met en scène en 1974 avec "My Life as a Man" . Puis vint, avec la grande maturité, le recul, le contexte politique et social, bien des interrogations sur la réalité de l'Américan Dream, qui débutent avec "American Pastoral" (1997), - un couple de la classe moyenne dont la fille devient terroriste -, première entrée dans la série américaine Trilogy, "I Married a Communist" (1998), "The Human Stain" (2000), le monde n'est plus ce qu'il était ...
"A broken wall of books, imperfectly shelved" - Arrêtons-nous un instant sur cet Alexander Portnoy qui semble toujours finir par se noyer dans sa propre subjectivité, une subjectivité singulière qui, comme celle de tant de protagonistes de Roth, semble être déterminée surtout par d’autres personnes qu'elle-même, sa famille, sa communauté, sa culture. Dans "Let Go" (1962), Gabe Wallach, l’un des personnages principaux, révèle certains des effets psychologiquement paralysants d’être ainsi élevé dans le nid familial, qui s'avère un véritable piège. Ainsi dit-il à sa petite amie qu’il ne pourra jamais s’en échapper, qu’il ne sera jamais « tiré d’affaire » (be off the hook), jusqu’à ce que, comme il le dit, «I make some sense of the larger hook I'm on». Mais il n'y parviendra jamais. De même, dans le premier roman de Roth, "Goodbye, Columbus" (1959), Neil Klugman regarde son reflet dans une fenêtre de bibliothèque après la fin douloureuse d’une affaire. «Je n’étais que cette substance, dit-il, ce visage que j’ai vu devant moi.» (I was only that substance, that face that I saw in front of me), "The outside of me gave up little information about the inside of me", il voulait « aller derrière cette image et attraper tout ce qui regardait à travers ces yeux » (o go behind that image and catch whatever it was that looked through those eyes). Cependant, alors qu’il « regardait attentivement » (looked hard) sa propre image, se souvient-il, et son « regard poussé à travers elle » (gaze pushed through it), tout ce qu’il a fini par voir, c’est « un mur de livres brisé, imparfaitement rangé » (a broken wall of books, imperfectly shelved).
L'intention de toute la fiction de Roth pourrait être précisément celui-ci : regarder l’image d’un Américain comme lui, découvrir ce qui se trouve en dessous. Qu’est-ce qui, demande-t-il, est le moi mystérieux, la subjectivité qui regarde en arrière, qui me captive ? Il ne donnera aucune réponse à cette question. Peut-être que l’individualité est une fiction, un produit de la réflexion qui s'écrit et se consigne dans des livres, mais non dans la réalité....
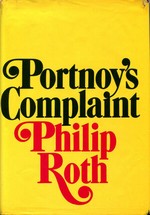
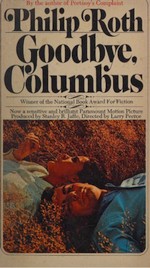
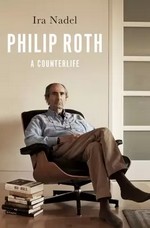

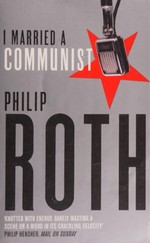
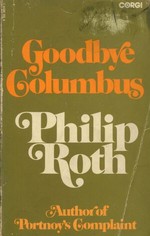
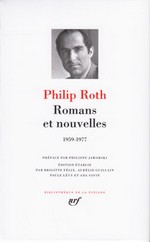
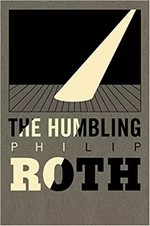
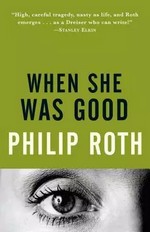
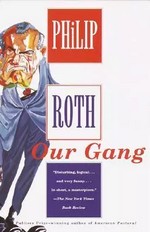
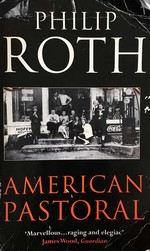
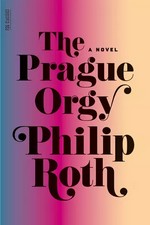
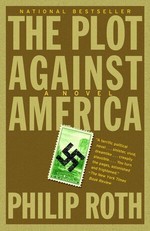
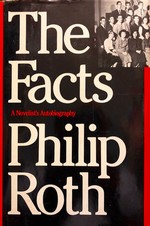

Philip Roth (1933-2018)
Né en 1933 à Newark, New Jersey, Philip Roth obtient, dès son premier livre, le recueil de nouvelles "Goodbye Columbus", en 1960, le National Book Award. Il fait scandale en 1969 avec "Portnoy et son complexe" (Portnoy’s Complaint). Il est l'auteur de plus d'une vingtaine de livres. La plupart de ses héros sont des juifs, un peu désorientés dans leurs problèmes moraux, philosophiques et sociaux et qui éprouvent des difficultés à s’intégrer à la société américaine. La communauté juive américaine, qui lui a d’abord donné le prix de Jewish Book Council en 1959, a vivement critiqué "Portnoy et son complexe". Les deux romans suivants furent une déception. "Letting go" (Laisser courir, 1962) est un gros roman sur les tourments politico-métaphysiques des étudiants et de leurs professeurs, et leurs crises sentimentales. "When she was Good" (Quand elle était gentille, 1967) est un drame de la démence chez les petits protestants de l’Ouest. Le thème dominant est celui de la frustration, les conséquences d’une morale répressive qui conduit l’homme à l’alcoolisme et la femme à la paranoïa. Chaque communauté fonctionne de manière close, se croit la seule à être vraiment américaine et observe les autres avec réprobation, et Roth n'évoque pas les autres communautés, elles demeurent invisibles Le rêve américain du self-made-man n'est qu'un mythe, chaque individu ne fabrique que des récits d'émancipation illusoires, ils demeurent le produit d'une éducation et d'un milieu, auxquels il ne peut échapper. C'est avant tout le mensonge que l'on se fait à soi-même, celui qu'on se raconte afin de se donner l'illusion de changer d'identité, qui est démenti par les coups de théâtre de l'histoire. Les familles tranquilles et heureuses décrites dans les romans de Philip Roth ne sont pas sans secrets et dissimulations, certains évènements provoquent une extériorisation souvent loufoque de son intériorité profonde , traitée avec dérision et ironie ...
Roth s'est attaqué aux questions d'identité, de paternité, de moralité et de mortalité dans une série de romans qui ont façonné le cours des lettres américaines dans la seconde moitié du XXe siècle, reflétant et traduisant toute la complexité de son héritage de juif-américain dans des œuvres comme "Portnoy's Complaint" (1969), "American Pastoral" (1997), "The Human Stain" (2000) et "The Plot Against America" (2004), qui ont remporté un succès à la fois critique et commercial, couvrant leur auteur de multiples prix littéraires. Et plus que n'importe quel autre écrivain de son temps, il fut infatigable dans son exploration de la sexualité masculine, non loin de Saul Bellow et de John Updike et les surpassant ne serait-ce qu'en ayant écrit plus de livres qu'eux ...
"La plus grave menace, à l'époque où j'étais enfant, venait de l'étranger, des Allemands et des Japonais, qui étaient nos ennemis parce que nous étions américains... Sur place, la plus grave menace venait des Américains qui s'opposaient à nous - ou nous repoussaient -, nous traitaient avec condescendance quand ils ne nous excluaient pas strictement - parce que nous étions juifs" (Les Faits. Autobiographie d'un romancier)

Goodbye Columbus (Goodbye, Columbus, 1959)
Son premier livre est un recueil de six nouvelles (Goodbye Columbus, The Conversion of the Jews, Defender of the Faith, Epstein, You Can't Tell A Man By The Song He Sings, Eli The Fanatic) qui fut très favorablement accueilli et reçut en 1960 le National Book Award. On y trouve un mélange d’humour et de verve mais aussi de la détresse et de la nostalgie. La nouvelle qui donne son titre au recueil, « Goodbye Columbus », sous des scènes cocasses comme celle de l’achat d’un diaphragme par un couple d’étudiants, est pleine de tristesse ; c’est l’adieu à l’université (Columbus), à la jeunesse et aux illusions : le jeune héros juif et pauvre n’épousera pas son amour, la fille d’une famille israélite riche et snob, habitant la banlieue chic. Le thème dominant du recueil est la déception des jeunes juifs pauvres devant la dureté de la vie, devant l’abîme qui sépare les juifs possédants des pauvres, ou les juifs européens rescapés du nazisme de la communauté juive américaine. "Conversation des Juifs" montre un rabbin victime d’une espièglerie d’enfant. "Le Défenseur de la foi" se déroule dans l’armée. "L’habit ne fait pas le moine" décrit l’amitié insolite entre un étudiant de bonne famille et deux jeunes dévoyés. Dans "Eli le fanatique", les habitants d’une petite ville veulent empêcher les rescapés de l’hitlérisme de monter une école....
"THE FIRST TIME I saw Brenda she asked me to hold her glasses. Then she stepped out to the edge of the diving board and looked foggily into the pool; it could have been drained, myopic Brenda would never have known it. She dove beautifully, and a moment later she was swimming back to the side of the pool, her head of short-clipped auburn hair held up, straight ahead of her, as though it were a rose on a long stem. She glided to the edge and then was beside me. "Thank you," she said, her eyes watery though not from the water. She extended a hand for her glasses but did not put them on until she turned and headed away. I watched her move off. Her hands suddenly appeared behind her. She caught the bottom of her suit between thumb and index finger and flicked what flesh had been showing back where it belonged. My blood jumped.
"LA PREMIÈRE FOIS que j'ai vu Brenda, elle m'a demandé de tenir ses lunettes. Elle s'est alors avancée jusqu'au bord du plongeoir et a regardé la piscine d'un air brumeux ; elle aurait pu être asséchée, Brenda la myope ne l'aurait jamais su. Elle plongea magnifiquement et, un instant plus tard, elle nageait de nouveau vers le bord de la piscine, sa tête aux cheveux auburn coupés court tenue droite devant elle, comme s'il s'agissait d'une rose sur une longue tige. Elle a glissé jusqu'au bord et s'est retrouvée à côté de moi. "Merci", dit-elle, les yeux larmoyants, mais pas à cause de l'eau. Elle a tendu la main pour prendre ses lunettes, mais ne les a pas mises avant de se retourner et de s'éloigner. Je l'ai regardée s'éloigner. Ses mains sont soudain apparues derrière elle. Elle a attrapé le bas de son costume entre le pouce et l'index et a remis la chair qui apparaissait à sa place. Mon sang n'a fait qu'un tour.
That night, before dinner, I called her.
"Who are you calling?" my Aunt Gladys asked.
"Some girl I met today."
"Doris introduced you?"
"Doris wouldn't introduce me to the guy who drains the pool, Aunt Gladys."
"Don't criticize all the time. A cousin's a cousin. How did you meet her?"
"I didn't really meet her. I saw her."
"Who is she?"
"Her last name is Patimkin."
"Patimkin I don't know," Aunt Gladys said, as if she knew anybody who belonged to the Green Lane Country Club. "You're going to call her you don't know her?"
"Yes," I explained. "I'll introduce myself."
"Casanova," she said, and went back to preparing my uncle's dinner.
None of us ate together: my Aunt Gladys ate at five o'clock, my cousin Susan at five-thirty, me at six, and my uncle at six-thirty. There is nothing to explain this beyond the fact that my aunt is crazy.
"Where's the suburban phone book?" I asked after pulling out all the books tucked under the telephone table.
"What?"
"The suburban phone book. I want to call Short Hills."
"That skinny book? What, I gotta clutter my house with that, I never use
it?"
"Where is it?"
"Under the dresser where the leg came off."
"For God's sake," I said.
"Call information better. You'll go yanking around there, you'll mess up my drawers. Don't bother me, you see your uncle'll be home soon. I haven't even fed you yet."
"Aunt Gladys, suppose tonight we all eat together. It's hot, it'll be easier for you."
"Sure, I should serve four different meals at once. You eat pot roast, Susan with the cottage cheese, Max has steak. Friday night is his steak night, I wouldn't deny him. And I'm having a little cold chicken. I should jump up and down twenty different times? What am I, a workhorse?"
"Why don't we all have steak, or cold chicken—"
Mais dans les faits, Roth a connu autant de succès que de controverse avec son premier recueil de nouvelles, suivre les fortunes de la classe moyenne des Juifs américains pris entre l'ancien et le nouveau, négociant les frontières entre l'assimilation et la différenciation dans les banlieues, ne sont pas choses aussi banales que cela, et lorsqu'il remporta le National Book, on vit se déclencher un flot de condamnations, il était devenu le "juif qui se déteste"... Mais, répondra-t-il, l''épithète écrivain juif américain n'a pas de sens pour moi, "si je ne suis pas américain, je ne suis rien..."

"Letting Go" (1961, Laissez courir)
Oeuvre de facture classique. où l'on a pu noter l'influence de Fitzgerald et qui aborde avec sérieux des sujets qui seront repris avec brio, et sur le mode parodique, dans les romans ultérieurs de l'auteur. C'est aussi un roman magistral sur les contraintes sociales et éthiques des années cinquante..
Gabe Wallach, jeune étudiant juif, fils d`un riche dentiste, va, après la mort de sa mère, poursuivre ses études à l'université de l`lowa pour échapper à l'amour possessif d'un père solitaire. C'est là qu'il fait la connaissance de Paul Herz, étudiant juif comme lui, marié à une catholique, Libby. Malgré sa conversion, celle-ci, rejetée par sa propre famille, n`est pas acceptée par les parents de Paul, et les Herz ont des difficultés financières. De plus, à la suite d`un avortement, Libby ne peut plus avoir d'enfant. Gabe ne peut résister au plaisir de leur venir en aide. ll leur prête une voiture. intervient auprès des parents de Paul, et lui trouve un emploi à l'université de Chicago. Peu à peu, Gabe s'immisce et s'installe dans la vie du couple.
Paul et Libby semblent apprécier cette intrusion dans leur vie privée, chacun y trouvant un profit réel ou fantasmatique. Libby, frustrée par le manque de passion de son mari, est prête à considérer Gabe comme un remplaçant potentiel. Paul, par son comportement, semble même souhaiter des rapports plus intimes entre sa femme et son ami. Gabe, tenté par le charme de Libby qui s'offre à lui, l'embrasse, mais est incapable de s'engager. Il est également incapable de lâcher prise. Son ingérence conduit le couple à deux doigts du divorce. Désireux de se racheter, Gabe offre ses bons offices pour rendre possible l'adoption d`un enfant.
Les personnages semblent manipulés ou déterminés par un destin qui leur échappe. Paul, qui veut être écrivain, est pris au piège d`un mariage désastreux. et reste avec Libby plus par devoir que par amour. Gabe, lui, prisonnier du souvenir d'une mère castratrice, ne peut établir de liens durables et authentiques avec les femmes qu'il rencontre. Mais, par crainte de la solitude, s'accroche à ses amis jusqu'au pourrissement de la situation. jusqu'à la rupture inéluctable. Malgré ses dénégations, il jouit bien du pouvoir qu'il exerce sur ceux qu`il attire à lui : il séduit une jeune étudiante qu'il abandonne quelques semaines plus tard; il a une liaison avec une jeune divorcée, mère de deux enfants, Martha Reganhart, mais il ne se décide pas à l'épouser et se trouve indirectement responsable de la mort de son fils à elle, Frank. Le roman s`achèvera sur une lettre à Libby où Gabe confesse son égoïsme, admettant que l`intérêt qu`il prenait aux affaires des autres lui permettait de ne pas s'interroger sur lui-même. Il reconnaitra aussi l'ambiguïté de son attitude : sa bonté n`était qu'un moyen d`exercer son pouvoir sur les autres, de les maintenir sous son emprise. (Trad. Gallimard,1966).

Portnoy et son complexe (Portnoy’s Complaint, 1969)
"Portnoy est un livre scabreux, presque obscène, où Roth manie la langue verte d’un Rabelais et le lyrisme sexuel d’un Henry Miller. Cette épopée de la fornication, cette complainte du sexe malheureux est avant tout un roman de la culpabilité, où la culpabilité sexuelle est de la même nature que la culpabilité raciale. Car Portnoy est un avocat juif qui, sur le divan d’un psychanalyste juif, « crache » tous les détails impudiques de son enfance, entre sa Mamma castratrice et son père constipé. Honte raciale et honte sexuelle sont le symbole de la conscience malheureuse qui permet à Roth de démonter le processus d’aliénation. Condamné à vie au ghetto du refoulement, Portnoy porte son sexe comme une étoile jaune, parce que les libidos sont seules au monde. Roth a génialement utilisé le yiddish et la famille juive pour mesurer la distance qui nous sépare d’une vraie société de tolérance." (Trad. Gallimard) Monologue des obsessions masturbatoires d'un jeune juif, Alexander Portnoy, attaché à sa mère, et de ses relations troublées avec les femmes dans les années 1940 dans le New Jersey, un roman qui transformera un jeune auteur entreprenant en une célébrité scandaleuse. Un best-seller immédiat, le monologue follement comique retrace la vie d'Alexander Portnoy alors qu'il poursuit sa libération sexuelle par des actes érotiques toujours plus extrêmes, retenus seulement par l'emprise de fer de son éducation juive américaine ...
" Yes, shame, shame, on Alex P., the only member of his graduating class who hasn't made grandparents of his Mommy and his Daddy. While everybody else has been marrying nice Jewish girls, and having children, and buying houses, and (my father's phrase) putting down roots, while al the other sons have been carrying forward the family name, what he has been doing is - chasing cunt. And shikse cunt, to boot! Chasing it, sniffing it, lapping it, shtupping it, but above al , thinking about it. Day and night, at work and on the street - thirty-three years old and stil he is roaming the streets with his eyes popping. A wonder he hasn't been ground to mush by a taxicab, given how he makes his way across the major arteries of Manhattan during the lunch hour.
Thirty-three, and stil ogling and daydreaming about every girl who crosses her legs opposite him in the subway! Stil cursing himself for speaking not a word to the succulent pair of tits that rode twenty-five floors alone with him in an elevator! Then cursing himself for the opposite as wel ! For he has been known to walk up to thoroughly respectable-looking girls in the street, and despite the fact that since his appearance on Sunday morning TV his face is not entirely unknown to an enlightened segment of the public - despite the fact that he may be on his way to his current mistress' apartment for his dinner - he has been known on one or two occasions to mutter, "Look, would you like to come home with me?" Of course she is going to say "No." Of course she is going to scream, "Get out of here, you!" or answer curtly, "I have a nice home of my own, thank you, with a husband in it." What is he doing to himself, this fool! this idiot! this furtive boy! This sex maniac!
"Oui, honte, honte à Alex Portnoy, le seul représentant de sa promotion qui n'a pas fait des grands-parents de sa maman et de son papa. Alors que tous les autres ont épousé des gentilles filles juives, fait des enfants, acheté des maisons et (selon la phrase de mon père) se sont enracinés. Alors que tous les autres fils ont assuré leur postérité, eh bien voilà ce qu'il a fait, lui - il a chassé le con. Et le con shikse, qui plus est! Chassé, reniflé, lapé, shuppé, mais par-dessus tout, il y a pensé. Jour et nuit, au travail et dans la rue - à trente-trois ans d'âge, et il rôde toujours dans les rues, avec des yeux hors de la tête. Un vrai miracle qu'il n'ait pas été réduit en bouillie par un taxi étant donné la façon dont il traverse les grandes artères de Manhattan à l'heure du déjeuner.
Trente-trois ans, et toujours à mater et à se monter le bourrichon sur chaque fille qui croise les jambes en face de lui dans le métro. Toujours à se maudire de ne pas avoir adressé la parole à la succulente paire de nichons qui monta vingt-cinq étages seule avec lui dans l'ascenseur! Puis à sa maudire aussi bien pour le motif inverse! Car il est bien connu qu'il a abordé dans la rue des filles d'aspect en tous points respectable et, en dépit du fait que depuis son apparition sur l'écran de la télé, un dimanche matin, son visage n'est pas totalement inconnu d'une fraction éclairée du public - en dépit du fait qu'il se rend peut-être à l'appartement de sa maîtresse du moment pour y dîner - il est bien connu qu'en telle ou telle occasion, il a murmuré, "Dites donc, vous ne voulez pas venir chez moi?" Bien entendu, elle va répondre, "Non". Bien entendu, elle va hurler, "Fichez-moi le camp, espèce de ...!" ou répondre d'un ton sec, "J'ai déjà un charmant chez moi, merci, avec un mari dedans." Que fait-il de lui-même, cet imbécile! Ce crétin! Ce sournois! Cet obsédé sexuel!
He simply cannot - will not -control the fires in his putz, the fevers in his brain, the desire continual y burning within for the new, the wild, the unthought-of and, if you can imagine such a thing, the undreamt-of. Where cunt is concerned he lives in a condition that has neither diminished nor in any significant way been refined from what it was when he was fifteen years old and could not get up from his seat in the classroom without hiding a hard-on beneath his threering notebook. Every girl he sees turns out (hold your hats) to be carrying around between her legs–a real cunt. Amazing!
Astonishing! Stil can't get over the fantastic idea that when you are looking at a girl, you are looking at somebody who is guaranteed to have on her–a cunt! They al have cunts!
Tout simplement il ne peut pas - il ne veut pas - réprimer le feu qui lui ronge le chibre, la fièvre qui lui délabre le cerveau, le désir qui le dévore en permanence, de l'inédit, du neuf, de l'extravagant, du jamais conçu et, si vous êtes capable d'imaginer une chose pareille, du jamais rêvé. En matière de con, il continue à vivre dans un état qui ne s'est jamais démenti et n'a subi aucun raffinement depuis qu'il avait quinze ans et ne pouvait se lever de son banc de classe sans cacher sa trique derrière son cahier à trois anneaux..."

"The Breast" (1972)
"I AM A BREAST. A phenomenon that has been variously described to me as “a massive hormonal influx,” “an endocrinopathic catastrophe,” and/or “a hermaphroditic explosion of chromosomes” took place within my body between midnight and 4 A.M. on February 18, 1971, and converted me into a mammary gland disconnected from any human form, a mammary gland such as could only appear, one would have thought, in a dream or a Dali painting. They tell me that I am now an organism with the general shape of a football, or a dirigible; I am said to be of spongy consistency, weighing one hundred and fifty-five pounds (formerly I was one hundred and sixty-five), and measuring, still, six feet in length. Though I continue to retain, in damaged and “irregular” form, much of the cardiovascular and central nervous systems, an excretory system described as “reduced and primitive,” and a respiratory system that terminates just above my midsection in something resembling a navel with a flap, the basic architecture in which these human characteristics are disarranged and buried is that of the breast of the mammalian female.
The bulk of my weight is fatty tissue. At one end I am rounded off like a watermelon, at the other I terminate in a nipple, cylindrical in shape, projecting five inches from my “body” and perforated at the tip with seventeen openings, each about half the size of the male urethral orifice. These are the apertures of the lactiferous ducts. As I am able to understand it without the benefit of diagrams—I am sightless—the ducts branch back into lobules composed of the sort of cells that secrete the milk that is carried to the surface of the normal nipple when it is being suckled, or milked by machine. My flesh is smooth and “youthful,” and I am still a “Caucasian.”
Tel un Gregor Samsa des temps modernes, le professeur David Kepesh se réveille un matin pour découvrir qu'il a été transformé. Mais là où le protagoniste de Kafka s'est transformé en scarabée géant, le narrateur de la fantaisie de Philip Roth est devenu un sein féminin de 155 livres. Il s'ensuit une exploration délirante, drôle et touchante des implications de la métamorphose de Kepesh - un livre audacieux et hérétique qui nous confronte à l'étrangeté intrinsèque du sexe et de la subjectivité...

Zuckerman Bound (1979 - 1985) - 1969, après la parution de romans moins appréciés par la critique, Roth, qui enseigne depuis quatre ans à l'université de Pennsylvanie, publie "Portnoy's Complaint", un roman qui fait scandale en donnant la parole à un personnage dont les deux occupations principales sont la masturbation et l'ingestion de nourriture. Le style de l'auteur est composé d'irrévérence, d'humour salace et d'autodérision ; ses personnages principaux peuvent aisément émarger au rang d'antihéros tant ils doutent de leurs choix et peinent à sortir de l'enfance. En 1972, "The Breast", récit de la métamorphose d'un narrateur en sein de femme, consacre l'écrivain qui est élu à l'American Academy of Arts and Sciences. Roth a effectué son premier voyage à Prague l'année précédente et s'est installé dans une vieille ferme du Connecticut, son logis jusqu'à la fin de sa vie.
Puis survient l'alter ego de l'écrivain, et plus encore. A travers Zuckerman, Roth va s'attaquer aux problèmes de la célébrité, de la littérature et de son identité juive dans une séquence de cinq romans...
En 1974, "My Life as a Man" introduit Nathan Zuckerman, le protagoniste des nouvelles rédigées par un narrateur-écrivain nommé Peter Tamopol. Double dédoublement et mise en abyme du métier d'écrivain : Roth donne voix à Peter qui donne voix à Nathan, et ouvre ainsi le "cycle Zuckerman". La même année, il fonde aux célèbres éditions Penguin la collection Writers from the Other Europe et œuvre pour la traduction et la diffusion des écrivains d”Europe de l'Est. Le cycle Zuckerman se poursuit, en 1979, "The Ghost Writer" voit Nathan Zuckerman, le narrateur, se souvenir du jeune écrivain qu'il fut vingt ans auparavant; en 1981, "Zuckerman Unbound" nous expose son héros devenu si riche et si célèbre qu'il est harcelé par un admirateur persuadé d'étre également écrivain; dans "The Anatomy lesson" (1983) nous assistons à la chute d'un Nathan Zuckerman que la maladie rend incapable d'écrire : le récit de ses souffrances occupe toute sa vie et remplace son activité d'écrivain. En 1985, c'est "The Prague Orgy", Nathan Zuckerman retrouve vie auprès d'écrivains contestataires d'Europe de l'Est qui, loin des débats d'idées, 'entraînent dans des ébats sexuels. 1986, avec "The Counterlife", c'est la fin des aventures de Nathan Zuckerman entrelaçant vies rêvées ou réelles, le chef-d'œuvre de Roth dans lequel chacun aspire à la condition de l'autre et l'idée même d'un soi devient une fabrication à la fois héroïque et à double sens. Mais il faut attendre 2007 pour assister à la dernière apparition du personnage de Nathan Zuckerman, "Exit Ghost" ...
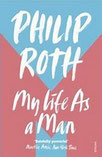
"My Life as a Man" (1974, Ma vie d'homme)
Une fiction-dans-une-fiction, un édifice labyrinthique de méditations drôles, tristes et déchirantes sur l’impasse fatale entre un homme et une femme, "My Life as a Man" est le roman le plus brûlant de Roth, dit-on. Son cœur en est le mariage de Pierre et de Maureen Tarnopol, jeune écrivain doué et une femme qui veut être sa muse mais qui est plutôt son ennemi juré. Leur union est basée sur la fraude, étayée par le chantage moral, mais elle est si perversement durable que, longtemps après la mort de Maureen, Peter essaie toujours — et échoue - d’écrire à sa façon. Et tout débute ainsi ...
Salad Days
First, foremost, the puppyish, protected upbringing above his father’s shoe store in Camden. Seventeen years the adored competitor of that striving, hotheaded shoedog (that’s all, he liked to say, a lowly shoedog, but just you wait and see), a man who gave him Dale Carnegie to read so as to temper the boy’s arrogance, and his own example to inspire and strengthen it. “Keep up that cockiness with people, Natie, and you’ll wind up a hermit, a hated person, the enemy of the world—“ Meanwhile, downstairs in his store, Polonius displayed nothing but contempt for any employee whose ambition was less fierce than his own. Mr. Z.—as he was called in the store, and at home by his little son when the youngster was feeling his oats—Mr. Z. expected, demanded., that by the end of the workday his salesmen and his stock boy should each have as stupendous a headache as he did. That the salesmen, upon quitting, invariably announced that they hated his guts, always came to him as a surprise: he expected a young fellow to be grateful to a boss who relentlessly goaded him to increase his commissions. He couldn’t understand why anyone would want less when he could have more, simply, as Mr. Z. put it, “by pushing a little.” And if they wouldn’t push, he would do it for them:
“Don’t worry,” he admitted proudly, “I’m not proud,” meaning by that apparently that he had easy access to his wrath when confronted with another’s imperfection.
Tout d'abord, l'éducation chétive et protégée au-dessus du magasin de chaussures de son père à Camden. Pendant dix-sept ans, il a été le concurrent adoré de ce chien de course ambitieux (c'est tout, se plaisait-il à dire, un humble chien de course, mais attendez de voir), un homme qui lui a donné Dale Carnegie à lire pour tempérer l'arrogance du garçon, et son propre exemple pour l'inspirer et la renforcer. "Pendant ce temps, en bas, dans son magasin, Polonius n'affichait que du mépris pour tout employé dont l'ambition était moins féroce que la sienne. M. Z. - comme on l'appelait dans le magasin, et à la maison par son petit fils quand celui-ci se sentait d'attaque - M. Z. s'attendait, exigeait, qu'à la fin de la journée de travail, ses vendeurs et son magasinier aient tous deux un mal de tête aussi épouvantable que le sien. Le fait que les vendeurs, en quittant le travail, annonçaient invariablement qu'ils le détestaient, le surprenait toujours : il s'attendait à ce qu'un jeune homme soit reconnaissant envers un patron qui l'incitait sans cesse à augmenter ses commissions. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un voulait moins alors qu'il pouvait avoir plus, simplement, comme le disait M. Z., "en poussant un peu". Et s'ils ne voulaient pas pousser, il le ferait à leur place :
"Ne vous inquiétez pas", admettait-il fièrement, "je ne suis pas fier", ce qui signifiait apparemment qu'il avait facilement accès à son courroux lorsqu'il était confronté à l'imperfection d'un autre.
And that went for his own flesh and blood as well as the hired help. For example, there was the time (and the son would never forget it—in part it may even account for what goaded him to be “a writer”), there was the time the father caught a glimpse of his little Nathan’s signature across the face of a booklet the child had prepared for school, and nearly blew their house down.
The nine-year-old had been feeling self-important and the signature showed it. And the father knew it. “This is the way they teach you to sign your name, Natie? This is supposed to be the signature that somebody on the other end is supposed to read and have respect for? Who the hell can read something that looks like a train wreck! Goddam it, boy, this is your name. Sign it right!”
Et cela valait aussi bien pour sa propre chair et son sang que pour les employés. Par exemple, il y a eu la fois (et le fils ne l'oubliera jamais - c'est peut-être même en partie ce qui l'a poussé à devenir "écrivain"), il y a eu la fois où le père a aperçu la signature de son petit Nathan sur la face d'un livret que l'enfant avait préparé pour l'école, et a failli faire exploser leur maison.
L'enfant de neuf ans s'était senti imbu de sa personne et la signature le montrait. Et le père le savait. "C'est comme ça qu'on t'apprend à signer ton nom, Natie ? C'est censé être la signature que quelqu'un à l'autre bout du fil est censé lire et respecter ? Qui diable peut lire quelque chose qui ressemble à une épave de train ! Bon sang, mon garçon, c'est ton nom. Signe-le bien !"
The self-important child of the self-important shoedog bawled in his room for hours afterward, all the while strangling his pillow with his bare hands until it was dead. Nonetheless, when he emerged in his pajamas at bedtime, he was holding by its topmost corners a sheet of white paper with the letters of his name, round and legible, engraved in black ink at the center. He handed it over to the tyrant: “Is this okay?” and in the next instant was lifted aloft into the heaven of his father’s bristly evening stubble. “Ah, now that’s a signature!
That’s something you can hold your head up about! This I’m going to tack up over the counter in the store!” And he did just that, and then led the customers (most of whom were Negroes) all the way around behind the register, where they could get a really close look at the little boy’s signature. “What do you think of that!” he would ask, as though the name were in fact appended to the Emancipation Proclamation.
L'enfant prétentieux du chien prétentieux a braillé dans sa chambre pendant des heures, tout en étranglant son oreiller à mains nues jusqu'à ce qu'il soit mort. Néanmoins, lorsqu'il émergea en pyjama à l'heure du coucher, il tenait par les coins supérieurs une feuille de papier blanc avec les lettres de son nom, rondes et lisibles, gravées à l'encre noire au centre. Il l'a tendue au tyran : "L'instant d'après, il s'éleva dans le ciel des poils hérissés du soir de son père. "Ah, ça c'est une signature !
C'est quelque chose dont on peut se réjouir ! Je vais l'apposer sur le comptoir du magasin !". C'est ce qu'il fait, puis il entraîne les clients (dont la plupart sont des Noirs) derrière la caisse, où ils peuvent voir de très près la signature du petit garçon. "Que pensez-vous de cela ?" demandait-il, comme si le nom était en fait annexé à la Proclamation d'émancipation.
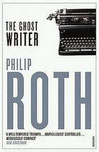
"The Ghost Writer" (1979)
Portrait of the Writer as a Young Man - Dix ans après Portnoy's Complaint, Roth a publié The Ghost Writer, un court roman dans lequel l'irrévérence et la comédie (et, la masturbation) se fondent dans un récit qui explore avec une maîtrise créative presque sereine tous les thèmes antérieurs de Roth. The Ghost Writer constituera plus tard la première des quatre sections de "Zuckerman Bound" ...
1. Maestro
It was the last daylight hour of a December afternoon more than twenty years ago—I was twenty-three, writing and publishing my first short stories, and like many a Bildungsroman hero before me, already contemplating my own massive Bildungsroman—when I arrived at his hideaway to meet the great man. The clapboard farmhouse was at the end of an unpaved road twelve hundred feet up in the Berkshires, yet the figure who emerged from the study to bestow a ceremonious greeting wore a gabardine suit, a knitted blue tie clipped to a white shirt by an unadorned silver clasp, and well-brushed ministerial black shoes that made me think of him stepping down from a shoeshine stand rather than from the high altar of art. Before I had composure enough to notice the commanding, autocratic angle at which he held his chin, or the regal, meticulous, rather dainty care he took to arrange his clothes before sitting—to notice anything, really, other than that I had miraculously made it from my unliterary origins to here, to him—my impression was that E. I. Lonoff looked more like the local superintendent of schools than the region’s most original storyteller since Melville and Hawthorne.
C'était la dernière heure d'un après-midi de décembre, il y a plus de vingt ans - j'avais vingt-trois ans, j'écrivais et publiais mes premières nouvelles et, comme beaucoup de héros de Bildungsroman avant moi, j'envisageais déjà mon propre Bildungsroman - lorsque je suis arrivé à son refuge pour rencontrer le grand homme. La ferme en planches à clin se trouvait au bout d'une route non goudronnée, à 1 200 mètres d'altitude dans les Berkshires, mais le personnage qui sortit du bureau pour me saluer cérémonieusement portait un costume en gabardine, une cravate bleue tricotée attachée à une chemise blanche par un fermoir en argent sans ornement, et des chaussures noires ministérielles bien brossées qui me firent penser qu'il descendait d'un stand de cirage plutôt que du grand autel de l'art. Avant d'avoir suffisamment de sang-froid pour remarquer l'angle autoritaire et autocratique de son menton, ou le soin royal, méticuleux et plutôt délicat qu'il mettait à arranger ses vêtements avant de s'asseoir - pour remarquer quoi que ce soit, en fait, si ce n'est que j'étais miraculeusement parvenu de mes origines non littéraires jusqu'ici, jusqu'à lui - mon impression fut qu'E. I. Lonoff ressemblait davantage au surintendant local des écoles qu'au conteur le plus original de la région depuis Melville et Hawthorne.
Not that the New York gossip about him should have led me to expect anything more grand. When I had recently raised his name before the jury at my first Manhattan publishing party—I’d arrived, excited as a starlet, on the arm of an elderly editor—Lonoff was almost immediately disposed of by the wits on hand as though it were comical that a Jew of his generation, an immigrant child to begin with, should have married the scion of an old New England family and lived all these years “in the country”—that is to say, in the goyish wilderness of birds and trees where America began and long ago had ended. However, since everybody else of renown I mentioned at the party also seemed slightly amusing to those in the know, I had been skeptical about their satiric description of the famous rural recluse. In fact, from what I saw at that party, I could begin to understand why hiding out twelve hundred feet up in the mountains with just the birds and the trees might not be a bad idea for a writer, Jewish or not.
Non pas que les ragots new-yorkais à son sujet m'aient amenée à m'attendre à quelque chose de plus grandiose. Lorsque j'ai récemment soulevé son nom devant le jury lors de ma première soirée d'édition à Manhattan - j'étais arrivée, excitée comme une starlette, au bras d'un éditeur âgé - Léonoff a été presque immédiatement éliminé par les esprits présents, comme s'il était comique qu'un juif de sa génération, un enfant d'immigrant pour commencer, ait épousé le rejeton d'une vieille famille de Nouvelle-Angleterre et vécu toutes ces années "à la campagne" - c'est-à-dire dans le désert goyish d'oiseaux et d'arbres où l'Amérique a commencé et s'est achevée il y a longtemps. Cependant, étant donné que toutes les autres personnes de renom que j'ai mentionnées lors de la fête semblaient également légèrement amusantes aux yeux des connaisseurs, j'étais sceptique quant à leur description satirique du célèbre reclus rural. En fait, d'après ce que j'avais vu à cette fête, je commençais à comprendre pourquoi se cacher à 300 mètres d'altitude dans les montagnes, avec seulement les oiseaux et les arbres, n'était pas une mauvaise idée pour un écrivain, juif ou non.
The living room he took me into was neat, cozy, and plain: a large circular hooked rug, some slipcovered easy chairs, a worn sofa, a long wall of books, a piano, a phonograph, an oak library table systematically stacked with journals and magazines. Above the white wainscoting, the pale-yellow walls were bare but for half a dozen amateur watercolors of the old farmhouse in different seasons. Beyond the cushioned windowseats and the colorless cotton curtains tied primly back I could see the bare limbs of big dark maple trees and fields of driven snow. Purity. Serenity. Simplicity. Seclusion. All one’s concentration and flamboyance and originality reserved for the grueling, exalted, transcendent calling. I looked around and I thought, This is how I will live..."
Le salon dans lequel il me conduisit était soigné, confortable et sobre : un grand tapis circulaire au crochet, quelques fauteuils recouverts de housses, un canapé usé, un long mur de livres, un piano, un phonographe, une table de bibliothèque en chêne systématiquement empilée avec des revues et des magazines. Au-dessus du lambris blanc, les murs jaune pâle étaient nus, à l'exception d'une demi-douzaine d'aquarelles d'amateurs représentant la vieille ferme à différentes saisons. Au-delà des sièges de fenêtre coussinés et des rideaux de coton incolore noués avec soin, je pouvais voir les branches dénudées de grands érables sombres et des champs de neige battue. Pureté. Sérénité. Simplicité. L'isolement. Toute la concentration, la flamboyance et l'originalité d'une personne sont réservées à la vocation éreintante, exaltée et transcendante. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit : "Voilà comment je vais vivre...".
Le narrateur est un écrivain de quarante-trois ans, Nathan Zuckerman, qui se remémore ses vingt-trois ans alors qu'il se rend en pèlerinage dans la retraite du Berkshire de son maître littéraire, E. I. Lonoff. L'apprenti, dont les premières histoires l'ont mis dans le même genre d'eau chaude que Roth avait fait bouillir avec Goodbye, Columbus, est à la recherche d'un père artistique pour lui offrir sagesse et conseils, maintenant que sa relation avec son vrai père, un podologue de Newark, a été mise à rude épreuve par les libertés artistiques que Nathan a prises avec des portraits de famille fictifs. L'observation par Zuckerman de la vie quotidienne de son héros qui vit en reclus ("I don’t know anybody. I turn sentences around, and that’s it", dit Lonoff) et de sa femme désespérément malheureuse ("I got fondled by more strangers on the rush-hour subway during two months in 1935 than I have up here in the last twenty years!", dit Mme Lonoff) ouvre les yeux du jeune disciple sur les terreurs domestiques de la consécration artistique. Mais c'est le fantasme qu'il développe autour de la charmante ancienne étudiante qui perturbe le mariage des Lonoff ("It’s just —that you bear some resemblance to Anne Frank,", lui dit Zuckerman) qui transforme cette courte fiction d'un simple conte en une œuvre d'imagination complexe, presque dangereusement inventive. Et Roth a passé un demi-siècle à tourner des phrases autour des thèmes de la famille et de l'indépendance, de l'identité ethnique et de l'assimilation, de la vocation artistique et des plaisirs humains ordinaires, mais il ne les a jamais tournées avec autant de créativité que dans The Ghost Writer.
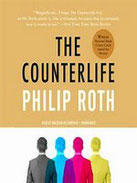
"The Counterlife" (1986, La Contrevie)
"The Counterlife", c'est la fin des aventures de Nathan Zuckerman entrelaçant vies rêvées ou réelles, le chef-d'œuvre de Roth dans lequel chacun aspire à la condition de l'autre et l'idée même d'un soi devient une fabrication à la fois héroïque et à double sens...
3. Aloft
SHORTLY AFTER the seat-belt sign went off a group of religious Jews formed a minyan up by the bulkhead. I couldn’t hear them over the noise of the engines, but in the sunlight streaming through the safety-exit window I could see the terrific clip at which they were praying. Off and running faster than a Paganini Caprice, they looked like their objective was to pray at supersonic speed—praying itself they made to seem a feat of physical endurance. It was hard to imagine another human drama as intimate and frenzied being enacted so shamelessly in a public conveyance. Had a pair of passengers thrown off their clothes and, in a fit of equally unabashed fervor, begun making love out in the aisle, watching them wouldn’t have seemed to me any more voyeuristic.
PEU DE TEMPS APRÈS que le signal de port de la ceinture se soit éteint, un groupe de juifs religieux a formé un minyan près de la cloison. Je ne pouvais pas les entendre à cause du bruit des moteurs, mais à la lumière du soleil qui traversait la fenêtre de l'issue de secours, je pouvais voir le rythme effréné auquel ils priaient. Plus rapides qu'un Caprice de Paganini, ils semblaient avoir pour objectif de prier à une vitesse supersonique - priant eux-mêmes, ils donnaient l'impression d'un exploit d'endurance physique. Il était difficile d'imaginer qu'un autre drame humain aussi intime et frénétique puisse se jouer de manière aussi éhontée dans un moyen de transport public. Si deux passagers s'étaient déshabillés et, dans un élan de ferveur tout aussi débridé, avaient commencé à faire l'amour dans l'allée, les regarder ne m'aurait pas semblé plus voyeuriste.
Though numbers of Orthodox Jews were seated throughout the tourist cabin, at my side was an ordinary American Jew like myself, a smallish man in his middle thirties, clean-shaven and wearing horn-rimmed glasses, who was alternately leafing through that morning’s Jerusalem Post—the Israeli English-language paper—and looking with curiosity at the covered heads
bobbing and jerking in that square blaze of sunlight up by the bulkhead. Some fifteen minutes out of Tel Aviv he turned and asked in a friendly voice,
“Visiting Israel or on business?”
“Just a visit.”
“Well,” he said, putting aside his paper, “what are your feelings about what you saw?”
“Sorry?”
“Your feelings. Were you moved? Were you proud?”
Henry was still very much on my mind, and so rather than indulge my neighbor—what he was fishing for was pretty clear—I said, “Don’t follow you,” and reached into my briefcase for a pen and a notebook. I had the urge to write my brother.
“You’re Jewish,” he said, smiling.
“I am.”
“Well, didn’t you have any feelings when you saw what they’ve done?”
“Don’t have feelings.”
“But did you see the citrus farms? Here are the Jews, who aren’t supposed to be able to farm—and there are those miles and miles of farms. You can’t imagine my feelings when I saw those farms. And the Jewish farmers! They took me out to an Air Force base—I couldn’t believe my eyes. Weren’t you moved by anything?”
Bien que de nombreux juifs orthodoxes aient pris place dans la cabine touristique, à mes côtés se trouvait un juif américain ordinaire comme moi, un petit homme d'une trentaine d'années, rasé de près et portant des lunettes à monture en corne, qui feuilletait tour à tour le Jerusalem Post du matin - le journal israélien en langue anglaise - et regardait avec curiosité les têtes couvertes qui se balançaient et se secouaient dans ce rayon de soleil carré, près de la cloison. À une quinzaine de minutes de Tel Aviv, il se retourna et demanda d'une voix amicale : "En visite en Israël ou pour affaires ?
"En visite en Israël ou pour affaires ?"
"Juste une visite.
"Eh bien", dit-il en mettant de côté son journal, "que pensez-vous de ce que vous avez vu ?".
"Pardon ?"
"Vos sentiments. Avez-vous été ému ? Etes-vous fier ?"
Henri était encore très présent dans mon esprit et, plutôt que de répondre à mon voisin - ce qu'il cherchait à savoir était assez clair - j'ai dit : "Je ne vous suis pas" et j'ai pris un stylo et un carnet dans mon porte-documents. J'ai eu envie d'écrire à mon frère.
Il me dit en souriant : "Tu es juif".
"Je le suis.
"Tu n'as pas ressenti de sentiments en voyant ce qu'ils ont fait ?"
"Je n'ai pas de sentiments."
"Mais avez-vous vu les fermes d'agrumes ? Voici les Juifs, qui ne sont pas censés pouvoir cultiver la terre, et il y a des kilomètres et des kilomètres de fermes. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti en voyant ces fermes. Et les agriculteurs juifs ! Ils m'ont emmené sur une base de l'armée de l'air - je n'en croyais pas mes yeux. Rien ne vous a ému ?"
I thought, while listening to him, that if his Galician grandfather were able to drop in on a tour from the realm of the dead upon Chicago, Los Angeles, or New York, he might well express just such sentiments, and with no less amazement: “We aren’t supposed to be Americans—and there are those millions and millions of American Jews! You can’t imagine my feelings when I saw how American they looked!” How do you explain this American-Jewish inferiority complex when faced with the bold claims of militant Zionism that
they have the patent on Jewish self-transformation, if not on boldness itself?
“Look,” I said to him, “I can’t answer these kinds of questions.”
“Know what I couldn’t answer? They kept wanting me to explain why American Jews persist in living in the Diaspora—and I couldn’t answer. After everything I’d seen, I didn’t know what to say. Does anybody know? Can anyone answer?”
En l'écoutant, j'ai pensé que si son grand-père galicien pouvait faire une visite du royaume des morts à Chicago, Los Angeles ou New York, il exprimerait exactement les mêmes sentiments, et avec non moins d'étonnement : "Nous ne sommes pas censés être Américains et il y a ces millions et ces millions de Juifs américains ! Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai vu à quel point ils avaient l'air américains ! Comment expliquer ce complexe d'infériorité américano-juif face à l'audace du sionisme militant qui prétend détenir le brevet de l'auto-transformation juive, voire de l'audace tout court ?
"Je lui ai dit : "Je ne peux pas répondre à ce genre de questions."
"Vous savez ce que je n'ai pas pu répondre ? Ils me demandaient sans cesse d'expliquer pourquoi les Juifs américains s'obstinaient à vivre en diaspora, et je ne pouvais pas répondre. Après tout ce que j'avais vu, je ne savais pas quoi dire. Quelqu'un le sait-il ? Quelqu'un peut-il répondre ?
Poor guy. Sounds like he must have been plagued by this thing - probably been on the defensive night and day about his artificial identity and totally alienated position. They said to him, “Where is Jewish survival, where is Jewish security, where is Jewish history? If you were really a good Jew you’d be in Israel, a Jew in a Jewish society.” They said to him, “The one place in the world that’s really Jewish and only Jewish is Israel”- and he was too cowed by the moral one-upmanship even to recognize, let alone admit, that that was one of the reasons he didn’t want to live there.
“Why is it?” he was asking, his helplessness in the face of the question now rather touching. “Why do Jews persist in living in the Diaspora?”
I didn’t feel like writing off with one line a man obviously in a state of serious confusion, but I didn’t want this conversation either, and wasn’t in the mood to answer in detail. That I would save for Henry. The best I could try to do was to leave him with something to think about. “Because they like it,” I replied, and got up and moved to an empty aisle seat a few rows back where I could concentrate undisturbed on what more, if anything, to say to Henry about the wonder of his new existence.
Pauvre homme. On dirait qu'il a dû être tourmenté par cette chose - probablement sur la défensive nuit et jour à propos de son identité artificielle et de sa position totalement aliénée. Ils lui ont dit : "Où est la survie juive, où est la sécurité juive, où est l'histoire juive ? Si tu étais vraiment un bon Juif, tu serais en Israël, un Juif dans une société juive". Ils lui ont dit : "Le seul endroit au monde qui soit vraiment juif et uniquement juif, c'est Israël" - et il était trop intimidé par cette surenchère morale pour reconnaître, et encore moins admettre, que c'était l'une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas vivre là-bas.
Il demandait : "Pourquoi cela ?", son impuissance face à la question étant maintenant plutôt touchante. "Pourquoi les Juifs s'obstinent-ils à vivre en diaspora ?
Je n'avais pas envie d'éliminer d'un trait un homme manifestement dans un état de confusion grave, mais je n'avais pas non plus envie de cette conversation et je n'étais pas d'humeur à répondre en détail. Je garderai cela pour Henry. Le mieux que je puisse faire, c'est de lui donner matière à réflexion. "Parce qu'ils aiment ça", répondis-je, et je me levai pour aller m'asseoir dans un couloir vide, quelques rangées plus loin, où je pourrais me concentrer sans être dérangée sur ce qu'il y avait encore à dire à Henry à propos de la merveille de sa nouvelle existence.
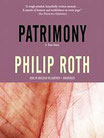
"Patrimony" (1991)
Patrimony, une histoire vraie qui touche par l'émotion qu'elle suscite, une émotion que Philip Roth n'avait jamais autant révélé jusque-là. Roth observe son père de quatre-vingt-six ans, célèbre pour sa vigueur, son charme et son répertoire de souvenirs de Newark, lutter contre la tumeur cérébrale qui le tuera. Le fils, plein d'amour, d'anxiété et d'effroi, accompagne son père à chaque étape dramatique de sa dernière épreuve et, ce faisant, révèle la ténacité survivaliste qui a caractérisé le long et obstiné engagement de son père dans la vie...
Well, WhatDo You Think?
My father had lost most of the sight in his right eye by the time he’d reached eighty-six, but otherwise he seemed in phenomenal health for a man his age when he came down with what the Florida doctor diagnosed, incorrectly, as Bell’s palsy, a viral infection that causes paralysis, usually temporary, to one side of the face.
The paralysis appeared, out of nowhere, the day after he had flown from New Jersey to West Palm Beach to spend the winter months sharing a sublet apartment with a retired bookkeeper of seventy, Lillian Beloff, who lived upstairs from him in Elizabeth and with whom he had become romantically involved a year after my mother died in 1981. At the West Palm airport, he had been feeling so fit that he hadn’t even bothered with a porter (whom, besides, he would have had to tip) and carried his own luggage from the baggage area all the way out to the taxi stands. Then the next morning, in the bathroom mirror, he saw that half his face was no longer his. What had looked like him the day before now looked like nobody - the lower lid of the bad eye bagged downward, revealing the lid’s inner lining, the cheek on that side had gone slack and lifeless as though beneath the bone had been filleted, and his lips were no longer straight but drawn down diagonally across his face.
Mon père avait perdu la majeure partie de la vue de son œil droit à l'âge de quatre-vingt-six ans, mais il semblait par ailleurs en parfaite santé pour un homme de son âge lorsqu'il a été atteint de ce que le médecin de Floride a diagnostiqué, à tort, comme étant la paralysie de Bell, une infection virale qui provoque une paralysie, généralement temporaire, d'un côté du visage.
La paralysie est apparue, sortie de nulle part, le lendemain du jour où il avait pris l'avion du New Jersey pour West Palm Beach afin de passer les mois d'hiver en partageant un appartement sous-loué avec une comptable retraitée de soixante-dix ans, Lillian Beloff, qui vivait à l'étage au-dessus du sien à Elizabeth et avec laquelle il avait noué une relation amoureuse un an après la mort de ma mère, en 1981. À l'aéroport de West Palm, il s'était senti si en forme qu'il n'avait même pas pris la peine de faire appel à un porteur (qu'il aurait d'ailleurs dû laisser en guise de pourboire) et avait porté lui-même ses bagages de la zone des bagages jusqu'aux stations de taxis. Le lendemain matin, dans le miroir de la salle de bains, il constate que la moitié de son visage n'est plus la sienne. Ce qui lui ressemblait la veille ne ressemblait plus à personne - la paupière inférieure du mauvais œil s'était rabattue vers le bas, révélant la doublure de la paupière, la joue de ce côté était devenue molle et sans vie, comme si l'os avait été coupé en dessous, et ses lèvres n'étaient plus droites, mais descendaient en diagonale sur son visage.
With his hand he pushed the right cheek back to where it had been the night before, holding it there for the count of ten. He did this repeatedly that morning—and every day thereafter—but when he let go, it wouldn’t stay. He tried to tell himself that he had lain the wrong way in bed, that his skin was simply furrowed from sleep, but what he believed was that he’d had a stroke. His father had been crippled by a stroke back in the early 1940s, and once he’d become an old man himself, he said to me several times, “I don’t want to go the way he did. I don’t want to lie there like that. That’s my worst fear.” He told me how he used to stop off to see his father at the hospital early in the morning on the way downtown to the office and again on his way home at night. Twice a day he lit cigarettes and stuck them in his father’s mouth for him and in the evening he sat beside the bed and read to him from the Yiddish paper. Immobilized and helpless, with only his cigarettes to soothe him, Sender Roth lingered for almost a year, and until a second stroke finished him off late one night in 1942, my father, twice each day, sat and watched him die.
Avec sa main, il repoussa la joue droite jusqu'à l'endroit où elle se trouvait la veille, et la maintint ainsi jusqu'à ce qu'il ait compté jusqu'à dix. Il le fit à plusieurs reprises ce matin-là, et tous les jours qui suivirent, mais lorsqu'il lâchait prise, la joue ne restait pas en place. Il essaya de se dire qu'il s'était couché dans le mauvais sens, que sa peau était simplement sillonnée par le sommeil, mais ce qu'il croyait, c'était qu'il avait eu une attaque. Son père avait été handicapé par une attaque cérébrale au début des années 1940 et, une fois devenu lui-même un vieil homme, il m'a dit à plusieurs reprises : "Je ne veux pas faire comme lui. Je ne veux pas rester allongé comme ça. C'est ma pire crainte." Il m'a raconté comment il s'arrêtait pour voir son père à l'hôpital, tôt le matin, en se rendant au bureau en ville, et de nouveau le soir en rentrant chez lui. Deux fois par jour, il allumait des cigarettes et les mettait dans la bouche de son père, et le soir, il s'asseyait à côté du lit et lui lisait un journal en yiddish. Immobilisé et impuissant, avec seulement ses cigarettes pour le soulager, Sender Roth s'est attardé pendant près d'un an, et jusqu'à ce qu'une seconde attaque cérébrale l'achève tard dans la nuit de 1942, mon père, deux fois par jour, s'est assis et l'a regardé mourir...."
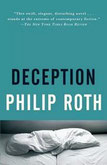
"Deception" (1993)
"One of the unfair things about adultery, when you compare the lover to the spouse, the lover is never seen in those awful dreary circumstances, arguing about the vegetables, or burning toast, or forgetting to ring up for something, or putting upon someone or being put upon" ... "Yes, with the lover everyday life recedes" (avec l’amant, la vie quotidienne recule), écrit Roth. Faisant preuve de tout son talent d'observateur brillant de la passion humaine, il présente dans "Deception" le monde étroitement clos de l'intimité adultère avec une franchise qui n'a pas d'équivalent dans la fiction américaine. Au centre du roman, deux adultères bien dissimulés. Lui est un écrivain américain d'âge moyen nommé Philip, qui vit à Londres, et elle est une Anglaise, intelligente et bien éduquée, compromise par un mariage humiliant auquel, à la trentaine, elle est déjà nerveusement à moitié résignée. L'action du livre, des conversations - principalement celles des amants qui se parlent avant et après avoir fait l'amour. Ce dialogue - vif, riche, enjoué, curieux, "émouvant", comme l'écrit Hermione Lee, "sur une échelle de douleur allant de la désorientation furieuse à la gaieté stoïque" ...
2000 - Les romans précédents de Roth ont explorer cette fameuse énigme de la subjectivité à travers une série de protagonistes qui partagent son éducation juive et qui ne parviennent pas à échapper au récit de la famille et de la culture juives. Portnoy est ainsi enfermé dans un passé qui est circonscrit par sa mère et les orthodoxes « frontières et restrictions », le « None Other » de la loi juive traditionnelle. Il cherche le soulagement dans la masturbation obsessionnelle et un monologue masturbatoire tout aussi obsessionnel. Mais les formes de soulagement, sexuelles et verbales, qu’il ne trouve que pour lui-même ne révèlent que le piège dont il ne peut s'échapper : sans fin, il tourne autour du passé et de la culpabilité qu’il instille. Constamment, comme tant d’hommes juifs piégés par Roth, il regarde avec nostalgie les « goyim » et leur monde. « Ces gens sont les Américains, déclare-t-il, ces chrétiens blonds sont les résidents et les propriétaires légitimes de cet endroit. » Ils occupent le « champ central » plutôt que les marges de la société; et ils lui semblent posséder une liberté du passé, une mobilité et une subjectivité non réflexive et sans contrainte qu’il ne peut que regarder avec envie. Cette perception des « Américains », comme Portnoy les appelle, est un mirage, bien sûr, le produit de son désir ardent, de son imagination rêveuse désireuse d’échapper aux histoires de sa culture. Et, dans beaucoup de ses romans ultérieurs, Roth a exploré à la fois ce mirage et l’utilisation de l’écriture pour refléter l’individualité et la nation.
Une grande partie de la meilleure partie de cette fiction ultérieure considère le destin d’un écrivain, Nathan Zuckerman, tout comme Roth, de sorte que le livre lui-même devient un miroir, un moyen de regarder à travers la fenêtre de la bibliothèque d’autres livres. The Ghost Writer (1979), Zuckerman Unbound (1981), The Anatomy Lesson (1983) et The Prague Orgy (1985) ont ensuite été rassemblés sous le nom de Zuckerman Bound, puis suivis de cinq autres romans de Zuckerman, The Counterlife (1986), American Pastoral (1997), I Married A Communist (1998), The Human Stain (2000) et Exit Ghost (2007).
Certains des autres romans de Roth concernent un autre substitut de l’auteur, un professeur appelé David Kepesh : The Breast (1972), The Professor of Desire (1977) et The Dying Animal (2001). D’autres encore se concentrent sur un écrivain appelé Philip (Deception (1990)) ou Philip Roth (Operation Shylock : A Confession (1993)) ou, comme dans Everyman (2006), un personnage qui reproduit des moments de la vie de l’auteur.
Tous ces livres, aussi autoréférentiels soient-ils à l’origine, se préoccupent non seulement de l’identité personnelle, mais aussi de l’identité de l’Amérique, tout comme le sont les fictions sociales et politiques plus ouvertement de Roth, comme Our Gang (1971) et The Great American Novel (1973). Son travail est peut-être profondément autobiographique, mais il est aussi profondément impliqué dans l’histoire – et l’histoire de l’Amérique en particulier. Il peut être absorbé dans les sujets humains éternels de l’éros et de la mort, le corps humain désirant et en décomposition, mais il n’est pas moins obsédé par les rêves et les déceptions des Américains ordinaires, car ils sont confrontés au changement social et aux conflits historiques, les défis de la division raciale et de l’oppression économique, ce que Roth voit clairement comme le point culminant de l’idéalisme américain et de la cohésion sociale dans les années 1940 et la désintégration ultérieure du rêve américain.
For his next work, "American Pastoral" (1997; film 2016), Roth was awarded a Pulitzer Prize. The novel, about a middle-class couple whose daughter becomes a terrorist, is the first entry in the "American Trilogy series", all three books of which are narrated by Zuckerman. The later installments are "I Married a Communist" (1998) and "The Human Stain" (2000; film 2003). In "The Dying Animal" (2001; filmed as Elegy, 2008), an aging literary professor reflects on a life of emotional isolation...
Un livre comme "The Plot Against America" (2004) imagine un coup d’État antisémite d’extrême droite aux États-Unis qui menace à la fois toute la nation et une famille très particulière, et dans la pastorale américaine, Zuckerman, en essayant de raconter l’histoire d’un homme qu’il voit comme un héros américain archétypal, se retrouve à raconter l’histoire de sa nation : l’histoire pastorale que les Américains se sont inventée de leur innocence autochtone, leur désir de liberté, un espace subjectif pur, et leur sentiment d’abandon et de consternation quand ils ne l’ont pas....
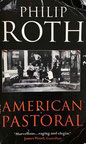
"American Pastoral" (1997)
Swede Levov a tout pour lui : il est beau, c'est un excellent athlète, il est riche, c'est un bon père, un bon fils, un bon citoyen et un bon employeur ; il est marié à une ancienne Miss New Jersey, avec laquelle il a une relation sexuelle plutôt bonne ; il est d'humeur égale, à l'aise avec lui-même, aux manières douces, et très admiré. Philip Roth le présente de manière convaincante et détaillée comme l'un des hommes les plus satisfaits d'Amérique, post-juif, mais profondément conscient de l'histoire récente de sa famille en tant qu'immigré. Pourquoi alors sa fille, Merry, devient-elle une présence si difficile dans la maison, refusant d'abord de se nourrir, puis devenant lentement obsédée par la guerre du Viêt Nam jusqu'à ce qu'elle pose une bombe dans le magasin local, qui est aussi un bureau de poste, et qu'elle disparaisse ? Pourquoi les émeutes de Newark, où se trouve la principale usine Levov, se produisent-elles ?
Roth met en scène les événements marquants de la seconde moitié du siècle aux États-Unis dans la vie d'une famille, dans une conscience toute américaine. Le résultat est un roman intensément captivant et lisible, avec quelques scènes magnifiques, comme une réunion d'anciens élèves pour le quarante-cinquième anniversaire, au cours de laquelle le narrateur rencontre le frère du Suédois parmi beaucoup d'autres, et un dîner épouvantable à la fin du livre, qui doit être le meilleur et le pire dîner de toute la littérature romanesque. Swede Levov est vivant dans ce livre, non pas en tant que type reconnaissable, mais en tant que personnalité unique et étonnamment bien réelle ...

"The Plot Against America" (Le Complot contre l'Amérique, 2004)
"It was work that identified and distinguished our neighbors for me far more than religion" - En 1997, "American Pastoral", prix Pulitzer, contait la contestation violente de l'extrême gauche des années 1970; en 1998, "I Married a Communist" se voulait une réflexion, toujours sur l'histoire récente des États-Unis, en l'occurrence le maccarthysme; en 2000 , "The Human Stain" répond au contexte dans lequel éclate l'affaire Lewinsky. Avec "The Plot Against America", Roth ose mettre à la question de savoir si les Juifs étaient ou non des Américains et continue ainsi d'entrecroiser des éléments autofictionnels avec une réflexion sur les heures les plus noires des Etats-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. C'est histoire de son pays vue sous un angle contrefactuel en imaginant tout simplement que l'aviateur Charles Lindbergh accède en 1940 à la présidence des États-Unis (Franklin Delano Roosevelt accomplira son troisième mandat durant cette période) : le romancier nous décrit quelles auraient été les répercussions de cette élection dans un quartier peuplé de familles juives modestes du New Jersey, qui ressemble à s'y tromper à celui de son enfance. Pendant deux ans, de juin 1940 à octobre 1942, et son "alternative history" invite à une singulière expérience immersive de la peur avec l'hypothèse d'une dérive de la démocratie américaine vers l'antisémitisme et l'isolationisme (Lindbergh nous est dépeint s'empressant de signer un pacte de non-agression avec Hitler), une dérive vécue par un enfant de 7 à 9 ans dont l'identité intime se forge à partir de cet événement fictif : "C'est la peur qui préside à ces Mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreurs, mais tout de même : aurais-je été aussi craintif si nous n'avions pas eu Lindbergh pour président, ou si je n'étais pas né dans une famille juive ?" ...
Le quartier Weequahic de Newark, où il a grandi et qui est devenu dans son écriture une sorte d'Eden disparu, était un lieu de fierté de la classe moyenne, un lieu de frugalité et d'aspiration, un endroit où personne n'ignorait "le pouvoir d'intimider qui émanait du plus haut et du plus bas de l'Amérique des Gentils", où être juif et être américain étaient pratiquement indiscernables...
" We were a happy family in 1940. My parents were outgoing, hospitable people, their friends culled from among my father’s associates at the office and from the women who along with my mother had helped to organize the Parent-Teacher Association at newly built Chancellor Avenue School, where my brother and I were pupils. All were Jews. The neighborhood men either were in business for themselves—the owners of the local candy store, grocery store, jewelry store, dress shop, furniture shop, service station, and delicatessen, or the proprietors of tiny industrial job shops over by the Newark-Irvington line, or self-employed plumbers, electricians, housepainters, and boilermen—or were foot-soldier salesmen like my father, out every day in the city streets and in people’s houses, peddling their wares on commission. The Jewish doctors and lawyers and the successful merchants who owned big stores downtown lived in one-family houses on streets branching off the eastern slope of the Chancellor Avenue hill, closer to grassy, wooded Weequahic Park, a landscaped three hundred acres whose boating lake, golf course, and harness-racing track separated the Weequahic section from the industrial plants and shipping terminals lining Route 27 and the Pennsylvania Railroad viaduct east of that and the burgeoning airport east of that and the very edge of America east of that—the depots and docks of
Newark Bay, where they unloaded cargo from around the world.
At the western end of the neighborhood, the parkless end where we lived, there resided an occasional schoolteacher or pharmacist but otherwise few professionals were among our immediate neighbors and certainly none of the prosperous entrepreneurial or manufacturing families. The men worked fifty, sixty, even seventy or more hours a week; the women worked all the time, with little assistance from labor-saving devices, washing laundry, ironing shirts, mending socks, turning collars, sewing on buttons, mothproofing
woolens, polishing furniture, sweeping and washing floors, washing windows, cleaning sinks, tubs, toilets, and stoves, vacuuming rugs, nursing the sick, shopping for food, cooking meals, feeding relatives, tidying closets and drawers, overseeing paint jobs and household repairs, arranging for religious observances, paying bills and keeping the family’s books while simultaneously attending to their children’s health, clothing, cleanliness, schooling, nutrition, conduct, birthdays, discipline, and morale. A few women labored alongside their husbands in the family-owned stores on the nearby shopping streets, assisted after school and on Saturdays by their older children, who delivered orders and tended stock and did the cleaning up.
It was work that identified and distinguished our neighbors for me far more than religion. Nobody in the neighborhood had a beard or dressed in the antiquated Old World style or wore a skullcap either outdoors or in the houses I routinely floated through with my boyhood friends....
"Nous étions une famille heureuse, en 1940. Mes parents étaient des gens sociables, hospitaliers, qui trouvaient leurs amis parmi les collègues de mon père et les femmes qui avaient, comme ma mère, aide à monter l'association de parents d'élèves de la toute jeune école de Chancellor Avenue, que nous fréquentions mon frère et moi. Tous étaient juifs. Les hommes du quartier travaillaient à leur compte, marchands de bonbons, épiciers, bijoutiers; ils vendaient des robes, des meubles, tenaient la station-service, la charcuterie casher; ils étaient propriétaires de petits ateliers de fabrique sur la ligne de partage entre Newark et Irvington; ils étaient plombiers, électriciens, peintres ou chauffagistes. D'autres, comme mon père, étaient des pousse-cailloux de la vente qui arpentaient les rues pour démarcher les gens et toucher leur commission. Les médecins juifs, les avocats, les commerçants prospères qui avaient de grands magasins en ville habitaient des pavillons individuels dans les rues à l'est de Chancellor Avenue, plus près de Weequahic Park, ses cent vingt hectares paysagers, ses pelouses, ses bois, son lac où l'on canotait, son parcours de golf, sa piste de courses d'attelage, séparaient cette partie de Weequahic des usines et des zones de fret aux bords de la Route 27 et du viaduc des chemins de fer de Pennsylvanie, puis, plus à l'est, de l'aéroport à peine ébauche, et, plus à l'est encore, au bord de l'Amérique, des hangars et des docks de la baie de Newark, où l'on déchargeait des denrées venues du monde entier.
Côté ouest, ce côté ouest sans parc qui était le nôtre, on trouvait bien un instituteur ou un pharmacien par-ci par-là, mais il n'y avait guère de professions libérales chez nos proches voisins, et sûrement aucune famille d'industriels ou de financiers opulents.
Les hommes travaillaient cinquante, soixante, voire soixante-dix heures et plus par semaine. Les femmes travaillaient tout le temps, sans grand équipement ménager pour les décharger des corvées; elles faisaient la lessive, repassaient les chemises, reprisaient les chaussettes, retournaient les cols, recousaient les boutons, glissaient de la naphtaline dans les lainages, ciraient les meubles, balayaient, passaient la serpillière, faisaient les vitres, récuraient les lavabos, les baignoires, les toilettes, les cuisinières, passaient l'aspirateur sur les tapis, soignaient les malades, faisaient les commissions et la cuisine, nourrissaient la parentèle, mettaient de l'ordre dans les placards, les tiroirs, avec un oeil sur les travaux de peinture, l'entretien de la maison; elles marquaient les fêtes religieuses, payaient les factures, tenaient les comptes du ménage sans perdre de vue les enfants : santé, habillement, scolarité, alimentation, conduite, anniversaires, sans oublier la discipline et la bonne humeur. Quelques-unes trimaient avec leur mari à la boutique familiale, dans les rues commerçantes; le soir après l'école, ainsi que le samedi, leurs aînés venaient les aider, livrer la marchandise, tenir le stock et faire le ménage de la boutique.
C'était par leur travail que j'identifiais et que je distinguais nos voisins, bien plus que par leur religion. Dans notre quartier, aucun homme ne portait la barbe ou le costume désuet du Vieux Monde; on ne portait pas davantage la kippa, ni à l'extérieur ni dans les maisons où j'avais mes entrées chez mes petits camarades. Les adultes ne pratiquaient plus la religion par des signes extérieurs reconnaissables, si tant est qu'ils aient continué de la pratiquer de façon sérieuse, et autour de nous, mis à part des commerçants d'âge mûr comme le tailleur ou le boucher casher, ou encore quelques vieillards malades ou décrépits contraints d'habiter chez leurs enfants adultes, presque personne n'avait d'accent.
En 1940, dans les familles juives du sud-ouest de la plus grande ville du New Jersey, on parlait un anglais américain bien plus proche de celui d`Altoona ou Binghamton que des célèbres dialectes de nos homologues juifs des cinq districts, sur l”autre rive de l'Hudson. Des caractères hébraïques avaient été imprimés au pochoir sur la vitrine du boucher casher, et gravés au fronton des petites synagogues, mais c'étaient bien, avec le cimetière, les seuls endroits où l'on avait l'occasion de rencontrer l'alphabet du livre de prière plutôt que les lettres familières de la langue maternelle en usage à longueur de temps chez presque tout le monde, pour tout propos imaginable, humble ou noble. Au kiosque à journaux, devant la boutique de bonbons du coin, il y avait dix fois plus de lecteurs du Racing Farm et de ses conseils pour les turfistes que du Forvetz, quotidien en yiddish.
Israël n'existait pas encore; en Europe, six millions de Juifs n'avaient pas encore cessé d'exister..."
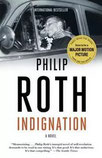
"Indignation" (2008)
Nous sommes en 1951 aux États-Unis, la deuxième année de la guerre de Corée. Marcus Messner, un jeune homme studieux, respectueux des lois et intense, originaire de Newark, dans le New Jersey, entame sa deuxième année sur le campus pastoral et conservateur du Winesburg College, dans l'Ohio. Et pourquoi se trouve-t-il là et non dans le collège local de Newark où il s'était inscrit à l'origine ? Parce que son père, le robuste boucher du quartier, semble être devenu fou - fou de peur et d'appréhension face aux dangers de la vie adulte, aux dangers du monde, aux dangers qu'il voit à chaque coin de rue pour son garçon bien-aimé. Comme la mère, qui souffre depuis longtemps et qui est désespérément harcelée, le dit à son fils, la peur du père provient de l'amour et de la fierté. Peut-être, mais elle produit trop de colère chez Marcus pour qu'il puisse supporter plus longtemps de vivre avec ses parents. Il les quitte et, loin de Newark, dans l'université du Midwest, doit trouver sa voie parmi les coutumes et les contraintes d'un autre monde américain. Indignation, le vingt-neuvième livre de Philip Roth, est une histoire d'inexpérience, de folie, de résistance intellectuelle, de découverte sexuelle, de courage et d'erreur. C'est une histoire racontée avec toute l'énergie inventive et l'esprit dont Roth dispose, à la fois une rupture surprenante avec les récits hantés de la vieillesse et de l'expérience de ses derniers livres et un ajout puissant à ses enquêtes sur l'impact de l'histoire américaine sur la vie de l'individu vulnérable.
En 2010, "Nemesis", qui a pour sujet l'épidémie de polio qui a ravagé les États-Unis au cours de l'été 1941, et qui a particulièrement affecté la communauté juive de Newark, la ville natale de l'auteur. Philip Roth annonce alors qu'il n'écrira plus. Géant de la littérature américaine, l'écrivain est mort d'une insuffisance cardiaque congestive, dans un hôpital de Manhattan à New York, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times et le magazine The New Yorker . Il avait 85 ans. Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark dans le New Jersey, le 19 mars 1933, avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir ...

Stanley Elkin (1930-1995)
Né à Brooklyn, New York, dans une famille juive, d'un père représentant en bijouterie de fantaisie, élevé à Chicago, enseignant dans le département d'anglais de l'Université Washington de Saint-Louis, Stanley Elkin commence à écrire dans les années 60 et publiera une dizaine de romans ("The Magic Kingdom", "The Franchiser"), de courts romans ou "novellas" ("The Bailbondsman") et des recueils de nouvelles ("Criers and Kibitzers, Kibitzers and Criers", "Searches and Seizures") : souvent qualifié de "serious funny writer", encensé par la critique mais ignoré du grand public, Stanley Elkin campe des personnages du Midwest américain, qu'il connaît bien depuis son enfance, des personnages ambigus, entièrement habités par leur vie professionnelle (Ellerbee, le propriétaire du magasin d'alcools de '' The Living End ''; Alexander Main, le Bailbonsman; et Ben Flesh, le franchiseur), embarqués dans des histoires banales, qui tentent, soutenus par un style parlé d'une impressionnante virtuosité, de s'en tirer malgré tout. Son réalisme teinté d'humour noir n'est jamais bien loin de cette littérature de l'absurde qu'il aimait tant dans Camus ou dans Saul Below. Son premier roman, "Boswell: A Modern Comedy" (1964), révèle ce goût de l'absurde : cette biographie de Samuel Johnson adaptée au monde moderne décrit comment lutte désespérement un personnage hanté par le sentiment de son indépassable médiocrité. Avec son second roman, "A Bad Man" (1967), Elkin fut reconnu comme "a bright satirist, a bleak absurdist and a deadly moralist" par la critique littéraire.

Un sale type (A Bad Man, 1965)
Leo Feldman, propriétaire d'un grand bazar, est condamné à un an de prison pour avoir rendu divers petits "services". Du fond de sa cellule, Feldman médite sur sa vie passée. Cynique et apparemment dépourvu de sentiments, Feldman va devoir affronter l'hostilité de ses compagnons de prison. Récit noir et farce métaphysique sur l'innocence et la culpabilité.
"Un jour un jeune homme coiffé d'un feutre presque sans rebord fit irruption dans le bureau où Feldman était occupé à dicter une lettre à sa secrétaire. Il brandissait un revolver et dit :
- "Lève les pattes, les carottes sont cuites, Feldman." Ils travaillaient devant le coffre de Feldman, dans lequel était déposé la recette journalière du grand magasin dont il était propriétaire. La secrétaire, qui se nommait Miss Lane, pressa immédiatement un bouton situé sous une saillie du bureau de Feldman et une puissante sonnerie retentit.
- "La police sera là avant que nous ayons eu le temps d'ouvrir le coffre", annonça-t-elle dans le fracas drelinesque. Mais Feldman qui, jusqu'alors, était resté assis dans son fauteuil, les coudes sur le bureau, les joues appuyées contre les paumes, dans l'attitude de la concentration, se mit en devoir de lever les mains en l'air.
- "Je crains fort d'avoir à me passer de vos services pendant un moment, Miss Lane, hurla Feldman.
- "Un geste, dit le jeune homme, et je te plombe."
- "Il faut reconnaître que vous avez la situation bien en main, concéda Feldman.
Miss Lane les regarda à tour de rôle.
- "Mais.. qu'est-ce que ..., s'enquit-elle.
- "Cest les carottes, expliqua Feldman. Elles sont cuites."
Il fut condamné à un an d'emprisonnement au pénitencier. C'était quelque part dans l'Ouest de l'Etat, dans les montagnes, où il n'avait jamais mis les pieds, lui qui passait ses vacances dans l'Est, à la plage, ou qui était allé à Las Vegas pour les spectacles, et deux fois en Europe pendant un mois et dans les Caraïbes, en croisière, habillé au rayon Yachting.
Ce n'était pas dans une ville, ni près d'une ville et il n'existait aucune liaison directe entre la ville de Feldman et la prison, distante de trois cent miles.
Après sa condamnation, un adjoint du shérif vint le voir dans cellule.
- "Demain, on va prendre le train", dit-il.
Feldman ne dormit pas. A l'exception des quelques heures qui avaient suivi son arrestation, c'était la première soirée qu'il passait en prison. Il portait encore le complet bleu d'homme d'affaires flambant neuf que l'acheteur était allé lui chercher au rayon Vêtements pour hommes. Il se demandait si on lui passerait les menottes..."
"Une femme entra dans la pièce et s'assit sur une chaise droite à quelques dizaines de centimètres du divan sur lequel Feldman lui-même était assis. Elle se tassa à la renverse, son derrière glissant vers le bas à l'intérieur de ses vêtements, de telle sorte que son corps entier sembla descendre par rapport à sa robe, découvrant une cuisse, des jarretelles, le haut d'un bas comme un vase de chair. Sa position aurait pu être une démonstration de secourisme, ce qu'il convenait de faire dans certains cas d'attaque respiratoire. Feldman attendit qu'elle prît la parole puis s'aperçut qu'elle était un peu grise et ne l'avait pas encore remarqué. Il contempla ses sous-vêtements, et en vint rapidement à y imaginer des formes, des renflements, des ombres, des taches. Cette contemplation le rendait nerveux et il se demanda s'il devait toussoter ou frotter les pieds par terre. Il regarda son visage. Il ne connaissait rien aux regards et ne pouvait pas deviner un caractère d'après la physionomie des gens. Ils étaient jeunes ou vieux, bruns ou blonds, gras ou maigres. Cette femme paraissait la trentaine et plus, elle était brune et devait mesurer deux ou trois centimètres de plus que lui, à moins que ce ne fût la façon dont elle tenait ses jambes étendues devant elle qui la grandissait. (Il trouvait à sa posture quelque chose de "lincolnesque"). Il trouvait agréable d'être là avec elle, leur intimité accidentelle et le fait qu'elle parût ignorer sa présence l'excitait bigrement! Elle leva une fois les yeux et, là encore, parut ne pas le remarquer; il s'installa donc confortablement dans sa contemplation, les mains posées sur les cuisses..."

Marchand de liberté (Searches and Seizures, 1973)
"Cincinnati, les années 60. Alexander Main est un bailbondsman, un marchand de liberté. Ses clients ? Truands, petits malfrats et autres égarés aux prises avec la justice, pour lesquels il se porte garant, faisant son beurre des commissions proportionnelles au montant des cautions. Un métier un peu louche qui demande du flair, car il ne faut pas se tromper de client, repérer celui qui pourra payer, qui ne cherchera pas à faire faux-bond au moment du procès. Du bagout aussi, pour mettre tout le monde dans sa poche, escrocs, avocats, flics, juges : la petite routine pittoresque et perverse de la justice américaine, la bonne vieille danse de l’argent et de la loi. Et enfin, il faut de la poigne, être prêt à faire parler la poudre, à faire respecter ses intérêts. Incroyable bonimenteur, Main est un personnage complexe, imprévisible, un malin mélancolique, un drôle de type qui fait de drôles de rêves. Il tyrannise gentiment son assistant, Crainpool, terne gratte-papier dont la fadeur se révélera trompeuse…" (Editions Cambourakis)

The Franchiser (1976)
Elkin conte les exploits de Ben Flesh, créateur d'une énorme empire de franchises couvrant tout le territoire américain, "one of the men who made America look like America, who made America famous" et dont l'enthousiasme fournit un morceau d'anthologie : "The colors of those ice creams! Chocolate like new shoes. Cherry like bright fingernail polish. We do a Maple Ripple it looks like fine-grained wood, Peach like a light coming through a lampshade. You should see that stuff -- the ice-cream paints bright as posters, fifty Day-Glo colors. You scoop the stuff up you feel like Jackson Pollock." Mais, à l'instar de la tragédie que vivra Elkin, Ben Flesh est atteinte par une sclérose en plaques qui va brouiller ses sensations alors que prolifèrent ces chaînes commerciales, - Monsieur Softee, Kentucky Fried Chicken - à travers le pays.

"Au commencement était la fin" (The Living End, 1979)
Dans ce court roman, Ellerbee, protagoniste par excellence d’Elkin, est un commerçant de spiritueux à Minneapolis, bon mari, bon employeur, bon samaritain, bien qu'ayant vécu une période difficile, un homme qui se soucie beaucoup de ses semblables, jusqu’à ce qu’il soit tué lors d’un hold-up : commence alors une autre histoire dans laquelle il doit parcourir le Paradis, qui lui est refusé, l'Enfer, où il rencontre le complice de son meurtrier, puis le Purgatoire, sous l'emprise d'un Dieu qui ne parvient pas à trouver véritablement son public.

Mrs. Ted Bliss (Mrs. Ted Bliss, 1995)
"Environ une semaine après avoir enterré son mari au cimetière de Chicago où reposaient presque tous les Bliss, Dorothy Bliss, revenue à Miami où elle vivait, fut abordée par un homme du nom d'Alcibiade Chitral. Le señor Chitral était natif du Venezuela et nouveau venu aux États-Unis. Il voulait faire une proposition à Dorothy. Il lui offrait d'acheter la voiture de son défunt mari. Quand Mrs. Bliss entendit ce qu'il disait, elle devint folle de rage, furieuse et, malgré son sourire, elle lui aurait, si le chagrin ne l'avait pas tant envahie, claqué la porte au nez. Vautour, pensa-t-elle, vautour charognard sans vergogne ! À quatre-vingt-deux ans, Mrs. Ted Bliss, qui affectionne les tailleurs-pantalons en polyester aux couleurs chatoyantes, est une veuve respectable. Mais elle va faire une grosse bêtise le soir où, finalement, elle accepte l'offre du gentleman vénézuélien qui, après tout, lui propose plus du double de la valeur du vieux tacot dont elle n'a pas l'usage et qu'il convoite. Seulement voilà, il s'agit d'un trafiquant de drogue. Et notre charmante retraitée, touchante et ridicule à la fois, va se trouver embarquée dans une série d'aventures qu'elle prendra avec sang-froid mais qui donneront des sueurs froides à ses enfants et petits-enfants. À travers elle, sur ce ton à la fois burlesque et désespéré qui n'appartient qu'à lui, Stanley Elkin, très malade quand il a écrit ce livre, son dernier, nous administre une leçon de vie." (Mercure de France)

Le court roman "Le Danseur de flamenco" ("The Bailbondsman") est adapté au cinéma par John Korty sous le titre "Alex & the Gypsy " (1976), with Jack Lemmon, Geneviève Bujold, James Woods - un individu sans scrupules fournit aux prévenus les cautions nécessaires à leur mise en liberté provisoire, mais choisit finalement l'amour avec une jeune gitane...
