- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Ann Beattie (1947), "Chilly Scenes of Winter" (1976), "Secrets and Surprises" (1978), "Park City: New and Selected Stories", (1998), "The Burning House" (1982), "The New Yorker Stories" (2010) - Jayne Anne Phillips, "Black Tickets" (1979), "Machine Dreams" (1984), "Lark and Termite" (2009) - ...
Last update: 12/12/2024
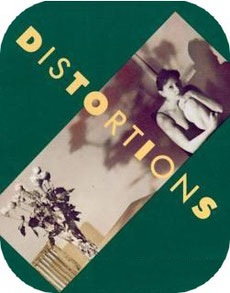
Ann Beattie et Jayne Anne Phillips, toutes deux nées après la Seconde Guerre mondiale (Beattie en 1947, Phillips en 1952), sont deux figures majeures de la short fiction américaine.
Si elles ont des styles très différents, elles ont souvent été rapprochées par la critique littéraire pour leur importance dans le renouveau de la nouvelle américaine à partir des années 1970–80, et pour leur manière de donner voix à des personnages en rupture, souvent féminins, dans une Amérique en mutation :une Amérique marquée par la fin des idéaux collectifs et le repli sur l’intime...
Elles apparaissent au moment où la nouvelle américaine retrouve un prestige critique, notamment grâce à The New Yorker, Harper’s, Esquire… : Ann Beattie publie ses premières nouvelles dans The New Yorker dès 1974, Jayne Anne Phillips se fait connaître en 1979 avec "Black Tickets" — immédiatement salué par Carver et Stone. Et toutes deux ont été reconnues dès leur premier recueil, ce qui est rare, considérées comme porteuses d’une voix générationnelle et précurseurs de nombreuses écrivaines contemporaines ...
"Chilly Scenes of Winter" (1976, Distortions), le premier recueil d’Ann Beattie, publié alors qu’elle avait à peine 28 ans, lui a valu une immédiate reconnaissance critique. Il a été vu comme fondateur d’un ton littéraire nouveau, influençant de nombreux auteurs des décennies suivantes (Lorrie Moore, David Leavitt, Jay McInerney, etc.). Charles, son principal protagoniste, est souvent perçu comme un anti-héros de l'Amérique désenchantée des années 70, celle qui survit à la guerre, au déclin politique et à l’implosion des idéaux sociaux. Un roman qui n'entend pas expliquer quoique ce soit, - un ton nouveau -, mais se contente de montrer ou de laisser penser, de saisir des gestes et des silences : le vide émotionnel est total.
Un livre qui préfigure ce qu'on appellera la "slacker culture" des années 1980–1990, et qui incarnera une attitude ironique, apathique et désabusée face aux attentes traditionnelles de la société, comme la réussite, la carrière ou la famille...
Dès ses débuts (1979, 27 ans, "Black Tickets"), Jayne Anne Phillips a été célébrée pour son écriture très sensorielle, fragmentaire, incantatoire. Son recueil de nouvelles a immédiatement été perçu comme révolutionnaire pour sa manière de mêler les voix de l’Amérique marginale, prostituées, junkies, enfants abusés, veuves : elle ouvrait la voie à une écriture féminine viscérale, entre trauma et désir, tout en assumant une plongée glaçante dans le désir masculin vu de l’intérieur ...

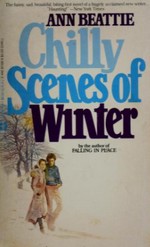
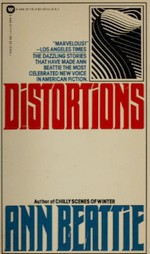
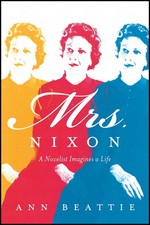


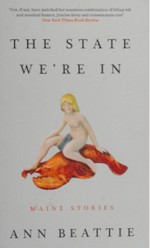

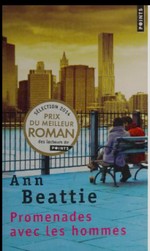
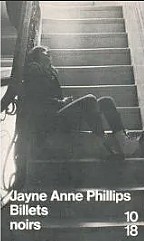







Ann Beattie (1947)
Née à Washington D.C. en 1947, Beattie a étudié à l'American University et à l'Université du Connecticut, où elle a commencé à écrire des nouvelles : elle est devenue une figure majeure de ce qu'on appelle le "minimalisme" (les émotions sont suggérées plus qu’expliquées). Ses nouvelles, publiées dès les années 1970 dans The New Yorker, l'ont imposée comme une voix représentative de sa génération. On l'a dit influencé par Donald Barthelme (postmodernisme) et John Cheever (réalisme suburbain). Là où Carver ou Wolff s'attachent à la violence ou la pauvreté, Beattie décrit des bourgeois désabusés. On l'a dit (quand on aime les étiquettes littéraires) précurseur du "réalisme désengagé" : Ann Beattie a influencé des auteurs comme Lorrie Moore ou David Foster Wallace ..
Depuis ses débuts avec Chilly Scenes of Winter (1976), elle a publié une œuvre vaste et influente, mêlant romans, recueils de nouvelles et essais littéraires ...
La désintégration de la famille américaine et l’aliénation en période post-soixante-huitarde structurent "Falling in Place" (1980), un roman qui nous livre le portrait acéré d’une société en perte de repères, où même les adultes semblent immatures. L’histoire se déroule en 1979 autour d'une famille dysfonctionnelle de banlieue : John Knapp, un publicitaire en crise de la quarantaine ; sa femme Louise, sans le plus espoir ; et leurs enfants, notamment le jeune John Joel, qui traverse une adolescence tourmentée. Un événement déclencheur survient lorsque John Joel, jouant avec une arme, blesse accidentellement une camarade de classe ..
"Love Always" (1985) s’articule autour de Lucy, une jeune femme travaillant pour un magazine satirique (une version parodique de The New Yorker), et de sa famille excentrique, dont sa tante, une actrice de soap opera égocentrique. L’intrigue mêle satire sociale, relations amoureuses chaotiques et réflexions sur l’art et la célébrité. Une critique mordante de la culture des années 1980, entre yuppies et contre-culture résiduelle...
"Mrs. Nixon: A Novelist Imagines a Life" (2011), entre biographie romancée et essai, imagine la vie de Pat Nixon, épouse du président Richard Nixon. Beattie s’interroge ici sur la façon dont on construit un personnage public, mêlant faits historiques et fiction pour explorer la solitude et l’effacement de cette First Lady si méconnue ..
Maîtresse de la chronique intime des classes moyennes supérieures, dans la veine de Cheever, Beattie capture les fractures du quotidien, souvent en arrière-plan de scènes ordinaires. Son genre de prédilection reste le recueil de nouvelles, ils sont nombreux ..
"Distortions" (1976), son premier recueil, acclamé par la critique, nous livre des histoires sur des jeunes adultes flottants, entre amour fragile et échecs professionnels, et ayant perdu toutes illusions ("A Platonic Relationship", "Distant Music", "The Lawn Party"). The New Yorker publiera plusieurs textes et elle en deviendra une figure régulière.
"Secrets and Surprises" (1978), nous livre des nouvelles plus variées de ton, entre mélancolie et satire, traitant des relations familiales et des compromis moraux. Le recueil "The Burning House" (1982), avec ses portraits de femmes en rupture avec les modèles sociaux traditionnels, est plus sombre et plus intimiste. "Park City: New and Selected Stories" (1998) constitue une première rétrospective de sa carrière avec une sélection de ses meilleurs textes et quelques inédits : une parfaite introduction à son univers. "The State We’re In: Maine Stories" (2015) se déroule dans le Maine, c'est de ses recueils les plus cohérents thématiquement, on y parle d'exil, de vieillissement, de recomposition familiale. "The Accomplished Guest" (2017) réalise un focus sur les retrouvailles, les dîners entre amis, la nostalgie douce-amère, une maturité stylistique remarquable, tout en retenue ...
On a souvent tenté de comparer trois grandes écrivaines de la nouvelle contemporaine que sont Ann Beattie, Lorrie Moore et Alice Munro : finesse psychologique et structurelle de “Runaway” ou de "The Bear Came Over the Mountain" (1999) de Munro, ton dévastateur, malgré le sujet, de Lorrie Moore dans "People Like That Are the Only People Here" (1997), saisie de l’inertie affective d’une génération sans illusions par Ann Beattie dans "Chilly Scenes of Winter" ..
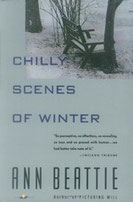
Ann Beattie, "Chilly Scenes of Winter" (1976)
"Chilly Scenes of Winter" (1976) est un roman culte qui a marqué une époque, influencé une génération d’écrivains, et continue d’être étudié comme une œuvre emblématique du minimalisme américain post-Vietnam ..
Le protagoniste, Charles, est un trentenaire mélancolique, fonctionnaire à Salt Lake City, hanté par sa rupture avec Laura, une femme mariée. Il flâne dans sa vie, entre ironie, ennui et obsession amoureuse. Un anti-héros de l'Amérique désenchantée des années 70, celle qui survit à la guerre, au désenchantement politique et à l’implosion des idéaux sociaux.
Charles, personnage sans direction, émerge comme une figure de l’errance contemporaine, annonçant des figures plus tardives comme dans les films de Noah Baumbach ou les romans de Bret Easton Ellis ..
Un style fondateur du "minimalisme émotionnel", le roman n’explique ni ne justifie quoique ce soit, il montre, laisse deviner, capte les gestes, les silences, les décalages émotionnels. Il est emblématique de cette écriture du vide affectif et du "désalignement" intime (on parle de "comedy of emotional inertia"). Bien que Laura ait quitté son mari pour Charles pendant un temps, elle est finalement retournée vers lui, laissant Charles dans un état d'abattement et d’attente passive. Charles erre dans sa routine, vivant dans une maison héritée de sa tante, partageant son temps avec son ami Sam, un éternel adolescent qui fume trop de "weed" et écoute du rock. Laura, de son côté, tente de reconstruire sa vie conjugale tout en gardant une affection distante pour Charles. La mère de Charles, Margaret, est une femme dépressive qui alterne entre séjours en clinique et tentatives maladroites de se rapprocher de son fils. Le titre du roman reflète l’atmosphère glaciale et stagnante qui entoure les personnages ...
- l’amour de Charles pour Laura est figé, comme un paysage hivernal.
- des dialogues brefs et des non-dits qui renforcent le sentiment d’isolement.
L’humour noir et l’absurde (comme les délires paranoïaques de Sam) apportent une touche de légèreté malgré le désespoir latent. Après des mois de séparation, Charles et Laura se revoient. Laura semble hésiter, laissant planer l’espoir d’une réconciliation, mais le roman se clôt sans résolution claire. Charles reste prisonnier de son attachement, incapable de passer à autre chose ...

Le roman a été adapté en 1979 par Joan Micklin Silver sous le même titre (Chilly Scenes of Winter), avec John Heard dans le rôle de Charles Richardson, un fonctionnaire de Salt Lake City, obsédé par son ex-compagne Laura Connelly (jouée par Mary Beth Hurt), qui l'a quitté pour retourner auprès de son mari. Le film, d’abord un échec commercial, est devenu un film culte, régulièrement cité dans les cercles de la culture alternative américaine, exprimant toute la complexité des émotions humaines et la difficulté de surmonter une rupture amoureuse ..

Ann Beattie est une maîtresse reconnue de la nouvelle américaine des années 1970 et 1980. Plusieurs de ses nouvelles sont devenues emblématiques par leur influence stylistique, leur finesse d’observation sociale, et leur capacité à capter ces fameux "états émotionnels" les plus discrets dont parlent les critiques littéraires pour décrire bien des oeuvres, en particulier dans l'Amérique post-Vietnam/post-Watergate ...
"Secrets and Surprises" (1978) est un recueil, considéré comme un classique du minimalisme littéraire américain. Dans la nouvelle éponyme, un couple, Pam et Stuart, découvre que leur ami commun, Terence, est gay. La révélation expose leurs propres hypocrisies et les non-dits de leur mariage. Dans "A Vintage Thunderbird", une femme nostalgique repense à son ex-amant, Nick, et à sa voiture Thunderbird, symbole de leur jeunesse insouciante. Leur relation se heurtera à l'incapacité de Nick à s'engager...
"Nick and Karen had driven from Virginia to New York in a little under six hours. They had made good time, keeping ahead of the rain all the way, and it was only now, while they were in the restaurant, that the rain began. It had been a nice summer weekend in the country with their friends Stephanie and Sammy, but all the time he was there Nick had worried that Karen had consented to go with him only out of pity; she had been dating another man, and when Nick suggested the weekend she had been reluctant. When she said she would go, he decided that she had given in for old time’s sake.
The car they drove was hers—a white Thunderbird convertible. Every time he drove the car, he admired it more. She owned many things that he admired: a squirrel coat with a black taffeta lining, a pair of carved soapstone bookends that held some books of poetry on her night table, her collection of Louis Armstrong 78s. He loved to go to her apartment and look at her things. He was excited by them, the way he had been spellbound, as a child, exploring the playrooms of schoolmates.
He had met Karen several years before, soon after he came to New York. Her brother had lived in the same building he lived in then, and the three of them met on the volleyball courts adjacent to the building. Her brother moved across town within a few months, but by then Nick knew Karen’s telephone number. At her suggestion, they had started running in Central Park on Sundays. It was something he looked forward to all week.
When they left the park, his elation was always mixed with a little embarrassment over his panting and his being sweaty on the street, but she had no self-consciousness. She didn’t care if her shirt stuck to her body, or if she looked unattractive with her wet, matted hair. Or perhaps she knew that she never looked really unattractive; men always looked at her ..."
Nick et Karen avaient roulé de la Virginie jusqu’à New York en un peu moins de six heures. Ils avaient fait bon temps, devançant la pluie tout le long du trajet, et ce n’est que maintenant, alors qu’ils étaient au restaurant, que la pluie se mit à tomber. Le week-end d’été à la campagne chez leurs amis Stephanie et Sammy avait été agréable, mais Nick n’avait cessé de craindre que Karen n’ait accepté de l’accompagner par pitié ; elle fréquentait un autre homme, et lorsque Nick avait proposé ce voyage, elle avait hésité. Quand elle avait fini par dire oui, il en avait conclu qu’elle avait cédé par nostalgie de leur passé.
La voiture dans laquelle ils roulaient était la sienne — une Thunderbird blanche décapotable. Chaque fois qu’il la conduisait, son admiration grandissait. Elle possédait tant de choses qu’il admirait : un manteau en fourrure d’écureuil doublé de taffetas noir, une paire de serre-livres en stéatite sculptée qui retenaient des recueils de poésie sur sa table de nuit, sa collection de 78-tours de Louis Armstrong. Il adorait se rendre chez elle pour contempler ses affaires. Elles le fascinaient, comme autrefois, enfant, il était captivé en explorant les salles de jeux chez ses camarades d’école.
Il avait rencontré Karen quelques années plus tôt, peu après son arrivée à New York. Son frère habitait alors le même immeuble que lui, et tous trois s’étaient liés sur les terrains de volley-ball attenants à l’immeuble. Son frère avait déménagé de l’autre côté de la ville quelques mois plus tard, mais Nick connaissait déjà le numéro de téléphone de Karen. Sur sa suggestion, ils avaient commencé à courir ensemble dans Central Park le dimanche. C’était un moment qu’il attendait toute la semaine.
Quand ils quittaient le parc, son exaltation était toujours mêlée d’un peu de gêne à cause de son souffle haletant et de sa transpiration en pleine rue, mais elle, ne semblait jamais complexée. Elle se moquait que son t-shirt colle à son corps ou que ses cheveux mouillés et emmêlés la rendent moins séduisante. Ou peut-être savait-elle qu’elle n’était jamais vraiment moins séduisante ; les hommes la regardaient toujours...
Dans "The Burning House" (1982), une femme passe la nuit chez un couple d’amis mariés. Alors qu'elle dort, la maison prend feu : une subtile métaphore des tensions familiales, un mélange d’ironie, de silence, et de menace diffuse. Un exemple parfait du style elliptique de Beattie.
"... La vie continue dans la maison bien que je sois couchée ; l’eau coule, quelqu’un écoute un disque. Sam est encore en bas, il doit donc se passer quelque chose.
Je connais tout le monde dans la maison depuis des années, mais à mesure que le temps passe je les connais de moins en moins. J. D. était le conseiller de Frank à l’université. Frank était son meilleur étudiant et ils ont commencé à se voir en dehors des cours. Ils jouaient au handball. J. D. et sa famille venaient dîner. Nous étions reçus chez eux. Cet été-là – l’été où Frank a décidé de faire une école supérieure de commerce au lieu d’une spécialisation en anglais – la femme et le fils de J. D. l’ont quitté d’une façon horrible, dans un accident de voiture. J. D. a abandonné son poste. Il est allé à Las Vegas, dans le Colorado, à La Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Paris (deux fois) ; il colle des cartes postales sur les murs de son séjour.
Très souvent, il arrive chez nous le week-end avec son sac de couchage. Quelquefois il amène une fille. Pas ces derniers temps. Il y a des années, Tucker faisait partie du groupe de thérapie de Frank à New York, et il a fini par l’engager comme comptable pour sa galerie. À l’époque il suivait une thérapie parce qu’il était obsédé par les étrangers. Maintenant il est aussi obsédé par les homosexuels. Il donne des soirées à la mode où il invite beaucoup d’étrangers et d’homosexuels. Avant il fait du yoga et de la méditation transcendentale, et pendant les fêtes il prend du Seconal et fait des exercices isométriques. La première fois que je l’ai rencontré, il passait l’été dans le Vermont, chez sa sœur qui se trouvait en Europe, et il nous a appelés un soir à New York, dans un état de réelle panique parce qu’il y avait une invasion de guêpes. Elles étaient en train d’« éclore », expliqua-t-il – de grosses guêpes endormies qui étaient partout. Nous avons accepté de venir ; nous avons roulé toute la nuit pour atteindre Brattleboro. Il avait dit la vérité : il y avait des guêpes à l’envers des assiettes, dans les plantes, dans les plis des rideaux. Tucker était si perturbé qu’il s’était réfugié derrière la maison, dans le matin glacé du Vermont, enveloppé dans une couverture comme un Indien, vêtu seulement d’un pyjama. Il était assis sur une chaise de jardin, caché sous un buisson, et nous attendait...."
(Nouvelles du New Yorker, 2010, traduction française Christian Bourgois Editeur)
"Janus", publié dans The New Yorker du 27 janvier 1986 et repris dans "Park City: New and Selected Stories" (1998) nous conte l'histoire d'une femme est obsédée par un bol de céramique qu’elle considère comme « parfait ». Cette obsession va devenir le miroir de son insatisfaction conjugale.
Dans “Snow” ("Secrets and Surprises", 1978), réimprimée dans "Park City" (1998), une femme évoque une relation passée à travers les souvenirs d’un hiver partagé avec un homme dans une maison de campagne. Une nouvelle très courte (moins de 2 pages), mais intensément évocatrice. Tout l'art de suggérer par l’atmosphère...
Un "Weekend” ("Secrets and Surprises", 1978) entre amis dans une maison de campagne, où les tensions de classe, de genre et de couple affleurent silencieusement. Tous les malaises sociaux voilés dans des décors apparemment banals ..

Avec "Imagine a Day at the End of Your Life" (publié dans The New Yorker, 2005 et repris dans "The New Yorker Stories" (2010), Beattie s’éloigne ici de la narration linéaire pour composer une méditation postmoderne sur le vieillissement, la mémoire, et les choix de vie, construite comme une série de fragments narratifs.
"... The last time the whole family was here was for our fortieth wedding anniversary. The TV ran night and day, and no one could keep on top of the chaos in the kitchen. Allison and Joan had even given friends the phone number, as if they were going into exile instead of visiting their parents for the weekend. The phone rang off the hook. Allison brought her dog and Joan brought her favorite dalmatian, and the two got into such an awful fight that Allison’s had to spend the night in the backseat of her car. All night long, inside the house, the other dog paced, wanting to get at it. At the end of the visit, when the last car pulled away, Harriet admitted to me that it had been too much for her. She’d gone into the kitchen and stood a broom upside down in the corner and opened the scissors facing the bristles. She’d interviewed a woman who practiced voodoo, and the woman had told her that that was a surefire way to get rid of guests. Harriet felt a little guilty that it had worked: initially, Denise had said that she was going to leave early Monday morning, but by Sunday noon she was gone—and the last to leave ..."
... La dernière fois que toute la famille était réunie ici, c’était pour notre quarantième anniversaire de mariage. La télé tournait jour et nuit, et personne ne parvenait à maîtriser le chaos dans la cuisine. Allison et Joan avaient même donné le numéro de téléphone à des amis, comme si elles partaient en exil plutôt que passer le week-end chez leurs parents. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Allison avait amené son chien, et Joan avait apporté son dalmatien préféré, et les deux se sont battus si violemment que celui d’Allison a dû passer la nuit sur la banquette arrière de sa voiture. Toute la nuit, dans la maison, l’autre chien tournait en rond, voulant en découdre. À la fin du séjour, quand la dernière voiture est partie, Harriet m’a avoué que ça avait été trop pour elle. Elle était allée dans la cuisine, avait posé un balai à l’envers dans un coin et ouvert des ciseaux en les pointant vers les poils. Elle avait interviewé une femme qui pratiquait le vaudou, et celle-ci lui avait affirmé que c’était un moyen infaillible de se débarrasser des invités. Harriet s’est sentie un peu coupable que ça ait marché : au début, Denise avait dit qu’elle partirait tôt le lundi matin, mais dès le dimanche midi, elle était partie - la dernière à s’en aller.
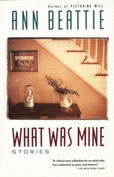
Beattie excelle à saisir l'indicible : ses personnages ne crient pas leur détresse, elle transparaît dans un geste, un silence, ou un détail apparemment anodin. "What Was Mine" (1991) d'Ann Beattie, un livre charnière dans son œuvre, entre ses premiers succès (Chilly Scenes of Winter, 1976) et ses expérimentations ultérieures (Mrs. Nixon, 2011), et un recueil qui rassemble 12 nouvelles qui saisit des instants de crise ou de révélation dans la vie de personnages ordinaires ..
- Des artistes confrontés à leur propre médiocrité ("The Working Girl").
- Des parents et enfants séparés par des non-dits ("Home to Marie").
- Des moments de bascule où le passé ressurgit ("Windy Day at the Reservoir").
"What Was Mine" ou Comment les objets deviennent les seuls témoins d'une histoire familiale - Un homme revient dans la maison de son enfance après la mort de ses parents et réalise que les objets qui lui semblaient insignifiants (une vieille théière, des lettres) contiennent toute l'histoire de sa famille – une métaphore de la mémoire et de la perte ...
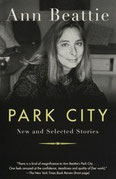
Et des couples en pleine rupture silencieuse. Dans "You Know What", un couple se sépare sans drame, lors d'une conversation banale sur un repas – l'effondrement du mariage est suggéré, jamais explicité...
"... Similarly, she had doubted whether they should marry. And whether, even if they did, she should give birth to the baby she was carrying. At the end of the first year, she didn’t know if she should stay in the marriage. At the end of the second year, he quit his job, set up a home office, and let her go out to become the primary income earner. For quite a while, things seemed better. She was promoted, then moved from one agency to another. Along the way, she acquired the diamond earrings and began to dab powder and rouge on her face every morning, then pat most of it off with little cotton pads. It was her habit to spray her face, once, with an Evian mister. Just that morning, when cleaning the bathroom counter, he had picked up the little metal mister and looked at it. First he leaned toward the mirror. Then he moved his head back a few inches and looked at his own earlobes. He even felt them, with his thumb and first finger. He looked down at his running shoes. He shook the sprayer lightly, closed his eyes, and pushed down on the top. He could not have been more surprised if a fire hose had been trained on his face. The sensation was so sensual, the feeling so sybaritic, he winced. He opened his eyes, startled, expecting to see another person in the mirror: someone younger, handsomer, loved. In that second, it became absolutely clear that he was entirely alone. The house quiet, his daughter in school, his wife at work. And it was as if all the tears he never allowed himself to cry had just appeared, in minuscule form, to hit him in the face..."
... De la même manière, elle avait douté de la pertinence de leur mariage. Et même s’ils se mariaient, elle s’était demandé si elle devait garder l’enfant qu’elle portait. À la fin de la première année, elle ignorait encore si elle devait rester dans cette union. À la fin de la deuxième, il avait quitté son emploi, aménagé un bureau à la maison et l’avait laissée devenir le principal soutien financier. Pendant un certain temps, les choses semblaient aller mieux. Elle avait été promue, puis avait changé d’agence. En chemin, elle s’était offert des boucles d’oreilles en diamant et avait pris l’habitude, chaque matin, de se poudrer légèrement le visage avant d’en estomper l’excédent avec des disques de coton. Elle vaporisait aussi, d’un geste, un peu d’eau d’Evian sur son visage. Ce matin-là, en nettoyant le lavabo, il avait attrapé le petit vaporisateur métallique et l’avait examiné. D’abord, il s’était penché vers le miroir. Puis il avait reculé de quelques centimètres pour observer ses propres lobes d’oreilles. Il les avait même palpés, entre le pouce et l’index. Il avait baissé les yeux vers ses baskets. Il avait secoué légèrement le vaporisateur, fermé les yeux et appuyé sur le bouton. Il n’aurait pas été plus surpris si un tuyau d’incendie lui avait arrosé le visage. La sensation était si sensuelle, le plaisir si sybarite, qu’il en eut un frisson. Il rouvrit les yeux, stupéfait, s’attendant à voir dans le miroir une autre personne : plus jeune, plus séduisante, aimée. À cet instant, il comprit avec une clarté absolue qu’il était totalement seul. La maison silencieuse, sa fille à l’école, sa femme au travail. Et ce fut comme si toutes les larmes qu’il n’avait jamais osé verser venaient de surgir, en une forme minuscule, pour lui fouetter le visage. .."

Dans l’ambivalence des années 1980, New York , et une nouvelle, « Walks with Men » (2010), une fable moderne sur la séduction toxique et l’apprentissage douloureux de l’autonomie : Jane, une diplômée universitaire récemment installée à Manhattan, rencontre Ben, un écrivain charismatique et manipulateur, plus âgé qu’elle. Séduite par son aura intellectuelle, elle se laisse entraîner dans une relation où il lui dicte des "leçons de vie" sur la manière de se vêtir, de penser, ou d’interagir avec le monde. Ben prétend façonner son existence, lui offrant une éducation sentimentale et sociale en échange de sa soumission. Au fil du temps, Jane réalise que Ben est un mythomane égocentrique, dont les conseils masquent un besoin de contrôle. Leur relation se désagrège. Si la nouvelle dépeint des rapports hommes-femmes sous l’angle de la domination psychologique, montrant une fois de plus que la littérature a précédé bien des questions dites sociétales, reste qu'on ne sait si Jane a su, tout en ayant réussi à construire son identité, à se libérer réellement de l’emprise de Ben...

Jayne Anne Phillips, "Black Tickets" (1979)
Un recueil qui a marqué la littérature américaine par sa prose poétique et ses portraits de vies brisées.
L'auteur naquit en Virginie-Occidentale en 1952, son œuvre est profondément marquée par le Sud rural américain et ses paysages industriels en pleine régression. Son style, est un mélange de réalisme cru et de langue sensorielle : là où Carver ou Ford sont économes en métaphores, Phillips sature ses textes d’images sensorielles, de sensations physiques et d'émotions brutes. Révélée à à 27 ans, elle s'est imposée comme une voix unique, saluée par Raymond Carver et Robert Stone...
"Black Tickets" (1979), son premier recueil, un recueil de 27 textes (nouvelles, fragments, monologues) abordant la violence, le désir et la perte, un imaginaire organique dans une Amérique post-Vietnam. "Black Tickets" est étudié pour son mélange de forme fragmentaire et d’émotion brute...

- "Home" - Une petite ville américaine rurale, sans nom, typique des décors de Phillips (probablement inspirée par la Virginie-Occidentale). La narratrice, une jeune femme sans nom, sans domicile fixe, mais qui dit dormir dans une maison qu'elle n’habite pas et voir le monde à travers les fenêtres d’un lieu qui n’est pas à elle, ni à personne : elle erre dans les rues et squatte des maisons abandonnées. Une figure secondaire, un homme plus âgé, peut-être un ancien amant ou un père défaillant, dont elle se souvient par fragments. Elle décrit son quotidien de sans-abri, cherchant refuge dans des maisons vides ou des motels sordides. Ses observations sont à la fois précises (odeurs de moisi, murs fissurés) et hallucinées, comme si la frontière entre réalité et mémoire était poreuse. Elle évoque des scènes de son passé : un homme (père ? amant ?) qui buvait, une mère absente ou morte, des moments de violence ou de tendresse ambiguë. Ces souvenirs sont racontés par bribes, sans chronologie, comme un puzzle traumatique. Puis dans une maison abandonnée, elle croise un petit garçon seul, sale et silencieux. Une connexion étrange se noue entre eux — deux âmes perdues. Elle lui parle à demi-mots, lui offre des restes de nourriture, mais la relation reste empreinte de menace et de tristesse. La narratrice finit par quitter la maison, incapable de créer un lien stable avec l’enfant ou avec quiconque...

“Lechery” (lubricité), l’un des récits les plus dérangeants et ambigus du recueil : une adolescente aborde la sexualité dans un contexte confus de désir, d’exploitation, et de solitude familiale. La sexualité comme terrain de pouvoir, d'effacement, mais aussi de survie. Une petite ville américaine, probablement dans les années 1970, avec ses bars miteux, ses motels et son ambiance étouffante. Une jeune femme anonyme, narratrice, qui observe et subit les désirs des hommes autour d’elle : odeur de bière rance, néons clignotants, rires gras, les hommes parlent de femmes comme d’objets, et elle se sent à la fois invisible et exposée...
"... He is nervous. Right away he holds out the money. Or he is a little mean, he punches at me with his childish fist. A fine blond boy with a sweet neck and thin collarbones arched out like wings, or someone freckled whose ashen hair falls loose. A dark boy, thick lashes and cropped wooled hair, rose lips full and swelling a little in the darkened car. I give him a little whiskey, I rifle through the pictures and pretend to arrange them. I take a drink too, joke with him. This is my favorite time; he leans back against the seat with something like sleep in his eyes. I stroke his hard thighs, his chest, I comfort him.
I put the pictures beside us, some of them are smaller than postcards. We put our faces close to see them. A blond girl, a black girl, they like to see the girls. One bending back droops her white hair while the other arches over, holds her at the waist, puts her mouth to a breast so small only the nipple stands up. In the picture her mouth moves in and out, anyone can tell. A black hand nearly touching pale pubic hair, a forefinger almost tender curls just so, moves toward a slit barely visible just below the pelvic bone. I don’t like pictures of shaven girls, it scares them to see so much. It makes them disappear.
I do things they’ve never seen, I could let them touch but no. I arrange their hands and feet, keep them here forever. Sometimes they tell me stories, they keep talking of baseball games and vicious battles with their friends. Lips pouty and soft, eyes a hard glass glitter. They lose the words and mumble like babies; I hold them just so, just tight, I sing the oldest songs. At times their smooth faces seem to grow smaller and smaller in my vision. I concentrate on their necks, their shoulders. Loosen their clothes and knead their scalps, pinching hard at the base of the head. Maybe that boy with dark hair and Spanish skin, his eyes flutter, I pull him across my legs and open his shirt. Push his pants down to just above his knees so his thin legs and smooth cock are exposed; our breathing is wavy and thick, we make a sound like music. He can’t move his legs but stiffens in my lap, palms of his hands turned up. In a moment he will roll his eyes and come, I’ll gently force my coated fingers into his mouth. I’ll take off my shirt and rub my slick palms around my breasts until the nipples stand up hard and frothy. I force his mouth to them. I move my hand to the tight secret place between his buttocks. Sometimes they get tears in their eyes...
... Il est nerveux. Aussitôt, il tend l'argent. Ou bien il est un peu méchant, il me frappe de son poing enfantin. Un joli garçon blond avec une nuque délicate et des clavicules fines arquées comme des ailes, ou un garçon tacheté de son dont les cheveux cendrés tombent en désordre. Un garçon brun, aux cils épais et aux cheveux coupés courts et frisés, des lèvres roses, pleines, légèrement gonflées dans la voiture sombre. Je lui donne un peu de whisky, je feuillette les photos et fais semblant de les arranger. Je bois aussi une gorgée, je plaisante avec lui. C'est mon moment préféré ; il se renverse contre le siège avec quelque chose comme du sommeil dans les yeux. Je caresse ses cuisses dures, sa poitrine, je le réconforte.
Je pose les photos près de nous, certaines sont plus petites que des cartes postales. Nous rapprochons nos visages pour les regarder. Une fille blonde, une fille noire, ils aiment voir les filles. L'une, penchée en arrière, laisse pendre ses cheveux blancs tandis que l'autre se cambre, la tient par la taille, porte sa bouche à un sein si petit que seul le mamelon se dresse. Sur la photo, sa bouche va et vient, c'est évident. Une main noire touchant presque des poils pubiens pâles, un index presque tendre se recourbe juste ainsi, s'approche d'une fente à peine visible sous l'os pelvien. Je n'aime pas les photos de filles rasées, ça leur fait peur de voir tant de choses. Ça les fait disparaître.
Je fais des choses qu'ils n'ont jamais vues, je pourrais les laisser toucher mais non. J'arrange leurs mains et leurs pieds, je les garde ici pour toujours. Parfois ils me racontent des histoires, ils parlent sans cesse de matchs de baseball et de bagarres violentes avec leurs amis. Les lèvres boudeuses et douces, les yeux durs et brillants comme du verre. Ils perdent leurs mots et marmonnent comme des bébés ; je les tiens juste comme ça, juste assez serrés, je chante les plus vieilles chansons. Parfois leurs visages lisses semblent rapetisser dans ma vision. Je me concentre sur leurs cous, leurs épaules. Je desserre leurs vêtements et pétris leur cuir chevelu, pinçant fort à la base de la tête. Peut-être ce garçon aux cheveux bruns et à la peau espagnole, ses paupières battent, je l'attire sur mes jambes et ouvre sa chemise. Je baisse son pantalon juste au-dessus des genoux pour que ses jambes minces et sa bite lisse soient exposées ; notre respiration est ondulante et épaisse, nous produisons un son comme de la musique. Il ne peut pas bouger ses jambes mais se raidit sur mes genoux, les paumes de ses mains tournées vers le haut. Dans un instant, il roulera des yeux et jouira, je lui enfoncerai doucement mes doigts enduits dans la bouche. J'enlèverai mon chemisier et passerai mes paumes moites sur mes seins jusqu'à ce que les mamelons durcissent et moussent. Je lui force la bouche dessus. Je déplace ma main vers l'endroit secret et tendu entre ses fesses. Parfois, des larmes leur montent aux yeux."
Mais les souvenirs s’immiscent dans le présent, le passé hante la narratrice. Elle se souvient d’un ancien amant qui photographiait son corps sans son consentement, transformant leur intimité en spectacle. Une autre scène nous révèle une amie prostituée, racontant comment les clients lui demandent de "faire semblant" d’avoir du plaisir. La rencontre avec l’homme du bar : elle finit par partir avec lui, dans une chambre de motel. La scène sexuelle est décrite avec un réalisme froid : il la touche comme on inspecte une marchandise, murmurant des clichés érotiques ("Tu es si douce"). Phillips utilise des détails corporels (peau moite, ongles sales) pour créer un malaise palpable. Elle, dissociée, compte les fissures du plafond. L'épilogue, la fuite.
À l’aube, elle s’échappe pendant qu’il dort. Dehors, elle croise une autre femme, échangent un regard de complicité amère. Le dernier paragraphe décrit le soleil levant, "jaune comme un bleu", image à la fois belle et toxique ...

“Souvenir”, une nouvelle sur la perte amoureuse, mais aussi sur la voix, ce qu’on n’a jamais dit. Une jeune femme se souvient d’un homme qu’elle a aimé et perdu, avec des images floues, sensuelles et mentales entrelacées. Une petite ville américaine, sans doute dans les années 1970, où le passé et le présent se confondent dans une atmosphère de deuil étouffant. La protagoniste et narratrice, une jeune femme (nommée ou non, selon la version) qui rend visite à sa mère vieillissante, atteinte d’un cancer en phase terminale. Des figures secondaires, la mère, autrefois forte, maintenant réduite à un corps fragile et douloureux. Un frère absent, évoqué par fragments, dont la disparition ou l’éloignement pèse sur la famille. Des phrases courtes, souvent sans verbes, pour créer un effet de rupture ("La chambre. La lumière. L’odeur.")...
La narratrice arrive chez sa mère, dans une maison remplie d’objets qui semblent figés dans le temps : photos jaunies, bibelots, médicaments alignés sur la table de nuit. L’odeur de la maladie (médicaments, chair mourante) imprègne l’air : la maladie comme paysage, comme une carte de souffrance, où chaque détail (un os saillant, une veine bleutée) raconte une histoire ...
Elle aide sa mère à se laver, décrivant avec une précision presque clinique son corps décharné, les cicatrices, les taches sur la peau. En rangeant une armoire, elle tombe sur une boîte de "souvenirs" : une mèche de cheveux d’enfant (la sienne ? celle du frère ?), des tickets de cinéma, une lettre jamais envoyée. Ces objets déclenchent des flashbacks ambivalents (rires, disputes, silences). Les souvenirs sont des pièges : les objets conservés ne préservent pas le passé, ils en révèlent les trous et les mensonges...
"Far away the hospital rose up white and glistening, its windows catching the glint of the sun. Directly below, the park was nearly deserted. There were a few cars in the parking lot and several dogs chasing each other across the grass. Two or three lone women held children on the teeter-totters and a wind was coming up. The forlorn swings moved on their chains. Kate had a vision of the park at night, totally empty, wind weaving heavily through the trees and children’s playthings like a great black fish about to surface. She felt a chill on her arms. The light had gone darker, quietly, like a minor chord.
“Mom,” Kate said, “it’s going to storm.” Her own voice seemed distant, the sound strained through layers of screen or gauze.
“No,” said her mother, “it’s going to pass over.” She moved her hand to Kate’s knee and touched the cloth of her daughter’s skirt. Kate gripped the metal bar at their waists and looked straight ahead. They were rising again and she felt she would scream. She tried to breathe rhythmically, steadily. She felt the immense weight of the air as they moved through it.
They came almost to the top and stopped. The little car swayed back and forth.
“You’re sick, aren’t you,” her mother said.
Kate shook her head. Below them the grass seemed to glitter coldly, like a sea. Kate sat wordless, feeling the touch of her mother’s hand. The hand moved away and Kate felt the absence of the warmth.
They looked at each other levelly.
“I know all about it,” her mother said, “I know what you haven’t told me.”
The sky circled around them, a sure gray movement. Kate swallowed calmly and let their gaze grow endless. She saw herself in her mother’s wide brown eyes and felt she was falling slowly into them."
"Au loin, l'hôpital se dressait, blanc et étincelant, ses fenêtres captant les reflets du soleil. Juste en dessous, le parc était presque désert. Quelques voitures stationnaient sur le parking et plusieurs chiens se poursuivaient sur l'herbe. Deux ou trois femmes solitaires balançaient des enfants sur les bascules tandis qu'une brise se levait. Les balançoires désertes bougeaient lentement sur leurs chaînes. Kate imagina le parc la nuit, complètement vide, le vent soufflant lourdement à travers les arbres et les jeux d'enfants comme un grand poisson noir sur le point de remonter à la surface. Elle sentit un frisson lui parcourir les bras. La lumière avait obscurci, discrètement, comme un accord mineur.
« Maman, dit Kate, il va y avoir un orage. » Sa propre voix lui semblait lointaine, comme filtrée à travers plusieurs épaisseurs de grillage ou de gaze.
« Non, répondit sa mère, ça va passer. » Elle déplaça sa main vers le genou de Kate et effleura le tissu de la jupe de sa fille. Kate agrippa la barre métallique à leur hauteur et fixa droit devant elle. Ils s'élevaient à nouveau et elle eut l'impression qu'elle allait crier. Elle essaya de respirer régulièrement, calmement. Elle sentait le poids immense de l'air tandis qu'ils le traversaient.
Ils atteignirent presque le sommet et s'arrêtèrent. La petite nacelle se balança d'avant en arrière.
« Tu es malade, n'est-ce pas », dit sa mère.
Kate secoua la tête. En contrebas, l'herbe semblait scintiller froidement, comme une mer. Kate resta silencieuse, sentant la main de sa mère sur elle. La main s'éloigna et Kate ressentit l'absence de cette chaleur.
Elles se regardèrent fixement.
« Je suis au courant de tout, dit sa mère. Je sais ce que tu ne m'as pas dit. »
Le ciel tournoyait autour d'elles, d'un mouvement gris et assuré. Kate déglutit calmement et laissa leurs regards s'éterniser. Elle se vit dans les grands yeux marron de sa mère et eut l'impression de tomber lentement en eux."
La scène centrale : la confession : la mère, dans un moment de lucidité, avoue quelque chose d’inattendu — peut-être un adultère, une fausse couche, ou un mensonge sur la mort du frère. Cette révélation reste elliptique, mais elle fissure l’image que la narratrice avait de sa famille. La nuit tombe. La mère s’endort sous l’effet des analgésiques. La narratrice reste assise près d’elle, regardant la lune à travers la fenêtre sale. Elle prend un des "souvenirs" (un bouton de manchette ? un ticket ?) et le glisse dans sa poche avant de partir, comme pour emporter une preuve de ce qui fut - ou de ce qui n’a jamais été.
L'impossible adieu ...

“Black Tickets” , des Black Tickets qui symbolisent l'impossibilité de rentrer "chez soi", la nouvelle la plus brutalement incarnée du recueil : une prostituée mineure raconte son quotidien dans une ville américaine, entre clients, souvenirs de famille et visions intérieures. La narration ne condamne ni ne sauve : elle observe depuis l’intérieur. En 10 pages, Phillips condense tout un univers ...
Une gare routière ou un motel sordide dans une ville anonyme d'Amérique, fin des années 1970. Une nuit pluvieuse, néons clignotants, odeur de désinfectant et de cigarettes froides. Un "non-lieu" où transitent les âmes perdues. Une jeune femme, la narratrice, sans nom, entre 18 et 25 ans, en fuite ou en errance. Elle observe le monde avec une lucidité désabusée. Un vendeur de billets, un homme âgé, visage raviné, qui semble connaître tous les secrets de la ville. Et des silhouettes secondaires ..
La narratrice entre dans la station Greyhound. Les murs sont couverts de graffitis, les bancs en vinyle craquelé. Elle s'approche du guichet où un vieillard vend des Black Tickets — des billets de bus "spéciaux" pour des destinations improbables ("Billet pour l'oubli", "Billet pour nulle part"). Chaque réplique est chargée de menaces et de sous-entendus sexuels. Le vieux semble offrir bien plus que des transports. En marge du dialogue, la narratrice se souvient, une chambre de motel où un homme (père ? amant ?) a laissé des traces de sang sur l'oreiller, le goût du métal dans sa bouche (peur ? un coup ?), la décision de prendre le premier bus, sans regarder la destination. Un homme en uniforme militaire tente de l'aborder (toute interaction avec un homme contient une menace voilée). Il sent le whisky et la sueur. Elle lui achète un Black Ticket imaginaire ("Pour se perdre en mer"). Il rit, croit à une blague, mais elle est sérieuse. Finalement, elle paie le vieillard avec des pièces volées. Il lui tend un ticket illisible, imprimé sur du papier bible. Le bus n'arrivera jamais, mais tu peux l'attendre toute ta vie ...

“El Paso”, la vision désolée de l’Amérique du bord de route, des êtres qui dérivent hors du rêve américain, comme une anticipation de ce que feront Denis Johnson (Jesus’ Son) ou Mary Gaitskill. Un couple marginal vit dans un motel au Texas, entre drogue, musique et solitude, avec un enfant dont personne ne s’occupe vraiment. La ville frontalière d'El Paso, Texas, avec ses motels cheap, ses bars climatisés et son désert qui "grignote les trottoirs". Les années 1970, dans une atmosphère de fin de route, où les rêves se meurent sous le soleil de plomb. Une écriture à la fois crue et lyrique. Le personnage principal, Lola (ou Loretta), une jeune femme de 22 ans, ancienne serveuse, en cavale après avoir volé la caisse d'un diner. Et Ray, un motard quadragénaire rencontré dans un bar, cicatrice sur la joue, "qui sentait l'essence et les Lucky Strike". Le barman, un témoin silencieux, essuie les verres en regardant la télé qui parle de l'épidémie de SIDA.
El Paso, Lola descend d'un bus Greyhound. Elle a mal aux pieds, ses chaussures en plastique lui ont écorché les talons. Elle traîne sa valise cabossée vers un motel Sunset Inn, dont le néon clignote malgré le jour aveuglant. Scène du bar : au Desert Moon, Ray lui offre un tequila, il parle de ses voyages (Alaska, Mexique), mais ses mains tremblent.
La nuit au motel, sexe et violence, l’acte est décrit comme une transaction mécanique. Ray devient brutal, Lola se dissocie : "Je regardais le plafond. Il y avait une tache en forme de Floride", le corps comme territoire conquis. Au petit matin, elle découvre que Ray a fouillé ses affaires. Il a trouvé l’argent volé, mais le laisse dans la valise avec un sourire en coin. Lola prend un bus pour Juárez, de l’autre côté de la frontière. Dernière image : Un enfant vend des chewing-gums devant la station. Elle lui donne un billet de 10 dollars sans prendre la marchandise. "Comme ça t’auras un souvenir de moi." Mais El Paso n’est qu’une étape avant une autre déception. Et Lola n’est ni victime ni coupable, juste vivante ...
Dernier paragraphe, le désert avale tout, même les regrets...
"She woke up in twisted blankets and raised her fingers to her face. We ate the bread slow, her mouth bleeding a little. I’m seeing her in summer by the stove in their room, sweat clouding her hair and her lips pursed with cheap wine; she smoothing her cotton skirt and throwing back her hair to bend over the burner with a cigarette, frowning as the blue flame jets up fast. On the street under my window she is walking early in the day, tight black skirt ripped in the slit that moves on her leg. Looking back she sees me watching and buys carnations from the blind man on the corner, walks back, tosses them up to me. She laughs and the flowers falling all around her are pale, their long stems tangling. The street is shaded in buildings and her face turned up to me is lost in black hair. She is small and she is washed in grilled shadow.
Fingers too swollen to button her shirt, she asked me would I get her something to soak them in. At the drugstore buying antiseptic and gauze I felt her standing shakily by the couch, touching her mouth with her purple fingers. Walking back fast I knew she was gone, took almost nothing. The ashed drawings were swept up and thrown probably from the window. He left for good soon after, thirty pounds of Mexican grass stashed in the truck for a connection in Detroit. I went as far north as I could get, snow that winter in Ottawa a constant slow sift that cooled and cleaned a dirt heat I kept feeling for months; having nothing of her but a sketch I’d taken from where she hid them: a picture of trains dark slashed on tracks, and behind them the sky opens up like a hole."
Elle se réveilla emmêlée dans les draps et porta ses doigts à son visage. On a mangé le pain lentement, sa bouche saignant un peu. Je la revois en été, près du poêle dans leur chambre, la sueur embuant ses cheveux et ses lèvres pincées par le vin bon marché ; elle lissant sa jupe en coton et rejetant ses cheveux en arrière pour se pencher sur le brûleur avec une cigarette, fronçant les sourcils tandis que la flamme bleue jaillit vite. Dans la rue sous ma fenêtre, elle marche tôt le matin, jupe noire moulante déchirée à l'encolure qui ondule sur sa jambe. Se retournant, elle me voit l'observer et achète des œillets au marchand aveugle du coin, revient, me les lance. Elle rit et les fleurs qui tombent autour d'elle sont pâles, leurs longues tiges s'emmêlant. La rue est ombragée par les immeubles et son visage levé vers moi se perd dans ses cheveux noirs. Elle est petite et baignée d'ombre grillagée.
Les doigts trop gonflés pour boutonner sa chemise, elle m'a demandé de lui trouver quelque chose où les tremper. À la pharmacie, en achetant de l'antiseptique et de la gaze, je l'ai sentie debout, chancelante près du canapé, touchant sa bouche avec ses doigts violacés. En revenant vite, j'ai su qu'elle était partie, n'ayant presque rien pris. Les dessins réduits en cendre avaient été balayés et jetés, probablement par la fenêtre. Lui est parti pour de bon peu après, trente livres d'herbe mexicaine planquées dans le camion pour un contact à Détroit. Je suis allé aussi loin au nord que possible, la neige cet hiver-là à Ottawa tombant en une lente couvée incessante qui refroidissait et nettoyait une chaleur crasse que j'ai sentie pendant des mois ; ne gardant d'elle qu'un croquis que j'avais pris là où elle les cachait : une image de trains sombres tailladés sur les rails, et derrière eux le ciel s'ouvrant comme un trou.

Parmi ses autres œuvres majeures citons "Machine Dreams" (1984), une Saga familiale couvrant plusieurs générations, de la Grande Dépression à la guerre du Vietnam, une réflexion sur les silences familiaux, la transmission, les femmes oubliées. C'est un récit polyphonique alternant les voix des membres de la famille Hampson, Jean (la mère), rêveuse et sans illusion, Mitch (le père), vétéran de la guerre, silencieux et brisé, Danner (la fille), adolescente rebelle des années 1960, Billy (le fils), envoyé au Vietnam. Le roman structuré en fragments chronologiques comme un album photo déchiré...
Les années 1940 : Mitch et Jean, l'illusion - Mitch, jeune soldat, rencontre Jean pendant la guerre. Leurs lettres (d'une poésie naïve) contrastent avec la brutalité du front. Une scène clé : Mitch, en permission, danse avec Jean sous un néon de diner. On aurait dit des acteurs dans un film qui finit mal ..
- Les années 1950 : Le rêve américain en toc - Le couple s'installe en Virginie-Occidentale. Mitch travaille dans l'électricité, Jean élève les enfants. Mais la maison neuve a des fissures dans les murs dès la première année...
- Les années 1960 : Danner, la révolte - Danner, 17 ans, fume des clopes en cachette et couche avec un garçon qui partira au Vietnam.
- Les années 1970 : Billy, l'absence - Billy est porté disparu au Vietnam. La famille vit dans le déni, continuant à mettre son couvert à table. Mitch nettoie obsessionnellement le fusil de chasse familial, "comme si ça pouvait ramener son fils"...
A inspiré des auteurs comme Tim O'Brien (The Things They Carried) ..

"Lark and Termite" (2009), deux récits imbriqués, un soldat mourant en Corée en 1950 et la vie de sa fille aux États-Unis des années plus tard, un livre salué comme un chef-d’œuvre formel et rempli d'émotions ...
Le récit alterne entre deux époques et perspectives,
- 1950 (Corée) : Les derniers jours de Robert Leavitt, soldat pris dans le massacre de No Gun Ri.
Robert, blessé, est caché par une jeune femme coréenne, Lola, dans un tunnel inondé. Hallucinant sous la morphine, il entend les cris des civils massacrés par l'armée américaine (référence à l'incident réel de No Gun Ri). Il confie son anneau de mariage à Lola avant de mourir, lui murmurant "Pour les enfants".
- 1959 (Virginie-Occidentale) : La vie de ses enfants, Lark (17 ans) et Termite, élevés par leur tante Nonie. Lark est une adolescente débrouillarde, protectrice de Termite, rêvant d'une vie ailleurs. Termite, un enfant de 9 ans, sourd et paralysé, perçu comme "simple d'esprit" mais doté d'une perception sensorielle unique. Le quotidien de Lark et Termite: Lark lit des histoires à Termite, qui réagit aux vibrations des mots à travers un morceau de métal. Termite perçoit le monde en couleurs et sons fantasmés (les trains sont des "dragons bleus"). Nonie travaille au Blue Moon Diner, où un mystérieux homme, Charlie, s'intéresse à eux.
Une inondation menace la ville, miroir du tunnel où Robert est mort. Charlie se révèle être un ancien soldat ayant connu Robert. Il confie à Lark que leur mère biologique était Lola, la Coréenne. Et Nonie a adopté les enfants après la mort de Lola, mais a toujours menti sur leurs origines.
Pendant l'inondation, Termite "entend" son père à travers l'eau (vision onirique). Lark décide de quitter la ville avec Termite, emportant l'anneau de Robert. On sera comme des feuilles dans le courant, Termite. Personne ne nous attrapera...

"Night Watch" (2023), une méditation gothique et historique sur la reconstruction après la guerre de Sécession (1863-1874, de la bataille de Gettysburg à l'ère post-guerre en Virginie-Occidentale) et les internements psychiatriques. Un roman historique primé, finaliste du Pulitzer 2024.
Le voyage vers l'asile (1863) : ConaLee est une jeune fille de 12 ans au début du récit, qui accompagne sa mère, Elizabeth, malade mentale à l'asile. La mère de ConaLee, ancienne institutrice, plongée dans un mutisme traumatique après un viol par des soldats. Elles traversent à pied une Virginie dévastée, poussant une brouette avec leurs maigres possessions.
L'établissement (Trans-Allegheny Lunatic Asylum) est géré par d'anciens infirmiers militaires. Les "patients" dorment dans des lits de fortune entre les miroirs fissurés et chaque nuit, on allume des lanternes pour calmer les cris ("Night Watch" du titre). Le Docteur Temple esdt un médecin de l'asile, ambigu, qui pratique des "thérapies" expérimentales.
Entrecoupant le récit, des fragments racontent la bataille de Gettysburg à travers les yeux d'un jeune soldat : progressivement, on apprendra que ce soldat est le père biologique de ConaLee (un viol non assumé). La révolte de ConaLee, lorsqu'elle découvre que le Dr. Temple prélève des dents en or sur les cadavres pour les revendre.
Épilogue (1874) : ConaLee, devenue sage-femme, accouche une jeune fille sous un chêne géant. Tandis qu'Elizabeth, toujours silencieuse, tresse des herbes médicinales – son premier geste de guérison. Un des rares romans sur les séquelles psychiatriques de la Guerre de Sécession (un sujet tabou).
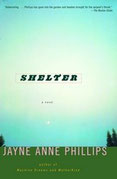
"Shelter" (1994)
Un roman sombre et poétique qui se déroule dans un camp de vacances religieux pour jeunes filles, situé dans les forêts isolées de Virginie-Occidentale, au cours des années 1960. L’atmosphère est étouffante, marquée par la chaleur de l’été, la violence latente et les tensions spirituelles et sexuelles qui agitent les adolescentes.
Parmi les personnages, Lenny, une adolescente introspective, en quête de sens, qui observe le monde autour d'elle avec une sensibilité aiguë; Alma, une jeune fille mystérieuse et fragile, marquée par un passé traumatique; Carmen, une campeuse plus âgée, charismatique et perturbée, qui exerce une influence trouble sur les autres; Buddy et Delia : Un couple d’adultes responsables du camp, dont les propres failles se reflètent dans leur incapacité à protéger vraiment les filles; Cap et Krystal, deux sœurs dont l’une est enceinte, ajoutant une dimension de menace et de désespoir au récit.
Le roman s’ouvre sur l’arrivée des filles au camp, un lieu censé être un refuge spirituel mais qui devient rapidement un espace de perversion et de danger. Les adolescentes, livrées à elles-mêmes, entre innocence et cruauté. Puis c'est la découverte d’un meurtre: une jeune fille, Cap, est retrouvée morte, étranglée près d’une rivière. Sa sœur, Krystal, enceinte et traumatisée, devient un symbole de la violence masculine et de la vulnérabilité des femmes.
Carmen, figure dominatrice, manipule les autres filles, notamment Alma, qu’elle attire dans des jeux pervers. Lenny, témoin silencieuse, assiste à ces interactions avec un mélange de fascination et d’horreur. Le camp, censé offrir un "abri" (shelter), échoue à protéger les filles. La religion est présentée comme ambiguë : à la fois source de réconfort et d’oppression. Un prédateur rôde dans les bois, et les filles sentent une présence menaçante. Le roman explore la peur constante de la violence sexuelle et l’impuissance face à un mal incontrôlable. Le roman se clôt sur une atmosphère de désolation. Alma, profondément marquée, semble perdue, tandis que Lenny reste hantée par ce qu’elle a vu. Le "shelter" n’a été qu’une illusion.
