- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt

Joan Didion (1934-2021), "Slouching Towards Bethlehem" (1968), "Play It As It Lays" (1970), "A Book of Common Prayer" (1977), "The White Album" (1979), "Salvador" (1983), "Miami" (1987), "Where I Was From" (2003).,"The Year of Magical Thinking" (2005) - ...
Last update : 03/03/2018

« We tell ourselves stories in order to live » (Nous nous racontons des histoires pour vivre), commence le titre du célèbre recueil d'essais de Joan Didion, “The White Album”, paru en 1979, une phrase devenue emblématique de sa pensée : l'humain crée des récits pour donner un sens à la vie, mais ces récits peuvent échouer à capturer la complexité et l'absurdité de la réalité. Didion témoigne de sa propre difficulté à structurer sa vie en un "récit" cohérent, reflétant ainsi l'expérience de beaucoup à cette époque troublée...
Joan Didion, tant à travers ses essais politiques et sociaux que ses romans, nous offre une critique sévère de l'Amérique contemporaine, souvent marquée par une désillusion profonde. Elle sait nous montrer, avec ce style qui lui est propre, - un style dépouillé, une prose concise et précise, souvent marquée par des répétitions et des juxtapositions, une approche littéraire dans des récits qui ne relèvent que pas ou peu de la fiction -, que les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur le monde sont de pures constructions, souvent en contradiction avec la réalité même. Didion est souvent fascinée par l'idée que le monde est chaotique et que nos tentatives pour en imposer un sens sont vouées à l'échec.
Commentatrice incisive des échecs du rêve américain et des fractures sociales de son pays, elle devint, dans la dernière partie de sa vie, une voix incontournable pour aborder la question de la perte et du deuil d'un être proche. - "Life changes in the instant. The ordinary instant", la vie peut basculer sans préavis, des moments anodins peuvent entraîner des bouleversements irrémédiables. Ses mémoires, en particulier "The Year of Magical Thinking" (2005) et "Blue Nights" (2011), qui évoquent la mort de son mari John Gregory Dunne et celle de sa fille Quintana, sont devenues des textes de référence sur le deuil, avec toujours cette articulation de froideur analytique et d'émotion brute qui caractérise son style.
Auparavant, Joan Didion aura passé toute la première partie de son existence à enregistrer dans une prose quasi laconique toutes les fêlures des Sixties qu'elle avait traversée, dit-elle, comme une somnambule, décennie où la violence, médiatisée, a commencé à s'emparer de la société : deux recueils de référence marqueront les turbulences des années 60 et 70, "Slouching Towards Bethlehem" (1968) et "The White Album" (1979).Elle publiera de même de nombreux articles dans des magazines comme The New Yorker, The New York Review of Books, et Esquire, certains de ses articles, comme "On Self-Respect" (1961) et "Goodbye to All That" (1967), devenant des classiques et fréquemment enseignés dans les cours de littérature pour leur style et leurs thématiques introspectives. Un roman, "Play It As It Lays" (1970), va en quelque sorte conclure ce premier segment de vie : traitant de la désintégration d'une héroïne, Maria, devenue emblématique, dans un contexte de superficialité et de culture de la célébrité, le roman deviendra un classique de la littérature américaine. Avec "Salvador" (1983) et "Miami" (1987), ce sont les ambiguïtés et les contradictions de la politique étrangère des États-Unis qu'elle dénoncera, explore la manière dont les conflits internationaux affectent les vies humaines au niveau le plus intime. Tout ordre social (et personnel) reste illusoire ...

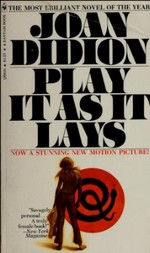
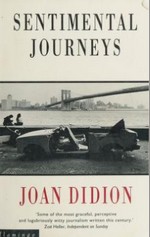





Joan Didion (1934-2021)
Elle a enregistrée dans une prose laconique toutes les fêlures des Sixties qu'elle a traversée, dit-elle, comme une somnambule, décennie où la violence, médiatisée, a commencé à s'emparer de la société..
Née à Sacramento, rédactrice à Vogue à New-York lorsqu'elle publie son premier roman, River Run (1963), une chronique familiale entre 1938 et 1959 dans une vallée agricole, celle du Sacramento, au moment disparaissent les grandes propriétés foncières au profit de l'industrie et que l'ordre social s'effondre : Didion dresse au centre de son histoire le portrait d'une femme, Lily Knight, qui voit son univers se dissoudre. Slouching Towards Bethlehem (1968) est un recueil de "choses vues", des reportages sur cette scène américaine de 1964 qui voit le ghetto noir de Watts, à Los Angeles, John Wayne tournant son 165e film, les rites des jeunes conscrits partant pour le Vietnam, le quartier hippie de Haight-Ashbury à San Francisco. The White Album (1970) réunit les reportages des années 1968-1969, avec cette allusion à l'album blanc des Beatles qui en 1968 parlait d'un monde où la violence "Rocky Racoon", "Bungalow Bill" : le recueil débute par la description de la clinique de Santa Monica dans laquelle Joan Didion tente de soigner sa dépression. Le recueil se poursuit avec Huey P.Newton, leader des Panthères noires, Jim Morrison qui enregistre avec les Doors, un pasteur disparu dans le désert de Jordanie, et surtout la tragédie du meurtre de Sharon Tate découverte le 9 août 1969 dans Cielo Drive, à Los Angeles. Les Sixties semblent ainsi s'achever. Mais c'est avec "Play it as it lays" (Maria avec et sans rien, 1970) que Joan Didion sort de l'anonymat et s'impose comme la grande inspiratrice, avec son style épuré, d'un Bret Easton Ellis et d'un Jay McInerney : Maria, trente et un ans, pour oublier des échecs sans fin, - divorcée, actrice ratée, sa fille internée, - part sur les routes sans fin de la Californie et remonte, étape par étape, la douloureuse expérience d'un vide sidéral... Frank Perry adapta le roman au cinéma en 1972 avec Tuesday Weld et Anthony Perkins.

"Slouching Towards Bethlehem" (1968)
Un recueil d'esssais qui porte sur la période californienne de Joan Didion dans les années soixante, l'un des chefs-d'oeuvre, et comporte trois parties, "Lifestyles in the Golden Land" ("Some Dreamers of the Golden Dream", "John Wayne: A Love Song", "Where the Kissing Never Stops"..), "Personals" et "Seven Places of the Mind". Un ensemble partiellement traduit en français partiellement dans "L'Amérique 1965-1990 - Chroniques". Un classique du journalisme littéraire pour sa capacité à exposer, avec lucidité, les fractures de la société américaine et son observation des transformations sociales qui s'opèrent dans le même temps.
"Slouching Towards Bethlehem", le titre de l'essai principal, est tiré du poème de W.B. Yeats, "The Second Coming", et symbolise le chaos et la désintégration de l'ordre moral. C'est en effet un regard lucide et mais parfois désabusé qu'adresse Didion sur la jeunesse des années 60, bien trop souvent idéalisée dans l’histoire dite de la "contre-culture". Abordant la scène hippie de Haight-Ashbury, à San Francisco, Didion n'y reconnaît que la désintégration sociale à travers des jeunes en rupture avec les valeurs traditionnelles, mais tout aussi perdus dans un monde d'excès et de confusion morale. Elle y décrit l’isolement des jeunes hippies, leurs idéaux d’amour et de paix confrontés à la réalité d’un vide émotionnel et existentiel, leurs prises de drogues et leur quête désespérée d’une communauté ou d’un sens à leur vie: "We were seeing the desperate attempt of a handful of pathetically unequipped children to create a community in a social vacuum" (Nous avons assisté à la tentative désespérée d'une poignée d'enfants pathétiquement mal équipés de créer une communauté dans un vide social). Didion ne se contente plus que d'observer avec une froideur qui peut paraître déconcertante une jeunesse perdue dans la déchéance d'une utopie avortée.
"Some Dreamers of the Golden Dream" conte l’histoire de Lucille Miller, accusée d’avoir tué son mari dans un accident de voiture dans la région de San Bernardino. Le côté sombre d'une Californie, par ailleurs terre de promesses et d’opportunités : "This is a story about love and death in the golden land, and begins with the country". Sous la surface idyllique, un univers de désillusion. Un essai critique du rêve américain montrant comment la poursuite de la réussite matérielle et du bonheur peut mener à la corruption morale. Didion dissèque l’histoire de Lucille Miller pour révéler les tensions sociales et les pressions culturelles qui, selon elle, poussent les individus vers la tragédie.
"Goodbye to All That" relate l'expérience à New York de Didion passé la vingtaine et le désenchantement qui l'a poussée à quitter la ville. Ce texte est l'un des plus personnels du recueil, décrivant la complexité de sa relation avec New York, un lieu à la fois fascinant et écrasant : "It is easy to see the beginnings of things, and harder to see the ends."
Dans "On Keeping a Notebook", Didion explore les raisons pour lesquelles elle tient un journal et interroge la nature subjective de la mémoire. Pour elle, le journal est un moyen de se rappeler des moments et des pensées qui autrement s'effaceraient : "I think we are well advised to keep on nodding terms with the people we used to be, whether we find them attractive company or not. Otherwise they turn up unannounced and surprise us."
"Where the Kissing Never Stops" : Didion décrit Joan Baez et sa vie à Carmel Valley, où elle a ouvert une école alternative. Didion s’y intéresse aux idéaux de la contre-culture et à l’image publique de Baez, la chanteuse folk. Didion explore les contradictions de cette figure de la contre-culture : une femme qui prône la paix mais est confrontée aux réalités matérielles et aux exigences d'une vie publique : "In the never-never land where the Kissing never stops, they are working a vein that everyone else left for scrap". Didion utilise le ton ironique pour évoquer la contradiction entre les idéaux prônés par les figures de la contre-culture et leur adaptation parfois forcée aux réalités de la société. Elle révèle à quel point ces idéaux sont souvent difficilement soutenables dans un monde qui valorise le pragmatisme et l’authenticité commerciale.
"Los Angeles Notebook" dépeint la ville de Los Angeles, explorant ses dynamiques sociales, son climat et ses failles. Didion y observe le phénomène des vents de Santa Ana, qui, selon elle, agissent comme un catalyseur de violence et de tension dans la ville. L'essai devient une métaphore pour l’instabilité émotionnelle et psychologique qui semble imprégner la culture de Los Angeles : "The wind shows us how close to the edge we are."
"On Morality", Didion y aborde explore le concept de morale et ce qu’il signifie dans un monde en mutation continue. Elle rejette la notion traditionnelle de morale absolue et évoque la complexité des choix éthiques, particulièrement en temps de crise : "I think we are finally confronted with a question of how much of what we believed on moral grounds was really something we believed in."
“Character - the willingness to accept responsibility for one’s own life - is the source from which self-respect springs" - C'est dans "On Self-Respect" que Didion nous parle de ce qu’elle appelle le "self-respect", qui repose, selon elle, sur la capacité d’assumer ses propres choix et responsabilités. Pour Didion, le respect de soi-même ne peut s'établir qu'à partir du moment où nous établissons une honnêteté rigoureuse envers nous-même, où nous acceptons de reconnaître nos propres erreurs et failles, plutôt que de nous lancer dans une quelconque recherche de l'approbation des autres. Une réflexion sur l’importance de la responsabilité personnelle ..

The White Album (1968-1978)
"The White Album" (1968-1978)
“We tell ourselves stories in order to live” - Un autre recueil qui regroupe tous les essais-reportages publiés dans Life and Esquire et correspondant à la phase d'immersion de Joan Didion dans l'univers de la contre-culture, en cinq grandes parties, "The White Album" (1968–78) proprement dit, puis "California Republic", "The Women's Movement" (1972) qui évoque Doris Lessing et Georgia O'Keeffe, "Sojourns", et enfin "On the Morning After the Sixties". Sera traduit partiellement en français dans "L'Amérique 1965-1990 - Chroniques".
Didion poursuit son exploration des années 60 et 70 en Amérique, scrutant les tensions culturelles et sociales, notamment les procès de Charles Manson, les événements de la contre-culture, et l’aliénation croissante. Le style de Didion ici est fragmenté, reflétant les désordres de l'époque. "The White Album" sera souvent étudié pour son style journalistique novateur et sa manière unique d'entrelacer des récits personnels et historiques.
1 - "we tell ourselves stories in order to live. The princess is caged in the consulate. The man with the candy will lead the children into the sea. The naked woman on the ledge outside the window on the sixteenth floor is a victim of accidie, or the naked woman is an exhibitionist, and it would be “interesting” to know which. We tell ourselves that it makes some difference whether the naked woman is about to commit a mortal sin or is about to register a political protest or is about to be, the Aristophanic view, snatched back to the human condition by the fireman in priest’s clothing just visible in the window behind her, the one smiling at the tele-photo lens. We look for the sermon in the suicide, for the social or moral lesson in the murder of five. We interpret what we see, select the most workable of the multiple choices. We live entirely, especially if we are writers, by the imposition of a narrative line upon disparate images, by the “ideas” with which we have learned to freeze the shifting phantasmagoria which is our actual experience.
1 - Nous nous racontons des histoires pour vivre. La princesse est en cage dans le consulat. L'homme au bonbon conduira les enfants à la mer. La femme nue sur le rebord de la fenêtre du seizième étage est victime d'un accident, ou la femme nue est une exhibitionniste, et il serait « intéressant » de savoir laquelle des deux. Nous nous disons que cela fait une certaine différence que la femme nue soit sur le point de commettre un péché mortel ou d'enregistrer une protestation politique ou d'être, selon le point de vue aristophanique, ramenée à la condition humaine par le pompier en habits de prêtre juste visible dans la fenêtre derrière elle, celui qui sourit au téléobjectif. Nous cherchons le sermon dans le suicide, la leçon sociale ou morale dans le meurtre de cinq personnes. Nous interprétons ce que nous voyons, nous sélectionnons le choix le plus réalisable parmi les multiples possibilités qui s'offrent à nous. Nous vivons entièrement, surtout si nous sommes écrivains, par l'imposition d'une ligne narrative sur des images disparates, par les « idées » avec lesquelles nous avons appris à figer la fantasmagorie changeante qui est notre expérience du réel.
Or at least we do for a while. I am talking here about a time when I began to doubt the premises of all the stories I had ever told myself, a common condition but one I found troubling. I suppose this period began around 1966 and continued until 1971. During those five years I appeared, on the face of it, a competent enough member of some community or another, a signer of contracts and Air Travel cards, a citizen: I wrote a couple of times a month for one magazine or another, published two books, worked on several motion pictures; participated in the paranoia of the time, in the raising of a small child, and in the entertainment of large numbers of people passing through my house; made gingham curtains for spare bedrooms, remembered to ask agents if any reduction of points would be pari passu with the financing studio, put lentils to soak on Saturday night for lentil soup on Sunday, made quarterly F. I. C. A. payments and renewed my driver’s license on time, missing on the written examination only the question about the financial responsibility of California drivers. It was a time of my life when I was frequently “named.” I was named godmother to children. I was named lecturer and panelist, colloquist and conferee. I was even named, in 1968, a Los Angeles Times “Woman of the Year,” along with Mrs. Ronald Reagan, the Olympic swimmer Debbie Meyer, and ten other California women who seemed to keep in touch and do good works. I did no good works but I tried to keep in touch. I was responsible. I recognized my name when I saw it. Once in a while I even answered letters addressed to me, not exactly upon receipt but eventually, particularly if the letters had come from strangers. “During my absence from the country these past eighteen months,” such replies would begin.
Ou du moins, nous le faisons pendant un certain temps. Je parle ici d'une période où j'ai commencé à douter des prémisses de toutes les histoires que je m'étais racontées, une situation courante mais que je trouvais troublante. Je suppose que cette période a commencé vers 1966 et s'est poursuivie jusqu'en 1971. Pendant ces cinq années, je suis apparu, à première vue, comme un membre assez compétent d'une communauté ou d'une autre, un signataire de contrats et de cartes de transport aérien, un citoyen : J'ai écrit plusieurs fois par mois pour un magazine ou un autre, j'ai publié deux livres, j'ai travaillé sur plusieurs films, j'ai participé à la paranoïa de l'époque, à l'éducation d'un enfant en bas âge et au divertissement d'un grand nombre de personnes qui passaient chez moi, j'ai confectionné des rideaux en vichy pour les chambres d'amis, je n'ai pas oublié de demander aux agents si toute réduction de points serait pari passu avec le studio de financement, j'ai mis des lentilles à tremper le samedi soir pour une soupe de lentilles le dimanche, j'ai effectué des paiements trimestriels au F. I. C. A. et j'ai renouvelé ma carte de crédit. C. A. et renouvelé mon permis de conduire à temps, ne manquant à l'examen écrit que la question sur la responsabilité financière des conducteurs californiens. C'était une période de ma vie où j'étais souvent « nommée ». J'ai été nommée marraine d'enfants. J'ai été nommée conférencière et panéliste, colloquiste et conférencière. J'ai même été nommée, en 1968, « femme de l'année » par le Los Angeles Times, aux côtés de Mme Ronald Reagan, de la nageuse olympique Debbie Meyer et de dix autres femmes californiennes qui semblaient rester en contact et faire de bonnes actions. Je n'ai pas fait de bonnes actions, mais j'ai essayé de rester en contact. Je n'ai pas fait de bonnes actions, mais j'ai essayé de rester en contact. J'étais responsable. Je reconnaissais mon nom quand je le voyais. De temps en temps, je répondais même aux lettres qui m'étaient adressées, pas exactement à la réception, mais éventuellement, surtout si elles provenaient d'étrangers. Ces réponses commençaient ainsi : « Pendant mon absence du pays au cours des dix-huit derniers mois ».
This was an adequate enough performance, as improvisations go. The only problem was that my entire education, everything I had ever been told or had told myself, insisted that the production was never meant to be improvised: I was supposed to have a script, and had mislaid it. I was supposed to hear cues, and no longer did. I was meant to know the plot, but all I knew was what I saw: flash pictures in variable sequence, images with no “meaning” beyond their temporary arrangement, not a movie but a cutting-room experience. In what would probably be the middle of my life I wanted still to believe in the narrative and in the narrative’s intelligibility, but to know that one could change the sense with every cut was to begin to perceive the experience as rather more electrical than ethical.
C'était une performance assez adéquate, si l'on s'en tient aux improvisations. Le seul problème était que toute mon éducation, tout ce que l'on m'avait dit ou que je m'étais dit, insistait sur le fait que la production n'était pas censée être improvisée : J'étais censé avoir un scénario, et je l'avais égaré. J'étais censée entendre les indications, et je ne les entendais plus. J'étais censé connaître l'intrigue, mais tout ce que je savais, c'était ce que je voyais : des images flash en séquence variable, des images sans « signification » au-delà de leur disposition temporaire, non pas un film, mais une expérience de salle de montage. Au milieu de ma vie, je voulais encore croire au récit et à son intelligibilité, mais savoir que l'on pouvait changer le sens à chaque coupure, c'était commencer à percevoir l'expérience comme plus électrique qu'éthique.
During this period I spent what were for me the usual proportions of time in Los Angeles and New York and Sacramento. I spent what seemed to many people I knew an eccentric amount of time in Honolulu, the particular aspect of which lent me the illusion that I could any minute order from room service a revisionist theory of my own history, garnished with a vanda orchid. I watched Robert Kennedy’s funeral on a verandah at the Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, and also the first reports from My Lai. I reread all of George Orwell on the Royal Hawaiian Beach, and I also read, in the papers that came one day late from the mainland, the story of Betty Lansdown Fouquet, a 26-year-old woman with faded blond hair who put her five-year-old daughter out to die on the center divider of Interstate 5 some miles south of the last Bakersfield exit. The child, whose fingers had to be pried loose from the Cyclone fence when she was rescued twelve hours later by the California Highway Patrol, reported that she had run after the car carrying her mother and stepfather and brother and sister for “a long time.” Certain of these images did not fit into any narrative I knew.
Au cours de cette période, j'ai passé ce qui était pour moi les proportions habituelles de temps à Los Angeles, New York et Sacramento. J'ai passé ce qui a semblé à beaucoup de gens que je connaissais un temps excentrique à Honolulu, dont l'aspect particulier m'a donné l'illusion que je pouvais à tout moment commander au room service une théorie révisionniste de ma propre histoire, agrémentée d'une orchidée vanda. J'ai assisté aux funérailles de Robert Kennedy sur une véranda de l'hôtel Royal Hawaiian à Honolulu, ainsi qu'aux premiers rapports de My Lai. J'ai relu tout George Orwell sur la plage du Royal Hawaiian Beach, et j'ai également lu, dans les journaux qui arrivaient avec un jour de retard du continent, l'histoire de Betty Lansdown Fouquet, une femme de 26 ans aux cheveux blonds décolorés qui a laissé mourir sa fille de cinq ans sur le séparateur central de l'Interstate 5, à quelques kilomètres au sud de la dernière sortie de Bakersfield. L'enfant, dont les doigts ont dû être arrachés de la clôture du Cyclone lorsqu'elle a été secourue douze heures plus tard par la California Highway Patrol, a déclaré qu'elle avait couru « longtemps » après la voiture transportant sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur. Certaines de ces images ne correspondaient à aucun des récits que je connaissais..."
Un autre aspect important de "The White Album", l'étude critique de la culture de la célébrité. Didion a rencontré Jim Morrison, les Doors, et Charles Manson, et abordé l'obsession croissante pour le crime et le scandale dans la culture américaine. Elle observe ces icônes à la fois avec fascination et scepticisme, se concentrant souvent sur leur part de vulnérabilité et de désespoir...
"It was six, seven o’clock of an early spring evening in 1968 and I was sitting on the cold vinyl floor of a sound studio on Sunset Boulevard, watching a band called The Doors record a rhythm track. On the whole my attention was only minimally engaged by the preoccupations of rock-androll bands (I had already heard about acid as a transitional stage and also about the Maharishi and even about Universal Love, and after a while it all sounded like marmalade skies to me), but The Doors were different, The Doors interested me. The Doors seemed unconvinced that love was brotherhood and the Kama Sutra. The Doors’ music insisted that love was sex and sex was death and therein lay salvation. The Doors were the Norman Mailers of the Top Forty, missionaries of apocalyptic sex. Break on through, their lyrics urged, and Light my fire, and ...
« Il était six ou sept heures d'une soirée du début du printemps 1968 et j'étais assis sur le sol froid en vinyle d'un studio de prise de son sur Sunset Boulevard, regardant un groupe appelé The Doors enregistrer une piste rythmique. Dans l'ensemble, les préoccupations des groupes de rock-androll n'attiraient que très peu mon attention (j'avais déjà entendu parler de l'acide comme d'une étape transitoire, du Maharishi et même de l'amour universel, et au bout d'un moment, tout cela ressemblait à des skis à la marmelade), mais les Doors étaient différents, les Doors m'intéressaient. Les Doors ne semblaient pas convaincus que l'amour était la fraternité et le Kama Sutra. La musique des Doors insistait sur le fait que l'amour était le sexe et que le sexe était la mort, et que c'était là que se trouvait le salut. Les Doors étaient les Norman Mailer du Top Forty, les missionnaires du sexe apocalyptique. Les Doors étaient des Norman Mailer du Top 40, des missionnaires du sexe apocalyptique :
Come on baby, gonna take a little ride
Goin down by the ocean side
Gonna get real close
Get real tight
Baby gonna drown tonight
Goin’ down, down, down.
On this evening in 1968 they were gathered together in uneasy symbiosis to make their third album, and the studio was too cold and the lights were too bright and there were masses of wires and banks of the ominous blinking electronic circuitry with which musicians live so easily. There were three of the four Doors. There was a bass player borrowed from a band called Clear Light. There were the producer and the engineer and the road manager and a couple of girls and a Siberian husky named Nikki with one gray eye and one gold. There were paper bags half filled with hardboiled eggs and chicken livers and cheeseburgers and empty bottles of apple juice and California rose. There was everything and everybody The Doors needed to cut the rest of this third album except one thing, the fourth Door, the lead singer, Jim Morrison, a 24-year-old graduate of U. C. L. A.who wore black vinyl pants and no underwear and tended to suggest some range of the possible just beyond a suicide pact. It was Morrison who had described The Doors as “erotic politicians.” It was Morrison who had defined the group’s interests as “anything about revolt, disorder, chaos, about activity that appears to have no meaning.” It was Morrison who got arrested in Miami in December of 1967 for giving an “indecent” performance. It was Morrison who wrote most of The Doors’ lyrics, the peculiar character of which was to reflect either an ambiguous paranoia or a quite unambiguous insistence upon the love-death as the ultimate high. And it was Morrison who was missing. It was Ray Manzarek and Robby Kriegerand John Densmore who made The Doors sound the way they sounded, and maybe it was Manzarek and Krieger and Densmore who made seventeen out of twenty interviewees on American Bandstand prefer The Doors over all other bands, but it was Morrison who got up there in his black vinyl pants with no underwear and projected the idea, and it was Morrison they were waiting for now.
Ce soir-là, en 1968, ils étaient réunis dans une symbiose malaisée pour réaliser leur troisième album, et le studio était trop froid, les lumières étaient trop vives, il y avait des masses de fils et des banques de circuits électroniques clignotants inquiétants avec lesquels les musiciens s'accommodent si facilement. Il y avait trois des quatre Doors. Il y avait un bassiste emprunté à un groupe appelé Clear Light. Il y avait le producteur, l'ingénieur, le road manager, deux filles et un husky sibérien nommé Nikki, avec un œil gris et un œil doré. Il y avait des sacs en papier à moitié remplis d'œufs durs, de foies de poulet, de cheeseburgers, de bouteilles vides de jus de pomme et de rose de Californie. Il y avait tout et tout le monde dont les Doors avaient besoin pour enregistrer le reste de ce troisième album, sauf une chose, la quatrième porte, le chanteur, Jim Morrison, un diplômé de 24 ans de l'Université de Californie à Los Angeles, qui portait des pantalons noirs en vinyle et pas de sous-vêtements, et qui avait tendance à suggérer un certain champ du possible, juste au-delà d'un pacte de suicide. C'est Morrison qui avait décrit les Doors comme des « politiciens érotiques ». C'est Morrison qui avait défini les intérêts du groupe comme « tout ce qui concerne la révolte, le désordre, le chaos, les activités qui semblent n'avoir aucun sens ». C'est Morrison qui a été arrêté à Miami en décembre 1967 pour avoir donné un spectacle « indécent ». C'est Morrison qui a écrit la plupart des paroles des Doors, dont le caractère particulier reflétait soit une paranoïa ambiguë, soit une insistance sans ambiguïté sur l'amour-mort en tant qu'apogée ultime. Et c'est Morrison qui manquait à l'appel. C'est Ray Manzarek, Robby Krieger et John Densmore qui ont fait sonner les Doors comme ils sonnaient, et c'est peut-être Manzarek, Krieger et Densmore qui ont fait que dix-sept interviewés sur vingt de l'émission American Bandstand ont préféré les Doors à tous les autres groupes, mais c'est Morrison qui est monté sur scène dans son pantalon en vinyle noir sans sous-vêtements et qui a projeté l'idée, et c'est Morrison qu'ils attendaient à présent..."
Et l'un des essais les plus marquants traite du procès des membres de la “Manson Family”. Didion examine comment les meurtres commis par ce groupe, et l'hystérie qu'ils ont déclenchée, illustrent la perte de toute stabilité morale dans la société américaine. Elle décrit l’angoisse sociale et la désintégration des normes, dans une Amérique qui commence à voir émerger les prémices de la culture du crime et de la paranoïa.
"... Many people I know in Los Angeles believe that the Sixties ended abruptly on August 9, 1969, ended at the exact moment when word of the murders on Cielo Drive traveled Uke brushfire through the community, and in a sense this is true. The tension broke that day. The paranoia was fulfilled. In another sense the Sixties did not truly end for me until January of 1971, when I left the house on Franklin Avenue and moved to a house on the sea. This particular house on the sea had itself been very much a part of the Sixties, and for some months after we took possession I would come across souvenirs of that period in its history — a piece of Scientology literature beneath a drawer lining, a copy of Stranger in a Strange Land stuck deep on a closet shelf — but after a while we did some construction, and between the power saws and the sea wind the place got exorcised..."
« ... Beaucoup de gens que je connais à Los Angeles pensent que les années soixante se sont terminées brusquement le 9 août 1969, au moment exact où la nouvelle des meurtres de Cielo Drive s'est répandue comme un feu de broussailles dans la communauté, et dans un sens, c'est vrai. La tension s'est relâchée ce jour-là. La paranoïa a pris fin. Dans un autre sens, les années soixante ne se sont pas vraiment terminées pour moi avant janvier 1971, lorsque j'ai quitté la maison de Franklin Avenue pour emménager dans une maison au bord de la mer. Cette maison particulière sur la mer avait elle-même fait partie intégrante des années soixante, et pendant quelques mois après que nous en ayons pris possession, j'ai découvert des souvenirs de cette période de son histoire - un morceau de littérature scientologique sous une doublure de tiroir, un exemplaire de Stranger in a Strange Land coincé au fond d'une étagère de placard - mais après un certain temps, nous avons fait des travaux de construction, et entre les scies mécaniques et le vent de la mer, l'endroit a été exorcisé..."
Enfin, pour Didion, la Californie représente à la fois un rêve et un cauchemar. Elle se penche sur l’histoire de l’État, notamment sa violence latente et ses idéaux utopiques qui masquent souvent des réalités plus sombres. Dans The White Album, la Californie devient un microcosme des luttes américaines, où l'individualisme, l'illusion et la chute des idéaux se mélangent. Elle observe avec une perspicacité intense comment cet État, avec ses cultes et ses célébrités, devient le terrain de toutes les contradictions de la fin du siècle.

"L'Amérique - Chroniques"
« Je me fais l’effet d’une somnambule, sensible uniquement à l’étoffe dont sont faits les mauvais rêves, aux fous, aux rôdeurs tapis dans l’ombre, aux enfants perdus, à toutes les armées de l’ignorance qui s’agitent dans la nuit. Je ne suis pas un microcosme de la société. Je suis une femme de 34 ans qui a de longs cheveux raides, un vieux bikini et une crise de nerfs, assise sur une île au milieu du Pacifique à attendre une lame de fond qui ne vient pas. » – Joan Didion, 1969 - Redécouverte en 2007 grâce à "L’Année de la pensée magique", Joan Didion fut d’abord et avant tout l’une des plus fines chroniqueuses de l’Amérique désaxée des années 60 et 70. Les onze textes ici réunis (restés à ce jour inédits en France et parés d’une aura quasi mythique aux Etats-Unis) nous entraînent dans une plongée en immersion au cœur du quartier hippie de San Francisco en 1967 ; à la rencontre de John Wayne, des Doors ou des Black Panthers ; dans les collines de Los Angeles terrorisées par la « famille » Manson ; à New York en proie à l’hystérie collective au lendemain d’un meurtre à Central Park ; sur la plage hawaïenne de Tant qu’il y aura des hommes ; ou encore dans les méandres des fêlures mentales de Joan Didion elle-même, qui par la force ensorcelante de son écriture ne cesse de surprendre, de déranger, et d’émouvoir." (Editions Grasset)
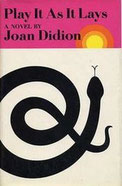
"Play It As It Lays" (1970)
Un roman qui est considéré comme l'un des plus emblématiques de Didion et l'un de ses plus plus célèbres. Il conclut nombre d'essais en exprimant toute la vacuité, la désillusion et la dépression dans l'Amérique des années 1960 à travers le prisme d'Hollywood ("Hollywood is a place where they’ll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul") et de la société californienne. Ce roman raconte l’histoire de Maria Wyeth, une actrice en perte de repères, confrontée à un monde superficiel, celui du culte de la célébrité, où les relations humaines et les valeurs sont remplacées par le cynisme et la désillusion.
Maria Wyeth, autrefois étoile montante à Hollywood, est une jeune femme qui sombre dans la dépression et le désespoir. L'intrigue suit Maria dans une période difficile. D'une part, la séparation d’avec son mari Carter Lang, un réalisateur égocentrique en proie à des sentiments d’aliénation profonde. Et d'autre part elle-même marquée par une série de drames personnels : la mort de sa mère dans un accident de voiture, un mariage désintégré, un avortement qui l’a traumatisée, et l’internement de sa fille Kate pour des problèmes de santé mentale ("I remember the way she [Kate] looked when they came for her, the way she said goodbye, the way I turned away"). Didion va débuter son intrigue en plongeant directement dans la conscience de Maria, sans préambule : "What makes Iago evil? some people ask. I never ask", Maria est une femme qui a cessé de chercher des réponses morales ou rationnelles dans un monde qui lui semble absurde et imprévisible. Son refus de questionner le mal ou de tenter de comprendre les motivations des autres reflète son nihilisme et sa résignation...
Le roman suit les errances existentielles de Maria dans Los Angeles et le désert du Nevada, ponctuées de souvenirs fragmentés et de réflexions sur l’absurdité de sa vie et de son environnement. Le roman alterne entre la voix de Maria, qui s’exprime de manière directe et parfois détachée, et celle d’un narrateur omniscient, créant une ambiance d’étrangeté et de distance émotionnelle. La quête de sens de Maria, à travers un monde vide et froid, se traduit par une narration minimaliste et un langage épuré, caractéristiques du style de Didion.
La Californie, lieu associé à l'image du rêve américain, devient avec Didion un symbole de la superficialité et de la désillusion, le désert californien se prêtant au sentiment de vide intérieur et d’errance : "In the meantime it was easier to drive than to think, easier to lose the way on the freeway than to call one more time and find no answer". Ici, la route sans fin et les autoroutes deviennent un moyen pour Maria de se dissocier de sa vie et de ses pensées. L’anesthésie d’une errance vaut toutes les confrontations avec ses émotions. Maria, malgré sa vie confortable, est enfermée dans un cycle de comportements autodestructeurs, trahissant une quête sans fin pour un bonheur inaccessible. Le roman se terminera avec Maria acceptant sa situation, une forme de paix résignée et stoïque, et le dernier passage, emblématique, laisse une impression de fatalité : "One thing in my defense, not that it matters: I know something Carter never knew, or Helene, or maybe you. I know what 'nothing' means, and keep on playing". Maria acceptera le vide de sa vie avec une compréhension intime de ce que signifie "RIEN". Elle choisit de continuer malgré tout, car elle sait que RIEN n’aura jamais de sens, une leçon qui la libère d’une certaine manière.
À sa parution, "Play It As It Lays" fut acclamé pour son portrait saisissant d’une génération en crise, bien que le roman ait également été critiqué pour son pessimisme radical ...
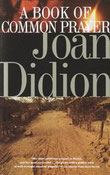
"A Book of Common Prayer" (Joan Didion, 1977)
Un premier roman qui imposa Joan Didion comme une voix singulière dans la littérature américaine, abordant des thèmes intimes (la perte, le désir d'appartenance, et l’impossibilité de contrôler son propre destin) tout en critiquant les dynamiques politiques et sociales, le tout dans un style fragmenté et avec des personnages ambigus. D'où une certaine complexité. L’histoire est racontée par Grace Strasser-Mendana, une scientifique cynique et désabusée mariée à un homme influent de Boca Grande. Le roman s’articule autour de deux femmes américaines dans la nation délabrée d’Amérique centrale de Boca Grande, Grace Strasser-Mendana qui contrôle une grande partie de la richesse du pays et connaît pratiquement tous ses secrets; et Charlotte Douglas, une "Immaculée de l’histoire, innocente de la politique", une Américaine issue de la classe aisée, qui arrive à Boca Grande après une vie marquée par des tragédies familiales et des échecs personnels. Charlotte est à la recherche de sa fille, Marin, qui a disparu après s'être associée à des terroristes d'extrême gauche. À mesure que l’histoire progresse, Charlotte semble de plus en plus perdue et déconnectée de la réalité, obsédée par son passé et par ses tentatives de comprendre ses erreurs et sa propre identité. Le personnage de Grace, qui observe Charlotte, tombe, quant à lui, dans une profonde fascination pour cette femme apparemment naïve mais désespérée ...

"Salvador" (Joan Didion, 1983)
Dans ce court essai journalistique, Joan Didion évoque la situation politique violente et chaotique du Salvador en pleine guerre civile, résultat d'un séjour de deux semaines avec pour mission de témoigner des effets de la guerre civile sur la société salvadorienne. Elle y révèle les réalités de ce conflit brutal, mais aussi les implications de la politique étrangère américaine dans la région, soulignant l’impact humain de l’ingérence politique et militaire des États-Unis en Amérique latine. Son récit s’attardera sur la peur omniprésente, la pauvreté, et la désensibilisation à la violence, mais aussi sur le cynisme et l’impuissance face aux atrocités commises quotidiennement. Elle sait mettre en lumière la complexité des alliances entre les gouvernements américain et salvadorien, montrant comment les États-Unis financent et soutiennent indirectement le régime salvadorien, malgré les accusations de corruption et de violations des droits de l’homme qui pèsent sur lui. Un soutien justifié par la volonté américaine de lutter contre l’influence communiste dans la région, un objectif poursuivi au détriment de la stabilité et de la sécurité des Salvadoriens eux-mêmes. L'engagement est tout autant personnel : en tant qu’étrangère observant une guerre civile, Didion elle-même se sent impuissante et déconnectée, incapable de comprendre pleinement les complexités de la situation ni de trouver des réponses aux questions morales qu’elle soulève. Un essai qui fut largement salué pour son style percutant et pour la manière dont Didion parvient à transmettre la tension palpable de la guerre civile et l’impact de la politique américaine sur le Salvador.

"Democracy" (Joan Didion, 1984)
Un roman de Joan Didion qui explore les thèmes du pouvoir, de la corruption, et des conséquences morales de la politique étrangère américaine, dans un contexte de la guerre froide, abordant notamment les interventions américaines en Asie, notamment les opérations clandestines et les interventions américaines dans des pays instables, un monde dans lequel la ligne entre bien et mal reste par essence floue. Inez et Lovett incarnent les personnages principaux, à la fois séduisants et moralement ambivalents. Inez Christian Victor, issue d'une famille influente, est l'épouse de Harry Victor, un sénateur américain ambitieux et préoccupé par son image publique. Inez, bien que riche et entourée de privilèges, est désillusionnée par sa vie et son mariage. Elle entame une relation amoureuse avec Jack Lovett, un mystérieux opérateur qui travaille sur des missions secrètes pour le gouvernement américain, souvent dans les zones de conflit en Asie du Sud-Est. "Democracy" entendait dévoiler les ramifications de la politique américaine et l’impact des intérêts personnels et financiers sur les décisions qui affectent des nations entières, ce qui semblait alors assez bien réussi ..
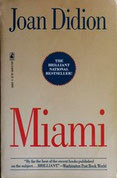
"Miami" (Joan Didion, 1987)
Un essai dans lequel Didion a dressé le portrait d’une ville, Miami, où les exilés cubains jouent un rôle influent, alimentant à la fois le rêve d’une libération de Cuba et un ressentiment envers le régime de Castro. Elle montre comment cette population se retrouve mêlée aux intérêts américains en matière de politique étrangère, avec des groupes d'exilés devenant des pions dans la guerre froide contre le communisme, allant jusqu'à relater les opérations clandestines organisées depuis Miami, les alliances entre agents de la CIA et exilés cubains, ainsi que les affaires de trafic de drogue et d’armes, qui contribuent à alimenter l'ambiguïté singulière de cette ville. "Miami" est devenu un texte de référence pour quiconque s’intéresse à la politique américaine envers Cuba et aux dynamiques culturelles de la ville. L’essai reste pertinent aujourd'hui pour sa capacité à capturer la dualité de Miami, à la fois lieu de rêve américain et espace de conflits politiques intenses. Ce livre a solidifié la réputation de Didion comme une observatrice perspicace des tensions sociales et politiques, et comme une voix critique de l’impérialisme américain.

"The Last Thing He Wanted" (Joan Didion, 1996)
Il s'agit ici d'un roman politique complexe explorant les thèmes de la corruption, de la manipulation, et des conséquences des intérêts américains en Amérique centrale dans les années 1980. Le roman s'inspire des intrigues de la Guerre froide et offre un regard particulièrement désillusionné sur le rôle des États-Unis dans les affaires internationales.
Ecrit à la troisième personne, le roman nous entraîne à la suite d'Elena McMahon, une journaliste de Washington D.C. qui, après avoir couvert de nombreux conflits mondiaux, quitte subitement son travail pour s'occuper de son père malade (Dick McMahon). Celui-ci, impliqué dans des affaires douteuses, convainc Elena de prendre en charge une livraison d'armes destinée à l'Amérique centrale. Sans en saisir les risques, elle se retrouve plongée dans un univers dangereux où se mêlent manipulations politiques, trafic d’armes, et violence. Au fur et à mesure de l'intrigue, elle devient un pion dans une opération complexe et de plus en plus menaçante. Le roman examine sa lente prise de conscience et la progression inexorable vers un sort tragique. Un roman qui divisa les critiques ...

"Political Fictions" (Joan Didion, 2001)
Joan Didion se penche très froidement sur le processus politique américain et sur « cette poignée d'initiés qui inventent, année après année, le récit de la vie publique » (“that handful of insiders who invent, year in and year out, the narrative of public life). En déconstruisant les sons et les photos de trois campagnes présidentielles, d'une destitution présidentielle et d'un scandale sexuel inoubliable, Didion met en évidence les mécanismes de la politique américaine. Elle nous révèle la vérité inconfortable sur la façon dont nous votons, sur les candidats pour lesquels nous votons et sur les personnes qui nous disent de voter pour eux. Ces éléments se succèdent pour former un portrait troublant du paysage politique américain, et qui constitue plus qu'une lecture essentielle de notre démocratie...

"Where I Was From" (Joan Didion, 2003)
Joan Didion réévalue dans ce nouveau certains aspects de sa vie, de son travail, de son histoire (et de la nôtre). Combinant histoire et reportage, mémoires et critique littéraire, "Where I Was From" explore les romances de la Californie avec la terre et l'eau, ses dettes non reconnues envers les chemins de fer, l'aérospatiale et le grand gouvernement, la disjonction entre son code de l'individualisme et son fétichisme pour les prisons. Qu'elle écrive sur ses ancêtres pionniers ou sur des prédateurs sexuels privilégiés, sur des barons voleurs ou sur des écrivains (sans s'exclure elle-même), Didion est une observatrice hors pair, et son livre est à la fois intellectuellement provocateur et profondément personnel...

"L'année de la pensée magique" ( The Year of Magical Thinking, 2005)
Dans ce livre bouleversant, Didion raconte la perte de son mari, John Gregory Dunne, et la maladie de sa fille Quintana. Elle explore le deuil, la souffrance et la résilience avec une honnêteté poignante. "The Year of Magical Thinking" a remporté le National Book Award et a été acclamé pour sa profondeur émotionnelle : "Grief, when it comes, is nothing like we expect it to be. Grief has no distance. Grief comes in waves, paroxysms, sudden apprehensions that weaken the knees and blind the eyes and obliterate the dailiness of life" (Le chagrin, lorsqu'il survient, n'a rien à voir avec ce que nous attendons de lui. Le chagrin n'a pas de distance. Le chagrin survient par vagues, paroxysmes, appréhensions soudaines qui affaiblissent les genoux, aveuglent les yeux et effacent le quotidien de la vie) ...
"Une soirée ordinaire, fin décembre à New York. Joan Didion s'apprête à dîner avec son mari, l'écrivain John Gregory Dunne - quand ce dernier s’écroule sur la table de la salle à manger, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Pendant une année entière, Didion essaiera de se résoudre à la mort du compagnon de toute sa vie, tout en s'occupant de leur fille, plongée dans le coma suite à une grave pneumonie. La souffrance, l'incompréhension, l'incrédulité, la méditation obsessionnelle autour de cet événement si commun et pourtant inconcevable : dans un récit impressionnant de sobriété et d'implacable honnêteté, Didion raconte la folie du deuil et dissèque, entre sécheresse clinique et monologue intérieur, la plus indicible expérience - et sa rédemption par la littérature. " (Editions Grasset)
".. Les gens qui ont récemment perdu quelqu'un ont un air particulier, que seuls peut-être ceux qui l'ont décelé sur leur propre visage peuvent reconnaître. Je l'ai remarqué sur mon visage et je le remarque à présent sur d'autres. C'est un air d'extrême vulnérabilité, une nudité, une béance. C'est l'air de quelqu'un qui sort de chez l'ophtalmologue, les yeux dilatés à la lumière du jour, ou de quelqu'un qui porte des lunettes et doit tout à coup les enlever. Ces gens qui ont perdu un proche ont l'air nus parce qu'ils se croient invisibles. Moi-même je me suis sentie invisible pendant un certain temps, incorporelle. Il me semblait avoir traversé l'un de ces fleuves légendaires qui séparent les vivants des morts, être entrée dans un espace où seuls pouvaient me voir ceux qui eux-mêmes étaient en deuil. J'ai compris pour la première fois le pouvoir qui réside dans l'image de ces fleuves, le Styx, le Léthé, le passeur vêtu de sa capeline avec sa longue rame. J'ai compris pour la première fois la signification du rite du satî: ce n'est pas de chagrin que les veuves se jetaient sur le bûcher funéraire; c'est plutôt que le bûcher était la représentation exacte du lieu où leur chagrin (non pas leur famille, ni la communauté, ni la coutume - leur chagrin) les avait conduites. Le soir où John est mort, nous étions à trente et un jours de notre quarantième anniversaire de mariage. Vous aurez deviné que la "douce et cruelle" sagesse de "Rose Aylmer" ne signifiait rien pour moi. Je voulais plus qu'une nuit de souvenirs et de soupirs. Je voulais hurler. Je voulais qu'il revienne..."
« We tell ourselves stories in order to live » (Nous nous racontons des histoires pour vivre), commence le titre du célèbre recueil d'essais de Joan Didion, “The White Album”, paru en 1979. Dans « L'année de la pensée magique » (Year of Magical Thinking), une Didion plus âgée demande ce que nous nous racontons exactement lorsque la mort s'assied à notre table.
Le 30 décembre 2003, Didion et son mari, le romancier John Gregory Dunne, se sont rendus à l'hôpital pour rendre visite à leur fille, Quintana, plongée dans un coma artificiel dans le cadre d'un traitement sévère pour une maladie mystérieuse et un choc septique. Plus tard dans la soirée, ils sont rentrés dans leur appartement de Manhattan et se sont mis à table. Ils parlent de leur journée. Au milieu de leur conversation, John s'est affaissé sur sa chaise, a levé la main et est mort.
« John was talking, then he wasn’t » (John parlait, puis il ne parlait plus), écrit Didion dans ce journal de deuil dépouillé et profondément émouvant, l'un des livres les plus significatifs de ces derniers temps, qui aborde le poids et les obligations imposés par la mort, ainsi que la rupture avec la normalité qu'entraîne le deuil. « C'est ma tentative », dit Didion à ses lecteurs et à elle-même, “de donner un sens à la période qui a suivi, des semaines puis des mois qui m'ont fait perdre toute idée fixe que j'avais jamais eue sur la mort, la maladie, les probabilités et la chance, la bonne et la mauvaise fortune, le mariage, les enfants et la mémoire, le deuil, la façon dont les gens gèrent ou non le fait que la vie s'arrête, la superficialité de la santé mentale, la vie elle-même” ("This is my attempt to make sense of the period that followed, weeks and then months that cut loose any fixed idea I had ever had about death, about illness, about probability and luck, about good fortune and bad, about marriage and children and memory, about grief, about the ways in which people do and do not deal with the fact that life ends, about the shallowness of sanity, about life itself").
Dans les mois qui suivent la mort de son mari (son année de « pensée magique » (magical thinking), c'est-à-dire d'imagination que les circonstances peuvent changer si seulement elle le souhaite assez fort), Didion devient la proie d'un deuil paralysant, son chagrin étant un état de siège étrange et ininterrompu. Elle se tourne vers la science à la recherche de réponses impossibles, et parle à ses amis pour découvrir que leur amitié ne lui apporte aucun secours. Tout ce qu'elle peut faire - lentement, avec incertitude - c'est commencer à faire des phrases, ériger, pour reprendre ses propres mots dans un autre contexte, « une barricade contre une profonde appréhension de l'absence de sens » (a barricade against some deep apprehension of meaninglessness). Le discernement aigu de l'auteur, avec lequel elle a précédemment éclairé les angoisses culturelles et les fictions politiques de l'Amérique au cours de quatre décennies d'essais et de romans, doit maintenant décrire le plus insaisissable des phénomènes : l'absence.
Ce qui est le plus émouvant dans l'anatomie du deuil de Didion, c'est qu'elle n'offre pas de faux réconfort. À la suite d'une tragédie, nous pouvons espérer trouver dans les livres le témoignage que le pire passera si seulement nous « surmontons » notre douleur. Il n'en est rien. Accepter la mort, nous montre Didion, c'est accepter les seuls termes qu'elle autorise, qui sont les mêmes que ceux de la vie, mais plus solitaires : “We tell ourselves stories in order to live.” And there’s something so true and nourishing in the telling here that The Year of Magical Thinking seems - paradoxically- a necessary, life-enhancing miracle, and a boon to those whose grief is boundless" (Nous nous racontons des histoires pour vivre. Et il y a quelque chose de si vrai et de si nourrissant dans ce récit que L'année de la pensée magique semble - paradoxalement - un miracle nécessaire et bénéfique pour la vie, et une aubaine pour ceux dont le chagrin est sans limites) ...
"We Tell Ourselves Stories in Order to Live: Collected Nonfiction" (2006)
Les sept ouvrages de non-fiction parus entre 1968 et 2003 sont ici réunis dans une nouvelle collection. "Slouching Towards Bethlehem" capture la contre-culture des années soixante, son humeur et son style de vie, symbolisés par la Californie, Joan Baez et Haight-Ashbury. "The White Album" couvre la politique révolutionnaire et le « désert contemporain » (contemporary wasteland) de la fin des années soixante et du début des années soixante-dix, avec des articles sur la famille Manson, les Black Panthers et Hollywood. "Salvador" est un regard captivant sur le paysage social et politique de la guerre civile. "Miami" expose le rôle secret que cette ville essentiellement latine a joué dans la guerre froide, de la baie des Cochons au Watergate. Dans "After Henry", Didion évoque les Reagan, Patty Hearst et l'affaire de la joggeuse de Central Park. Les huit essais de "Political Fictions" - sur la censure dans les médias, Gingrich, Clinton, Starr et le « conservatisme compatissant » (compassionate conservatism), entre autres - nous montrent comment nous en sommes arrivés à la scène politique de ce tout début du XXIe siècle. Et dans "Where I Was From", Didion montre que la Californie n'a jamais été le pays du "golden dream" ....

"Blue Nights" (2011, Le bleu de la nuit)
Après avoir érigé un inoubliable tombeau littéraire à l’homme de sa vie ("L'Année de la pensée magique"), Joan Didion adresse, dans "Le Bleu de la nuit", un vibrant hommage funèbre à leur fille, décédée quelques semaines à peine avant la parution de "La Pensée magique" aux Etats-Unis. Mais qu’on ne se méprenne pas : loin d’être une « suite », ce récit serait plutôt son image en miroir, une variation inversée. On y retrouve, intactes, la puissance et la singularité de l’écriture de Didion : sèche, précise, lumineuse face à la nuit. Dans un puzzle de réminiscences et de réflexions (sur la mort, bien sûr, mais aussi sur les mystères de la maternité, de l’enfance, de la maladie, de la vieillesse, de la création…), l’auteur mène un combat acharné contre les fantômes de la mélancolie, des doutes et des regrets. Poignante sans jamais verser dans le pathétique, d’une impitoyable honnêteté envers elle-même sans jamais céder aux sirènes de la complaisance ou de l’impudeur, elle affirme une fois de plus, au crépuscule de son existence, sa foi dans les forces de l’esprit et de la littérature." (trad. Editions Grasset)
"Blue Nights" s'ouvre le 26 juillet 2010, alors que Didion se remémore le mariage de Quintana à New York, sept ans auparavant: son anniversaire de mariage, autant d'instantanés qui rejaillissent de l'enfance de sa fille - à Malibu, à Brentwood, à l'école de Holmby Hills. Didon pense à elle et à son propre rôle de mère, et se laissera emporter dans un sentiment de culpabilité auquel elle suppose ne pouvoir échapper : "When we talk about mortality, we are talking about our children. Once she was born, I was never not afraid. I was afraid of swimming pools, I was afraid of highways, I was afraid of planes, I was afraid of drugs, I was afraid of everything" (Lorsque nous parlons de mortalité, nous parlons de nos enfants. Une fois qu'elle est née, la peur ne m'a plus jamais quitté. J'avais peur des piscines, j'avais peur des autoroutes, j'avais peur des avions, j'avais peur des drogues, j'avais peur de tout) ... "There’s a point when you go with what you’ve got. Or you don’t go ..."
