- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Taeko Kôno (1926-2015), "Une voix soudaine" (Fui no Koe, A Sudden Voice, 1969), "Yōjigari" (1961-1966, La Chasse à l'enfant, Toddler-Hunting), "Hone no niku" (La chair des os, Bone Meat, 1971) - .......
Last update: 12/12/2017

Dans les années 1950-1960, période de transformation sociale rapide, marquée par l'occupation américaine, la modernisation et une remise en question des traditions, Taeko Kōno occupe une place unique dans la littérature japonaise : son écriture semble s'être forgée dans la subversion pure ...
Elle appartient à la même vague que
- Kenzaburō Ōe (1935-2023), le Prix Nobel 1994 est un humaniste qui herche à comprendre l’homme dans l’histoire (là où Kōno privilégie ce que la société préfère ignorer),
- Yasutaka Tsutsui (né en 1934), qui utilise la science-fiction pour dénoncer les absurdités du monde moderne (alors que Kōno plonge dans les abîmes de l’inconscient féminin),
- Minako Ōba (1930-2007), dont le séjour en Alaska influença son regard sur le Japon ("Les Années de voyage", 1982) et qui s'attache à la condition féminine à travers des héroïnes intellectuelles et introspectives ("Urashimasō", 1977),
- et Yūko Tsushima (1947-2016), fille d'Osamu Dazai, qui partage avec Kōno la même attirance pour les zones d'ombre de la condition féminine, mais Tsushima le fait en poète tragique tandis que Kōno agit en chirurgienne sans pitié. Tsushima cherche à comprendre, Kōnose contente d'exposer en toute cruauté. Leur héritage commun réside dans leur refus des représentations conventionnelles de la féminité, mais l'une, Tsushima sera reconnue de son vivant, couronnée par des prix littéraires prestigieux, et considérée comme "importante", mais Kōno sera quant à elle jugée "dangereuse" ...

L'influence de l'existentialisme français (Sartre, Beauvoir, Camus) sur la génération d'écrivains japonais des années 1950-1970, dont Taeko Kōno, Kenzaburō Ōe et Yūko Tsushima, fut profonde. Cette influence s'exerça paradoxalement via l'Occupation américaine qui suivi la défaite japonaise.
Les autorités d'Occupation interdirent en effet toute référence au nationalisme japonais ou au marxisme (jugé trop subversif en pleine Guerre froide naissante). Avec le discrédit du militarisme nippon et la marginalisation des communistes, l'existentialisme apparut "naturellement" comme une "troisième voie" intellectuellement valable...
- Entre 1942 et 1945, l'un des efforts de guerre intellectuel que menèrent des universités américaines fut de développer des programmes d'urgence, et les départements de français des universités (Yale, Harvard, Columbia) développent des cours accélérés sur la pensée française contemporaine pour comprendre l'allié français et anticiper la reconstruction culturelle de l'Europe. Sartre devint, malgré lui, un symbole : son double statut de résistant et d'intellectuel en fait une figure idéale pour représenter la "nouvelle France.
- Les officiers américains formés entre 1943-1945 par les Military Government Schools étaient le plus souvent issus des élites universitaires et devinrent les administrateurs du Japon occupé : et alors que Sartre critiquait l'impérialisme américain, l'armée américaine fit traduire en secret dès 1943 "L'Être et le Néant" (version abrégée pour les State Department Briefings)et "Les Mouches" (distribué comme guide sur la résistance morale). C'est que l'existentialisme de Sartre (bien que marxiste) apparaissait comme une alternative "libérale" au déterminisme marxiste et un outil pour combattre l'influence soviétique dans les cercles intellectuels. La théorie sartrienne de la liberté absolue dans l'absurde séduisait des officiers confrontés à la gestion de sociétés détruites et au choc culturel de l'occupation. Le manuel Military Government Handbook for Japan (1945) cite explicitement L'Existentialisme est un humanisme dans ses annexes pédagogiques...
- Au Japon, des revues autorisées, telle que la revue Kindai Bungaku (1946), sous contrôle allié, devient un relais de la pensée existentialiste. Parallèlement, furent lancées des traductions accélérées d'ouvrages sartrien : "Hataraku Mono" (traduction de "La Nausée") paraît dès 1947 grâce aux presses universitaires protégées par le GHQ.
Conséquence totalement imprévue : nombre d'officiers américains au Japon encouragèrent paradoxalement la lecture d'un philosophe marxiste - créant les conditions pour l'émergence d'une avant-garde littéraire japonais existentielle mais profondément anti-américaine (comme Kōno ou Ōe). L'armée avait fourni à ses futurs critiques leurs armes conceptuelles ...
Après le scandale et la marginalisation des année 1960-70, il faudra attendre les années 1980-90 pour que se construise un redécouverte féministe sous l'égide Judith Butler qui cite "Toddler-Hunting" dans "Bodies That Matter" (1993). En 2012-2013, "Toddler-Hunting' sera traduit en 12 langues. Taeko Kōno aura créé une littérature de l'impureté radicale, où le désir se confond avec la violence ...

Taeko Kôno (1926-2015)
Dans une société comme celle du Japon, tout va bien tant que les secrets restent confinés au plus profond de notre intimité. Native d'Ôsaka, d'une famille de commerçants qui sera ruinée par la guerre, Taeko Kôno goûte le côté obsessionnel d'écrivains comme Kyôka Izumi (1873-1939) et surtout de Junichirô Tanizaki (1886-1965), rendu célèbre pour sa nouvelle "Shisei" (The Tattooer, Le Tatouage, 1910), un sommet de la cruauté raffinée, mais aussi pour "Chijin no ai" (Naomi, Un amour insensé, 1924), "In'ei raisan" (Éloge de l'ombre, In Praise of Shadows, 1933), et son chef-d'œuvre, "Sasameyuki" (The Makioka Sisters, Quatre sœurs, 1943).
Dans un contexte de bouleversement social et culturel où se juxtaposaient les traditions occidentales et japonaises, la dynamique de la vie familiale semblait s'enfermer dans l'intimité d'une obsession érotique destructrice. L'identité s'affirmait non pas socialement mais au travers de la sublimation du sexe et de la souffrance. Taeko Kôno gagne Tokyo en 1952 où elle exerce de nombreux petits métiers et parvient enfin en 1960 à pouvoir se consacrer entièrement à la littérature : la revue littéraire Shinchōsha a commencé à publier ses histoires en 1961.
C'est sous couvert de personnages féminins à la limite du pathologique et du sado-masochisme que Taeko Kôno va explorer le quotidien. Les femmes qu'elle dépeint semblent par une soudaine impulsion s'installer dans un désir obsessionnel qui devient progressivement l'incontournable réalité de leur existence, estompant cette autre vie qui fut la leur, forcées de vivre sous des contraintes psychologiques, voire culturelles, qu'elles ne pouvaient supporter : "Yôjigari" (La chasse à l'enfant, Toddler-Hunting, 1962), recueil de nouvelles dont l'une d'entre elles, la plus célèbre, relate en profondeur l'aversion d'une femme pour les enfants, "Kani" (Le Crabe, 1963), "Saigo no toki" (Le dernier moment, 1967) fait le constat dramatiquement désenchanté de la vie de couple, "Fui no koe" (Une voix inattendue, 1969) conte l'histoire d'Ukiko hanté par la mort de son père et qui ne maîtrise ses relations avec autrui qu'en imaginant tuer les êtres qui pourraient contrôler sa vie, dans "Yuki" (Snow, La Neige), le personnage principal risque de sombrer psychologiquement pour devoir assumer l'infidélité de son père et la dramatique folie de sa belle-mère...

"Une voix soudaine" (Fui no Koe, A Sudden Voice, 1969)
"Ukiko a cessé d'aimer son mari, Kiichi qui, le soir, rentre à la maison, ivre mort ou en compagnie de collègues avec lesquels il se saoule devant elle. Hantée par ses angoisses d'enfance et d'adolescence, tourmentée par la mort de son père qu'elle redoutait dans sa jeunesse, elle sombre progressivement dans une sorte de calme folie. Elle reçoit, de façon inopinée mais récurrente, la visite du fantôme de son père, décédé sept ans plus tôt. Avec sérénité, le mort oriente sa vie, en lui donnant une série de conseils meurtriers. Ukiko va accomplir trois crimes rituels, dont seront victimes sa mère, un petit garçon (le fils d'un ancien amant) et un inconnu. Dans un style étonnamment froid et réaliste, qui suit pas à pas une existence apparemment affranchie de tout affect, la grande romancière japonaise décrit minutieusement un univers mental qui a perdu tout repère moral et sentimental. Ça et là, sont donnés des indices de la perte du contrôle de soi, mais le lecteur n'est jamais plongé dans un univers fantastique, en dépit de l'apparition du spectre et de quelques scènes terrifiantes. Rares sont les romans dotés de cette logique implacable et glacée dans l'analyse du mal. Sans avoir recours aux moyens psychologiques habituels, Taeko Kôno nous permet de pénétrer, par un juste dosage des ellipses et des répétitions, dans le chaos intérieur de son héroïne." (Editions du Seuil, traduit du japonais par Ryôji Nakamura et René de Ceccatty)
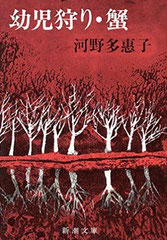
"Yōjigari" (1961-1966, La Chasse à l'enfant, Toddler-Hunting)
Une femme hantée par des fantasmes pédophiles et sadomasochistes : c'est la première œuvre japonaise à explorer ouvertement le fétichisme féminin ...
Deux recueils, "La Chasse à l'enfant" (Editions du Seuil, traduction Cécile Sakai), comporte six nouvelles (La Chasse à l'Enfant, Les Crabes, La Neige, Derrière les murs, Théâtre, Derniers Instants); "Toddler-Hunting and other stories" (New Directions, traduction Lucy North) comporte Snow, Theater, Final Moments, Ants Swarm, Toddler Hunting, Night Journey.
Taeko Kôno a écrit ces nouvelles entre 1961 et 1969, à une époque où Jakuchō Setōchi (1922), avec "Natsu no owari" (The End of Summer, 1963), et Setsuko Tsumura (1928), "Yakoodokei" (Luminous Watch, 1969), contestaient le rapport de soumission de l'épouse japonaise à son mari, a contrario de la femme occidentale totalement ouverte à la socialisation. Les nouvelles de Taeko Kôno montre des femmes aux prises avec leurs nouvelles libertés, mais plus encore aux prises avec la puissance du désir, du pouvoir et du désir, qu'elles vont assumer jusqu'au bout, et toute la force de Taeko Kôno réside justement dans le fait que ses protagonistes s'assument jusqu'au bout, et cela les conduit à assumer une liberté qui se révèle subversive et paraître choquante. Tout le talent de Taeko Kôno réside dans ce dénouement au bout duquel chaque femme, chaque épouse, aura assumé pleinement son identité la plus intime, affronté des vérités dissimulées ou réprimées, au risque de se perdre socialement ou psychologiquement....
"Homme ou femme, jeune ou vieux, aucun être humain ne répugnait autant à Akiko Hayashi qu'une petite fille - surtout entre trois et dix ans. Si, comme les autres, Akiko s'était mariée et avait eu un enfant, il aurait eu à peu près cet âge. Et souvent elle se demandait comment
elle aurait réagi si cela avait été une petite fille. Bien des hommes ont commencé par détester les enfants, avant de fondre plus tard de tendresse devant leur progéniture. Mais Akiko ne parvenait même pas à imaginer comment l'amour maternel, dont elle se sentait de
toute façon plutôt dépourvue, pourrait venir à bout de la répulsion qu'elle éprouvait à l'égard des petites filles. Pourtant elle ne détestait pas les petites Occidentales, fussent-elles de cet âge-là, qu'elle trouvait assez mignonnes, peut-être parce que dans une autre race les
similitudes comme les différences entre hommes et femmes lui semblaient estompées. La seule solution aurait peut-être été d'épouser un étranger, et de donner naissance à une petite fille de sang mêlé, mais elle était persuadée que, dans tous les autres cas de figure, elle serait devenue une mère excessivement indigne. Car la répulsion qu'elle éprouvait était si forte qu`elle aurait eu beau l'extérioriser - par la froideur ou la méchanceté - cela n'y aurait rien changé.
Cela n'avait pas plus à voir avec l'aversion que lui inspiraient par exemple les femmes de sa génération, à la fois belles, heureuses et hautaines, ou les adolescents bouffis d'orgueil, ou bien encore les vieillards égocentriques. Non, c'était plutôt une phobie, comme celle
qu'éprouvent envers les serpents, les chats ou les grenouilles ceux qui les ont en horreur.
Et puis Akiko ne pouvait souffrir l'idée qu'autrefois elle aussi avait été une petite fille.
Pourtant, cela avait été la période la plus heureuse de sa vie ; pas le moindre souvenir pénible pour entacher sa mémoire. Elle avait peut-être reçu plus de bonheur qu'aucun autre enfant dans ce monde et, de fait, elle était une petite fille pleine d'entrain. Toutefois, sous ce ciel d'azur sans l'ombre d'un nuage, tout au fond d'elle-même, une impression étrange et sourde la tenaillait - quelque chose d'haïssable, d'abominable, qui agressait ses sens, comme si elle avait été obligée de marcher indéfiniment le long d'un tunnel profond et interminable, comme si une substance invisible mais visqueuse suintait de tout son corps, comme si, enfin, elle avait été l'objet d'une malédiction.
Un jour, le cours de sciences naturelles avait été consacré aux vers à soie ; le professeur avait alors incisé un cocon avec un scalpel. A l'instant où elle découvrit la chrysalide remuant imperceptiblement, Akiko crut reconnaître dans cette larve obscure et répugnante, entravée par les fils qu'elle avait sécrétés, l'impression même qui ne cessait de la hanter.
En outre, elle était intimement convaincue, et ce sans pouvoir se l'expliquer, que toutes les petites filles de son âge partageaient cette impression étrange et désagréable tapie au fond d'elle, et que, en revanche, les grandes, les adultes et les garçons étaient épargnés.
Le fait est qu'Akiko sentit cette impression refluer dès qu'elle eut atteint ses six ans; elle se trouva, soudain, propulsée dans un univers vaste et rafraîchissant. Et c'est aussi à partir de ce moment que commença à grandir sa répulsion à l'égard des petites filles.
Plus celles-ci étaient marquées par les caractéristiques de leur âge, moins Akiko pouvait les supporter. Leur teint laiteux, leur corps dodu, leur coupe au carré - le creux de la nuque encore bleui par un rasage récent -, leur voix curieusement égale, perçante et humide, jusqu'aux couleurs et aux formes des objets qui leur appartenaient, tout en elles lui semblait provenir de cette obscurité, de cette abjection originelles, et Akiko se sentait incapable de les toucher, voire de les regarder en face. Les choses en étaient restées là depuis lors.
En revanche, Akiko s'était aperçue un jour qu'elle aimait particulièrement les petits garçons de cet âge. Depuis quand en allait-il ainsi? Elle l'ignorait, mais incontestablement ce sentiment se renforçait d'année en année et s'était exacerbé ces derniers temps." (éditions du Seuil, traduction du japonais par Cécile Sakai, 1990)

Dans "Snow" (Yuki, 1962), Hayako assiste à la veillée funèbre de sa mère adoptive et s'interroge sur l'authenticité de sa relation avec elle. Mais cette mort est aussi l'occasion pour Hayako de régler ses comptes avec son passé et de se libérer de ses traumatismes d'enfant : comme sa mère, Hayako souffrait de fortes migraines dès les premières chutes de neige. Son traumatisme a pour origine un acte insensé de sa mère enterrant sa demi-sœur dans la neige jusqu'à ce qu'elle meure de froid. Hayako, née de la maîtresse de son père, a du assumer l'identité de sa sœur pour étouffer le drame. Elle a ainsi l'impression d'avoir vécu comme sa sœur aînée et non en tant qu'elle-même. Elle a ainsi à payer le double prix pour le meurtre de sa mère et l'adultère de son père. Substitut d'une âme morte, elle survit dans un état permanent de désincarnation, un état qui devient plus aigu pendant les tempêtes de neige. Le corps est ainsi vécu comme une entité séparée de l'esprit, abandonné à des désirs inconscients et contradictoires, un corps qu'il faut contrôler pour ne pas sombrer...
Dans "Theater", une femme, Hideko, se sentant négligée par un mari lointain, décide de travailler dans la maison d'un couple étrange rencontré à l'opéra, la femme, Haru, est d'une grande beauté et l'homme, Ken, particulièrement repoussant, la première est soumise, le second dominateur, dans un jeu permanent de rôles auquel Hideko semble vouloir s'abandonner. Les femmes semblent savoir, plus que tout autre, se jouer des règles sans les abandonner complètement.
Dans "Final Moments" (Saigo no toki), une femme, au bord de la mort, réalise que son mariage n'a jamais atteint cette intimité tant espérée et sans nuages avec son époux, et qu'au fond elle ne peut espérer de leur couple qu'une cohabitation de longue haleine entre deux amants délibérément provisoires.

"Ants Swarm" (Ari takaru, 1964),
Une femme stérile développe une obsession pour les insectes et la destruction, une fusion inédite entre naturalisme et psychanalyse ...
La femme narratrice semble toujours à la dérive dans ses relations avec son partenaire. Dans "Ants Swarm" (Ari takaru, 1964), Matsuda et Fumiko semblent parfaitement en accord lorsqu'ils prétendent tous deux ne pas vouloir d'enfants, mais lorsque Fumiko s'aperçoit qu'elle est peut- être enceinte, elle remarque que Matsuda se révèle rapidement plus réceptif à l'égard d'un enfant qu'elle ne le pensait auparavant : le voir tant excité à l'idée d'être père provoque en elle jalousie et sentiment de trahison. L'enfant apparaît ainsi source de transformation profonde voir menaçante, éclairant des zones de l'esprit jusque-là tenues dans l'ombre.
Dans "Toddler Hunting" (Yōji-gari), Akiko est une femme d'un certain âge qui ne peut pas avoir d'enfant. L'essentiel de l'intrigue tient à son étrange attirance pour les petits garçons âgés de trois à dix ans. Elle a ainsi l'habitude est d'acheter des vêtements pour les garçons des autres mères et de les regarder s'habiller et se déshabiller. L'obsession d'Akiko, son désir de jouer intimement avec de jeunes garçons (otoko no ko), se veut retour à l'innocence, purification, libération des obligations de l'âge adulte, au fond libération de ce qu'elle considère comme un fardeau, celui de la maternité et de l'amour maternel.

Dans "Night Journey" (1963, Yoru no Tabi, une soirée entre couples), un couple, Utako et Saeki, traverse la ville pour se rendre chez un autre couple, Fukuko et Murao, ils semblent avoir accepté d'échanger leurs conjoints, mais le temps de l'attente et de l'errance modifie la texture de l'histoire. Utako et Saeki forment un couple marié, apparemment conventionnel dont la relation est marquée par une froideur érotique. Fukuko et Murao sont plus ouvertement libertin. La nouvelle s’ouvre sur Utako et Saeki traversant la ville de nuit, se rendant chez Fukuko et Murao. Le trajet en taxi ou à pied (selon les versions) est décrit avec une tension érotique sourde, Utako observe son mari avec distance, imaginant déjà son corps avec Fukuko, Saeki, lui, semble à la fois excité et anxieux, comme s’il redoutait de perdre le contrôle. Arrivés chez l’autre couple, les règles du jeu restent floues, les dialogues sont polis, presque banals, mais chargés de sous-entendus. Au moment critique, Utako se rétracten réalisant que ce jeu ne comble pas son désir profond, mais révèle plutôt son vide conjugal. Saeki, lui, semble prêt à aller plus loin, créant un déséquilibre entre eux. La nouvelle se termine sans confirmation de l’échange : Kōno laisse planer le doute sur ce qui s’est vraiment passé...
"When the night game ended, her husband reached over to switch off the TV.
The cheering crowds shrank down to a spot on the screen, and vanished.
“Hey, what’s taking them so long?” Murao asked, recrossing his legs and looking up at the clock. They’d told the Saekis to come after dinner, but it was nine-thirty and their guests were now long overdue.
“Well they can’t have forgotten,” Fukuko replied. “But maybe they won’t come now that it’s this late.”
Murao grunted, looking grouchy for a moment, but then his expression changed: “Shall we go barge in on them?” he suggested. “They’re bound to be home.”
“Shall we?” Fukuko didn’t hesitate. “Let’s go for a walk, and just drop by. If they’re out, they’re out.”
It was a Saturday night, so they could stay up as late as they wanted. Murao declared he would go as he was, in his yukata. Fukuko didn’t change out of hers either, and only put on a different sash. Turning her key in the front door, Fukuko paused: “Did I lock the kitchen door?”
Murao walked around, and tugged the glass door.
“It’s locked.”
Fukuko drew the key out, and tucked it under her sash.
The night was unusually clear for the muggy season, moist and cool, and the stars were out. The evening train heading to the city was almost totally deserted. As Fukuko and Murao sat down comfortably on two of the empty seats, a fresh breeze poured in through the open windows — and everything, even the compartment’s milky lights, seemed shiny with a
strange sort of excitement.
Fukuko had had no idea that a summer evening train ride could be such a pleasant experience. They and the Saekis were always visiting — it only took half an hour. The Saeki couple lived four tram stops away from the end of the railway line. But this was the first time she and Murao had set out in the evening just to drop by. The Saekis mostly came to them, since they had a car. They would visit the Saekis on their way back from a trip into the city, or else arranged to meet up at the couple’s apartment at the end of a workday. But sitting there, enjoying that pleasant night train, Fukuko was surprised that they’d never thought to take it before. It was strange, she
realized, considering what good terms they were all on.
Fukuko had known Mrs. Saeki, or Utako, since they’d been little girls.
Their families were neighbors, so once they had become friends, they spent all their time together. Utako was older than Fukuko, but only by two years.
When Fukuko started kindergarten, Utako was already in elementary school. Fukuko’s kindergarten, however, was the same one where Utako had been just before. Fukuko had gone to the same elementary school, too, and though she didn’t try to follow in her friend’s footsteps on purpose, she ended up going to Utako’s secondary school and women’s college as well.
The war was in its final stages by the time Fukuko entered college, and students were being mobilized by class to work in factories, so she hardly ever saw anyone from different grades. When the students did return to college at the end of the war, the seniors were forced to graduate six months early, in September. Utako, however, joined the graduate studies program
and continued to commute to college with Fukuko the following fall.
Fukuko didn’t copy her friend to the point of becoming a research student. She didn’t have any particular ambition, and when she graduated, she took a job as an ordinary clerk in a company. Utako, however, remained in college for years, becoming a research associate, then a lecturer, and now an assistant professor.
As a girl Utako had been an exceptionally good swimmer. She had spent so much time in her secondary school pool that she was never home until after six o’clock, even when she was studying for exams — her scores were outstanding, anyway. Fukuko had been taken aback by Utako’s preparations for the women’s college she herself was planning to enter a couple of years down the line. Utako came from an academic family. Her mother was unremarkable, an ordinary housewife, but her father was a university physics professor, and her two older sisters also studied science, and later became doctors of physics and medicine. Fukuko had assumed Utako would at least try to get into a prestigious teacher-training college or medical school. Utako, however, said she would be “bored to death” in those places..."
« Lorsque le match de nuit se termina, son mari se pencha pour éteindre la télévision.
Les acclamations de la foule se réduisirent à un point sur l’écran, puis disparurent.
— Hé, qu’est-ce qui leur prend tant de temps ? demanda Murao en croisant et décroisant les jambes avant de lever les yeux vers l’horloge. Ils avaient dit aux Saeki de venir après le dîner, mais il était déjà 21 h 30 et leurs invités avaient beaucoup de retard.
— Ils ne peuvent pas avoir oublié, répondit Fukuko. Mais peut-être qu’ils ne viendront plus, maintenant qu’il est si tard.
Murao grogna, l’air maussade un instant, puis son expression changea :
— Si on allait leur tomber dessus ? proposa-t-il. Ils sont forcément chez eux.
— Pourquoi pas ? Fukuko n’hésita pas. Allons faire une promenade et passons leur dire bonjour. S’ils ne sont pas là, tant pis.
C’était un samedi soir, ils pouvaient veiller aussi tard qu’ils le voulaient. Murao déclara qu’il partirait comme il était, en yukata. Fukuko ne changea pas non plus le sien, se contentant de nouer une ceinture différente. En tournant la clé dans la porte d’entrée, elle s’arrêta soudain :
— J’ai bien verrouillé la porte de la cuisine ?
Murao fit le tour et tira la porte vitrée.
— Elle est fermée.
Fukuko retira la clé et la glissa sous sa ceinture.
La nuit était exceptionnellement claire pour cette saison humide, douce et fraîche, avec des étoiles qui scintillaient. Le train du soir en direction de la ville était presque vide. Lorsque Fukuko et Murao s’installèrent confortablement sur deux sièges inoccupés, une brise légère s’engouffra par les fenêtres ouvertes — et tout, même la lumière laiteuse des lampes du compartiment, semblait briller d’une étrange excitation.
Fukuko n’avait jamais imaginé qu’un trajet en train, un soir d’été, puisse être si agréable. Eux et les Saeki se rendaient toujours visite — cela ne prenait qu’une demi-heure. Le couple Saeki vivait à quatre arrêts de tramway après la dernière gare. Mais c’était la première fois qu’elle et Murao partaient le soir simplement pour « passer dire bonjour ». Les Saeki venaient surtout chez eux, puisqu’ils avaient une voiture. Ils leur rendaient visite au retour d’une excursion en ville, ou bien convenaient de se retrouver à leur appartement après le travail. Mais assise là, profitant de ce trajet nocturne si plaisant, Fukuko fut surprise qu’ils n’y aient jamais pensé avant. C’était étrange, réalisa-t-elle, vu l’excellente entente qui régnait entre eux.
Fukuko connaissait Mme Saeki, ou Utako, depuis leur plus tendre enfance. Leurs familles étaient voisines, et une fois devenues amies, elles passaient tout leur temps ensemble. Utako était plus âgée que Fukuko, mais seulement de deux ans. Quand Fukuko entra à la maternelle, Utako était déjà à l’école primaire. Cependant, la maternelle de Fukuko était la même que celle qu’Utako avait fréquentée juste avant. Fukuko alla aussi à la même école primaire, et bien qu’elle n’ait pas cherché à suivre les traces de son amie intentionnellement, elle finit par intégrer le même collège, lycée, puis établissement supérieur pour jeunes filles.
La guerre entrait dans sa phase finale lorsque Fukuko commença ses études supérieures, et les étudiants étaient mobilisés par classe pour travailler dans les usines, si bien qu’elle ne croisait presque jamais ceux des autres niveaux. Lorsque les étudiants purent enfin retourner à l’université à la fin de la guerre, les seniors durent obtenir leur diplôme six mois plus tôt, en septembre. Utako, cependant, s’inscrivit en troisième cycle et continua à se rendre à l’université avec Fukuko l’automne suivant.
Fukuko n’imita pas son amie au point de devenir chercheuse. Elle n’avait aucune ambition particulière et, à sa sortie, devint simple employée dans une entreprise. Utako, en revanche, resta à l’université pendant des années, devenant assistante de recherche, puis chargée de cours, et désormais maître de conférences.
Jeune fille, Utako avait été une nageuse exceptionnelle. Elle passait tant de temps dans la piscine de son lycée qu’elle ne rentrait jamais avant six heures, même pendant les révisions — ses résultats étaient excellents, de toute façon. Fukuko avait été surprise par les préparatifs d’Utako pour l’école supérieure qu’elle-même envisageait d’intégrer quelques années plus tard. Utako venait d’une famille d’universitaires. Sa mère était sans particularité, une simple femme au foyer, mais son père était professeur de physique à l’université, et ses deux sœurs aînées avaient également étudié les sciences, devenant par la suite docteures en physique et en médecine. Fukuko avait supposé qu’Utako tenterait au moins d’entrer dans une grande école normale ou une faculté de médecine. Utako, cependant, déclara qu’elle s’y « ennuierait à mourir »... »

Dans "Crabs" (Kani, 1963), Yuko qui est atteinte de tuberculose, supplie son mari de la laisser partir pour une cure de repos. Si la première partie de sa cure s'est bien déroulée, la fin de la deuxième année la voit agitée, fatiguée, et lorsque le frère de son mari, sa femme et son fils viennent lui rendre visite, Yuko se lance pour son neveu à la recherche d'une espèce particulière de crabe, dérive de ses désirs sadomasochistes...

Dans "Sang et Coquillage" (Blood and Shell), Akiko, une femme trentenaire en apparence conventionnelle mais traversée par de sombres pulsions : elle est obsédée par l'image d’un coquillage rempli de sang, qu’elle associe à un désir inavouable, voir un jeune garçon (qu’elle connaît) blessé. Akiko rejette les rôles traditionnels de la femme japonaise (épouse/mère) et s’invente des scénarios où l’enfant se coupe avec un coquillage tranchant, le coquillage évoque la féminité, mais aussi une arme potentielle, le sang représente à la fois la vie (maternité) et la destruction (pulsion thanatique). La nouvelle culmine dans une scène où Akiko manipule le coquillage près de l’enfant, frôlant l’irréparable. Contrairement à d’autres œuvres de Kōno (comme "Chasse à l’enfant"), il n’y a pas d’acte explicite, mais une tension érotique sublimée dans la violence. (traduction éditions du Seuil)

"Saigo no toki" (1966), "Final Moments", dans Toddler-Hunting and Other Stories, New Directions (trad. Lucy North) et "Final Hours", dans Snow Woman, Pushkin Press (2023, trad. Lucy Lower) ..
Elle savait qu'il ne mourrait pas ce soir. Pas encore. Le jeu exigeait qu'elle fasse semblant d'y croire, alors elle serra les poings comme une jeune épouse effrayée, tout en comptant les taches brunes sur son dos nu .. - Un couple vieillissant rejoue des scènes de domination : la vieillesse comme espace de transgression. Une influence notable sur Mishima (thématique de la décrépitude érotique).
Le rituel du "dernier fois" : chaque semaine, le mari annonce à sa femme que ce sera "la dernière fois" qu'ils ont des rapports sexuels, jouant avec l'idée de la fin imminente (mort, impuissance). La femme participe à ce jeu, simulant la résistance tout en anticipant secrètement ces moments.
L'homme exige des actes humiliants (ex : lui laver les pieds), évoquant une inversion des rôles conjugaux traditionnels japonais. La femme feint la soumission, mais révèle intérieurement un plaisir trouble à contrôler l'angoisse de son mari.
Lors d'une scène, le mari s'effondre, victime d'un malaise. La femme, au lieu d'appeler à l'aide, observe son corps vieillissant avec une fascination clinique. Et le récit se clôt sur l'ambiguïté : s'agit-il vraiment de leur "dernière fois", ou le jeu continuera-t-il jusqu'à la mort ?
"She had to die at some point, she could accept that; and to die in that particular way might even be her fate. But so suddenly, so quickly - Noriko couldn’t begin to face the possibility.
“Give me a few days,” she begged.
“You mean you want time to get used to the idea,” a voice said.
“Who can ‘get used’ to dying?” she retorted. “I’m not an old lady - I’m not terminally ill: I’m middle-aged. I’m healthy — and nothing is wrong with my mind, as far as I know. And anyway, there’s not a drop of samurai blood in my veins: I know I won’t want to let go of life — I’ll be
exceptionally unwilling — unless you manage to kill me on your very first try.”
“I thought you said you believed in spirits.”
“I do. But that doesn’t mean I’m happy to die!”
“Well, that’s better than not believing at all.”
“I don’t know if I agree with you. Spirits and ghosts are probably powerless creatures, you know. I know they’re supposed to be able to influence humans — to be able to read their minds, and so on. But they don’t have physical power over people, or objects; I don’t think they can even see them. And what happens when from the other side they try to reach people whose minds are insensitive, and who don’t react? Or who are too sensitive, so they overreact? I’m sure lines get crossed all the time: it must be easy for a ghost to get frustrated and lose interest. Besides, after a while, seeing into people’s minds must get quite boring and annoying. And aren’t ghosts supposed to be bundles of irritation and resentment? No, I dread dying all the more when I think of such an eternally painful existence. If anything, I envy people who can believe in nothingness after death.”
Then she cried out: “Oh, I wish that my spirit could stay with my body forever! Or at least that when I die, my spirit would go too!” She so fiercely wanted this that for a moment she forgot about the reprieve.
“Anyway, the point is,” she resumed, “I don’t want to die. I have to, I know, but you could at least give me some extra time.”
“You can’t get out of it, you know.”
"Elle devait mourir un jour, elle pouvait l'accepter ; et mourir de cette manière particulière était peut-être même son destin. Mais si soudainement, si rapidement - Noriko ne pouvait même pas commencer à envisager cette possibilité.
« Accorde-moi quelques jours », supplia-t-elle.
« Tu veux dire que tu veux du temps pour t'habituer à l'idée », dit une voix.
« Qui peut "s'habituer" à la mort ? » rétorqua-t-elle. « Je ne suis pas une vieille femme - je ne suis pas en phase terminale : je suis d'âge mûr. Je suis en bonne santé — et rien ne cloche dans mon esprit, autant que je sache. Et de toute façon, il n'y a pas une goutte de sang de samouraï dans mes veines : je sais que je ne voudrai pas lâcher la vie — je serai exceptionnellement réticente — à moins que tu ne parviennes à me tuer du premier coup. »
« Je croyais que tu avais dit que tu croyais aux esprits. »
« C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je suis heureuse de mourir ! »
« Eh bien, c'est déjà mieux que de ne pas y croire du tout. »
« Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. Les esprits et les fantômes sont probablement des créatures impuissantes, tu sais. Je sais qu'ils sont censés pouvoir influencer les humains — pouvoir lire dans leurs pensées, et ainsi de suite. Mais ils n'ont aucun pouvoir physique sur les gens ou les objets ; je ne pense même pas qu'ils puissent les voir. Et que se passe-t-il lorsque, depuis l'au-delà, ils essaient d'atteindre des gens dont l'esprit est insensible et qui ne réagissent pas ? Ou qui sont trop sensibles, alors ils surréagissent ? Je suis sûre qu'il y a des interférences tout le temps : ça doit être facile pour un fantôme de se frustrer et de perdre tout intérêt. D'ailleurs, après un certain temps, voir dans les pensées des gens doit devenir assez ennuyeux et agaçant. Et les fantômes ne sont-ils pas censés être des boules d'irritation et de ressentiment ? Non, je redoute encore plus la mort quand je pense à une existence éternellement douloureuse. Si quoi que ce soit, j'envie les gens qui peuvent croire au néant après la mort. »
Puis elle s'écria : « Oh, si seulement mon esprit pouvait rester avec mon corps pour toujours ! Ou au moins que, quand je mourrai, mon esprit disparaisse aussi ! » Elle le souhaitait si ardemment qu'elle en oublia un instant son sursis.
« Quoi qu'il en soit, le fait est, » reprit-elle, « que je ne veux pas mourir. Je le dois, je le sais, mais tu pourrais au moins m'accorder un peu plus de temps. »
« Tu ne peux pas y échapper, tu le sais. »
"“I know. That’s exactly why I’m asking. I only need two or three days. . . .”
“Out of the question.”
“But it’s not as though I was born in a matter of seconds. How can I just suddenly die? There are so many things I have to take care of before I . . .”
“Such as?”
“Look at me,” she said, holding the edges of her kimono sleeves as she spread her arms out. “You can’t expect me to die like this. I was on my way to a friend’s funeral. I wouldn’t have dressed like this if I’d known.”
“That’s good enough — better than house slippers and an apron.”
“But this is black — the color of the dead!”
“The color of the dead is white. Oh, you’re right, so is black. But so much the better — think how impressed everybody’ll be by your wearing black: they’ll think you died very tastefully, in a mood of calmness and acceptance.”
“But that’s the last thing I want! I don’t want to give the impression I went calmly and peacefully!”
“Well, what would you wear to show them you held out to your very last breath?”
“I don’t know! I need time. Time to think about it, time to change.”
“All right. You have a day to get ready.”
“Can’t you make it two?”
“What difference will that make? One day, and no more.”
Noriko looked at her wristwatch — 1:17. The ticking seconds were suddenly very loud to her ears.
“I expect you here in exactly twenty-four hours,” the voice said.
The ticking grew even louder. At 1:17 tomorrow, Noriko thought, trembling, she would probably still be alive — but by 1:30 or 1:40, she’d be dead. The fatal time was getting closer by the minute, and once it came, she would never experience that time, or any time of day, ever again.
“Can’t you make it twenty-six hours?” she pleaded.
The tiny hand continued on its way round the watch dial. Seconds were passing; already it was 1:19.
“All right — 3:19 tomorrow!”
Noriko bowed, and began hurrying away.
“So you’re not going to the funeral, after all?” the voice said, behind her. “Your friend’s ghost will be sad — don’t you care?”
Noriko didn’t pause to look back, but walked even more quickly toward home.
« Je sais. C’est précisément pour ça que je demande. J’ai besoin de deux ou trois jours seulement...
— Hors de question.
— Mais je ne suis pas née en quelques secondes, moi ! Comment pourrais-je mourir d’un coup ? Il y a tant de choses à régler avant que je...
— Comme quoi ?
— Regardez-moi », dit-elle en écartant les bras, les bords des manches de son kimono entre les doigts. « Vous ne pouvez pas me laisser mourir ainsi. J’allais à un enterrement. Je ne me serais pas habillée comme ça si j’avais su.
— C’est très bien — mieux que des pantoufles et un tablier.
— Mais c’est noir — la couleur des morts !
— La couleur des morts, c’est le blanc. Ah oui, vous avez raison, le noir aussi. Mais tant mieux : imaginez l’effet élégant de votre tenue noire. On pensera que vous êtes morte avec goût, dans le calme et la résignation.
— C’est tout le contraire que je veux ! Je ne veux pas qu’on croie que je suis partie calmement, en paix !
— Alors, quelle tenue montrerait que vous avez résisté jusqu’à votre dernier souffle ?
— Je ne sais pas ! Il me faut du temps. Du temps pour réfléchir, pour me changer.
— Soit. Vous avez un jour pour vous préparer.
— Deux, ce n’est pas possible ?
— Quelle différence ? Un jour, pas un de plus. »
Noriko consulta sa montre — 13h17. Le tic-tac des secondes lui parut soudain assourdissant.
« Je vous attends dans exactement vingt-quatre heures », dit la voix.
Les battements semblaient encore plus forts. À 13h17 demain, pensa Noriko en tremblant, elle serait probablement encore en vie — mais à 13h30 ou 13h40, elle serait morte. L’heure fatidique approchait minute après minute, et une fois venue, elle ne connaîtrait plus jamais ce moment, ni aucun autre.
« Vingt-six heures, ce n’est pas possible ? » supplia-t-elle.
L’aiguille continua sa course autour du cadran. Déjà 13h19.
« Soit — 15h19 demain ! »
Noriko s’inclina et se dépêcha de partir.
« Finalement, vous n’irez pas à l’enterrement ? » lança la voix derrière elle. « L’esprit de votre ami sera triste — ça ne vous touche pas ? »
Sans même se retourner, Noriko pressa encore le pas vers chez elle.
"As Noriko turned off the street for the road to her house, the red public telephone in front of the corner bakery caught her eye. She went over, dialed the number of her husband Asari’s office and, staring blankly at the broken cradle for the receiver, listened to the urgent ringing. It would seem odd, she reflected, if she asked straight out when he was coming home.
First she’d pretend to consult him about how much money to take to the funeral as a condolence gift.
The switchboard operator came on the line.
“Mr. Asari in sales, please,” Noriko said.
“Who shall I say is calling?”
Noriko was silent.
“Who is calling, please!” the operator repeated, her voice rising. Noriko cut the connection, and replaced the receiver.
Arriving home, she unlocked the front door and turning the knob to go in, her eyes fell on the yellow milk-bottle box by the step’s wooden wainscoting. Its lid was half-up, propped on the two empties from breakfast. After tomorrow, she reflected, one bottle would be enough. Her
habit was to attach her order for the milkman to an empty bottle with a rubber band whenever Asari went away on business, or the two of them took a trip. “Please leave one bottle till such and such a date,” she would write; or “Please cease deliveries until further notice.”
It occurred to her as she went inside and slipped off her sandals that she should write a note before she forgot, telling the milkman, “Starting the day after tomorrow, please leave one bottle only.” Taking a ballpoint pen from the letter rack, she sat down at the dinner table and searched in her bag for the condolence envelope. She found an unmarked part of the envelope and, after taking out the money, tore off a rectangular strip.
“Dear Milkman,” she wrote. “Thank you for delivering the milk every day. From the day after tomorrow . . .” But here she paused. She intended to take proper leave of her husband, but discreetly, without his actually being aware of it. If she put this note on the bottle now, and Asari saw it, she’d destroy her whole plan. No, it would have to wait till tomorrow morning, after her husband had left the house...."
Alors que Noriko quittait la rue pour prendre le chemin de sa maison, le téléphone public rouge devant la boulangerie du coin attira son regard. Elle s'approcha, composa le numéro du bureau de son mari Asari et, fixant d'un air vide le support cassé du combiné, écouta la sonnerie pressante. Cela semblerait bizarre, songea-t-elle, si elle demandait directement quand il rentrerait.
D'abord, elle feindrait de le consulter sur le montant d'argent à apporter pour le cadeau de condoléances aux funérailles.
L'opératrice prit la ligne.
« M. Asari du service des ventes, je vous prie », dit Noriko.
« De la part de qui ? »
Noriko resta silencieuse.
« Qui appelle, s'il vous plaît ? » répéta l'opératrice, la voix montant. Noriko coupa la communication et raccrocha.
En arrivant chez elle, elle déverrouilla la porte d'entrée et, tout en tournant la poignée pour entrer, son regard tomba sur la boîte à bouteilles de lait jaune près des lambris en bois de la marche. Son couvercle était entrouvert, calé sur les deux bouteilles vides du petit-déjeuner. Après demain, réfléchit-elle, une seule bouteille suffirait. Elle avait pour habitude d'attacher sa commande pour le laitier à une bouteille vide avec un élastique chaque fois qu'Asari partait en voyage d'affaires ou qu'ils partaient tous les deux. « Veuillez ne laisser qu'une bouteille jusqu'à telle date », écrivait-elle ; ou « Veuillez arrêter les livraisons jusqu'à nouvel ordre ».
Alors qu'elle entrait et retirait ses sandales, l'idée lui vint qu'elle devait écrire un mot avant d'oublier, disant au laitier : « À partir d'après-demain, veuillez ne laisser qu'une bouteille. » Prenant un stylo à bille dans le range-lettres, elle s'assit à la table de la salle à manger et fouilla dans son sac à la recherche de l'enveloppe de condoléances. Elle trouva une partie vierge de l'enveloppe et, après avoir sorti l'argent, en déchira une bande rectangulaire.
« Cher Laitier, écrivit-elle. Merci de livrer le lait chaque jour. À partir d'après-demain... » Mais ici, elle s'interrompit. Elle comptait prendre congé de son mari correctement, mais discrètement, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Si elle mettait ce mot sur la bouteille maintenant et qu'Asari le voyait, elle ruinerait tout son plan. Non, il faudrait attendre demain matin, après le départ de son mari...
Kōno montre que le désir ne s'éteint pas avec l'âge, mais se déforme en pulsions paradoxales et que la femme domine en feignant d'obéir. Perçu comme scandaleux pour sa représentation de la sexualité sénile, la relecture contemporaine voit cette nouvelle comme une anticipation des études sur le "queer aging" que théorisa Kathryn Bond Stockton (2012-2015).
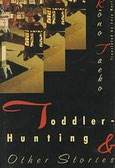
"Hone no niku" (La chair des os, Bone Meat, 1971)
Une nouvelle publiée en 1977 dans "the anthology Contemporary Japanese Literature" (ed. Howard Hibbett) qui rendit Taeko Kôno accessible aux lecteurs de langue anglaise. C'est l'une des œuvres les plus troublantes et violentes de l'auteur.
La famille Takeuchi compte le père (un Homme autoritaire et sadique, obsédé par la pureté et la corruption), la mère (soumise, complice silencieuse de la violence domestique), leur fils (adolescent, victime et bourreau, tiraillé entre haine et désir envers sa sœur), et la jeune fille (jeune adulte et narratrice, cible des sévices familiaux, mais aussi objet d'un désir malsain).
Le père impose des règles alimentaires grotesques : la famille ne doit manger que de la viande crue, découpée directement sur l’os (hone no niku), symbolisant une violence primitive. Il interdit toute nourriture "impure" (cuite, transformée), comme une parodie de pureté shintoïste. et oblige sa fille à manger devant lui, observant ses réactions avec excitation. De même, il lui interdit de se laver, fétichisant sa saleté comme marque de possession (un corps-territoire à conquérir). Parallèlement, le frère développe une attraction-répulsion pour sa sœur, oscillant entre protection et cruauté : une scène clé, lorsqu'il lui lèche les bras pour "nettoyer" une blessure, mimant un acte cannibale. Révolte ou la soumission ? La jeune fille tente de résister, en secret, vomit la viande crue ou cache des aliments "interdits". Mais son corps finit par s’adapter, reflétant une internalisation de l’horreur. Le père va mourir (accident ? meurtre ?), mais la famille perpétuera ses rituels, suggérant que la violence est désormais en eux. Une fin qui suggère que la victime devient bourreau : la mère prend la relève ...

Dans "Une chambre à soi" (Dokuji no heya), une femme, abandonnée par son amant, se retrouve submergée par les détails du quotidien et les objets qui lui rappellent leur relation passée. L'atmosphère étouffante et l'obsession pour les traces matérielles de l'amour perdu sont caractéristiques du style de Kōno, qui explore souvent les thèmes de la solitude, du désir et de la décomposition des relations...
"Même après le commencement de la nouvelle année, la femme n'arrivait pas à se mettre dans l'idée de disposer des affaires que l'homme avait abandonnées en même temps qu'elle. L'automne dernier, il avait plu la veille ou l'avant-veille du jour où il était parti. Elle s'était aperçue, quatre ou cinq jours plus tard, que son propre parapluie et celui de l'homme étaient restés par terre contre la balustrade de la fenêtre. Comme elle ne gardait aucun souvenir d'avoir posé là ces deux parapluies, c'était peut-être lui qui l'avait fait. À moins que, dans le désarroi où l'avait plongée ce départ, elle n'eût oublié un des gestes qu'elle avait fait. Les ouvrant, elle vit que les deux parapluies avaient complètement séché, tout mal pliés qu'ils étaient. Elle remit chacun d'eux bien en ordre, ajustant soigneusement ses plis, et enroula l'attache tout autour avant d'accrocher l'anneau de métal au bouton. Mais, quand elle eut dressé son propre parapluie dans le porte-parapluies logé parmi les étagères à chaussures, elle enveloppa dans un papier, qu'elle ficela, celui de l'homme, avec un autre parapluie qu'elle y découvrit et lui appartenant aussi, et rangea le tout dans le placard.
N'est-ce pas aussi vers ce temps-là qu'elle jeta la brosse à dents de l'homme? Au moment où, un matin, elle allait se saisir de sa brosse à dents personnelle, ses yeux s'arrêtèrent sur l'autre, qui se trouvait à proximité. Au bout du manche transparent bleu pâle, les poils durement maltraités s'écartaient de tous côtés. Une fois, l'homme avait acheté, pour eux deux, un assortiment de six brosses à dents en réclame. Elle se souvenait d'en avoir acheté, elle aussi, à deux ou trois reprises. Elle ne savait pas si celle qu'il avait laissée faisait partie ou non des six que lui avait achetées. Mais, lorsqu'elle la tint dans sa main, l'achat qu'il avait fait lui revint en mémoire et, trouvant dans le très mauvais état des poils une bonne raison d'admettre que l'objet n'était qu'à jeter, elle le fit disparaître dans la corbeille à papiers, avec, par la même occasion, trois ou quatre lames de rasoir usagées. Elle retira la lame engagée dans le rasoir et sur laquelle avait durci un reste de savon mêlé de poils de barbe, et elle la jeta aussi. Quant au rasoir, voyant qu'il restait encore quelques lames neuves dans la petite boîte, elle l'enveloppa avec celle-ci dans la serviette maintenant sèche de l'homme et le rangea dans le tiroir aux sous-vêtements masculins. Ce tiroir occupait le haut de son armoire à elle. A l'intérieur de la penderie aussi, les affaires de l'homme avaient été autrefois suspendues à côté des siennes, mais, en partant, il les avait rapidement rassemblées pour les emporter. Elle s'était simplement aperçue par la suite qu'il restait une ceinture en lézard gris qu°il n'utilisait plus ; la couleur en avait fané, prenant par endroits une teinte chârain clair; elle la rangea dans le même tiroir. Elle aurait dû y mettre d'autres objets appartenant à l'homme. Il devait rester deux ou trois chemises à la blanchisserie; elle s'était dit qu'elle irait les chercher et les rangerait dans ce tiroir, mais elle ne l'avait pas encore fait. Il était improbable qu'il fût allé lui-même les chercher, mais... Elle permuta les quatre boîtes à vêtements de l'homme, qui paraissaient inégalement pleines et se trouvaient sur le dessus de l'armoire, avec les siennes dans le placard.
L'oreiller de l'homme était resté tel quel assez longtemps. Pendant plusieurs semaines elle avait continué à jeter d'abord par terre, chaque soir, lorsqu'elle installait sa literie, l'oreiller en question qu'elle saisissait par l'ouverture de la taie - une taie bien trop grande puisqu'elle était conçue pour deux personnes; puis elle le relançait dans le placard, une fois la literie dehors, quitte à le ressortir le matin; c'est en remettant celle-ci dans le placard que l'idée de ranger aussi ledit oreiller lui était venue. Elle avait lavé la taie et, profitant d'un jour où les rayons faiblissants du soleil étaient un peu plus forts, elle avait exposé l'oreiller au soleil, puis l'avait replacé dans sa taie, enveloppé dans un sac de nylon et rangé dans le placard sur les boîtes contenant les vêtements de l'homme.
Elle savait parfaitement qu'il ne reviendrait jamais. Bien des fois, il avait adopté vis-à-vis d'elle une attitude qui l'avait malgré elle amenée à lui dire ce qu'au fond elle ne pensait pas vraiment : "Je n'ai plus besoin de toi." Un autre jour, comme elle n'avait pu s'empêcher de lui répéter cela, il avait dit : "C'est bien ce qu'il me semble." Là-dessus il était parti sans plus de façons. Le regret qu'elle avait conçu était cuisant. Elle regrettait amèrement d'avoir pris l'habitude de se laisser aller à dire ce qui ne correspondait pas au fond de sa pensée, et d'avoir, en répétant ces mots ce jour-là, permis à l'homme d'en tirer immédiatement avantage. Mais, ce qui avivait encore ses regrets, c'était que son attitude à lui, au cours des derniers temps, et la promptitude avec laquelle il avait saisi l'occasion qui se présentait, ne lui donnaient même pas le droit d'en avoir. Cette douleur-là lui avait enlevé la force de lui courir après. Elle n'avait même plus envie de lui demander de venir chercher ses affaires, car elle était sûre de la réponse : "Fais-en ce que tu voudras." En fait, il ne tenait probablement pas aux choses qu'il avait laissées chez elle. A mesure que leur liaison s'était affermie et que ses séjours avaient commencé à se prolonger, il lui avait bien fallu apporter peu à peu ses effets personnels. Mais, même une fois installé pratiquement chez elle, il ne s'était jamais défait, au-dehors, de la chambre où devaient encore se trouver son armoire, son bureau, quelques boîtes à vêtements, son équipement de ski et sa literie. Il avait remporté les vêtements dont il avait besoin dans l'immédiat - ceux qui se trouvaient dans son armoire à elle; d'ailleurs, il semblait bien qu'il eût commencé à obtenir de l'avancement et n'avait, sans aucun doute, pas le moindre regret pour lesvieux vêtements qu'il avait laissés chez elle.
Mais elle, ne savait vraiment pas comment en disposer. Une fois qu'elle eut rangé les choses qui traînaient, elle fut absolument incapable de trouver un moyen de se défaire de tous ces laissés-pour-compte. Il lui déplaisait de s'entendre dire, si elle le contactait pour qu'il vienne les chercher, quelque chose comme : « Jette-les ! ››, ou bien : "elles sont encore là? Eh bien! envoie-les-moi, veux-tu?" Mais, ce qu'elle trouvait désagréable avant tout, c'était de devoir prendre contact avec lui, même par l'intermédiaire de quelqu'un.
Pourtant, il lui répugnait de disposer à sa guise d'affaires appartenant à autrui et qui pouvaient encore parfaitement servir, en les faisant emporter par le chiffonnier ou en les jetant. Elle ne pouvait pas non plus donner ces objets que l'homme avait abandonnés en même temps qu'elle. Elle regrettait de ne pas lui avoir fait emporter toutes ses affaires lorsqu'il était parti. Elle le regrettait de toute son âme. Il avait, par son comportement, révélé qu'il songeait à une vie sans elle, avant même d'avoir commencé à obtenir de l'avancement.
Maintenant qu'il l'avait quittée, il devait être plein d'entrain, en public comme en privé, et son aspect vestimentaire devait avoir totalement changé. Elle éprouvaít comme une espèce de sympathie pitoyable pour les vieilles affaires dont il n'avait aucun souci, tout en se sentant méprisée par ces choses au sort desquelles elle compatissait bien qu'elle en fût désormais indigne. C'est pourquoi ces effets dont elle ne trouvait pas le moyen de se défaire lui étaient encore plus insupportables. Elle avait souvent songé à rassembler les sous-vêtements masculins qui encombraient le tiroir du haut de son armoire et les lainages mêlés aux siens qui se trouvaient dans la caisse en bas du placard; mais, à cette seule pensée, elle ressentait ime immense lassitude, comme si elle allait avoir un accès de fièvre. Il y aurait peut-être en fruste assez de place pour les sous-vêtements et les lainages dans la valise de l'homme posée sur la caisse à thé, et, dans la partie supérieure du placard, dans les quatre boîtes à vêtements qu'elle avait mises à la place des siennes sur sa propre valise; mais il aurait fallu pour cela y aller voir et les ouvrir. N'auraít-elle pas pu mettre non plus des choses dans le sac tyrolien de l'homme et dans son sac de toile, qu'on apercevait sur l'étagère, car ils ne semblaient pas pleins ? Mais elle n'avait pas le courage d'ouvrir quoi que ce soit. Elle avait sans cesse l'impression que tout œ que l'homme avait laissé pesait sur elle.
Lorsqu'elle y songeait, elle ne pouvait s'empêcher d'envier le sentiment de délivrance avec lequel il l'avait quittée sur les seuls mots : "C'est bien ce qu'il me semble." Il lui apparaissait que la meilleure façon de disposer de ces affaires qui la plongeaient dans la perplexité, c'était de les abandonner telles quelles, avec les siennes, et d'aller s'installer ailleurs. Mais l'argent nécessaire pour déménager et se rééquiper entièrement lui manquait. Elle s'était prise de dégoût pour ses propres affaires dont elle voulait se séparer sans pouvoir le faire, et même pour ce logement.
Il ne lui restait plus qu'à espérer que des circonstances se présentent, où le manque d'argent ne constituerait plus un obstacle. Elle se disait qu'elle aimerait bien voir tout brûler, les affaires de l'homme, les siennes et cet endroit même, et que, si elle brûlait elle aussi, ce n'en serait que mieux. Toutefois elle ne faisait que l'espérer sans rien tenter. C'était étrange de la part d'une femme parvenue au point de penser qu'elle pouvait bien brûler elle aussi; mais il y avait à cela une explication : dans son enfance, un incendie avait éclaté dans le voisinage, en pleine nuit, et sans cesse lui revenait à l'esprit l'image du vieillard chez qui le feu s'était déclaré, emmené de force au milieu de la foule, pieds nus sur l'asphalte de la rue où ruisselait l'eau utilisée pour éteindre l'incendie, le dos couvert d'un habit en coton matelassé dont il avait simplement passé les manches par-dessus son vêtement de nuit en flanelle. Elle s'était mise à prendre encore plus de précautions qu'avant contre l'incendie. Si, maintenant, elle provoquait un incendie par imprudence, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir l°impression qu'on croirait à un incendie criminel. Surtout quand elle sortait, il lui fallait à tout prix vérifier deux ou trois fois les sources d'incendie éventuelles, et cela à plus forte raison si elle était pressée. Ce jour-là, une fois qu'elle eut fermé la porte à clé et se fut éloignée de deux ou trois pas, elle fut soudain saisie d'inquiétude. Elle rouvrit la porte, rentra à l'intérieur et promena ses regards sur toutes les prises de gaz et d'électricité. Elle porta le cendrier, dans lequel elle avait déjà versé de l'eau, sous le robinet de la cuisine, et rajouta de l'eau jusqu'à ce qu'y surnagent les mégots. Rassurée, elle ressortit, mais sa main s'arrêta de nouveau au moment où elle allait mettre la clé dans son sac. lnvinciblement revint s'imposer à elle l'impression qu'elle venait d'avoir. Quand elle avait pris le cendrier dans sa main, il lui avait semblé se souvenir avoir fumé le paquet et demi de cigarettes que l'homme avait laissé en partant..." (traduction de Christine Kodama, Gallimard)

"The Craving" (dans le recueil Toddler-Hunting & Other Stories, Shishū Hanzai)
Un médecin de 38 ans, Masataka Otaka, épouse une jeune fille de 19 ans, Sachiko, une jeune fille fragile et soumise qu’il va initier à des pratiques sexuelles particulières afin de réaliser avec la complicité de celle-ci son rêve le plus secret : être tué des mains de la femme qu’il aime. Taeko Kôno a choisi de situer son récit en pleine Seconde Guerre mondiale : le couple, qui se marie quelques mois avant Pearl Harbor, vit sa dernière nuit peu de temps après la chute du mur de Berlin. Ainsi l’amplification des attaques aériennes qui mène peu à peu le Japon vers la défaite a pour fonction d’exacerber la progression insidieuse des héros vers la mort. Dans un passage hallucinatoire, Masataka imagine Sachiko le poignardant avec une aiguille à broder, La nouvelle se termine sans confirmer si ce meurtre s'est produit ...

"The Doctor's Wife" (Isha no tsuma, 1966), un roman (et non pas une nouvelle) dans lequel une femme mariée à un médecin entretient une relation sadomasochiste avec un autre homme : le désir, la domination et la transgression ...
Toutes les histoires de la collection Chasse aux tout-petits ont été publiées au Japon dans les années 1960. Cette décennie de l'histoire japonaise est célèbre pour la croissance phénoménale de l'économie japonaise, une histoire à succès qui a attiré l'attention internationale sur la famille japonaise comme modèle à imiter. Ce modèle mettait l'accent sur le travailleur acharné "salarié" en col blanc qui travaillait à l'extérieur de la maison, tandis que le "shufu", qui travaillait tout aussi dur et se sacrifiait lui-même, restait à la maison en se consacrant aux soins et à l'éducation de ses enfants. C'est dans ce milieu, en 1967, que "The Doctor's Wife" est devenu un best-seller...
En écrivant en cette même décennie, Kono Taeko s'interroge sur tous les aspects de la vie du shufu. Ses personnages féminins ont une aversion pour la maternité et beaucoup d'entre eux n'épousent pas les hommes avec lesquels ils vivent. Ils initient le sexe, et c'est toujours brutal, douloureux, voire dangereux. La vie de ces personnages semble tout à fait banale mais leurs fantasmes sont exceptionnels, tellement tabous qu'ils ne peuvent être décrits que dans ce monde marginal de la fiction. Rappelant les œuvres de Flannery O'Connor, les histoires de Kono explorent le côté sombre et terrifiant de la nature humaine qui se manifeste par un comportement antisocial. Ses protagonistes sont invariablement des femmes d'âge moyen qui, malgré leur vie apparemment paisible, sont extrêmement instables et solitaires dans leurs relations avec les hommes. Kono, avec les yeux d'un observateur impersonnel, examine leur malheur en observant les émotions et les impulsions refoulées dans les recoins sombres de leur inconscient." Les critiques ont soutenu que les héroïnes masochistes de Kono renforcent l'image stéréotypée des femmes japonaises comme totalement passives envers les hommes. Les personnages, cependant, résistent à la domination des hommes en lançant le jeu de pouvoir du sadomasochisme et en les attirant dans l'arène. Les dichotomies de la douleur et du plaisir, l'illusion et la réalité, la domination et la soumission illuminées dans ce jeu créent dans les histoires une qualité à la fois inquiétante et esthétique ..
