- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Théophile de Viau (1590-1626), "Pyrame et Thisbé" - Marc-Antoine de Saint-Amant (1594-1661) - Guez de Balzac (1597-1654), "Lettres" - Tristan L’Hermite (1601-1655) - François de Boisrobert (1592-1662) - Jacques Des Barreaux (1599-1673) - ...
Last update 10/10/2021

Du "Parnasse satyrique" (1622) au "Parnasse royal" (1635) - "L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner. Doit être à plus haut prix que celui de régner", Charles IX à Ronsard - Une certaine volonté d'indépendance de l'esprit vient à naître en cette première moitié du XVIIe, encore hésitante tant le contexte est encore lourd de ses querelles religieuses et politiques. Au centre, une dizaine d'années à peine, un Théophile de Viau qui, durant sa courte vie de trente-six ans, né en pleine guerre de religion et de parents protestants, se retrouve écartelé entre une pensée libertine orientée vers l'athéisme et le catholicisme auquel il se convertira avant de mourir, mais un catholicisme au centre d'un absolutisme politique qui cherche encore sa voie : "Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints, Promener mon esprit par de petits desseins, Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise, Méditer à loisir, rêver tout à mon aise, Employer toute une heure à me mirer dans l'eau, Ouïr, comme en songeant, la course d'un ruisseau, Ecrire dans les bois, m'interrompre, me taire, Composer un quatrain sans songer à le faire", écrit Théophile de Viau, ami de Jacques Des Barreaux, figure de proue du libertinage au XVIIe siècle, mais qui n'a jamais exercé une charge ni écrit quoique ce soit, François de Boisrobert, Mainard, Saint-Amant. Théophile, libertin de moeurs et d'esprit, fut sans doute le plus audacieux du groupe.
La tragédie de son destin est d'apparaître à un moment critique de cette "liberté de pensée" qui prenait corps au travers, notamment, de ses écrits : car, en 1620, c'est par l'écrit que se prolonge la fronde perpétuelle de ces grands seigneurs qui menace le pouvoir royal, et Théophile, plus qu'il ne pense, est emporté par cette crise larvée de l'autorité. Théophile est effet à cette date le poète d’un clan opposé au favori de Louis XIII, le duc de Luynes, le voici dans l'obligation de rejoindre l’armée qui combat la Reine-Mère et les princes révoltés aux Ponts-de-Cé. Son procès est ainsi celui de l'écrit et de l'homme de lettres tout à la découverte de sa liberté intellectuelle, intuitive et naturelle, mais impossible à laisser vivre dans un contexte politique et religieux en quête de stabilité : il faudra attendre une quinzaine d'années, Richelieu et la création de l'Académie française en 1635, pour mettre sous contrôle cette liberté d'esprit qui semblait sans freins ni lois, quinze années qui peut-être structurent encore notre monde...
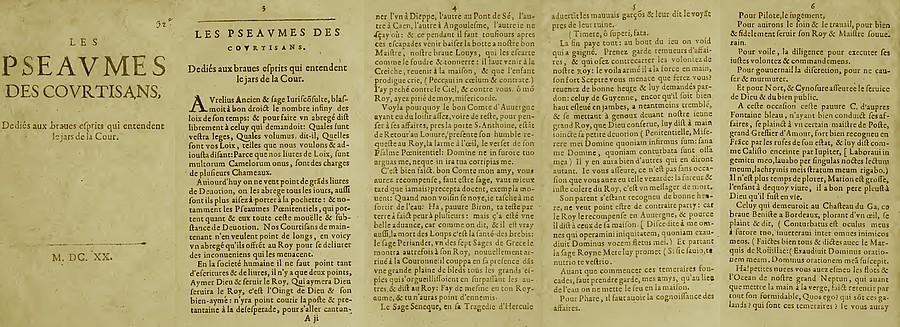
L'âge classique oubliera ces quelques années, il n'aura que dédain pour Théophile, mais sans ce goût ingénieux des "choses de l'esprit" qui reconnaît sa dette à Malherbe et à Vaugelas, et qui singularise le style libertin puis précieux, en continuité avec la littérature courtoise et les allégories des siècles précédents, la littérature française qui génère tant de talents divers à partir de 1650 n'aurait connu sans doute un tel développement...
Animé par un rationalisme empirique, Descartes n'a pas encore "pensé", le libertinage revendique cependant une certaine liberté de pensée, un goût de la réflexion indépendante, un mépris du fanatisme et de tout esprit de système. Le "libertinage philosophique" apparaît sous Richelieu, vers 1628, lorsque se réunit le fameux cercle des frères Dupuy, Jacques et Pierre, un cercle d'érudits et de philosophes tels que La Mothe Le Vayer (1588-1672), Pierre Gassendi (1592-1655), Guy Patin, Gabriel Naudé (1600-1650). Compte tenu de la répression, la prudence impose de converser plus que d'écrire. Ils sont fondamentalement sceptiques et rejettent le dogmatisme religieux. Ils s'opposeront tout autant au rationalisme cartésien, qui suppose chez tout être humain l'existence d'une raison universelle et identique, à l'image de Dieu. Tout au contraire, ce "libertinage philosophique" pense que le progrès des sciences de trouver dans la nature humaine les éléments d'une morale adaptée à sa vie terrestre. Rabelais et Montaigne ne sont pas loin. Et le chemin des Encyclopédistes du XVIIIe semble tracé.

C'est à partir de ces cercles d'érudits que le libertinage va progressivement s'insinuer dans les milieux mondains, des milieux où règnent Condé, la princesse Palatine, le cardinal de Retz, le chevalier de Méré, Bussy-Rabutin, s'installer dans le salon de Ninon de Lenclos, le salon où rayonne un certain Saint-Evremond (1613-1703), grand seigneur épicurien et déiste, jusqu'à son exil en Angleterre en 1661... En littérature, le libertinage ouvre une boîte de Pandore, des genres considérés comme mineurs, le burlesque, qui conteste la littérature traditionnelle (Charles Sorel), des évocations narratives de mondes anciens ou lointains (Denis Veiras, Fontenelle), des fictions philosophiques, dont Cyrano de Bergerac sera sans conteste le grand représentant littéraire...
Dès le début du XVIIe, une certaine opposition à l'esprit précieux se fera jour, sous forme de parodies, "Le Berger extravagant" (1627) de Saint-Amant en est un exemple, soit de parti pris de "vulgarité", ce sera le genre burlesque avec Paul Scarron (le Roman comique, 1651-1657) : Charles Sorel reprend quant à lui la tradition rabelaisienne, bourgeoise et populaire, avec son "Histoire comique de Francion" (1622)...
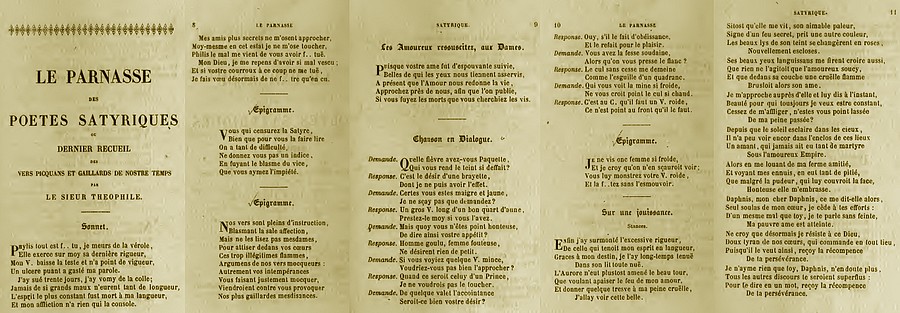
C'est au jésuite Garasse, dans la "Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps" (1622-1623), que l'on doit l' «invention» de la dénomination de "libertin", en fait une énorme machine de guerre qui, sous couleur de passer en revue les principaux libertins de l'époque, vise surtout Théophile, contre lequel elle est dirigée. Le terme lui-même préexistait, il désignait, dans la pensée de Calvin en particulier, des dissidents spirituels. Sous la plume du jésuite, il désigne les impies, les disciples d'Épicure et tous les esprits qui mettent en doute les vérités révélées et revendiquent, au nom de l'indépendance de la pensée, le droit à l'incrédulité. C'est le Cabinet satyrique ou Recueil parfaict des vers picquants et gaillards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs Sigogne, Régnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalés poètes de ce siècle (1618) qui déclenche les foudres du père jésuite : cette anthologie de la poésie satirique et licencieuse est aussi un recueil de vers licencieux de Des Yveteaux, de Ronsard et de Du Ryer. La plupart des satires sont dirigées, en termes crus, contre les normes morales en vigueur ; poèmes licencieux, franchement obscènes, épicuriens constituent l'essentiel de ce recueil dont trois éditions augmentées parurent en 1619, 1623 et 1666. La dénonciation extrêmement violente de Garasse lui vaudra de déclencher ce que l'on a appelé la « querelle de la raillerie chrétienne », François Ogier reprochant au père d'avoir usé d'invectives, de railleries vulgaires et violentes et d'avoir ainsi échappé à la politesse et à la bienveillance au nom de laquelle le père était censé écrire...
Il reste qu'un groupe de libertins a bien existé durant la première moitié du XVIIe siècle : Théophile, des Barreaux, Chouvigny, Saint-Pavin et tous ceux que les travaux de Frédéric Lachèvre et de René Pintard ont mis au jour, témoignent d'une critique violente des normes religieuses, morales et sexuelles en vigueur dans la société de leur temps. Ils se rattachent directement aux pyrrhoniens du XVIe s., comme Montaigne et Charron, s'appuient sur une érudition profonde et une curiosité sans limite, leurs maîtres sont Gassendi et Gabriel Naudé. La justice poursuivit tous ceux qui n'hésitèrent pas à pratiquer ouvertement des comportements illicites ou à exprimer publiquement leur pensée: Théophile mourra d'épuisement après un très long procès, Claude le Petit sera brûlé en place de grève en 1661 pour avoir publié un Bordel des Muses. Aussi, pour échapper à la censure, la plupart des auteurs durent employer une écriture dissimulée, souvent ironique, à double compréhension.
L'historiographie depuis la fin du XIXe siècle a toujours dissocié, non sans arrière-pensées, un libertinage érudit, philosophique, digne d'étude et d'attention, qui regrouperait les Naudé, La Mothe de la Vayer, Cyrano, Gassendi, d'un libertinage de mœurs, scandaleux, obscène, aux pratiques sexuelles déviantes..
Théophile de VIAU - Prière de Théophile aux poètes de ce temps
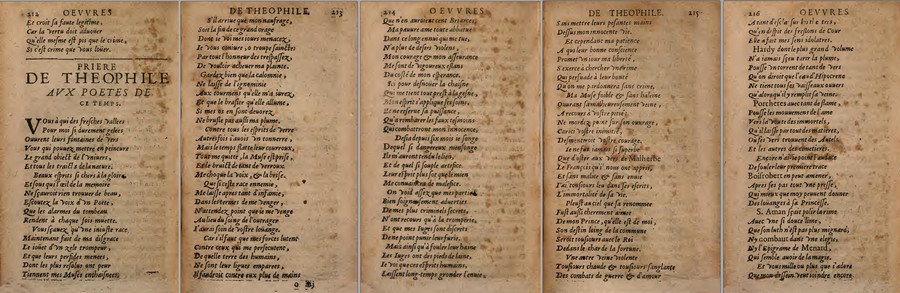
Vous à qui de fraîches vallées
Pour moi si durement gelée
Ouvrent leurs fontaines de vers,
Vous qui pouvez mettre en peinture
Le grand objet de l’univers
Et tous les traits de la nature,
Beaux esprits si chers à la gloire,
Et sans qui l’oeil de la mémoire
Ne saurait rien trouver de beau,
Ecoutez la voix d’un poète
Que les alarmes du tombeau
Rendent à chaque fois muette.
Vous savez qu’une injuste race
Maintenant fait de ma disgrâce
Le jouet d’un zèle trompeur,
Et que leurs perfides menées,
Dont les plus résolus ont peur,
Tiennent mes Muses enchaînées.
S’il arrive que mon naufrage
Soit la fin de ce grand orage
Dont je vois mes jours menacés,
Je vous conjure, ô troupe sainte,
Par tout l’honneur des trépassés,
De vouloir achever ma plainte.
Gardez bien que la calomnie
Ne laisse de l’ignominie
Aux tourments qu’elle m’a jurés,
Et que le brasier qu’elle allume,
Si mes os en sont dévorés,
Ne brûle pas aussi ma plume.
Contre tous les esprits de verre
Autrefois j’avais un tonnerre,
Mais le temps flatte leur courroux,
Tout me quitte, la Muse est prise,
Et le bruit de tant de verrous
Me choque la voix, et la brise.
Que si cette race ennemie
Me laisse après tant d’infamie
Dans les termes de me venger,
N’attendez point que je me venge:
Au lieu du soin de l’outrager
J’aurai soin de votre louange.
Car s’il faut que mes forces luttent
Contre ceux qui me persécutent,
De quelle terre des humains
Ne sont leurs ligues emparées?
Il faudrait contr’eux plus de mains
Que n’en auraient cent Briarées.
Ma pauvre âme toute abattue
Dans ce long ennui qui me tue
N’a plus de désirs violents;
Mon courage et mon assurance
Me font de vigoureux élans
Du côté de mon espérance.
Ici pour dénouer la chaîne
Qui me tient tout prêt à la gêne,
Mon esprit n’applique ses soins
Et ne réserve sa puissance
Qu’à rembarrer les faux témoins
Qui combattront mon innocence.
Déjà depuis six mois je songe
De quel si dangereux mensonge
Ils m’auront tendu le lien,
Et de quel si souple artifice
Leur esprit plus fort que le mien
Me convaincra de maléfice.
On voit assez que mes parties,
Bien soigneusement averties
De mes plus criminels secrets,
N’ont recours qu’à la tromperie,
Et que mes juges sont discrets
De ne point punir leur furie.
Mais ainsi qu’à fouler leur haine
Les juges ont des pieds de laine,
Je vois que ces esprits humains
Laissent longtemps gronder l’envie
Sans mettre leurs pesantes mains
Dessus mon innocente vie.
Et cependant ma patience,
A qui leur bonne conscience
Promet un jour ma liberté,
S’exerce à chercher une rime
Qui persuade à leur bonté
Qu’on me pardonnera sans crime.
Ma Muse faible et sans haleine,
Ouvrant sa malheureuse veine
A recours à votre pitié:
Ne mordez point sur son ouvrage,
Car ici votre inimitié
Démentirait votre courage.
Je ne fus jamais si superbe
Que d’ôter aux vers de MALHERBE
Le français qu’ils nous ont appris,
Et sans malice et sans envie
J’ai toujours lu dans ses écrits
L’immortalité de sa vie.
Plût au ciel que sa renommée
Fût aussi chèrement aimée
De mon Prince qu’elle est de moi,
Son destin loin de la commune
Serait toujours avec le Roi
Dedans le char de la Fortune.
Une autre veine violente,
Toujours chaude et toujours sanglante
Des combats de guerre et d’amour,
A tant d’éclats sur les théâtres
Qu’en dépit des frelons de Cour
Elle a fait mes sens idolâtres:
HARDY, dont le plus grand volume
N’a jamais su tarir la plume,
Pousse un torrent de tant de vers
Qu’on dirait que l’eau d’Hippocrène
Ne tient tous ses vaisseaux ouverts
Qu’alors qu’il y remplit sa veine.
PORCHERES avec tant de flamme
Pousse les mouvements de l’âme
Vers la route des immortels
Qu’il laisse partout des matières
Où ses vers trouvent des autels
Et les autres des cimetières.
Encore n’ai-je point l’audace
De fouler leur première trace.
BOISROBERT en peut amener
Après ses pas toute une presse
Qui mieux que moi peuvent donner
Des louanges à sa princesse.
SAINT-AMANT sait polir la rime
Avec une si douce lime
Que son luth n’est pas mignard,
Ni GOMBAUD dans une élégie,
Ni l’épigramme de MAYNARD
Qui semble avoir de la magie.
Et vous, mille ou plus que j’adore,
Que mon dessein veut joindre encore
A ces génies vigoureux
De qui je tache ici la gloire
Parce que le sort malheureux
Les a fait choir à ma mémoire.
Voyant mes Muses étourdies
Des frayeurs et des maladies
Qui me prennent à tous moments,
Faites-leur un peu de caresse
Et leur rendez les compliments
De celui qui vous les adresse.

Théophile de Viau (1590-1626)
"Notre destin est assez doux, Et, pour n'être pas immortelle, Notre nature est assez belle Si nous savons jouir de nous..." - Né près d'Agen, à Clairac-en-Agenais, en 1590 de parents huguenots, - Jacques de Viau, son père, était avocat au Parlement de Bordeaux -, Théophile de Viau étudie dans les collèges fondés par les Réformés à Nérac et à Montauban, puis à Bordeaux et à l'Académie protestante de Saumur, réputée pour ses écoliers turbulents. Le voici lancé dans une jeunesse des plus aventureuse, s'attache à une troupe de comédiens, on le retrouve ainsi en 1613 avec Guez de Balzac, originaire d'Angoulême et protégé par le duc d'Epernon dans les Provinces-Unies (Leyde)...
"Je crois que les destins ne font venir personne En l'être des mortels qui n'ait l'âme assez bonne; Je pense que chacun aurait assez d'esprit, Suivant le libre train que Nature prescrit" Theophile entre au service du comte de Candale en 1615, qui est du parti des Princes; puis, à partir de 1616, il se rapproche de la Cour. Contrairement à la légende tardive qui fait de lui un suppôt de tavernes et de mauvais lieux, il mène le train d'un courtisan fastueux. Il est exilé en 1619 en raison des intrigues de la Cour plus encore que pour la hardiesse de ses écrits. Rentré en grâce, il abjure prudemment le protestantisme, devient célèbre dès la publication du premier recueil de ses oeuvres en 1621 (les Oeuvres du sieur Théophile) et la représentation d'une tragédie, "Pyrame et Thisbé". C'est avec une certaine candeur qu'il reconnaît son libertinage spirituel, mais en 1623, la publication du second recueil de ses oeuvres qu'aggravent celle du "Parnasse satyrique", dont la plupart des poèmes frondeurs et licencieux, lui sont, à tort, attribués, lui attire les foudres des jésuites Garasse et Voisin. Le contexte est de plus à la peste, on est au plus fort de la contagion, la Cour avait pris la fuite et les Tribunaux ne siégeaient plus. En l'absence de la Grand'Chambre de laquelle relevait le procès, on réunit tant bien que mal dix juges des enquêtes qui allèrent vite en besogne. Théophile doit fuir, est jugé par contumace, accusé du crime de lèse-majesté divine, et condamné au bûcher. Le 19 août 1623, l'effigie du poète et ses oeuvres sont brûlées en place de Grève. Il est arrêté peu après, en septembre : "L'exécution de quelque criminel bien célèbre n'a jamais eu plus de foule à son spectacle que je n'en eus à mon emprisonnement. Soudain que je fus écroué, on me dévala dans un cachot dont le toit même était sous terre. Je couchais tout vêtu et chargé de liens si rudes et si pesants que les marques et la douleur en demeurent encore en mes jambes ; les murailles y suaient d'humidité et moi de peur..." Il fait deux années de prison avant d'être libéré en 1625, sa peine est commuée en bannissement et va mourir en 1626 chez son protecteur, le duc de Montmorency, à Chantilly. Sept années plus tard, en 1632, Henri II de Montmorency, soutien de Gaston d'Orléans contre Richelieu, était condamné à mort pour crime de lèse-majesté et exécuté...
Requête de Théophile à Nosseigneurs de Parlement
Celui qui briserait les portes
Du cachot noir des troupes mortes,
Voyant les maux que j’ai soufferts,
Dirait que ma prison est pire:
Ici les âmes ont des fers,
Ici le plus constant soupire.
Dieux, souffrez-vous que les Enfers
Soient au milieu de votre empire,
Et qu’une âme innocente, en un corps languissant,
Ne trouve point de crise aux douleurs qu’elle sent?
L’oeil du monde qui par ses flammes
Nourrit autant de corps et d’âmes
Qu’en peut porter chaque élément,
Ne saurait vivre demi-heure
Où m’a logé le Parlement;
Et faut que ce bel astre meure
Lorsqu’il arrive seulement
Au premier pas de ma demeure.
Chers lieutenants des dieux qui gouvernez mon sort,
Croyez-vous que je vive où le Soleil est mort?
Je sais bien que mes insolences
Ont si fort chargé les balances
Qu’elles penchent à la rigueur,
Et que ma pauvre âme abattue
D’une longue et juste langueur,
Hors d’apparence s’évertue
De sauver un peu de vigueur
Dans le désespoir qui la tue;
Mais vous êtes des dieux, et n’avez point de mains
Pour la première faute où tombent les humains.
Si mon offense était un crime,
La calamité qui m’opprime
Dans les horreurs de ma prison
Ne pourrait sans effronterie
Vous demander sa guérison;
Mon insolente flatterie
Ferait lors une trahison
A la pitié dont je vous prie,
Et ce reste d’espoir qui m’accompagne ici
Se rendrait criminel de vous crier merci.
Pressé d’un si honteux outrage,
Je cherche au fond de mon courage
Mes secrets les moins paraissants,
Je songe à toutes les délices
Où se sont emportés mes sens;
Je m’adresse à tous mes complices:
Mais ils se trouvent innocents
Et s’irritent de mes supplices.
O ciel! ô bonnes mœurs! que puis-je avoir commis
Pour rendre à mon bon droit tant de dieux ennemis?
Mais c’est en vain que je me fie
A la raison qui justifie
Ma pensée et mes actions;
Bien que mon bon droit soit palpable,
Ce sont peut-être illusions:
Le Parlement n’est pas capable
Des légères impressions
Qui font un innocent coupable.
Quelque tort apparent qui me puisse assaillir,
Les juges sont des dieux, ils ne sauraient faillir.
N’ai-je point mérité la flamme
De n’avoir su ployer mon âme
A louer vos divins esprits?
Il est temps que le Ciel s’irrite
Et qu’il punisse le mépris
D’un flatteur de Cour hypocrite
Qui vous a volé tant d’écrits
Qui sont dus à votre mérite.
Courtisans qui m’avez tant dérobé de jours,
Est-ce vous dont j’espère aujourd’hui du secours?
Race lâche et dénaturée,
Autrefois si mal figurée
Par mes vers mal récompensés,
Si ma vengeance est assouvie,
Vous serez si bien effacés
Que vous ne ferez plus d’envie
Aux honnêtes gens offensés
Des louanges de votre vie,
Et que les vertueux douteront désormais
Quel vaut mieux d’un marquis ou d’un clerc du Palais.
Et s’il faut que mes funérailles
Se fassent entre les murailles
Dont mes regards sont limités
Dans ces pierres moins impassibles
Que vos courages hébétés,
J’écrirai des vers si lisibles
Que vos honteuses lâchetés
Y seront à jamais visibles,
Et que les criminels de ce hideux manoir
N’y verront point d’objet plus infâme et plus noir.
Mais si jamais le Ciel m’accorde
Qu’un rayon de miséricorde
Passe au travers de cette tour,
Et qu’enfin mes juges ployables
Ou par justice ou par amour
M’ôtent de ces lieux effroyables,
Je vous ferai paraître au jour
Dans des portraits si pitoyables,
Que votre faible éclat se trouvera si faux,
Que vos fils rougiront de vos sales défauts.
Mes juges, mes dieux tutélaires,
S’il est juste que vos colères
Me laissent désormais vivant,
Si le trait de la calomnie
Me perce encore assez avant,
Si ma muse est assez punie,
Permettez que dorénavant
Elle soit sans ignominie,
Afin que votre honneur puisse trouver des vers
Dignes de les porter aux yeux de l’univers.
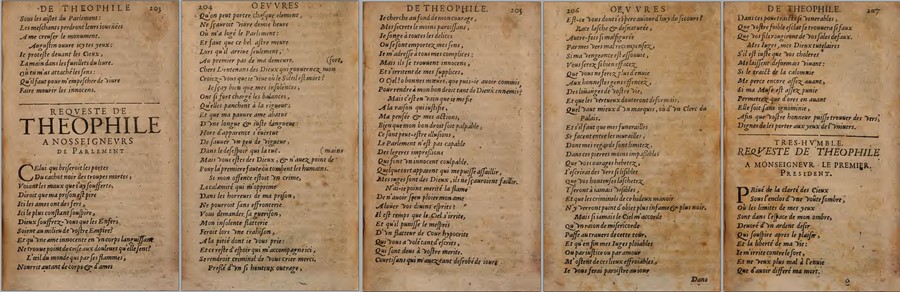
Très humble requête de Théophile à Monseigneur le premier président
Privé de la clarté des cieux
Sous l’enclos d’une voûte sombre
Où les limites de mes yeux
Sont dans l’espace de mon ombre,
Dévoré d’un ardent désir
Qui soupire après le plaisir
Et la liberté de ma vie,
Je m’irrite contre le sort
Et ne veux plus mal à l’envie
Que d’avoir différé ma mort.
Plût au Ciel qu’il me fût permis,
Sans violer les droits de l’âme,
De me rendre à mes ennemis,
Et moi-même allumer ma flamme!
Que bientôt j’aurais évité
La honteuse captivité
Dont la force du temps me lie!
Aujourd’hui mes sens bienheureux
Verraient ma peine ensevelie
Dans un sépulcre généreux.
Mais ce grand Dieu qui fit nos lois,
Lorsqu’il régla nos destinées
Ne laissa point à notre choix
La mesure de nos années.
Quand nos astres ont fait leurs cours,
Et que la trame de nos jours
N’a plus aucun filet à suivre,
L’homme alors peut changer de lieu,
Et pour continuer de vivre
Ne doit mourir qu’avecque Dieu.
Aussi me puis-je bien vanter
Que dans l’horreur d’une aventure
Assez capable de tenter
La faiblesse de la nature,
Le Ciel, ami des innocents,
Fit voir à mes timides sens
Sa divinité si propice
Qu’encore j’ai toujours été
Sur le bord de mon précipice
D’un visage assez arrêté.
Il est vrai qu’au point d’endurer
Les affronts que la calomnie
M’a fait si longuement durer,
Ma constance se voit finie.
Dans ce sanglant ressouvenir
Celui qui veut me retenir
Il a ses passions trop lentes,
Et n’a jamais été battu
Des prospérités insolentes
Qui s’attaquent à la vertu.
Mais, ô l’erreur de mes esprits!
Dans le siècle infâme où nous sommes,
Tout ce déshonneur n’est qu’un prix
Pour passer le commun des hommes.
Combien de favoris de Dieu
Dans un plus misérable lieu
Ont senti de pires malices,
Et dans leurs innocentes mains,
Qui n’avaient que les Cieux complices,
Reçu des fers inhumains!
D’ailleurs l’épine est sous la fleur,
Le jour sort d’une couche noire;
Et que sais-je si mon malheur
N’est point la source de ma gloire?
Un jour mes ennuis effacés,
Dans mon souvenir retracés,
Seront eux-même leur salaire:
Toutes les choses ont leur tour,
Dieu veut souvent que la colère
Soit la marque de son amour.
Qui me pourra persuader
Que la Cour soit toujours charmée?
D’où la peut encore aborder
Le venin de la renommée?
Si Verdun ouvre un peu ses yeux
Quel esprit assez captieux
Pourra mordre à sa conscience?
De quel vent peut-on écumer
Dans ce grand gouffre de science
Pour n’y pas bientôt abîmer?
Grande lumière de nos jours,
Dont les projets sont des miracles,
Et de qui les communs discours
Ont plus de poids que les oracles,
Sainte guide de tant de dieux
Qui, sur le modèle des cieux,
Donnez des règles à la terre,
Dieu sans excès et sans défaut,
Vous avez ça-bas un tonnerre,
Comme en a ce grand Dieu là-haut.
Le Ciel par de si beaux crayons
Marque le fil de vos harangues
Qu’on y voit les mêmes rayons
Du grand trésor de tant de langues
Qu’il versa par le Saint-Esprit
Au disciples de Jésus-Christ.
Paris est jaloux que Toulouse
Ait eu devant lui tant d’honneur,
L’Europe est aujourd’hui jalouse
Que la France ait tout ce bonheur.
Quand je pense profondément
A vos vertus si reconnues,
Mon espoir prend un fondement
Qui l’élève au dessus des nues,
Je laisse reposer mes soins,
Les alarmes des faux témoins
Ne me donnent plus tant de crainte,
Et mon esprit tout transporté,
Au milieu de tant de contrainte,
Goûte à demi ma liberté.
C’est de vous sur tous que j’attends
A voir retrancher la licence
Qui fait habiter trop longtemps
La crainte avec l’innocence;
Et quand tout l’Enfer répandrait
Ses ténèbres sur mon bon droit,
Je sais que votre esprit éclate
Dans la plus noire obscurité,
Et que tout l’appas qui vous flatte
C’est la voix de la vérité.
Mais, ô l’honneur du Parlement!
Tout ce que j’écris vous offense
Puisqu’écrire ici seulement
C’est violer votre défense.
Mon faible esprit s’est débauché
A l’objet d’un si doux péché,
Et croit sa faute légitime,
Car la vertu doit avouer
Qu’elle-même est pis que le crime,
Si c’est crime que vous louer.

Les éditions des Œuvres de Théophile de Viau vont se multiplier, soixante-dix éditions environ de 1627 à 1696; trois recueils de ses poèmes seront publiés avant sa mort et Georges de Scudéry en publiera une édition posthume en 1632. Dramatique exemple des vicissitudes de la littérature sceptique et satirique au début du XVIIe siècle et aussi des rivalités politiques de la Cour, Théophile de Viau laisse une œuvre poétique riche et originale, indépendante des leçons de Malherbe qu'il admire en refusant de l'imiter. Il exprime "dans une langue moderne la sensibilité d'une âme moderne" (A. Adam) : il aime sincèrement et spontanément "la nature, la vie, la société, l'océan, ses vagues; son calme... la musique, les beaux habits, la chasse, les beaux chevaux, les bonnes odeurs, la bonne chère"... ainsi évoque-t-il naturellement toutes les beautés du monde lorsqu'il veut adresser un bon éloge au roi, ou supplier Cloris de lui accorder "un amoureux plaisir ".
Mais il a aussi chanté les formes les plus sombres de la passion : faiblesses et déceptions, humiliations et chagrin d'amour, et il a découvert avec l'exil la tristesse profonde de la condition humaine. On comprend que, jusqu'à Boileau, Saint-Amant et Tristan L'Hermite, et plus longtemps qu'eux, Théophile de Viau ait eu une renommée éclatante....
Le Matin, "la nuit a retiré ses voiles..."
L'AURORE sur le front du jour
Sème l'azur, l'or et l'ivoire,
Et le soleil, lassé de boire,
Commence son oblique tour.
Ses chevaux, au sortir de l'onde.
De flamme et de clarté couverts,
La bouche et les naseaux ouverts,
Ronflent la lumière du monde.
La lune fuit devant nos yeux ;
La nuit a retiré ses voiles;
Peu à peu le front des étoiles
S'unit à la couleur des cieux.
Déjà la diligente avette
Boit la marjolaine et le thym,
Et revient, riche du butin
Qu'elle a pris sur le mont Hymette,
Je vois les agneaux bondissants
Sur ces blés qui ne font que naître ;
Cloris, chantant, les mène paître
Parmi ces coteaux verdissants.
Les oiseaux, d'un joyeux ramage,
En chantant semblent adorer
La lumière qui vient dorer
Leur cabinet et leur plumage.
La charrue écorche la plaine ;
Le bouvier, qui suit les sillons,
Presse de voix et d'aiguillons
Le couple de bœufs qui l'entraîne.
Alix apprête son fuseau ;
Sa mère, qui lui fait la tâche,
Presse le chanvre qu'elle attache
A sa quenouille de roseau.
Une confuse violence
Trouble le calme de la nuit,
Et la lumière, avec le bruit.
Dissipe l'ombre et le silence...
Les bêtes sont dans leur tanière.
Qui tremblent de voir le soleil.
L'homme, remis par le sommeil,
Reprend son œuvre coutumière.
Le forgeron est au fourneau ;
Vois comme le charbon s'allume!
Le fer rouge, dessus l'enclume,
Étincelle sous le marteau.
Cette chandelle semble morte.
Le jour la fait s'évanouir ;
Le soleil vient nous éblouir :
Vois qu'il passe au travers la porte !
Il est jour : levons-nous, Philis ;
Allons à notre jardinage.
Voir s'il est, comme ton visage.
Semé de roses et de lis.
Depuis les Regrets de Du Bellay, il n'est pas un sonnet qui traduise de façon plus poignante et plus sobre que celui sur son exil le désespoir et la douleur de vivre....
"Quelque si doux espoir où ma. raison s'appuie,
Un mal si découvert ne se saurait cacher :
J'emporte, malheureux, quelque part où je fuis,
Un trait qu'aucun secours ne me peut arracher
Je viens dans un désert mes larmes épancher,
Où la terre languit, où le soleil s'ennuie,
Et, d 'un torrent de pleurs qu 'on ne peut étancher
Couvre l'air de vapeur et la terre de pluie.
Parmi ces tristes lieux traînant mes longs regrets,
Je me promène seul dans l'horreur des forêts
Où la funeste orfraie et le hibou se perchent.
Là, le seul réconfort qui peut m'entretenir
C'est de ne craindre point que les vivants me cherchent
Où le flambeau du jour n'osa jamais venir."
La Solitude, "Personne ne nous voit qu'Amour.."
DANS ce val solitaire et sombre,
Le cerf qui brame au bruit de l'eau,
Penchant ses yeux dans un ruisseau,
S'amuse à regarder son ombre.
De cette source une Naïade,
Tous les soirs, ouvre le portai
De sa demeure de cristal.
Et nous chante une sérénade.
Les Nymphes, que la chasse attire
A l'ombrage de ces forêts.
Cherchent les cabinets secrets.
Loin de l'embûche du satyre...
Un froid et ténébreux silence
Dort à l'ombre de ces ormeaux,
Et les vents battent les rameaux
D'une amoureuse violence...
Ici, l'Amour fait ses études;
Vénus y dresse des autels ;
Et les visites des mortels
Ne troublent point ces solitudes...
Corinne, je te prie, approche ;
Couchons-nous sur ce tapis vert,
Et, pour être mieux à couvert.
Entrons au creux de cette roche...
Mon Dieu ! que tes cheveux me plaisent !
Ils s'ébattent dessus ton front,
Et, les voyant beaux comme ils sont.
Je suis jaloux quand ils te baisent...
Si tu mouilles tes doigts d'ivoire
Dans le cristal de ce ruisseau,
Le Dieu, qui loge dans cette eau,
Aimera, s'il en ose boire...
Vois-tu ce tronc et cette pierre ?
Je crois qu'ils prennent garde a nous ;
Et mon amour devient jaloux
De ce myrte et de ce lierre.
Sus, ma Corinne ! que je cueille
Tes baisers, du matin au soir !
Vois comment, pour nous faire asseoir,
Ce myrte a laissé choir sa feuille !...
Approche, approche, ma Dryade!
Ici, murmureront les eaux;
Ici, les amoureux oiseaux
Chanteront une sérénade.
Prête-moi ton sein pour y boire
Des odeurs qui m'embaumeront;
Ainsi mes sens se pâmeront
Dans les lacs de tes bras d'ivoire.
Je baignerai mes mains folâtres
Dans les ondes de tes cheveux.
Et ta beauté prendra les vœux
De mes œillades idolâtres.
Ne crains rien, Cupidon nous garde.
Mon petit ange, es-tu pas mien ?
Ah ! je vois que tu m'aimes bien :
Tu rougis quand je te regarde...
Ma Corinne, que je t'embrasse !
Personne ne nous voit qu'Amour;
Vois que même les yeux du jour
Ne trouvent point ici de place.
Les vents, qui ne se peuvent taire,
Ne peuvent écouter aussi ;
Et ce que nous ferons ici
Leur est un inconnu mystère.
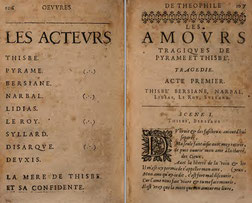
1623 - Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé
La tragédie de Pyrame et Thisbé fut vraisemblablement créée en 1621. Éditée pour la première fois en 1623, elle donna lieu à plus de soixante-dix rééditions au cours du XVIIe siècle. Dans la Babylone antique, Pyrame et Thisbé s'aiment, mais deux obstacles s'opposent à cet amour. Comme dans Roméo et Juliette de William Shakespeare, les deux familles sont ennemies et ne veulent pas entendre parler de mariage. D'autre part, le roi est éperdument amoureux de Thisbé et utilise son pouvoir pour s'opposer à Pyrame. Devant cette situation, les deux amoureux décident de s'enfuir. Ils doivent se retrouver, la nuit, dans un endroit écarté. Mais Pyrame, arrivé le premier au lieu du rendez-vous, voit du sang et les traces du passage d'un lion. Il croit que Thisbé a été dévorée et se tue. Thisbé, parvenue à son tour à l'endroit fixé, se suicidera sur le corps de son bien-aimé...
Celui qui lance le tonnerre
Qui gouverne les éléments,
Et meut avec des tremblements
La grande masse de la terre,
Dieu qui vous mit le sceptre en main,
Qui vous le peut ôter demain,
Lui qui vous prête sa lumière,
Et qui, malgré les fleurs de lys,
Un jour fera de la poussière
De vos membres ensevelis.
Ce grand Dieu qui fit les abîmes
Dans le centre de l'univers,
Et les tient toujours ouverts
A la punition des crimes,
Veut aussi que les innocents,
A l'ombre de ses bras puissants,
Trouvent un assuré refuge,
Et ne sera point irrité
Que vous tarissiez le déluge
Des maux où vous m'avez jeté.
Théophile de VIAU, Courtisans, qui passez vos jours dans les délices…
Courtisans, qui passez vos jours dans les délices,
Qui n’éloignez jamais la demeure des rois,
Qui ne savez que c’est de la rigueur des lois,
Vous seuls à qui le Ciel a caché ses malices.
Si vous trouvez mauvais qu’au fort de mes supplices,
Les soupirs et les pleurs m’échappent quelquefois,
Parlez à ces rochers, venez dedans ces bois,
Qui de mon désespoir vont être les complices.
Vous verrez que mes maux sont sans comparaison,
Et que j’invoque en vain le temps et la raison
Aux tourments infinis que le destin m’ordonne;
Je sens de tous côtés mon esprit assailli;
Pourquoi veux-je espérer aussi qu’on me pardonne?
On ne pardonne point à qui n’a point failli.
Ode, 1621, Theophile voit l'univers s'assombrir et le poème s'ouvrir sur d'inquiétantes énigmes...
Un corbeau devant moi croasse.
Une ombre offusque mes regards,
Deux belettes, et deux renards,
Traversent l'endroit où je passe ;
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal,
J'entends craqueter le tonnerre,
Un esprit se présente à moi,
J'ouis
Charon qui m'appelle à soi.
Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source,
Un bœuf gravit sur un clocher,
Le sang coule de ce rocher,
Un aspic s'accouple d'une ourse.
Sur le haut d'une vieille tour
Un serpent déchire un vautour,
Le feu brûle dedans la glace,
Le soleil est devenu noir,
Je vois la lune qui va choir,
Cet arbre est sorti de sa place.
Stances, 1621, Theophile se livre ébloui à la contemplation d'une femme endormie...
Quand tu me vois baiser tes bras,
Que tu poses nus sur tes draps,
Bien plus blancs que le linge même ;
Quand tu sens ma brûlante main
Se promener dessus ton sein,
Tu sens bien,
Cloris, que je t'aime.
Comme un dévot devers les cieux,
Mes yeux tournés devers tes yeux,
A genoux auprès de ta couche,
Pressé de mille ardents désirs,
Je laisse sans ouvrir ma bouche
Avec toi dormir mes plaisirs.
Le sommeil aise de t'avoir
Empêche tes yeux de me voir,
Et te retient dans son empire
Avec si peu de liberté,
Que ton esprit tout arrêté
Ne murmure ni ne respire.
La rose en rendant son odeur,
Le soleil donnant son ardeur,
Diane et le char qui la traîne,
Une Naïade dedans l'eau,
Et les Grâces dans un tableau,
Font plus de bruit que ton haleine.
Là je soupire auprès de toi,
Et considérant comme quoi
Ton œil si doucement repose,
Je m'écrie : Ô Ciel ! peux-tu bien
Tirer d'une si belle chose
Un si cruel mal que le mien!
Arrêté en septembre 1623, Théophile est conduit à la prison du Châtelet et y restera enfermé jusqu'à l'intervention de son ami des Barreaux, en 1625. Il y écrira notamment la "Lettre à son frère". Puis, libéré et banni, il trouve refugie à Chantilly, protégé par Henri II de Montmorency : il y écrira une suite de dix odes, la "Maison de Sylvie", dédiée à un rendez-vous de chasse, construit pour recevoir Henri IV, et dans lequel le poète trouva refuge et s'y laissa mourir. Un rendez-vous de chasse situé près de l’étang où Marie-Felice des Ursins, duchesse de Montmorency, chantée sous le nom de « Silvie », nymphe de la forêt, venait se reposer...
La maison de Sylvie par Théophile
Ode I
Pour laisser avant que mourir
Les traits vivants d’une peinture
Qui ne puisse jamais périr
Qu’en la perte de la nature,
Je passe de crayons dorés
Sur les lieux les plus révérés
Où la vertu se réfugie,
Et dont le port me fut ouvert
Pour mettre ma tête à couvert
Quand on brûla mon effigie.
Tout le monde a dit qu’Apollon
Favorise qui le réclame,
Et qu’avec l’eau de son vallon
Le savoir peut couler dans l’âme;
Mais j’étouffe ce vieil abus
Et bannis désormais Phébus
De la bouche de nos poètes:
Tous ses temples sont démolis
Et ses démons ensevelis
Dans des sépultures muettes.
Je ne consacre point mes vers
A ces idoles effacées
Qui n’ont été dans l’univers
Qu’un faux objet de nos pensées.
Ces fantômes n’ont plus de lieu:
Tel qu’on dit avoir été dieu
N’était pas seulement un homme
Le premier qui vit l’Eternel
Fut cet imprudent criminel
Qui mordit la fatale pomme.
Tous ces dieux de bronze et d’airain
N’ont jamais lancé le tonnerre,
C’est le dard du Dieu souverain
Qui créa le ciel et la terre.
Ah! que le céleste courroux
Etait bien embrasé sur nous
Lorsqu’il fit parler ces oracles,
Et que sans détourner nos pas
Il nous vit courir aux appas
De leurs pernicieux miracles.
Satan ne nous fait plus broncher
Dans de si dangereuses toiles;
Le Dieu que nous allons chercher
Loge plus haut que les étoiles.
Nulle divinité que lui
Ne me peut donner aujourd’hui
Cette flamme ou cette fumée
Dont nos entendements épris
S’efforcent à gagner le prix
Qui mérite la renommée.
Après lui je m’en vais louer
Une image de Dieu si belle
Que le Ciel me doit avouer
Du travail que je fais pour elle.
Car après ses sacrés autels
Qui devant leurs feux immortels
Font aussi prosterner les anges,
Nous pouvons sans impiété
Flatter une chaste beauté
Du doux encens de nos louanges.
Ainsi sous de modestes vœux
Mes vers promettent à Sylvie
Ce bruit charmeur que les neveux
Nomment une seconde vie.
Que si mes écrits méprisés
Ne peuvent voir autorisés
Les témoignages de sa gloire,
Ces eaux, ces rochers et ces bois
Prendront des âmes et des voix
Pour en conserver la mémoire.
Si quelques arbres renommés
D’une adoration profane
Ont été jadis animés
Des sombres regards de Diane,
Si les ruisseaux en murmurant
Allaient autrefois discourant
Au gré d’un faune ou d’une fée,
Et si la masse du rocher
Se laissa quelquefois toucher
Aux chansons que disait Orphée,
Quelle dureté peut avoir
L’objet que ma Princesse touche,
Qu’elle ne puisse le pourvoir
Tout aussitôt d’âme et de bouche?
Dans ses bâtiments orgueilleux,
Dans ses promenoirs merveilleux,
Quelle solidité de marbres
Ne pourront pénétrer ses yeux?
Quelles fontaines et quels arbres
Ne les estimeront des dieux?
Les plus durs chênes entrouverts
Bien plutôt de gré que de force,
Peindront pour elle de mes vers
Et leurs feuilles et leur écorce,
Et quand ils les auront gravés
Sur leurs fronts les plus relevés,
Je sais que les plus fiers orages
Ne leur oseront pas toucher,
Et pourront plutôt arracher
Leurs racines et leurs ombrages.
Je sais que ces miroirs flottants
Où l’objet change tant de place,
Pour elle devenus constants
Auront une fidèle glace,
Et sous un ornement si beau
La surface même de l’eau,
Nonobstant sa délicatesse,
Gardera sûrement encrés
Et mes caractères sacrés
Et les attraits de la Princesse.
Mais sa gloire n’a pas besoin
Que mon seul ouvrage en réponde;
Le ciel a déjà pris le soin
De la peindre par tout le monde:
Ses yeux sont peints dans le Soleil,
L’Aurore dans son teint vermeil
Voit ses autres beautés tracées,
Et rien n’éteindra ses vertus
Que les cieux ne soient abattus
Et les étoiles effacées.
Ode II
Un soir que les flots mariniers
Apprêtaient leur molle litière
Aux quatre rouges limoniers
Qui sont au joug de la lumière,
Je penchais mes yeux sur le bord
D’un lit où la Naïade dort
Et regardant pêcher Sylvie
Je voyais battre les poissons
A qui plus tôt perdrait la vie
En l’honneur de ses hameçons.
D’une main défendant le bruit
Et de l’autre jetant la line
Elle fait qu’abordant la nuit
Le jour plus bellement décline.
Le Soleil craignait d’éclairer
Et craignait de se retirer,
Les étoiles n’osaient paraître,
Les flots n’osaient s’entrepousser,
Le zéphyre n’osait passer,
L’herbe se retenait de croître.
Ses yeux jetaient un feu dans l’eau:
Ce feu choque l’eau sans la craindre,
Et l’eau trouve ce feu si beau
Qu’elle ne l’oserait éteindre.
Ces éléments si furieux
Pour le respect de ses beaux yeux
Interrompirent leur querelle,
Et de crainte de la fâcher
Se virent contraints de cacher
Leur inimitié naturelle.
Les Tritons en la regardant
A travers leurs vitres liquides,
D’abord à cet objet ardent
Sentent qu’ils ne sont plus humides,
Et par étonnement soudain
Chacun d’eux dans un corps de daim
Cache sa forme dépouillée,
S’étonne de se voir cornu,
Et comment le poil est venu
Dessus son écaille mouillée.
Soupirant du cruel affront
Qui de dieux les a fait des bêtes
Et sous les cornes de leur front
A courbé leurs honteuses têtes,
Ils ont abandonné les eaux,
Et dans la rive où les rameaux
Leur ont fait un logis si sombre,
Promenant leurs yeux ébahis,
N’osent plus fier que leur ombre
A l’étang qui les a trahis.
On dit que la sœur du Soleil
Eut ce pouvoir sur la nature
Lorsque d’un changement pareil
Actéon quitta sa figure.
Ce que fit sa divine main
Pour punir dans un corps humain
Sa curiosité profane,
S’est fait ici contre les dieux
Qui n’avaient approché leurs yeux
Que des yeux de notre Diane.
Ces daims que la honte et la peur
Chassent des murs et des allées,
Maudissent le destin trompeur
Des frontières qu’il leur a volées.
Leur cœur privé d’humidité
Ne peut qu’avec timidité
Voir le ciel ni fouler la terre
Où Sylvie en ses promenoirs
Jette l’éclat de ses yeux noirs
Qui leur font encore la guerre.
Ils s’estiment heureux pourtant
De prendre l’air qu’elle respire,
Leur destin n’est que trop content
De voir le jour sous son empire.
La Princesse qui les charma
Alors qu’elle les transforma
Les fit être blancs comme neige,
Et pour consoler leur douleur
Ils reçurent le privilège
De porter toujours sa couleur.
Lorsqu’à petits flocons liés
La neige fraîchement venue
Sur de grands tapis déliés
Epanche l’amas de la nue,
Lorsque sur le chemin des cieux
Ses grains serrés et gracieux
N’ont trouvé ni vent ni tonnerre,
Et que sur les premiers coupeaux,
Loin des hommes et des troupeaux,
Ils ont peint les bois et la terre,
Quelque vigueur que nous ayons
Contre les esclaves qu’elle darde,
Ils nous blessent, et leurs rayons
Eblouissent qui les regarde.
Tel dedans ce parc ombrageux
Eclate le troupeau neigeux,
Et dans ses vêtements modestes,
Où le front de Sylvie est peint,
Fait briller l’éclat de son teint
A l’envi des neiges célestes.
En la saison que le Soleil,
Vaincu du froid et de l’orage,
Laisse tant d’heures au sommeil
Et si peu de temps à l’ouvrage,
La neige, voyant que ces daims
La foulent avec des dédains,
S’irrite de leurs bonds superbes
Et pour affamer ce troupeau,
Par dépit sous un froid manteau
Cache et transit toutes les herbes.
Mais le parc pour ses nourrissons
Tient assez de crèches couvertes
Que la neige ni les glaçons
Ne trouveront jamais ouvertes.
Là le plus rigoureux hiver
Ne les saurait jamais priver
Ni de loge ni de pâture:
Ils y trouvent toujours du vert
Qu’un peu de soin met à couvert
Des outrages de la nature.
Là les faisans et les perdrix
Y fournissent leurs compagnies
Mieux que les Halles de Paris
Ne les sauraient avoir fournies.
Avec elles voit-on manger
Ce que l’air le plus étranger
Nous peut faire venir de rare,
Des oiseaux venus de si loin
Qu’on y voit imiter le soin
D’un grand Roi qui n’est pas avare.
Les animaux les moins privés
Aussi bien que les moins sauvages,
Sont également captivés
Dans ces bois et dans ces rivages.
Le maître d’un lieu si plaisant
De l’hiver le plus malfaisant
Défie toutes les malices:
A l’abondance de son bien
Les éléments ne trouvent rien
Pour lui retrancher ses délices.
Elégie à une Dame
Si votre doux accueil n’eût consolé ma peine,
Mon âme languissait, je n’avais plus de veine,
Ma fureur était morte et mes esprits, couverts
D’une tristesse sombre, avaient quitté les vers.
Ce métier est pénible, et notre sainte étude
Ne connaît que mépris, ne sent qu’ingratitude:
Qui de notre exercice aime le doux souci,
Il hait sa renommée et sa fortune aussi.
Le savoir est honteux depuis que l’ignorance
A versé son venin dans le sein de la France.
Aujourd’hui l’injustice a vaincu la raison,
Les bonnes qualités ne sont plus de saison,
La vertu n’eut jamais un siècle plus barbare,
Et jamais le bon sens ne se trouva si rare.
Celui qui dans les cœurs met le mal ou le bien,
Laisse faire au destin sans se mêler de rien.
Non pas que ce grand Dieu qui donne l’âme au monde,
Ne trouve à son plaisir la nature féconde,
Et que son intelligence encore à pleines mains
Ne verse ses faveurs dans les esprits humains:
Parmi tant de fuseaux la Parque en sait retordre
Où la contagion du vice n’a su mordre,
Et le Ciel en fait naître encore infinité
Qui retiennent beaucoup de la divinité,
Des bons entendements qui sans cesse travaillent
Contre l’erreur du peuple et jamais ne défaillent,
Et qui d’un sentiment hardi, grave et profond,
Vivent tout autrement que les autres ne font.
Mais leur divin génie est forcé de se feindre
Et les rend malheureux s’il ne se peut contraindre.
La coutume et le nombre autorise les sots:
Il faut aimer la Cour, rire des mauvais mots,
Accoster un brutal, lui plaire, en faire estime.
Lorsque cela m’advient, je pense faire un crime;
J’en suis tout transporté, le cœur me bat au sein,
Je ne crois plus avoir l’entendement bien sain,
Et pour m’être souillé de cet abord funeste,
Je crois longtemps après que mon âme a la peste.
Cependant il faut vivre en ce commun malheur,
Laisser à part esprit, franchise et valeur,
Rompre son naturel, emprisonner son âme,
Et perdre tout plaisir pour acquérir du blâme.
L’ignorant qui me juge un fantasque rêveur,
Me demandant des vers croit me faire faveur,
Blâme ce qu’il n’entend, et son âme étourdie
Pense que mon savoir me vient de maladie.
Mais vous à qui le Ciel de son plus doux flambeau
Inspira dans le sein tout ce qu’il a de beau,
Vous n’avez point l’erreur qui trouble ces infâmes,
Ni l’obscure fureur de ces brutales âmes;
Car l’esprit plus subtil, en ses plus rares vers,
N’a point de mouvements qui ne vous soient ouverts.
Vous avez un génie à voir dans les courages,
Et qui connaît assez mon âme et mes ouvrages.
Or, bien que la façon de mes nouveaux écrits
Diffère du travail des plus fameux esprits,
Et qu’ils ne suivent point la trace accoutumée,
Par où nos écrivains cherchent la renommée,
J’ose pourtant prétendre à quelque peu de bruit,
Et crois que mon espoir ne sera point sans fruit.
Vous me l’avez promis, et sur cette promesse
Je fausse ma promesse aux vierges de Permesse.
Je ne veux réclamer ni Muses, ni Phébus,
Grâce à Dieu, bien guéri de ce grossier abus,
Pour façonner un vers que tout le monde estime,
Votre contentement est ma dernière lime:
Vous entendez le poids, le sens, la liaison,
Et n’avez en jugeant pour but que la raison.
Aussi mon sentiment à votre aveu se range,
Et ne reçoit d’autrui ni blâme ni louange.
Imite qui voudra les merveilles d’autrui;
Malherbe a très bien fait, mais il a fait pour lui;
Mille petits voleurs l’écorchent tout en vie;
Quant à moi, ces larcins ne me font point d’envie.
J’approuve que chacun écrive à sa façon,
J’aime sa renommée et non pas sa leçon.
Ces esprits mendiants, d’une veine infertile,
Prennent à tous propos ou sa rime ou son style;
Et de tant d’ornements qu’on trouve en lui si beaux,
Joignent l’or et la soie à de vilains lambeaux,
Pour paraître aujourd’hui d’aussi mauvaise grâce
Que parut autrefois la corneille d’Horace:
Ils travaillent un mois à chercher comme à fils
Pourra s’apparier la rime de Memphis.
Ce Liban, ce Turban, et ces rivières mornes,
Ont souvent de la peine à retrouver leurs bornes.
Cet effort tient leurs sens dans la confusion,
Et n’ont jamais un rais de bonne vision.
J’en connais qui ne font des vers qu’à la moderne,
Qui cherchent à midi Phébus à la lanterne,
Grattent tant le français qu’ils le déchirent tout,
Blâmant tout ce qui n’est facile qu’à leur goût,
Sont un mois à connaître, en tâtant la parole,
Lorsque l’accent est rude ou que la rime est molle;
Veulent persuader que ce qu’ils font est beau,
Et que leur renommée est franche du tombeau,
Sans autre fondement sinon que tout leur âge
S’est laissé consommer en un petit ouvrage;
Que leurs vers dureront au monde précieux,
Parce qu’en les faisant il sont devenus vieux:
De même l’araignée en filant son ordure,
Use toute sa vie et ne fait rien qui dure.
Mais cet autre poète est bien plein de ferveur,
Il est blême, transi, solitaire, rêveur,
La barbe mal peignée, un oeil branlant et cave,
Un front tout renfrogné, tout le visage hâve,
Ahane dans son lit, et marmotte tout seul
Comme un esprit qu’on oit parler dans un linceul;
Grimace par la rue et stupide retarde
Ses yeux sur un objet sans voir ce qu’il regarde.
Mais déjà ce discours m’a porté trop avant,
Je suis bien près du port, ma voile a trop de vent;
D’une insensible ardeur peu à peu je m’élève,
Commençant un discours que jamais je n’achève.
Je ne veux point unir le fil de mon sujet,
Diversement je laisse et reprends mon objet,
Mon âme imaginant n’a point la patience
De bien polir les vers et ranger la science:
La règle me déplaît, j’écris confusément;
Un bon esprit ne fait rien qu’aisément.
Autrefois, quand mes vers ont animé la scène,
L’ordre où j’étais contraint m’a bien fait de la peine.
Ce travail importun m’a longtemps martyré,
Mais enfin, grâce aux dieux, je m’en suis retiré.
Peu sans faire naufrage et sans perdre leur Ourse,
Se sont aventurés à cette longue course.
Il y faut par miracle être fol sagement,
Confondre la mémoire avec le jugement,
Imaginer beaucoup et d’une source pleine
Puiser toujours des vers dans une même veine:
Le dessein se dissipe, on change de propos
Quand le style a goûté tant soit peu le repos.
Donnant à tels efforts ma première furie
Jamais ma veine encor ne s’y trouva tarie.
Mais il me faut résoudre à ne la plus presser:
Elle m’a bien servi, je la veux caresser,
Lui donner du relâche, entretenir la flamme
Qui de sa jeune ardeur m’échauffe encore l’âme.
Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints,
Promener mon esprit par de petits desseins,
Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise,
Méditer à loisir, rêver tout à mon aise,
Employer tout une heure à me mirer dans l’eau,
Ouïr comme en songeant la course d’un ruisseau,
Ecrire dans les bois, m’interrompre, me taire,
Composer un quatrain sans songer à le faire.
Après m’être égayé par cette douce erreur,
Je veux qu’un grand dessein réchauffe ma fureur,
Qu’un œuvre de dix ans me tienne à la contrainte
De quelque beau poème où vous serez dépeinte.
Là, si mes volontés ne manquent de pouvoir,
J’aurai bien de la peine en ce plaisant devoir.
En si haute entreprise où mon esprit s’engage,
Il faudrait inventer quelque nouveau langage,
Prendre un esprit nouveau, penser et dire mieux
Que n’ont jamais pensé les hommes et les dieux.
Si je parviens au but où mon dessein m’appelle,
Mes vers se moqueront des ouvrages d’Apelle;
Qu’Hélène ressuscite, elle aussi rougira
Partout où votre nom dans mon ouvrage ira.
Tandis que je remets mon esprit à l’école,
Obligé dès longtemps à vous tenir parole,
Voici de mes écrits ce que mon souvenir,
Désireux de vous plaire, en a pu retenir.
Lettre de Théophile à son frère
Mon frère, mon dernier appui,
Toi seul dont le secours me dure
Et toi qui seul trouves aujourd’hui
Mon adversité longue et dure,
Ami ferme, ardent, généreux,
Que mon sort le plus malheureux
Pique d’aventure à le suivre,
Achève de me secourir:
Il faudra qu’on me laisse vivre
Après m’avoir fait tant mourir.
Quand les dangers où Dieu m’a mis
Verront mon espérance morte,
Quand mes juges et mes amis
T’auront tous refusé la porte,
Quand tu seras las de prier,
Quand tu seras las de crier,
Ayant bien balancé ma tête
Entre mon salut et ma mort,
Il faut enfin que la tempête
M’ouvre le sépulcre ou le port.
Mais l’heure, qui la peut savoir!
Nos malheurs ont certaines courses
Et des flots dont on ne peut voir
Ni les limites ni les sources.
Dieu seul connaît ce changement;
Car l’esprit ni le jugement
Dont nous a pourvus la nature,
Quoique l’on veuille présumer
N’entend non plus notre aventure
Que le secret flux de la mer.
Je sais bien que tous les vivants,
Eussent-ils juré ma ruine,
N’aideront point mes poursuivants
Malgré la volonté divine.
Tous leurs efforts sans son aveu
Ne sauraient m’ôter un cheveu.
Si le Ciel ne les autorise
Ils nous menacent seulement;
Eux ni nous de leur entreprise
Ne savons pas l’événement.
Cependant je suis abattu,
Mon courage se laisse mordre,
Et d’heure en heure ma vertu
Laisse tous mes sens en désordre.
La raison avec ses discours
Au lieu de me donner secours
Est importune à ma faiblesse,
Et les pointes de la douleur,
Même alors que rien ne me blesse,
Me changent et voix et couleur.
Mon sens noirci d’un long effroi
Ne se plaît qu’en ce qui l’attriste,
Et le seul désespoir chez moi
Ne trouve rien qui lui résiste.
La nuit mon somme interrompu,
Tiré d’un sang tout corrompu,
Me met tant de frayeurs dans l’âme
Que je n’ose bouger mes bras
De peur de trouver de la flamme
Et des serpents parmi mes draps.
Au matin mon premier objet
C’est la colère insatiable
Et le long et cruel projet
Dont m’attaquent les fils du Diable;
Et peut-être ces noirs Lutins
Que la haine de mes destins
A trouvé si prompts à me nuire,
Vaincus par des démons meilleurs,
Perdent le soin de me détruire
Et soufflent leur tempête ailleurs.
Peut-être, comme les voleurs
Sont quelquefois lassés de crimes,
Les ministres de mes malheurs
Sont las de déchiffrer mes rimes;
Quelque reste d’humanité,
Voyant l’injuste impunité
Dont on flatte la calomnie,
Peut-être leur bat dans le sein
Et s’oppose à leur félonie
Dans un si barbare dessein.
Mais quand il faudrait que le Ciel
Mêlât sa foudre à leur bruine,
Et qu’ils auraient autant de fiel
Qu’il leur en faut pour ma ruine,
Attendant ce fatal succès
Pourquoi tant de fiévreux accès
Me feront-ils pâlir la face,
Et si souvent hors de propos,
Avecque des sueurs de glace,
Me troubleront-ils le repos ?
Quoique l’implacable courroux
D’une si puissante partie
Fasse gronder trente verrous
Contre l’espoir de ma sortie,
Et que ton ardente amitié
Par tous les soins de la pitié
Que te peut fournir la nature
Te rende en vain si diligent
Et ne donne qu’à l’aventure
Tes pas, tes écrits et ton argent,
J’espère toutefois au Ciel:
Il fit que ce troupeau farouche
Tout prêt à dévorer Daniel
Ne trouva ni griffe ni bouche.
C’est le même qui fit jadis
Descendre un air de Paradis
Dans l’air brûlant de la fournaise
Où les saints parmi les chaleurs
Ne sentirent non plus la braise
Que s’ils eussent foulé des fleurs.
Mon Dieu, mon souverain recours
Peut s’opposer à mes misères,
Car ses bras ne sont pas plus courts
Qu’ils étaient au temps de nos pères.
Pour être si prêt à mourir
Dieu ne me peut pas moins guérir:
C’est des afflictions extrêmes
Qu’il tire la prospérité,
Comme les fortunes suprêmes
Souvent le trouvent irrité.
Tel de qui l’orgueilleux destin
Brave la misère et l’envie,
N’a peut-être plus qu’un matin
Ni de volupté ni de vie.
La Fortune qui n’a point d’yeux,
Devant tous les flambeaux des cieux
Nous peut porter dans une fosse;
Elle va haut, mais que sait-on
S’il fait plus sûr dans son carrosse
Que dans celui de Phaéton?
Le plus brave de tous les rois
Dressant un appareil de guerre
Qui devait imposer des lois
A tous les peuples de la terre,
Entre les bras de ses sujets,
Assuré de tous les objets
Comme de ses meilleurs gardes,
Se vit frapper mortellement
D’un coup à qui cent hallebardes
Prenaient garde inutilement.
En quelle plage des mortels
Ne peut le vent crever la terre?
En quel palais et quels autels
Ne se peut glisser le tonnerre?
Quels vaisseaux et quels matelots
Sont toujours assurés des flots?
Quelquefois des villes entières
Par un horrible changement
Ont rencontré leurs cimetières
En la place du fondement.
Le sort qui va toujours de nuit,
Enivré d’orgueil et de joie,
Quoiqu’il soit sagement conduit
Garde malaisément sa voie.
Ah! que les souverains décrets
Ont toujours demeuré secrets
A la subtilité de l’homme!
Dieu seul connaît l’état humain:
Il sait ce qu’aujourd’hui nous sommes,
Et ce que nous serons demain.
Or selon l’ordinaire cours
Qu’il fait observer à nature,
L’astre qui préside à mes jours
S’en va changer mon aventure.
Mes yeux sont épuisés de pleurs,
Mes esprits, usés des malheurs,
Vivent d’un sang gelé de craintes.
La nuit trouve enfin la clarté,
Et l’excès de tant de contraintes
Me présage ma liberté.
Quelque lac qui me soit tendu
Par de si subtils adversaires,
Encore n’ai-je point perdu
L’espérance de voir Boussères;
Encore un coup le dieu du jour
Tout devant moi fera sa cour
Aux rives de notre héritage,
Et je verrai ses cheveux blonds
Du même or qui luit sur le Tage
Dorer l’argent de nos sablons.
Je verrai ces bois verdissants
Où nos îles et l’herbe fraîche
Servent aux troupeaux mugissants
Et de promenoir et de crèche;
L’Aurore y trouve à son retour
L’herbe qu’ils ont mangé le jour;
Je verrai l’eau qui les abreuve
Et j’orrai plaindre les graviers
Et répartir l’écho du fleuve
Aux injures des mariniers.
Le pêcheur en se morfondant
Passe la nuit dans ce rivage
Qu’il croît être plus abondant
Que les bords de la mer sauvage;
Il vend si peu ce qu’il a pris
Qu’un teston est souvent le prix
Dont il laisse vider sa nasse,
Et la quantité du poisson
Déchire parfois la tirasse
Et n’en paye pas la façon.
S’il plaît à la bonté des cieux
Encore une fois à ma vie
Je paîtrai ma dent et mes yeux
Du rouge éclat de la pavie;
Encore ce brugnon muscat
Dont le pourpre est plus délicat
Que le teint uni de Caliste,
Me fera d’un oeil ménager
Etudier dessus la piste
Qui me l’est venu ravager.
Je cueillerai ces abricots,
Les fraises à couleur de flammes
Où nos bergers font des écots
Qui seraient ici bons aux dames,
Et ces figues et ces melons
Dont la bouche des aquilons
N’a jamais su baiser l’écorce,
Et ces jaunes muscats si chers
Que jamais la grêle ne force
Dans l’asile de nos rochers.
Je verrai sur nos grenadiers
Leurs rouges pommes entrouvertes,
Où le ciel comme à ses lauriers
Garde toujours des feuilles vertes;
Je verrai ce touffu jasmin
Qui fait ombre à tout le chemin
D’une assez spacieuse allée,
Et la parfume d’une fleur
Qui conserve dans la gelée
Son odorat et sa couleur.
Je reverrai fleurir nos prés,
Je leur verrai couper les herbes;
Je verrai quelque temps après
Le paysan couché sur les gerbes;
Et comme ce climat divin
Nous est très libéral de vin,
Après avoir rempli la grange
Je verrai du matin au soir
Comme les flots de la vendange
Ecumeront dans le pressoir.
Là d’un esprit laborieux
L’infatigable Bellegarde,
De la voix, des mains et des yeux
A tout le revenu prend garde.
Il connaît d’un exact soin
Ce que les prés rendent de foin,
Ce que nos troupeaux ont de laines,
Et sait mieux que les vieux paysans
Ce que la montagne et la plaine
Nous peuvent donner tous les ans.
Nous cueillerons tout à moitié
Comme nous avons fait encore,
Ignorants de l’inimitié
Dont une race se dévore;
Et frères et sœurs et neveux,
De mêmes soins, de mêmes vœux
Flattant une si douce terre,
Nous y trouverons trop de quoi,
Y dût l’orage de la guerre
Ramener le canon du Roi.
Si je passais dans ce loisir
Encore autant que j’ai de vie,
Le comble d’un si cher plaisir
Bornerait tout mon envie.
Il faut qu’un jour ma liberté
Se lâche en cette volupté;
Je n’ai plus de regret au Louvre.
Ayant vécu dans ces douceurs,
Que la même terre me couvre
Qui couvre mes prédécesseurs.
Ce sont les droits que mon pays
A mérités de ma naissance,
Et mon sort les aurait trahis
Si la mort m’arrivait en France.
Non, non, quelque cruel complot
Qui de la Garonne et du Lot
Veuille éloigner ma sépulture,
Je ne dois point en autre lieu
Rendre mon corps à la nature,
Ni résigner mon âme à Dieu.
L’espérance ne confond point;
Mes maux ont trop de véhémence,
Mes travaux sont au dernier point,
Il faut que mon repos commence.
Quelle vengeance n’a point pris
Le plus fier de tous ces esprits
Qui s’irritent de ma constance!
Ils m’ont vu lâchement soumis
Contrefaire une repentance
De ce que je n’ai point commis.
Ah! que les cris d’un innocent,
Quelques longs maux qui les exercent,
Trouvent malaisément l’accent
Dont ces âmes de fer se percent!
Leur rage dure un an sur moi
Sans trouver ni raison ni loi
Qui l’apaise ou qui lui résiste;
Le plus juste et le plus chrétien
Croit que sa charité m’assiste
Si sa haine ne me fait rien.
L’énorme suite de malheurs!
Dois-je donc aux races meurtrières
Tant de fièvres et tant de pleurs,
Tant de respects, tant de prières,
Pour passer mes nuits sans sommeil,
Sans feu, sans air et sans Soleil,
Et pour mordre ici les murailles?
N’ai-je encore souffert qu’en vain?
Me dois-je arracher les entrailles
Pour soûler leur dernière faim?
Parjures infracteurs des lois,
Corrupteurs des plus belles âmes,
Effroyables meurtriers des rois,
Ouvriers de couteaux et de flammes,
Pâles prophètes de tombeaux,
Fantômes, loup-garoux, corbeaux,
Horrible et venimeuse engeance:
Malgré vous, race des enfers,
A la fin j’aurai la vengeance
De l’injuste affront de mes fers.
Derechef, mon dernier appui,
Toi seul dont le secours me dure
Et qui seul trouves aujourd’hui
Mon adversité longue et dure,
Rare frère, ami généreux,
Que mon sort le plus malheureux
Pique davantage à le suivre,
Achève de me secourir:
Il faudra qu’on me laisse vivre
Après m’avoir fait tant mourir.
Les Nautonniers (Entrée de Ballet)
LES Amours plus mignards à nos rames se lient ;
Les Tritons à l'envi nous viennent caresser;
Les vents sont modérés, les vagues s'humilient
Par tous les lieux de l'onde où nous voulons passer.
Avec notre dessein va le cours des étoiles;
L'orage ne fait point blêmir nos matelots ;
Et jamais alcyon sans regarder nos voiles
Ne commit sa nichée à la merci des flots.
Notre Océan est doux comme les eaux d'Euphrate;
Le Pactole, le Tage, est moins riche que lui ;
Ici, jamais rocher ne craignit le pirate.
Ni d'un calme trop long ne ressentit l'ennui.
Sous un climat heureux, loin du bruit du tonnerre,
Nous passons a loisir nos jours délicieux.
Et, la, jamais notre œil ne désira la terre.
Ni sans quelque dédain ne regarda les cieux.
Agréables beautés, pour qui l'amour soupire.
Eprouvez avec nous un si joyeux destin,
Et nous dirons partout qu'un si rare navire
Ne fut jamais chargé d'un si rare butin.
Apollon Champion
MOI de qui les rayons font les traits du tonnerre
Et de qui l'univers adore les autels,
Moi dont les plus grands dieux redouteraient la guerre,
Puis-je, sans déshonneur, me prendre à des mortels ?
J'attaque malgré moi leur orgueilleuse envie ;
Leur audace a vaincu ma nature et le sort;
Car ma vertu, qui n'est que de donner la vie.
Est aujourd'hui forcée à leur donner la mort.
J'affranchis mes autels de ces fâcheux obstacles,
Et, foulant ces brigands que mes traits vont punir.
Chacun dorénavant viendra vers mes oracles,
Et préviendra le mal qui lui peut advenir.
C'est moi qui, pénétrant la dureté des arbres,
Arrache de leur cœur une savante voix.
Qui fais taire les vents, qui fais parler les marbres.
Et qui trace au destin la conduite des rois.
C'est moi dont la chaleur donne la vie aux roses
Et fait ressusciter les fruits ensevelis;
Je donne la durée et la couleur aux choses.
Et fais vivre l'éclat de la blancheur des lis.
Si peu que je m'absente, un manteau de ténèbres
Tient d'une froide horreur ciel et terre couverts;
Les vergers les plus beaux sont des objets funèbres ;
Et quand mon œil est clos, tout meurt en l'univers.
La pénitence de Théophile
Aujourd’hui que les courtisans,
Les bourgeois et les artisans,
Et les peuples de la campagne,
Pour noyer les soins du trépas
Passent les excès d’Allemagne
Dans leur voluptueux repas,
Que le jeu, la danse et l’amour
Occupent la nuit et le jour
Des enfants de la douce vie,
Que le cœur le plus débauché
Contente la plus molle envie
Que lui fournisse le péché,
Que les plus modestes désirs
Ne respirent que les plaisirs,
Que les luths par toute la terre
Ont fait taire les pistolets,
Et cacher les dieux de la guerre
Dans la machine des ballets,
Mon jeu, ma danse et mon festin
Se font avec saint Augustin,
Dont l’aimable et sainte lecture
Est ici mon contrepoison
En la misérable aventure
Des longs ennuis de ma prison.
Celui qui d’un pieux devoir
Employa l’absolu pouvoir
A borner ici mon étude,
L’envoya pour m’entretenir
Dans cette étroite solitude
Dont il voulut me retenir.
Parmi le céleste entretien
D’un si beau livre et si chrétien,
Je me mêle à la voix des anges,
Et transporté de cet honneur,
Mon esprit donne des louanges
A qui m’a causé ce bonheur.
Je vois dans ces divins écrits
Que l’orgueil des plus grands esprits
Ne sert au sien que de trophée,
Et que la sotte Antiquité
Soupire et languit étouffée
Sous le joug de la vérité.
Tous ces démons du temps passé
Dont il a vivement tracé
Les larcins et les adultères,
Sont moins que fantômes de nuit
Devant les glorieux mystères
Du grand Soleil qui nous reluit.
Tous ces grands temples si vantés
Dont tant de siècles enchantés
Ont suivi les fameux oracles,
N’ont plus de renom ni de lieu,
Et désormais tous les miracles
Se font en la Cité de Dieu.
Grande lumière de la foi,
Qui me donnez si bien de quoi
Me consoler dans les ténèbres,
Mon désespoir le plus mordant
Et mes soucis les plus funèbres
Se calment en te regardant.
Je ne te puis lire si peu
Qu’aussitôt un céleste feu
Ne me perce au profond de l’âme,
Et que mes sens faits plus chrétiens
Ne gardent beaucoup de la flamme
Que me font éclater les tiens.
Je maudis mes jours débauchés,
Et dans l’horreur de mes péchés,
Bénissant mille fois l’orage
Qui m’en donne le repentir,
Je trouve encore en mon courage
Quelque espoir de me garantir.
Cet espoir prend à son secours
Le souvenir de tant de jours
Dont la jeune et grande licence
Eut besoin des confessions
Qui cherchèrent de l’innocence
Pour tes premières actions.
Grand Saint, pardonne à ce captif
Qui d’un emprunt lâche et furtif,
Porte ici ton divin exemple:
Pressé d’un accident mortel
J’entre tout sanglant dans le temple
Et me sers du droit de l’autel.
Alors que mes yeux indiscrets
Ont trop percé dans tes secrets,
Jésus m’a mis dans la pensée
Qu’il se fit ouvrir le côté,
Et que sa veine fut percée
Pour laver notre iniquité.
Esprit heureux, puisqu’aujourd’hui
Tu contemples avecque lui
Les félicités éternelles,
Et que tu me vois empêché
Des affections criminelles
De l’objet mortel du péché,
Jette un peu l’oeil sur ma prison,
Et portant de ton oraison
La faiblesse de ma prière,
Gagne pour moi son amitié,
Et me rends la digne matière
Des mouvements de sa pitié.
Je confesse que justement
Un si rude et si long tourment
Voit tarder sa miséricorde,
Mais ni ma plume ni ma voix
N’ont jamais rien fait que n’accorde
La douceur des humaines lois.
Et puisque Dieu m’a tant aimé
Que d’avoir ici renfermé
Les pauvres Muses étonnées
Sous les ailes du Parlement,
Les méchants perdront leurs journées
A me creuser le monument.
Augustin, ouvre ici tes yeux:
Je proteste devant les Cieux,
La main dans les feuillets du livre
Où tu m’as attaché les sens,
Qu’il faut pour m’empêcher de vivre
Faire mourir les innocents.
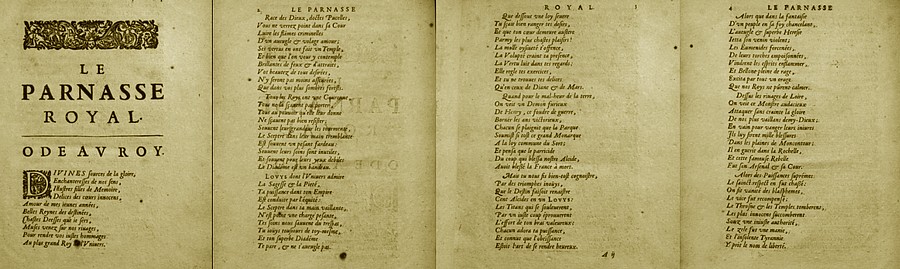

François de Boisrobert (1592-1662)
Fils d'un homme de loi normand et huguenot, François Le Métel de Boisrobert vint à Paris en 1616, et plutôt que de faire profession d'avocat et s'insinue comme poète dans les bonnes grâces de la reine mère Marie de Médicis. Il se convertit au catholicisme en 1621 et fut tonsuré en 1623. Il collabore avec Théophile de Viau, Saint-Amant et Charles Sorel, au livret du ballet des Bacchanales, représenté au Louvre le 26 février 1623. Son esprit et son effronterie lui valent la faveur du cardinal de Richelieu, et, après avoir visité l'Angleterre (1625-1626), avoir trouvé le moyen d'appartenir à la suite d'Henriette de France lors de son mariage avec Charles 1er d'Angleterre, mais s'être fait un ennemi de Lord Holland, puis visité Rome (1630-1631), il entra dans les ordres et reçut le bénéfice d'un canonicat à Rouen (1634), puis d'une abbaye en Bourgogne (1638). Entre-temps, il avait publié une paraphrase des Psaumes (1627), un roman, Histoire indienne d'Anaxandre et d'Orazie (1627) et une tragi-comédie, "Pyrandre et Lysimène, ou l'heureuse tromperie" (1633), ainsi que des anthologies des poèmes faisant l'éloge du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu (1634-1635). L'influence de Boisrobert sur Richelieu encouragea celui-ci à fonder l'Académie française ; il en fut l'un des premiers membres (1634). Il fut de même le promoteur du "Parnasse royal , où les immortelles actions du très-chrestien et très-victorieux monarque Louis XIII sont publiées par les plus célèbres esprits de ce temps" (1635) : le "Parnasse Satyrique" publié en 1622, celui des pièces licencieuses et bouffonnes qui contribuèrent à la condamnation de Théophile de Viau, laisse place, dix ans plus tard, au Parnasse de bel esprit glorifiant l'autorité royale...
Sous le régime qui suivit, les traits d'esprit de Boisrobert ne furent guère du goût de Mazarin, et il se tint assez éloigné de la cour. Aussi consacra-t-il surtout les vingt dernières années de sa vie à la dramaturgie. Ses dix-huit pièces, tragi-comédies pour la plupart, sont bien oubliées (Cassandre, comtesse de Barcelone, 1654, La Belle Plaideuse, 1655, Les coups d'amour et de fortune ou L'heureux infortuné, 1656) et n'intéressent plus guère que les spécialistes du théâtre français au XVIIe siècle.

Marc-Antoine de Saint-Amant (1594-1661)
Marc Antoine Girard, «sieur de Saint-Amant» naît à Quevilly près de Rouen, dans une famille de marins et marchands protestants. Son frère court l’aventure à Java. Son père qui a navigué, devient armateur et possède des intérêts commerciaux dans une fabrique de verre. Tour à tour, marin, soldat, diplomate, il reçoit une éducation solide et se flatte de n’avoir pas appris les langues anciennes. Mais il brille particulièrement dans la pratique des langues étrangères: l’italien, l’espagnol et l’anglais. Il s’intéresse aux sciences (il rencontra Peiresc, Galilée et Campanella) et à la philosophie à la peinture et à la musique; il jouira d’une belle réputation de joueur de luth. Dès son adolescence, on l’embarque, probablement sur un navire négrier faisant le commerce triangulaire. Il fit alors des voyages «tant en l'Europe qu'en l'Afrique et qu'en Amérique»; il touche les côtes d’Afrique noire, les Canaries (L'automne des Canaries, "Voici les seuls coteaux, voici les seuls vallons Où Bacchus et Pomone ont établi leur gloire"), qu’il chantera dans un sonnet, les Indes occidentales. Il participe aussi à de nombreuses expéditions militaires en Italie, en Angleterre et en Espagne. En 1617, il suit le duc de Retz à Belle-Isle, où le paysage terrestre et marin lui inspire son premier poème, "La Solitude" (1617), au lyrisme décalé pour l'époque...
(1617) - La Solitude
O que j’ayme la solitude !
Que ces lieux sacrez à la nuit,
Esloignez du monde et du bruit,
Plaisent à mon inquietude !
Mon Dieu ! que mes yeux sont contens
De voir ces bois, qui se trouverent
A la nativité du temps,
Et que tous les siècles reverent,
Estre encore aussi beaux et vers,
Qu’aux premiers jours de l’univers !
Un gay zephire les caresse
D’un mouvement doux et flatteur.
Rien que leur extresme hauteur
Ne fait remarquer leur vieillesse.
Jadis Pan et ses demi-dieux
Y vinrent chercher du refuge,
Quand Jupiter ouvrit les cieux
Pour nous envoyer le deluge,
Et, se sauvans sur leurs rameaux,
A peine virent-ils les eaux.
Que sur cette espine fleurie
Dont le printemps est amoureux,
Philomele, au chant langoureux,
Entretient bien ma resverie!
Que je prens de plaisir à voir
Ces monts pendans en precipices,
Qui, pour les coups du desespoir,
Sont aux malheureux si propices,
Quand la cruauté de leur sort,
Les force a rechercher la mort !
Que je trouve doux le ravage
De ces fiers torrens vagabonds,
Qui se precipitent par bonds
Dans ce valon vert et sauvage !
Puis, glissant sour les arbrisseaux,
Ainsi que des serpens sur l’herbe,
Se changent en plaisans ruisseaux,
Où quelque Naïade superbe
Regne comme en son lict natal,
Dessus un throsne de christal !
Que j’ayme ce marets paisible !
Il est tout bordé d’aliziers,
D’aulnes, de saules et d’oziers,
À qui le fer n’est point nuisible.
Les nymphes, y cherchans le frais,
S’y viennent fournir de quenouilles,
De pipeaux, de joncs et de glais ;
Où l’on voit sauter les grenouilles,
Qui de frayeur s’y vont cacher
Si tost qu’on veut s’en approcher.
Là, cent mille oyseaux aquatiques
Vivent, sand craindre, en leur repos,
Le giboyeur fin et dispos,
Avec ses mortelles pratiques.
L’un tout joyeux d’un si beau jour,
S’amuse à becqueter sa plume ;
L’autre allentit le feu d’amour
Qui dans l’eau mesme se consume,
Et prennent tous innocemment
Leur plaisir en cet élement.
Jamais l’esté ny la froidure
N’ont veu passer dessus cette eau
Nulle charrette ny batteau,
Depuis que l’un et l’autre dure ;
Jamais voyageur alteré
N’y fit servir sa main de tasse ;
Jamais chevreuil desesperé
N’y finit sa vie à la chasse ;
Et jamais le traistre hameçon
N’en fit sortir aucun poisson.
Que j’ayme à voir la décadence
De ces vieux chasteaux ruinez,
Contre qui les ans mutinez
Ont deployé leur insolence !
Les sorciers y font leur savat ;
Les demons follets y retirent,
Qui d’un malicieux ébat
Trompent nos sens et nous martirent ;
Là se nichent en mille troux
Les couleuvres et les hyboux.
L’orfraye, avec ses cris funebres,
Mortels augures des destins,
Fait rire et dancer les lutins
Dans ces lieux remplis de tenebres.
Sous un chevron de bois maudit
Y branle le squelette horrible
D’un pauvre amant qui se pendit
Pour une bergère insensible,
Qui d’un seul regard de pitié
Ne daigna voir son amitié.
Aussi le Ciel, juge équitable,
Qui maintient les loix en vigueur,
Prononça contre sa rigueur
Une sentence epouvantable :
Autour de ces vieux ossemens
Son ombre, aux peines condamnée,
Lamente en longs gemissemens
Sa malheureuse destinée,
Ayant, pour croistre son effroy,
Tousjours son crime devant soy.
Là se trouvent sur quelques marbres
Des devises du temps passé ;
Icy l’âge a presque effacé
Des chiffres taillex sur les arbres ;
Le plancher du lieu le plus haut
Est tombé jusques dans la cave,
Que la limace et le crapaud
Souillent de venin et de bave ;
Le lierre y croist au foyer,
A l’ombrage d’un grand noyer.
Là dessous s’estend une voûte
Si sombre en un certain endroit,
Que, quand Phebus y descendroit,
Je pense qu’il n’y verrroit goutte ;
Le Sommeil aux pesans sourcis,
Enchanté d’un morne silence,
Y dort, bien loing de tous soucis,
Dans les bras de la Nonchalence,
Laschement couché sur le dos
Dessus des gerbes de pavots.
Au creux de cette grotte fresche,
Où l’Amour se pourroit geler,
Echo ne cesse de brusler
Pour son amant froid et revesche,
Je m’y coule sans faire bruit,
Et par la celeste harmonie
D’un doux lut, aux charmes instruit,
Je flatte sa triste manie
Faisant repeter mes accords
A la voix qui luy sert de corps.
Tantost, sortant de ces ruines,
Je monte au haut de ce rocher,
Dont le sommet semble chercher
En quel lieu se font les bruïnes ;
Puis je descends tout à loisir,
Sous une falaise escarpée,
D’où je regarde avec plaisir
L’onde qui l’a presque sappée
Jusqu’au siege de Palemon,
Fait d’esponges et de limon.
Que c’est une chose agreable
D’estre sur le bord de la mer,
Quand elle vient à se calmer
Après quelque orage effroyable !
Et que les chevelus Tritons,
Hauts, sur les vagues secouées,
Frapent les airs d’estranges tons
Avec leurs trompes enrouées,
Dont l’eclat rend respectueux
Les vents les plus impetueux.
Tantost l’onde brouillant l’arène,
Murmure et fremit de courroux
Se roullant dessus les cailloux
Qu’elle apporte et qu’elle r’entraine.
Tantost, elle estale en ses bords,
Que l’ire de Neptune outrage,
Des gens noyex, des monstres morts,
Des vaisseaux brisez du naufrage,
Des diamans, de l’ambre gris,
Et mille autres choses de prix.
Tantost, la plus claire du monde,
Elle semble un miroir flottant,
Et nous represente à l’instant
Encore d’autres cieux sous l’onde.
Le soleil s’y fait si bien voir,
Y contemplant son beau visage,
Qu’on est quelque temps à savoir
Si c’est luy-mesme, ou son image,
Et d’abord il semble à nos yeux
Qu’il s’est laissé tomber des cieux.
Bernières, pour qui je me vante
De ne rien faire que de beau,
Reçoy ce fantasque tableau
Fait d’une peinture vivante,
Je ne cherche che les deserts,
Où, resvant tout seul, je m’amuse
A des discours assez diserts
De mon genie avec la muse ;
Mais mon plus aymable entretien
C’est le ressouvenir du tien.
Tu vois dans cette poesie
Pleine de licence et d’ardeur
Les beaux rayons de la splendeur
Qui m’esclaire la fantaisie :
Tantost chagrin, tantost joyeux
Selon que la fureur m’enflame,
Et que l’objet s’offre à mes yeux,
Les propos me naissent en l’ame,
Sans contraindre la liberté
Du demon qui m’a transporté.
O que j’ayme la solitude !
C’est l’element des bons esprits,
C’est par elle que j’ay compris
L’art d’Apollon sans nulle estude.
Je l’ayme pour l’amour de toy,
Connaissant que ton humeur l’ayme
Mais quand je pense bien à moy,
Je la hay pour la raison mesme
Car elle pourroit me ravir
L’heur de te voir et te servir.
Puis il séjourne à Paris, se lie avec Boisrobert, Faret, Théophile. Après diverses campagnes, il participe à l'expédition du comte d'Harcourt qui, partie de l'île de Ré, va reprendre les îles de Lérins aux Espagnols : c'est pour lui l'occasion d'écríre "Le Passage de Gibraltar", un « caprice héroî-comique ». Puis, toujours avec d°Harcourt, va se battre en Piémont (1637). Protestant de naissance, il se convertit au catholicisme, par précaution peut-être, car il se montre fort libre et même libertin dans ses œuvres. Pourtant dans ses dernières années, poète attitré du duc de Liancourt, il exprime une piété qui semble sincère. Il meurt en 1661....
Homme d'action et de voyages, Saint-Amant élargit considérablement le domaine de la poésie. Seul Blaise Cendrars peut-être a conçu ainsi la poésie comme la somme des impressions, des expériences et des curiosités d'une vie d'aventures. Les titres de ses poèmes sont éloquents : Le Passage de Gibraltar, l'Eté de Rome, l'Automne des Canaries, l'Hyver des Alpes, Sonnet sur Amsterdam, la Vistule sollicitée. Narration de campagnes ou de traversées ou même de simples promenades au bord de la mer, description de paysages, de régions étranges, d'hommes extraordinaires, natures mortes (melon, fromage, cidre, fumée de sa pipe), sa poésie est aussi riche et variée que la vie même, tantôt héroïque ou dangereuse, tantôt simple et rustique, toujours spontanée et sincère. Il a laissé trois volumes de poésies et un poème héroïque, Moïse ; ses Stances à Corneille sur son Imitation de Jésus-Christ sont les derniers et les meilleurs vers qu’il ait publiés.
L'été de Rome...
Quelle étrange chaleur nous vient ici brûler?
Sommes-nous transportés sous la zone torride,
Ou quelque autre imprudent a-t-il lâché la bride
Aux lumineux chevaux qu”on voit étinceler?
La terre, en ce climat, contrainte à panteler,
Sous Pardeur des rayons s'entre-fend et se ride ;
Et tout le champ romain n'est plus qu'un sable aride
D”où nulle fraîche humeur ne se peut exhaler.
Les furieux regards de l'âpre canicule
Forcent même le Tibre à périr comme Hercule,
Dessous l'ombrage sec des joncs et des roseaux.
Sa qualité de dieu ne l'en saurait défendre,
Et le vase natal d'où s'écoulent ses eaux
Sera l'urne funeste où l'on mettra sa cendre.
Ainsi, dans "le Contemplateur", il passe de l'observation de la mer à une rêverie philosophique et religieuse, du tir au cormoran à l'angoisse métaphysique.
"J'écoute, à demi transporté,
Le bruit des ailes du silence,
Qui vole dans l'obscurité."
La Nuit
Paisible et solitaire Nuit,
Sans Lune et sans Étoiles,
Renferme le Jour qui me nuit
Dans tes plus sombres voiles ;
Hâte tes pas, Déesse exauce-moi,
J’aime une Brune comme toi.
… Ha ! voilà le jour achevé,
Il faut que je m’apprête ;
L’Astre de Vénus est levé
Propice à ma requête ;
Si bien qu’il semble en se montrant si beau
Me vouloir servir de flambeau.
L’artisan las de travailler,
Délaisse son ouvrage ;
Sa femme qui le voit bâiller
En rit en son courage,
Et l’oeilladant s’apprête à recevoir
Les fruits du nuptial devoir.
Les Chats presque enragés d’amour,
Grondent dans les gouttières ;
Les loups-garous fuyant le jour
Hurlent aux Cimetières :
Et les Enfants transis d’être tout seuls,
Couvrent leurs têtes de linceuls.
Le Clochetteur des trépassés
Sonnant de rue en rue,
De frayeur rend leurs coeurs glacés,
Bien que leur corps en sue ;
Et mille Chiens oyant sa triste voix
Lui répondent à longs abois.
Ces tons ensemble confondus,
Font des accords funèbres,
Dont les accents sont épandus
En l’horreur des ténèbres
Que le Silence abandonne à ce bruit
Qui l’épouvante, et le détruit.
… Tous ces vents qui soufflaient si fort
Retiennent leurs haleines,
Il ne pleut plus, la foudre dort,
On n’oit que les fontaines,
Et le doux son de quelques luths charmants
Qui parlent au lieu des Amants.
Je ne puis être découvert,
La Nuit m’est trop fidèle ;
Entrons, je sens l’huis entrouvert,
J’aperçois la chandelle ;
Dieux ! qu’est ceci ? je tremble à chaque pas,
Comme si j’allais au trépas.
Ô toi ! dont l’oeil est mon vainqueur,
Sylvie, eh ! que t’en semble ?
Un homme qui n’a point de coeur
Ne faut-il pas qu’il tremble ?
Je n’en ai point, tu possèdes le mien ?
Me veux-tu pas donner le tien ?
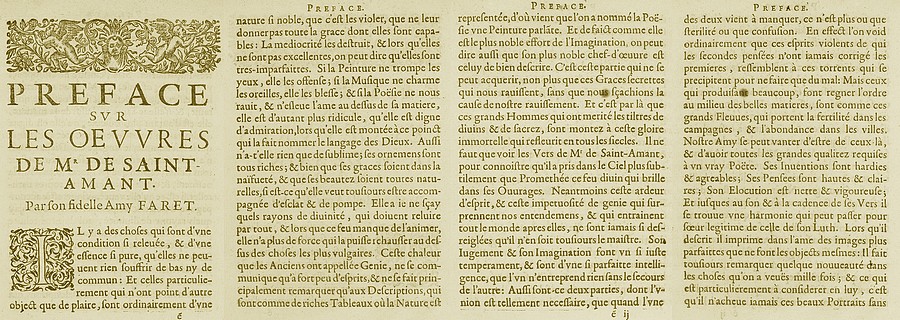
Comme Malherbe et Théophile de Viau, il est résolument moderne. Il prétend ignorer le grec et le latin mais connaît admirablement l'anglais, l'espagnol et l'italien. Il a imité d'ailleurs la poésie descriptive du poète italien Marino. Musicien, savant admirateur de Copernic et de Galilée, il suit sa raison et non une autorité quelconque. Il se distingue de Malherbe, quand il affirme la nécessité pour le poète d'être soi-même et de « suivre sa nature », et son œuvre ne doit rien aux principes de l'Académie, dont il fit pourtant partie, ni au goût des salons mondains.
Sa poésie amoureuse renouvelle la tradition : c'est ainsi qu'aux plaintes de l'amant bafoué s'ajoutent les émotions que suggère à Tircis une nature hostile et inquiétante. C'est un bon vivant, un homme ouvert et gai, un écrivain qui a voulu amuser ses lecteurs avec des oeuvres variées, originales et libres; il est heureux de traiter n'importe quel sujet en une langue toujours vigoureuse, de tirer parti de toutes les richesses du vocabulaire, d'utiliser même les expressions populaires quand elles sont justes et pittoresques. Il évolue avec aisance entre l'héroïque et le trivial, le grandiose et le bouffon, entonne une chanson à boire avant de plonger dans des visions de cauchemars, et de nous confier les terreurs et les angoisses inséparables de la condition humaine. « Ce poète avait assez de génie pour les ouvrages de débauche et de satire outrée, il a même quelquefois des boutades assez heureuses dans le sérieux, mais il gâte tout par les basses circonstances qu’il y mêle. » (Boileau).
Les Visions
Peintre de la réalité multiforme, Saint-Amant a voulu aussi traduire l'indicible, à partir d'un évènement net et concret ...
Le coeur plein d’amertume et l’âme ensevelie
Dans la plus sombre humeur de la mélancolie,
Damon, je te décris mes travaux intestins,
Où tu verras l’effort des plus cruels destins
Qui troublèrent jamais un pauvre misérable,
À qui le seul trépas doit être désirable.
Un grand chien maigre et noir, se traînant lentement,
Accompagné d’horreur et d’épouvantement,
S’en vient toutes les nuits hurler devant ma porte,
Redoublant ses abois d’une effroyable sorte.
Mes voisins, éperdus à ce triste réveil,
N’osent ni ne sauraient rappeler le sommeil ;
Et chacun, le prenant pour un sinistre augure,
Dit avec des soupirs tout ce qu’il s’en figure.
Moi, qu’un sort rigoureux outrage à tout propos
Et qui ne puis goûter ni plaisir ni repos,
Les cheveux hérissés, j’entre en des rêveries
De contes de sorciers, de sabbats, de furies ;
J’erre dans les enfers, je rôde dans les cieux ;
L’âme de mon aïeul se présente à mes yeux ;
Ce fantôme léger, coiffé d’un vieux suaire
Et tristement vêtu d’un long drap mortuaire,
À pas affreux et lents s’approche de mon lit ;
Mon sang en est glacé, mon visage en pâlit,
De frayeur mon bonnet sur mes cheveux se dresse,
Je sens sur l’estomac un fardeau qui m’oppresse.
Je voudrais bien crier, mais je l’essaie en vain :
11 me ferme la bouche avec sa froide main,
Puis d’une voix plaintive en l’air évanouie
Me prédit mes malheurs et longtemps, sans ciller,
Murmurant certains mots funestes à l’ouïe,
Me contemple debout contre mon oreiller.
Je vois des feux volants, les oreilles me cornent ;
Bref, mes sens tous confus l’un l’autre se subornent
En la crédulité de mille objets trompeurs
Formés dans le cerveau d’un excès de vapeurs,
Qui, s’étant emparé de notre fantaisie,
La tourne moins de rien en pure frénésie.
…
Voilà donc, cher Damon, comme passe les nuits
Ton pauvre Clidamant, comblé de mille ennuis,
Et toutefois, hélas ! ce ne serait que roses
Si les jours ne m’offraient de plus horribles choses.
Cet astre qu’on réclame avec tant de désirs
Et de qui la venue annonce les plaisirs,
Ce grand flambeau du ciel, ne sort pas tant de l’onde
Pour redonner la grâce et les couleurs au monde,
Avec ses rayons d’or si beaux et si luisants,
Que pour me faire voir des objets déplaisants.
Sa lumière, inutile à mon âme affligée,
La laisse dans l’horreur où la nuit l’a plongée ;
La crainte, le souci, la tristesse et la mort,
En quelque lieu que j’aille, accompagnent mon sort.
Ces grands jardins royaux, ces belles Tuileries,
Au lieu de divertir mes sombres rêveries,
Ne font que les accroître et fournir d’aliment
À l’extrême fureur de mon cruel tourment.
Au plus beau de l’été je n’y sens que froidure,
Je n’y vois que cyprès, encore sans verdure,
Qu’arbres infortunés tout dégouttants de pleurs,
Que vieux houx tout flétris et qu’épines sans fleurs.
L’écho n’y répond plus qu’aux longs cris de l’orfraie
Dont le mur qui gémit en soi-même s’effraie ;
Le lierre tortu qui le tient enlacé,
En frémissant d’horreur, en est tout hérissé,
Semblable en sa posture à ces enfants timides
Qui, le corps tout tremblant et les yeux tout humides,
Embrassent leur nourrice alors que quelque bruit
Les va dedans leur couche épouvanter la nuit.
Si j’y rencontre un cerf, ma triste fantaisie
De la mort d’Actéon est tout soudain saisie ;
Les cygnes qu’on y voit dans un paisible étang
Me semblent des corbeaux qui nagent dans du sang ;
Les plaisants promenoirs de ces longues allées,
Où tant d’afflictions ont été consolées,
Sont autant de chemins à ma tristesse offerts
Pour sortir de la vie et descendre aux enfers.

Tristan L’Hermite (1601-1655)
Né en 1601 dans la Marche, au vieux château de Soliers, où ses ancêtres, bravant la justice du roi, avaient mené une vie de gentilhommes rançonneurs et pillards, L'Hermite (Tristan n'est qu'un surnom) suit leur exemple et mène une vie aventureuse, errant de ville en ville et d'emploi en emploi, une jeunesse errante relatée et romancée dans "Le Page disgracié" (1643), à six ans, Henri IV le donne pour page à son bâtard Henri de Bourbon; quinze ans, ayant dû fuir, à la suite d'une rixe où il y a eu mort d'homme, il est précepteur en Angleterre, se fait aimer de sa jeune élève, est mis en prison, s'évade, passe en Ecosse, puis en Norvège, où il vend "des martres zibelines, des hermines et autres belles fourrures," revient à Londres, rentre en France, perd au jeu l'argent qu'il a rapporté, songe à se rendre à pied en Espagne pour chercher fortune, rencontre en route, à Loudun, le vieux poète Scévole de Sainte-Marthe, un survivant de la Pléiade, qui le prend pour lecteur. Enfin, après bien d'autres traverses, en 1621 où il entre au service de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qu'il suit dans ses exils jusqu'en 1634 à travers toutes les vicissitudes provoquées par les incessants complots de ce prince contre Louis XIII et Richelieu: en 1629, il est en Lorraine, en 1631 à Nancy, l'année suivante en Flandre; en 1634, il est de nouveau en Lorraine, puis il passe en Angleterre, à la cour du roi Charles Ier; à son retour en France, il se lie d'amitié avec la famille des Béjart; de 1640 à 1642, il est de nouveau dans la maison de Gaston d'Orléans comme gentilhomme ordinaire, puis, après avoir été chevalier d'honneur de la duchesse de Chambres, il entre en 1646 dans la maison du duc de Guise; lorsque, en 1648, ce prince est fait prisonnier des Espagnols, au cours d'une expédition en Italie, Tristan, qui se retrouve presque sans ressources, se place sous la protection du chancelier Séguier, qui le fait élire à l'Académie française (1649). Il meurt à Paris, pauvre et désenchanté, regrettant ses années de vaine servitude.
En 1636, quelques mois avant le Cid, Tristan l'Hermite donne sa tragédie "La Mariane", qui balancera le succès du Cid, et qui sera suivie de plusieurs autres, les seules dignes, avec celles de Rotrou, d'être lues et admirées parmi l'immense production dramatique des contemporains de Corneille (Penthée, 1637; La Mort de Sénèque, 1645; La Mort de Chrispe, 1645; une comédie, Le Parasite, 1656). Ce solitaire est aussi un grand poète qui compose une abondante oeuvre lyrique: "Plaintes d'Acante" (1633), "les Amours de Tristan"(1638), "la Lyre" (1641), "Vers héroïques" (1648) en sont les principaux recueils. Chantre de l'amour, il joint au pétrarquisme hérité de la Renaissance, les accents plus sensuels imités de l'italien Marino : "Donnons-nous des baisers sans nombre et joignons à la fois nos lèvres et nos cœurs..."; il aime les "concetti", les périphrases. Homme de rêverie et de solitude, il analyse ses contemplations mélancoliques ou heureuses et possède incontestablement le sentiment de la nature qu'il sait d'ailleurs admirer en artiste et en curieux. C'est ainsi que dans cette dernière strophe de l'ode "la Mer", qu'il écrit au siège de La Rochelle, il s'efforce de décrire les effets pittoresques de la lumière...
"Souvent, de la pointe où je suis,
Lorsque la lumière décline,
J 'aperçois des jours et des nuits
En même endroit de la marine;
C'est lorsqu'enfermé de brouillard
Cet astre lance des regards
Dans un nuage épais et sombre,
Qui, réfléchissant à côté,
Nous fait voir des montagnes d 'ombre
Avec des sources de clarté...."
Tristan a chanté les joies de l'amour et les consolations épicuriennes. Le temps qui emporte toutes les belles choses l'avertit de "faire des bouquets en la saison des roses". Mais il sait aussi les déceptions, les souffrances et le malheur inévitable de la condition humaine, comme dans ce sonnet des "Amours"...
"Venir à la clarté sans force et sans adresse,
Et n'ayant fait longtemps que dormir et manger,
Souffrír mille rigueur d 'un secours étranger,
Pour quitter l'ignorance en quittant la faiblesse;
Après, servir longtemps une ingrate maîtresse,
Qu'on ne peut acquérir, qu'on ne peut obliger,
Ou qui, d'un naturel inconstant et léger,
Donne fort peu de joie et beaucoup de tristesse;
Cabaler dans la cour, puis devenu grison,
Se retirant du bruit, attendre en sa maison
Ce qu'ont nos derniers ans de maux inévitables :
C'est l'heureux sort de l'homme. O misérable sort!
Tous ces attachements sont-ils considérables,
Pour aimer tant la vie, et craindre tant la mort?"
1643 - "Le Page disgracié, ou l'on voit de vifs caractères d'hommes de tous temperamens et de toutes professions", un récit qui prend fin en 1621...
CHAPITRE XXII - L'arrivée du page disgracié à Londres - "Si tost que je fus au logis du Marchand,
dont mon Philosophe m'avoit parlé, et qu'il eust ouvert le billet que je lui portois de cette part, il me fit beaucoup de caresses, et donna ordre qu'on me traitast comme si j'eusse esté quelqu'un des enfans de la maison, Cetuy-cy estoit un homme fort riche, et qui trafiquoit en beaucoup de Provinces éloignées. Il avoit au moins deux ou trois vaisseaux bien équipez. Tout ce qui me fit peine en sa maison, c'est qu'il n'y avoit que luy là dedans qui sceust entendre ma langue, tellement que lors qu'il en estoit sorty pour quelque affaire, je ne sçavois comment demander les choses dont j'avois besoin. Je m'allay plaindre de cette incommodité chez un ordinaire François, où logeoit le Maistre d'Hostel,dont j'avois acquis les bonnes grâces : il y eust là dedans un honneste homme, qui par compassion de la peine où j'estois, me fournit d'un petit livre imprimé à Londres, qui m'enseigna la manière de demander tout ce qui me seroit nécessaire : en moins de rien je le sçeus par cœur, et mesme avec sa naturelle prononciation, à la faveur de quelques valets du logis, qui prirent plaisir à me l'apprendre. Mais cette nouvelle connoissance qui me devoit apporter de la commodité me fut extrême- ment incommode. Ce Marchand avoit un de ses proches parens chez luypour lui servir de facteur dont la femme estoit assez belle, au moins elle étoit blanche,. vermeille et en bon poinct n'ayant au plus que vingt-deux ou vingt-trois ans. Cette femme dont le mary n'estoit nullement bien fait, jetta possible les yeux sur moy pour m'embarquer dans quelque pratique amoureuse ; je m'apperceus qu'elle me regardoit avec de grands yeux, et me lançoit beaucoup de regards à la dérobée, et qu'elle prenoit grand plaisir à m'entendre prononcer les mots que je sçavois de sa langue. Un soir qu'il y avoit peu de gens au logis qui estoient encores occupez à descendre quelques tonnes de marchandise dans une espèce de cave, elle me vint trouver en ma chambre, et comme si j'eusse esté capable de l'entendre, elle me fit un discours avec beaucoup d'émotion, qui dura bien demy quart- d'heure ; je ne sçeus rien répondre à tout cela. Mais elle fit semblant de croire que je me mocquois, et reprit ses discours de plus belle. Enfin, comme elle eust bien lassé ma patience, je luy voulus parler par signes, mais elle se retira soudain, et ne me donna qu'un Gdoboy. Cette femme revint plusieurs fois à ma chambre pour me continuer ses beaux discours, ausquels je n'entendois rien, et ne vouloit point estre interrompue en les faisant, de peur qu'elle avoit que j'en perdisse la suite. Après qu'elle m'eust longtemps importuné de ses douces conversations je ne pouvois comprendre aucune chose, il se présenta une occasion qui finit nostre Comédie. Ce fust qu'un soir son mary revint de la ville après avoir fait grande chère : le boire avec excez, en ce quartier, n'estant pas tenu pour un vice. C'estoit un ouvrage de Bachus auquel il ne restoit plus rien que la parole, encore ne luy estoit-elle pas demeurée bien nette : les continuels hocquets la rendoient mal intelligible, et sa teste estoit si pesante que ses jambes mal asseurées succomboient
souvent sous le faix. Comme c'est la coustume de ceux qui ont trop beu de vouloir encore boire, cet homme ne fust pas plustost entré en son appartement qu'il se fit apporter du vin, et commanda qu'on me fit venir pour luy tenir compagnie à souper. J'y vins et fus présent à ce spectacle désagréable. J'appris là qu'il n'y a rien qui puisse mieux donner de l'horreur du vice que la propre image du vice, et que les Grecs estoient bien sensez qui faisoient enyvrer leurs esclaves devant leurs enfans pour leur imprimer la tempérance. Ce facteur fist à table beaucoup d'actions indécentes, et tesmoigna par ses paroles, et par ses gestes, qu'il ne luy restoit plus rien de cet avantage que nous avons sur les autres animaux. Cependant sa femme n'en faisoit que sousrire : et ne se rendant pas plus sage par cet exemple, prenoit le chemin pour arriver au mesme point. Elle vuida plusieurs une grande tasse de vermeil doré, faite en Navire, et j'eus quelque doute que sa raison ferait naufrage par cette voie. Enfin son mary tomba de la table, et ce fut tout ce que nous peusmes faire, sa femme, deux de ses serviteurs et moy, que de le porter sur son lit. Je m'estois retiré dans ma chambre après lui avoir rendu ce bon office, lors que sa femme me vint tirer par le bras, et sans me donner le loisir de reprendre mon pourpoint, me ramena avec un flambeau dans la ruelle de son lit. Je ne la suivis que par force, et ne sçavois ce qu'elle vouloit de moy, quand elle s'assit sur le bord du lit, et tirant de dessous un grand pot plein de vin, elle m'invita d'en remplir la navire, qui estoit à terre auprès d'elle. Je luy fis beaucoup de signes du peu d'envie que j'avois de boire : mais elle ne se contenta pas de cela, elle remplit la tasse, et me montrant qu'elle alloit boire à ma santé, elle n'en laissa pas une goûte. Puis elle m'equippa le mesme vaisseau, afin que je le conduisisse de pareille sorte; la main luy trembloit si fort en me le présentant, qu'elle respandit une partie du vin qu'elle me vouloit faire boire ; mais j'avois si peu d'amour pour cette liqueur, que je ne me pouvois résoudre à boire le reste. Et comme j'estois en cette peine, et que j'avois desja la tasse à la bouche pour prendre à contre cœur cette médecine, je m'apperceus d'une belle occasion pour m'en exempter ; c'est que l'Angloise tourna la teste du costé qu'estoit son mary, pour voir s'il dormoit profondement. Je pris ce temps avec adresse pour verser doucement le vin sur mon espale, aymant mieux que ma chemise en fust tachée, que mon estomach en fust offensé. Ma Bâchante ne s'apperceut pas de cette ruse, et comme transportée de je ne sçay quelle fureur, me mit les deux mains dans les cheveux, et m'approchant la teste de son visage me fit un hocquet au nez, qui ne me fut point agréable. Je m'efforçay de m'en dépestrer, mais elle me tenoit si fort qu'il ne fust pas possible, et là dessus il luy prit un certain mal de cœur qui deshonora toute ma teste, tout le vin qu'elle avoit beu luy sortit tout à coup de la bouche, et je ne pus faire autre chose que baisser un peu le front pour sauver mon visage de ce déluge. J'eus les cheveux tout trempez de cet orage, et l'horreur que cet accident m'apporta me fit faire un si grand effort pour me sauver des mains de cette insensée, qu'elle fut contrainte de quiter prise. Le souvenir de cette vilaine action me fit le lendemain tenir sur mes gardes, pour éviter les occasions de me rencontrer seul avec cette belle impudente ; mais elle-mesme mieux avisée, lors que son vin fut évacué, me donna bien tost conseil de sortir tout à fait de la maison..."
"L’extase d’un baiser" (François Tristan L'HERMITE, "Les vers héroïques")
Au point que j’expirais, tu m’as rendu le jour
Baiser, dont jusqu’au coeur le sentiment me touche,
Enfant délicieux de la plus belle bouche
Qui jamais prononça les Oracles d’Amour.
Mais tout mon sang s’altère, une brûlante fièvre
Me ravit la couleur et m’ôte la raison ;
Cieux ! j’ai pris à la fois sur cette belle lèvre
D’un céleste Nectar et d’un mortel poison.
Ah ! mon Ame s’envole en ce transport de joie !
Ce gage de salut, dans la tombe m’envoie ;
C’est fait ! je n’en puis plus, Élise je me meurs.
Ce baiser est un sceau par qui ma vie est close :
Et comme on peut trouver un serpent sous des fleurs,
J’ai rencontré ma mort sur un bouton de rose.
Le "Promenoir des deux amants»...
Tristan, qui se tient à l'écart des groupes littéraires et des modes, publie dans «Les Amours» (1638), son fameux «Promenoir des deux amants», son ode la plus célèbre au cours de laquelle figures mythologiques et formes de la nature se fondent pour ne parler que d'amour. Claude Debussy en fit en 1910 une pièce pour voix et piano ...
Auprès de cette grotte sombre
Où l'on respire un air si doux,
L'onde lutte avec les cailloux,
Et la lumière avecque l'ombre.
Ces flots lassés de l'exercice
Qu'ils ont fait dessus ce gravier,
Se reposent dans ce vivier
Où mourut autrefois Narcisse.
C'est un des miroirs où le Faune
Vient voir si son teint cramoisi,
Depuis que l'amour l'a saisi,
Ne serait point devenu jaune.
L'ombre de cette fleur vermeille
Et celle de ces joncs pendants
Paraissent être là dedans
Les songes de l'eau qui sommeille.
Les plus aimables influences
Qui rajeunissent l'univers,
Ont relevé ces tapis verts
De fleurs de toutes les nuances.
Dans ce bois ni dans ces montagnes
Jamais chasseur ne vint encor :
Si quelqu'un y sonne du cor,
C'est Diane avec ses compagnes.
Ce vieux chêne a des marques saintes :
Sans doute qui le couperait,
Le sang chaud en découlerait,
Et l'arbre pousserait des plaintes.
Ce rossignol, mélancolique
Du souvenir de son malheur,
Tâche de charmer sa douleur,
Mettant son histoire en musique.
Il reprend sa note première
Pour chanter, d'un art sans pareil,
Sous ce rameau que le soleil
A doré d'un trait de lumière.
Sur ce frêne deux tourterelles
S'entretiennent de leurs tourments,
Et font les doux appointements
De leurs amoureuses querelles.
Un jour, Vénus avec Anchise
Parmi ces forts s'allait perdant,
Et deux Amours, en l'attendant,
Disputaient pour une cerise.
Dans toutes ces routes divines,
Les nymphes dansent aux chansons,
Et donnent la grâce aux buissons
De porter des fleurs sans épines.
Jamais les vents ni le tonnerre
N'ont troublé la paix de ces lieux,
Et la complaisance des dieux
Y sourit toujours à la terre.
Crois mon conseil, chère Climène ;
Pour laisser arriver le soir,
Je te prie, allons nous asseoir
Sur le bord de cette fontaine.
N'as-tu pas soupirer Zéphire,
De merveille et d'amour atteint,
Voyant des roses sur ton teint,
Qui ne sont pas de son empire ?
Sa bouche, d'odeur toute pleine,
A soufflé sur notre chemin,
Mêlant un esprit de jasmin
À l'ambre de ta douce haleine.
Penche la tête sur cette onde
Dont le cristal paraît si noir ;
Je t'y veux faire apercevoir
L'objet le plus charmant du monde.
Tu ne dois pas être étonnée
Si, vivant sous tes douces lois,
J'appelle ces beaux yeux mes rois,
Mes astres et ma destinée.
Bien que ta froideur soit extrême,
Si, dessous l'habit d'un garçon,
Tu te voyais de la façon,
Tu mourrais d'amour pour toi-même.
Vois mille Amours qui se vont prendre
Dans les filets de tes cheveux ;
Et d'autres qui cachent leurs feux
Dessous une si belle cendre.
Cette troupe jeune et folâtre
Si tu pensais la dépiter,
S'irait soudain précipiter
Du haut de ces deux monts d'albâtre.
Je tremble en voyant ton visage
Flotter avecque mes désirs,
Tant j'ai de peur que mes soupirs
Ne lui fassent faire naufrage.
De crainte de cette aventure,
Ne commets pas si librement
A cet infidèle Élément
Tous les trésors de la Nature.
Veux-tu par un doux privilège,
Me mettre au-dessus des humains ?
Fais-moi boire au creux de tes mains,
Si l'eau n'en dissout point la neige.
Ah ! je n'en puis plus, je me pâme,
Mon âme est prête à s'envoler ;
Tu viens de me faire avaler
La moitié moins d'eau que de flamme.
Ta bouche d'un baiser humide
Pourrait amortir ce grand feu :
De crainte de pécher un peu
N'achève pas un homicide.
J'aurais plus de bonne fortune
Caressé d'un jeune Soleil
Que celui qui dans le sommeil
Reçut des faveurs de la Lune.
Climène, ce baiser m'enivre,
Cet autre me rend tout transi.
Si je ne meurs de celui-ci,
Je ne suis pas digne de vivre.
Les Baisers de Dorinde
LA douce haleine des zéphirs
Et ces eaux qui se précipitent,
Par leur murmure nous invitent
A prendre d'innocents plaisirs.
Dorinde, on dirait que les flammes
Dont nous sentons brûler nos âmes,
Brûlent les herbes et les fleurs;
Goûtons mille douceurs à la faveur de l'ombre,
Donnons-nous des baisers sans nombre,
Et joignons à la fois nos lèvres et nos cœurs.
Quand deux objets également
Soupirent d'une même envie.
Comme l'amour en est la vie,
Les baisers en sont l'élément.
Il faut donc en faire des chaînes
Qui durent autant que les peines
Que je souffre loin de tes yeux.
Amour, qui les baisers aimes sur toutes choses.
Fais une couronne de roses,
Pour donner à celui qui baisera le mieux.
O que tes baisers sont charmants !
Dorinde, tous ceux que tu donnes,
Pourraient mériter des couronnes
De perles et de diamants.
Cette douceur où je me noie
Force, par un excès de joie,
Tous mes esprits à s'envoler ;
Mon cœur est palpitant d'une amoureuse fièvre,
Et mon âme vient sur ma lèvre.
Alors que tes baisers l'y veulent appeler.
Si l'Amour allait au tombeau
Par un noir effet de l'envie,
Tes baisers lui rendraient la vie
Et rallumeraient son flambeau.
Leur aimable délicatesse
A banni toute la tristesse
Qui rendait mon sens confondu;
Mais un roi détrôné par le malheur des armes,
A la faveur des mêmes charmes
Se pourrait consoler d'un empire perdu.
La manne fraîche d'un matin
N'a point une douceur pareille,
Ni l'esprit que cherche l'abeille
Sur la buglose et sur le thym.
Le meilleur sucre qui s'amasse
Et que l'Art sait réduire en glace
N'a point ces appâts ravissants ;
Et même le nectar semblerait insipide.
Au prix de ce baiser humide
Dont tu viens de troubler l'office de mes sens.
Aussi les plus riches trésors,
Qu'on tire du sein de la terre,
Et que, pour engendrer la guerre,
L'Océan sème sur ses bords.
L'or et toutes les pierreries,
Dont nous provoquent les Furies,
Pour envenimer nos esprits ;
Bref tout ce que l'aurore a de beau dans sa couche.
Au prix des baisers de ta bouche
Sont à mes sentiments des objets de mépris.

1636, "Mariamne" - Si ses recueils poétiques ne touchèrent pas beaucoup ses contemporains, il trouva un public pour ses tragédies, qui mettent en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, et qui le font considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille : "Mariamne" en 1636 vient contester le succès du Cid joué la même année, mais c'est à Racine que l'on a le plus songé en relisant cette tragédie en cinq actes et vers. Inspirée d'une tragédie d'Alexandre Hardy (1570-1632) parue en 1610, l'une des cinq ou six cents pièces que cet auteur prolifique prétendait avoir mise en scène. Tristan en fait une surprenante "tragédie de l'échec", son chef d'oeuvre. Son héros, Hérode, fils d'Antipater, roi de Judée, chassé de son pays, parvient un jour à y rentrer grâce aux légions de Rome, à s'y maintenir par la terreur, à se faire ainsi haïr d`autant du peuple d'lsraël. Face à lui, la fille de maison royale dont il vient de faire son épouse, après l`avoir rendue orpheline de père, l'intrépide, intègre et belle Mariamne. Hérode aime Mariamne jusqu`à l`idolâtrie, maître de son corps, il veut être celui de son âme, une passion délirante condamnée sans espoir qui le conduit à la condamner à mort : "Qu'Hérode m'importune ou d'amour ou de haine On me verra toujours vivre et mourir en reine..."
Acte III, scène 2....
MARIANE
Poursuy, poursuy, barbare, & sois inexorable,
Tu me rends vn deuoir qui m'est fort agréable.
Et ta main obstinée à me priuer du iour.
M'oblige beaucoup plus que n'a fait ton amour.
Icy ta passion respond à mon enuie,
Tu flates mon désir en menaçant ma vie,
le dois bénir l'excez de ta seuerité,
Car ie vay de la mort à l'immortalité.
Ma teste bondissant du coup que tu luy donnes,
S'en va dedans le Ciel se charger de Couronnes,
Dont les riches brillans n'ont point de pesanteur
Et que ne peut rauir vn lasche vsurpateur.
Si ie me plains encor d'vn Arrest si seuere.
C'est à cause que i'ay des sentimens de mère ;
le laisse des enfans, & m'afflige pour eux ;
Ces mal-heureux enfans d'vn père mal-heureux,
Ils sortent d'vne souche en gloire si féconde
Qu'elle a fait de l'ombrage aux quatre coins du monde :
Ces petits orphelins sont dignes de pitié,
Ces aimables obiects de ma tendre amitié,
Qu'vne rude Marastre ainsi qu'il est croyable
Maltraitera bien tost d'vn air impitoyable.
Elle se porte vu mouchoir sur les yeux.
HERODE
Au point que mon couroux estoit le plus aigry,
Par le cours de ses pleurs mon cœur s'est attendry.
Il semble que l'Amour qui se rend son complice,
Déchire le bandeau que porte ma iustice,
Afin qu'en la voyant ie luy puisse accorder
Le pardon que pour elle il me vient demander.
Desia mon ame incline à la miséricorde.
Tu demandes sa grâce, Amour, ie te l'accorde :
Mais vueille agir prés d'elle, & me faire accorder,
Vn bien qu'en mesme temps ie lui veux demander ;
Fay qu'à iamais son cœur repentant de son crime,
Responde à mes bontez auecque plus d'estime ;
Qu'elle quitte pour moy cet insolent orgueil
Qui pourroit quelque iour nous ouurir le cercueil;
Fay luy voir que ie l'ayme à l'egal de moy-mesme,
Et s'il se peut encore. Amour, fay qu'elle m'ayrae.
(Il fait signe à ceux qui sont du Conseil qu'ils se retirent).
Vueille essuyer tes yeux, Objet rare & charmant.
La qualité de Roy cède à celle d'Amant,
Ma iustice pouuoit à mes loix te sousmettre,
Mais mon affection ne le sçauroit permettre :
le me sens trop touché de tes moindres douleurs,
le trouue que mon sang coule parmy tes pleurs,
l'interromps cet Arrest, car ma colère extrême
Te faisant ton procez, me le fait à moy-mesme,
Et si dans vn moment ie n'arrestois ton dueil,
le sens bien qu'auec toy i'yrois dans le cercueil,
le mourrois de ta mort, & les mesmes supplices
Traicteroient ta Partie ainsi que tes Complices.
Voy de quelle façon mon sort dépend du tien.
Et si ie t'importune en te voulant du bien,
Si tu conçois pour moy quelque cruelle enuie,
N'vses plus de poison pour abréger ma vie,
S'il te prend vn désir d'auancer mon trespas,
Tu n'as rien qu'à monstrer que tu ne m'aimes pas.
Tu n'as qu'à m'exprimer cette haine secrète,
Et bientost mes ennuis te rendront satisfaite.
Mais confesse moy tout, afin de faire voir
Que tu veux auiourd'huy rentrer en ton deuoir,
Et que ton cœur touché d'vn remors véritable.
Déteste auec horreur vn crime détestable.
MARIANE
On connoist à ce stile, & doux, & deceuant.
Comme en l'art de trahir ton esprit est sçauant.
C'est auec trop de soin m'ouurir la sépulture,
Pour me perdre il suffit d'vne seule imposture.
HERODE
Mauuaise, tu crois donc que ie suis vn trompeur,
Et toute ceste audace est l'efFect de ta peur.
Ne crains point pour ta grâce, elle est entérinée,
le tiendray ma parole après l'auoir donnée ;
Cesse de m'affliger auecque tes douleurs.
MARIANE
Mais fay plustost cesser ma vie & mes mal -heurs.
Tous les miens sont passez, ie brusle de les suiure.
HERODE
Comment ? veux-tu mourir pour m'empescher de viure?
Et violant encor toutes sortes de droits
Attenter sur ton Roy pour la seconde fois ?
Bien que tu sois de glace, & que ie sois de flame,
Les Cieux ont attaché mon esprit à ton ame,
Le beau fil de tes iours ne peut estre accourcy,
Sans que du mesme temps le mien le soit aussi.
MARIANE
Lors que ta vie au moins finira sa durée,
La mienne, il est certain, sera mal asseurée,
Car les précautions de ta soigneuse amour
Me feront, s'il se peut, partir le mesme iour ;
Certes ce sont des traits d'vne amitié bien tendre.
HERODE
Ce propos est obscur, ie ne sçaurois l'entendre.
.....
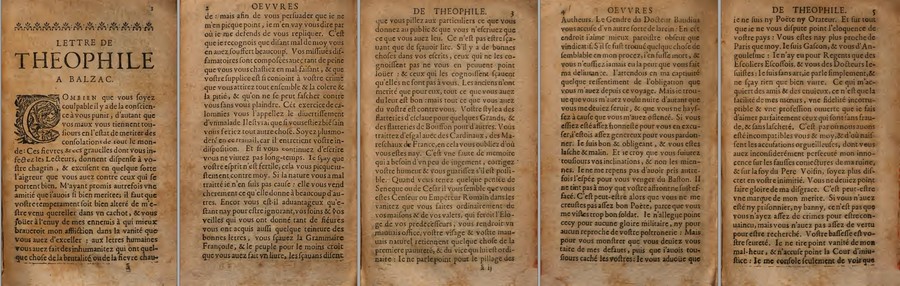

Guez de Balzac (1597-1654)
Né à Angoulême, descendant par sa mère d'une dynastie de robe, élève de Nicolas Bourbon, Jean-Louis Guez de Balzac fut d'abord attaché en qualité de secrétaire au duc d'Epernon, qu'il accompagna à Metz; puis il fut envoyé en mission à Rome. C'est durant ces voyages que lui vint l'idée d'écrire ses célèbres Lettres. Des Lettres vibrantes d'enthousiasme pour l'Antiquité et qui furent accueillies avec faveur à l'hôtel de Rambouillet. Occupant dans les courants culturels et stylistiques de son époque, une position médiatrice entre la Cour et l'humanisme érudit parlementaire, son recueil publié en 1624 connut un succès prodigieux dans toute l'Europe et l'on estime qu'il a joué un rôle essentiel dans la formation de la prose classique en France. Choyé par Richelieu (qui en fit l'un des premiers membres de l’Académie), c'est pourtant un homme déçu dans ses ambitions, critiqué qui décide de se retirer sur ses terres de l'Angoumois et de se consacrer aux belles-lettres. Après "Le Prince" (1631), peinture du souverain idéal et panégyrique voilé de Louis XIII, parmi ses meilleures pages, il composa "Aristippe ou de la Cour" (posth. 1658), réflexion sur le machiavélisme en politique, et "Le Socrate chrétien" (1652). Considéré comme " le plus éloquent homme " du temps, il donnait tous ses soins à ses Lettres, publiées de 1624 à 1654 et attendues par les milieux littéraires et mondains de la capitale....
1624-1654 - Lettres
Dans ses Lettres (1624) qu'il adresse non seulement à la société précieuse de l'hôtel de Rambouillet mais à toute l'Europe savante, Balzac prend soin d'adapter en français les raffinements de la rhétorique latine (Cicéron, Sénèque, les Pères de l'Église). Ces lettres portent tout à la fois sur des sujets de circonstance comme sur des questions politiques, littéraires ou morales. Le succès que rencontrent les Lettres est dû à la nouveauté avec laquelle Balzac associe panégyrique et harangue, pour montrer que le genre épistolaire est capable d'abriter toutes les formes d'éloquence. Mais Balzac se garde bien d'improviser, et cet effort de construction de chacune de ses phrases tout en visant la perfection, mène, parfois, à l'emphase...
Dans une lettre du 17 janvier 1643 adressée à Corneille, Balzac écrit toute son admiration pour Cinna et pour la grandeur de Rome telle que reconstituée par le dramaturge. Il avait en son temps défendu le Cid contre les attaques de Scudéry...
"Vous nous faites voir Rome tout ce qu'elle peut être à Paris, et ne l'avez point brisée en la remuant. Ce n'est point une Rome de Cassiodore, et aussi déchirée qu'elle était au siècle des Théodorics : c'est une Rome de Tite-Live, et aussi pompeuse qu'elle était au temps des premiers Césars. Vous avez même trouvé ce qu'elle avait perdu dans les ruines de la République, cette noble et magnanime fierté; et il se voit bien quelques passables traducteurs de ses paroles et de ses locutions, mais vous êtes le vrai et le fidèle interprète de son esprit et de son courage. Je dis plus, Monsieur, vous êtes souvent son pédagogue, et l'avertissez de la bienséance, quand elle ne s'en souvient pas. Vous êtes le réformateur du vieux temps, s'il a besoin d'embellissement ou d'appui. Aux endroits où Rome est de brique, vous la rebâtissez de marbre ; quand vous trouvez du vide, vous le remplissez d'un chef-d'œuvre; et je prends garde que ce que vous prêtez à l'histoire est toujours meilleur que ce que vous empruntez d'elle.
La femme d'Horace et la maîtresse de Cinna, qui sont vos deux véritables enfantements et les deux pures créations de votre esprit, ne sont-elles pas aussi les principaux ornements de vos deux poèmes ? Et qu'est-ce que la saine antiquité a produit de vigoureux et de ferme dans le sexe faible, qui soit comparable à ces nouvelles héroïnes que vous avez mises au monde, à ces Romaines de votre façon? Je ne m'ennuie point, depuis quinze jours, de considérer celle que j'ai reçue la dernière. Je l'ai fait admirer à tous les habiles de notre province : nos orateurs et nos poètes en disent merveilles; mais un docteur de mes voisins, qui se met d'ordinaire sur le haut style, en parle, certes, d'une étrange sorte; et il n'y a point de mal que vous sachiez jusques où vous avez porté son esprit. Il se contentait le premier jour de dire que votre Emilie était la rivale de Caton et de Brutus, dans la passion de la liberté; à cette heure il va bien plus loin. Tantôt il la nomme la possédée du démon de la République, et quelquefois la belle, la raisonnable, la sainte et l'adorable furie.
Voilà d'étranges paroles sur le sujet de votre Romaine, mais elles ne sont pas sans fondement. Elle inspire en effet toute la conjuration, et donne chaleur au parti, par le feu qu'elle jette dans l'âme du chef. Elle entreprend, en se vengeant, de venger toute la terre. Elle veut sacrifier à son père une victime qui serait trop grande pour Jupiter même. C'est à mon gré une personne si excellente, que je pense dire peu à son avantage, de dire que vous êtes beaucoup plus heureux en votre race, que Pompée n'a été en la sienne, et que votre fille Émilie vaut sans comparaison davantage que Cinna, son petit-fils. Si celui-ci même a plus de vertu que n'a cru Sénèque, c'est pour être tombé entre vos mains, et à cause que vous avez pris soin de lui. Il vous est obligé de son mérite comme à Auguste de sa dignité. L'empereur le fit consul, et vous l'avez fait honnête homme ; mais vous l'avez pu faire par les lois d'un art qui polit et orne la vérité, qui permet de favoriser en imitant, qui quelquefois se propose le semblable et quelquefois le meilleur..."
1631 - Le Prince
"Le Prince" parut trois ans après la prise de la Rochelle. C'est une peinture du souverain idéal, tout dévoué à la chose publique. Le pouvoir trouve dans la volonté divine à la fois sa légitimité et ses limites. Le livre fut bien moins accueilli que ses Lettres et notamment auprès de Richelieu. Après l'échec du Prince, Balzac se rapprochera de l'humanisme dévot et sera reçu dans le cercle des frères Dupuy....
"Chapitre XIV - Argument - Vigilance et activité du Prince. Les Roys et les Royaumes ne peuvent jouir d'un mesme repos. Le nostre travaille tousjours, se hazarde souvent, expose sa personne à toutes les injures des saisons , fait ses Galeries de Paris en Guyenne et en Languedoc. Son corps ne pese point à son esprit; n'a point de peine à suivre les mouvemens de son courage. Il ne traisne point après luy vn long équipage de desbauche, comme les Princes Asiatiques. Il ne s'arreste point à tous les objets agréables, comme Marc Antoine. Il est extraordinaircment diligent. Il mesnage le temps avec vne grande œconomie. Tous les momens luy sont précieux. Sans cela il n'auroit que commencé les miracles qu'il a faits, et qui sont icy plustost marquez que descrits: Il ne seroit pas ce Prince par excellence, qui nous fournit sa vie pour l'instruction des autres, et nous dispense de tous nos préceptes. Réformation du passé. Anciennes fautes corrigées. Mauvaises maximes changées. Renouvellement de l'Estat.
Il y a dix ans qu'il veille quasi tousjours; qu'il est quasi tousjours à cheval ; qu'il court par tout où l'appelle la nécessité publique : Et d'autant qu'il sçait bien que les Roys et les Royaumes ne peuvent jouir d'un mesme repos, il est content que les peines et les dangers soient pour luy, et la paix et la seureté soient à la France. Ses cheveuv blancs luy sont venus des nobles et glorieuses inquiétudes, qui ont produit la tranquillité de ses Peuples. Il pleut et il neige tous les Hyvers sur la premiere teste du Monde. Dans les plus violentes chaleurs de l'Esté, lors que nous employons tous les moyens imaginables pour chercher le frais et avoir de l'ombre, son visage se hasle au Soleil de Languedoc, et c'est d'ordinaire en pleine campagne, et à dix journées du Louvre qu'il reçoit les injures de l'air et les incommoditez des saisons. Quelques-uns de ses Prédécesseurs avoient plus de peine à se remuer, et à passer de leur chambre à leur cabinet, qu'il n'en a d'aller d'une extrémité du Royaume à l'autre. Il fait ses Galeries et ses pourmenoirs de Paris en Guyenne ou en Dauphiné, et il n'y a point de partie affligée en son Estât, pour esloignée qu'elle soit, qui luy ayant découvert ses playes, et donné connoissance de son mal, ne sente incontinent le soulagement qu'apporte sa présence en quelque lieu qu'il se monstre. Pour cet effet la Nature luy a donné vn corps qui ne pese point à son esprit , et qui estant extrêmement souple et vigoureux, n'a pas beaucoup de difficulté à suivre les mouvemens de son courage. La continuelle agitation dans laquelle il se nourrit, ne laisse pas mettre ensemble ce grand amas d'humeur, et cet excez de chair superflue, qui se forme par l'oisiveté, et qui bien souvent est à charge à l'ame; Outre qu'il n'est pas embarrassé de ce long équipage de débauche, que traisnent après eux les voluptueux, et qu'il ne fait pas la guerre à la mode des Princes Asiatiques, on ne voit point des troupes de femmes et d'Eunuques, et vne autre armée de personnes inutiles à la suite de la sienne. Il ne luy faut point un nombre incroyable de chariots pour porter des luths, des violons, des miroirs et des parfums, comme il en falloit à Marc Antoine, quand il marchoit avec Cleopatre. Le premier objet agréable qu'il rencontre en son chemin ne l'oblige point de s'y arrester, et il ne campe pas au bord des belles rivières, au lieu de les traverser, ny ne fait dresser des tentes dans les vallons délicieux, quand il faut passer les montagnes. Il est libre de ces empeschemens que se font ou que trouvent les effeminez et qui sont cause d'une notable perte de temps, qui doit estre au Prince la plus précieuse de toutes les choses, et de laquelle il peut estre avare sans perdre le tiltre de Libéral.
Si le Roy n'en scavoit user avec beaucoup d'oeconomie, et s'il n'estoit excellent dispensateur d'un bien si fragile et de si mauvaise garde, il n'auroit pas, comme il a fait en moins de six ans, commencé, poursuivy et terminé un travail qui apparemment devoit exercer ses Successeurs et durer jusqu'à la postérité. Il ne se seroit pas rendu Maistre chez soy et luge chez ses voisins, et n'auroit pas esteint. comme il a fait, la rebellion, désarmé l'erreur, soustenu la foiblesse, abbaissé la tyrannie. Un Prince medriocrement diligent seroit encore à my-chemin d'une si pénible course, et sous un autre Roy que le nostre, nous ferions encore des vœux pour arriver au port, dans lequel aujourd'huy nous les rendons.
Ne parlons point laschement de la prospérité de nos affaires. Ne contredisons point à la voix publique. N'affoiblissons point la vérité par des exceptions malicieuses, et par des loüanges conditionnées. Avoüons à tout le moins les obligations que nous avons au Roy, si nous ne pouvons les roconnoistre. On ne vit jamais vue si grande disposition à la félicité, que les Politiques cherchent : Jamais les promesses de l'avenir ne furent si belles. Nous ne craignons plus la ruine de nostre Estat, nous on espérons l'Eternité. Toutes les pièces de cette superbe Masse, qui a bransié si longtemps, sont maintenant raffermies. Tout est compassé avec vne admirable justesse : Pas vne pierre ne pousse hors de son alignement : Rien n'offense les yeux délicats. Voïcy la première fois que la Médisance sera muette. Il n'y a plus de défauts à découvrir; il n'y a presque pas de souhaits à faire...."
1652 - Le Socrate chrétien
Le Socrate chrétien fut publié à Paris deux ans avant la mort de Balzac, par les soins de Conrart qui en surveilla l'impression. Il se compose de douze discours sur différents sujets mais l'argument principal est de concilier la morale antique avec la religion chrétienne, en faisant l'apologie de l'éloquence laconique de la Bible. On y a lu l'intention pour l'auteur de se disculper des accusations de libertinage qui furent portées contre lui...
"... L'homme que nous adorons a nettoyé la Terre de cette multitude de Monstres que les Hommes adoroient; Mais il n'en est pas demeuré là. Il ne s'est pas contenté de ruiner l'Idolâtrie et d'imposer silence aux Démons; il a, de plus, confondu la Sagesse humaine : Il a osté la parole aux Philosophes. Leurs Sectes ont fait place à son Eglise, et leurs Dogmes à ses commandemens : Toute la Raison, toute l'Eloquence d'Athènes luy a cédé. C'est luy qui a humilié l'orgueil du Portique; qui a décrédité le Lycée et les autres Escholes de Grèce. Il a fait voir qu'il y avoit de l'Imposture partout, qu'il y avoit des Fables dans la Philosophie, et que les Philosophes n'estoient pas moins extravagans que les Poètes, mais que leur extravagance estoit plus grave et plus composée. Il a fait advouër aux Spéculatifs qu'ils avoient resvé, lors qu'ils avoient voulu méditer. Il leur a monstre que de cent cinquante tant d'opinions, qui visoient au Souverain Bien, il n'y en avoit pas vne qui eust touché au but. Vous pouvez voir et compter ces opinions dans les livres de la Cité de Dieu de Sainct Augustin. Jesus-Christ a ainsi traité les Sages du Monde : De cette sorte il a pacifié leurs Querelles et leurs Guerres. En les réfutant tous, il les a tous accordez. Avant luy, on se doutoit bien de quelque chose. On donnoit de légères atteintes à la Vérité : On avoit quelques soupçons et quelques conjectures de ce qui est. Mais les plus intelligens estoient les plus retenus et les plus timides à se faire entendre; ils n'osoient se déclarer sur quoy que ce soit: ils ne parloient qu'en tremblant et en hésitant des affaires de l'autre Vie : Ils consultoient et deliberoient tousjours sans jamais se résoudre ny prendre party. Je ne m'en estonne pas neantmoins. Car comment eussentils pu trouver la Vérité qu'ils cherchoient, puis qu'elle n'estoit pas encore née? Il falloit que la Vérité se fist chair, afin de se rendre sensible et de devenir familière aux hommes, afin de se faire voir et toucher. Cette Vérité n'est autre que Jesus-Christ, et c'est ce Jesus-Christ qui a fait cesser les doutes et les irrésolutions de l'Académie, qui a mesme asseuré le Pyrrhonisme. Il est venu arresler les pensées vagues de l'esprit humain et fixer ses raisonnemens en l'air. Apres plusieurs Siècles d'agitation et de trouble, il est venu faire prendre terre à la Philosophie et donner des ancres et des ports à vne Mer qui n'avoit ny fond ny rive. Par son moyen, nous sçavons ce qu'Aristote, ce que le Maistre d'Aristote, ce que les Disciples d'Aristote ont ignoré. Ils avoient les yeux bons, mais ils cheminoient de nuit, et la subtilité de leur veuë n'estoit point comparable à la pureté de nostre lumière...."
1658 - Aristippe ou De la Cour
Dédié à la reine Christine de Suède, et considéré comme le chef d'oeuvre de Guez de Balzac, l'auteur étudie les moeurs de la cour et cherche les moyens d'une conciliation du devoir et de la politique..
"J' ay esté assés long temps dans le monde, mais je n' ay vescu qu' autant que dura l' automne passé : et pource qu' il n' est pas possible de faire revenir ces jours bien-heureux, et qui me furent si chers, je tasche le plus que je puis de les regouster par le souvenir, et par le discours. La liberté en laquelle je me trouvois, apres une captivité de trois ans, j' appelle ainsi le sejour que j' avois fait à la ville : la pureté de l' air, que je commençois à respirer, et que je recevois avidement, comme une nourriture qui m' estoit nouvelle, et la face riante de la campagne, qui monstroit encore sur soy une partie de ses biens, et se paroit des derniers presens qu' elle devoit faire aux hommes, me donnoient des pensées si douces et si tranquilles, que sans estre agité de l' émotion qu' excite la joye, j' avois tout le plaisir qu' elle cause. Les autres maladies de l' ame plus importunes, qui tourmentent les cours et les assemblées, n' approchoient point de nostre village. Je ne sçavois que c' estoit de craindre, ny d' esperer, et ne connoissois plus le soupçon, la deffiance, ny la jalousie. Toutes mes passions se reposoient, et celles d' autruy ne parvenoient point jusques à moy. L' envie et la haine, qui se sont si cruellement attachées à une petite ombre de bien, que quelques-uns ont crû voir parmy mes defaux, m' attaquant où je n' estois pas, ne me faisoient point de mal que je sentisse ; et les objets presens remplissoient mon esprit de telle sorte, et y effaçoient si nettement l' impression du passé, que comme ils n' y laissoient point de lieu aux apprehensions de l' advenir, il n' y demeuroit rien de fascheux qui me pust travailler la memoire. En cet estat, bien different du tumulte d' où j' estois sorty, et sous la serenité d' un ciel si benin, il me sembloit visiblement de renaistre, et d' assister au renouvellement de toutes les choses. Et à la verité quand nous eussions eu durant cette saison la direction du monde, et que nous eussions fait nous mesmes les jours, nous n' en pouvions pas avoir de plus beaux, ny dispenser l' ombre et la lumiere, le froid et le chaud avec une plus égale mesure. Il s' eslevoit bien quelquefois une petite vapeur de la riviere voisine, qui l' envelopoit comme dans un ré, et s' épandoit sur la superficie de la terre : mais outre qu' elle n' attendoit pas tousjours le soleil pour se desfaire, et qu' elle n' en pouvoit soustenir les premiers rayons, elle n' avoit jamais tant de force qu' elle montast à la hauteur de nos plus basses fenestres, et nous jouïssions d' un calme tres-net, et d' une clarté extremement vive, pendant qu' il y avoit un peu de trouble et de fumée au dessous de nous. Avant que nous fussions habillés, et que nous eussions fait nos prieres, cette humidité, qui n' avoit moüillé que la pointe des herbes, et le pied des plantes, estoit entierement essuyée, et toute la fraischeur du matin avoit tombé sur la teste des laboureurs, et de ceux qui voyagent par necessité. Si bien qu' il me restoit un juste intervalle pour me promener jusques à midy, et pour faire de l' exercice, qui desnoüast le corps sans le travailler, et reveillast moderément l' appetit, sans le porter à une faim déreglée, qui suit d' ordinaire les mouvemens violens, et tient quelque chose de la maladie. La premiere partie de l' apres-disnée se passoit en une conversation familiere, d' où nous avions banny les affaires d' estat, les controverses de la religion, et les questions de philosophie. On n' y disputoit point avec aigreur si le pape estoit par dessus le concile :on ne se mettoit point en peine d' accorder les princes chrestiens, pour faire une ligue contre le turc : on ne debattoit point à outrance, qui estoit le plus grand capitaine, du Marquis De Spinola, ou du Comte De Tilly. Personne ne reformoit les royaumes, ny ne vouloit changer leur gouvernement. Il n' estoit pas seulement permis de nommer le public, ny le siecle ; et nous ne parlions que de la bonté de nos melons, de la recolte de nos bleds, et de l' esperance de nos vendanges."
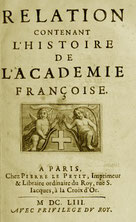
Les Académies - A partir des années 1620 un certain nombre d’intellectuels se réunissent pour échanger leurs points de vue. C’est ainsi qu’en 1629 s’est formé autour de Valentin Conrart (1603-1675), - le fils d'un commerçant huguenot originaire de Valenciennes, élevé dans un calvinisme austère, qui ne sait ni le latin ni le grec, mais apprend l'italien et l'espagnol et achète en 1627 achète une charge de conseiller-secrétaire du roi -, un groupe d’écrivains discutant littérature. Richelieu leur offre sa protection et signe les statuts de ce qui va devenir l’Académie Française en 1635. Ses membres sont cooptés, et les intronisations qui deviennent publiques en 1675 se transforment en événements mondains. Louis XIV l’installe au Louvre (1672) en lui imposant un règlement détaillé. L’accès à l’Académie donne droit à des pensions et des gratifications royales, d’où son succès. Y entrer devient alors une consécration, mais ce système subordonne l’institution au pouvoir royal qui s’attache ainsi la fine fleur du monde littéraire. Le roi résume bien le rôle qu’il attribue aux académiciens quant il leur déclare en 1663 : " Vous pouvez, Messieurs, jugez de l’estime que je fais de vous, puisque je vous confie la chose au monde qui m’est la plus précieuse, qui est ma gloire".
Au départ, les buts de l’Académie étaient de fixer des règles à la création artistique. Mais après sa malheureuse intervention dans la "Querelle du Cid" (en 1637, elle prend partie contre Corneille, lui reprochant son dédain des règles de la tragédie), son dessein prioritaire devient la création d’un dictionnaire normatif, pour "nettoyer la langue des ordures qu’elle a contracté ou dans la bouche du peuple ou dans la foule du Palais" (projet du 24 mars 1634). Il s’agit d’unifier la langue, comme le pays est uni derrière son roi, et de donner des règles de clarté et de bon usage, maîtres-mots du classicisme. Ce dictionnaire ne paraîtra qu’en 1694, bien après ceux de Richelet et de Furetière. Mais c’est surtout l’influence qu’exerce l’Académie qui est importante : tous les grands écrivains du temps la rejoignent à un moment ou à un autre, et elle donne le ton à une littérature quasi officielle.
Ce phénomène s’étend à d’autres domaines : Académies royales de Musique (1669), de peinture et de sculpture (1648), d’architecture (1672), des Sciences (1666). Pour parfaire ce maillage, des Académies sur le même modèle que l’Académie Française sont crées en province, donnant droit à des honneurs et des privilèges à leurs impétrants....
