- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Boileau (1636-1711), "Satires" (1666-1668), Les Epîtres (1669-1695), L'Art poétique (1674) ....
- et tous ses hommes de lettres que Boileau retrouvera au bout de ses vers pour les faire malignement rimer, Philippe Quinault (1635-1688), Jean Chapelain (1595-1674), les deux Perrault, dont Charles (1628-1703), Gauthier de Costes, seigneur de la Calprenède (1609-1663), Georges de Brébeuf (1617-1661), Edmé Boursault (1638-1701), Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676), François-Séraphin Régnier-Desmarais (1632-1713), Triteville (1598-1672), Guillaume Colletet (1598-1659), François Payot de Lignières (1626-1704), Pinchêne, neveu de Voiture, Jacques Pradon (1644-1698), Claude Boyer (1618-1698), Pierre Perrin (1620-1675), Balthasar Bonnecorse (1631-1706), Paul Scarron (1610-1660), Charles Coypeau d'Assoucy (1605-1677), Claude Malleville (1597-1647), Jean Ogier de Gombauld (1576-1666), Gédéon Tallemant des Réaux (1619-1692), Michel Le Clerc (1622-1691), Nicolas Faret (1600-1646), Marc-Antoine Girard de Saint-Amant (1594-1661), Valentin Conrart (1603-1675), Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière (1610-1663), François du Souhait (1580-1617), Michel de Pure (1620-1680), Gilles Ménage (1613-1692),Charles Cotin (1604-1681), Jacques Cassagne (1636-1679), Georges de Scudéry (1601-1667), Louis de Neufgermain (1574-1662), Jean Puget de la Serre (1594-1665), Pierre de Montmaur (1576-1648), Jean Le Pelletier (1633-1711), Denis Sanguin de Saint-Pavin (1595-1670), Jacques Carel de Sainte-Garde (1620-1684), Pierre Bardin (1595-1635), Pierre Motin (1566-1612), etc., etc..
Last update 10/10/2021

"D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir", dira Boileau, et c'est aux environs de 1660, que s'achève l'évolution littéraire qui conduit, depuis plus d'un siècle, en France, à l'art classique. Dans le même mouvement, un Louis XIV énonce son fameux absolutisme, "la nation ne fait pas corps en France; elle réside entière dans la personne du roi. L'Etat, c'est moi.." Il y a, sans que l'on s'en doute encore, un écart entre ces deux logiques, l'un prône l'usage de la raison, de la vérité et de la nature, l'autre défend l'allégorie, la comédie de cour et de salon, repoussant l'exercice de la pensée pour assurer et préserver l'éclat de son pouvoir...
Mais c'est bien cette dernière qui en fin de compte absorbe raison, vérité et nature, et s'en joue, lorsque notre satiriste écrit déjà son "Epître au Roi" et le décrit "Jeune et vaillant héros, dont la haute sagesse N'est point le fruit tardif d'une lente vieillesse, Et qui seul, sans ministre, à l'exemple des dieux, Soutiens tout par toi-même et vois tout par tes yeux, Grand Roi, si, jusqu'ici, par un trait de prudence, J'ai demeuré pour toi dans un humble silence. Ce n'est pas que mon cœur, vainement suspendu. Balance pour t'offrir un encens qui t'est dû ; Mais je sais peu louer ; et ma muse tremblante Fuit d'un si grand fardeau la charge trop pesante. Et dans ce haut éclat où tu te viens offrir, Touchant à tes lauriers, craindrait de les flétrir."...
A la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, Louis XIV, qui a vingt-trois ans, déclare qu'il n'aura pas de Premier ministre et va désormais exercer son "métier de roi", son règne personnel débute, 1660-1715. Se considérant comme le lieutenant de Dieu dans son royaume, maître absolu des biens, des personnes et même des esprits de ses sujets, il sera assisté de quelques ministres, - le chancelier, le contrôleur général des Finances, les quatre secrétaires d'État -, par les Conseils (Conseils d'en haut, des finances, des dépêches, des parties), est représenté dans les provinces par les gouverneurs, dont la fonction n'a plus qu'un caractère honorifique, et par les intendants, véritables délégués pourvus en son nom de tous les pouvoirs dans leur généralité. La La cour, qui a pris une extraordinaire ampleur, - 10 000 hommes dans la maison militaire, 4 000 dans la maison civile, rassemblant toute la haute noblesse -, n'est pas seulement le cadre prestigieux où se donne le spectacle solennel de la vie quotidienne du roi, mais aussi un organisme politique : un moyen sûr pour dominer et même pour domestiquer ces Grands, si encombrants et dangereux dans la première moitié du siècle : ruinée par le luxe, le jeu, le besoin de paraître, la noblesse de cour ne peut se passer des pensions et des faveurs du roi, et finit par dépendre entièrement de son bon vouloir.
Dans bien des introductions à l'histoire de la littérature française du XVIIe siècle, reviennent les notions de "grandeur', d' "éclat des lettres et des arts" dans une France dominant l'Europe. Mais de quelle "grandeur" parle-t-on, celle de la cour de Versailles et de l'absolutisme ou celle du peuple livré à la famine et à l'arbitraire? En fait une formulation peut retenir notre attention, "le règne de la raison lucide correspond à celui de l'ordre et de l'autorité"..
Nos structures de pensée sont encore et toujours au XXIe siècle héritières de ce XVIIe qui voit se construire intellectuellement, par ralliement des belles-lettres à l'exercice du pouvoir, une "raison", et étroitement associée à celle-ci, les notions d'ordre et d'autorité comme principes régulateurs de notre vie en société. Ce règne de la "raison lucide" qui vient à naître porte à la fois codification de notre pensée, de notre langage et de nos attitudes sociales. Et c'est ainsi qu'à nouveau la fiction prend le pas sur la réalité...
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement" - 1674, L'Art poétique de Boileau paraît alors que le premier recueil des Fables de La Fontaine vient de paraître, un La Fontaine qui depuis Malherbe, adoubé par Boileau, a appris que toute la puissance d'u mot mis à sa juste place, que l'on songe à la fable du Meunier, son fils et l'âne. 1674, Molière n'est plus et Racine a déjà donné la plupart de ses tragédies. Boileau n'est donc pas le grand forgeron de l'art classique du XVIIe siècle, mais le codificateur d'un temps déjà presque révolu prônant la vraisemblance et la bienséances, la raison, la clarté, la mesure, l'équilibre. Il est un observateur critique et satirique, attaquant les excès de la préciosité et d'un burlesque finissant, l'héroïsme factice, l'invraisemblance des sentiments et des gestes, la mascarade anachronique des personnages et des situations; soutenant Molière, Corneille et Racine, au détriment des puissants littérateurs de l'époque Chapelain, Quinault ou Pradon, par ailleurs rapidement oubliés. Plaidant pour le "naturel" et la "simplicité", Boileau est surtout le premier à articuler éloge de la sincérité dans la vie et de la vérité dans l'art.
"L'esprit de l'homme est naturellement plein d'un nombre infini d'idées confuses du vrai, que souvent il n'entrevoit qu'à demi; et rien ne lui est plus agréable que lorsqu'on lui offre quelqu'une de ces idées bien éclaircie et mise dans un beau jour. Qu'est-ce qu'une pensée neuve, brillante, extraordinaire? Ce n'est point, comme se le persuadent les ignorants, une pensée que personne n'a jamais eue, ni dû avoir . C'est au contraire une pensée qui a dû venir à tout le monde, et que quelqu'un s'avise le premier d'exprimer. Un bon mot n'est un bon mot qu'en ce qu'il dit une chose que chacun pensait, et qu'íl la dit d'une manière vive, fine et nouvelle...." (Préface de 1701)
Mais ce règne de la "raison lucide", porte déjà en lui un pessimisme foncier relatif à la nature humaine, que les siècles suivants, dont le XVIIIe, s'efforceront de tempérer ou de retourner en une force plus positive...
En attendant, La Rochefoucauld, La Bruyère, La Fontaine, Racine, Pascal, Molière, tous, à leur manière, naissent en raison, structurent une raison et une rationalité sans la moindre illusion sur cette nature humaine qu'ils apprennent à décrire avec une précision littéraire et psychologique alors encore jamais atteinte. La corruption de cette nature humaine par le péché a encore dans ce XVIIe une valeur explicative, mais elle ne suffit plus, c'est du spectacle du monde et des relations humaines que nos auteurs explicitent ce constat...
(Jean-Baptiste Santerre (1651-1717), Portrait de Nicolas Boileau, 1678, Musée des Beaux-Arts de Lyon)


Vauban, Dîme royale, 1707 - La politique de grandeur de Louis XIV aboutit à une France certes plus unie qu'en 1661, mais sa prépondérance européenne des années 1678 à 1688 a disparu au profit de celle de l'Autriche et de l'Angleterre. Quant à l'état du royaume, il est désastreux dans les dernières années du règne : la charge des guerres continuelles est devenue intolérable; l'exode des industriels, des commerçants et des ouvriers protestants désorganise l'activité économique; la répartition de l'impôt est déplorable, surtout depuis la mort de Colbert : la taille, qui ne pèse que sur les paysans, est foncièrement injuste et paralyse tout esprit d'amélioration et d'initiative; les impôts indirects perçus par les fermiers ou "traitants" donnent lieu a de multiples abus, les taxes sur le sel ou gabelle, les "aides" (taxes sur les boissons) et "traites" (droits de douane entre provinces) apparaissent comme des vexations insupportables et illogiques. La crise monétaire européenne de la fin du XVIIe siècle qui correspond à une diminution progressive des stocks d'or et d'argent aggrave la situation : la production industrielle s'effondre, la misère s'installe et le désarroi financier ne permet pas la réforme fiscale qui serait nécessaire. Vauban essaie en vain de convaincre le roi dans sa "Dîme royale" en 1707; son livre est condamné et mis au pilon...
"Je me sens encore obligé d'honneur et de conscience de représenter à Sa Majesté qu'il m'a paru que de tout temps on n'avait pas eu assez d'égards en France pour le menu peuple, et qu'on en avait fait trop peu de cas; aussi c'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume; c'est elle, cependant, qui est la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend; car c'est elle qui porte toutes les charges, qui a toujours le plus souffert, et qui souffre encore le plus et c'est sur elle aussi que tombe toute la diminution des hommes qui arrive dans le royaume...
C 'est encore la partie basse du peuple qui, par son travail et son commerce, et par ce qu'elle paye au roi, l'enrichit et tout son royaume; c'est elle qui fournit tous les soldats et matelots de ses armées de terre et de mer, et grand nombre d'officiers, tous les marchands et les petits officiers de judicature ; c'est elle qui exerce et qui remplit tous les arts et métiers; c'est elle qui fait tout le commerce et les manufactures de ce royaume, qui fournit tous les laboureurs, vignerons et manœuvres de la campagne, qui garde et nourrit les bestiaux, qui sème les blés et les recueille; qui façonne les vignes et fait le vin, et pour achever de le dire en peu de mots, c'est elle qui fait tous les gros et menus ouvrages de la campagne et des villes.
Voilà en quoi consiste cette partie du peuple si utile et si méprisée, qui a tant souffert et qui souffre tant de l'heure que j'écris ceci. On peut espérer que l'établissement de la Dîme royale pourra réparer tout cela en moins de quinze années de temps, et remettre le royaume dans une abondance parfaite d'hommes et de biens; car quand les peuples ne seront pas si oppressés, ils se marieront plus hardiment, ils se vêtiront et nourriront mieux, leurs enfants seront plus robustes et mieux élevés; ils prendront un plus grand soin de leurs affaires; enfin, ils travailleront avec plus de force et de courage, quand ils verront que la principale partie du profit qu'ils y feront leur demeure.
Il est constant que la grandeur des rois se mesure par le nombre de leurs sujets; c'est en quoi consiste leur bien, leur bonheur et toute la considération qu'ils ont dans le monde. On ne saurait donc rien faire de mieux pour leur service et pour leur gloire, que de leur remettre souvent cette maxime devant les yeux; car puisque c'est en cela que consiste tout leur bonheur, ils ne sauraient trop se donner de soin pour la conservation et augmentation de ce peuple qui leur doit être si cher..." (Vauban)
Fénelon, Lettre au roi, 1693 - Le gouvernement se contente de multiplier les expédients les plus fâcheux, tels que les manipulations monétaires et les créations d'offices inutiles, sans pouvoir écarter la menace de banqueroute. Dans cette faiblesse généralisée des finances et de l'économie, les mauvaises récoltes, les épidémies, les cataclysmes naturels provoquent de terribles famines en 1687, en 1693 et 1694, en 1709. La population diminue et on peut compter 2 millions de mendiants sur 17 millions d'habitants.
Aussi le mécontentement s'accroit, les pamphlets se répandent, les émeutes, et particulièrement les jacqueries des paysans se répètent; les mémoires des commissaires du roi de 1687, les rapports des intendants, les Mémoires de Saint-Simon, de Boisguillebert, de Vauban en donnent de nombreux exemples. Mais le témoignage le plus saisissant est peut-être celui de Fénelon qui, dans sa "Lettre au roi" de 1693, le supplie d'écouter une vérité qu'il n'est "guère accoutumé à entendre" tout en s'exprimant sur un infini ton de déférence et de respect...
"Depuis environ trente ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes de l'Etat, pour faire monter jusqu'au comble votre autorité, qui était devenue la leur, parce qu'elle était dans leurs mains. On n'a plus parlé de l'Etat ni des règles; on n'a parlé que du roi et de son bon plaisir. On a poussé vos revenus et vos dépenses à l'infini.
On vous a élevé jusqu'au ciel, pour avoir effacé, disait-on, la grandeur de tous vos prédécesseurs ensemble, c'est-à-dire, pour avoir appauvri la France entière, afin d'introduire à la Cour un luxe monstrueux et incurable. Ils ont voulu vous élever sur les ruines de toutes les conditions de l'Etat; comme si vous pouviez être grand en ruinant tous vos sujets, sur qui votre grandeur est fondée. Il est vrai que vous avez été jaloux de l'autorité, peut-être même trop dans les choses extérieures; mais pour le fond, chaque ministre a été le maître de l'étendue de son administration.
Vous avez cru gouverner, parce que vous avez réglé les limites entre ceux qui gouvernaient. Ils ont bien montré au public leur puissance, et on ne l'a que trop sentie. Ils ont été durs, hautains, injustes, violents, de mauvaise foi. Ils n 'ont connu d'autre règle, ni pour l'administration du dedans de l'Etat, ni pour les négociations étrangères, que de menacer, que d'écraser, que d'anéantir tout ce qui leur résistait. Ils ne vous ont parlé, que pour écarter de vous tout mérite qui pouvait leur faire ombrage. Ils vont ont accoutumé à recevoir sans cesse des louanges outrées qui vont jusqu'à l'idolâtrie, et que vous auriez dû, pour votre honneur, rejeter avec indignation. On a rendu votre nom odieux, et toute la nation française insupportable à tous nos voisins. On n'a conservé aucun ancien allié parce qu 'on n'a voulu que des esclaves. On a causé depuis plus de vingt ans des guerres sanglantes. Par exemple, Sire, on fit entreprendre à Votre Majesté, en 1671, la guerre de Hollande pour votre gloire, et pour punir les Hollandais, qui avaient fait quelque raillerie, dans le chagrin où on les avait mis en troublant les règles du commerce établies par le cardinal de Richelieu.
Je cite en particulier cette guerre, parce qu'elle a été la source de toutes les autres. Elle n'a eu pour fondement qu 'un motif de vengeance, ce qui ne peut jamais rendre une guerre juste; d 'où il s'ensuit que toutes les frontières que vous avez étendues par cette guerre sont injustement acquises dans l'origine. Il est vrai, Sire, que les traités de paix subséquents semblent couvrir et réparer cette injustice puisqu 'ils vous ont donné les places conquises : mais une guerre injuste n'en est pas moins injuste, pour être heureuse.
Cependant vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu'ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée : les villes et la campagne se dépeuplent, tous les métiers languissent et ne nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéanti. Par conséquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre Etat, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au-dehors.
Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d'Etat. Vous êtes importuné de la foule des gens qui demandent et qui murmurent. C'est vous-même, Sire, qui vous êtes attiré tous ces embarras, car, tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains, et personne ne peut plus vivre que de vos dons. Voilà ce grand royaume si florissant sous un roi qu'on nous dépeint comme les délices du peuple, et qui le serait en effet si les conseils flatteurs ne l'avaient point empoisonné...."

Boileau (1636-1711)
Il y a peu d'écrivains qui ont été aussi lus que Boileau, constatera G. Lanson : en France on comptera 60 éditions complètes de son oeuvre, du vivant de l'auteur, et plus de 200, de 1711 à 1832. Pour un auteur dont la lecture n'est pas d'une évidence absolue, son influence fut considérable, et notamment dans toute l'Europe, ramenant, en littérature, les beaux esprits vers la simplicité et le sens commun, en Angleterre, en Allemagne, en Italie (Dryden, Pope, Gottsched, Lessing), et au-delà, mais si entretemps on en avait plus parlé que lu...
Issu de la bourgeoisie de robe, Nicolas Boileau-Despréaux, naquit à Paris en 1636, l'année du Cid, rue de Jérusalem , tout à côté du Palais-de-Justice. Son père était greffier au Parlement. Il fit de bonnes études classiques, puis étudia la théologie et le droit; mais il se mêla tôt aux poètes satiriques que fréquentait son frère Gilles, ami de Chapelain et de l'abbé d'Aubignac, ennemi de Ménage. Sa première Satire, composée on 1658, fut publiée en 1666, l'année du Misanthrope. Après 1657, l'héritage paternel lui permet de vivre indépendant et il commence à écrire des satires dont le contenu varie selon les circonstances : son admiration pour Molière, rencontré en 1661, et sa colère contre Chapelain (1663) s'y inscrivent tout naturellement. En 1666, il compose le "Dialogue des Héros de roman", satire des romans d'aventures galantes. Ces années sont marquées par une véritable petite guerre de pamphlets, satires, discours et opuscules de toutes sortes. Coten et Coras attaquent violemment Boileau, Molière et Furetière.
Mais à partir de 1668, Boileau mène une vie plus régulière et rédige des œuvres moins combatives; il fréquente les salons, et en particulier l'Académie du président Lamoignon, se fait présenter au roi en 1674, et reçoit une pension de 2000 livres. Il devient même historiographe du roi en 1677, ainsi que Racine qu'il défend au moment de la Cabale de Phèdre. Tout en ne publiant que peu d'oeuvres poétiques, il continue à jouer un grand rôle dans la vie littéraire : il est élu en 1684 à l'Académie française et intervient dans la lutte des Anciens et des Modernes déclenchée par Claude Perrault qui avait soutenu que les Modernes égalaient et parfois surpassaient les Anciens.
En 1694, il publie des "Réflexíons Critiques". En 1698, trois épîtres, dont l'une défend avec vigueur les thèses jansénistes. Et par ses sympathies pour le jansénisme il s'aliène Louis XIV, qu'il avait jusque-là fidèlement servi. Il meurt en 1711, sans avoir publié sa douzième satire, dirigée elle aussi contre la casuistique.
Le théoricien Boileau n'a pas été, comme on l'a cru longtemps, le législateur du Parnasse et le maître des grands classiques; il n'a pas approfondi les grands principes qui régissaient l'art de son temps, il n'a pas cherché à élucider les mystères de la création littéraire, ou a préciser la signification humaine des grandes oeuvres, mais il a réalisé une synthèse commode qui nous aide, bien que partielle, à voir clair dans ce siècle fécond. Il fait preuve d`un goût sévère, mais souvent sûr, et la postérité n'a eu qu'à ratifier sa vigoureuse apologie de Racine et de Molière :
"Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces,
Sont recherchés du peuple et reçus chez les princes?
Ce n'est pas que leurs sons, agréables, nombreux,
Soient toujours à l'oreille également heureux,
Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure,
Et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure:
Mais c'est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur,
Partout se montre aux yeux et va saisir le cœur;
Que le bien et le mal sont prisés au juste;
Que jamais un faquin n'y tint un rang auguste;
Et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit,
Ne dit rien aux lecteurs qu'à soi-même il n'ait dit,
Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose;
Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose."
(Epître IX)

1666-1668 - Satires
Quand Boileau commence d'écrire vers 1660, il a ce constat, que le "bon sens" n'est pas encore la qualité première de la littérature française, un "bon sens" qui est "vérité " et "nature". Comment écrivent et pensent les futures victimes de ses Satires? Certains usent de cette délicatesse aristocratique qui fait mépriser la simplicité comme par trop grossière; d'autres, se sont érigés en romanciers à grands sentiments ou tragiques doucereux, et vont ainsi inventer des modes de penser et de sentir que l'âme humaine n'avait jamais éprouvés, un héroïsme plus héroïque, un amour plus amoureux que tout ce qu'on voit dans la vie. Reprenant le fameux genre littéraire légitimé par le modèle antique (Horace, et surtout Juvénal) qu'est la Satire, le jeune Boileau, - il a 30 ans -, se met ainsi à l'ouvrage pour railler les mœurs du temps (VI, dite « des embarras de Paris »), les moeurs bourgeoises (I, III, VI), les lieux communs de la philosophie morale (IV, V, VIII), la vie littéraire et les auteurs galants à la mode (II, III, VII). Une douzaine de satires destinées à être lues dans les Salons dont le rythme des publications fut lié à la crainte des plagiats et contrefaçons.
Des satires qui lui valent la réputation d'être un esprit chagrin, de solides inimitiés et des attaques, auxquelles il répliquera (Discours sur la Satire). Mais il a pris soin toutefois de déminer une éventuelle réaction de Cour et a couvert, dans une Epître, de louanges Louis XIV, "Quand je vois ta sagesse, en ses justes projets, D'une heureuse abondance enrichir tes sujets, Fouler aux pieds l'orgueil et du Tage et du Tibre, Nous faire de la mer une campagne libre, Et tes braves guerriers, secondant ton grand cœur. Rendre à l'aigle éperdu sa première vigueur, La France sous tes lois maîtriser la fortune..". Il peut alors se livrer à la condamnation d'un Chapelain pour sa dureté laborieuse, d'un Scudéry pour sa fécondité stérile, d'un Quinault pour sa fade tendresse, et des romans pour le ridicule travestissement de l'antiquité...
Boileau ne répondit particulièrement à aucun des pamphlets qu'on fit contre lui. Particulièrement et nominativement. Plus modéré dans sa propre cause que dans celle de son ami Racine, il ne se laissa pas engager dans la voie des polémiques virulentes et des diffamations injurieuses, comme il le fit dans l'affaire de Phèdre. Il se contenta d'affirmer dans ses Préfaces qu'il avait usé de son droit en critiquant des auteurs comme auteurs, que du reste on pouvait écrire contre ses œuvres, «attendu qu'il était de l'essence d'un bon livre d'avoir des censeurs».
Mais s'il ne répliquait pas directement, il réglait ses comptes par l'intermédiaire d'une épître ou d'une épigramme ou de n'importe quel ouvrage en vers ou en prose; mais plus encore contre par exemple le plus modéré de ses ennemis, contre Boursault, il fit demande et obtint un arrêt du Parlement pour interdire aux comédiens du Marais de représenter une Satire des Satires, que Boursault leur avait donnée. Enfin il savait intriguer pour empêcher l'œuvre où il était diffamé de s'imprimer et de se vendre. En cela, "comme dans sa dure poésie, le bonhomme était un réaliste..." (G.Lanson).
Mais la littérature était toute la vie de Boileau et il se faisait une très haute idée de l'écrivain, tant pour lui-même que pour les autres...
Les sept premières satires, courtes et assez agressives, sont ordonnées à fustiger un contexte social et à lui fournir un remède "mondain", à une époque où l'emportent une imagination burlesque et des jeux de pensées qui s'avèrent le plus souvent stériles et vont jusqu'à corrompre tout jugement et notre sens des réalités. On ne sert plus, pour le dire plus prosaïquement, de ses yeux pour voir, et de sa bouche pour traduire la sensation de ses yeux. Molière est, par exemple, pour Boileau, le premier, qui sait renoncer aux bouffonneries fantastiques et aux énormes charges où la comédie s'était enlisée, et faut-il après suivre un La Fontaine qui écrit "Et maintenant il ne faut pas Quitter la nature d'un pas..."

Satire I, "Adieu d'un poète à la ville de Paris", composée en 1657.
Première satire, plusieurs fois remaniée, publiée en 1666, le début satirique de Boileau à l’âge de vingt-quatre ans, la vie sociale urbaine est marquée à Paris du sceau du mensonge financier et du mal-dire des poètes, sont attaqués grands voleurs (Rolet, Mouleron,Sylvain)et puissants (le le cardinal de Retz?). Le célèbre passage sur les "embarras" fut retiré, "l'autheur aiant reconnu qu'un trop long détail des embarras de Paris languissoit, il résolut d'en faire une satire à part..."
Damon, ce grand auteur dont la muse fertile
Amusa si longtemps et la cour et la ville,
Mais qui, n’étant vêtu que de simple bureau,
Passe l’été sans linge, et l’hiver sans manteau,
Et de qui le cœur sec et la mine affamée
N’en sont pas mieux refaits pour tant de renommée ;
Las de perdre en rimant et sa peine et son bien,
D’emprunter en tous lieux, et de ne gagner rien,
Sans habits, sans argent, ne sachant plus que faire,
Vient de s’enfuir, chargé de sa seule misère ;
Et, bien loin des sergens, des clercs et du palais,
Va chercher un repos qu’il ne trouva jamais ;
Sans attendre qu’ici la justice ennemie
L’enferme en un cachot le reste de sa vie,
Ou que d’un bonnet vert le salutaire affront
Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front.
Mais le jour qu’il partit, plus défait et plus blême
Que n’est un pénitent sur la fin d’un carême,
La colère dans l’âme et le feu dans les yeux,
Il distilla sa rage en ces tristes adieux :
«Puisqu’en ce lieu, jadis aux Muses si commode.
Le mérite et l’esprit ne sont plus à la mode ;
Qu’un poëte, dit-il, s’y voit maudit de Dieu,
Et qu’ici la vertu n’a plus ni feu ni lieu,
Allons du moins chercher quelque antre ou quelque roche
D’où jamais ni l’huissier ni le sergent n’approche :
Et, sans lasser le ciel par des vœux impuissans,
Mettons-nous à l’abri des injures du temps,
Tandis que, libre encor malgré les destinées,
Mon corps n’est point courbé sous le poids des années.
Qu’on ne voit point mes pas sous l’âge chanceler,
Et qu’il reste à la Parque encor de quoi filer :
C’est là dans mon malheur le seul conseil à suivre.
Que George vive ici, puisque George y sait vivre,
Qu’un million comptant, par ses fourbes acquis,
De clerc, jadis laquais, a fait comte et marquis ;
Que Jaquin vive ici, dont l’adresse funeste
A plus causé de maux que la guerre et la peste,
Qui de ses revenus écrits par alphabet
Peut fournir aisément un calepin complet ;
Qu’il règne dans ces lieux, il a droit de s’y plaire.
Mais moi, vivre à Paris ! Eh ! qu’y voudrois-je faire ?
Je ne sais ni tromper, ni feindre, ni mentir,
Et, quand je le pourrois, je n’y puis consentir.
Je ne sais point en lâche essuyer les outrages
D’un faquin orgueilleux qui vous tient à ses gages,
De mes sonnets flatteurs lasser tout l’univers,
Et vendre au plus offrant mon encens et mes vers ;
Pour un si bas emploi ma muse est trop altière.
Je suis rustique et fier, et j’ai l’âme grossière :
Je ne puis rien nommer, si ce n’est par son nom ;
J’appelle un chat un chat, et Rolet un fripon.
De servir un amant, je n’en ai pas l’adresse ;
J’ignore ce grand art qui gagne une maîtresse.
Et je suis, à Paris, triste, pauvre et reclus.
Ainsi qu’un corps sans âme, ou devenu perclus.
« Mais pourquoi, dira-t-on, cette vertu sauvage
Qui court à l’hôpital, et n’est plus en usage ?
La richesse permet une juste fierté ;
Mais il faut être souple avec la pauvreté :
C’est par là qu’un auteur que presse l’indigence
Peut des astres malins corriger l’influence,
Et que le sort burlesque, en ce siècle de fer,
D’un pédant, quand il veut, sait faire un duc et pair.
"Tandis que Colletet, crotté jusqu’à l’échine,
S’en va chercher son pain de cuisine en cuisine,
Savant en ce métier, si cher aux beaux esprits,
Dont Montmaur autrefois fit leçon dans Paris...."
Ainsi de la vertu la fortune se joue :
Tel aujourd’hui triomphe au plus haut de sa roue,
Qu’on verroit, de couleurs bizarrement orné,
Conduire le carrosse où l’on le voit traîné,
Si dans les droits du roi sa funeste science
Par deux ou trois avis n’eût ravagé la France.
Je sais qu’un juste effroi l’éloignant de ces lieux
L’a fait pour quelques mois disparoître à nos yeux.
Mais en vain pour un temps une taxe l’exile,
On le verra bientôt, pompeux en cette ville,
Marcher encor chargé des dépouilles d’autrui
Et jouir du ciel même irrité contre lui ;
Tandis que Colletet, crotté jusqu’à l’échine,
S’en va chercher son pain de cuisine en cuisine,
Savant en ce métier, si cher aux beaux esprits,
Dont Montmaur autrefois fit leçon dans Paris.
« Il est vrai que du roi la bonté secourable
Jette enfin sur la muse un regard favorable ;
Et, réparant du sort l’aveuglement fatal,
Va tirer désormais Phébus de l’hôpital.
On doit tout espérer d’un monarque si juste,
Mais sans un Mécénas à quoi sert un Auguste ?
Et fait comme je suis, au siècle d’aujourd’hui,
Qui voudra s’abaisser à me servir d’appui ?
Et puis, comment percer cette foule effroyable
De rimeurs affamés dont le nombre l’accable ;
Qui, dès que sa main s’ouvre, y courent les premiers,
Et ravissent un bien qu’on devoit aux derniers,
Comme on voit les frelons, troupe lâche et stérile,
Aller piller le miel que l’abeille distille ?
Cessons donc d’aspirer à ce prix tant vanté
Que donne la faveur à l’importunité.
Saint-Amant n’eut du ciel que sa veine en partage,
L’habit qu’il eut sur lui fut son seul héritage,
Un lit et deux placets composoient tout son bien
Ou, pour en mieux parler, Saint-Amant n’avoit rien.
Mais quoi ! las de traîner une vie importune,
Il engagea ce rien pour chercher la fortune,
Et, tout chargé de vers qu’il devoit mettre au jour,
Conduit d’un vain espoir, il parut à la cour.
Qu’arriva-t-il enfin de sa muse abusée ?
Il en revint couvert de honte et de risée ;
Et la fièvre, au retour, terminant son destin.
Fit par avance en lui ce qu’auroit tait la faim
Un poëte à la cour fut jadis à la mode ;
Mais des fous aujourd’hui c’est le plus incommode.
Et l’esprit le plus beau, l’auteur le plus poli,
N’y parviendra jamais au sort de l’Angéli.
« Faut-il donc désormais jouer un nouveau rôle ?
Dois-je, las d’Apollon, recourir à Barthole ?
Et, feuilletant Louet allongé par Brodeau,
D’une robe à longs plis balayer le barreau ?
Mais à ce seul penser je sens que je m’égare
Moi ! que j’aille crier dans ce pays barbare,
Où l’on voit tous les jours l’innocence aux abois
Errer dans les détours d’un dédale de lois,
Et, dans l’amas confus des chicanes énormes.
Ce qui fut blanc au fond rendu noir par les formes ?
Où Patru gagne moins qu’Huot et Le Mazier,
Et dont les Cicérons se font chez Pé-Fournier !
Avant qu’un tel dessein m’entre dans la pensée,
On pourra voir la Seine à la Saint-Jean glacée ;
Arnauld à Charenton devenir huguenot,
Saint-Sorlin janséniste, et Saint-Pavin bigot.
« Quittons donc pour jamais une ville importune.
Où l’honneur a toujours guerre avec la fortune ;
Où le vice orgueilleux s’érige en souverain,
Et va la mitre en tête et la crosse à la main ;
Où la science triste, affreuse, délaissée,
Est partout des bons lieux comme infâme chassée ;
Où le seul art en vogue est l’art de bien voler ;
Où tout me choque ; enfin, où… je n’ose parler,
Et quel homme si froid ne seroit plein de bile,
À l’aspect odieux des mœurs de cette ville ?
Qui pourroit les souffrir ? et qui, pour les blâmer,
Malgré Muse et Phébus n’apprendroit à rimer ?
Non, non, sur ce sujet pour écrire avec grâce,
Il ne faut point monter au sommet du Parnasse ;
Et, sans aller rêver dans le double vallon,
La colère suffit, et vaut un Apollon.
« Tout beau, dira quelqu’un, vous entrez en furie,
« À quoi bon ces grands mots ? doucement, je vous prie :
« Ou bien montez en chaire ; et là, comme un docteur,
« Allez de vos sermons endormir l’auditeur :
« C’est là que bien ou mal on a droit de tout dire. »
Ainsi parle un esprit qu’irrite la satire,
Qui contre ses défauts croit être en sûreté
En raillant d’un censeur la triste austérité ;
Qui fait l’homme intrépide, et, tremblant de foiblesse,
Attend pour croire en Dieu que la fièvre le presse ;
Et, toujours dans l’orage au ciel levant les mains,
Dès que l’air est calmé, rit des foibles humains.
Car de penser alors qu’un Dieu tourne le monde,
Et règle les ressorts de la machine ronde.
Ou qu’il est une vie au delà du trépas,
C’est la, tout haut du moins, ce qu’il n’avouera pas.
Pour moi, qu’en santé même un autre monde étonne,
Qui crois l’âme immortelle, et que c’est Dieu qui tonne,
Il vaut mieux pour jamais me bannir de ce lieu,
Je me retire donc. Adieu, Paris, adieu.

Satire II, A M. de Molière, La Rime et la Raison, composée en 1662, publiée en 1664 -
A Molière, de la difficulté d'accorder la rime à la raison - Boileau voit dans l'art poétique, art du dire juste, une voie de redressement dont Molière serait le maître. Sacrifier la raison à la rime serait chercher la beauté ailleurs que dans la vérité, c'est-à-dire tourner l'art contre son but, qui est de créer dans la forme un équivalent sensible de l'idée...
"Toi donc qui vois les maux où ma muse s’abîme. / De grâce, enseigne-moi l’art de trouver la rime : / Ou, puisque enfin tes soins y seroient superflus, / Molière, enseigne-moi l’art de ne rimer plus."
Rare et fameux esprit, dont la fertile veine
Ignore en écrivant le travail et la peine ;
Pour qui tient Apollon tous ses trésors ouverts,
Et qui sais à quel coin se marquent les bons vers,
Dans les combats d’esprit savant maître d’escrime,
Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime.
On diroit, quand tu veux, qu’elle te vient chercher
Jamais au bout du vers on ne te voit broncher ;
Et, sans qu’un long détour t’arrête, ou t’embarrasse,
À peine as-tu parlé, qu’elle-même s’y place.
Mais moi, qu'un vain caprice, une bizarre humeur,
Pour mes péchés, je crois, fit devenir rimeur,
Dans ce rude métier où mon esprit se tue,
En vain, pour la trouver, je travaille et je sue.
Souvent j’ai beau rêver du matin jusqu’au soir ;
Quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir.
Si je veux d’un galant dépeindre la figure,
Ma plume pour rimer trouve l’abbé de Pure;
Si je pense exprimer un auteur sans défaut,
La raison dit Virgile, et la rime Quinault.
Enfin, quoi que je fasse ou que je veuille faire,
La bizarre toujours vient m’offrir le contraire.
De rage quelquefois, ne pouvant la trouver,
Triste, las et confus, je cesse d’y rêver ;
Et, maudissant vingt fois le démon qui m’inspire,
Je fais mille sermens de ne jamais écrire.
Mais, quand j'ai bien maudit et Muses et Phébus,
Je la vois qui paroît quand je n’y pense plus :
Aussitôt, malgré moi, tout mon feu se rallume ;
Je reprends sur-le-champ le papier et la plume ;
Et, de mes vains sermens perdant le souvenir,
J’attends de vers en vers qu’elle daigne venir.
Encor si pour rimer dans sa verve indiscrète,
Ma muse au moins souffroit une froide épithète,
Je ferois comme un autre ; et, sans chercher si loin,
J’aurois toujours des mots pour les coudre au besoin.
Si je louois Philis en miracles féconde,
Je trouverois bientôt, à nulle autre seconde ;
Si je voulois vanter un objet nonpareil,
Je mettrais à l’instant, plus beau que le soleil;
Enfin parlant toujours d’astres et de merveilles,
De chefs-d’œuvre des cieux, de beautés sans pareilles.
Avec tous ces beaux mots, souvent mis au hasard,
Je pourrois aisément, sans génie et sans art,
Et transportant cent fois et le nom et le verbe,
Dans mes vers recousus mettre en pièces Malherbe.
Mais mon esprit, tremblant sur le choix de ses mots.
N’en dira jamais un, s’il ne tombe à propos,
Et ne sauroit souffrir qu’une phrase insipide
Vienne à la fin d’un vers remplir la place vide ;
Ainsi recommençant un ouvrage vingt fois,
Si j’écris quatre mots, j’en effacerai trois.
Maudit soit le premier dont la verve insensée
Dans les bornes d’un vers renferma sa pensée.
Et, donnant à ses mots une étroite prison.
Voulut avec la rime enchaîner la raison !
Sans ce métier fatal au repos de ma vie,
Mes jours, pleins de loisir, couleroient sans envie.
Je n’aurois qu’à chanter, rire, boire d’autant,
Et, comme un gras chanoine, à mon aise et content,
Passer tranquillement, sans souci, sans affaire,
La nuit à bien dormir, et le jour à rien faire.
Mon cœur, exempt de soins, libre de passion,
Sait donner une borne à son ambition ;
Et, fuyant des grandeurs la présence importune.
Je ne vais point au Louvre adorer la fortune
Et je serois heureux si, pour me consumer,
Un destin envieux ne m’avoit fait rimer.
Mais depuis le moment que cette frénésie
De ses noires vapeurs troubla ma fantaisie,
Et qu’un démon jaloux de mon contentement
M’inspira le dessein d’écrire poliment.
Tous les jours malgré moi, cloué sur un ouvrage,
Retouchant un endroit, effaçant une page,
Enfin passant ma vie en ce triste métier.
J’envie, en écrivant, le sort, de Pelletier.
Bienheureux Scudéri, dont la fertile plume
Peut tous les mois sans peine enfanter un volume ?
Tes écrits, il est vrai, sans art et languissans,
Semblent être formés en dépit du bon sens,
Mais ils trouvent pourtant, quoi qu’on en puisse dire,
Un marchand pour les vendre, et des sots pour les lire ;
Et quand la rime enfin se trouve au bout des vers,
Qu’importe que le reste y soit mis de travers ?

Satire III, Le Repas ridicule, écrite en 1665, publiée en 1666.
Le jeune satirique y parle, comme dit Voltaire, «d'un fort mauvais repas en très beaux vers», tout l'art du dialogue pour relater en cent soixante dix vers un repas ridicule et le peu d'esprit dont font preuve les convives, "Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques S'élevaient trois lapins, animaux domestiques, Qui, dès leur tendre enfance, élevés dans Paris, Sentaient encor le chou dont ils furent nourris..". Les envieux répéteront que tout cela était traduit d'Horace et le public estimera que, traduit ou non, le dessin était ferme et le pittoresque achevé dans ces vers qu'on récitait partout, et chacun y reconnaîtra des personnages connus, le comte de Broussin, dit le Roi des gourmands, Villandri, gentilhomme de la Chambre du Roi, buveur et mangeur réputé, le commandeur de Souvré, une autre fourchette remarquable, le pâtissier-traiteur de la rue de la Harpe, Jacques Mignot. Tout Paris bruissait alors du Tartuffe interdit à la scène et que Molière lisait dans les maisons, où on l'invitait....
Quel sujet inconnu vous trouble et vous altère.
D'où vous vient aujourd'hui cet air sombre et sévère.
Et ce visage enfin plus pâle qu'un rentier
A l'aspect d'un arrêt qui retranche un quartier'?
Qu'est devenu ce teint dont la couleur fleurie
Sembloit d'ortolans seuls et de bisques nourrie.
Où la joie en son lustre attiroit les regards.
Et le vin en rubis brilloit de toutes parts?
Qui vous a pu plonger dans cette humeur chagrine ?
A-t-on par quelque édit réformé la cuisine ?
Ou quelque longue pluie, inondant vos vallons
A-t-elie fait couler vos vins et vos melons ?
Répondez donc enfin, ou bien je me retire.
P. Ah! de grâce, un moment, souffrez que je respire.
Je sors de chez un fat qui, pour m'empoisonner ,
Je pense , exprès chez lui m'a forcé de dîner.
Je l'avois bien prévu. Depuis près d'une année
J'éludois tous les jours sa poursuite obstinée.
Mais hier il m'aborde, et me serrant la main,
Ah ! monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends demain.
N'y manquez pas au moins. J'ai quatorze bouteilles
D'un vin vieux.... Boucingo n'en a point de pareilles;
Et je gagerois bien que , chez le commandeur ,
Villandri priseroit sa sève et sa verdeur.
Molière avec Tartuffe y doit jouer son rôle:
Molière avec Tartuffe y doit jouer son rôle ;
Et Lambert, qui plus est, m’a donné sa parole.
C’est tout dire en un mot, et vous le connoissez.
- Quoi ! Lambert ? - Oui, Lambert. À demain. - C’est assez. »
Ce matin donc, séduit par sa vaine promesse,
J’y cours midi sonnant, au sortir de la messe.
À peine etois-je entré, que, ravi de me voir,
Mon homme, en m’embrassant, m’est venu recevoir ;
Et, montrant à mes yeux une allégresse entière,
« Nous n’avons, m’a-t-il dit, ni Lambert ni Molière ;
Mais, puisque je vous vois, je me tiens trop content.
Vous êtes un brave homme ; entrez, on vous attend. »
À ces mots, mais trop tard, reconnoissant ma faute.
Je le suis en tremblant dans une chambre haute,
Où, malgré les volets, le soleil irrité
Formoit un poêle ardent au milieu de l’été.
Le couvert étoit mis dans ce lieu de plaisance,
Où j’ai trouvé d’abord, pour toute connoissance,
Deux nobles campagnards grands liseurs de romans,
Qui m’ont dit tout Cyrus dans leurs longs complimens.
J’enrageois. Cependant on apporte un potage.
Un coq paroissoit en pompeux équipage,
Qui, changeant sur ce plat et d’état et de nom,
Par tous les conviés s’est appelé chapon.
Deux assiettes suivoient, dont l’une étoit ornée
D’une langue en ragoût, de persil couronnée ;
L’autre, d’un godiveau tout brûlé par dehors,
Dont un beurre gluant inondoit tous les bords.
On s’assied : mais d’abord notre troupe serrée
Tenoit à peine autour d’une table carrée,
Ou chacun, malgré soi, l’un sur l’autre porté,
Faisoit un tour à gauche, et mangeoit de côté.
Jugez en cet état si je pouvois me plaire,
Moi qui ne compte rien ni le vin ni la chère,
Si l’on n’est plus au large assis en un festin
Qu’aux sermons de Cassagne, ou de l’abbé Cotin.
Notre hôte cependant, s’adressant à la troupe,
« Que vous semble, a-t-il dit, du goût de cette soupe ?
Sentez-vous le citron dont on a mis le jus
Avec des jaunes d’oeufs mêlés dans du verjus ?
Ma foi, vive Mignot et tout ce qu’il apprête ! »
Les cheveux cependant me dressoient à la tête :
Car Mignot, c’est tout dire ; et dans le monde entier
Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier.
J'approuvois tout pourtant de la mine et du geste,
Pensant qu’au moins le vin dût réparer le reste.
Pour m’en éclaircir donc, j’en demande ; et d’abord
Un laquais effronté m’apporte un rouge-bord
D’un Auvernat fameux qui, mêlé de Lignage,
Se vendoit chez Crenet pour vin de l’Ermitage,
Et qui, rouge et vermeil, mais fade et doucereux.
N’avoit rien qu’un goût plat, et qu’un déboire affreux.
À peine ai-je senti cette liqueur traîtresse,
Que de ces vins mêlés j’ai reconnu l’adresse :
Toutefois avec l’eau que j’y mets à foison
J’espérois adoucir la force du poison.
Mais, qui l’auroit pensé ? pour comble de disgrâce,
Par le chaud qu’il faisoit nous n’avions point de glace.
"J’allois sortir enfin quand le rôt a paru.
Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
S’élevoient trois lapins, animaux domestiques ....."
Point de glace, bon Dieu ! dans le fort de l’été !
Au mois de juin ! Pour moi, j’étois si transporté,
Que, donnant de fureur tout le festin au diable,
Je me suis vu vingt fois prêt à quitter la table ;
Et, dût-on m’appeler et fantasque et bourru,
J’allois sortir enfin quand le rôt a paru.
Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
S’élevoient trois lapins, animaux domestiques.
Qui, dès leurs tendres ans, élevés dans Paris,
Sentoient encor le chou dont ils furent nourris,
autour de cet amas de viandes entassées
Régnoit un long cordon d’alouettes pressées,
Et sur les bords du plat six pigeons étalés
Présentoient pour renfort leurs squelettes brûlés.
A côté de ce plat paroissoient deux salades,
L’une de pourpier jaune, et l’autre d’herbes fades,
Dont l’huile de fort loin saisissoit l’odorat,
Et nageoit dans des flots de vinaigre rosat.
Tous mes sots, à l’instant changeant de contenance.
Ont loué du festin la superbe ordonnance ;
Tandis que mon faquin qui se voyoit priser,
Avec un ris moqueur les prioit d’excuser.
Surtout certain hâbleur, à la gueule affamée,
Qui vint à ce festin conduit par la fumée,
Et qui s’est dit profes dans l’ordre des coteaux.
À fait en bien mangeant l’éloge des morceaux.
Je riois de le voir avec sa mine étique,
Son rabat jadis blanc, et sa perruque antique,
En lapins de garenne ériger nos clapiers,
Et nos pigeons cauchois en superbes ramiers,
Et, pour flatter notre hôte, observant son visage,
Composer sur ses yeux son geste et son langage ;
Quand notre hôte charmé, m’avisant sur ce point :
« Qu’avez-vous donc, dit-il, que vous ne mangez point ?
Je vous trouve aujourd’hui l’âme tout inquiète.
Et les morceaux entiers restent sur votre assiette.
Aimez-vous la muscade ? on en a mis partout.
Ah ! monsieur, ces poulets sont d’un merveilleux goût ;
Ces pigeons sont dodus : mangez, sur ma parole,
J’aime à voir aux lapins cette chair blanche et molle.
Ma foi, tout est passable, il le faut confesser,
Et Mignot aujourd’hui s’est voulu surpasser.
Quand on parle de sauce, il faut qu’on y raffine ;
Pour moi, j’aime surtout que le poivre y domine ;
J’en suis fourni, Dieu sait ! et j’ai tout Pelletier
Roulé dans mon office en cornets de papier. »
A tous ces beaux discours j’étois comme une pierre,
Ou comme la statue est au Festin de Pierre;
Et, sans dire un seul mot, j’avalois au hasard
Quelque aile de poulet dont j’arrachois le lard.
"Et la troupe à l’instant, cessant de fredonner,
D’un ton gravement fou s’est mise à raisonner,
Le vin au plus muet fournissant des paroles,
Chacun a débité ses maximes frivoles.."
Cependant mon hâbleur, avec une voix haute,
Porte à mes campagnards la santé de notre hôte.
Qui tous deux pleins de joie, en jetant un grand cri,
Avec un rouge-bord acceptent son défi.
Un si galant exploit réveillant tout le monde,
On a porté partout des verres à la ronde,
Où les doigts des laquais, dans la crasse tracés,
Témoignoient par écrit qu’on les avoit rincés :
Quand un des conviés, d’un ton mélancolique,
Lamentant tristement une chanson bachique,
Tous mes sots à la fois ravis de l’écouter,
Détonnant de concert, se mettent à chanter.
La musique sans doute étoit rare et charmante !
L’un traîne en longs fredons une voix glapissante ;
Et l’autre, l’appuyant de son aigre fausset,
Semble un violon faux qui jure sous l’archet.
Sur ce point, un jambon d’assez maigre apparence,
Arrive sous le nom de jambon de Mayence.
Un valet le portoit, marchant à pas comptés,
Comme un recteur suivi des quatre facultés.
Deux marmitons crasseux, revêtus de serviettes,
Lui servoient de massiers, et portoient deux assiettes,
L’une de champignons avec des ris de veau,
Et l’autre de pois verts qui se noyoient dans l’eau.
Un spectacle si beau surprenant l’assemblée,
Chez tous les conviés la joie est redoublée ;
Et la troupe à l’instant, cessant de fredonner,
D’un ton gravement fou s’est mise à raisonner,
Le vin au plus muet fournissant des paroles,
Chacun a débité ses maximes frivoles,
Réglé les intérêts de chaque potentat,
Corrigé la police, et réformé l’État :
Puis, de là s’embarquant dans la nouvelle guerre,
A vaincu la Hollande ou battu l’Angleterre.
Enfin, laissant en paix tous ces peuples divers,
De propos en propos on a parlé de vers.
Là, tous mes sots, enflés d’une nouvelle audace,
Ont jugé des auteurs en maîtres du Parnasse :
Mais notre hôte surtout, pour la justesse et l’art,
Elevoit jusqu’au ciel Théophile et Ronsard,
Quand un des campagnards relevant sa moustache,
Et son feutre à grands poils ombragé d’un panache,
Impose à tous silence, et d’un ton de docteur :
« Morbleu ! dit-il, La Serre est un charmant auteur !
Ses vers sont d’un beau style, et sa prose est coulante.
La Pucelle est encore un œuvre bien galante,
Et je ne sais pourquoi je bâille en la lisant.
Le Pays, sans mentir, est un bouffon plaisant :
Mais je ne trouve rien de beau dans ce Voiture,
Ma foi, le jugement sert bien dans la lecture.
À mon gré, le Corneille est joli quelquefois.
En vérité, pour moi j’aime le beau françois
Et je ne sais pas pourquoi l’on vante l'Alexandre,
Ce n’est qu’un glorieux qui ne dit rien de tendre.
Les héros chez Quinault parlent bien autrement,
Et jusqu’à Je vous hais, tout s’y dit tendrement.
On dit qu’on l’a drapé dans certaine satire ;
Qu’un jeune homme. — Ah ! je sais ce que vous voulez dire,
À répondu notre hôte : « Un auteur sans défaut,
« La raison dit Virgile, et la rime Quinault. »
— Justement. À mon gré, la pièce est assez plate
Et puis, blâmer Quinault ! … Avez-vous vu l’Astrate ?
C’est là ce qu’on appelle un ouvrage achevé.
Surtout l’anneau royal me semble bien trouvé.
Son sujet est conduit d’une belle manière ;
Et chaque acte, en sa pièce, est une pièce entière.
Je ne puis plus souffrir ce que les autres font.
— Il est vrai que Quinault est un esprit profond,
A repris certain fat qu’à sa mine discrète
Et son maintien jaloux j’ai reconnu poëte ;
Mais il en est pourtant qui le pourroient valoir.
— Ma foi, ce n’est pas vous qui nous le ferez voir, »
A dit mon campagnard avec une voix claire.
Et déjà tout bouillant de vin et de colère.
« Peut-être, a dit l’auteur pâlissant de courroux :
Mais vous, pour en parler, vous y connoissez-vous !
— Mieux que vous mille fois, dit le noble en furie.
— Vous ? mon Dieu ! mêlez-vous de boire, je vous prie, »
À l’auteur sur-le-champ aigrement reparti.
« Je suis donc un sot, moi ? vous en avez menti, »
Reprend le campagnard ; et, sans plus de langage,
Lui jette pour défi son assiette au visage.
L’autre esquive le coup ; et l’assiette volant
S’en va frapper le mur, et revient en roulant.
À cet affront l’auteur, se levant de la table,
Lance à mon campagnard un regard effroyable :
Et, chacun vainement se ruant entre deux,
Nos braves s’accrochant se prennent aux cheveux.
Aussitôt sous leurs pieds les tables renversées
Font voir un long débris de bouteilles cassées :
En vain à lever tout les valets sont fort prompts,
Et les ruisseaux de vin coulent aux environs.
Enfin, pour arrêter cette lutte barbare,
De nouveau l’on s’efforce, on crie, on les sépare ;
Et, leur première ardeur passant en un moment.
On a parlé de paix et d’accommodement.
Mais, tandis qu’à l’envi tout le monde y conspire,
J’ai gagné doucement la porte sans rien dire,
Avec un bon serment que, si pour l’avenir
En pareille cohue on me peut retenir,
Je consens de bon cœur, pour punir ma folie,
Que tous les vins pour moi deviennent vins de Brie,
Qu’à Paris le gibier manque tous les hivers,
Et qu’à peine au mois d’août l’on mange des pois verts.

Satire IV, Les folies humaines, à M. l'abbé Le Vayer; composée en 1663, publiée en 1666 -
Une satire morale qui retrace une conversation entre l'abbé, Molière et Boileau et laisse s'exprimer un regard globalement pessimiste sur une vie sociale marquée par le thème de la folie universelle où chacun se croit très sage et traite de fou son voisin...
C'est ici que le septuagénaire Jean Chapelain (1595-1674), qui régentait le monde littéraire dans les années 1650, se découvre la cible d'un Despréaux qui ose se placer au-dessus de tous ses adorateurs, lui qui était partout et parler de tout, les mercredis de Mme de Rambouillet, les mardis de Sapho et les réceptions élégantes de Mme de Sablé, les réunions qui se tenaient chez Ménage, Montmort, Lamoignon, ou chez les frères Du Puy, à l'hôtel de Thou... "Chapelain veut rimer, et c'est là sa folie. Mais bien que ses durs vers, d'épithètes enflés, Soient des moindres grimauds chez Ménage sifflés. Lui-même il s'applaudit, et d'un esprit tranquille Prend le pas au Parnasse au-dessus de Virgile, Que ferait-il, hélas! si quelque audacieux Allait pour son malheur lui dessiller les yeux, Lui faisant voir ses vers et sans force et sans grâces. Montés sur deux grands mots comme sur deux échasses, Ses termes sans raison l'un de l'autre écartés Et ses froids ornements à la ligne plantés..". Chapelain sera un des grands personnages des satires de Boileau, ainsi en 1667, mais aussi de quelques plaisanteries décapantes telles que son "Chapelain décoiffé", parodie d'une scène du Cid, et "La métamorphose de la perruque de Chapelain en comète", imitation de La Chevelure de Bérénice...
D’où vient, cher Le Vayer, que l’homme le moins sage
Croit toujours seul avoir la sagesse en partage,
Et qu’il n’est point de fou qui, par belles raisons,
Ne loge son voisin aux Petites-Maisons ?
Un pédant, enivré de sa vaine science,
Tout hérissé de grec, tout bouffi d’arrogance,
Et qui, de mille auteurs retenus mot pour mot,
Dans sa tête entassés, n’a souvent fait qu’un sot,
Croit qu’un livre fait tout, et que, sans Aristote,
La raison ne voit goutte, et le bon sens radote.
D’autre part un galant, de qui tout le métier
Est de courir le jour de quartier en quartier,
Et d’aller, à l’abri d’une perruque blonde.
De ses froides douceurs fatiguer tout le monde,
Condamne la science, et, blâmant tout écrit,
Croit qu’en lui l’ignorance est un titre d’esprit ;
Que c’est des gens de cour le plus beau privilège,
Et renvoie un savant dans le fond d’un collège.
Un bigot orgueilleux, qui, dans sa vanité,
Croit duper jusqu’à Dieu par son zèle affecté,
Couvrant tous ses défauts d’une sainte apparence,
Damne tous les humains, de sa pleine puissance.
Un libertin d’ailleurs, qui, sans âme et sans foi,
Se fait de son plaisir une suprême loi,
Tient que ces vieux propos de démons et de flammes
Sont bons pour étonner des enfans et des femmes,
Que c’est s’embarrasser de soucis superflus,
Et qu’enfin tout dévot a le cerveau perclus.
En un mot, qui voudroit épuiser ces matières,
Peignant de tant d’esprits les diverses manières,
Il compteroit plutôt combien, dans un printemps,
Guenaud et l’antimoine ont fait mourir de gens,
N’en déplaise à ces fous nommés sages de Grèce.
En ce monde il n’est point de parfaite sagesse :
Tous les hommes sont fous, et, malgré tous leurs soins,
Ne diffèrent entre eux que du plus ou du moins.
Comme on voit qu’en un bois que cent routes séparent
Les voyageurs sans guide assez souvent s’égarent,
L’un à droite, l’autre à gauche, et, courant vainement,
La même erreur les fait errer diversement :
Chacun suit dans le monde une route incertaine,
Selon que son erreur le joue et le promène ;
Et tel y fait l’habile et nous traite de fous,
Qui sous le nom de sage est le plus fou de tous.
Mais, quoi que sur ce point la satire publie,
Chacun veut en sagesse ériger sa folie,
Et, se laissant régler à son espri tortu,
De ses propres défauts se fait une vertu.
Ainsi, cela soit dit pour qui veut se connoître,
Le plus sage est celui qui ne pense point l’être ;
Qui, toujours pour un autre enclin vers la douceur,
Se regarde soi-même en sévère censeur.
Rend à tous ses défauts une exacte justice,
Et fait sans se flatter le procès à son vice.
Mais chacun pour soi-même est toujours indulgent.
Un avare, idolâtre et fou de son argent,
Rencontrant la disette au sein de l’abondance,
Appelle sa folie une rare prudence,
Et met toute sa gloire et son souverain bien
À grossir un trésor qui ne lui sert de rien.
Plus il le voit accru, moins il en sait l’usage.
Sans mentir, l’avarice est une étrange rage,
Dira cet autre fou non moins privé de sens,
Qui jette, furieux, son bien à tous venans,
Et dont l’âme inquiète, à soi-même importune,
Se fait un embarras de sa bonne fortune.
Qui des deux en effet est le plus aveuglé ?
L’un et l’autre, à mon sens, ont le cerveau troublé,
Répondra, chez Fredoc, ce marquis sage et prude,
Et qui sans cesse au jeu, dont il fait son étude,
Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept,
Voit sa vie ou sa mort sortir de son cornet.
Que si d’un sort fâcheux la maligne inconstance
Vient par un coup fatal faire tourner la chance,
Vous le verrez bientôt, les cheveux hérissés,
Et les yeux vers le ciel de fureur élancés,
Ainsi qu’un possédé que le prêtre exorcise,
Fêter dans ses sermens tous les saints de l’Église.
Qu’on le lie ; ou je crains, à son air furieux,
Que ce nouveau Titan n’escalade les cieux.
Mais laissons-le plutôt en proie à son caprice,
Sa folie, aussi bien, lui tient lieu de supplice,
Il est d’autres erreurs dont l’aimable poison
D’un charme bien plus doux enivre la raison,
L’esprit dans ce nectar heureusement s’oublie.
Chapelain veut rimer, et c’est là sa folie,
Mais bien que ses durs vers, d’épithètes enflés,
Soient des moindres grimauds chez Ménage sifflés,
Lui-même il s’applaudit, et, d’un esprit tranquille,
Prend le pas au Parnasse au-dessus de Virgile.
"Souvent de tous nos maux la raison est le pire.
C’est elle qui, farouche au milieu des plaisirs,
D’un remords importun vient brider nos désirs."
Que feroit-il, hélas ! si quelque audacieux
Alloit pour son malheur lui dessiller les yeux,
Lui faisant voir ses vers et sans force et sans grâces,
Montés sur deux grands mots, comme sur deux échasses ;
Ses termes sans raison l’un de l’autre écartés,
Et ses froids ornemens à la ligne plantés ?
Qu’il maudiroit le jour où son âme insensée
Perdit l’heureuse erreur qui charmoit sa pensée !
Jadis certain bigot, d’ailleurs homme sensé,
D’un mal assez bizarre eut le cerveau blessé,
S’imaginant sans cesse, en sa douce manie,
Des esprits bienheureux entendre l’harmonie.
Enfin un médecin fort expert en son art
Le guérit par adresse, ou plutôt par hasard ;
Mais voulant de ses soins exiger le salaire,
Moi vous payer ! lui dit le bigot en colère,
Vous dont l’art infernal, par ses secrets maudits,
En me tirant d’erreur m’ôte du paradis !
J’approuve son courroux ; car, puisqu’il faut le dire,
Souvent de tous nos maux la raison est le pire.
C’est elle qui, farouche au milieu des plaisirs,
D’un remords importun vient brider nos désirs.
La fâcheuse a pour nous des rigueurs sans pareilles ;
C’est un pédant qu’on a sans cesse à ses oreilles,
Qui toujours nous gourmande, et, loin de nous toucher,
Souvent comme Joli, perd son temps à prêcher.
En vain certains rêveurs nous l’habillent en reine,
Veulent sur tous nos sens la rendre souveraine,
Et, s’en formant en terre une divinité,
Pensent aller par elle à la félicité :
C’est elle, disent-ils, qui nous montre à bien vivre.
Ces discours, il est vrai, sont fort beaux dans un livre,
Je les estime fort ; mais je trouve en effet
Que le plus fou souvent est le plus satisfait.
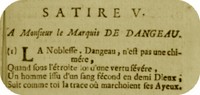
Satire V, Sur la Noblesse, à M. le marquis de Dangeau, composée en 1663, publiée en 1666.
Dénonciation de la hiérarchie des hommes, et plus spécifiquement du manque de vertu de la noblesse (1664, cent quarante-quatre vers), la seule véritable noblesse est celle du cœur, inspirée de la Satire VIII de Juvénal et que l'on retrouvera tant chez Corneille (Le Menteur) que chez Molière (Dom Juan). La satire semblait devoir être tout d'abord adressée au duc de la Rochefoucauld, mais le nom de Dangeau , de moins vieille souche, s'accommodait mieux aux nécessités du vers..
La noblesse, Dangeau, n’est pas une chimère,
Quand, sous l’étroite loi d’une vertu sévère,
Un homme issu d’un sang fécond en demi-dieux
Suit, comme toi, la trace où marchoient ses aïeux.
Mais je ne puis souffrir qu’un fat, dont la mollesse
N’a rien pour s’appuyer qu’une vaine noblesse,
Se pare insolemment du mérite d’autrui,
Et me vante un honneur qui ne vient pas de lui.
Je veux que la valeur de ses aïeux antiques
Ait fourni de matière aux plus vieilles chroniques,
Et que l’un des Capets, pour honorer leur nom,
Ait de trois fleurs de lis doté leur écusson :
Que sert ce vain amas d’une inutile gloire,
Si, de tant de héros célèbres dans l’histoire,
Il ne peut rien offrir aux jeux de l’univers
Que de vieux parchemins qu’ont épargnés les vers ;
Si, tout sorti qu’il est d’une source divine,
Son cœur dément en lui sa superbe origine,
Et, n’ayant rien de grand qu’une sotte fierté,
S’endort dans une lâche et molle oisiveté ?
Cependant, à le voir avec tant d’arrogance
Vanter le faux éclat de sa haute naissance,
On diroit que le ciel est soumis à sa loi,
Et que Dieu l’a pétri d’autre limon que moi.
Enivré de lui-même, il croit, dans sa folie,
Qu’il faut que devant lui d’abord tout s’humilie.
Aujourd’hui toutefois, sans trop le manager,
Sur ce ton un peu haut je vais l’interroger :
Dites-moi, grand héros, esprit rare et sublime,
Entre tant d’animaux, qui sont ceux qu’on estime ?
On fait cas d’un coursier qui, fier et plein de cœur,
Fait paroître en courant sa bouillante vigueur ;
Qui jamais ne se lasse, et qui dans la carrière
S’est couvert mille fois d’une noble poussière.
Mais la postérité d’Alfane et de Bayard,
Quand ce n’est qu’une rosse, est vendue au hasard,
Sans respect des aïeux dont elle est descendue,
Et va porter la malle, ou tirer la charrue.
Pourquoi donc voulez-vous que, par un sot abus,
Chacun respecte en vous un honneur qui n’est plus ?
On ne m’éblouit point d’une apparence vaine ;
La vertu, d’un cœur noble est la marque certaine.
Si vous êtes sorti de ces héros fameux,
Montrez-nous cette ardeur qu’on vit briller en eux,
Ce zèle pour l’honneur, cette horreur pour le vice.
Respectez-vous les lois ? fuyez-vous l’injustice ?
Savez-vous pour la gloire oublier le repos,
Et dormir en plein champ le harnois sur le dos ?
Je vous connois pour noble à ces illustres marques.
Uors soyez issu des plus fameux monarques,
Venez de mille aïeux ; et, si ce n’est assez,
Feuilletez à loisir tous les siècles passés ;
Voyez de quel guerrier il vous plaît de descendre ;
Choisissez de César, d’Achille, ou d’Alexandre :
En vain un faux censeur voudroit vous démentir,
Et si vous n’en sortez, vous en devez sortir.
Mais, fussiez-vous issu d’Hercule en droite ligne,
Si vous ne faites voir qu’une bassesse indigne,
Ce long amas d’aïeux que vous diffamez tous ;
Sont autant de témoins qui parlent contre vous ;
Et tout ce grand éclat de leur gloire ternie
Ne sert plus que de jour à votre ignominie.
En vain, tout lier d’un sang que vous déshonorez,
Vous dormez à l’abri de ces noms révérés ;
En vain vous vous couvrez des vertus de vos pères ;
Ce ne sont à mes yeux que de vaines chimères ;
Je ne vois rien en vous qu’un lâche, un imposteur,
Un traître, un scélérat, un perfide, un menteur,
Un fou dont les accès vont jusqu’à la furie,
Et d’un tronc fort illustre une branche pourrie.
Je m’emporte peut-être, et ma muse en fureur
Verse dans ses discours trop de fiel et d’aigreur :
Il faut avec les grands un peu de retenue.
Eh bien ! je m’adoucis. Votre race est connue,
Depuis quand ? répondez. Depuis mille ans entiers ;
Et vous pouvez fournir deux fois seize quartiers.
C’est beaucoup. Mais enfin les preuves en sont claires.
Tous les livres sont pleins des titres de vos pères ;
Leurs noms sont échappés du naufrage des temps.
Mais qui m’assurera qu’en ce long cercle d’ans,
À leurs fameux époux vos aïeules fidèles,
Aux douceurs des galans furent toujours rebelles ?
Et comment savez-vous si quelque audacieux
N’a point interrompu le cours de vos aïeux ;
Et si leur sang tout pur, ainsi que leur noblesse,
Est passé jusqu’à vous de Lucrèce en Lucrèce ?
".... par le temps le mérite avili
Vit l’honneur en roture, et le vice ennobli ;
Et l’orgueil, d’un faux titre appuyant sa foiblesse,
Maîtrisa les humains sous le nom de noblesse.
De là vinrent en foule et marquis et barons..."
Que maudit soit le jour où cette vanité
Vint ici de nos mœurs souiller la pureté !
Dans les temps bienheureux du monde en son enfance,
Chacun mettoit sa gloire en sa seule innocence ;
Chacun vivoit content, et sous d’égales lois,
Le mérite y faisoit la noblesse et les rois ;
Et, sans chercher l’appui d’une naissance illustre,
Un héros de soi-même empruntoit tout son lustre.
Mais enfin par le temps le mérite avili
Vit l’honneur en roture, et le vice ennobli ;
Et l’orgueil, d’un faux titre appuyant sa foiblesse,
Maîtrisa les humains sous le nom de noblesse.
De là vinrent en foule et marquis et barons :
Chacun pour ses vertus n’offrit plus que des noms.
Aussitôt maint esprit fécond en rêveries
Inventa le blason avec les armoiries ;
De ses termes obscurs fit un langage à part ;
Composa tous ces mots de Cimier et d’Écart,
De Pal, de Contrepal, de Lambel et de Fasce,
Et tout ce que Segoing dans son Mercure entasse.
Une vaine folie enivrant la raison,
L’honneur triste et honteux ne fut plus de saison.
Alors, pour soutenir son rang et sa naissance,
Il fallut étaler le luxe et la dépense ;
Il fallut habiter un superbe palais,
Faire par les couleurs distinguer ses valets,
Et, traînant en tous lieux de pompeux équipages,
Le duc et le marquis se reconnut aux pages,
Bientôt, pour subsister, la noblesse sans bien
Trouva l’art d’emprunter, et de ne rendre rien ;
Et, bravant des sergens la timide cohorte,
Laissa le créancier se morfondre à sa porte :
Mais, pour comble, à la fin le marquis en prison
Sous le faix des procès vit tomber sa maison.
Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
Humblement du faquin rechercha l’alliance ;
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un lâche contrat vendit tous ses aïeux ;
Et, corrigeant ainsi la fortune ennemie,
Rétablit son honneur à force d’infamie.
Car, si l’éclat de l’or ne relève le sang,
En vain l’on fait briller la splendeur de son rang ;
L’amour de vos aïeux passe en vous pour manie,
Et chacun pour parent vous fuit et vous renie.
Mais quand un homme est riche, il vaut toujours son prix ;
Et, l’eût-on vu porter la mandille à Paris,
N’eut-il de son vrai nom ni titre ni mémoire,
D’Hozier lui trouvera cent aïeux dans l’histoire.
Toi donc, qui, de mérite et d’honneurs revêtu,
Des écueils de la cour as sauvé ta vertu,
Dangeau, qui, dans le rang où notre roi t’appelle,
Le vois, toujours orné d’une gloire nouvelle,
Et plus brillant par soi que par l’éclat des lis,
Dédaigner tous ces rois dans la pourpre amollis ;
Fuir d’un honteux loisir la douceur importune ;
A ses sages conseils asservir la fortune ;
Et, de tout son honneur ne devant rien qu’à soi,
Montrer à l’univers ce que c’est qu’être roi :
Si tu veux te couvrir d’un éclat légitime,
Va par mille beaux faits mériter son estime ;
Sers un si noble maître ; et fais voir qu’aujourd’hui
Ton prince a des sujets qui sont dignes de lui.

Satire VI, Les embarras de Paris, composée en 1665, publiée en 1666.
Pour l'essentiel détachée de la Satire I, déplore bruits et embarras de Paris (cent vingt-six vers), le désordre ambiant de la vie sociale. Le Paris du XVIIe siècle a déjà fait l'objet de nombreux opuscules plus ou moins burlesques mais offrant des tableaux vivants de la capitale, le "Paris ridicule" de Claude le Petit (1638), la "Ville de Paris" par Berthod, les "Tracas de Paris" par Guillaume Colletet, la "Foire Saint-Germain" de Scarron, "Foire, l’élément des coquets, Des filous et des tire-laine, Foire, où l’on vend moins d’affiquets Que l’on ne vend de chair humaine !.." Juvénal avait peint les Embarras de Rome..
"En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse
D'un peuple d'importuns qui fourmillent sans cesse.
L'un me heurte d'un ais, dont je suis tout froissé ;
Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé;
Là, d'un enterrement la funèbre ordonnance,
D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance;
Et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçants,
Font aboyer les chiens et jurer les passants.
Des paveurs, en ce lieu, me bouchent le passage;
Là, je trouve une croix de funeste présage,
Et des couvreurs, grimpés au toit d'une maison,
En font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison.
Là, sur une charrette une poutre branlante
Vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente;
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant
Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant;
D'un carrosse, en tournant, il accroche une roue,
Et du choc le renverse en un grand tas de boue,
Quand un autre à l'instant s'efforçant de passer
Dans le même embarras se vient embarrasser.
Vingt carrosses bientôt arrivant à la file
Y sont en moins de rien suivis de plus de mille;
Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux
Conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs;
Chacun prétend passer; l'un mugit, l'autre jure;
Des mulets en sonnant augmentent le murmure;
Aussitôt, cent chevaux dans la foule appelés
De l'embarras qui croît ferment les défilés,
Et partout, des passants enchaînant les brigades,
Au milieu de la paix font voir les barricades.
On n'entend que des cris poussés confusément :
Dieu pour s'y faire ouïr tonnerait vainement.
Moi donc, qui dois souvent en certain lieu me rendre,
Le jour déjà baissant, et qui suis las d'attendre,
Ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer,
Je me mets au hasard de me faire rouer,
Je saute vingt ruisseaux, j'esquive, je me pousse;
Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse;
Et n'osant plus paraître en l'état où je suis,
Sans songer où je vais, je me sauve où je puis."

Satire VII, Sur le genre satirique, composée en 1663, publiée en 1666.
Une apologie du genre satirique qui prend pour cible plusieurs poètes autour de Chapelain...
Muse, changeons de style, et quittons la satire ;
C’est un méchant métier que celui de médire ;
À l’auteur qui l’embrasse il est toujours fatal :
Le mal qu’on dit d’autrui ne produit que du mal.
Maint poëte, aveuglé d’une telle manie,
En courant à l’honneur, trouve l’ignominie ;
Et tel mot, pour avoir réjoui le lecteur,
A coûté bien souvent des larmes à l’auteur.
Un éloge ennuyeux, un froid panégyrique,
Peut pourrir à son aise au fond d’une boutique,
Ne craint point du public les jugemens divers,
Et n’a pour ennemis que la poudre et les vers :
Mais un autre malin, qui rit et qui fait rire,
Qu’on blâme en le lisant, et pourtant qu’on veut lire,
Dans ses plaisans accès qui se croit tout permis,
De ses propres rieurs se fait des ennemis.
Un discours trop sincère aisément nous outrage :
Chacun dans ce miroir pense voir son visage ;
Et tel, en vous lisant, admire chaque trait,
Qui dans le fond de l’âme et vous craint et vous hait.
Muse, c’est donc en vain que la main vous démange :
S’il faut rimer ici, rimons quelque louange ;
Et cherchons un héros, parmi cet univers,
Digne de notre encens et digne de nos vers.
Mais à ce grand effort en vain je vous anime :
Je ne puis pour louer rencontrer une rime ;
Des que j’y veux rêver, ma veine est aux abois.
J’ai beau frotter mon front, j’ai beau mordre mes doigts.
Je ne puis arracher du creux de ma cervelle
Que des vers plus forcés que ceux de la Pucelle.
Je pense être à la gêne ; et, pour un tel dessein,
La plume et le papier résistent à ma main,
Mais, quand il faut railler, j’ai ce que je souhaite.
Alors, certes, alors je me connois poëte :
Phébus, dés que je parle, est prêt à m’exaucer ;
Mes mots viennent sans peine, et courent se placer.
Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville ?
Ma main, sans que j’y rêve, écrira Raumaville.
Faut-il d’un sot parfait montrer l’original ?
Ma plume au bout du vers d’abord trouve Sofal.
Je sens que mon esprit travaille de génie.
Faut-il d’un froid rimeur dépeindre la manie ?
Mes vers, comme un torrent, coulent sur le papier :
Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier,
Bonnecorse, Pradon, Coletet, Titreville;
Et, pour un que je veux, j’en trouve plus de mille.
Aussitôt je triomphe ; et ma muse en secret
S’estime et s’applaudit du beau coup qu’elle a fait.
C’est en vain qu’au milieu de ma fureur extrême
Je me fais quelquefois des leçons à moi-même ;
En vain je veux au moins faire grâce à quelqu’un :
Ma plume auroit regret d’en épargner aucun ;
Et sitôt qu’une fois la verve me domine,
Tout ce qui s’offre à moi passe par l’étamine.
Le mérite pourtant m’est toujours précieux :
Mais tout fat me déplaît, et me blesse les yeux ;
Je le poursuis partout, comme un chien fait sa proie,
Et ne le sens jamais qu’aussitôt je n’aboie.
Enfin, sans perdre temps en de si vains propos,
Je sais coudre une rime au bout de quelques mots.
"Souvent j’habille en vers une maligne prose :
C’est par là que je vaux, si je vaux quelque chose....."
Souvent j’habille en vers une maligne prose :
C’est par là que je vaux, si je vaux quelque chose.
Ainsi, soit que bientôt, par une dure loi,
La mort d’un vol affreux vienne fondre sur moi,
Soit que le ciel me garde un cours long et tranquille,
À Rome ou dans Paris, aux champs ou dans la ville,
Dût ma muse par là choquer tout l’univers,
Riche, gueux, triste ou gai, je veux faire des vers.
Pauvre esprit, dira-t-on, que je plains ta folie !
Modère ces bouillons de ta mélancolie ;
Et garde qu’un de ceux que tu penses blâmer
N’éteigne dans ton sang cette ardeur de rimer.
Eh quoi ! lorsqu’autrefois Horace, après Lucile,
Exhaloit en bons mots les vapeurs de sa bile,
Et, vengeant la vertu par des traits éclatans,
Alloit ôter le masque aux vices de son temps ;
Ou bien quand Juvénal, de sa mordante plume
Faisant couler des flots de fiel et d’amertume,
Gourmandoit en courroux tout le peuple latin,
L’un ou l’autre fit-il une tragique fin ?
Et que craindre, après tout, d’une fureur si vaine ?
Personne ne connoit ni mon nom ni ma veine :
On ne voit point mes vers, à l’envi de Montreuil,
Grossir impunément les feuillets d’un recueil.
À peine quelquefois je me force à les lire,
Pour plaire à quelque ami que charme la satire,
Qui me flatte peut-être, et, d’un air imposteur,
Rit tout haut de l’ouvrage, et tout bas de l’auteur.
Enfin c’est mon plaisir ; je veux me satisfaire.
Je ne puis bien parler, et ne saurois me taire ;
Et, dès qu’un mot plaisant vient luire à mon esprit,
Je n’ai point de repos qu’il ne soit en écrit :
Je ne résiste point au torrent qui m’entraîne.
Mais c’est assez, parlé ; prenons un peu d’haleine ;
Ma main, pour cette fois, commence à se lasser.
Finissons. Mais demain, muse, à recommencer.
Les cinq dernières Satires, plus proches des Epîtres, plus longues et plus démonstratives que les premières qui ont permis de de faire un tour des aspects sociaux les plus essentiels de notre existence, et tendent à proposer un remède moral et ontologique à partir des révélations mises en évidence sur la nature humaine.

Satire VIII, Sur l'Homme, à M. M**, docteur en Sorbonne, composée en 1667,
publiée en 1668.
Satire qui, prenant à partie Claude Morel, hostile aux jansénistes, amorce une réflexion sur l'homme, " l'homme n'est qu'une bête!"....
De tous les animaux qui s’élèvent dans l’air,
Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c’est l’homme.
Quoi ! dira-t-on d’abord, un ver, une fourmi,
Un insecte rampant qui ne vit qu’à demi,
Un taureau qui rumine, une chèvre qui broute,
Ont l’esprit mieux tourné que n’a l’homme ? Oui sans doute.
Ce discours te surprend, docteur, je l’aperçoi.
L’homme de la nature est le chef et le roi :
Bois, prés, champs, animaux, tout est pour son usage,
Et lui seul a, dis-tu, la raison en partage.
Il est vrai, de tout temps la raison fut son lot :
Mais de là je conclus que l’homme est le plus sot.
Ces propos, diras-tu, sont bons dans la satire,
Pour égayer d’abord un lecteur qui veut rire :
Mais il faut les prouver. En forme. J’y consens.
Réponds-moi donc, docteur, et mets-toi sur les bancs.
Qu’est-ce que la sagesse ? une égalité d’âme
Que rien ne peut troubler, qu’aucun désir n’enflamme,
Qui marche en ses conseils à pas plus mesurés
Qu’un doyen au palais ne monte les degrés.
Or cette égalité dont se forme le sage,
Qui jamais moins que l’homme en a connu l’usage ?
La fourmi tous les ans traversant les guérets
Grossit ses magasins des trésors de Cérés ;
Et dés que l’aquilon, ramenant la froidure,
Vient de ses noirs frimas attrister la nature.
Cet animal, tapi dans son obscurité,
Jouit l’hiver des biens conquis durant l’été.
Mais on ne la voit point, d’une humeur inconstante.
Paresseuse au printemps, en hiver diligente,
Affronter en plein champ les fureurs de janvier,
Ou demeurer oisive au retour du bélier.
Mais l’homme, sans arrêt dans sa course insensée,
Voltige incessamment de pensée en pensée :
Son cœur, toujours flottant entre mille embarras,
Ne sait ni ce qu’il veut ni ce qu’il ne veut pas.
Ce qu’un jour il abhorre, en l’autre il le souhaite.
Moi ! j’irois épouser une femme coquette !
J’irois, par ma constance aux affronts endurci,
Me mettre au rang des saints qu’a célébrés Bussi !
Assez de sots sans moi feront parler la ville,
Disoit le mois passé ce marquis indocile,
Qui, depuis quinze jours dans le piège arrêté,
Entre les bons maris pour exemple cité,
Croit que Dieu tout exprés d’une côte nouvelle
A tiré pour lui seul une femme fidèle.
Voilà l’homme en effet. Il va du blanc au noir ;
Il condamne au matin ses sentimens du soir :
Importun à tout autre, à soi-même incommode,
Il change a tous momens d’esprit comme de mode :
Il tourne au moindre vent, il tombe au moindre choc,
Aujourd’hui dans un casque, et demain dans un froc.
Cependant à le voir, plein de vapeurs légères,
Soi-même se bercer de ses propres chimères,
Lui seul de la nature est la base et l’appui,
Et le dixième ciel ne tourne que pour lui.
De tous les animaux il est, dit-il, le maître.
Qui pourroit le nier ? poursuis-tu. Moi, peut-être.
"L’homme seul, l’homme seul, en sa fureur extrême,
Met un brutal honneur à s’égorger soi-même."
Mais, sans examiner si vers les antres sourds,
L’ours a peur du passant, ou le passant de l’ours ;
Et si, sur un édit des pâtres de Nubie,
Les lions de Barca videroient la Libye ;
Ce maître prétendu qui leur donne des lois,
Ce roi des animaux, combien a-t-il de rois !
L’ambition, l’amour, l’avarice, la haine,
Tiennent comme un forçat son esprit à la chaîne.
Le sommeil sur ses yeux commence à s’épancher :
« Debout, dit l’avarice, il est temps de marcher.
Hé ! laisse-moi. - Debout ! - Un moment. - Tu répliques ?
- À peine le soleil fait ouvrir les boutiques.
- N’importe, lève-toi. — Pourquoi faire après tout ?
- Pour courir l’Océan de l’un à l’autre bout,
Chercher jusqu’au Japon la porcelaine et l’ambre,
Rapporter de Goa le poivre et le gingembre.
- Mais j’ai des biens en foule, et je puis m’en passer.
- On n’en peut trop avoir : et pour en amasser
Il ne faut épargner ni crime ni parjure :
Il faut souffrir la faim, et coucher sur la dure :
Eût-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
N’avoir en sa maison ni meubles ni valet ;
Parmi les tas de blé vivre de seigle et d’orge ;
De peur de perdre un liard souffrir qu’on vous égorge.
- Et pourquoi cette épargne enfin ? - L’ignores-tu ?
Afin qu’un héritier, bien nourri, bien vêtu,
Profitant d’un trésor en tes mains inutile,
De son train quelque jour embarrasse la ville.
- Que faire ? - Il faut partir : les matelots sont prêts. »
Ou, si pour l’entraîner l’argent manque d’attraits,
Bientôt l’ambition et toute son escorte
Dans le sein du repos vient le prendre à main forte,
L’envoie en furieux, au milieu des hasards,
Se faire estropier sur les pas des Césars ;
Et cherchant sur la brèche une mort indiscrète,
De sa folle valeur embellir la gazette.
« Tout beau, dira quelqu’un, raillez plus à propos ;
Ce vice fut toujours la vertu des héros.
Quoi donc ! à votre avis, fut-ce un fou qu’Alexandre ? »
Qui ? cet écervelé qui mit l’Asie en cendre ?
Ce fougueux l’Angéli, qui, de sang altéré,
Maître du monde entier s’y trouvoit trop serré !
L’enragé qu’il étoit, né roi d’une province
Qu’il pouvoit gouverner en bon et sage prince,
S’en alla follement, et pensant être Dieu,
Courir comme un bandit qui n’a ni feu ni lieu ;
Et, traînant avec soi les horreurs de la guerre,
De sa vaste folie emplir toute la terre :
Heureux, si de son temps, pour cent bonnes raisons,
La Macédoine eut eu des Petites-Maisons,
Et qu’un sage tuteur l’eût en cette demeure,
Par avis de parens, enfermé de bonne heure !
Mais, sans nous égarer dans ces digressions,
Traiter, comme Senaut, toutes les passions ;
Et, les distribuant, par classes et par titres,
Dogmatiser en vers, et rimer par chapitres,
Laissons-en discourir La Chambre et Coeffeteau.
En voyant l’homme enfin par l’endroit le plus beau.
Lui seul, vivant, dit-on, dans l’enceinte des villes,
Fait voir d’honnêtes mœurs, des coutumes civiles,
Se fait des gouverneurs, des magistrats, des rois,
Observe une police, obéit à des lois.
Il est vrai. Mais pourtant sans lois et sans police,
Sans craindre archers, prévôt, ni suppôt de justice,
Voit-on les loups brigands, comme nous inhumains,
Pour détrousser les loups courir les grands chemins ?
Jamais, pour s’agrandir, voit-on dans sa manie
Un tigre en factions partager l’Hyrcanie ?
L’ours a-t-il dans les bois la guerre avec les ours ?
Le vautour dans les airs fond-il sur les vautours ?
A-t-on vu quelquefois dans les plaines d’Afrique,
Déchirant à l’envi leur propre république,
Lions contre lions, parens contre parens,
Combattre follement pour le choix des tyrans ?
L’animal le plus fier qu’enfante la nature
Dans un autre animal respecte sa figure,
De sa rage avec lui modère les accès,
Vit sans bruit, sans débats, sans noise, sans procès.
Un aigle, sur un champ prétendant droit d’aubaine,
Ne fait point appeler un aigle à la huitaine ;
Jamais contre un renard chicanant un poulet
Un renard de son sac n’alla charger Rolet;
Jamais la biche en rut n’a, pour fait d’impuissance,
Traîné du fond des bois un cerf à l’audience ;
Et jamais juge, entre eux ordonnant le congrès,
De ce burlesque mot n’a sali ses arrêts.
On ne connoît chez eux ni placets ni requêtes,
Ni haut ni bas conseil, ni chambre des enquêtes.
Chacun l’un avec l’autre en toute sûreté
Vit sous les pures lois de la simple équité.
L’homme seul, l’homme seul, en sa fureur extrême,
Met un brutal honneur à s’égorger soi-même.
C’étoit peu que sa main, conduite par l’enfer,
Eût pétri le salpêtre, eut aiguisé le fer :
II falloit que sa rage, à l’univers funeste,
Allât encor de lois embrouiller le Digeste :
Cherchât pour l’obscurcir des gloses, des docteurs,
Accablât l’équité sous des monceaux d’auteurs,
Et pour comble de maux apportât dans la France
Des harangueurs du temps l’ennuyeuse éloquence.
Doucement, diras-tu ! que sert de s’emporter ?
L’homme a ses passions, on n’en sauroit douter ;
Il a comme la mer ses flots et ses caprices :
Mais ses moindres vertus balancent tous ses vices.
"Toi-même réponds-moi : Dans le siècle où nous sommes
Est-ce au pied du savoir qu’on mesure les hommes ?"
N’est-ce pas l’homme enfin dont l’art audacieux
Dans le tour d’un compas a mesuré les cieux ;
Dont la vaste science, embrassant toutes choses,
A fouillé la nature, en a percé les causes ?
Les animaux ont-ils des universités ?
Voit-on fleurir chez eux des quatre facultés ?
Y voit-on des savans en droit, en médecine.
Endosser l’écarlate et se fourrer d’hermine?
Non, sans doute ; et jamais chez eux un médecine,
N’empoisonna les bois de soit art assassin.
Jamais docteur armé d’un argument frivole
Ne s’enroua chez eux sur les bancs d’une école.
Mais sans chercher au fond si notre esprit déçu
Sait rien de ce qu’il sait, s’il a jamais rien su,
Toi-même réponds-moi : Dans le siècle où nous sommes
Est-ce au pied du savoir qu’on mesure les hommes ?
« Veux-tu voir tous les grands à ta porte courir ?
Dit un père à son fils dont le poil va fleurir ;
Prends-moi le bon parti : laisse là tous les livres.
Cent francs au denier cinq combien font-ils ? - Vingt livres.
— C’est bien dit. Va, tu sais tout ce qu’il faut savoir.
Que de biens, que d’honneurs sur toi s’en vont pleuvoir !
Exerce-toi, mon fils, dans ces hautes sciences ;
Prends, au lieu d’un Platon, le Guidon des finances;
Sache quelle province enrichit les traitans ;
Combien le sel au roi peut fournir tous les ans.
Endurcis-toi le cœur, sois arabe, corsaire,
Injuste, violent, sans foi, double, faussaire.
Ne va point sottement faire le généreux :
Engraisse-toi, mon fils, du suc des malheureux ;
Et, trompant de Colbert la prudence importune,
Va par tes cruautés mériter la fortune.
Aussitôt tu verras poëtes, orateurs,
Rhéteurs, grammairiens, astronomes, docteurs,
Dégrader les héros pour te mettre en leurs places,
De tes titres pompeux enfler leurs dédicaces,
Te prouver à toi-même, en grec, hébreu, latin,
Que tu sais de leur art et le fort et le fin.
Quiconque est riche est tout : sans sagesse il est sage
Il a, sans rien savoir, la science en partage :
Il a l’esprit, le cœur, le mérite, le rang,
La vertu, la valeur, la dignité, le sang.
Il est aimé des grands, il est chéri des belles :
Jamais surintendant ne trouva de cruelles.
L’or même à la laideur donne un teint de beauté,
Mais tout devient affreux avec la pauvreté. »
C’est ainsi qu’à son fils un usurier habile
Trace vers la richesse une route facile :
Et souvent tel y vient, qui sait, pour tout secret,
Cinq et quatre font neuf, ôtez deux, reste sept.
Après cela, docteur, va pâlir sur la Bible ;
Va marquer les écueils de cette mer terrible ;
Perce la sainte horreur de ce livre divin ;
Confonds dans un ouvrage et Luther et Calvin,
Débrouille des vieux temps les querelles célèbres,
Eclaircis des rabbins les savantes ténèbres :
Afin qu’en ta vieillesse un livre en maroquin
Aille offrir ton travail à quelque heureux faquin,
Qui, pour digne loyer de la Bible éclaircie,
Te paye en l’acceptant d’un « Je vous remercie. »
Ou, si ton cœur aspire à des honneurs plus grands,
Quitte là ton bonnet, la Sorbonne, et les bancs ;
Et, prenant désormais un emploi salutaire,
Mets-toi chez un banquier ou bien chez un notaire :
Laisse là saint Thomas s’accorder avec Scot ;
Et conclus avec moi qu’un docteur n’est qu’un sot.
Un docteur ! diras-tu. Parlez de vous, poëte :
C’est pousser un peu loin votre muse indiscrète.
Mais, sans perdre en discours le temps hors de saison,
"L’homme, venez au fait, n’a-t-il pas la raison ?...
L’homme seul, qu’elle éclaire, en plein jour ne voit goutte :
Réglé par ses avis, fait tout à contre-temps,
Et dans tout ce qu’il fait n’a ni raison ni sens :
Tout lui plaît et déplaît ; tout le choque et l’oblige ;
Sans raison il est gai, sans raison il s’afflige..."
L’homme, venez au fait, n’a-t-il pas la raison ?
N’est-ce pas son flambeau, son pilote fidèle ?
Oui. Mais de quoi lui sert que sa voix le rappelle,
Si, sur la foi des vents tout prêt à s’embarquer,
Il ne voit point d’écueil qu’il ne l’aille choquer ?
Et que sert à Cotin la raison qui lui crie :
N’écris plus, guéris-toi d’une vaine furie ;
Si tous ces vains conseils, loin de la réprimer,
Ne font qu’accroître en lui la fureur de rimer ?
Tous les jours de ses vers, qu’à grand bruit il récite,
Il met chez lui voisins, parens, amis, en fuite ;
Car, lorsque son démon commence à l’agiter,
Tout, jusqu’à sa servante, est prêt à déserter.
Un âne, pour le moins, instruit par la nature,
A l’instinct qui le guide obéit sans murmure.
Ne va point follement de sa bizarre voix
Défier aux chansons les oiseaux dans les bois :
Sans avoir la raison, il marche sur sa route.
L’homme seul, qu’elle éclaire, en plein jour ne voit goutte :
Réglé par ses avis, fait tout à contre-temps,
Et dans tout ce qu’il fait n’a ni raison ni sens :
Tout lui plaît et déplaît ; tout le choque et l’oblige ;
Sans raison il est gai, sans raison il s’afflige ;
Son esprit au hasard aime, évite, poursuit,
Défait, refait, augmente, ôte, élève, détruit,
Et voit-on, comme lui, les ours ni les panthères
S’effrayer sottement de leurs propres chimères,
Plus de douze attroupés craindre le nombre impair,
Ou croire qu’un corbeau les menace dans l’air ?
Jamais l’homme, dis-moi, vit-il la bête folle
Sacrifier à l’homme, adorer son idole,
Lui venir, comme au dieu des saisons et des vents,
Demander à genoux la pluie et le beau temps ?
Non, mais cent fois la bête a vu l’homme hypocondre
Adorer le métal que lui-même il fit fondre :
A vu dans un pays les timides mortels
Trembler aux pieds d’un singe assis sur leurs autels ;
Et sur les bords du Nil les peuples imbéciles,
L’encensoir à la main, chercher des crocodiles.
Mais pourquoi, diras-tu, cet exemple odieux ?
Que peut servir ici l’Égypte et ses faux dieux ?
Quoi ! me prouverez-vous par ce discours profane
Que l’homme, qu’un docteur, est au-dessous d’un âne !
Un âne, le jouet de tous les animaux.
Un stupide animal, sujet à mille maux ;
Dont le nom seul en soi comprend une satire !
Oui, d’un âne : et qu’a-t-il qui nous excite à rire ?
Nous nous moquons de lui : mais s’il pouvoit un jour,
Docteur, sur nos défauts s’exprimer à son tour ;
Si, pour nous réformer, le ciel prudent et sage
De la parole enfin lui permettoit l’usage ;
Qu’il pût dire tout haut ce qu’il se dit tout bas :
Ah ! docteur, entre nous, que ne diroit-il pas ?
Et que peut-il penser lorsque dans une rue,
Au milieu de Paris, il promène sa vue ;
Qu’il voit de toutes parts les hommes bigarrés.
Les uns gris, les uns noirs, les autres chamarrés ?
Que dit-il quand il voit, avec la mort en trousse,
Courir chez un malade un assassin en housse ;
Qu’il trouve de pédans un escadron fourré,
Suivi par un recteur de bedeaux entouré.
Ou qu’il voit la Justice, en grosse compagnie,
Mener tuer un homme avec cérémonie ?
Que pense-t-il de nous lorsque sur le midi
Un hasard au palais le conduit un jeudi,
Lorsqu’il entend de loin, d’une gueule infernale,
La chicane en fureur mugir dans la grand’salle ?
Que dit-il quand il voit les juges, les huissiers,
Les clercs, les procureurs, les sergens, les greffiers ?
Oh ! que si l’âne alors, à bon droit misanthrope,
Pouvoit trouver la voix qu’il eut au temps d’Esope ;
De tous côtés, docteur, voyant les hommes fous,
Qu’il diroit de bon cœur, sans en être jaloux,
Content de ses chardons, et secouant la tête :
Ma foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête !

Satire IX, A son esprit, composée en 1667, publiée en 1668 - Satire complétant la Satire VII et riposte aux attaques suscitées par l'édition de 1666, rappelant que ce n'est pas tant l'être humain qui est visé par la critique mais l'auteur, un bon ouvrage triomphera toujours d'une quelconque cabale. Est évoqué l'abbé Charles Cotin, oracle des salons et membre en 1655 de l'Académie, renommé pour les charades et rébus dont il se délectait, inondant de vers discutables les Mme de Montpensier, Mme de Nemours, à toutes les Amaranthes et Iris à la mode, "Et que sert à Cotin la raison qui lui crie : N'écris plus, guéris-toi d'une vaine furie..."
C’est à vous, mon esprit, à qui je veux parler.
Vous avez des défauts que je ne puis celer :
Assez et trop longtemps ma lâche complaisance
De vos jeux criminels a nourri l’insolence ;
Mais, puisque vous poussez ma patience à bout,
Une fois en ma vie il faut vous dire tout.
On croiroit à vous voir dans vos libres caprices
Discourir en Caton des vertus et des vices,
Décider du mérite et du prix des auteurs,
Et faire impunément la leçon aux docteurs,
Qu’étant seul à couvert des traits de la satire
Vous avez tout pouvoir de parler et d’écrire.
Mais moi, qui dans le fond sais bien ce que j’en croîs,
Qui compte tous les jours vos défauts par mes doigts,
Je ris quand je vous vois si foible et si stérile,
Prendre sur vous le soin de réformer la ville,
Dans vos discours chagrins plus aigre et plus mordant
Qu’une femme en furie, ou Gautier en plaidant.
Mais répondez un peu. Quelle verve indiscrète
Sans l’aveu des neuf Sœurs vous a rendu poëte ?
Sentiez-vous, dites-moi, ces violens transports
Qui d’un esprit divin font mouvoir les ressorts ?
Qui vous a pu souffler une si folle audace ?
Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse ?
Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré,
Qui ne vole au sommet tombe au plus bas degré,
Et qu’à moins d’être au rang d’Horace ou de Voiture,
On rampe dans la fange avec l’abbé de Pure ?
Que si tous mes efforts ne peuvent réprimer
Cet ascendant malin qui vous force à rimer,
Sans perdre en vains discours tout le fruit de vos veilles,
Osez chanter du roi les augustes merveilles :
Là, mettant à profit vos caprices divers,
Vous verriez tous les ans fructifier vos vers :
Et par l’espoir du gain votre muse animée
Vendroit au poids de l’or une once de fumée.
Mais en vain, direz-vous, je pense vous tenter
Par l’éclat d’un fardeau trop pesant à porter.
Tout chantre ne peut pas, sur le ton d’un Orphée,
Entonner en grands vers la Discorde étouffée ;
Peindre Bellone en feu tonnant de toutes parts,
Et le Belge effrayé fuyant sur ses remparts.
Sur un ton si hardi, sans être téméraire,
Racan pourrait chanter au défaut d’un Homère ;
Mais pour Cotin et moi, qui rimons au hasard,
Que l’amour de blâmer fit poëtes par art,
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre éloquence,
Le plus sûr est pour nous de garder le silence,
Un poëme insipide et sottement flatteur
Déshonore à la fois le héros et l’auteur ;
Enfin de tels projets passent notre foiblesse.
Ainsi parle un esprit languissant de mollesse,
Qui, sous l’humble dehors d’un respect affecté,
Cache le noir venin de sa malignité.
Mais, dussiez-vous en l’air voir vos ailes fondues,
Ne valoit-il pas mieux vous perdre dans les nues,
Que d’aller sans raison, d’un style peu chrétien,
Faire insulte en rimant à qui ne vous dit rien,
Et du bruit dangereux d’un livre téméraire
À vos propres périls enrichir le libraire ?
Vous vous flattez, peut-être, en votre vanité,
D’aller comme un Horace à l’immortalité ;
Et déjà vous croyez dans vos rimes obscures
Aux Saumaises futurs préparer des tortures.
Mais combien d’écrivains, d’abord si bien reçus,
Sont de ce fol espoir honteusement déçus !
Combien, pour quelques mois, ont vu fleurir leur livre,
Dont les vers en paquet se vendent à la livre !
"Quel démon vous irrite, et vous porte à médire ?
Un livre vous déplaît : qui vous force à le lire ?
Laissez mourir un fat dans son obscurité :
Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté ?...."
Vous pourrez voir, un temps, vos écrits estimés
Courir de main en main par la ville semés ;
Puis de là, tout poudreux, ignorés sur la terre,
Suivre chez l’épicier Neuf-Germain et La Serre ;
Ou, de trente feuillets réduits peut-être à neuf,
Parer, demi-rongés, les rebords du Pont-Neuf.
Le bel honneur pour vous, en voyant vos ouvrages
Occuper le loisir des laquais et des pages,
Et souvent dans un coin renvoyés à l’écart
Servir de second tome aux airs du Savoyard !
Mais je veux que le sort, par un heureux caprice,
Fasse de vos écrits prospérer la malice,
Et qu’enfin votre livre aille, au gré de vos vœux,
Faire siffler Cotin chez nos derniers neveux :
Que vous sert-il qu’un jour l’avenir vous estime,
Si vos vers aujourd’hui vous tiennent lieu de crime,
Et ne produisent rien, pour fruits de leurs bons mots,
Que l’effroi du public et la haine des sots ?
Quel démon vous irrite, et vous porte à médire ?
Un livre vous déplaît : qui vous force à le lire ?
Laissez mourir un fat dans son obscurité :
Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté ?
Le Jonas inconnu sèche dans la poussière :
Le David imprimé n’a point vu la lumière ;
Le Moïse commence à moisir par les bords.
Quel mal cela fait-il ? Ceux qui sont morts sont morts :
Le tombeau contre vous ne peut-il les défendre ?
Et qu’ont fait tant d’auteurs, pour remuer leur cendre ?
Que vous ont fait Perrin, Bardin, Pradon, Hainaut,
Colletet, Pelletier, Titreville, Quinault,
Dont les noms en cent lieux, placés comme en leurs niches,
Vont de vos vers malins remplir les hémistiches ? »
Ce qu’ils font vous ennuie. Ô le plaisant détour !
Ils ont bien ennuyé le roi, toute la cour,
Sans que le moindre édit ait, pour punir leur crime,
Retranché les auteurs, ou supprimé la rime.
Écrive qui voudra. Chacun à ce métier
Peut perdre impunément de l’encre et du papier.
Un roman, sans blesser les lois ni la coutume,
Peut conduire un héros au dixième volume.
De là vient que Paris voit chez lui de tout temps
Les auteurs à grands flots déborder tous les ans ;
Et n’a point de portail où, jusques aux corniches,
Tous les piliers ne soient enveloppés d’affiches.
Vous seul, plus dégoûté, sans pouvoir et sans nom,
Viendrez régler les droits et l’État d’Apollon !
Mais vous, qui raffinez sur les écrits des autres.
De quel œil pensez-vous qu’on regarde les vôtres ?
Il n’est rien en ce temps à couvert de vos coups,
Mais savez-vous aussi comme on parle de vous ?
Gardez-vous, dira l’un, de cet esprit critique.
On ne sait bien souvent quelle mouche le pique.
Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui pour un bon mot va perdre vingt amis.
Il ne pardonne pas aux vers de la Pucelle,
Et croit régler le monde au gré de sa cervelle.
Jamais dans le barreau trouva-t-il rien de bon ?
Peut-on si bien prêcher qu’il ne dorme au sermon ?
Mais lui, qui fait ici le régent du Parnasse,
N’est qu’un gueux revêtu des dépouilles d’Horace.
Avant lui Juvénal avoit dit en latin.
Qu’on est assis à l’aise aux sermons de Cotin.
L’un et l’autre avant lui s’étoient plaints de la rime,
Et c’est aussi sur eux qu’il rejette son crime :
Il cherche à se couvrir de ces noms glorieux.
J’ai peu lu ces auteurs, mais tout n’iroit que mieux,
Quand de ces médisans l’engeance tout entière
Iroit la tête en bas rimer dans la rivière.
Voilà comme on vous traite : et le monde effrayé
Vous regarde déjà comme un homme noyé.
En vain quelque rieur, prenant votre défense,
Veut faire au moins, de grâce, adoucir la sentence :
Rien n’apaise un lecteur toujours tremblant d’effroi,
Qui voit peindre en autrui ce qu’il remarque en soi.
Vous ferez-vous toujours des affaires nouvelles ?
Et faudra-t-il sans cesse essuyer des querelles ?
N’entendrai-je qu’auteurs se plaindre et murmurer ?
Jusqu’à quand vos fureurs doivent-elles durer ?
Répondez, mon esprit : ce n’est plus raillerie :
Dites… Mais, direz-vous, pourquoi cette furie ?
Quoi ! pour un maigre auteur que je glose en passant,
Est-ce crime, après tout, et si noir et si grand ?
Et qui, voyant un fat s’applaudir d’un ouvrage
Où la droite raison trébuche à chaque page,
Ne s’écrie aussitôt : L’impertinent auteur !
L’ennuyeux écrivain ! Le maudit traducteur !
A quoi bon mettre au jour tous ces discours frivoles,
Et ces riens enfermés dans de grandes paroles ?
Est-ce donc là médire, ou parler franchement ?
Non, non, la médisance y va plus doucement.
Si l’on vient à chercher pour quel secret mystère
Alidor à ses frais bâtit un monastère :
Alidor ! dit un fourbe, il est de mes amis,
Je l’ai connu laquais avant qu’il lut commis :
C’est un homme d’honneur, de piété profonde,
Et qui veut rendre à Dieu ce qu’il a pris au monde
Voilà jouer d’adresse, et médire avec art ;
Et c’est avec respect enfoncer le poignard.
Un esprit né sans fard, sans basse complaisance,
Fuit ce ton radouci que prend la médisance.
Mais de blâmer des vers ou durs ou languissans,
De choquer un auteur qui choque le bon sens,
De railler d’un plaisant qui ne sait pas nous plaire,
C’est ce que tout lecteur eut toujours droit de faire
Tous les jours à la cour un sot de qualité
Peut juger de travers avec impunité ;
A Malherbe, à Racan, préférer Théophile,
Et le clinquant du Tasse à tout l’or de Virgile.
Un clerc, pour quinze sous, sans craindre le holà,
Peut aller au parterre attaquer Attila;
Et, si le roi des Huns ne lui charme l’oreille,
Traiter de visigoths tous les vers de Corneille.
"En vain contre le Cid un ministre se ligue :
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue..."
Il n’est valet d’auteur, ni copiste à Paris,
Qui, la balance en main, ne pèse les écrits.
Dès que l’impression fait éclore un poëte,
Il est esclave-né de quiconque l’achète :
Il se soumet lui-même aux caprices d’autrui,
Et ses écrits tout seuls doivent parler pour lui.
Un auteur à genoux, dans une humble préface,
Au lecteur qu’il ennuie a beau demander grâce ;
Il ne gagnera rien sur ce juge irrité,
Qui lui fait son procès de pleine autorité.
Et je serai le seul qui ne pourrai rien dire !
On sera ridicule, et je n’oserai rire !
Et qu’ont produit mes vers de si pernicieux,
Pour armer contre moi tant d’auteurs furieux ?
Loin de les décrier, je les ai fait paroître :
Et souvent, sans ces vers qui les ont fait connoîre,
Leur talent dans l’oubli demeureroit caché.
Et qui sauroit sans moi que Cotin a prêché ?
La satire ne sert qu’à rendre un fat illustre :
C’est une ombre au tableau, qui lui donne du lustre.
En les blâmant enfin j’ai dit ce que j’en croi ;
Et tel qui m’en reprend en pense autant que moi.
Il a tort, dira l’un ; pourquoi faut-il qu’il nomme ?
Attaquer Chapelain ! ah ! c’est un si bon homme !
Balzac en fait l’éloge en cent endroits divers.
Il est vrai, s’il m’eût cru, qu’il n’eût point fait de vers.
Il se tue à rimer : que n’écrit-il en prose ?
Voilà ce que l’on dit. Et que dis-je autre chose ?
En blâmant ses écrits, ai-je d’un style affreux
Distillé sur sa vie un venin dangereux ?
Ma muse en l’attaquant, charitable et discrète,
Sait de l’homme d’honneur distinguer le poëte.
Qu’on vante en lui la foi, l’honneur, la probité ;
Qu’on prise sa candeur et sa civilité ;
Qu’il soit doux, complaisant, officieux, sincère :
On le veut, j’y souscris, et suis près de me taire.
Mais que pour un modèle ou montre ses écrits ;
Qu’il soit le mieux renté de tous les beaux esprits,
Comme roi des auteurs qu’on l’élève à l’empire :
Ma bile alors s’échauffe, et je brûle d’écrire ;
Et, s’il ne m’est permis de le dire au papier,
J’irai creuser la terre, et, comme ce barbier,
Faire dire aux roseaux par un nouvel organe :
« Midas, le roi Midas a des oreilles d’âne. »
Quel tort lui fais-je enfin ? Ai-je par un écrit
Pétrifié sa veine et glacé son esprit ?
Quand un livre au Palais se vend et se débite,
Que chacun par ses yeux juge de son mérite,
Que Bilaine l’étale au deuxième pilier,
Le dégoût d’un censeur peut-il le décrier ?
En vain contre le Cid un ministre se ligue :
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
L’Académie en corps a beau le censurer :
Le public révolté s’obstine à l’admirer.
Mais lorsque Chapelain met une œuvre en lumière,
Chaque lecteur d’abord lui devient un Linière.
En vain il a reçu l’encens de mille auteurs :
Son livre en paroissant dément tous ses flatteurs.
Ainsi, sans m’accuser, quand tout Paris le joue,
Qu’il s’en prenne à ses vers que Phébus désavoue ;
Qu’il s’en prenne à sa muse allemande en françois.
Mais laissons Chapelain pour la dernière fois.
La satire, dit-on, est un métier funeste,
Qui plait à quelques gens, et choque tout le reste.
La suite en est à craindre : en ce hardi métier
La peur plus d’une fois fit repentir Régnier.
Quittez, ces vains plaisirs dont l’appât vous abuse,
À de plus doux emplois occupez, votre muse ;
Et laissez à Feuillet réformer l’univers.
Et sur quoi donc faut-il que s’exercent mes vers ?
Irai-je dans une ode, en phrases de Malherbe,
Troubler dans ses roseaux le Danube superbe ;
Délivrer de Sion le peuple gémissant ;
Faire trembler Memphis, ou pâlir le croissant ;
Et, passant du Jourdain les ondes alarmées,
Cueillir mal à propos les palmes idumées ?
Viendrai-je en une églogue, entouré de troupeaux,
Au milieu de Paris enfler mes chalumeaux,
Et, dans mon cabinet assis au pied des hêtres,
Faire dire aux échos des sottises champêtres ?
Faudra-t-il de sang-froid, et sans être amoureux,
Pour quelque Iris en l’air faire le langoureux,
Lui prodiguer les noms de Soleil et d’Aurore,
Et, toujours bien mangeant, mourir par métaphore ?
Je laisse aux doucereux ce langage affété,
Où s’endort un esprit de mollesse hébété.
"La satire, en leçons, en nouveautés fertile,
Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile,
Et, d’un vers qu’elle épure aux rayons du bon sens,
Détromper les esprits des erreurs de leur temps...."
La satire, en leçons, en nouveautés fertile,
Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile,
Et, d’un vers qu’elle épure aux rayons du bon sens,
Détromper les esprits des erreurs de leur temps.
Elle seule, bravant l’orgueil et l’injustice,
Va jusque sous le dais faire pâlir le vice ;
Et souvent sans rien craindre, à l’aide d’un bon mot,
Va venger la raison des attentats d’un sot.
C’est ainsi que Lucile, appuyé de Lélie,
Fit justice en son temps des Cotins d’Italie,
Et qu’Horace, jetant le sel à pleines mains,
Se jouoit aux dépens des Pelletiers romains.
C’est elle qui, m’ouvrant le chemin qu’il faut suivre,
M’inspira dès quinze ans la haine d’un sot livre ;
Et sur ce mont fameux, où j’osai la chercher,
Fortifia mes pas et m’apprit à marcher.
C’est pour elle, en un mot, que j’ai fait vœu d’écrire.
Toutefois, s’il le faut, je veux bien m’en dédire,
Et, pour calmer enfin tous ces flots d’ennemis,
Réparer en mes vers les maux qu’ils ont commis
Puisque vous le voulez, je vais changer de style.
Je le déclare donc : Quinault est un Virgile ;
Pradon comme un soleil en nos ans a paru ;
Pelletier écrit mieux qu’Ablancourt ni Patru ;
Cotin, à ses sermons traînant toute la terre,
Fend les flots d’auditeurs pour aller à sa chaire :
Saufal est le phénix des esprits relevés ;
Perrin… Bon, mon esprit ! courage ! poursuivez
Mais ne voyez-vous pas que leur troupe en furie
Va prendre encor ces vers pour une raillerie ?
Et Dieu sait aussitôt que d’auteurs en courroux,
Que de rimeurs blessés s’en vont fondre sur vous !
Vous les verrez bientôt, féconds en impostures,
Amasser contre vous des volumes d’injures,
Traiter en vos écrits chaque vers d’attentat,
Et d’un mot innocent faire un crime d’État.
Vous aurez beau vanter le roi dans vos ouvrages,
Et de ce nom sacré sanctifier vos pages ;
Qui méprise Cotin n’estime point son roi,
Et n’a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.
Mais quoi ! répondrez-vous, Cotin nous peut-il nuire
Et par ses cris enfin que sauroit-il produire ?
Interdire à mes vers, dont peut-être il fait cas,
L’entrée aux pensions où je ne prétends pas ?
Non, pour louer un roi que tout l’univers loue,
Ma langue n’attend point que l’argent la dénoue ;
Et, sans espérer rien de mes foibles écrits,
L’honneur de le louer m’est un trop digne prix :
On me verra toujours, sage dans mes caprices,
De ce même pinceau dont j’ai noirci les vices
Et peint du nom d’auteur tant de sots revêtus,
Lui marquer mon respect, et tracer ses vertus.
Je vous crois ; mais pourtant on crie, on vous menace.
Je crains peu, direz-vous, les braves du Parnasse.
Hé ! mon Dieu, craignez tout d’un auteur en courroux,
Qui peut… - Quoi ? - Je m’entends. - Mais encor ? - Taisez-vous.
"Il a tort, dira l'un ; pourquoi faut-il qu'il nomme?
Attaquer Chapelain ! ah! c'est un si bon homme!
Balzac en fait l'éloge en cent endroits divers.
Il est vrai, s'il m'eût cru, qu'il n'eût point fait de vers.
Il se tue à rimer : que n'écrit-il en prose?"
Voilà ce que l'on dit. Et que dis-je autre chose?
En blâmant ses écrits, ai-je, d'un style affreux,
Distillé sur sa vie un venin dangereux?
Ma Muse, en l'attaquant, charitable et discrète,
Sait de l'homme d'honneur distinguer le poète.
Qu'on vante en lui la foi, l'honneur, la probité,
Qu'on prise sa candeur et sa civilité,
Qu'il soit doux, complaisant, officieux, sincère :
On le veut, j'y souscris, et suis prêt de me taire.
Mais, que pour un modèle on montre ses écrits,
Qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits,
Comme roi des auteurs, qu'on l'élève à l'empire :
Ma bile alors s'échauffe, et je brûle d'écrire,
Et, s'il ne m'est permis de le dire au papier,
J'irai creuser la terre, et, comme ce barbier,
Faire dire aux roseaux par un nouvel organe :
"Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne."
Quel tort lui fais-je enfin? Ai-je par un écrit
Pétrifié sa veine et glacé son esprit?
Quand un livre au Palais se vend et se débite,
Que chacun par ses yeux juge de son mérite,
Que Bilaine l'étale au deuxième pilier,
Le dégoût d'un censeur peut-il le décrier?
En vain, contre le Cid un ministre se ligue;
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue :
L'Académie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s'obstine à l'admirer.
Mais, lorsque Chapelain met une œuvre en lumière,
Chaque lecteur d'abord lui devient un Linière;
En vain il a reçu l'encens de mille auteurs,
Son livre en paraissant dément tous ses flatteurs.
Ainsi, sans m'accuser, quand tout Paris le joue,
Qu'il s'en prenne à ses vers que Phébus désavoue."

Satire X, Les femmes, composée en 1692, publiée en 1694
Publiée sous le titre de Dialogue ou satire contre les femmes, Boileau, bourgeois et vieux garçon ("Je suis las de me voir le soir en ma maison Seul avec des valets, souvent voleurs et traîtres, Et toujours, à coup sûr, ennemis de leurs maître"), indique dans un bref Avis au lecteur, qu'on lui demanda depuis longtemps ce texte dans un contexte qui voyait nombre de femmes prendre parti dans la querelle des Anciens et des Modernes, et notamment pour ces derniers. "La bienséance néanmoins voudroit, ce me semble, que je fisse quelque excuse au beau sexe de la liberté que je me suis donnée de peindre ses vices ; mais, au fond, toutes les peintures que je fais dans ma satire sont si générales, que, bien loin d'appréhender que les femmes s'en offensent, c'est sur leur approbation et sur leur curiosité que je fonde la plus grande espérance du succès de mon ouvrage. Une chose au moins dont je suis certain qu'elles me loueront, c'est d'avoir trouvé moyen , dans une matière aussi délicate que celle que j'y traite, de ne pas laisser échapper un seul mot qui pût le moins du monde blesser la pudeur. J'espère donc que j'obtiendrai aisément ma grâce, et qu'elles ne seront pas plus choquées des prédications que je fais contre leurs défauts dans cette satire que des satires que les prédicateurs font tous les jours en chaire contre ces mêmes défauts." Mais les critiques furent vives et nombreuses, et pour le rassurer Racine lui répondit : «Vous avez attaqué tout un corps, qui n'est composé que de langues, sans compter celles des galants, qui prennent parti dans la querelle. Attendez que le beau sexe ait dormi sur sa colère, vous verrez qu'il se rendra à la raison, et votre satire reviendrai sa juste valeur.»...
Enfin bornant le cours de tes galanteries,
Alcippe, il est donc vrai, dans peu tu te maries ;
Sur l’argent, c’est tout dire, on est déjà d’accord ;
Ton beau-père futur vide son coffre-fort ;
Et déjà le notaire a, d’un style énergique,
Griffonné de ton joug l’instrument authentique.
C’est bien fait. Il est temps de fixer tes désirs :
Ainsi que ses chagrins l’hymen a ses plaisirs.
Quelle joie, en effet, quelle douceur extrême,
De se voir caressé d’une épouse qu’on aime !
De s’entendre appeler petit cœur, ou mon bon !
De voir autour de soi croître dans sa maison,
Sous les paisibles lois d’une agréable mère,
De petits citoyens dont on croit être père !
Quel charme, au moindre mal qui nous vient menacer,
De la voir aussitôt accourir, s’empresser,
S’effrayer d’un péril qui n’a point d’apparence,
Et souvent de douleur se pâmer par avance !
Car tu ne seras point de ces jaloux affreux,
Habiles à se rendre inquiets, malheureux,
Qui, tandis qu’une épouse à leurs yeux se désole,
Pensent toujours qu’un autre en secret la console.
Mais quoi, je vois déjà que ce discours t’aigrit.
Charmé de Juvénal, et plein de son esprit,
Venez-vous, diras-tu, dans une pièce outrée,
Comme lui nous chanter que, dès le temps de Rhée,
La chasteté déjà, la rougeur sur le front,
Avoit chez les humains reçu plus d’un affront ;
Qu’on vit avec le fer naître les injustices,
L’impiété, l’orgueil et tous les autres vices :
Mais que la bonne foi dans l’amour conjugal
N’alla point jusqu’au temps du troisième métal ?
Ces mots ont dans sa bouche une emphase admirable ;
Mais je vous dirai, moi, sans alléguer la fable,
Que si sous Adam même, et loin avant Noé,
Le vice audacieux, des hommes avoué,
À la triste innocence en tous lieux fit la guerre,
Il demeura pourtant de l’honneur sur la terre ;
Qu’aux temps les plus féconds en Phrynés, en Laïs,
Plus d’une Pénélope honora son pays ;
Et que, même aujourd’hui, sur ce fameux modèle,
On peut trouver encor quelque femme fidèle.
Sans doute, et dans Paris, si je sais bien compter,
Il en est jusqu’à trois que je pourrois citer.
Ton épouse dans peu sera la quatrième :
Je le veux croire ainsi. Mais, la chasteté même
Sous ce beau nom d’épouse entrât-elle chez toi,
De retour d’un voyage, en arrivant, crois-moi,
Fais toujours du logis avertir la maîtresse.
Tel partit tout baigné des pleurs de sa Lucrèce,
Qui, faute d’avoir pris ce soin judicieux,
Trouva… tu sais. — Je sais que d’un conte odieux
Vous avez comme moi sali votre mémoire.
Mais laissons là, dis-tu, Joconde et son histoire ;
Du projet d’un hymen déjà fort avancé,
Devant nous aujourd’hui criminel dénoncé,
Et mis sur la sellette aux pieds de la critique,
Je vois bien tout de bon qu’il faut que je m’explique.
Jeune autrefois par vous dans le monde conduit,
J’ai trop bien profité pour n’être pas instruit
À quels discours malins le mariage expose :
Je sais que c’est un texte où chacun fait sa glose ;
Que de maris trompés tout rit dans l’univers,
Épigrammes, chansons, rondeaux, fables en vers,
Satire, comédie ; et, sur cette matière,
J’ai vu tout ce qu’ont fait La Fontaine et Molière ;
J’ai lu tout ce qu’ont dit Villon et Saint-Gelais,
Arioste, Marot, Boccace, Rabelais,
Et tous ces vieux recueils de satires naïves,
des malices du sexe immortelles archives.
"L’épouse que tu prends, sans tache en sa conduite,
Aux vertus, m’a-t-on dit, dans Port-Royal instruite,
Aux lois de son devoir règle tous ses désirs.
Mais qui peut t’assurer qu’invincible aux plaisirs,
Chez toi, dans une vie ouverte à la licence,
Elle conservera sa première innocence ?....."
Mais, tout bien balancé, j’ai pourtant reconnu
Que de ces contes vains le monde retenu
N’en a pas de l’hymen moins vu fleurir l’usage ;
Que sous ce joug moqué tout à la fin s’engage ;
Qu’à ce commun filet les railleurs mêmes pris
Ont été très-souvent de commodes maris ;
Et que, pour être heureux sous ce joug salutaire,
Tout dépend, en un mot, du bon choix qu’on sait faire.
Enfin, il faut ici parler de bonne loi :
Je vieillis, et ne puis regarder sans effroi
Ces neveux affamés dont l’importun visage
De mon bien à mes yeux fait déjà le partage.
Je crois déjà les voir, au moment annoncé
Qu’à la fin sans retour leur cher oncle est passé,
Sur quelques pleurs forcés qu’ils auront soin qu’on voie,
Se faire consoler du sujet de leur joie.
Je me fais un plaisir, à ne vous rien celer,
De pouvoir, moi vivant, dans peu les désoler,
Et, trompant un espoir pour eux si plein de charmes,
Arracher de leurs yeux de véritables larmes.
Vous dirai-je encor plus ? Soit foiblesse ou raison,
Je suis las de me voir le soir en ma maison
Seul avec des valets, souvent voleurs et traîtres,
Et toujours, à coup sûr, ennemis de leurs maîtres.
Je ne me couche point qu’aussitôt dans mon lit
Un souvenir fâcheux n’apporte à mon esprit
Ces histoires de morts lamentables, tragiques,
Dont Paris tous les ans peut grossir ses chroniques.
Dépouillons-nous ici d’une vaine fierté :
Nous naissons, nous vivons pour la société.
À nous-mêmes livrés dans une solitude,
Notre bonheur bientôt fait notre inquiétude ;
Et, si durant un jour notre premier aïeul,
Plus riche d’une côte, avait vécu tout seul,
Je doute, en sa demeure alors si fortunée,
S’il n’eut point prié Dieu d’abréger la journée.
N’allons donc point ici réformer l’univers,
Ni, par de vains discours et de frivoles vers,
Étalant au public notre misanthropie,
Censurer le lien le plus doux de la vie.
Laissons là, croyez-moi, le monde tel qu’il est.
L’hymenée est un joug, et c’est ce qui m’en plaît :
L’homme en ses passions toujours errant sans guide
A besoin qu’on lui mette et le mors et la bride :
Son pouvoir malheureux ne sert qu’à le gêner ;
Et, pour le rendre libre, il le faut enchaîner.
C’est ainsi que souvent la main de Dieu l’assiste.
Ha ! bon ! voilà parler en docte janséniste,
Alcippe ; et, sur ce point si savamment touché,
Desmâres dans Saint-Roch n’auroit pas mieux prêché.
Mais c’est trop t’insulter ; quittons la raillerie ;
Parlons sans hyperbole et sans plaisanterie.
Tu viens de mettre ici l’hymen en son beau jour :
Entends donc ; et permets que je prêche à mon tour.
L’épouse que tu prends, sans tache en sa conduite,
Aux vertus, m’a-t-on dit, dans Port-Royal instruite,
Aux lois de son devoir règle tous ses désirs.
Mais qui peut t’assurer qu’invincible aux plaisirs,
Chez toi, dans une vie ouverte à la licence,
Elle conservera sa première innocence ?
Par toi-même bientôt conduite à l’Opéra,
De quel air penses-tu que ta sainte verra
D’un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse ;
Ces danses, ces héros à voix luxurieuse ;
Entendra ces discours sur l’amour seul roulans,
Ces doucereux Renauds, ces insensés Rolands,
Saura d’eux qu’à l’amour, comme au seul dieu suprême.
On doit immoler tout, jusqu’à la vertu même ;
Qu’on ne sauroit trop tôt se laisser enflammer ;
Qu’on n’a reçu du ciel un cœur que pour aimer ;
Et tous ces lieux communs de morale lubrique
Que Lulli réchauffa des sons de sa musique ?
Mais de quels mouvemens, dans son cœur excités,
Sentira-t-elle alors tous ses sens agités !
Je ne te réponds pas qu’au retour, moins timide,
Digne écolière enfin d’Angélique et d’Armide,
Elle n’aille à l’instant, pleine de ces doux sons,
Avec quelque Médor pratiquer ces leçons.
Supposons toutefois qu’encor fidèle et pure,
Sa vertu de ce choc revienne sans blessure :
Bientôt dans ce grand monde où tu vas l’entraîner,
Au milieu des écueils qui vont l’environner,
Crois-tu que, toujours ferme aux bords du précipice,
Elle pourra marcher sans que le pied lui glisse ;
Que, toujours insensible aux discours enchanteurs
D’un idolâtre amas de jeunes séducteurs,
Sa sagesse jamais ne deviendra folie ?
D’abord tu la verras, ainsi que dans Clélie,
Recevant ses amans sous le doux nom d’amis,
S’en tenir avec eux aux petits soins permis ;
Puis bientôt en grande eau sur le fleuve de Tendre
Naviguer à souhait, tout dire et tout entendre.
Et ne présume pas que Vénus, ou Satan,
Souffre qu’elle en demeure aux termes du roman.
Dans le crime il suffit qu’une fois on débute ;
Une chute toujours attire une autre chute.
L’honneur est comme une île escarpée et sans bords
On n’y peut plus rentrer dès qu’on en est dehors.
Peut-être avant deux ans, ardente à te déplaire,
Éprise d’un cadet, ivre d’un mousquetaire,
Nous la verrons hanter les plus honteux brelans,
Donner chez la Cornu rendez-vous aux galans ;
De Phèdre dédaignant la pudeur enfantine,
Suivre à front découvert Z… et Messaline ;
Compter pour grands exploits vingt hommes ruinés,
Blessés, battus pour elle, et quatre assassinés :
Trop heureux si, toujours femme désordonnée,
Sans mesure et sans règle au vice abandonnée,
Par cent traits d’impudence aisés à ramasser
Elle t’acquiert au moins un droit pour la chasser !
Mais que deviendras-tu si, folle en son caprice,
N’aimant que le scandale et l’éclat dans le vice,
Bien moins pour son plaisir que pour t’inquiéter,
Au fond peu vicieuse, elle aime à coqueter ?
"Combien n’a-t-on point vu de belles aux doux yeux,
Avant le mariage anges si gracieux,
Tout à coup se changeant en bourgeoises sauvages,
Vrais démons apporter l’enfer dans leurs ménages,
Et, découvrant l’orgueil de leurs rudes esprits,
Sous leur fontange altière asservir leurs maris ! ..."
Entre nous, verras-tu d’un esprit bien tranquille
Chez ta femme aborder et la cour et la ville ?
Hormis toi, tout chez toi rencontre un doux accueil :
L’un est payé d’un mot, et l’autre d’un coup d’œil.
Ce n’est que pour toi seul qu’elle est fière et chagrine :
Aux autres elle est douce, agréable, badine ;
C’est pour eux qu’elle étale et l’or et le brocart,
Que chez toi se prodigue et le rouge et le fard,
Et qu’une main savante, avec tant d’artifice,
Bâtit de ses cheveux le galant édifice.
Dans sa chambre, crois-moi, n’entre point tout le jour.
Si tu veux posséder ta Lucrèce à ton tour,
Attends, discret mari, que la belle en cornette
Le soir ait étalé son teint sur la toilette,
Et dans quatre mouchoirs, de sa beauté salis,
Envoie au blanchisseur ses roses et ses lis.
Alors tu peux entrer ; mais, sage en sa présence,
Ne va pas murmurer de sa folle dépense.
D’abord, l’argent en main, paye et vite et comptant.
Mais non, fais mine un peu d’en être mécontent,
Pour la voir aussitôt, de douleur oppressée,
Déplorer sa vertu si mal récompensée.
Un mari ne veut pas fournir à ses besoins ?
Jamais femme, après tout, a-t-elle coûté moins ?
A cinq cents louis d’or tout au plus, chaque année,
Sa dépense en habits n’est-elle pas bornée ?
Que répondre ? Je vois qu’à de si justes cris,
Toi-même convaincu, déjà tu t’attendris,
Tout prêt à la laisser, pourvu qu’elle s’apaise,
Dans ton coffre, à pleins sacs, puiser tout à son aise.
À quoi bon en effet t’alarmer de si peu ?
Eh ! que seroit-ce donc si, le démon du jeu
Versant dans son esprit sa ruineuse rage,
Tous les jours, mis par elle à deux doigts du naufrage,
Tu voyois tous tes biens, au sort abandonnés,
Devenir le butin d’un pique ou d’un sonnez ?
Le doux charme pour toi de voir, chaque journée,
De nobles champions ta femme environnée,
Sur une table longue et façonnée exprès,
D’un tournoi de bassette ordonner les apprêts !
Ou, si par un arrêt la grossière police
D’un jeu si nécessaire interdit l’exercice,
Ouvrir sur cette table un champ au lansquenet,
Ou promener trois dés chassés de son cornet !
Puis sur une autre table, avec un air plus sombre,
S’en aller méditer une vole au jeu d’hombre ;
S’écrier sur un as mal à propos jeté ;
Se plaindre d’un gâno qu’on n’a point écouté !
Ou, querellant tout bas le ciel qu’elle regarde,
A la bête gémir d’un roi venu sans garde !
Chez elle, en ces emplois, l’aube du lendemain
Souvent la trouve encor les cartes à la main :
Alors, pour se coucher les quittant, non sans peine,
Elle plaint le malheur de la nature humaine,
Qui veut qu’en un sommeil ou tout s’ensevelit
Tant d’heures sans jouer se consument au lit.
Toutefois en partant la troupe la console,
Et d’un prochain retour chacun donne parole.
C’est ainsi qu’une femme en doux amusemens
Sait du temps qui s’envole employer les momens ;
C’est ainsi que souvent par une forcenée
Une triste famille à l’hôpital traînée
Voit ses biens en décret sur tous les murs écrits
De sa déroute illustre effrayer tout Paris.
Mais que plutôt son jeu mille fois te ruine,
Que si, la famélique et honteuse lésine
Venant mal à propos la saisir au collet,
Elle te réduisoit à vivre sans valet,
Comme ce magistrat de hideuse mémoire
Dont je veux bien ici te crayonner l’histoire.
Dans la robe on vantoit son illustre maison :
Il étoit plein d’esprit, de sens et de raison ;
Seulement pour l’argent un peu trop de foiblesse
De ces vertus en lui ravaloit la noblesse.
Sa table toutefois, sans superfluité,
N’avoit rien que d’honnête en sa frugalité.
Chez lui deux bons chevaux, de pareille encolure,
Trouvoient dans l’écurie une pleine pâture,
Et, du foin que leur bouche au râtelier laissoit,
De surcroît une mule encor se nourrissoit.
Mais cette soif de l’or qui le brûloit dans l’âme
Le fit enfin songer à choisir une femme,
Et l’honneur dans ce choix ne fut point regardé.
Vers son triste penchant son naturel guidé
Le fit, dans une avare et sordide famille,
Chercher un monstre affreux sous l’habit d’une fille :
Et, sans trop s’enquérir d’où la laide venoit,
Il sut, ce fut assez, l’argent qu’on lui donnoit.
Rien ne le rebuta, ni sa vue éraillée,
Ni sa masse de chair bizarrement taillée :
Et trois cent mille francs avec elle obtenus
La firent à ses yeux plus belle que Vénus.
Il l’épouse ; et bientôt son hôtesse nouvelle
Le prêchant lui fit voir qu’il étoit, au prix d’elle.
Un vrai dissipateur, un parfait débauché.
Lui-même le sentit, reconnut son péché,
Se confessa prodigue, et plein de repentance,
Offrit sur ses avis de régler sa dépense.
Aussitôt de chez eux tout rôti disparut.
Le pain bis, renfermé, d’une moitié décrut ;
Les deux chevaux, la mule, au marché s’envolèrent ;
Deux grands laquais, à jeun, sur le soir s’en allèrent :
De ces coquins déjà l’on se trouvoit lassé,
Et pour n’en plus revoir le reste fut chassé.
Deux servantes déjà, largement souffletées,
Avoient à coups de pied descendu les montées,
Et se voyant enfin hors de ce triste lieu,
Dans la rue en avoient rendu grâces à Dieu.
Un vieux valet restoit, seul chéri de son maître,
Que toujours il servit, et qu’il avoit vu naître,
Et qui de quelque somme amassée au bon temps
Vivoit encor chez eux, partie à ses dépens.
Sa vue embarrassoit : il fallut s’en défaire ;
Il fut de la maison chassé comme un corsaire.
Voila nos deux époux sans valets, sans enfans,
Tout seuls dans leur logis libres et triomphans.
Alors on ne mit plus de borne à la lésine :
On condamna la cave, on ferma la cuisine ;
Pour ne s’en point servir aux plus rigoureux mois,
Dans le fond d’un grenier on séquestra le bois.
L’un et l’autre dès lors vécut à l’aventure
Des présens qu’à l’abri de la magistrature
Le mari quelquefois des plaideurs extorquoit,
Ou de ce que la femme aux voisins escroquoit.
Mais, pour bien mettre ici leur crasse en tout son lustre,
Il faut voir du logis sortir ce couple illustre :
Il faut voir le mari tout poudreux, tout souillé,
Couvert d’un vieux chapeau de cordon dépouillé,
Et de sa robe, en vain de pièces rajeunie,
A pied dans les ruisseaux traînant l’ignominie.
Mais qui pourroit compter le nombre de haillons,
De pièces, de lambeaux, de sales guenillons,
De chiffons ramassés dans la plus noire ordure,
Dont la femme, aux bons jours, composoit sa parure ?
Décrirai-je ses bas en trente endroits percés,
Ses souliers grimaçans, vingt fois rapetassés,
Ses coiffes d’où pendoit au bout d’une ficelle
Un vieux masque pelé presque aussi hideux qu’elle?
Peindrai-je son jupon bigarré de latin,
Qu’ensemble composoient trois thèses de satin ;
Présent qu’en un procès sur certain privilège
Firent à son mari les régens d’un collège,
Et qui, sur cette jupe, à maint rieur encor
Derrière elle faisoit lire Argumentabor ?
Mais peut-être j’invente une fable frivole.
Démens donc tout Paris, qui, prenant la parole,
Sur ce sujet encor de bons témoins pourvu,
Tout prêt à le prouver, te dira : Je l’ai vu ;
Vingt ans j’ai vu ce couple, uni d’un même vice,
À tous mes habitans montrer que l’avarice
Peut faire dans les biens trouver la pauvreté,
Et nous réduire à pis que la mendicité.
Des voleurs, qui chez eux pleins d’espérance entrèrent,
De cette triste vie enfin les délivrèrent :
Digne et funeste fruit du nœud le plus affreux
Dont l’hymen ait jamais uni deux malheureux !
Ce récit passe un peu l’ordinaire mesure :
Mais un exemple enfin si digne de censure
Peut-il dans la satire occuper moins de mots ?
Chacun sait son métier. Suivons notre propos.
Nouveau prédicateur aujourd’hui, je l’avoue,
Écolier ou plutôt singe de Bourdaloue,
Je me plais à remplir mes sermons de portraits.
En voilà déjà trois peints d’assez heureux traits :
La femme sans honneur, la coquette et l’avare.
Il faut y joindre encor la revèche bizarre,
Qui sans cesse, d’un ton par la colère aigri,
Gronde, choque, dément, contredit un mari.
Il n’est point de repos ni de paix avec elle.
Son mariage n’est qu’une longue querelle.
Laisse-t-elle un moment respirer son époux,
Ses valets sont d’abord l’objet de son courroux ;
Et sur le ton grondeur lorsqu’elle les harangue,
Il faut voir de quels mots elle enrichit la langue :
Ma plume ici, traçant ces mots par alphabet,
Pourroit d’un nouveau tome augmenter Richelet.
Tu crains peu d’essuyer cette étrange furie :
En trop bon lieu, dis-tu, ton épouse nourrie
Jamais de tels discours ne te rendra martyr ;
Mais, eût-elle sucé la raison dans Saint-Cyr,
Crois-tu que d’une fille humble, honnête, charmante,
L’hymen n’ait jamais fait de femme extravagante ?
Combien n’a-t-on point vu de belles aux doux yeux,
Avant le mariage anges si gracieux,
Tout à coup se changeant en bourgeoises sauvages,
Vrais démons apporter l’enfer dans leurs ménages,
Et, découvrant l’orgueil de leurs rudes esprits,
Sous leur fontange altière asservir leurs maris !
Et puis, quelque douceur dont brille ton épouse,
Penses-tu, si jamais elle devient jalouse,
Que son âme livrée à ses tristes soupçons
De la raison encore écoute les leçons ?
Alors, Alcippe, alors, tu verras de ses œuvres :
Résous-toi, pauvre époux, à vivre de couleuvres ;
À la voir tous les jours, dans ses fougueux accès,
À ton geste, à ton rire, intenter un procès ;
Souvent, de ta maison gardant les avenues,
Les cheveux hérissés, t’attendra au coin des rues ;
Te trouver en des lieux de vingt portes fermés,
Et, partout où tu vas, dans ses yeux enflammés
T'offrir non pas d’Isis la tranquille Euménide,
Mais la vraie Alecto, peinte dans l'Enéide,
Un tison à la main, chez le roi Latinus,
Soufflant sa rage au sein d’Amate et de Turnus.
Mais quoi ! je chausse ici le cothurne tragique !
"Mais qui vient sur ses pas ? c’est une précieuse,
Reste de ces esprits jadis si renommés
Que d’un coup de son art Molière a diffamés.
De tous leurs sentimens cette noble héritière
Maintient encore ici leur secte façonnière...."
Reprenons au plus tôt le brodequin comique,
Et d’objets moins affreux songeons à te parler.
Dis-moi donc, laissant là cette folle hurler,
T’accommodes-tu mieux de ces douces Ménades,
Qui, dans leurs vains chagrins, sans mal toujours malades,
Se font des mois entiers, sur un lit effronté,
Traiter d’une visible et parfaite santé ;
Et douze fois par jour, dans leur molle indolence,
Aux yeux de leurs maris tombent en défaillance ?
Quel sujet, dira l’un, peut donc si fréquemment
Mettre ainsi cette belle aux bords du monument ?
La Parque, ravissant ou son fils ou sa fille,
A-t-elle moissonné l’espoir de sa famille ?
Non : il est question de réduire un mari
À chasser un valet dans la maison chéri,
Et qui, parce qu’il plaît, a trop su lui déplaire ;
Ou de rompre un voyage utile et nécessaire,
Mais qui la priveroit huit jours de ses plaisirs,
Et qui, loin d’un galant, objet de ses désirs…
Oh ! que pour la punir de cette comédie
Ne lui vois-je une vraie et triste maladie !
Mais ne nous fâchons point. Peut-être avant deux jours,
Courtois et Denyau, mandés à son secours,
Digne ouvrage de l’art dont Hippocrate traite,
Lui sauront bien ôter cette santé d’athlète ;
Pour consumer l’humeur qui fait son embonpoint,
Lui donner sagement le mal qu’elle n’a point ;
Et, fuyant de Fagon les maximes énormes,
Au tombeau mérité la mettre dans les formes.
Dieu veuille avoir son âme, et nous délivrer d’eux !
Pour moi, grand ennemi de leur art hasardeux,
Je ne puis cette fois que je ne les excuse.
Mais à quels vains discours est-ce que je m’amuse ?
Il faut sur des sujets plus grands, plus curieux,
Attacher de ce pas ton esprit et tes yeux.
Qui s’offrira d’abord ? Bon, c’est cette savante
Qu’estime Roberval, et que Sauveur fréquente.
D’où vient qu’elle a l’œil trouble et le teint si terni ?
C’est que sur le calcul, dit-on, de Cassini,
Un astrolabe en main, elle a, dans sa gouttière,
À suivre Jupiter passé la nuit entière.
Gardons de la troubler. Sa science, je croi,
Aura pour s’occuper ce jour plus d’un emploi :
D’un nouveau microscope on doit, en sa présence,
Tantôt chez Delancé faire l’expérience,
Puis d’une femme morte avec son embryon
Il faut chez du Verney voir la dissection.
Rien n’échappe aux regards de notre curieuse.
Mais qui vient sur ses pas ? c’est une précieuse,
Reste de ces esprits jadis si renommés
Que d’un coup de son art Molière a diffamés.
De tous leurs sentimens cette noble héritière
Maintient encore ici leur secte façonnière.
C’est chez, elle toujours que les fades auteurs
S’en vont se consoler du mépris des lecteurs.
Elle y reçoit leur plainte ; et sa docte demeure
Aux Perrins, aux Coras, est ouverte à toute heure.
Là, du faux bel esprit se tiennent les bureaux :
Là, tous les vers sont bons pourvu qu’ils soient nouveaux.
Au mauvais goût public la belle y fait la guerre :
Plaint Pradon opprimé des sifflets du parterre ;
Rit des vains amateurs du grec et du latin ;
Dans la balance met Aristote et Cotin ;
Puis, d’une main encor plus fine et plus habile,
Pèse sans passion Chapelain et Virgile :
Remarque en ce dernier beaucoup de pauvretés,
Mais pourtant confessant qu’il a quelques beautés ;
Ne trouve en Chapelain, quoi qu’ait dit la satire,
Autre défaut, sinon qu’on ne le sauroit lire ;
Et, pour faire goûter son livre à l’univers,
Croit qu’il faudroit en prose y mettre tous les vers.
À quoi bon m’étaler cette bizarre école
Du mauvais sens, dis-tu, prêché par une folle !
De livres et d’écrits bourgeois admirateur,
Vais-je épouser ici quelque apprentive auteur ?
Savez-vous que l’épouse avec qui je me lie
Compte entre ses parens des princes d’Italie ;
Sort d’aïeux dont les noms… ? Je t’entends, et je voi
D’où vient que tu t’es fait secrétaire du roi :
Il falloit de ce titre appuyer ta naissance.
Cependant (t’avouerai-je ici mon insolence ?),
Si quelque objet pareil chez moi, deçà les monts,
Pour m’épouser entroit avec tous ces grands noms,
Le sourcil rehaussé d’orgueilleuses chimères ;
Je lui dirais bientôt : Je connois tous vos pères ;
Je sais qu’ils ont brillé dans ce fameux combat
Où sous l’un des Valois Enghien sauva l’État.
D’Hozier n’en convient pas ; mais, quoi qu’il en puisse être,
Je ne suis point si sot que d’épouser mon maître.
Ainsi donc, au plus tôt délogeant de ces lieux,
Allez, princesse, allez, avec tous vos aïeux,
Sur le pompeux débris des lances espagnoles,
Coucher, si vous voulez, aux champs de Cérisoles :
Ma maison ni mon lit ne sont point faits pour vous.
J’admire, poursuis-tu, votre noble courroux.
Souvenez-vous pourtant que ma famille illustre
De l’assistance au sceau ne tire point son lustre ;
Et que, né dans Paris de magistrats connus,
Je ne suis point ici de ces nouveaux venus,
De ces nobles sans nom, que, par plus d’une voie,
La province souvent en guêtres nous envoie.
Mais eussé-je comme eux des meuniers pour parens,
Mon épouse vînt-elle encor d’aïeux plus grands,
On ne la verroit point, vantant son origine,
À son triste mari reprocher la farine.
Son cœur, toujours nourri dans la dévotion,
De trop bonne heure apprit L’humiliation :
Et, pour vous détromper de la pensée étrange
Que l’hymen aujourd’hui la corrompe et la change,
Sachez qu’en notre accord elle a, pour premier point,
Exigé qu’un époux ne la contraindroit point
A traîner après elle un pompeux équipage,
Ni surtout de souffrir, par un profane usage,
Qu’à l’église jamais devant le Dieu jaloux,
Un fastueux carreau soit vu sous ses genoux.
Telle est l’humble vertu qui, dans son âme empreinte…
Je le vois bien, tu vas épouser une sainte,
Et dans tout ce grand zèle il n’est rien d’affecté.
Sais-tu bien cependant, sous cette humilité,
L’orgueil que quelquefois nous cache une bigote,
Alcippe, et connois-tu la nation dévote ?
Il te faut de ce pas en tracer quelques traits,
Et par ce grand portrait finir tous mes portraits.
"Elle lit Rodriguez, fait l’oraison mentale,
Va pour les malheureux quêter dans les maisons,
Hante les hôpitaux, visite les prisons,
Tous les jours à l’église entend jusqu’à six messes :
Mais de combattre en elle et dompter ses foiblesses,
Sur le fard, sur le jeu, vaincre sa passion,
Mettre un frein à son luxe, à son ambition,
Et soumettre l’orgueil de son esprit rebelle,
C’est ce qu’en vain le ciel voudroit exiger d’elle..."
À Paris, à la cour, on trouve, je l’avoue,
Des femmes dont le zèle est digne qu’on le loue,
Qui s’occupent du bien, en tout temps, en tout lieu.
J’en sais une chérie et du monde et de Dieu,
Humble dans les grandeurs, sage dans la fortune,
Qui gémit, comme Esther, de sa gloire importune,
Que le vice lui-même est contraint d’estimer,
Et que sur ce tableau d’abord tu vas nommer.
Mais pour quelques vertus si pures, si sincères,
Combien y trouve-t-on d’impudentes faussaires,
Qui, sous un vain dehors d’austère piété,
De leurs crimes secrets cherchent l’impunité ;
Et couvrent de Dieu même, empreint sur leur visage,
De leurs honteux plaisirs l’affreux libertinage !
N’attends pas qu’à tes yeux j’aille ici l’étaler ;
Il vaut mieux le souffrir que de le dévoiler.
De leurs galans exploits les Bussys, les Brantômes,
Pourroient avec plaisir te compiler des tomes :
Mais pour moi, dont le front trop aisément rougit,
Ma bouche a déjà peur de t’en avoir trop dit.
Rien n’égale en fureur, en monstrueux caprices,
Une fausse vertu qui s’abandonne aux vices.
De ces femmes pourtant l’hypocrite noirceur
Au moins pour un mari garde quelque douceur.
Je les aime encor mieux qu’une bigote altière,
Qui, dans son fol orgueil, aveugle et sans lumière,
À peine sur le seuil de la dévotion,
Pense atteindre au sommet de la perfection ;
Qui du soin qu’elle prend de me gêner sans cesse
Va quatre fois par mois se vanter à confesse ;
Et, les yeux vers le ciel, pour se le faire ouvrir,
Offre à Dieu les tourmens qu’elle me fait souffrir.
Sur cent pieux devoirs aux saints elle est égale ;
Elle lit Rodriguez, fait l’oraison mentale,
Va pour les malheureux quêter dans les maisons,
Hante les hôpitaux, visite les prisons,
Tous les jours à l’église entend jusqu’à six messes :
Mais de combattre en elle et dompter ses foiblesses,
Sur le fard, sur le jeu, vaincre sa passion,
Mettre un frein à son luxe, à son ambition,
Et soumettre l’orgueil de son esprit rebelle,
C’est ce qu’en vain le ciel voudroit exiger d’elle.
Et peut-il, dira-t-elle, en effet l’exiger ?
Elle a son directeur, c’est à lui d’en juger.
Il faut sans différer savoir ce qu’il en pense.
Bon ! vers nous à propos je le vois qui s’avance.
Qu’il paroît bien nourri ! Quel vermillon ! quel teint !
Le printemps dans sa fleur sur son visage est peint.
Cependant, à l’entendre, il se soutient à peine :
Il eut encore hier la fièvre et la migraine ;
Et, sans les prompts secours qu’on prit soin d’apporter,
Il seroit sur son lit peut-être à trembloter.
Mais de tous les mortels, grâce aux dévotes âmes,
Nul n’est si bien soigné qu’un directeur de femmes.
Quelque léger dégoût vient-il le travailler,
Une foible vapeur le fait-elle bâiller,
Un escadron coiffé d’abord court à son aide :
L’une chauffe un bouillon, l’autre apprête un remède ;
Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
Confitures surtout, volent de tous côtés :
Car de tous mets sucrés, secs, en pâte, ou liquides,
Les estomacs dévots toujours furent avides :
Le premier massepain pour eux, je crois, se fit,
Et le premier citron à Rouen fut confit.
Notre docteur bientôt va lever tous ses doutes,
Du paradis pour elle il aplanit les routes ;
Et, loin sur ses défauts de la mortifier,
Lui-même prend le soin de la justifier.
Pourquoi vous alarmer d’une vaine censure ?
Du rouge qu’on vous voit on s’étonne, on murmure :
Mais a-t-on, dira-t-il, sujet de s’étonner ?
Est-ce qu’à faire peur on veut vous condamner ?
Aux usages reçus il faut qu’on s’accommode :
Une femme surtout doit tribut à la mode.
L’orgueil brille, dit-on, sur vos pompeux habits ;
L’œil à peine soutient l’éclat de vos rubis ;
Dieu veut-il qu’on étale un luxe si profane ?
Oui, lorsqu’à l’étaler notre rang nous condamne.
Mais ce grand jeu chez vous comment l’autoriser ?
Le jeu fut de tout temps permis pour s’amuser ;
On ne peut pas toujours travailler, prier, lire :
Il vaut mieux s’occuper à jouer qu’à médire.
Le plus grand jeu, joué dans cette intention,
Peut même devenir une bonne action :
Tout est sanctifié par une âme pieuse.
"Son mari, qu’une affaire appelle dans la ville,
Et qui chez lui sortant a tout laissé tranquille,
Se trouve assez surpris, rentrant dans la maison,
De voir que le portier lui demande son nom .."
Vous êtes, poursuit-on, avide, ambitieuse ;
Sans cesse vous brûlez de voir tous vos parens
Engloutir à la cour charges, dignités, rangs.
Votre bon naturel en cela pour eux brille ;
Dieu ne nous défend point d’aimer notre famille.
D’ailleurs tous vos parens sont sages, vertueux :
Il est bon d’empêcher ces emplois fastueux
D’être donnés peut-être à des âmes mondaines,
Éprises du néant des vanités humaines.
Laissez là, croyez-moi, gronder les indévots,
Et sur votre salut demeurez en repos.
Sur tous ces points douteux c’est ainsi qu’il prononce,
Alors, croyant d’un ange entendre la réponse,
Sa dévote s’incline, et, calmant son esprit,
A cet ordre d’en haut sans réplique souscrit.
Ainsi, pleine d’erreurs qu’elle croit légitimes,
Sa tranquille vertu conserve tous ses crimes ;
Dans un cœur tous les jours nourri du sacrement
Maintient la vanité, l’orgueil, l’entêtement,
Et croit que devant Dieu ses fréquens sacrilèges
Sont pour entrer au ciel d’assurés privilèges.
Voilà le digne fruit des soins de son docteur.
Encore est-ce beaucoup si ce guide imposteur,
Par les chemins fleuris d’un charmant quiétisme,
Tout à coup l’amenant au vrai molinosisme,
Il ne lui fait bientôt, aidé de Lucifer,
Goûter en paradis les plaisirs de l’enfer.
Mais dans ce doux état, molle, délicieuse,
La hais-tu plus, dis-moi, que cette bilieuse
Qui, follement outrée en sa sévérité,
Baptisant son chagrin du nom de piété,
Dans sa charité fausse où l’amour-propre abonde,
Croit que c’est aimer Dieu que haïr tout le monde ?
Il n’est rien où d’abord son soupçon attaché
Ne présume du crime et ne trouve un péché.
Pour une fille honnête et pleine d’innocence
Croit-elle en ses valets voir quelque complaisance ?
Réputés criminels, les voilà tous chassés,
Et chez elle à l’instant par d’autres remplacés.
Son mari, qu’une affaire appelle dans la ville,
Et qui chez lui sortant a tout laissé tranquille,
Se trouve assez surpris, rentrant dans la maison,
De voir que le portier lui demande son nom ;
Et que, parmi ses gens, changés en son absence,
Il cherche vainement quelqu’un de connoissance.
Fort bien ! le trait est bon ! dans les femmes, dis-tu,
Enfin vous n’approuvez ni vice ni vertu.
Voilà le sexe peint d’une noble manière :
Et Théophraste même, aidé de La Bruyère,
Ne m’en pourroit pas faire un plus riche tableau.
C’est assez : il est temps de quitter le pinceau ;
Vous avez désormais épuisé la satire.
Épuisé, cher Alcippe ! Ah ! tu me ferois rire !
Sur ce vaste sujet si j’allois tout tracer,
Tu verrois sous ma main des tomes s’amasser.
Dans le sexe j’ai peint la piété caustique :
Et que seroit-ce donc si, censeur plus tragique,
J’allois t’y faire voir l’athéisme établi,
Et, non moins que l’honneur, le ciel mis en oubli ;
Si j’allois t’y montrer plus d’une Capanée
Pour souveraine loi mettant la destinée,
Du tonnerre dans l’air bravant les vains carreaux,
Et nous parlant de Dieu du ton de Desbarreaux ?
"Enfin t’ai-je dépeint la superstitieuse,
La pédante au ton fier, la bourgeoise ennuyeuse,
Celle qui de son chat fait son seul entretien,
Celle qui toujours parle et ne dit jamais rien ?
Il en est des milliers ; mais ma bouche enfin lasse
Des trois quarts pour le moins veut bien te faire grâce...."
Mais sans aller chercher cette femme infernale,
T’ai-je encor peint, dis-moi, la fantasque inégale
Qui, m’aimant le matin, souvent me hait le soir ?
T’ai-je peint la maligne aux yeux faux, au cœur noir ?
T’ai-je encore exprimé la brusque impertinente ?
T’ai-je tracé la vieille à morgue dominante,
Qui veut, vingt ans encore après le sacrement,
Exiger d’un mari les respects d’un amant ?
T’ai-je fait voir de joie une belle animée,
Qui souvent d’un repas sortant tout enfumée,
Fait, même à ses amans, trop foibles d’estomac,
Redouter ses baisers pleins d’ail et de tabac ?
T’ai-je encore décrit la dame brelandière
Qui des joueurs chez soi se fait cabaretière,
Et souffre des affronts que ne souffriroit pas
L’hôtesse d’une auberge à dix sous par repas ?
Ai-je offert à tes yeux ces tristes Tisiphones,
Ces monstres pleins d’un fiel que n’ont point les lionnes.
Qui, prenant en dégoût les fruits nés de leur flanc,
S’irritent sans raison contre leur propre sang ;
Toujours en des fureurs que les plaintes aigrissent,
Battent dans leurs enfans l’époux qu’elles haïssent ;
Et font de leur maison, digne de Phalaris,
Un séjour de douleur, de larmes et de cris ?
Enfin t’ai-je dépeint la superstitieuse,
La pédante au ton fier, la bourgeoise ennuyeuse,
Celle qui de son chat fait son seul entretien,
Celle qui toujours parle et ne dit jamais rien ?
Il en est des milliers ; mais ma bouche enfin lasse
Des trois quarts pour le moins veut bien te faire grâce.
J’entends, c’est pousser loin la modération.
Ah ! finissez, dis-tu, la déclamation.
Pensez-vous qu’ébloui de vos vaines paroles,
J’ignore qu’en effet tous ces discours frivoles
Ne sont qu’un badinage, un simple jeu d’esprit
D’un censeur dans le fond qui folâtre et qui rit,
Plein du même projet qui vous vint dans la tête
Quand vous plaçâtes l’homme au-dessous de la bête ?
Mais enfin vous et moi c’est assez badiner,
Il est temps de conclure ; et, pour tout terminer,
Je ne dirai qu’un mot. La fille qui m’enchante,
Noble, sage, modeste, humble, honnête, touchante,
N’a pas un des défauts que vous m’avez fait voir.
Si, par un sort pourtant qu’on ne peut concevoir,
La belle, tout à coup rendue insociable,
D’ange, ce sont vos mots, se transformoit en diable,
Vous me verriez bientôt, sans me désespérer,
Lui dire : Eh bien ! madame, il faut nous séparer ;
Nous ne sommes pas faits, je le vois, l’un pour l’autre.
Mon bien se monte à tant : tenez, voilà le vôtre.
Partez : délivrons-nous d’un mutuel souci.
Alcippe, tu crois donc qu’on se sépare ainsi ?
Pour sortir de chez toi sur cette offre offensante
As-tu donc oublié qu’il faut qu’elle y consente ?
Et crois-tu qu’aisément elle puisse quitter
Le savoureux plaisir de t’y persécuter ?
Bientôt son procureur, pour elle usant sa plume,
De ses prétentions va t’offrir un volume :
Car, grâce au droit reçu chez les Parisiens,
Gens de douce nature, et maris bons chrétiens,
Dans ses prétentions une femme est sans borne.
Alcippe, à ce discours je te trouve un peu morne.
Des arbitres, dis-tu, pourront nous accorder,
Des arbitres !… Tu crois l’empêcher de plaider !
Sur ton chagrin déjà contente d’elle-même,
Ce n’est point tous ses droits, c’est le procès qu’elle aime.
Pour elle un bout d’arpent qu’il faudra disputer
Vaut mieux qu’un fief entier acquis sans contester.
Avec elle il n’est point de droit qui s’éclaircisse,
Point de procès si vieux qui ne se rajeunisse ;
Et sur l’art de former un nouvel embarras,
Devant elle Rolet mettroit pavillon bas.
Crois-moi, pour la fléchir trouve enfin quelque voie,
Ou je ne réponds pas dans peu qu’on ne te voie,
Sous le faix des procès abattu, consterné,
Triste, à pied, sans laquais, maigre, sec, ruiné,
Vingt fois dans ton malheur résolu de te pendre,
Et, pour comble de maux, réduit à la reprendre.

Satire Xl, Sur l'Honneur, à M. de Valincour, composée en 1698, publiée en 1701.
Satire écrite à l'occasion du procès intenté aux Boileau sur leur noblesse , par une compagnie de financiers, et critique le faux honneur du "monde" qui, vicié par l'orgueil, impose le duel pour le moindre affront...
Oui, l’honneur, Valincour, est chéri dans le monde :
Chacun, pour l’exalter, en paroles abonde ;
À s’en voir revêtu chacun met son bonheur ;
Et tout crie ici-bas : L’honneur ! Vive l’honneur !
Entendons discourir sur les bancs des galères,
Ce forçat abhorré même de ses confrères ;
Il plaint, par un arrêt injustement donné,
L’honneur en sa personne a ramer condamné :
En un mot, parcourons et la mer et la terre ;
Interrogeons marchands, financiers, gens de guerre,
Courtisans, magistrats : chez eux, si je les croi,
L’intérêt ne peut rien, l’honneur seul fait la loi.
Cependant, lorsqu’aux yeux leur portant la lanterne,
J’examine au grand jour l’esprit qui les gouverne,
Je n’aperçois partout que folle ambition,
Foiblesse, iniquité, fourbe, corruption,
Que ridicule orgueil de soi-même idolâtre.
Le monde, à mon avis, est comme un grand théâtre,
Où chacun en public, l’un par l’autre abusé,
Souvent à ce qu’il est joue un rôle opposé.
Tous les jours on y voit, orné d’un faux visage
Impudemment le fou représenter le sage ;
L’ignorant s’ériger en savant fastueux,
Et le plus vil faquin trancher du vertueux.
Mais, quelque fol espoir dont leur orgueil les berce,
Bientôt on les connoît, et la vérité perce.
On a beau se farder aux yeux de l’univers :
À la fin sur quelqu’un de nos vices couverts
Le public malin jette un œil inévitable ;
Et bientôt la censure, au regard formidable,
Sait, le crayon en main, marquer nos endroits faux,
Et nous développer avec tous nos défauts.
Du mensonge toujours le vrai demeure maître.
Pour paroître honnête homme, en un mot, il faut l’être ;
Et jamais, quoi qu’il fasse, un mortel ici-bas
Ne peut aux yeux du monde être ce qu’il n’est pas.
En vain ce misanthrope, aux yeux tristes et sombres,
Veut, par un air riant, en éclaircir les ombres :
Le ris sur son visage est en mauvaise humeur ;
L’agrément fuit ses traits, ses caresses font peur ;
Ses mots les plus flatteurs paroissent des rudesses,
Et la vanité brille en toutes ses bassesses.
Le naturel toujours sort et sait se montrer :
Vainement on l’arrête, on le force à rentrer ;
Il rompt tout, perce tout, et trouve enfin passage.
Mais loin de mon projet je sens que je m’engage.
Revenons de ce pas à mon texte égaré.
L’honneur partout, disois-je, est du monde admiré ;
Mais l’honneur en effet qu’il faut que l’on admire,
Quel est-il, Valincour ? Pourras-tu me le dire ?
L’ambitieux le met souvent à tout brûler ;
L’avare, à voir chez lui le Pactole rouler ;
Un faux brave, à vanter sa prouesse frivole ;
Un vrai fourbe, à jamais ne garder sa parole ;
Ce poëte, a noircir d’insipides papiers ;
Ce marquis, à savoir frauder ses créanciers :
Un libertin, à rompre et jeûnes et carême ;
Un fou perdu d’honneur, à braver l’honneur même.
L’un d’eux a-t-il raison ? Qui pourroit le penser ?
Qu’est-ce donc que l’honneur que tout doit embrasser ?
Est-ce de voir, dis-moi, vanter notre éloquence,
D’exceller en courage, en adresse, en prudence ;
De voir à notre aspect tout trembler sous les cieux ;
De posséder enfin mille dons précieux ?
Mais avec tous ces dons de l’esprit et de l’âme
Un roi même souvent peut n’être qu’un infâme,
Qu’un Hérode, un Tibère effroyable à nommer.
Où donc est cet honneur qui seul doit nous charmer ?
Quoi qu’en ses beaux discours Saint-Évremont nous prône,
Aujourd’hui j’en croirai Sénèque avant Pétrone.
"Depuis, toujours ici riche de leur ruine,
Sur les tristes mortels le faux honneur domine,
Gouverne tout, fait tout, dans ce bas univers.."
Dans le monde il n’est rien de beau que l’équité :
Sans elle la valeur, la force, la bonté,
Et toutes les vertus dont s’éblouit la terre,
Ne sont que faux brillans, et que morceaux de verre.
Un injuste guerrier, terreur de l’univers,
Qui, sans sujet, courant chez cent peuples divers,
S’en va tout ravager jusqu’aux rives du Gange,
N’est qu’un plus grand voleur que du Tertre et Saint-Ange.
Du premier des Césars on vante les exploits ;
Mais dans quel tribunal, jugé suivant les lois,
Eût-il pu disculper son injuste manie ?
Qu’on livre son pareil en France à La Reynie,
Dans trois jours nous verrons le phénix des guerriers
Laisser sur l’échafaud sa tête et ses lauriers.
C’est d’un roi que l’on tient cette maxime auguste,
Que jamais on est grand qu’autant que l’on est juste.
Rassemblez à la fois Mithridate et Sylla ;
Joignez-y Tamerlan, Genséric, Attila :
Tous ces fiers conquérans, rois, princes, capitaines,
Sont moins grands à mes yeux que ce bourgeois d’Athènes
Qui sut, pour tous exploits, doux, modéré, frugal,
Toujours vers la justice aller d’un pas égal.
Oui, la justice en nous est la vertu qui brille ;
Il faut de ses couleurs qu’ici-bas tout s’habille ;
Dans un mortel chéri, tout injuste qu’il est,
C’est quelque air d’équité qui séduit et qui plaît.
À cet unique appas l’âme est vraiment sensible :
Même aux yeux de l’injuste un injuste est horrible ;
Et tel qui n’admet point la probité chez lui
Souvent à la rigueur l’exige chez autrui.
Disons plus : il n’est point d’âme livrée au vice
Où l’on ne trouve encor des traces de justice.
Chacun de l’équité ne fait pas son flambeau ;
Tout n’est pas Caumartin, Bignon, ni Daguesseau.
Mais jusqu’en ces pays où tout vit de pillage,
Chez l’Arabe et le Scythe, elle est de quelque usage ;
Et du butin, acquis en violant les lois,
C’est elle entre eux qui fait le partage et le choix.
Mais allons voir le vrai jusqu’en sa source même.
Un dévot aux yeux creux, et d’abstinence blême,
S’il n’a point le cœur juste, est affreux devant Dieu.
L’Évangile au chrétien ne dit en aucun lieu :
« Sois dévot : » elle dit : « Sois doux, simple, équitable. »
Car d’un dévot souvent au chrétien véritable
La distance est deux fois plus longue, à mon avis,
Que du pôle antarctique au détroit de Davis.
Encor par ce dévot ne crois pas que j’entende
Tartuffe, ou Molinos et sa mystique bande :
J’entends un faux chrétien, mal instruit, mal guidé,
Et qui de l’Évangile en vain persuadé,
N’en a jamais conçu l’esprit ni la justice ;
Un chrétien qui s’en sert pour disculper le vice ;
Qui toujours près des grands, qu’il prend soin d’abuser,
Sur leurs foibles honteux sait les autoriser,
Et croit pouvoir au ciel, par ses folles maximes,
Comblé de sacremens faire entrer tous les crimes.
Des faux dévots pour moi voilà le vrai héros.
Mais, pour borner enfin tout ce vague propos,
Concluons qu’ici-bas le seul honneur solide,
C’est de prendre toujours la vérité pour guide,
De regarder en tout la raison et la loi ;
D’être doux pour tout autre, et rigoureux pour soi,
D’accomplir tout le bien que le ciel nous inspire ;
Et d’être juste enfin : ce mot seul veut tout dire.
Je doute que le flot des vulgaires humains
À ce discours pourtant donne aisément les mains ;
Et, pour t’en dire ici la raison historique,
Souffre que je l’habille en fable allégorique.
Sous le bon roi Saturne, ami de la douceur,
L’honneur, cher Valincour, et l’équité, sa sœur,
De leurs sages conseils éclairant tout le monde,
Régnoient, chéris du ciel, dans une paix profonde ;
Tout vivoit en commun sous ce couple adoré :
Aucun n’avoit d’enclos ni de champ séparé.
La vertu n’étoit point sujette à l’ostracisme,
Ni ne s’appeloit point alors un jansénisme.
L’honneur, beau par soi-même, et sans vains ornemens,
N’étaloit point aux yeux l’or ni les diamans ;
Et, jamais ne sortant de ses devoirs austères,
Maintenoit de sa sœur les règles salutaires.
Mais une fois au ciel par les dieux appelé,
Il demeura longtemps au séjour étoilé.
Un fourbe cependant, assez haut de corsage,
Et qui lui ressembloit de geste et de visage,
Prend son temps, et partout ce hardi suborneur
S’en va chez les humains crier qu’il est l’honneur,
Qu’il arrive du ciel, et que, voulant lui-même
Seul porter désormais le faix du diadème,
De lui seul il prétend qu’on reçoive la loi.
À ces discours trompeurs le monde ajoute foi.
L’innocente équité, honteusement bannie,
Trouve à peine un désert où fuir l’ignominie.
Aussitôt sur un trône éclatant de rubis
L’imposteur monte, orné de superbes habits.
La hauteur, le dédain, l’audace l’environnent ;
Et le luxe et l’orgueil de leurs mains le couronnent
Tout fier il montre alors un front plus sourcilleux :
Et le Mien et le Tien, deux frères pointilleux,
Par son ordre amenant les procès et la guerre,
En tous lieux de ce pas vont partager la terre ;
En tous lieux, sous les noms de bon droit et de tort,
Vont chez elle établir le seul droit du plus fort.
Le nouveau roi triomphe, et, sur ce droit inique,
Bâtit de vaines lois un code fantastique ;
Avant tout aux mortels prescrit de se venger,
L’un l’autre au moindre affront les force à s’égorger,
Et dans leur âme, en vain de remords combattue,
Trace en lettres de sang ces deux mots : Meurs ou tue.
Alors, ce fut alors, sous ce vrai Jupiter,
Qu’on vit naître ici-bas le noir siècle de fer.
Le frère au même instant s’arma contre le frère ;
Le fils trempa ses mains dans le sang de son père ;
La soif de commander enfanta des tyrans,
Du Tanaïs au Nil porta les conquérans ;
L’ambition passa pour la vertu sublime :
Le crime heureux fut juste et cessa d’être crime :
On ne vit plus que haine et que division,
Qu’envie, effroi, tumulte, horreur, confusion.
Le véritable honneur sur la voûte céleste
Est enfin averti de ce trouble funeste.
Il part sans différer, et descendu des cieux,
Va partout se montrer dans les terrestres lieux :
Mais il n’y fait plus voir qu’un visage incommode ;
On n’y peut plus souffrir ses vertus hors de mode ;
Et lui-même, traité de fourbe et d’imposteur,
Est contraint de ramper aux pieds du séducteur.
Enfin, las d’essuyer outrage sur outrage,
Il livre les humains à leur triste esclavage ;
S’en va trouver sa sœur, et dès ce même jour,
Avec elle s’envole au céleste séjour.
Depuis, toujours ici riche de leur ruine,
Sur les tristes mortels le faux honneur domine,
Gouverne tout, fait tout, dans ce bas univers ;
Et peut-être est-ce lui qui m’a dicté ces vers.
Mais en fût-il l’auteur, je conclus de sa fable
Que ce n’est qu’en Dieu seul qu’est l’honneur véritable.

Satire XII, L'Equivoque, composé en 1703, publiée en 1716.
La dernière satire qu'écrit Boileau se veut une défense contre des écrits qui circulent en son nom : "j'ai appris qu'on débitoit dans le monde, sous mon nom , quantité de méchants écrits, et entre autres une pièce en vers contre les jésuites, également odieuse et insipide, et où l'on me faisoit, en mon propre nom, dire à toute leur société les injures les plus atroces et les plus grossières. J'avoue que cela m'a donné un très-grand chagrin : car, bien que tous les gens sensés aient connu sans peine que la pièce n'étoit point de moi, et qu'il n'y ait eu que de très-petits esprits qui aient présumé que j'en pouvois être l'auteur, la vérité est pourtant que je n'ai pas regardé comme un médiocre affront de me voir soupçonné, même par des ridicules, d'avoir fait un ouvrage si ridicule. J'ai donc cherché les moyens les plus propres pour me laver de cette infamie; et, tout bien considéré, je n'ai point trouvé de meilleur expédient que de faire imprimer ma satire contre I'Équivoque ; parce qu'en la lisant, les moins éclairés même de ces petits esprits ouvriroient peut-être les yeux, et verroient manifestement le peu de rapport qu'il y a de mon style, même en l'âge où je suis, au style bas et rampant de l'auteur de ce pitoyable écrit. Ajoutez à cela que je pouvois mettre à la tête de ma satire, en la donnant au public, un avertissement en manière de préface, où je me justifierois pleinement, et tirerois tout le monde d'erreur."
Du langage françois bizarre hermaphrodite.
De quel genre te faire, équivoque maudite,
Ou maudit ? car sans peine aux rimeurs hasardeux
L’usage encor, je crois, laisse le choix des deux.
Tu ne me réponds rien. Sors d’ici, fourbe insigne,
Mâle aussi dangereux que femelle maligne,
Qui crois rendre innocens les discours imposteurs ;
Tourment des écrivains, juste effroi des lecteurs :
Par qui de mots confus sans cesse embarrassée
Ma plume, en écrivant, cherche en vain ma pensée
Laisse-moi ; va charmer de tes vains agrémens
Les yeux faux et gâtés de tes louches amans,
Et ne viens point ici de ton ombre grossière
Envelopper mon style, ami de la lumière.
Tu sais bien que jamais chez toi, dans mes discours,
Je n’ai d’un faux brillant emprunté le secours :
Fuis donc. Mais non, demeure ; un démon qui m’inspire
Veut qu’encore une utile et dernière satire,
De ce pas en mon livre exprimant tes noirceurs,
Se vienne, en nombre pair, joindre à ses onze sœurs,
Et je sens que ta vue échauffe mon audace.
Viens, approche voyons, malgré l'âge et sa glace,
Si ma muse aujourd’hui sortant de sa langueur,
Pourra trouver encore un reste de vigueur.
Mais où tend, dira-t-on, ce projet fantastique ?
Ne vaudroit-il pas mieux dans mes vers, moins caustique,
Répandre de tes jeux le sel divertissant,
Que d’aller contre toi, sur ce ton menaçant,
Pousser jusqu’à l’excès ma critique boutade ?
Je ferois mieux, j’entends, d’imiter Benserade.
C’est par lui qu’autrefois, mise en ton plus beau jour,
Tu sus, trompant les yeux du peuple et de la cour,
Leur faire, à la faveur de tes bluettes folles,
Goûter comme bons mots tes quolibets frivoles.
Mais ce n’est plus le temps : le public détrompé
D’un pareil enjouement ne se sent plus frappé.
Tes bons mots, autrefois délices des ruelles,
Approuvés chez les grands, applaudis chez les belles,
Hors de mode aujourd’hui chez nos plus froids badins,
Sont des collets montés et des vertugadins.
Le lecteur ne sait plus admirer dans Voiture
De ton froid jeu de mots l’insipide figure :
C’est à regret qu’on voit cet auteur si charmant,
Et pour mille beaux traits vanté si justement,
Chez toi toujours cherchant quelque finesse aiguë,
Présenter au lecteur sa pensée ambiguë,
Et souvent du faux sens d’un proverbe affecté
Faire de son discours la piquante beauté.
Mais laissons là le tort qu’à ses brillans ouvrages
Fit le plat agrément de tes vains badinages.
Parlons des maux sans fin que ton sens de travers,
Source de toute erreur, sema dans l’univers :
Et, pour les contempler jusque dans leur naissance,
Dès le temps nouveau-né, quand la Toute-Puissance
D’un mot forma le ciel, l’air, la terre et les flots,
N’est-ce pas toi, voyant le monde à peine éclos,
Qui, par l’éclat trompeur d’une funeste pomme,
Et tes mots ambigus, fis croire au premier homme
Qu’il alloit, en goûtant de ce morceau fatal,
Comblé de tout savoir, à Dieu se rendre égal ?
Il en fit sur-le-champ la folle expérience :
Mais tout ce qu’il acquit de nouvelle science
Fut que, triste et honteux de voir sa nudité,
Il sut qu’il n’étoit plus, grâce à sa vanité,
Qu’un chétif animal pétri d’un peu de terre,
À qui la faim, la soif partout faisoient la guerre,
Et qui, courant toujours de malheur en malheur,
A la mort arrivoit enfin par la douleur.
"Ainsi, loin du vrai jour par toi toujours conduit,
L’homme ne sortit plus de son épaisse nuit......"
Oui, de tes noirs complots et de ta triste rage
Le genre humain perdu fut le premier ouvrage.
Et bien que l’homme alors parût si rabaissé,
Par toi contre le ciel un orgueil insensé
Armant de ses neveux la gigantesque engeance,
Dieu résolut enfin, terrible en sa vengeance,
D’abîmer sous les eaux tous ces audacieux.
Mais avant qu’il lâchât les écluses des cieux,
Par un fils de Noé fatalement sauvée.
Tu fus, comme serpent, dans l’arche conservée,
Et d’abord poursuivant tes projets suspendus,
Chez les mortels restans, encor tout éperdus,
De nouveau tu semas tes captieux mensonges,
Et remplis leurs esprits de fables et de songes.
Tes voiles offusquant leurs yeux de toutes parts,
Dieu disparut lui-même à leurs troubles regards.
Alors ce ne fut plus que stupide ignorance,
Qu’impiété sans borne en son extravagance,
Puis, de cent dogmes faux la superstition
Répandant l’idolâtre et folle illusion
Sur la terre en tout lieu disposée à les suivre,
L’art se tailla des dieux d’or, d’argent et de cuivre ;
Et l’artisan lui-même, humblement prosterné
Aux pieds du vain métal par sa main façonné,
Lui demanda les biens, la santé, la sagesse.
Le monde fut rempli de dieux de toute espèce :
On vit le peuple fou qui du Nil boit les eaux
Adorer les serpens, les poissons, les oiseaux,
Aux chiens, aux chats, aux boucs offrir des sacrifices,
Conjurer l’ail, l’oignon, d’être à ses vœux propices ;
Et croire follement maîtres de ses destins
Ces dieux nés du fumier porté dans ses jardins.
Bientôt te signalant par mille faux miracles,
Ce fut toi qui partout fis parler les oracles :
C’est par ton double sens dans leurs discours jeté
Qu’ils surent, en mentant, dire la vérité ;
Et sans crainte, rendant leurs réponses normandes,
Des peuples et des rois engloutir les offrandes.
Ainsi, loin du vrai jour par toi toujours conduit,
L’homme ne sortit plus de son épaisse nuit.
Pour mieux tromper ses yeux, ton adroit artifice
Fit à chaque vertu prendre le nom d’un vice ;
Et par toi, de splendeur faussement revêtu,
Chaque vice emprunta le nom d’une vertu.
Par toi l’humilité devint une bassesse ;
La candeur se nomma grossièreté, rudesse.
Au contraire, l’aveugle et folle ambition
S’appela des grands cœurs la belle passion :
Du nom de fierté noble on orna l’impudence,
Et la fourbe passa pour exquise prudence :
L’audace brilla seule aux yeux de l’univers ;
Et pour vraiment héros, chez les hommes pervers,
On ne reconnut plus qu’usurpateurs iniques,
Que tyranniques rois censés grands politiques,
Qu’infâmes scélérats à la gloire aspirans,
Et voleurs revêtus du nom de conquérans,
Mais à quoi s’attacha ta savante malice ?
Ce fut surtout à faire ignorer la justice.
Dans les plus claires lois ton ambiguïté
Répandant son adroite et fine obscurité,
Aux yeux embarrassés des juges les plus sages
Tout sens devint douteux, tout mot eut deux visages.
Plus on crut pénétrer, moins on fut éclairci ;
Le texte fut souvent par la glose obscurci :
Et pour comble de maux, à tes raisons frivoles
L’éloquence prêtant l’ornement des paroles,
Tous les jours accablé sous leur commun effort,
Le vrai passa pour faux, et le bon droit eut tort.
"Car, qu’est-ce, loin de Dieu, que l’humaine sagesse ? ....."
Voilà comme, déchu de sa grandeur première,
Concluons, l’homme enfin perdit toute lumière,
Et, par tes yeux trompeurs se figurant tout voir,
Ne vit, ne sut plus rien, ne put plus rien savoir.
De la raison pourtant, par le vrai Dieu guidée,
Il resta quelque trace encor dans la Judée.
Chez les hommes ailleurs sous ton joug gémissans
Vainement on chercha la vertu, le droit sens :
Car, qu’est-ce, loin de Dieu, que l’humaine sagesse ?
Et Socrate, l’honneur de la profane Grèce,
Qu’étoit-il en effet, de prés examiné,
Qu’un mortel par lui-même au seul mal entraîné
Et, malgré la vertu dont il faisoit parade,
Très-équivoque ami du jeune Alcibiade ?
Oui, j’ose hardiment l’affirmer contre toi,
Dans le monde idolâtre, asservi sous ta loi,
Par l’humaine raison de clarté dépourvue
L’humble et vraie équité fut à peine entrevue :
Et, par un sage altier, au seul faste attaché,
Le bien même accompli souvent fut un péché.
Pour tirer l’homme enfin de ce désordre extrême,
Il fallut qu’ici-bas Dieu, fait homme lui-même,
Vint du sein lumineux de l’éternel séjour
De tes dogmes trompeurs dissiper le faux jour.
A l’aspect de ce Dieu les démons disparurent ;
Dans Delphes, dans Délos, tes oracles se turent :
Tout marqua, tout sentit sa venue en ces lieux ;
L’estropié marcha, l’aveugle ouvrit les yeux.
Mais bientôt contre lui ton audace rebelle,
Chez la nation même à son culte fidèle,
De tous côtés arma tes nombreux sectateurs,
Prêtres, pharisiens, rois, pontifes, docteurs.
C’est par eux que l’on vit la vérité suprême
De mensonge et d’erreur accusée elle-même,
Au tribunal humain le Dieu du ciel traîné,
Et l’auteur de la vie à mourir condamné.
Ta fureur toutefois à ce coup fut déçue,
Et pour toi ton audace eut une triste issue
Dans la nuit du tombeau ce Dieu précipité
Se releva soudain tout brillant de clarté ;
Et partout sa doctrine en peu de temps portée
Fut du Gange et du Nil et du Tage écoutée.
Des superbes autels à leur gloire dressés
Tes ridicules dieux tombèrent renversés :
On vit en mille endroits leurs honteuses statues
Pour le plus bas usage utilement fondues ;
Et gémir vainement Mars, Jupiter, Vénus,
Urnes, vases, triépieds, vils meubles devenus.
Sans succomber pourtant tu soutins cet orage
Et, sur l’idolâtrie enfin perdant courage,
Pour embarrasser l’homme en des nœuds plus subtils,
Tu courus chez Satan brouiller de nouveaux fils.
Alors, pour seconder ta triste frénésie,
Arriva de l’enfer ta fille, l’hérésie.
Ce monstre, dés l’enfance à ton école instruit,
De tes leçons bientôt te fit goûter le fruit.
Par lui l’erreur, toujours finement apprêtée,
Sortant pleine d’attraits de sa bouche empesté,
De son mortel poison tout courut s’abreuver,
Et l’Église elle-même eut peine à s’en sauver.
Elle-même deux fois, presque toute arienne,
Sentit chez soi trembler la vérité chrétienne ;
Lorsqu’attaquant le Verbe et sa divinité,
D’une syllabe impie un saint mot augmenté
Remplit tous les esprits d’aigreurs si meurtrières,
Et fit de sang chrétien couler tant de rivières.
Le fidèle, au milieu de ces troubles confus,
Quelque temps égaré, ne se reconnut plus ;
Et dans plus d’un aveugle et ténébreux concile
Le mensonge parut vainqueur de l’Évangile.
Mais à quoi bon ici du profond des enfers,
Nouvel historien de tant de maux soufferts,
Rappeler Arius, Valentin, et Pélage,
Et tous ces fiers démons que toujours d’âge en âge
Dieu, pour faire éclaircir à fond ses vérités,
A permis qu’aux chrétiens l’enfer ait suscités ?
"Ce ne fut plus partout que fous anabaptistes,
Qu’orgueilleux puritains, qu’exécrables déistes.
Le plus vil artisan eut ses dogmes à soi,
Et chaque chrétien fut de différente loi....."
Laissons hurler là-bas tous ces damnés antiques,
Et bornons nos regards aux troubles fanatiques
Que ton horrible fille ici sut émouvoir,
Quand Luther et Calvin, remplis de ton savoir,
Et soi-disant choisis pour réformer l’Église,
Vinrent du célibat affranchir la prêtrise,
Et, des vœux les plus saints blâmant l’austérité,
Aux moines las du joug rendre la liberté.
Alors n’admettant plus d’autorité visible,
Chacun fut de la foi censé juge infaillible ;
Et, sans être approuvé par le clergé romain,
Tout protestant fut pape, une Bible à la main.
De cette erreur dans peu naquirent plus de sectes
Qu’en automne on ne voit de bourdonnans insectes
Fondre sur les raisins nouvellement mûris,
Ou qu’en toutes saisons sur les murs, à Paris,
On ne voit affichés de recueils d’amourettes,
De vers, de contes bleus, de frivoles sornettes,
Souvent peu recherchés du public nonchalant,
Mais vantés à coup sûr du Mercure Galant.
Ce ne fut plus partout que fous anabaptistes,
Qu’orgueilleux puritains, qu’exécrables déistes.
Le plus vil artisan eut ses dogmes à soi,
Et chaque chrétien fut de différente loi.
La Discorde, au milieu de ces sectes altières,
En tout lieu cependant déploya ses bannières ;
Et ta fille, au secours des vains raisonnemens
Appelant le ravage et les embrasemens,
Fit, en plus d’un pays, aux villes désolées,
Sous l’herbe en vain chercher leurs églises brûlées.
L’Europe fut un champ de massacre et d’horreur,
Et l’orthodoxe même, aveugle en sa fureur,
De tes dogmes trompeurs nourrissant son idée,
Oublia la douceur aux chrétiens commandée,
Et crut, pour venger Dieu de ses fiers ennemis,
Tout ce que Dieu défend légitime et permis.
Au signal tout à coup donné pour le carnage,
Dans les villes, partout, théâtres de leur rage,
Cent mille faux zélés, le fer en main courans,
Allèrent attaquer leurs amis, leurs parens ;
Et, sans distinction, dans tout sein hérétique
Pleins de joie enfoncer un poignard catholique.
Car quel lion, quel tigre égale en cruauté
Une injuste fureur qu’arme la piété ?
Ces fureurs, jusqu’ici du vain peuple admirées,
Étoient pourtant toujours de l’Église abhorrées ;
Et, dans ton grand crédit pour te bien conserver,
Il falloit que le ciel parût les approuver :
Ce chef-d’œuvre devoit couronner ton adresse.
Pour y parvenir donc, ton active souplesse,
Dans l’école abusant tes grossiers écrivains,
Fit croire à leurs esprits ridiculement vains
Qu’un sentiment impie, injuste, abominable,
Par deux ou trois d’entre eux réputé soutenable,
Prenoit chez eux un sceau de probabilité,
Qui même contre Dieu lui donnoit sûreté ;
Et qu’un chrétien pouvoit, rempli de confiance,
Même en le condamnant, le suivre en conscience.
C’est sur ce beau principe, admis si follement,
Qu’aussitôt tu posas l’énorme fondement
De la plus dangereuse et terrible morale
Que Lucifer, assis dans sa chaire infernale,
Vomissant contre Dieu ses monstrueux sermons,
Ait jamais enseignée aux novices démons.
Soudain, au grand honneur de l’école païenne,
On entendit prêcher dans l’Église chrétienne
Que sous le joug du vice un pécheur abattu
Pouvoit, sans aimer Dieu ni même la vertu,
Par la seule frayeur au sacrement unie,
Admis au ciel, jouir de la gloire infinie ;
Et que, les clefs en main, sur ce seul passe-port.
Saint Pierre à tous venans devoit ouvrir d’abord.
Ainsi, pour éviter l’éternelle misère,
Le vrai zèle au chrétien n’étant plus nécessaire,
Tu sus, dirigeant bien en eux l’intention,
De tout crime laver la coupable action.
Bientôt, se parjurer cessa d’être un parjure ;
L’argent à tout denier se prêta sans usure ;
Sans simonie, on put, contre un bien temporel,
Hardiment échanger un bien spirituel ;
Du soin d’aider le pauvre on dispensa l’avare ;
Et même chez les rois le superflu fut rare.
C’est alors qu’on trouva, pour sortir d’embarras,
L’art de mentir tout haut en disant vrai tout bas ;
C’est alors qu’on apprit qu’avec un peu d’adresse
Sans crime un prêtre peut vendre trois fois sa messe ;
Pourvu que, laissant là son salut à l’écart,
Lui-même en la lisant n’y prenne aucune part.
C’est alors que l’on sut qu’on peut pour une pomme,
Sans blesser la justice, assassiner un homme :
Assassiner ! ah ! non, je parle improprement ;
Mais que, prêt à la perdre, on peut innocemment,
Surtout ne la pouvant sauver d’une autre sorte,
Massacrer le voleur qui fuit et qui l’emporte.
Enfin ce fut alors que, sans se corriger,
Tout pécheur…. Mais où vais-je aujourd’hui m’engager ?
Veux-je d’un pape illustre, armé contre tes crimes,
À tes yeux mettre ici toute la bulle en rimes ;
Exprimer tes détours burlesquement pieux
Pour disculper l’impur, le gourmand, l’envieux ;
Tes subtils faux-fuyans pour sauver la mollesse,
Le larcin, le duel, le luxe, la paresse,
En un mot, faire voir à fond développés
Tous ces dogmes affreux d’anathème frappés,
Que, sans peur débitant tes distinctions folles,
L’erreur encor pourtant maintient dans tes écoles ?
Mais sur ce seul projet soudain puis-je ignorer
À quels nombreux combats il faut me préparer ?
J’entends déjà d’ici tes docteurs frénétiques
Hautement me compter au rang des hérétiques,
M’appeler scélérat, traître, fourbe, imposteur.
Froid plaisant, faux bouffon, vrai calomniateur,
De Pascal, de Wendrock copiste misérable ;
Et, pour tout dire enfin, janséniste exécrable.
J’aurai beau condamner, en tous sens expliqués,
Les cinq dogmes fameux par ta main fabriqués,
Blâmer de tes docteurs la morale risible :
C’est, selon eux, prêcher un calvinisme horrible,
C’est nier qu’ici-bas par l’amour appelé
Dieu pour tous les humains voulut être immolé.
Prévenons tout ce bruit : trop tard, dans le naufrage,
Confus on se repent d’avoir bravé l’orage.
Halte-là donc, ma plume. Et toi, sors de ces lieux,
Monstre à qui, par un trait des plus capricieux,
Aujourd’hui terminant ma course satirique,
J’ai prêté dans mes vers une âme allégorique.
Fuis, va chercher ailleurs tes patrons bien-aimés,
Dans ces pays par toi rendus si renommés,
Où l’Orne épand ses eaux, et que la Sarthe arrose ;
Ou, si plus sûrement tu veux gagner ta cause,
Porte-la dans Trévoux, à ce beau tribunal
Où de nouveaux Midas un sénat monacal,
Tous les mois, appuyé de ta sœur l’Ignorance,
Pour juger Apollon tient, dit-on, sa séance.

Le "Discours sur la satire",
répond aux reproches adressés à l'édition de 1666 par une justification des critiques "ad hominem". De 1668 à 1685, Boileau avait placé le Discours sur la satire après la neuvième satire qui était alors la dernière; mais de 1694 à 1713, il le renvoya aux œuvres en prose...
"Quand je donnai la première fois mes satires au public, je m'étois bien préparé au tumulte que l'impression de mon livre a excité sur le Parnasse. Je savois que la nation des poètes, et surtout des mauvais poètes, est une nation farouche qui prend feu aisément, et que ces esprits avides de louanges ne digéreroient pas facilement une raillerie, quelque douce qu'elle put être. Aussi oserai-je dire, à mon avantage, que j'ai regardé avec des yeux assez stoïques les libelles diffamatoires qu'on a publiés contre moi. Quelques calomnies dont on ait voulu me noircir, quelques faux bruits qu'on ait semés de ma personne, j'ai pardonné sans peine ces petites vengeances au déplaisir d'un auteur irrité, qui se voyoit attaqué par l'endroit le plus sensible d'un poète, je veux dire par ses ouvrages.
Mais j'avoue que j'ai été un peu surpris du chagrin bizarre de certains lecteurs, qui, au lieu de se divertir d'une querelle du Parnasse dont ils pouvoient être spectateurs indifférents, ont mieux aimé prendre parti et s'affliger avec les ridicules, que de se réjouir avec les honnêtes gens. C'est pour les consoler que j'ai composé ma neuvième satire, où je pense avoir montré assez clairement que, sans blesser l'Etat ni sa conscience, on peut trouver de méchants vers méchants, et s'ennuyer de plein droit à la lecture d'un sot livre. Mais puisque ces messieurs ont parlé de la liberté que je me suis donnée de nommer, comme d'un attentat inouï et sans exemples , et que des exemples ne se peuvent pas mettre en rimes, il est bon d'en dire ici un mot pour les instruire d'une chose qu'eux seuls veulent ignorer, et leur faire voir qu'en comparaison de tous mes confrères les satiriques j'ai été un poëte fort retenu (...) Raillerie à part, ces messieurs veulent-ils être plus sages que Scipion et Laelius, plus délicats qu'Auguste, plus cruels que Néron ? Mais eux qui sont si rigoureux envers les critiques, d'où vient cette clémence qu'ils affectent pour les méchants auteurs? Je vois bien ce qui les afflige; ils ne veulent pas être détrompés. Il leur fâche d'avoir admiré sérieusement des ouvrages que mes satires exposent à la risée de tout le monde, et de se voir condamnés à oublier dans leur vieillesse ces mêmes vers qu'ils ont autrefois appris par cœur comme des chefs-d'œuvre de l'art. Je les plains sans doute; mais quel remède? Faudra- t-il, pour s'accommoder à leur goût particulier, renoncer au sens commun ? Faudra-t-il applaudir indifféremment à toutes les impertinences qu'un ridicule aura répandues sur le papier? Et au lieu qu'en certains pays on condamnoit les méchants poètes à effacer leurs écrits avec la langue, les livres deviendront-ils désormais un asile inviolable où toutes les sottises auront droit de bourgeoisie, où l'on n'osera toucher sans profanation?.."

1669- 1677, seconde période de la carrière poétique de Boileau, le satirique s'apaise et devient plus philosophe, c'est le temps des Epîtres qui commence...
Sur le mode de la conversation familière, voire de la confidence, les Epîtres de Boileau, modèle horacien, pour évoquer ses soucis d'écrivain, goût pour les plaisirs des champs (VI, XI), mais aussi actualité historique (I, IV), sujets moraux (II, III, V, XII), sujets littéraires (VII, IX). La première publication groupée est réalisée en 1683, les neuf premières structurées par les celles qui sont adressées au roi. Et dans ses Epîtres au roi, écrite peu de temps après le traité d'Aix-la-Chapelle, l'auteur conseille à Louis XIV de chercher désormais sa gloire dans la paix, en fait pièce de circonstance et prétexte à une rencontre qui eut lieu en 1669; d'Epître IV, qui traite du célèbre le passage du Rhin (guerre de Hollande, 12 juin 1672 ), Boileau s'essaie au genre héroïque. Le message est clair : l'ordre du monde repose moins sur un maître de la guerre que sur des maîtres de la paix, et qu'au fond les véritables maîtres sont ceux du beau, qu'il soit poète ou jardinier..
Un Boileau qui, certes, dans son Epître VIII, se révèle moins à son aise dans la louange que dans la satire. Pourtant ces treize petites compositions furent pour beaucoup jugées supérieures aux Satires, non tant pour la sensibilité qui pouvait émaner de ses textes, ce qui n'était guère son fort, que pour mais pour la vivacité et la précision de son esprit, "chefs-d'œuvre de raison autant que de poésie", dira Voltaire...
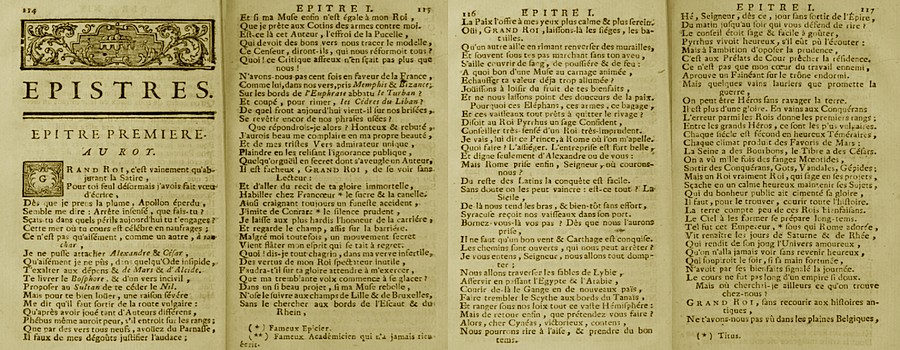
Epître I, Au Roi (1668)
Composée après le traité d'Aix-la-Chapelle en 1668, à la demande de Colbert, pour détourner le roi de la guerre. Cette épître a été présentée à Louis XIV par Mme de Thianges, sœur de Mme de Montespan....
"Grand roi, c'est vainement qu'abjurant la satire
Pour toi seul désormais j'avois fait vœu d'écrire.
Dès que je prends la plume , Apollon éperdu
Semble me dire : Arrête , insensé ; que fais-tu ?
Sais-tu dans quels périls aujourd'hui tu t'engages?
Cette mer où tu cours est célèbre en naufrages.
Je ne pusse attacher «Alexandre» et «César;»
Qu'aisément je ne pusse, en quelque ode insipide,
T'exalter aux dépens et de «Mars» et «d'Alcide ,»
Te livrer le «Bosphore,» et, d'un vers incivil,
Proposer au « sultan» de te céder le Nil;
Mais, pour te bien louer, une raison sévère
Me dit qu'il faut sortir de la route vulgaire ;
Qu'après avoir joué tant d'auteurs différents,
Phébus même auroit peur s'il entroit sur les rangs ;
Que par des vers tout neufs , avoués du Parnasse ,
Il faut de mes dégoûts justifier l'audace;
Et, si ma muse enfin n'est égale à mon roi,
Que je prête aux Cotins des armes contre moi.
Est-ce là cet auteur, l'effroi de la Pucelle,
Qui devoit des bous vers nous tracer le modèle,
Ce censeur, diront-ils, qui nous réformoit tous?
Quoi! ce critique affreux n'en sait pas plus que nous! ..."
Boileau lut à Louis XIV les quarante derniers vers de cette épître la première fois qu'il lui fut présenté : «Voilà qui est très-beau, dit le prince, cela est admirable. Je vous louerois davantage si vous ne m'aviez pas tant loué. Le public donnera à vos ouvrages les éloges qu'ils méritent; mais ce n'est pas assez pour moi de vous louer. Je vous donne une pension de deux mille livres; j'ordonnerai à Colbert de vous la payer d'avance, et je vous accorde le privilège pour l'impression de tous vos ouvrages. »
Ceci n'empêche pas Boileau de sembler faire un grand effort pour louer le roi et lui faire grâce de ne pas le déchirer, voir son fameux 186e vers particulièrement insolent, "On dira quelque jour..."..
"... Pour moi qui, sur ton nom déjà brûlant d'écrire,
Sens au bout de ma plume expirer la satire,
Je n'ose de mes vers vanter ici le prix.
Toutefois, si quelqu'un de mes foibles écrits
Des ans injurieux peut éviter l'outrage,
Peut-être pour ta gloire aura-t-il son usage;
Et comme tes exploits, étonnant les lecteurs,
Seront à peine crus sur la foi des auteurs,
Si quelque esprit malin les veut traiter de fables ,
On dira quelque jour , pour les rendre croyables :
Boileau, qui , dans ses vers pleins de sincérité ,
Jadis à tout son siècle a dit la vérité ,
Qui mit à tout blâmer son étude et sa gloire ,
A pourtant de ce roi parlé comme l'histoire."
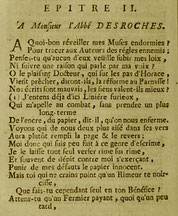
Épître II, à M. l'abbé des Roches (1669)
Composée en 1669, pour y intercaler l'apologue de l'huître, s'élève contre la justice, publiée en 1672, et que Boileau avait retiré de l'Epître I ainsi qu'il nous l'explique dans l'Avertissement, "J'ai néanmoins balancé longtemps si je l'ôterois, parce qu'il y en avoit plusieurs qui la louoient avec autant d'excès que les autres la blâmoient ; mais enfin je me suis rendu à l'autorité d'un prince non moins considérable par les lumières de son esprit que par le nombre de ses victoires. Comme il m'a déclaré franchement que cette fable , quoique très bien contée, ne lui sembloit pas digne du reste de l'ouvrage, je n'ai point résisté ; j'ai mis une autre fin à ma pièce, et je n'ai pas cru , pour une vingtaine de vers, devoir me brouiller avec le premier capitaine de notre siècle."
"...Toutefois, si jamais quelque ardeur bilieuse
Allumoit dans ton cœur l'humeur litigieuse.
Consulte-moi d'abord, et, pour la réprimer.
Retiens bien la leçon que je te vais rimer.
Un jour, dit un auteur, n'importe en quel chapitre,*
Deux voyageurs à jeun rencontrèrent une huître.
Tous deux la contestoient, lorsque dans leur chemin
La Justice passa, la balance à la main.
Devant elle à grand bruit ils expliquent la chose.
Tous deux avec dépens veulent gagner leur cause.
La Justice, pesant ce droit litigieux.
Demande l'huître, l'ouvre, et l'avale à leurs yeux.
Et par ce bel arrêt terminant la bataille :
Tenez, voilà, dit-elle, à chacun une écaille.
Des sottises d' autrui nous vivons au palais :
Messieurs, l'huître étoit bonne. Adieu. Vivez en paix."

Epître III (1669), "A M. Arnauld", porte sur la fausse honte liée au jugement d'autrui, à partir d'une analyse des raisons pour lesquelles le janséniste n'a pas réussi à convaincre le pasteur Claude...
"Oui, sans peine, au travers des sophismes de Claude,
Arnauld , des novateurs tu découvres la fraude ,
Et romps de leurs erreurs les filets captieux,
Mais que sert que ta main leur dessille les yeux
Si toujours dans leur âme une pudeur rebelle ,
Prêt d'embrasser l'Église, au prêche les rappelle?
Non, ne crois pas que Claude, habile à se tromper,
Soit insensible aux traits dont tu le sais frapper;
Mais un démon l'arrête, et, quand ta voix l'attire.
Lui dit : Si tu te rends , sais-tu ce qu'on va dire ?
Dans son heureux retour lui montre un faux malheur,
Lui peint de Charenton l'hérétique douleur;
Et, balançant Dieu même en son âme flottante,
Fait mourir dans son cœur la vérité naissante.
Des superbes mortels le plus affreux lien,
N'en doutons point, Arnauld, c'est la honte du bien.
Des plus nobles vertus cette adroite ennemie
Peint l'honneur à nos yeux des traits de l'infamie ..."

Epître IV (1672), "Au Roi", après quelques lignes en prose d'avis au lecteur, une relation élogieuse du passage du Rhin par les troupes de Louis XIV, mais le burlesque est présent et les conquêtes bien rapides..
"Je ne sais si les rangs de ceux qui passèrent le Rhin à la nage devant Tholus sont fort exactement gardés dans le poëme que je donne au public ; et je n'en voudrois pas être garant, parce que franchement je n'y étois pas, et que je n'en suis encore que fort médiocrement instruit. Je viens même d'apprendre en ce moment que M. de Soubise, dont je ne parle point, est un de ceux qui s'y est le plus signalé. Je m'imagine qu'il en est ainsi de beaucoup d'autres, et j'espère de leur faire justice dans une autre édition. Tout ce que je sais, c'est que ceux dont je fais mention ont passé des premiers. Je ne me déclare donc caution que de l'histoire du fleuve en colère, que j'ai apprise d'une de ses naïades, qui s'est réfugiée dans la Seine..."

Epître V (1674), "A M. de Guilleragues, secrétaire du cabinet du roi",
une épître qui annonce l'intention de Boileau d'abandonner la satire et fait l'éloge de la sagesse et de la médiocrité qui conviennent à son âge et à la fonction poétique, se connaître soi-même est d'importance, n'est-il pas ...
Esprit né pour la cour et maître en l’art de plaire,
Guilleragues, qui sais et parler et te taire,
Apprends-moi si je dois ou me taire ou parler,
Faut-il dans la satire encor me signaler,
Et, dans ce champ fécond en plaisantes malices,
Faire encore aux auteurs redouter mes caprices ?
Jadis, non sans tumulte, on m’y vit éclater,
Quand mon esprit plus jeune, et prompt à s’irriter,
Aspiroit moins au nom de discret et de sage ;
Que mes cheveux plus noirs ombrageoient mon visage.
Maintenant, que le temps a mûri mes désirs,
Que mon âge, amoureux de plus sages plaisirs,
Bientôt s’en va frapper à son neuvième lustre,
J’aime mieux mon repos qu’un embarras illustre.
Que d’une égale ardeur mille auteurs animés,
Aiguisent contre moi leurs traits envenimés ;
Que tout, jusqu’à Pinchêne, et m’insulte et m’accable,
Aujourd’hui vieux lion je suis doux et traitable ;
Je n’arme point contre eux mes ongles émoussés.
Ainsi que mes beaux jours mes chagrins sont passés :
Je ne sens plus l’aigreur de ma bile première,
Et laisse aux froids rimeurs une libre carrière.
Ainsi donc, philosophe à la raison soumis,
Mes défauts désormais sont mes seuls ennemis :
C’est l’erreur que je fuis, c’est la vertu que j’aime.
Je songe à me connoître, et me cherche en moi-même,
C’est là l’unique étude où je veux m’attacher.
Que, l’astrolabe en main, un autre aille chercher
Si le soleil est fixe ou tourne sur son axe,
Si Saturne à nos yeux peut faire un parallaxe ;
Que Rohaut vainement sèche pour concevoir
Comment, tout étant plein, tout a pu se mouvoir ;
Ou que Bernier compose et le sec et l’humide
Des corps ronds et crochus errant parmi le vide :
Pour moi, sur cette mer qu’ici-bas nous courons,
Je songe à me pourvoir d’esquif et d’avirons,
À régler mes désirs, à prévenir l’orage,
Et sauver, s’il se peut, ma raison du naufrage.
C’est au repos d’esprit que nous aspirons tous ;
Mais ce repos heureux se doit chercher en nous.
Un fou, rempli d’erreurs, que le trouble accompagne,
Et malade à la ville ainsi qu’à la campagne,
En vain monte à cheval pour tromper son ennui ;
Le chagrin monte en croupe, et galope avec lui.
Que crois-tu qu’Alexandre, en ravageant la terre,
Cherche parmi l’horreur, le tumulte et la guerre ?
Possédé d’un ennui qu’il ne saurait dompter,
Il craint d’être à soi-même, et songe à s’éviter.
C’est là ce qui l’emporte aux lieux où naît l’Aurore,
Où le Perse est brûlé de l’astre qu’il adore.
De nos propres malheurs auteurs infortunés,
Nous sommes loin de nous à toute heure entraînés.
À quoi bon ravir l’or au sein du nouveau monde ?
Le bonheur tant cherché sur la terre et sur l’onde
Est ici comme aux lieux où mûrit le coco.
Et se trouve à Paris de même qu’à Cusco :
On ne le tire point des veines du Potose.
Qui vit content de rien possède toute chose.
Mais, sans cesse ignorans de nos propres besoins,
Nous demandons au ciel ce qu’il nous faut le moins.
« Oh ! que si cet hiver un rhume salutaire,
Guérissant de tous maux mon avare beau-père,
Pouvoit, bien confessé, l’étendre en un cercueil,
Et remplir sa maison d’un agréable deuil !
Que mon âme, en ce jour de joie et d’opulence,
D’un superbe convoi plaindroit peu la dépense ! »
Disoit le mois passé, doux, honnête et soumis,
L’héritier affamé de ce riche commis
Qui, pour lui préparer cette douce journée,
Tourmenta quarante ans sa vie infortunée.
La mort vient de saisir le vieillard catarrheux :
Voilà son gendre riche ; en est-il plus heureux ?
Tout fier du faux éclat de sa vaine richesse,
Déjà nouveau seigneur il vante sa noblesse.
Quoique fils de meunier, encor blanc du moulin,
Il est prêt à fournir ses titres en vélin.
En mille vains projets à toute heure il s’égare.
Le voilà fou, superbe, impertinent, bizarre,
Rêveur, sombre, inquiet, à soi-même ennuyeux.
Il vivroit plus content, si, comme ses aïeux,
Dans un habit conforme à sa vraie origine,
Sur le mulet encore il chargeoit la farine.
Mais ce discours n’est pas pour le peuple ignorant,
Que le faste éblouit d’un bonheur apparent.
L’argent, l’argent, dit-on ; sans lui tout est stérile :
La vertu sans l’argent n’est qu’un meuble inutile.
L’argent en honnête homme érige un scélérat ;
L’argent seul au palais peut faire un magistrat
Qu’importe qu’en tous lieux on me traite d’infâme ?
Dit ce fourbe sans foi, sans honneur et sans âme ;
Dans mon coffre tout plein de rares qualités,
J’ai cent mille vertus en louis bien comptés.
Est-il quelque talent que l’argent ne me donne ?
C’est ainsi qu’en son cœur ce financier raisonne.
Mais pour moi, que l’éclat ne sauroit décevoir,
Qui mets au rang des biens l’esprit et le savoir,
J’estime autant Patru, même dans l’indigence,
Qu’un commis engraissé des malheurs de la France.
Non que je sois du goût de ce sage insensé
Qui, d’un argent commode esclave embarrassé,
Jeta tout dans la mer pour crier : « Je suis libre. »
De la droite raison je sens mieux l’équilibre ;
Mais je tiens qu’ici-bas, sans faire tant d’apprêts,
La vertu se contente et vit à peu de frais.
Pourquoi donc s’égarer en des projets si vagues ?
Ce que j’avance ici, crois-moi, cher Guilleragues,
Ton ami dès l’enfance ainsi l’a pratiqué.
Mon père, soixante ans au travail appliqué,
En mourant me laissa, pour rouler et pour vivre,
Un revenu léger, et son exemple à suivre.
Mais bientôt amoureux d’un plus noble métier,
Fils, frère, oncle, cousin, beau-frère de greffier,
Pouvant charger mon bras d’une utile liasse,
J’allai loin du palais errer sur le Parnasse.
La famille en pâlit, et vit en frémissant
Dans la poudre du greffe un poëte naissant :
On vit avec horreur une muse effrénée
Dormir chez un greffier la grasse matinée.
Dès lors à la richesse il fallut renoncer :
Ne pouvant l’acquérir, j’appris à m’en passer ;
Et surtout redoutant la basse servitude,
La libre vérité fut toute mon étude.
Dans ce métier funeste à qui veut s’enrichir,
Qui l’eût cru que pour moi le sort dût se fléchir ?
Mais du plus grand des rois la bonté sans limite,
Toujours prête à courir au-devant du mérite,
Crut voir dans ma franchise un mérite inconnu,
Et d’abord de ses dons enfla mon revenu.
La brigue ni l’envie à mon bonheur contraires,
Ni les cris douloureux de mes vains adversaires,
Ne purent dans leur course arrêter ses bienfaits
C’en est trop ; mon bonheur a passé mes souhaits.
Qu’à son gré désormais la fortune me joue ;
On me verra dormir au branle de sa roue.
Si quelque soin encore agite mon repos,
C’est l’ardeur de louer un si fameux héros.
Ce soin ambitieux me tirant par l’oreille,
La nuit, lorsque je dors, en sursaut me réveille ;
Me dit que ses bienfaits, dont j’ose me vanter,
Par des vers immortels ont dû se mériter.
C’est là le seul chagrin qui trouble encor mon âme.
Mais si, dans le beau feu du zèle qui m’enflamme,
Par un ouvrage enfin des critiques vainqueur
Je puis sur ce sujet satisfaire mon cœur,
Guilleragues, plains-toi de mon humeur légère,
Si jamais, entraîné d’une ardeur étrangère,
Ou d’un vil intérèt reconnoissant la loi,
Je cherche mon bonheur autre part que chez moi.

L'Epître VI (1677), s'adresse à l'avocat général De Lamoignon, fils du premier président du Parlement de Paris et lui chante le site de Haute-Isle, sur les bords de la Seine, près de La Roche-Guyon, évocation des charmes de la Nature, comparé à la ville, sujet peu abordé en ce XVIIe siècle...
"Oui, Lamoignon, je fuis les chagrins de la ville.
Et contre eux la campagne est mon unique asile.
Du lieu qui m'y retient veux-tu voir le tableau?
C'est un petit village, ou plutôt un hameau,
Bâti sur le penchant d'un long rang de collines,
D'où l'œil s'égare au loin dans les plaines voisines.
La Seine, au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt îles s'élever,
Qui, partageant son cours en diverses manières,
D'une rivière seule y forment vingt rivières.
Tous ses bords sont couverts de saules non plantés,
Et de noyers, souvent du passant insultés.
Le village, au-dessus, forme un amphithéâtre :
L'habitant ne connaît ni la chaux ni le plâtre,
Et dans le roc, qui cède et se coupe aisément,
Chacun sait de sa main creuser son logement.
La maison du seigneur, seule, un peu plus ornée,
Se présente au dehors, de murs environnée;
Le soleil en naissant la regarde d'abord,
Et le mont la défend des outrages du Nord;
C'est là, cher Lamoignon, que mon esprit tranquille
Met à profit les jours que la Parque me file :
Ici, dans un vallon bornant tous mes désirs,
J'achète à peu de frais de solides plaisirs.
Tantôt, un livre en main, errant dans les prairies,
J'occupe ma raison d'utiles rêveries.
Tantôt, cherchant la fin d'un vers que je construi,
Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui.
Quelquefois, aux appâts d'un hameçon perfide,
J'amorce en badinant le poisson trop avide;
Ou, d'un plomb qui suit l'œil, et part avec l'éclair,
Je vais faire, la guerre aux habitants de l'air.
Une table, au retour, propre et non magnifique,
Nous présente un repas agréable et rustique :
Là, sans s'assujettir aux dogmes de Broussain,
Tout ce qu'on boit est bon, tout ce qu'on mange est sain;
La maison le fournit, la fermière l'ordonne ;
Et, mieux que Bergerat, l'appétit l'assaisonne.
O fortuné séjour! ô champs aimés des cieux!,
Que pour jamais, foulant vos prés délicieux,
Ne puis-je ici fixer ma course vagabonde,
Et, connu de vous seuls, oublier tout le monde!

A Racine - L'Epître VII, littéraire, composée en 1677,
un texte est destiné à réconforter Racine abattu par l'échec de Phèdre, associant son combat à celui de Molière, mort depuis quatre ans, et à Corneille, bien oublié à cette date..
"Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur,
Emouvoir, étonner, ravir un spectateur!
Jamais Iphigénie en Aulide immolée
N'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée,
Que, dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé,
En a fait sous son nom verser la Champmeslé.
Ne crois pas toutefois, par tes savants ouvrages,
Entraînant tous les cœurs, gagner tous les suffrages
Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s'amassent
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent ;
Et son trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.
La mort seule ici-bas, en terminant sa vie,
Peut calmer sur son nom l'injustice et l'envie,
Faire au poids du bon sens peser tous ses écrits,
Et donner à ses vers leur légitime prix.
Avant qu'un peu de terre, obtenu par prière,
Pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière,
Mille de ces beaux traits, aujourd'hui si vantés,
Furent des sots esprits à nos yeux rebutés.
L'ignorance et l'erreur, à ses naissantes pièces,
En habits de marquis, en robes de comtesses,
Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau,
Et secouaient la tête à l'endroit le plus beau.
Le commandeur voulait la scène plus exacte;
Le vicomte, indigné, sortait au second acte;
L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu,
Pour prix de ses bons mots le condamnait au feu;
L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre,
Voulait venger la cour immolée au parterre.
Mais, sitôt que d'un trait de ses fatales mains
La Parque l'eut rayé du nombre des humains,
On reconnut le prix de sa Muse éclipsée.
L'aimable Comédie, avec lui terrassée,
En vain d'un coup si rude espéra revenir,
Et sur ses brodequins ne put plus se tenir.
Tel fut chez nous le sort du théâtre comique.
Toi donc qui, t'élevant sur la scène tragique,
Suis les pas de Sophocle, et, seul de tant d'esprits,
De Corneille vieilli sais consoler Paris,
Cesse de t'étonner, si l'envie animée,
Attachant à ton nom sa rouille envenimée,
La calomnie en main, quelquefois te poursuit.
En cela, comme en tout, le Ciel qui nous conduit,
Racine, fait briller sa profonde sagesse.
Le mérite en repos s'endort dans la paresse;
Mais, par les envieux un génie excité,
Au comble de son art est mille fois monté;
Plus on veut l'affaiblir, plus il croît et s'élance;
Au Cid persécuté Cinna doit sa naissance;
Et, peut-être, ta plume aux censeurs de Pyrrhus
Doit les plus nobles traits dont tu peignis Burrhus."

Epître VIII (composée en 1675, publiée en 1677), Au Roi,
Boileau menace de ne plus écrire si le rythme des conquêtes de son maître reste inchangé, le poète devait alors remercier le roi de la pension qu'il lui avait donnée. Mais la fin de l'année 1675 avait été marquée par des revers, Turenne était mort emporté par un coup de canon et les troupes avaient été obligées de repasser le Rhin et de revenir en Alsace. Le maréchal de Créqui avait perdu la bataille de la Taverne s'était réfugié dans la ville de Trêves, et cette ville ayant capitulé malgré lui, il avait été fait prisonnier. Ces échecs auraient rendu ridicule le premier vers de cette épître et donc Boileau en retarda la publication; la campagne suivante, marquée par de brillants succès, lui permit de renoncer au changement qu'il avait imaginé...
"Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire.
Tu sais bien que mon style est né pour la satire;
Mais mon esprit, contraint de la désavouer.
Sous ton règne étonnant ne veut plus que louer.
Tantôt, dans les ardeurs de ce zèle incommode,
Je songe à mesurer les syllabes d'une ode ;
Tantôt d'une Enéide auteur ambitieux,
Je m'en forme déjà le plan audacieux :
Ainsi, toujours flatté d'une douce manie,
Je sens de jour en jour dépérir mon génie ;
Et mes vers en ce style , ennuyeux , sans appas ,
Déshonorent ma plume, et ne t'honorent pas.
Encor si ta valeur, à tout vaincre obstinée,
Nous laissoit, pour le moins, respirer une année,
Peut-être mon esprit , prompt à ressusciter ,
Du temps qu'il a perdu sauroit se racquitter.
Sur ses nombreux défauts, merveilleux à décrire.
Le siècle m'offre encor plus d'un bon mot à dire.
Mais à peine Dinant et Limbourg sont forcés ,
Qu'il faut chanter Bouchain et Condé terrassés.
Ton courage, affamé de péril et de gloire,
Court d'exploits en exploits, de victoire en victoire.
Souvent ce qu'un seul jour te voit exécuter
Nous laisse pour un an d'actions à compter..."

Epître IX (1675), "Rien n'est plus beau que le vrai", Au marquis de Seignelay, secrétaire d'Etat,
Boileau reprend le principe majeur de l'Art poétique et souligne fortement le lien entre sa morale et son esthétique. De la critique des flatteries mensongères, il passe â l'éloge de la sincérité dans la vie et de la vérité dans l'art, qui se confondent à ses yeux: "Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable, Il doit régner partout, et même dans la fable : De toute fiction l'adroite fausseté, Ne tend qu'å faire aux yeux briller la vérité."
Dangereux ennemi de tout mauvais flatteur,
Seignelay, c’est en vain qu’un ridicule auteur,
Prêt à porter ton nom de l’Ebre jusqu’au Gange,
Croit te prendre aux filets d’une sotte louange.
Aussitôt ton esprit, prompt à se révolter,
S’échappe, et rompt le piège où l’on veut l’arrêter.
Il n’en est pas ainsi de ces esprits frivoles
Que tout flatteur endort au son de ses paroles ;
Qui, dans un vain sonnet, placés au rang des dieux,
Se plaisent à fouler l’Olympe radieux ;
Et, fiers du haut étage où La Serre les loge,
Avalent sans dégoût le plus grossier éloge.
Tu ne te repais point d’encens à si bas prix.
Non que tu sois pourtant de ces rudes esprits
Qui regimbent toujours, quelque main qui les flatte :
Tu souffres la louange adroite et délicate,
Dont la trop forte odeur n’ébranle point les sens ;
Mais un auteur novice à répandre l’encens
Souvent à son héros, dans un bizarre ouvrage,
Donne de l’encensoir au travers du visage,
Va louer Monterey d’Oudenarde forcé,
Ou vante aux Électeurs Turenne repoussé.
Tout éloge imposteur blesse une âme sincère.
Si, pour faire sa cour à ton illustre père,
Seignelay, quelque auteur, d’un faux zèle emporté,
Au lieu de peindre en lui la noble activité,
La solide vertu, la vaste intelligence,
Le zèle pour son roi, l’ardeur, la vigilance,
La constante équité, l’amour pour les beaux-arts,
Lui donnoit les vertus d’Alexandre ou de Mars ;
Et, pouvant justement l’égaler à Mécène,
Le comparoit au fils de Pelée ou d’Alemène:
Ses yeux, d’un tel discours foiblement éblouis,
Bientôt dans ce tableau reconnoîtroient Louis ;
Et, glaçant d’un regard la muse et le poëte,
Imposeroient silence à sa verve indiscrète.
Un cœur noble est content de ce qu’il trouve en lui,
Et ne s’applaudit point des qualités d’autrui.
Que me sert en effet qu’un admirateur fade
Vante mon embonpoint, si je me sens malade ;
Si dans cet instant même un feu séditieux
Fait bouillonner mon sang et pétiller mes yeux ?
Rien n’est beau que le vrai : le vrai seul est aimable ;
Il doit régner partout, et même dans la fable.
De toute fiction l’adroite fausseté
Ne tend qu’à faire aux yeux briller la vérité.
Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces,
Sont recherchés du peuple, et reçus chez les princes ?
Ce n’est pas que leurs sons, agréables, nombreux,
Soient toujours à l’oreille également heureux ;
Qu’en plus d’un lieu le sens n’y gêne la mesure,
Et qu’un mot quelquefois n’y brave la césure :
Mais c’est qu’en eux le vrai, du mensonge vainqueur,
Partout se montre aux yeux, et va saisir le cœur ;
Que le bien et le mal y sont prisés au juste ;
Que jamais un faquin n’y tint un rang auguste ;
Et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit,
Ne dit rien aux lecteurs, qu’à soi-même il n’ait dit.
Ma pensée au grand jour partout s’offre et s’expose,
Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.
C’est par là quelquefois que ma rime surprend ;
C’est là ce que n’ont point Jonas ni Childebrand
Ni tous ces vains amas de frivoles sornettes,
Montre, Miroir d’amour, Amitiés ; Amourettes,
Dont le titre souvent est l’unique soutien,
Et qui, parlant beaucoup ne disent jamais rien.
Mais peut-être, enivré des vapeurs de ma muse,
Moi-même en ma faveur, Seignelay, je m’abuse.
Cessons de nous flatter. Il n’est esprit si droit
Qui ne soit imposteur et faux par quelque endroit :
Sans cesse on prend le masque, et, quittant la nature,
On craint de se montrer sous sa propre figure.
Par là le plus sincère assez souvent déplaît.
Rarement un esprit ose être ce qu’il est.
Vois-tu cet importun que tout le monde évite ;
Cet homme à toujours fuir, qui jamais ne vous quitte ?
Il n’est pas sans esprit ; mais, né triste et pesant,
Il veut être folâtre, évaporé, plaisant ;
Il s’est fait de sa joie une loi nécessaire,
Et ne déplaît enfin que pour vouloir trop plaire.
La simplicité plaît sans étude et sans art.
Tout charme en un enfant dont la langue sans fard,
À peine du filet encor débarrassée,
Sait d’un air innocent bégayer sa pensée.
Le faux est toujours fade, ennuyeux, languissant ;
Mais la nature est vraie, et d’abord on la sent :
C’est elle seule en tout qu’on admire et qu’on aime.
Un esprit né chagrin plaît par son chagrin même.
Chacun pris dans son air est agréable en soi :
Ce n’est que l’air d’autrui qui peut déplaire en moi.

Epître X (1695), "A mes vers",
une réponse aux critiques qui avaient accueilli la Satire X, l'Ode sur la prise de Namur et les Réflexions sur Longin, et tout en espérant sa retraite tresse ses louanges de poète. Après avoir écrit ses neuf premières Epîtres, Boileau en ajoute trois autres, non seulement pour se défendre vis-à-vis de ses censeurs mais prendre une certaine hauteur avec ce monde tout en se présentant, dit-il comme "le Poète orgueilleux & le Villageois grossier & le Théologien téméraire" : "quelques fortes portant que soient leurs attaques, je doute qu'elles ébranlent la ferme résolution que j'ai prise il y a longtemps de ne rien répondre, au moins sur le ton sérieux, à tous ceux qu'ils écriront contre moi..." (préface sur les trois épîtres suivantes).
J’ai beau vous arrêter, ma remontrance est vaine,
Allez, partez, mes vers, dernier fruit de ma veine.
C’est trop languir chez moi dans un obscur séjour :
La prison vous déplaît, vous cherchez le grand jour ;
Et déjà chez Barbin, ambitieux libelles,
Vous brûlez d’étaler vos feuilles criminelles.
Vains et foibles enfans dans ma vieillesse nés,
Vous croyez sur les pas de vos heureux aînés
Voir bientôt vos bons mots, passant du peuple aux princes,
Charmer également la ville et les provinces ;
Et, par le prompt effet d’un sel réjouissant,
Devenir quelquefois proverbes en naissant.
Mais perdez cette erreur dont l’appât vous amorce.
Le temps n’est plus, mes vers, où ma muse en sa force,
Du Parnasse françois formant les nourrissons,
De si riches couleurs habilloit ses leçons ;
Quand mon esprit, poussé d’un courroux légitime,
Vint devant la raison plaider contre la rime ;
À tout le genre humain sut faire le procès,
Et s’attaqua soi-même avec tant de succès.
Alors il n’étoit point de lecteur si sauvage
Qui ne se déridât en lisant mon ouvrage,
Et qui, pour s’égayer, souvent dans ses discours,
D’un mot pris en mes vers n’empruntât le secours.
Mais aujourd’hui qu’enfin la vieillesse venue,
Sur mes faux cheveux blancs déjà toute chenue,
A jeté sur ma tête, avec ses doigts pesans,
Onze lustres complets, surchargés de trois ans,
Cessez de présumer dans vos folles pensées,
Mes vers, de voir en foule à vos rimes glacées
Courir, l’argent en main, les lecteurs empressés ;
Nos beaux jours sont finis, nos honneurs sont passés :
Dans peu vous allez voir vos froides rêveries
Du public exciter les justes moqueries ;
Et leur auteur, jadis à Régnier préféré,
A Pinchêne, à Linière, à Perrin comparé.
Vous aurez beau crier : « Ô vieillesse ennemie !
« N’a-t-il donc tant vécu que pour cette infamie ? »
Vous n’entendrez partout qu’injurieux brocards
Et sur vous et sur lui fondre de toutes parts.
« Que veut-il ? dira-t-on ; quelle fougue indiscrète
Ramène sur les rangs encor ce vain athlète ?
Quels pitoyables vers ! quel style languissant !
Malheureux, laisse en paix ton cheval vieillissant,
De peur que tout à coup, efflanqué, sans haleine,
Il ne laisse en tombant son maître sur l’arène. »
Ainsi s’expliqueront nos censeurs sourcilleux,
Et bientôt vous verrez mille auteurs pointilleux,
Pièce à pièce épluchant vos sons et vos paroles.
Interdire chez vous l’entrée aux hyperboles ;
Traiter tout noble mot de terme hasardeux,
Et dans tous vos discours, comme monstres hideux,
Huer la métaphore et la métonymie,
Grands mots que Pradon croit des termes de chimie
Vous soutenir qu’un lit ne peut être effronté,
Que nommer la luxure est une impureté.
En vain contre ce flot d’aversion publique
Vous tiendrez quelque temps ferme sur la boutique ;
Vous irez à la fin, honteusement exclus,
Trouver au magasin Pyrame et Régulus,
Ou couvrir chez Thierry, d’une feuille encor neuve,
Les méditations de Buzée et d’Hayneuve ;
Puis, en tristes lambeaux semés dans les marchés,
Souffrir tous les affronts au Jonas reprochés.
Mais quoi ! de ces discours bravant la vaine attaque,
Déjà, comme les vers de Cinna, d'Andromaque,
Vous croyez à grands pas chez la postérité
Courir, marqués au coin de l’immortalité !
Eh bien ! contentez donc l’orgueil qui vous enivre ;
Montrez-vous, j’y consens : mais du moins dans mon livre,
Commencez par vous joindre à mes premiers écrits.
C’est là qu’à la faveur de vos frères chéris,
Peut-être enfin soufferts comme enfans de ma plume,
Vous pourrez vous sauver, épars dans le volume.
Que si mêmes un jour le lecteur gracieux,
Amorcé par mon nom, sur vous tourne les yeux,
Pour m’en récompenser, mes vers, avec usure,
De votre auteur alors faites-lui la peinture :
Et surtout prenez soin d’effacer bien les traits
Dont tant de peintres faux ont flétri mes portraits.
Déposez hardiment qu’au fond cet homme horrible,
Ce censeur qu’ils ont peint si noir et si terrible,
Fut un esprit doux, simple, ami de l’équité,
Qui, cherchant dans ses vers la seule vérité,
Fit sans être malin ses plus grandes malices,
Et qu’enfin sa candeur seule a fait tous ses vices.
Dites que, harcelé par les plus vils rimeurs,
Jamais, blessant leurs vers, il n’effleura leurs moeurs :
Libre dans ses discours, mais pourtant toujours sage,
Assez foible de corps, assez doux de visage ;
Ni petit, ni trop grand, très-peu voluptueux,
Ami de la vertu plutôt que vertueux.
Que si quelqu’un, mes vers, alors vous importune
Pour savoir mes parens, ma vie et ma fortune,
Contez-lui qu’allié d’assez hauts magistrats.
Fils d’un père greffier, né d’aïeux avocats,
Dès le berceau perdant une fort jeune mère,
Réduit seize ans après à pleurer mon vieux père,
J’allai d’un pas hardi, par moi-même guidé,
Et de mon seul génie en marchant secondé,
Studieux amateur et de Perse et d’Horace,
Assez près de Régnier m’asseoir sur le Parnasse ;
Que, par un coup du sort au grand jour amené,
Et des bords du Permesse à la cour entraîné,
Je sus, prenant l’essor par des routes nouvelles,
Élever assez haut mes poétiques ailes ;
Que ce roi dont le nom fait trembler tant de rois
Voulut bien que ma main crayonnât ses exploits ;
Que plus d’un grand m’aima jusques à la tendresse ;
Que ma vue à Colbert inspirait l’allégresse ;
Qu’aujourd’hui même encor, de deux sens affoibli,
Retiré de la cour, et non mis en oubli,
Plus d’un héros, épris des fruits de mon étude,
Vient quelquefois chez moi goûter la solitude.
Mais des heureux regards de mon astre étonnant
Marquez bien cet effet encor plus surprenant,
Qui dans mon souvenir aura toujours sa place :
Que de tant d’écrivains de l’école d’Ignace
Étant, comme je suis, ami si déclaré,
Ce docteur toutefois si craint, si révéré,
Qui contre eux de sa plume épuisa l’énergie,
Arnauld, le grand Amauld, fit mon apologie.
Sur mon tombeau futur, mes vers, pour l’énoncer,
Courez en lettres d’or de ce pas vous placer :
Allez, jusqu’où l’Aurore en naissant voit l’Hydaspe,
Chercher, pour l’y graver, le plus précieux jaspe :
Surtout à mes rivaux sachez bien l’étaler.
Mais je vous retiens trop. C’est assez vous parler.
Déjà, plein du beau feu qui pour vous le transporte,
Barbin impatient chez moi frappe à la porte :
Il vient pour vous chercher. C’est lui : j’entends sa voix.
Adieu, mes vers, adieu, pour la dernière fois.

Epître XI, composée en 1695, s'adresse au jardinier de Boileau, Antoine,
un Boileau qui arpente les allées en se laissant aller à parler tout seul dans son jardin, évoque les difficultés du métier poétique...
"Antoine, de nous deux, tu crois donc, je le voi,
Que le plus occupé dans ce jardin, c'est toi.
Oh! que tu changerais d'avis et de langage,
Si, deux jours seulement, libre du jardinage,
Tout à coup devenu poète et bel esprit,
Tu t'allais engager à polir un écrit
Qui dît, sans s'avilir, les plus petites choses,
Fît, des plus secs chardons, des œillets et des roses,
Et sût, même aux discours de la rusticité,
Donner de l'élégance et de la dignité ;
Un ouvrage en un mot, qui, juste en tous ses termes,
Sût plaire à Daguesseau, sût satisfaire Termes.
Sût, dis-je, contenter, en paraissant au jour,
Ce qu'ont d'esprits plus fins et la ville et la cour!
Bientôt, de ce travail devenu sec et pâle,
Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle,
Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau :
"J'aime mieux mettre encor cent arpents au niveau,
Que d'aller follement, égaré dans les nues,
Me lasser à chercher des visions cornues,
Et, pour lier des mots si mal s'entr'accordants,
Prendre dans ce jardin la lune avec les dents."
Approche donc, et viens ; qu'un paresseux t'apprenne,
Antoine, ce que c'est que fatigue, et que peine.
L'homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,
Est, dans le repos même, au travail condamné.
La fatigue l'y suit. C'est en vain qu'aux poètes
Les neuf trompeuses Sœurs, dans leurs douces retraites,
Promettent du repos sous leurs ombrages frais :
Dans ces tranquilles bois, pour eux plantés exprès,
La cadence aussitôt, la rime, la césure,
La riche expression, la nombreuse mesure,
Sorcières, dont l'amour sait d'abord les charmer,
De fatigues sans fin viennent les consumer.
Sans cesse, poursuivant ces fugitives fées,
On voit sous les lauriers haleter les Orphées,
Leur esprit toutefois se plaît dans son tourment,
Et se fait de sa peine un noble amusement.

Epître XII (1695), "Sur l'Amour de Dieu", à l'abbé Renaudot,
Reprise du thème de la Xe Provinciale, contre ceux qui jugent suffisant le repentir inspiré par la crainte d'un châtiment éternel et dispensent ainsi le pécheur d`aimer Dieu. C'est l'ami d'Arnauld qui triomphe dans la douzième et dernière Epître adressée à l'abbé Renaudot et reprenant, en vers, tout ce que le père lui a conté de l'amour de Dieu...
Docte abbé, tu dis vrai, l’homme, au crime attaché,
En vain, sans aimer Dieu, croit sortir du péché.
Toutefois, n’en déplaise aux transports frénétiques
Du fougueux moine auteur des troubles germaniques,
Des tourmens de l’enfer la salutaire peur
N’est pas toujours l’effet d’une noire vapeur,
Qui, de remords sans fruit agitant le coupable,
Aux yeux de Dieu le rende encor plus haïssable.
Cette utile frayeur, propre à nous pénétrer,
Vient souvent de la grâce en nous prête d’entrer,
Qui veut dans notre cœur se rendre la plus forte,
Et, pour se faire ouvrir, déjà frappe à la porte.
Si le pécheur, poussé de ce saint mouvement,
Reconnoissant son crime, aspire au sacrement,
Souvent Dieu tout à coup d’un vrai zèle l’enflamme ;
Le Saint-Esprit revient habiter dans son âme,
Y convertit enfin les ténèbres en jour,
Et la crainte servile en filial amour.
C’est ainsi que souvent la sagesse suprême
Pour chasser le démon se sert du démon même.
Mais lorsqu’en sa malice un pécheur obstiné,
Des horreurs de l’enfer vainement étonné,
Loin d’aimer, humble fils, son véritable père,
Craint et regarde Dieu comme un tyran sévère,
Au bien qu’il nous promet ne trouve aucun appas,
Et souhaite en son cœur que ce Dieu ne soit pas :
En vain, la peur sur lui remportant la victoire,
Aux pieds d’un prêtre il court décharger sa mémoire ;
Vil esclave toujours sous le joug du péché,
Au démon qu’il redoute il demeure attaché.
L’amour, essentiel à notre pénitence,
Doit être l’heureux fruit de notre repentance.
Non, quoi que l’ignorance enseigne sur ce point,
Dieu ne fait jamais grâce à qui ne l’aime point.
À le chercher la peur nous dispose et nous aide ;
Mais il ne vient jamais, que l’amour ne succède.
Cessez de m’opposer vos discours imposteurs,
Confesseurs insensés, ignorans séducteurs,
Qui, pleins des vains propos que l’erreur vous débite,
Vous figurez qu’en vous un pouvoir sans limite
Justifie à coup sur tout pécheur alarmé,
Et que sans aimer Dieu l’on peut en être aimé.
Quoi donc ! cher Renaudot, un chrétien effroyable,
Qui jamais, servant Dieu, n’eut d’objet que le diable,
Pourra, marchant toujours dans des sentiers maudits,
Par des formalités gagner le paradis !
Et parmi les élus, dans la gloire éternelle.
Pour quelques sacremens reçus sans aucun zèle,
Dieu fera voir aux yeux des saints épouvantés
Son ennemi mortel assis à ses côtés !
Peut-on se figurer de si folles chimères?
On voit pourtant, on voit des docteurs même austères
Qui, les semant partout, s’en vont pieusement
De toute piété saper le fondement ;
Qui, le cœur infecté d’erreurs si criminelles,
Se disent hautement les purs, les vrais fidèles ;
Traitant d’abord d’impie et d’hérétique affreux
Quiconque ose pour Dieu se déclarer contre eux.
De leur audace en vain les vrais chrétiens gémissent :
Prêts à le repousser, les plus hardis mollissent ;
Et, voyant contre Dieu le diable accrédité,
N’osent qu’en bégayant prêcher la vérité.
Mollirons-nous aussi ? Non ; sans peur, sur ta trace,
Docte abbé, de ce pas j’irai leur dire en face :
Ouvrez les yeux enfin, aveugles dangereux.
Oui, je vous le soutiens, il seroit moins affreux
De ne point reconnoître un Dieu maître du monde,
Et qui règle à son gré le ciel, la terre et l’onde,
Qu’en avouant qu’il est, et qu’il sut tout former,
D’oser dire qu’on peut lui plaire sans l’aimer.

1668-1713 - le "Dialogue des héros de roman"
Dans le Dialogue des héros de roman, Boileau nous livre comment lui vint cet esprit satirique qui le singularise tant, et explicite sa critique générale du genre romanesque tel qu'il s'est établi pendant la première moitié du XVIIe siècle.
"Le dialogue a été composé à l'occasion de cette prodigieuse quantité de romans qui parurent vers le milieu du seizième siècle, et dont voici en peu de mots l'origine. Honoré d'Urfé, homme de fort grande qualité dans le Lyonnais, et très enclin à l'amour, voulant faire valoir un grand nombre de vers qu'il avait composés pour ses maîtresses, et rassembler en un corps plusieurs aventures amoureuses qui lui étaient arrivées, s'avisa d'une invention très agréable. Il feignit que dans le Forez, petit pays contigu à la Limagne d'Auvergne, il y avait eu, du temps de nos premiers rois, une troupe de bergers et de bergères qui habitaient sur les bords de la rivière du Lignon, et qui, assez accommodés des biens de la fortune, ne laissaient pas néanmoins, par un simple amusement, et pour leur seul plaisir, de mener paître eux-mêmes leurs troupeaux.
Tous ces bergers et toutes ces bergères étant d'un fort grand loisir, l'amour, comme on le peut penser, et comme il le raconte lui-même, ne tarda guère à les y venir troubler, et produisit quantité d'événements considérables. D'Urfé y fit arriver toutes ses aventures, parmi lesquelles il en mêla beaucoup d'autres, et enchâssa les vers dont j'ai parlé, qui, tout méchants qu'ils étaient, ne laissèrent pas d'être soufferts, et de passer à la faveur de l'art avec lequel il les mit en oeuvre : car il soutint tout cela d'une narration également vive et fleurie , de fictions très ingénieuses, et de caractères aussi finement imaginés qu'agréablement variés et bien suivis. Il composa ainsi un roman qui lui acquit beaucoup de réputation, et qui fut fort estimé, même des gens du goût le plus exquis ; bien que la morale en fût fort vicieuse, ne prêchant que l'amour et la mollesse, et allant quelquefois jusqu'à blesser un peu la pudeur. Il en fit quatre volumes, qu'il intitula Astrée, du nom de la plus belle de ses bergères ; et sur ces entrefaites, étant mort, Baro son ami, et, selon quelques-uns, son domestique, en composa sur ses mémoires un cinquième tome, qui en formait la conclusion, et qui ne fut guère moins bien reçu que les quatre autres volumes.
Le grand succès de ce roman échauffa si bien les beaux esprits d'alors, qu'ils en firent à son imitation quantité de semblables, dont il y en avait même de dix et de douze volumes ; et ce fut quelque temps comme une espèce de débordement sur le Parnasse. On vantait surtout ceux de Gomberville, de la Calprenede, de Desmarets et de Scudery. Mais ces imitateurs, s'efforçant mal-à-propos d'enchérir sur leur original, et prétendant ennoblir ses caractères, tombèrent, à mon avis, dans une très-grande puérilité : car au lieu de prendre, comme lui, pour leurs héros , des bergers occupés du seul soin de gagner le coeur de leurs maîtresses, ils prirent, pour leur donner cette étrange occupation, non-seulement des princes et des rois, mais les plus fameux capitaines de l'antiquité, qu'ils peignirent pleins du même esprit que ces bergers, ayant, à leur exemple, fait comme une espèce de voeu de ne parler jamais et de n'entendre jamais parler que d'amour. De sorte qu'au lieu que d'Urfé dans son Astrée, de bergers très frivoles, avait fait des héros de roman considérables, ces auteurs, au contraire, des héros les plus considérables de l'histoire, firent des bergers très frivoles, et quelquefois même des particuliers encore plus frivoles que ces bergers.
Leurs ouvrages néanmoins ne laissèrent pas de trouver un nombre infini d'admirateurs, et eurent longtemps une fort grande vogue. Mais ceux qui s'attirèrent le plus d'applaudissements, ce furent le Cyrus et la Clélie de Mademoiselle de Scudery, soeur de l'auteur du même nom. Cependant, non seulement elle tomba dans la même puérilité, mais elle la poussa encore à un plus grand excès. Si bien qu'au lieu de représenter, comme elle devait, dans la personne de Cyrus, un roi promis par les prophètes, tel qu'il est exprimé dans la Bible, ou, comme le peint Hérodote, le plus grand conquérant que l'on eût encore vu, ou enfin tel qu'il est figuré dans Xénophon, qui a fait aussi bien qu'elle un roman de la vie de ce prince ; au lieu, dis-je, d'en faire un modèle de toute perfection, elle en composa un Artamène plus fou que tous les Céladons et tous les Sylvandres, qui n'est occupé que du seul soin de sa Mandane, qui ne fait du matin au soir que lamenter, gémir et filer le parfait amour. Elle a encore fait pis dans son autre roman intitulé Clélie, où elle représente tous les héros de la République romaine naissante, les Horatius-Coclès, les Mutius-Scévola, les Clélie, les Lucrèce, les Brutus, encore plus amoureux qu'Artamène, ne s'occupant qu'à tracer des cartes géographiques d'amour, qu'à se proposer les uns aux autres des questions et des énigmes galantes ; en un mot, qu'à faire tout ce qui paraît le plus opposé au caractère et à la gravité héroïque de ces premiers Romains.
Comme j'étais fort jeune dans le temps que tous ces romans, tant ceux de Mademoiselle de Scudery, que ceux de la Calprenede et de tous les autres, faisaient le plus d'éclat, je les lus, ainsi que les lisait tout le monde, avec beaucoup d'admiration ; et je les regardai comme des chefs-d'oeuvres de notre langue. Mais enfin mes années étant accrues, et la raison m'ayant ouvert les yeux, je reconnus la puérilité de ces ouvrages.
Si bien que l'esprit satirique commençant à dominer en moi, je ne me donnai point de repos que je n'eusse fait contre ces romans un dialogue à la manière de Lucien, où j'attaquais non seulement leur peu de solidité, mais leur afféterie précieuse de langage, leurs conversations vagues et frivoles, les portraits avantageux faits à chaque bout de champ de personnes de très médiocre beauté, et quelquefois même laides par excès, et tout ce long verbiage d'amour qui n'a point de fin. Cependant, comme Mademoiselle de Scudery était alors vivante, je me contentai de composer ce dialogue dans ma tête ; et bien loin de le faire imprimer, je gagnai même sur moi de ne point l'écrire, et de ne point le laisser voir sur le papier, ne voulant pas donner ce chagrin à une fille qui, après tout, avait beaucoup de mérite, et qui, s'il en faut croire tous ceux qui l'ont connue, nonobstant la mauvaise morale enseignée dans ses romans, avait encore plus de probité et d'honneur que d'esprit.
Mais aujourd'hui qu'enfin la mort l'a rayée du nombre des humains, elle et tous les autres compositeurs de romans, je crois qu'on ne trouvera pas mauvais que je donne mon dialogue, tel que je l'ai retrouvé dans ma mémoire..."

1671 - "L'Arrêt burlesque"
Dans l'Arrêt burlesque, Boileau prend position, en matière « philosophique » (c'est-à-dire scientifique aussi) pour Descartes contre Aristote. L'origine en est qu'à cette même année, l’Université de Paris espérait obtenir la censure du cartésianisme par le Parlement. La réaction du "Parnasse" ne se fit pas attendre et l'Université renonça à son entreprise.
Le 11 août 1671 paraît en effet, et circule, un opuscule anonyme, douze pages contenant trois textes, un Préface d'Alitophile au lecteur, une "Requeste à nos seigneurs de la cour souveraine de Parnasse", et l'Arrêt burlesque proprement dit, "Arrêt burlesque, donné en la grand'chambre du Parnasse, en faveur des maîtres-es-Arts, médecins et professeurs de L'Université de Stagyre, au pays des Chimères : pour le maintien de la doctrine d'Aristote" (version de 1701). Trois auteurs y ont collaboré, Boileau, Racine et Bernier...
Texte de l'Arrêt Burlesque, écrit par Boileau :
"Vu par la cour la requête présentée par les régents, maîtres es arts, docteurs et professeurs de l'Université, tant en leurs noms que comme tuteurs et défenseurs de la doctrine de maître en blanc, Aristote, ancien professeur royal en grec dans le collège du Lycée, et précepteur du feu roi de querelleuse mémoire, Alexandre dit le Grand, acquéreur de l'Asie, Europe, Afrique et autres lieux; contenant que, depuis quelques années, une inconnue, nommée la Raison, auroit entrepris d'entrer par force dans les écoles de ladite Université, et pour cet effet, à l'aide de certains quidams factieux, prenant les surnoms de Gassendistes, Cartésiens, MaIalebranchistes et Pourchotistes, gens sans aveu, se seroit mise en état d'en expulser ledit Aristote, ancien et paisible possesseur desdites écoles, contre lequel elle et ses consorts auroient déjà publié plusieurs livres, traités, dissertations et raisonnemens diffamatoires, voulant assujettir ledit Aristote à subir devant elle l'examen de sa doctrine, ce qui seroit directement opposé aux lois, us et coutumes de ladite Université, où ledit Aristote auroit toujours été reconnu pour juge sans appel et non comptable de ses opinions.
Que même, sans l'aveu d'icelui, elle auroit changé et innové plusieurs choses en et au dedans de la nature, ayant ôté au cœur la prérogative d'être le principe des nerfs, que ce philosophe lui avoit accordée libéralement et de son bon gré, et laquelle elle auroit cédée et transportée au cerveau. Et ensuite, par une procédure nulle de toute nullité, auroit attribué audit cœur la charge de recevoir le chyle, appartenant ci-devant au foie, comme aussi de faire voiturer le sang par tout le corps, avec plein pouvoir audit sang d'y vaguer, errer et circuler impunément par les veines et artères, n'ayant autre droit ni titre, pour faire lesdites vexations, que la seule expérience, dont le témoignage n'a jamais été reçu dans lesdites écoles. Auroit aussi attenté ladite Raison, par une entreprise inouïe, de déloger le feu de la plus haute région du ciel, et prétendu qu'il n'avoit là aucun domicile, nonobstant les certificats dudit philosophe, et les visites et descentes faites par lui sur les lieux.
Plus, par un attentat et voie de fait énorme contre la Faculté de médecine, se seroit ingérée de guérir, et auroit réellement et de fait guéri quantité de fièvres intermittentes, comme tierces, doubles-tierces, quartes, triples-quartes, et même continues, avec vin pur, poudre, écorce de quinquina et autres drogues inconnues audit Aristote et à Hippocrate son devancier, et ce sans saignée, purgation ni évacuation précédentes; ce qui est non-seulement irrégulier, mais tortionnaire et abusif; ladite Raison n'ayant jamais été admise ni agrégée au corps de ladite Faculté, et ne pouvant par conséquent consulter avec les docteurs d'icelle, ni être consultée par eux, comme elle ne l'a en effet jamais été. Nonobstant quoi, et malgré les plaintes et oppositions réitérées des sieurs Blondel, Courtois, Denyau et autres défenseurs de la bonne doctrine, elle n'auroit pas laissé de se servir toujours desdites drogues, ayant eu la hardiesse de les employer sur les médecins mêmes de ladite Faculté, dont plusieurs, au grand scandale des règles, ont été guéris par lesdits remèdes : ce qui est d'un exemple très-dangereux, et ne peut avoir été fait que par mauvaises voies, sortilèges et pactes avec le diable.
Et non contente de ce, auroit entrepris de diffamer et de bannir des écoles de philosophie les formalités, matérialités, entités, identités, virtualités, eccéités, pétréités, polycar- péités et autres êtres imaginaires, tous enfants et ayants cause de défunt maître Jean Scot, leur père ; ce qui porteroit un préjudice notable et causeroit la totale subversion de la philosophie scolastique, dont elles font tout le mystère, et qui tire d'elles toute sa subsistance, s'il n'y étoit par la cour pourvu.
Vu les libelles intitulés "Physique de Rohault", "Logique de Port-Royal", "Traités du Quinquina", même I'Adversus Aristoteleos de Gassendi, et autres pièces attachées à ladite requête, signée Chicaneau, procureur de ladite Université : Ouï le rapport du conseiller commis, tout considéré :
La COUR, ayant égard à ladite requête, a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Aristote en la pleine et paisible possession et jouissance desdites écoles. Ordonne qu'il sera toujours suivi et enseigné par les régents, docteurs, maîtres es arts et professeurs de ladite Université, sans que pour cela ils soient obligés de le lire, ni de savoir sa langue et ses sentiments. Et sur le fond de sa doctrine, les renvoie à leurs cahiers.
Enjoint au cœur de continuer d'être le principe des nerfs, et à toutes personnes, de quelque condition et profession qu'elles soient, de le croire tel, nonobstant toute expérience à ce contraire. Ordonne pareillement au chyle d'aller droit au foie, sans plus passer par le cœur, et au foie de le recevoir. Fait défenses au sang d'être plus vagabond, errer ni circuler dans le corps, sous peine d'être entièrement livré et abandonné à la Faculté de médecine. Défond à la Raison et à ses adhérens de plus s'ingérer à l'avenir de guérir les fièvres tierces, doubles-tierces, quartes, triples-quartes ni continues, par mauvais moyens et voies de sortilèges, comme vin pur, poudre, écorce de quinquina et autres drogues non approuvées ni connues des anciens.
Et en cas de guérisons irrégulières par icelles drogues, permet aux médecins de ladite Faculté de rendre, suivant leur méthode ordinaire, la fièvre aux malades, avec casse, séné, sirops, juleps et autres remèdes propres à ce, et de remettre lesdits malades en tel et semblable état qu'ils étoient auparavant, pour être ensuite traités selon les règles, et, s'ils n'en réchappent, conduits du moins en l'autre monde suffisamment purgés et évacués. Remet les entités, identités, virtualités, eccéités et autres pareilles formules scotistes, en leur bonne famé et renommée. A donné acte aux sieurs Blondel, Courtois et Denyau de leur opposition au bon sens. A réintégré le feu dans la plus haute région du ciel, suivant et conformément aux descentes faites sur les lieux. Enjoint à tous régents, maîtres es arts et professeurs d'enseigner comme ils ont accoutumé, et de se servir, pour raison de ce, de tel raisonnement qu'ils aviseront bon être, et aux répétiteurs hibernois et autres leurs suppôts de leur prêter main-forte, et de courir sus aux contrevenants, à peine d'être privés du droit de disputer sur les prolégomènes de la logique.
Et afin qu'à l'avenir il n'y soit contrevenu, a banni à perpétuité la Raison des écoles de ladite Université; lui fait défenses d'y entrer, troubler ni inquiéter ledit Aristote en la possession et jouissance d'icelles, à peine d'être déclarée janséniste et amie des nouveautés. Et à cet effet sera le présent arrêt lu et publié aux Mathurins de Stagire, à la première assemblée qui sera faite pour la procession du recteur, et affiché aux portes de tous les collèges du Parnasse et partout où besoin sera. Fait ce trente-huitième jour d'août onze mil six cent soixante et quinze".

1674 - 1683 - Le Lutrin
Poème héroï-comique qui se veut un défi littéraire, burlesque, visant à montrer qu'une épopée, serait-elle de peu de matière, peut être écrite avec grandiloquence et force procédés épiques et allégoriques (la Discorde, la Nuit, la Mollesse). L'intrigue est ridicule et oppose trois "héros", des personnages médiocres et querelleurs, membres de clergé de la Sainte-Chapelle, le Trésorier, le Chantre et le chevecier, chargé des chapes et de la cire, qui se disputent à propos d'un lutrin dont la masse imposante masque le chantre dans sa stalle. Les voici dans l'obscurité de leur église craignant sourdement le moindre bruit..
"Mais les trois champions, pleins de vin et d'audace,
Du Palais cependant passent la grande place;
Et, suivant de Bacchus les auspices sacrés,
De l'auguste Chapelle ils montent les degrés.
Ils atteignaient déjà le superbe portique
Où Ribou le libraire, au fond de sa boutique,
Sous vingt fidèles clefs garde et tient en dépôt
L'amas toujours entier des écrits de Haynaut,
Quand Boirude, qui voit que le péril approche,
Les arrête ; et, tirant un fusil de sa poche,
Des veines d'un caillou, qu'il frappe au même instant,
Il fait jaillir un feu qui pétille en sortant :
Et bientôt, au brasier d'une mèche enflammée,
Montre, à l'aide du soufre, une cire allumée,
Cet astre tremblotant, dont le jour les conduit,
Est pour eux un soleil au milieu de la nuit.
Le temple, à sa faveur, est ouvert par Boirude :
Ils passent de la nef la vaste solitude,
Et dans la sacristie entrant, non sans terreur,
En percent jusqu'au fond la ténébreuse horreur.
C'est là que du lutrin gît la machine énorme.
La troupe quelque temps en admire la forme.
Mais le barbier, qui tient les moments précieux :
"Ce spectacle n'est pas pour amuser nos yeux,
Dit-il, le temps est cher; portons-le dans le temple;
C'est là qu'il faut demain qu'un prélat le contemple."
Et d'un bras, à ces mots, qui peut tout ébranler,
Lui-même, se courbant, s'apprête à le rouler.
Mais à peine il y touche, ô prodige incroyable!
Que du pupitre sort une voix effroyable.
Brontin en est ému, le sacristain pâlit;
Le perruquier commence à regretter son lit.
Dans son hardi projet toutefois il s'obstine,
Lorsque des flancs poudreux de la vaste machine
L'oiseau sort en courroux, et, d'un cri menaçant,
Achève d'étonner le barbier frémissant.
De ses ailes dans l'air secouant la poussière,
Dans la main de Boirude il éteint la lumière.
Les guerriers à ce coup demeurent confondus;
Ils regardent la nef, de frayeur éperdus.
Sous leurs corps tremblotants leurs genoux s'affaiblissent;
D'une subite horreur leurs cheveux se hérissent;
Et bientôt, au travers des ombres de la nuit,
Le timide escadron se dissipe et s'enfuit..."
(Chant III, v. 41-84).
L'Indolence
Dans le réduit obscur d'une alcôve enfoncée
S'élève un lit de plume à grands frais amassée:
Quatre rideaux pompeux, par un double contour,
En défendent l'entrée à la clarté du jour. i
Là, parmi les douceurs d'un tranquille silence,
Règne sur le duvet une heureuse indolence.
C'est là que le prélat, muni d'un déjeuner,
Dormant d'un léger somme, attendait le dîner.
La jeunesse en sa fleur brille sur son visage;
Son menton sur son sein descend à double étage;
Et son corps, ramassé dans sa courte grosseur,
Fait gémir les-coussins sous sa molle épaisseur.
(Le Lutrin. I.)

1674 - "L’Art poétique"
Les Satires n'ont donc pas réussi à détruire ce que Boileau dénonçait comme de la mauvaise littérature, ainsi reprend-il une nouvelle bataille, et l'Art poétique fait preuve sous cet angle là de la même agressivité envers ce qui constituent pour lui de méchants auteurs (Saint-Amant, Scudéry, Brébeuf) et des ouvrages ridicules (Cyrus, Clélie, Cliildebrand). Mais le public ne suivra pas dans sa totalité sa critique virulente. Ainsi, nous expliquera G. Lanson, "on trouverait la juste expression du goût moyen et général de la bonne société, pendant le dernier tiers du XVIIe siècle, dans Bussy-Rabutin et son cercle, tel que sa correspondance nous les montre. Ce grand seigneur académicien, qui avait la passion des lettres, de l'esprit, et du style exact, et qui écrivait avec une précision si fine, encore qu'un peu sèche, ne se rangea jamais complètement au parti de Boileau..."
Dans ce célèbre traité, qui reprend les éléments de doctrine élaborés entre autres par Aristote (Poétique), Longin (Traité du sublime), Horace (Art poétique), et que l'auteur veut répandre dans parmi le grand public lettré, Boileau s'emploie d'abord à condamner le "faste pédantesque" de la poésie du XVIème siècle et salue en Malherbe l'initiateur de l'ordre et de la mesure en poésie, des principes que sont la recherche d'une expression condensée et signifiante, une conception morale de la littérature, héritée de l'humanisme français, - l'art littéraire est une imitation de la nature humaine, l'idéal est la vérité, et pour plaire il faut donc faire vrai -, mais adaptée à une société où le monarque et sa cour sont devenus les repères du goût et des mœurs.
Son projet semble avoir été conçu dès 1669-70. au sein de l'Académie Lamoignon, foyer de réflexion poétique mondaine, et des lectures en ont été données dès 1672, dans le salon du cardinal de Retz, et en 1673, intégralement, chez Jean Herauld Gourville.
Il s'agit de diffuser un savoir confisqué par des doctes au plus grand public lettré possible, et donc chercher à séduire en divertissant, et de fait l'ensemble comporte de rapides dialogues, des croquis mordants, des allusions voilées, et le vers travaillé pour permettre la mémorisation...
La question de la "Raison" - "Jamais écrit n'a été plus populaire et plus incompris que cet Art poétique, écrira Gustave Lanson, et il n'y a pas d'ouvrage doctrinal dont on ait plus méconnu ou défiguré le sens. En voici tout d'abord une raison : c'est que la langue, qui n'a pas beaucoup changé depuis que le XVIIe siècle s'est flatté de la fixer, a pourtant changé un peu : en sorte que, quand nous lisons Boileau, ou Racine, ou Corneille, leurs expressions ne suscitent plus en nous tout à fait les mêmes représentations qui surgissaient dans l'esprit des contemporains, et la traduction mentale que nous en faisons en courant, n'est qu'une suite d'à peu près, d'inexactitudes et de faux sens. Et quand ii s'agit de termes abstraits, qui expriment des concepts tout intellectuels, associés dans l'idée de l'auteur par certaines relations logiques, l'inexactitude perpétuelle finit par devenir une erreur considérable, un contresens total.
C'est notre cas, quand nous parcourons Boileau des yeux. Tous ces mots qu'il emploie, raison, vrai, sublime, pompeux, et tant d'autres, qui sont comme les étiquettes de sa doctrine, ont été affectés par nous à d'autres emplois ou correspondent à des cases de l'esprit, dont nous avons renouvelé le contenu. Il faut une transposition continuelle d'idées et de termes pour obtenir la pensée de Boileau en son vrai sens, dans son vrai jour. On s'aperçoit alors que cette pensée est singulièrement moins étroite et moins choquante qu'on ne croyait.."
Ainsi du terme de "raison", qu'on voit si souvent revenir presque à chaque page de son poème, d'où l'on a entretenu le reproche si souvent adressé à Boileau, de n'avoir pas fait à l'imagination sa part dans l'œuvre poétique. "Voilà un poète, dit-on, qui, pour faire des chefs-d'œuvre, ne connaît qu'un secret : être bien raisonnable, bien sage, bien obéissant aux règles. De l'imagination pas un mot, ou, s'il y pense, ce n'est que pour l'emmailloter de préceptes, à la rendre incapable de bouger. Et l'on rappelle que Boileau n'avait pas d'imagination ; c'est donc pour cela qu'il défend aux autres d'en avoir". En fait, notre auteur demande avant tout à celui qui veut faire des vers d'être né poète, d'avoir le génie, d'avoir ce don naturel, cette faculté créatrice que donne « l'influence secrète du ciel », et n'est-ce pas l'imagination ?
"Non, poursuit G. Lanson, la raison de Boileau n'a rien de commun avec l'esprit positif, calculateur, prosaïque, de la bourgeoisie de 1830. Ce n'est pas non plus la raison des idéologues et des philosophes, la raison raisonnante, analytique et critique, qui loge tout l'univers en formules abstraites dans l'esprit humain, et réduit toute l'activité de 'intelligence à une sèche algèbre : ce n'est pas la raison de Voltaire et de Condillac. Mais c'est la raison cartésienne, dominatrice et directrice de l'âme humaine, dont elle règle toutes les facultés sans en empêcher aucune : c'est celle qui, par essence, distingue le vrai du faux.
Mais qu'est-ce qu'une pensée vraie, en poésie? La poésie est un art, et la vérité n'y est pas d'un autre ordre qu'en peinture et en sculpture : c'est la vérité de l'imitation, la conformité de la représentation figurée au modèle naturel. Dans le style, c'est l'équivalence du mot à l'idée : dans la conception, l'équivalence de l'idée à l'objet. Nous n'avons qu'à rapprocher deux ou trois vers épars dans l'œuvre de Boileau, et sa pensée se dégagera avec une netteté parfaite : "Aimez donc la raison : que toujours vos écrits Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix."
Donc la raison fait la beauté. Mais la beauté, c'est la vérité : "Rien n'est beau que le vrai....
Mais le vrai, c'est la nature : La nature est vraie...."
Raison, vérité, nature, c'est donc tout un, et voici le terme où l'on aboutit. Sous ces mots abstraits de raison et de vérité, ce n'est pas la froideur de l'imagination ni la sécheresse scientifique que Boileau prescrit aux poètes : c'est l'amour et le respect de la nature. Ainsi cette théorie de la poésie classique, dont on accuse le plus souvent l'étroitesse, et qu'on fait presque consister dans l'horreur du naturel, est une théorie essentiellement et franchement naturaliste : c'est tout ce que veut dire, ou du moins c'est ce que veut dire d'abord l'appel incessant qu'il fait à la raison..."
"Hâtez-vous lentement; et sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage"- Le Chant I s'attache aux préceptes guidant l'art d'écrire, l'inspiration ne suffit pas, une méthode est nécessaire, qui subordonne la forme à la pensée, soumise elle-même à la raison. Contre le faux brillant, il prône la clarté et une parfaite pureté de style, fruit d'une rigoureuse et patiente élaboration..
"Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime,
Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime :
L'un l'autre vainement ils semblent se haïr;
La rime est une esclave et ne doit qu'obéir.
Lorsqu'à la bien chercher d'abord on s'évertue,
L'esprit à la trouver aisément s'habitue ;
Au joug de la raison sans peine elle fléchit
Et, loin de la gêner, la sert et l'enrichit.
Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle,
Et pour la rattraper le sens court après elle.
Aimez donc la raison : que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.
La plupart emportés d'une fougue insensée,
Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensée :
Ils croiraient s'abaisser, dans leurs vers monstrueux,
S'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux.
Évitons ces excès : laissons à l'Italie
De tous ces faux brillants l'éclatante folie.
Tout doit tendre au bon sens : mais pour y parvenir
Le chemin est glissant et pénible à tenir;
Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie.
La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie...
Il est certain esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées ;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d'écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L*expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Surtout qu'en vos écrits la langue révérée
Dans vos plus grands excès vous soit toujours sacrée.
En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
Si le terme est impropre ou le tour vicieux :
Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,
Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.
Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.
Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse,
Et ne vous piquez point d'une folle vitesse :
Un style si rapide, et qui court en rimant,
Marque moins trop d'esprit que peu de jugement.
J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène,
Dans un pré plein de fleurs lentement se promène,
Qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux,
Roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux.
Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez ;
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez"
Une digression sur la poésie le conduit à la bien connue reconnaissance de Malherbe, l'initiateur de l'art classique.
"Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée.
Les stances avec grâce apprirent à tomber,
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.
Tout reconnut ses lois; et ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle.
Marchez donc sur ses pas; aimez sa pureté,
Et de son tour heureux imitez la clarté.
Si le sens de vos vers tarde à se faire entendre,
Mon esprit aussitôt commence à se détendre,
Et, de vos vains discours prompt à se détacher,
Ne suit point un auteur qu'il faut toujours chercher.
Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d'écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Surtout qu'en vos écrits la langue révérée
Dans vos plus grands excès vous soit toujours sacrée.
En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
Si le terme est impropre, ou le tour vicieux;
Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,
Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.
Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.
Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse,
Et ne vous piquez point d'une folle vitesse;
Un style si rapide, et qui court en rimant,
Marque moins trop d'esprit, que peu de jugement.
J'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arène
Dans un pré plein de fleurs lentement se promène,
Qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux,
Roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux.
Hâtez-vous lentement; et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.
C'est peu qu'en un ouvrage où les fautes fourmillent,
Des traits d'esprit semés de temps en temps pétillent.
Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu;
Que le début, la fin répondent au milieu;
Que d'un art délicat les pièces assorties
N'y forment qu'un seul tout de diverses parties :
Que jamais du sujet le discours s'écartant
N'aille chercher trop loin quelque mot éclatant.
Craignez-vous pour vos vers la censure publique ?
Soyez-vous à vous-même un sévère critique.

Le Chant II se consacre aux genres mineurs, idylle, élégie, ode, sonnet, épigramme, ballade et satire...
"Cependant cet oiseau qui prône les merveilles,
Ce monstre composé de bouches et d'oreilles,
Oui, sans cesse volant de climats en climats,
Dit partout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas;
La Renommée enfin, cette prompte courrière,
Va d'un mortel effroi glacer la perruquière ;
Lui dit que son époux, d'un faux zèle conduit,
Pour placer un lutrin doit veiller cette nuit.
A ce triste récit, tremblante, désolée,
Elle accourt, l'oeil en feu, la tète échevelée.
Et trop sûre d'un mal qu'on pense lui celer :
Oses-tu bien encor, traître, dissimuler?
Dit-elle : et ni la foi que ta main m'a donnée,
Ni nos embrassements qu'a suivi l'hyménée.
Ni ton épouse enfin toute prête à périr,
Ne sauroient donc t'ôter cette ardeur de courir!
Perfide! si du moins, à ton devoir fidèle,
Tu veillois pour orner quelque tête nouvelle,
L'espoir d'un juste gain, consolant ma langueur,
Pourroit de ton absence adoucir la longueur,
Mais quel zèle indiscret, quelle aveugle entreprise
Arme aujourd'hui ton bras en faveur d'une église?
Où vas-tu, cher époux? est-ce que tu me fuis?
As-tu donc oublié tant de si douces nuits?
Quoi! d'un œil sans pitié vois-tu couler mes larmes?
Au nom de nos baisers jadis si pleins de charmes,
Si mon cœur, de tout temps facile à tes désirs,
N'a jamais d'un moment différé tes plaisirs;
Si, pour te prodiguer mes plus tendres caresses.
Je n'ai point exigé ni serments, ni promesses:
Si toi seul à mon lit enfin eus toujours part,
Diffère au moins d'un jour ce funeste départ..."

Le Chant III est un exposé méthodique des caractéristiques de la tragédie telle qu'elle est conçue à l'époque, débutant par un rappel des grands principes de l'art classique dont elle est le "grand genre" le plus représentatif. Boileau y refait, après Aristote, la théorie de l'imitation, mais aussitôt il note la nécessité de plaire et de toucher.
Puis il précise les impératifs techniques : le sujet doit être au plus tôt expliqué, le lieu et le temps bien définis et limités, l'action unique; de façon générale, l'œuvre doit être vraisemblable, acceptable pour l'esprit : une progression dramatique qui s'éclaire tout à coup par une révélation raisonnable satisfait pleinement l'intelligence. Ainsi se mêlent habilement les précisions techniques et les vues générales qui assimilent peu à peu la tragédie et l'essence même de l'art classique...
"Il n'est point de serpent, ni de monstre odieux,
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux.
D 'un pinceau délicat l'artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable.
Ainsi, pour nous charmer, la Tragédie en pleurs
D 'œdipe tout sanglant fit parler les douleurs,
D 'Oreste parricide exprima les alarmes,
Et pour nous divertir nous arracha des larmes.
Vous donc, qui d'un beau feu pour le Théâtre épris,
Venez en vers pompeux y disputer le prix,
Voulez-vous sur la scène étaler des ouvrages,
Où tout Paris en foule apporte ses suffrages,
Et qui toujours plus beaux, plus ils sont regardés,
Soient au bout de vingt ans encor redemandés?
Que dans tous vos discours la passion émue
Aille chercher le cœur, l'échauffe, et le remue.
Si d 'un beau mouvement l'agréable fureur
Souvent ne nous remplit d'une douce terreur,
Ou n'excite en notre âme une pitié charmante,
En vain vous étalez une scène savante :
Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir
Un spectateur toujours paresseux d'applaudir,
Et qui des vains efforts de votre Rhétorique,
Justement fatigué, s'endort, ou vous critique.
Le secret est d'abord de plaire et de toucher :
Inventez des ressorts qui puissent m'attacher.
Que dès les premiers vers l'action préparée,
Sans peine, du sujet aplanisse l'entrée.
Je me ris d'un acteur qui lent à 1'exprimer,
De ce qu'il veut d 'abord ne sait pas m'informer,
Et qui débrouillant mal une pénible intrigue
D 'un divertissement me fait une fatigue.
J'aimerais mieux encor qu'il déclinât son nom,
Et dise : je suis Oreste, ou bien Agamemnon
Que d'aller par un tas de confuses merveilles,
Sans rien dire à l'esprit, étourdir les oreilles.
Le sujet n 'est jamais assez tôt expliqué.
Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué.
Un rimeur, sans péril, delà les Pyrénées,
Sur la scène en un jour renferme des années.
Là souvent le héros d 'un spectacle grossier,
Enfant au premier acte, est barbon au dernier.
Mais nous, que la Raison à ses règles engage,
Nous voulons qu'avec art l'action se ménage :
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.
Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable.
Le Vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.
Une merveille absurde est pour moi sans appas.
L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas.
Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose :
Les yeux en le voyant saisiraient mieux la chose.
Mais il est des objets que l'Art judicieux
Doit offrir à l'oreille, et reculer des yeux.
Que le trouble toujours croissant de scène en scène
A son comble arrivé se débrouille sans peine.
L 'esprit ne se sent point plus vivement frappé,
Que lorsque en un sujet d'intrigue enveloppé,
D 'un secret tout à coup la vérité connue
Change tout, donne à tout une face imprévue."
1677-1687 - En 1677, Boileau devient avec Racine historiographe du roi. Il entre à l'Académie en 1684. Il a publié en 1683 un nouveau recueil de ses œuvres, enrichi des Epîtres VI à IX et des Chants V et VI du Lutrin. En 1685, il achète à Auteuil une propriété dont il immortalisera le jardin dans l'Épître XI. Pendant une dizaine d'années, il produira peu, pris par ses occupations officielles et goûtant dans ses loisirs les charmes de la retraite champêtre...
1687 - La fameuse querelle des Anciens et des Modernes - Le 27 janvier 1687, pendant la mémorable séance où Charles Perrault (1628-1703), l'homme de confiance de Colbert, auprès de qui il a remplace Chapelain, fait l'éloge du siècle de Louis le Grand au détriment d'Homère et du siècle d'Auguste, Boileau intervient vivement en faveur des écrivains anciens.
Perrault fit paraître à la fin de 1688 le premier volume de ses "Parallèles des anciens et des modernes", -le quatrième ne sera publié qu'en 1697. Dès la préface du premier volume, Perrault se représente bataillant contre «un certain peuple tumultueux de savants qui, entêtés de l'antiquité, n'estiment que le talent d'entendre bien les vieux auteurs », se moque des hommes de collège, « payés et gagés » pour s'enthousiasmer aux heures des leçons sur n'importe quels vers grecs ou latins. Perrault choisit ici la forme du dialogue qui lui permet d'être plus aisément compréhensible sans être trop profond, et imagine trois personnages, un Président, savant homme et idolâtre des anciens, à qui il ne put prêter plus d'attachement à l'antiquité, qu'il ne croyait qu'on pût raisonnablement en avoir; un abbé, tout autant savant mais «plus riche de ses propres pensées que de celles des autres», au fond l'auteur lui-même, et un chevalier, sorte de Turlupin de la critique, que Perrault va charger d'avancer toutes les énormités qu'il n'osait faire endosser à son abbé.
Boileau, quant à lui, combat en composant des épigrammes et, toujours à l'appui de sa thèse, une "Ode pindarique sur la prise de Namur", précédée d'un 'Discours sur l'Ode" (publiées en 1693), et des "Réflexions sur Longin" (1694-1713), dont les neuf premières dès 1694, et qui pour beaucoup ne sont pas à la hauteur de ses fameuses Satires.
"... Ce n'est donc point la vieillesse des mots et des expressions, dans Ronsard, qui a décrié Ronsard; c'est qu'on s'est aperçu tout d'un coup que les beautés qu'on y croyait voir n'étaient point des beautés, ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes, et Racan, qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connaître, ayant attrapé dans le genre sérieux le vrai génie de la langue française, qui, bien loin d'être en son point de maturité du temps de Ronsard, comme Pasquier se l'était persuadé faussement, n'était pas même encore sortie de sa première enfance. Au contraire, le vrai tour de l'épigramme, du rondeau, et des épîtres naïves, ayant été trouvé, même avant Ronsard par Marot, par Saint- Gelais, et par d'autres, non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés dans le mépris, mais ils sont encore aujourd'hui généralement estimés; jusque-là même que, pour trouver l'art naïf en français, on a encore quelquefois recours à leur style; et c'est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de la Fontaine. Concluons donc qu'il n'y a qu'une longue suite d'années qui puisse établir la valeur et le vrai mérite d'un ouvrage.
Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant un fort grand nombre de siècles, et n'ont été méprisés que par quelques gens de goût bizarre, car il se trouve toujours des goûts dépravés, alors non-seulement il y a de la témérité, mais il y a de la folie à vouloir douter du mérite de ces écrivains. Que si vous ne voyez point les beautés de leurs écrits , il ne faut pas conclure qu'elles n'y sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous n'avez point de goût. Le gros des hommes à la longue ne se trompe point sur les ouvrages d'esprit. Il n'est plus question, à l'heure qu'il est, de savoir si Homère, Platon , Cicéron , Virgile , sont des hommes merveilleux ; c'est une chose sans contestation, puisque vingt siècles en sont convenus : il s'agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles; et il faut trouver moyen de le voir , ou renoncer aux belles-lettres , auxquelles vous devez croire que vous n'avez ni goût ni génie, puisque vous ne sentez point ce qu'ont senti tous les hommes.
Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous sachiez la langue de ces auteurs; car si vous ne la savez point, et si vous ne vous l'êtes point familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n'en point voir les beautés : je vous blâmerai seulement d'en parler. Et c'est en quoi on ne saurait trop condamner M. Perrault, qui, ne sachant point la langue d'Homère, vient hardiment lui faire son procès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages de ce grand poète durant tant de siècles : Vous avez admiré des sottises. C'est à peu près la même chose qu'un aveugle-né qui s'en irait crier par toutes les rues : « Messieurs, je sais que le soleil que vous voyez vous paraît fort beau; mais moi, qui ne l'ai jamais vu, je vous déclare qu'il est fort laid. »
Mais, pour revenir à ce que je disais, puisque c'est la postérité seule qui met le véritable prix aux ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que vous paraisse un écrivain moderne, le mettre aisément en parallèle avec ces écrivains admirés durant un si grand nombre de siècles..." (Réflexions VII)

C'est aussi après 1694, Boileau et Perrault se réconcilieront sur les instances d'Arnauld, et c'est alors que Boileau produira sans doute, et enfin, ses meilleures pages sur la Querelle des anciens et des modernes, au cours de la lettre qu'il écrivit à Perrault en 1700, montrant que le siècle de Louis XIV n'est pas plus grand à lui seul que tous les siècles passés, mais supérieur à n'importe quel siècle pris à part, même à celui d'Auguste.. avec toute la vénération qu'il avait pour l'antiquité, l'auteur de l'Art poétique et des Réflexions sur Longin confessait qu'il était réellement un «moderne», et Racine en était le plus extraordinaire exemple...
"... Mais maintenant que nous voilà bien remis , et qu'il ne reste plus entre nous aucun levain d'animosité ni d'aigreur, oserais-je, comme votre ami, vous demander ce qui a pu, depuis si longtemps, vous irriter, et vous porter à écrire contre tous les plus célèbres écrivains de l'antiquité? Est-ce le peu de cas qu'il vous a paru que l'on faisait parmi nous des bons auteurs modernes? Mais où avez vous vu qu'on les méprisât? Dans quel siècle a-t-on plus volontiers applaudi aux bons livres naissants que dans le nôtre? Quels éloges n'y a-t-on point donnés aux ouvrages de M. Descartes, de M. Arnauld, de M. Nicole, et de tant d'autres admirables philosophes et théologiens que la France a produits depuis soixante ans, et qui sont en si grand nombre, qu'on pourrait faire un petit volume de la seule liste de leurs écrits?
Mais pour ne nous arrêter ici qu'aux seuls auteurs qui nous touchent vous et moi de plus près, je veux dire aux poètes, quelle gloire ne s'y sont point acquise les Malherbe, les Racan, les Maynard? Avec quels battements de mains n'y a-t-on point reçu les ouvrages de Voiture, de Sarrazin, et de la Fontaine? Quels honneurs n'y a-t-on point , pour ainsi dire, rendus à M. de Corneille et à M. Racine? Et qui est-ce qui n'a point admiré les comédies de Molière? Vous-même , Monsieur, pouvez-vous vous plaindre qu'on n'y ait pas rendu justice à votre Dialogue de l'amour et de l'amitié; à votre Poème sur la peinture; à votre Épître sur M. de la Quintinie, et à tant d'autres excellentes pièces de votre façon? On n'y a pas véritablement fort estimé nos poèmes héroïques : mais a-t-on eu tort? et ne confessez-vous pas vous-même en quelque endroit de vos Parallèles, que le meilleur de ces poèmes est si dur et si forcé, qu'il n'est pas possible de le lire?
Quel est donc le motif qui vous a tant fait crier contre les anciens? Est-ce la peur qu'on ne se gâtât en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce ne soit au contraire à cette imitation-là même que nos plus grands poëtes sont redevables du succès de leurs écrits? Pouvez-vous nier que ce ne soit dans Tite-Live, dans Dion Cassius, dans Plutarque, dans Lucain, et dans Sénèque, que M. de Corneille a pris ses plus beaux traits, a puisé ces grandes idées qui lui ont fait inventer un nouveau genre de tragédie, inconnu à Aristote?
Car c'est sur ce pied, à mon avis, qu'on doit regarder quantité de ses plus belles pièces de théâtre, où se mettant au-dessus des règles de ce philosophe, il n'a point songé, comme les poètes de l'ancienne tragédie, à émouvoir la pitié et la terreur , mais à exciter dans l'âme des spectateurs, par la sublimité des pensées, et par la beauté des sentiments, une certaine admiration, dont plusieurs personnes, et les jeunes gens surtout, s'accommodent souvent beaucoup mieux que des véritables passions tragiques. Enfin, Monsieur, pour finir cette période un peu longue, et pour ne me point écarter de mon sujet, pouvez-vous ne pas convenu' que ce sont Sophocle et Euripide qui ont formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer que c'est dans Plante et dans Térence que Molière a appris les plus grandes finesses de son art?
D'où a pu donc venir votre chaleur contre les anciens? Je commence, si je ne m'abuse, à l'apercevoir. Vous avez vraisemblablement rencontré, il y a longtemps, dans le monde , quelques-uns de ces faux savants , tels que le président de vos Dialogues , qui ne s'étudient qu'à enrichir leur mémoire, et qui n'ayant d'ailleurs ni esprit, ni jugement, ni goût, n'estiment les anciens que parce qu'ils sont anciens; ne pensent pas que la raison puisse parler une autre langue que la grecque ou la latine , et condamnent d'abord tout ouvrage en langue vulgaire, sur ce fondement seul qu'il est en langue vulgaire.
Ces ridicules admirateurs de l'antiquité vous ont révolté contre tout ce que l'antiquité a de plus merveilleux ; vous n'avez pu vous résoudre d'être du sentiment de gens si déraisonnables , dans la chose même où ils avaient raison. Voilà, selon toutes les apparences, ce qui vous a fait faire vos Parallèles. Vous vous êtes persuadé qu'avec l'esprit que vous avez , et que ces gens-là n'ont point; avec quelques arguments spécieux, vous déconcerteriez aisément la vaine habileté de ces faibles antagonistes; et vous y avez si bien réussi que, si je ne me fusse mis de la partie, le champ de bataille, s'il faut ainsi parler, vous demeurait : ces faux savants n'ayant pu, et les vrais savants, par une hauteur un peu trop affectée, n'ayant pas daigné vous répondre.
Permettez-moi cependant de vous faire ressouvenir que ce n'est point à l'approbation des faux ni des vrais savants que les grands écrivains de l'antiquité doivent leur gloire; mais à la constante et unanime admiration de ce qu'il y a eu dans tous les siècles d'hommes sensés et délicats , entre lesquels on compte plus d'un Alexandre et plus d'un César.
Permettez-moi de vous représenter qu'aujourd'hui même encore ce ne sont point, comme vous vous le figurez , les Schrevelius, les Peraredus , les Menagius , ni , pour me servir des termes de Molière, les savants en us, qui goûtent davantage Homère, Horace, Cicéron, Virgile. Ceux que j'ai toujours vus le plus frappés de la lecture des écrits de ces grands personnages, ce sont des esprits du premier ordre ; ce sont des hommes de la plus haute élévation. Que s'il fallait nécessairement vous en citer ici quelques-uns, je vous étonnerais peut-être par les noms illustres que je mettrais sur le papier ; et vous y trouveriez non-seulement des Lamoignon, des Daguesseau, des Troisville, mais des Condé, des Conti, et des Turenne.
Ne pourrait-on point donc , Monsieur, aussi galant homme que vous l'êtes , vous réunir de sentiments avec tant de si galants hommes? Oui, sans doute, on le peut ; et nous ne sommes pas même vous et moi si éloignés d'opinion que vous pensez. En effet, qu'est-ce que vous avez voulu établir par tant de poèmes, de dialogues, et de dissertations sur les anciens et sur les modernes? Je ne sais si j'ai bien pris votre pensée : mais la voici , ce me semble. Votre dessein est de montrer que pour la connaissance surtout des beaux-arts, et pour le mérite des belles-lettres, notre siècle, ou pour mieux parler, le siècle de Louis le Grand, est non-seulement comparable, mais supérieur à tous les plus fameux siècles de l'antiquité, et même au siècle d'Auguste. Vous allez donc être bien étonné, quand je vous dirai que je suis sur cela entièrement de votre avis ; et que même, si mes infirmités et mes emplois m'en laissaient le loisir , je m'offrirais volontiers de prouver comme vous cette proposition , la plume à la main. A la vérité j'emploierais beaucoup d'autres raisons que les vôtres, car chacun a sa manière de raisonner; et je prendrais des précautions et des mesures que vous n'avez point prises.
Je n'opposerais donc pas, comme vous avez fait, notre nation et notre siècle seuls à toutes les autres nations et à tous les autres siècles joints ensemble; l'entreprise, à mon sens, n'est pas soutenable. J'examinerais chaque nation et chaque siècle l'un après l'autre; et, après avoir mûrement pesé en quoi ils sont au-dessus de nous, et en quoi nous les surpassons, je suis fort trompé, si je ne prouvais invinciblement que l'avantage est de notre côté.
Ainsi, quand je viendrais au siècle d'Auguste, je commencerais par avouer sincèrement que nous n'avons point de poètes héroïques ni d'orateurs que nous puissions comparer aux Virgile et aux Cicéron. Je conviendrais que nos plus habiles historiens sont petits devant les Tite-Live et les Salluste. Je passerais condamnation sur la satire et sur l'élégie, quoiqu'il y ait des satires de Régnier admirables, et des élégies de Voiture, de Sarrazin et de la comtesse de la Suze, d'un agrément infini.
Mais en même temps je ferais voir que pour la tragédie nous sommes beaucoup supérieurs aux Latins, qui ne sauraient opposer, à tant d'excellentes pièces tragiques que nous avons en notre langue, que quelques déclamations plus pompeuses que raisonnables d'un prétendu Sénèque, et un peu de bruit qu'ont fait en leur temps le Thyeste de Varius et la Médée d'Ovide. Je ferais voir que , bien loin qu'ils aient eu dans ce siècle-là des poètes comiques meilleurs que les nôtres, ils n'en ont pas eu un seul dont le nom ait mérité qu'on s'en souvînt : les Plaute, les Cécilius et les Térence étant morts dans le siècle précédent. Je montrerais que si pour l'ode nous n'avons pas d'auteurs si parfaits qu'Horace, qui est leur seul poëte lyrique, nous en avons néanmoins un assez grand nombre qui ne lui sont guère inférieurs en délicatesse de langue et en justesse d'expression, et dont tous les ouvrages mis ensemble ne feraient peut-être pas dans la balance un poids de mérite moins considérable que les cinq livres d'odes qui nous restent de ce grand poëte.
Je montrerais qu'il y a des genres de poésie où non-seulement les Latins ne nous ont point surpassés, mais qu'ils n'ont pas même connus : comme, par exemple, ces poëmes en prose que nous appelons romans , et dont nous avons chez nous des modèles qu'on ne saurait trop estimer, à la morale près qui y est fort vicieuse et qui en rend la lecture dangereuse aux jeunes personnes. Je soutiendrais hardiment qu'à prendre le siècle d'Auguste dans sa plus grande étendue , c'est-à-dire depuis Cicéron jusqu'à Corneille Tacite, on ne saurait pas trouver parmi les Latins un seul philosophe qu'on puisse mettre pour la physique en parallèle avec Descartes, ni même avec Gassendi. Je prouverais que pour le grand savoir et la multiplicité de connaissances, leur Varron et leur Pline, qui sont leurs plus doctes écrivains, paraîtraient de médiocres savants devant nos Bignon, nos Scaliger, nos Saumaise, nos père Sirmond, et nos père Petau.
Je triompherais avec vous du peu d'étendue de leurs lumières sur l'astronomie, sur la géographie et sur la navigation. Je les délierais de me citer, à l'exception du seul Vitruve, qui est même plutôt un bon docteur d'architecture qu'un excellent architecte ; je les défierais, dis-je, de me nommer un seul habile architecte, un seul habile sculpteur , un seul habile peintre latin , ceux qui ont fait du bruit à Rome dans tous ces arts étant des Grecs d'Europe et d'Asie, qui venaient pratiquer chez les Latins des arts que les Latins, pour ainsi dire, ne connaissaient point : au lieu que toute la terre aujourd'hui est pleine de la réputation et des ouvrages de nos Poussin, de nos Lebrun, de nos Girardon et de nos Mansard.
Je pourrais ajouter encore à cela beaucoup d'autres choses ; mais ce que j'ai dit est suffisant, je crois, pour vous faire entendre comment je me tirerais d'affaire à l'égard du siècle d'Auguste. Que si de la comparaison des gens de lettres et des illustres artisans, il fallait passer à celle des héros et des grands princes, peut- être en sortirais-je avec encore plus de succès. Je suis bien sûr au moins que je ne serais pas fort embarrassé à montrer que l'Auguste des Latins ne l'emporte pas sur l'Auguste des Français.
Par tout ce que je viens de dire, vous voyez, Monsieur, qu'à proprement parler, nous ne sommes point d'avis différent sur l'estime qu'on doit faire de noire nation et de notre siècle, mais que nous sommes différemment de même avis. Aussi n'est-ce point votre sentiment que j'ai attaqué dans vos Parallèles , mais la manière hautaine et méprisante dont votre abbé et votre chevalier y traitent des écrivains pour qui, même en les blâmant, on ne saurait, à mon avis, marquer trop d'estime, de respect et d'admiration. Il ne reste donc plus maintenant, pour assurer notre accord, et pour étouffer entre nous toute semence de dispute , que de nous guérir l'un et l'autre , vous, d'un penchant un peu trop fort à rabaisser les bons écrivains de l'antiquité; et moi, d'une inclination un peu trop violente à blâmer les méchants, et même les médiocres auteurs de notre siècle. C'est à quoi nous devons sérieusement nous appliquer; mais quand nous n'en pourrions venir à bout, je vous réponds que de mon côté cela ne troublera point notre réconciliation ; et que , pourvu que vous ne me forciez point à lire le Clovis ni la Pucelle , je vous laisserai tout à votre aise critiquer l'Iliade et l'Enéide ; me contentant de les admirer , sans vous demander pour elles cette espèce de culte tendant à l'adoration, que vous vous plaignez, en quelqu'un de vos poëmes, qu'on veut exiger de vous ....
1694-1711 - Vieillissant, Boileau se rapproche des jansénistes, produisant des textes marqués par une critique âpre des mœurs modernes (satire X, "Sur les femmes", 1694, Satire XI, Sur l'Honneur, 1701), par la spiritualité ("épître Sur l'amour de Dieu", 1695), par la lutte contre les conceptions «jésuitiques» du religieux (la satire XII "Sur l'équivoque" (publié en 1711) s'en prend à la casuistique jésuite et au Journal de Trévoux). Mais le P. Le Tellier, confesseur du roi et adversaire farouche des jansénistes, l'empêchera d'obtenir le privilège nécessaire à la publication de cette œuvre, qui ne parut que dans l'édition posthume de 1716. En 1701, l'auteur donne une nouvelle édition de ses œuvres, précédée d'une importante Préface qui apporte à l'Art poétique un utile complément.
Boileau, amère et très affaibli depuis plusieurs années, mourut à Paris le 13 mars 1711. C'est à lui que Racine, son ami intime, adressera, dit-on, ses dernières paroles..
En 1701, Boileau revenait sur l'Art poétique (Préface), un art qui ne va pas de soi quand bien même suivrions-nous la raison et la vérité, ou le simple bon sens...
"Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs : s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un certain sel propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra à la fin que les connaisseurs eux-mêmes avouent qu'ils se sont trompés en lui donnant leur approbation ; que si on me demande ce que c'est que cet agrément et ce sel, je répondrai que c'est un je ne sais quoi qu'on peut beaucoup mieux sentir que dire. A mon avis néanmoins, il consiste principalement à ne jamais présenter au lecteur que des pensées vraies et des expressions justes.
L'esprit de l'homme est naturellement plein d'un nombre infini d'idées confuses du vrai, que souvent il n'entrevoit qu'à demi; et rien ne lui est plus agréable que lorsqu'on lui offre quelqu'une de ces idées bien éclaircie et mise dans un beau jour. Qu'est-ce qu'une pensée neuve, brillante, extraordinaire? Ce n'est point, comme se le persuadent les ignorants, une pensée que personne n'a jamais eue, ni dû avoir . C'est au contraire une pensée qui a dû venir à tout le monde, et que quelqu'un s'avise le premier d'exprimer.
Un bon mot n'est un bon mot qu'en ce qu'il dit une chose que chacun pensait, et qu'íl la dit d'une manière vive, fine et nouvelle. Considérons, par exemple, cette réplique si fameuse de Louis Douzième à ceux de ses ministres qui lui conseillaient de faire périr plusieurs personnes qui, sous le règne précédent, et lorsqu'il n'était encore que duc d'Orléans, avaient pris à tâche de le desservir. "Un Roi de France, leur répondit-il, ne venge point les injures d'un duc d'Orléans." D'où vient que ce mot frappe d'abord? N'est-il pas aisé de voir que c'est parce qu'il présente aux yeux une vérité que tout le monde sent, et qu'il dit mieux que tous les plus beaux discours de morale : "Qu'un grand prince, lorsqu'il est une fois sur le trône, ne doit plus agir par des mouvements particuliers, ni avoir d'autre vue que la gloire et le bien général de son Etat" ? Veut-on voir au contraire combien une pensée fausse est froide et puérile?
Je ne saurais rapporter un exemple qui le fasse mieux sentir que deux vers du poète Théophile, dans sa tragédie intitulée Pyrame et Thisbé, lorsque cette malheureuse amante, ayant ramassé le poignard encore tout sanglant dont Pyrame s'était tué, elle querelle ainsi ce poignard : "Ah ! voici le poignard qui du sang de son maître s'est souillé lâchement. Il en rougit, le traître!"
Toutes les glaces du Nord ensemble ne sont pas, à mon sens, plus froides que cette pensée. Quelle extravagance, bon Dieu! de vouloir que la rougeur du sang dont est teint le poignard d'un homme qui vient de s'en tuer lui-même, soit un effet de la honte qu'a ce poignard de l'avoir tué! Voici encore une pensée qui n'est pas moins fausse, ni par conséquent moins froide. Elle est de Benserade, dans ses Métamorphoses en rondeaux, où parlant du déluge envoyé par les Dieux pour châtier l'insolence de l'homme, il s'exprime ainsi : "Dieu lava bien la tête â son image".
Peut-on, à propos d'une aussi grande chose que le déluge, dire rien de plus petit, ni de plus ridicule que ce quolibet, dont la pensée est d'autant plus fausse en toutes manières, que le Dieu dont il s'agit à cet endroit, c'est Jupiter, qui n'a jamais passé chez les païens pour avoir fait l'homme à son image, l'homme dans la Fable étant, comme tout le monde sait, l'ouvrage de Prométhée?
Puis donc qu'une pensée n'est belle qu'en ce ce qu'elle est vraie, et que l'effet infaillible du vrai, quand il est bien énoncé, c'est de frapper les hommes, il s'ensuit que ce qui ne frappe point les hommes n'est ni beau ni vrai, ou qu'il est mal énoncé, et que, par conséquent, un ouvrage qui n'est point goûté du public est un très méchant ouvrage. Le gros des hommes peut bien, durant quelque temps, prendre le faux pour le vrai, et admirer de méchantes choses; mais il n'est pas possible qu'à la longue une bonne chose ne lui plaise, et je défie tous les auteurs les plus mécontents du public de me citer un bon livre que le public ait jamais rebuté ; à moins qu'ils ne mettent en ce rang leurs écrits, de la bonté desquels eux seuls sont persuadés.
J'avoue néanmoins, et on ne saurait le nier, que quelquefois, lorsque d'excellents ouvrages viennent à paraître, la cabale et l'envie trouvent moyen de les rabaisser, et d'en rendre en apparence le succès douteux; mais cela ne dure guère; et il en arrive de ces ouvrages comme d'un morceau de bois qu'on enfonce dans l'eau avec la main; il demeure au fond tant qu'on l'y retient, mais bientôt, la main venant à se lasser, il se relève et gagne le dessus. Je pourrais dire un nombre infini de pareilles choses sur ce sujet, et ce serait la matière d'un gros livre; mais en voilà assez, ce me semble, pour marquer au public ma reconnaissance, et la bonne idée que j'ai de son goût et de ses jugements."
