- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Mme de La Fayette (1634-1694), "La Princesse de Clèves" (1678) - Mme de Sévigné (1626-1696), "Lettres" - Gabriel de Guilleragues, (1628-1685), "Lettres portugaises" (1669) - Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693) - Henriette d'Angleterre (1644-1670) - ...
Last update 10/10/2021

La critique littéraire a depuis longtemps partagé le XVIIe siècle en deux périodes, avec une année charnière, 1660 : avant 1660, avant Boileau, derrière Corneille, Balzac, Voiture, on pressent Racine, Bossuet, Molière, et Mme de La Fayette annonce une nouvelle façon d'exprimer la vie, donc de la comprendre, elle est, avec Mme de Sévigné, ni sublime ni précieuse, mais pour reprendre le mot de La Rochefoucauld, "vraies". La simplicité, la clarté, la finesse des analyses, les victoires morales qui peuvent coûter cher. Elle n'écrivit qu'un chef d'oeuvre et s'y achemina lentement...
On peut ainsi évoquer dans l'éducation littéraire de Madame de La Fayette l'écriture du "portrait", avant qu'il ne s'empare au siècle suivant de la peinture. On y apprend à peindre "l'intérieur des gens". La mode en 1660 est effet aux "portraits", dans la continuité de la société précieuse, et Madame de La Fayette dès le sixième tome du Grand Cyrus put exercer son ingéniosité sur les portraits d'Angélique Paulet, de Mme de Rambouillet, de Julie d'Angennes, d'Angélique d'Angennes, du marquis de Montausier, de Godeau, de Conrart, de Chapelain, et de Mlle de Scudéry, qui sans doute lança le mouvement. Et c'est la grande Mademoiselle qui, dit-on, sépara le portrait du roman pour en faire un genre littéraire à part, lorsqu'elle demanda à Segrais de préparer une édition de portraits qu'elle avait collectionné.
La mode se répandit assez vite à travers la France et non seulement dans la haute société, mais aussi dans la bourgeoisie, à côté des Portraits de la Cour surgissent Les Portraits des plus belles dames de la Ville de Montpellier ou Les Portraits de Messieurs du Parlement, un Bussy-Rabutin en parsème ses mémoires, ils encombrent tant les romans que Boileau ironise, et atteindront la perfection dans les Caractères de La Bruyère. La première oeuvre publiée par Mme de la Fayette est un Portrait de Madame de Sévigné, sous le nom d'un inconnu. On trouvera ce type d'écriture chez Scarron, qui l'utilise dans "Le roman comique" (1651-1657), dans la fameuse galerie de portraits dressée par Célimène dans "Le Misanthrope" de Molière (1666)...
(Le Misanthrope)
ACASTE
Parbleu ! S’il faut parler de gens extravagants,
Je viens d’en essuyer un des plus fatigants :
Damon, le raisonneur, qui m’a, ne vous déplaise,
Une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise.
CELIMENE
C’est un parleur étrange, et qui trouve toujours
L’art de ne vous rien dire avec de grands discours ;
Dans les propos qu’il tient, on ne voit jamais goutte,
Et ce n’est que du bruit que tout ce qu’on écoute.
ELIANTE, à Philippe
Ce début n’est pas mal ; et contre le prochain
La conversation prend un assez bon train.
CLITANDRE
Timante encore, Madame, est un bon caractère.
CELIMENE
C’est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup d’œil égaré,
Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.
Tout ce qu’il vous débite en grimaces abonde ;
A force de façons, il assomme le monde ;
Sans cesse, il a, tout bas, pour rompre l’entretien
Un secret à vous dire, et ce secret n’est rien ;
De la moindre vétille il fait une merveille
Et jusques au bonjour, il dit tout à l’oreille.
ACASTE
Et Géralde, madame ?
CELIMENE
O l’ennuyeux conteur !
Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur ;
Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse,
Et ne cite jamais que duc, prince ou princesse :
La qualité l’entête, et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d’équipages et de chiens ;
Il tutaye en parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de Monsieur est chez lui hors d’usage.
CLIANDRE
On dit qu’avec Bélise il est du dernier bien.
CELIMENE
Le pauvre esprit de femme, et le sec entretien !
Lorsqu’elle vient me voir, je souffre le martyre :
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire,
Et la stérilité de son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain, pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs vous prenez l’assistance :
Le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud
Sont des fonds qu’avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable ;
Et l’on demande l’heure, et l’on bâille vingt fois,
Qu’elle grouille aussi peu qu’une pièce de bois.

"Le Portrait mythologique de la famille de Louis XIV", tel que représenté par (Jean Nocret, (1670, Château de Versailles) montre encore tout le chemin qui reste à faire en peinture vers ce plus de réalisme auquel parvient Madame de La Fayette dans "La Princesse de Clèves", jusque-là nous n'avions que des personnages réels dissimulés sous des noms fantaisistes, mythologiques ou historiques...
"Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa parure ; le bal commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas surpris de le voir quand on ne l’avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris de se parer augmentait encore l’air brillant qui était dans sa personne ; mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point.
Il se rangea derrière une des fenêtres, qui servaient de porte, pour voir ce que faisait Mme de Clèves. Il vit qu’elle était seule ; mais il la vit d’une si admirable beauté qu’à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n’avait rien, sur la tête et sur sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans ; elle en choisit quelques-uns, et M. de Nemours remarqua que c’étaient des mêmes couleurs qu’il avait portées au tournoi. Il vit qu’elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu’il avait portée quelque temps et qu’il avait donnée à sa sœur, à qui Mme de Clèves l’avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours."
A cette écriture du portrait, joignons un thème, celui de l'amour impossible, auquel s'ajoute une audace qui ne cessa de passionner son public, l'aveu de cet amour impossible... - La cruauté de l'amour est aussi évidente dans "la Princesse de Clèves" que dans "Andromaque" ou "Bérénice" de Racine. M. de Clèves meurt de n'être pas aimé de sa femme; Mme de Clèves, qui se sent responsable de la mort de son mari, ne pourra jamais accepter les hommages de M. de Nemours, qu'elle aime avec ardeur et dont elle se sépare a tout jamais. Or cette cruauté s'allie à une parfaite politesse : M. de Clèves regrette sa jalousie et déplore seulement que sa femme n'ait pas pour lui les sentiments qu'elle a pour un autre. Mme de Clèves, incapable de supprimer sa passion, éprouve une affliction profonde à la mort de son mari... L'élégance de l'expression, la noble sobriété des attitudes font de cette oeuvre le symbole d'une humanité à la fois digne et passionnée....
Le roman épistolaire prolonge l'utilisation fréquente et souvent centrale des lettres dans les intrigues des romans pastoraux et précieux du début du siècle, de même que dans les romans analytiques comme La Princesse de Clèves. Le genre sera encore très prisé au XVIIIe, avec notamment Les Liaisons dangereuses. Gabriel-Joseph de La Vergne, vicomte de Guilleragues (1628-1685) est notamment l'auteur d'une supercherie littéraire très réussie, les Lettres d'une religieuse portugaise....
(Jean Nocret (1615–1672), "Anne-Marie-Louise d'Orléans (1627-1693), duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle", vers 1650, Château de Versailles)

Mme de La Fayette (1634-1694)
Il ne reste que treize gravures qui représentent Mme de La Fayette, dont une gravée par Louis Elle, dit Ferdinand II (1612-1689), qui paraît être la plus ressemblante, mais l'artiste s'est montré peu tendre, reste comme un geste de lassitude., appuyé sur la main gauche, songeuse et mélancolique, une femme d'esprit modeste et simple. C’est le graveur Étienne Jehandier Desrochers qui fixera avant 1741 l’estampe d’après ce portrait, pour la postérité...
Née à Paris, d'une famille de petite noblesse, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne perdit son père en 1649 et le remariage de sa mère avec le chevalier de Sévigné, qui fut frondeur, entraîna le départ de la famille en Anjou (1652). Cet exil ne l'empêcha pas de mener une carrière mondaine et littéraire. Ce fut d'ailleurs Gille Ménage, l'homme du monde qui versifiait en quatre langues, qui se chargea de son éducation, elle fut donc précieuse en sa jeunesse. Dès 1651, elle devint, grâce à la protection de sa marraine, la duchesse d'Aiguillon, demoiselle d'honneur de la reine mère Anne d'Autriche, ce qui lui permit d'entrer en relation avec l'aristocratie du temps: elle fut présentée à Henriette de France et à sa fille (Henriette d'Angleterre, qui épousa le frère de Louis XIV en 1661), se lia avec Mme de Sévigné (1657), et fréquenta le salon de Mme du Plessis-Guénégaud et son château de Fresnes. Ayant épousé en 1655 le comte de La Fayette, plus âgé qu'elle de dix-huit ans, elle vécut avec lui sur ses terres d'Auvergne jusqu'en 1660, date à laquelle elle revint à Paris. Le mariage, à 22 ans, la sauva sans doute de la préciosité...
Femme savante sans être pédante et précieuse qui n'est nullement ridicule, son salon de la rue de Vaugirard réunira un milieu aristocratique et lettré. Elle y reçoit Gilles Ménage, qu'elle rencontra en 1651 et qui tomba amoureux d'elle, Pierre Daniel Huet, Jean de Segrais et le duc de La Rochefoucauld, avec qui elle noua, en 1665, une relation d'amitié qui ne s'éteindra qu'à la mort de celui-ci (1680). Ces intellectuels contribuèrent à former et à exercer son esprit. Segrais écrira : "Mlle de Scudéry a beaucoup d'esprit, mais Mme de La Fayette a plus de jugement." Familière des salons littéraires de la capitale, citée dans le Dictionnaire des précieuses (1660) de Somaize, Mme de La Fayette ne tarda pas à s'adonner à la littérature....
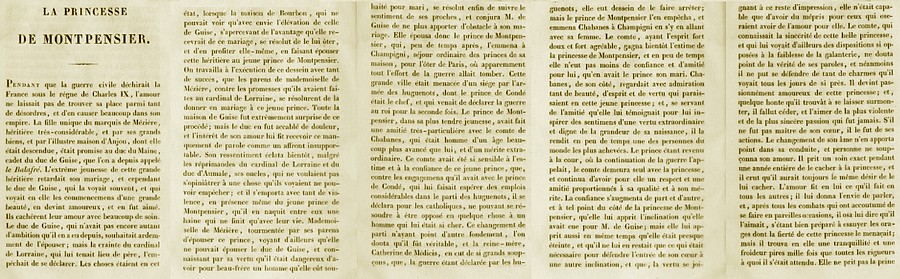

" Pendant que la guerre civile déchirait la France sous le règne de Charles IX, l'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres et d'en causer beaucoup dans son empire..." - En collaboration avec Ménage, elle composa d'abord une nouvelle, "la Princesse de Montpensier", (1662) que, par souci de son rang, elle fit paraître anonymement, mais une nouvelle qui passa presque inaperçue. Mais, à la différence de Mlle de Scudéry, elle laisse de côté les Romains, les Turcs et les Mèdes et donne à ses personnages des noms, un costume et des mœurs que tout le monde connaît, le duc d'Anjou, le prince et la princesse de Montpensier, le duc de Guise et le comte de Chabannes. Quant à l'intrigue, elle est presque familière : une femme romanesque laisse naître et grandir en son cœur une passion coupable, elle souffre, elle pleure, elle s'écroule, elle tombe et meurt après avoir tout perdu.
Cinq ans plus tard, en 1667, Mlle de Scudéry publiera "Mathilde d'Aguilar", un roman en un tome qui ne dépassera pas 518 pages, une concession. Quant à Mme de Sévigné elle avoue dévorer toujours autant Gautier de Costes, sieur de La Calprenède (1609-1663), l'auteur de près de douze mille pages d'épopées galantes entre 1640 et 1660. En 1670, le grave et docte évêque d'Avranches, Huet, relit L'Astrée d'un bout à l'autre, en sort encore plus enthousiaste que jamais et, sous la forme d'une lettre à Segrais, publie son naïf "Traité de l'origine des Romans". On mesure toute la solitude littéraire de Mme de La Fayette..
C'est vraisemblablement en collaboration avec La Rochefoucauld, qu'elle écrivit ensuite "Zayde, Histoire espagnole" (1669-1670), que signa Jean Regnault de Segrais (624-1701). L'ouvrage semble avoir porté un coup fatal à la vogue des oeuvres de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie et l'Artamène, ou aux extravagantes productions de la Calprenède et de Gomberville. A "Zayde" succéda "La princesse de Montpensier", qui fut semble-t-il moins goûté que l'ouvrage qui suivit..
En 1670, La Rochefoucauld entre dans sa vie. En 1672, on dit à Paris que Mme de La Fayette travaille à un nouveau roman. Le livre écrit, on en lit discrètement le manuscrit dans les salons. Enfin, en 1678, le 18 mai, elle publia, sous l'anonymat, "la Princesse de Clèves"...
Assez vite attribué à Mme de La Fayette, cet ouvrage, qui frappe par l'extrême simplicité de son sujet, va créer un beau tumulte dans les salons, mais il passera un peu plus tard pour le chef-d'œuvre du roman classique et pour le modèle du roman d'analyse psychologique...
En fait, tout est neuf dans ce petit roman. On y voit "les moeurs des honnêtes gens et des aventures naturelles dérites avec grâce." Ecrit à la troisième personne, il s'attache à décrire les progrès d'une passion impossible entre l'héroïne éponyme du roman, mariée au prince de Clèves, et le duc de Nemours. Toute une tradition romanesque au XVIIe siècle est fondée sur l'analyse du sentiment amoureux, en particulier les romans précieux, romans-fleuves alourdis d'interminables digressions qui tentent de décortiquer les mécanismes du cœur. Héritier de cette tradition, la Princesse de Clèves doit son exceptionnelle réussite à ce qu'il associe de façon équilibrée l'action et l'analyse psychologique, dans le cadre d'un récit bref, ayant pour toile de fond historique la vie à la cour d'Henri II. De fait, le personnage principal se sert de sa faculté d'introspection comme d'une arme pour lutter contre l'appel de la passion. Evoquant un amour refusé, plutôt qu'un amour impossible, cette œuvre s'inscrit dans la lignée d'un pessimisme moral, sensible chez Racine et La Rochefoucauld, et qu'on attribue souvent, ce qu'il faudrait probablement nuancer, à l'influence du courant janséniste.
Elle perdra successivement en 1680, De La Rochefoucauld, qu'elle vit expirer entre les bras de Bossuet, il avait 65 ans, elle en avait 46, une relation de plus de vingt-cinq ans; en 1683, son mari; elle mourra en 1693 après avoir joué un rôle diplomatique important dans les relations entre la France et la Savoie et reprit la plume pour écrire les Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689. Son livre est bien sévère pour Louis XIV et Mme de Maintenon. Le livre ne sera publié qu'en 1731...

1660-1671 - "Zayde, histoire espagnole"
«Le premier roman, écrira La Harpe, qui offrit des aventures raisonnables écrites avec intérêt et élégance", conte les amours de Zaïde, naufragée et fille de Zuléma, prince musulman converti. et de Gonzalve, fils du Comte de Castille, qui, après avoir traversé mille obstacles en apparence insurmontables, parviennent à s'unir, unissant, couleur locale oblige, la galanterie maure et la jalousie espagnole. Il fallait encore écrire dans le goût du temps, ultime obligation dont Mme de La Fayette s'affranchira une dizaine d'années plus tard. L'intrigue est encore bien enchevêtrée, on y compte pas moins de cinq histoires et autant de personnages, Consalve et Zayde, mais aussi Alphonse et Bélasire, Alamir et Féline...
«Zaïde, dit Sainte-Beuve, tient en quelque sorte un milieu entre l'Astrée et les romans de l'abbé Prévost et fait la chaîne de l'un aux autres. Ce sont également des passions extraordinaires et subites, des ressemblances incroyables de visages, des méprises prolongées et pleines d'aventures, des résolutions formées sur un portrait ou un bracelet entrevus. Ces amants malheureux quittent la cour pour des déserts horribles où ils ne manquent de rien; ils passent les après-dînées dans les bois, contant aux rochers leur martyre, et ils rentrent dans les galeries de leurs maisons, où se voient toutes sortes de peintures. ils rencontrent à l'improviste sur le bord de la mer des princesses infortunées, étendues et comme sans vie, qui sortent du naufrage en habits magnifiques et qui ne rouvrent languissamment les yeux que pour leur donner de l'amour. Des naufrages, des déserts, des descentes par mer et des ravissements : c'est donc toujours plus ou moins l'ancien roman d'Héliodore, celui de d'Urfé, le genre romanesque espagnol, celui des nouvelles de Cervantes. La nouveauté particulière à Mme de La Fayette consiste dans l'extrême finesse de l'analyse; les sentiments tendres y sont démêles dans toute leur subtilité et leur confusion. Cette jalousie d'Alphonse, qui parut si invraisemblable aux contemporains, et que Segrais nous dit avoir été dépeinte sur le vrai, et en diminuant plutôt qu'en augmentant, est poursuivie avec dextérité et clarté dans les derrières nuances de son dérégleraient et comme au fond de son labyrinthe. Là se fait sentir le mérite; là l'observation, par endroits, se retrouve. Un beau passage, et qui a pu être qualifié admirable par D'Alembert, est celui où les deux amants, qui avaient été séparés peu de mois auparavant sans savoir la langue l'un de l'autre, se rencontrent inopinément et s'abordent en se parlant chacun dans la langue qui n'est pas la leur, et qu'ils ont apprise dans l'intervalle, et puis s'arrêtent tout à coup en rougissant comme d'un mutuel aveu.»
"... Cependant les Maures avaient profité des désordres du royaume de Léon ; ils avaient surpris plusieurs villes et continuaient encore à étendre leurs limites, sans avoir néanmoins déclaré la guerre. Don Garcie, poussé par son ambition naturelle et se trouvant fortifié par la valeur de Consalve, résolut d'entrer dans leur pays et de reprendre tout ce qu'ils avaient usurpé. Don Ordogno, son frère, se joignit à lui, et ils mirent une puissante armée en campagne. Consalve en fut le général. Il fit en peu de temps des progrès considérables, il prit des villes, il eut l'avantage en plusieurs combats, et enfin il assiégea Talavera, qui était une place importante par sa situation et par sa grandeur. Abdérame, roi de Cordoue, successeur d'Abdallah, vint lui-même s'opposer au roi de Léon. Il s'approcha de Talavera dans l'espérance de faire lever le siège. Don Garcie, avec le prince Ordogno son frère, prit la plus grande partie de l'armée pour l'aller combattre, et laissa Consalve avec le reste pour continuer le siège. Consalve s'en chargea avec joie ; et l'assurance d'y réussir ou d'y trouver la mort ne lui laissa pas appréhender de mauvais succès. Il n'avait point eu de nouvelles de Zaïde, il était plus tourmenté que jamais de la passion qu'il avait pour elle et du désir de la revoir, de sorte qu'au travers de sa fortune et de sa gloire il n'envisageait qu'une vie si désagréable, qu'il courait avec ardeur aux occasions de la finir. Le roi marcha contre Abdérame ; il le trouva campé dans un poste avantageux, à une journée de Talavera.
Quelques jours se passèrent sans qu'ils en vinssent aux mains ; les Maures ne voulaient pas sortir de leur poste, et don Garcie se trouvait trop faible pour les y attaquer. Cependant Consalve jugea qu'il était impossible de continuer le siège, parce que, n'ayant pas assez de troupes pour enfermer toute la place, il y entrait du secours toutes les nuits et que ce secours pouvait enfin mettre les assiégés en état de faire des sorties qu'il ne pourrait soutenir. Comme il avait déjà fait une brèche considérable, il résolut de hasarder un assaut général et d'essayer, par une action si hardie, de réussir dans une chose qu'il croyait désespérée. Il exécuta ce qu'il avait résolu, et, après avoir donné tous les ordres nécessaires, il attaqua la ville avant que le jour parût, mais avec tant de courage et d'espérance de vaincre qu'il inspira ces mêmes sentiments aux soldats. Ils firent des actions incroyables, et enfin, en moins de deux heures, Consalve se rendit maître de Talavera. Il fit tous ses efforts pour empêcher le pillage, mais il était impossible d'arrêter des troupes qui avaient été animées par l'espérance du butin.
Comme il allait lui-même par la ville pour prévenir le désordre, il vit un homme qui se défendait seul contre plusieurs autres avec une valeur admirable et qui, en se retirant, tâchait de gagner un château qui ne s'était pas encore rendu. Ceux qui attaquaient cet homme, le pressaient si vivement qu'ils l'allaient percer de plusieurs coups si Consalve ne se fût jeté au milieu d'eux, et ne leur eût commandé de se retirer. Il leur fit honte de l'action qu'ils voulaient faire, ils s'en excusèrent en lui disant que celui qu'ils attaquaient était le prince Zuléma, qui venait de tuer un nombre infini des leurs et qui voulait se jeter dans le château. Ce nom était trop célèbre par la grandeur de ce prince et par le commandement général qu'il avait dans les armées des Maures, pour n'être pas connu de Consalve.
Il s'avança vers lui, et ce vaillant homme, voyant bien qu'il ne pouvait plus se défendre, rendit son épée avec un air si noble et si hardi que Consalve ne douta point qu'il ne fût digne de la grande réputation qu'il avait acquise. Il le donna en garde à des officiers qui le suivaient et marcha vers ce château pour le sommer de se rendre. Il promit la vie à ceux qui étaient dedans, on lui en ouvrit les portes, il apprit, en y entrant, qu'il y avait beaucoup de dames arabes qui s'y étaient retirées. On le conduisit au lieu où elles étaient ; il entra dans un appartement superbe orné avec toute la politesse des Maures. Plusieurs dames, à demi couchées sur des carreaux, ne faisaient voir que par un triste silence la douleur qu'elles avaient d'être captives. Elles étaient un peu éloignées, comme par respect, d'une personne magnifiquement habillée et assise sur un lit de repos. Sa tête était appuyée sur une de ses mains ; de l'autre elle essuyait ses larmes et cachait son visage, comme si elle eût voulu retarder de quelques moments la vue de ses ennemis. Enfin, au bruit que firent ce dont Consalve était suivi, elle se tourna et lui fit reconnaître Zaïde, mais Zaïde plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, malgré la douleur et le trouble qui paraissaient sur son visage. Consalve fut si surpris qu'il parut plus troublé que Zaïde, et Zaïde sembla se rassurer et perdre une partie de ses craintes à la vue de Consalve.
Ils s'avancèrent l'un vers l'autre et, prenant tous deux la parole, Consalve se servit de la langue grecque pour lui demander pardon de paraître donnant elle comme un ennemi, dans le même moment que Zaïde lui disait en espagnol qu'elle ne craignait plus les malheurs qu'elle avait appréhendés et que ce ne serait pas le premier péril dont il l'aurait garantie. Ils furent si étonnés de s'entendre parler leurs langues, et leur surprise leur jeta si vivement dans l'esprit les raisons qui les avaient obligés de les apprendre, qu'ils en rougirent et demeurèrent quelque temps dans un profond silence.
Enfin, Consalve reprit la parole et, continuant de se servir de la langue grecque : Je ne sais, madame, lui dit-il, si j'ai eu raison de souhaiter, autant que je l'ai fait, que vous me pussiez entendre ; peut-être n'en serai-je pas moins malheureux, mais, quoi qu'il puisse m'arriver, puisque j'ai la joie de vous revoir après en avoir tant de fois perdu l'espérance, je ne me plaindrai plus de ma fortune.
Zaïde parut embarrassée de ce que lui disait Consalve, et le regardant avec ses beaux yeux où il ne paraissait néanmoins que de la tristesse : Je ne sais encore, lui dit-elle en sa langue, ne voulant plus lui parler espagnol, si mon père a pu échapper des périls où il s'est exposé dans cette journée, vous me permettrez bien de ne vous pas répondre pour demander de ses nouvelles. Consalve appela ceux qui se trouvèrent proche de lui pour s'enquérir de ce qu'elle voulait savoir. Il eut le plaisir d'apprendre que ce prince à qui il venait de sauver la vie, était le père de Zaïde, et elle parut avoir beaucoup de joie de savoir par quel bonheur son père avait été garanti de la mort. Ensuite Consalve fut obligé de faire des civilités à toutes les autres dames qui étaient dans le château. Il fut fort surpris d'y trouver don Olmond, dont on n'avait point eu de nouvelles depuis qu'il était parti de Léon pour le chercher.
Après avoir satisfait à ce qu'il devait à un ami si fidèle, il revint dans le lieu où était Zaïde. Comme il commençait à lui parler, on le vint avertir que le désordre était si grand dans la ville, que sa présence seule pouvait l'arrêter. il fut contraint d'aller où son devoir l'appelait. Il donna tous les ordres qu'il jugea nécessaires pour apaiser le tumulte que faisaient naître l'avarice des soldats et la terreur des habitants ; ensuite il dépêcha un courrier au roi pour lui donner avis de la prise de la ville et revint avec impatience auprès de Zaïde.
Toutes les dames qui étaient auprès d'elle, s'éloignèrent par hasard, il voulut profiter des moments où il pouvait l'entretenir, mais, comme il avait dessein de lui parler de sa passion, il sentit un trouble extraordinaire et il connut bien que ce n'était pas toujours assez de pouvoir être entendu pour se déterminer à se vouloir faire entendre. Il craignit néanmoins de perdre une occasion qu'il avait tant souhaitée, et, après avoir admiré quelque temps la bizarrerie de leur aventure, d'avoir été si longtemps ensemble sans se connaître et sans se parler :
− Nous sommes bien éloignés, dit Zaïde, de retomber dans le même embarras, puisque j'entends la langue espagnole et que vous entendez la mienne.
− Je m'étais trouvé si malheureux de ne la pas entendre, répondit Consalve, que je, l'ai apprise sans espérer même qu'elle pût me servir à réparer ce que j'avais souffert de ne la pas savoir.
− Pour moi, reprit Zaïde en rougissant, j'ai appris l'espagnol, parce qu'il est difficile de n'apprendre pas la langue du pays où l'on demeure et que l'on est dans une peine continuelle lorsqu'on ne peut se faire entendre.
− Je vous entendais souvent, madame, répliqua Consalve, et quoique je ne susse pas votre langue, il y a eu bien des heures où j'aurais pu rendre un compte exact de vos sentiments, et je suis persuadé que vous voyiez encore mieux les miens que je ne voyais les vôtres.
− Je vous assure, répondit Zaïde, que je suis moins habile que vous ne pensez et que, tout ce que j'ai pu juger, c est que vous aviez quelquefois beaucoup de tristesse.
− Je vous en disais la cause, répondit Consalve, et je crois que, sans savoir ce que signifiaient mes paroles, vous n'avez pas laissé de m'entendre. Ne vous en défendez point, madame ; vous m'avez répondu, sans me parler, avec une sévérité dont vous devez être satisfaite, mais, puisque j'ai pu connaître votre indifférence, comment n'auriez-vous pas connu des sentiments qui paraissent plus aisément que l'indifférence et qui s'expliquent souvent malgré nous ? J'avoue néanmoins que j'ai vu quelquefois vos beaux yeux tournés sur moi d'une manière qui m'aurait donné de la joie, si je n'avais cru devoir ce qu'ils avaient de favorable à la ressemblance de quelque autre.
− Je ne vous désavouerai pas, reprit Zaïde, que je n'aie trouvé que vous ressembliez à quelqu'un, mais vous n'auriez pas sujet de vous plaindre, si je vous disais que j'ai souvent souhaité que vous puissiez être celui à qui vous ressemblez.
− Je ne sais, madame, répondit Consalve, si ce que vous me dites m'est favorable, et je ne puis vous en rendre grâce si vous ne me l'expliquez mieux.
− Je vous en ai trop dit pour vous l'expliquer, répliqua Zaïde, et mes dernières paroles m'engagent à vous en faire un secret.
− Je suis bien destiné au malheur de ne vous pas entendre, reprit Consalve, puisque, même en me parlant espagnol, je ne sais ce que vous me dites. Mais, madame, avez-vous la cruauté d'ajouter encore des incertitudes à celles où je vis depuis si longtemps ? Il faut que je meure à vos pieds, ou que vous me disiez qui vous avez pleure dans la solitude d'Alphonse et qui est celui à qui mon malheur ou mon bonheur veulent que je ressemble. Ma curiosité ne s'arrêterait pas sans doute à ces deux choses, si le respect que j'ai pour vous ne la retenait ; mais j'attendrai que le temps et votre bonté me permettent de vous en demander davantage.
Comme Zaïde allait répondre, les dames arabes qui étaient dans le château demandèrent à parler à Consalve, et il vint ensuite tant d'autres personnes, qu'avec le soin qu'apporta cette princesse à éviter de l'entretenir en particulier, il lui fut possible d'en retrouver l'occasion.
Il se renferma seul pour s'abandonner au plaisir d'avoir retrouvé Zaïde et de l'avoir retrouvée dans un lieu dont il était le maître ; il croyait même avoir remarqué dans ses yeux quelque joie de le revoir ; il était bien aise qu'elle eût appris l'espagnol, et elle s'était servie de cette langue avec tant de promptitude, sitôt qu'elle l'avait vu, qu'il se flattait d'avoir eu quelque part au soin qu'elle avait eu de l'apprendre. Enfin la vue de Zaïde et l'espérance de n'en être pas haï faisaient sentir à Consalve ce qu'un amant, qui n'est pas assuré d'être aimé, peut sentir de plus agréable..."

1678 - "La Princesse de Clèves"
La Princesse de Clèves, qui paraît anonymement en 1678 remporte un succès immense. Il s'agit d'une histoire sentimentale se déroule à la cour d'Henri II (à la fin du règne d'Henri II et le début du règne de François II) : Mlle de Chartres a été mariée à seize ans au prince de Clèves qui l'aime avec ferveur. Mais elle ne trouve l'amour qu'en rencontrant le duc de Nemours, et cet amour est partagé. La jeune femme résiste à sa passion, l'avoue a son mari, mais celui-ci éprouve un désespoir profond et finit par mourir. Elle n'épousera jamais le duc de Nemours et ne survivra guère à M. de Clèves.
Ce livre demeure aujourd'hui encore un joyau et un archétype du genre. Écrit dans une langue sobre et toute en litotes, ce roman se caractérise par sa concentration extrême, son organisation rigoureuse autour d'une série de symétries et sa chronologie stricte, qui adapte au roman une sorte d'unité de temps : le récit dure un an, prémisses au printemps (tome I), passion en été (tome II) et renoncement en hiver (tome III).
A quinze ans, Mlle De Chartres fait ses débuts à la cour : sa mère, qui a veillé elle-même à son éducation, a pris soin de la mettre en garde contre les dangers de la passion...
"Il parut alors à la cour une beauté qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'e1le donna de l'admíration dans un lieu où l'on était si accoutumé de voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Mme de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté; elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Mme de Chartres avait une opinion opposée; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour ; elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui en contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements ; elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une femme honnête, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance; mais elle lui faisait voir qu'elle ne pouvait conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée.
Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eût en France, et, quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Mme de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait rien qui fût digne de sa fille la voyant dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle : il fut surpris de la grande beauté de Mlle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a vu qu'à elle; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâces et de charmes.."
Le prince de Clèves s'éprend de Mlle De Chartres dès leur première rencontre, ménagée par le hasard, sans même savoir qui elle est, une scène de rencontre dans la tradition du roman précieux...
"Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine et s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise; et Mlle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné; elle se remit néanmoins, sans témoigner d'autre attention aux actions de ce prince que celle que la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. M. de Clèves la regardait avec admiration, et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien, par son air et par tout ce qui était à sa suite, qu'elle devait être de grande qualité. Sa jeunesse lui faisait croire que c'etait une fille; mais, ne lui voyant point sa mère, et l'Italien, qui ne la connaissait point, l'appelant madame, il ne savait que penser, et il la regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté : il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et, en effet, elle sortit assez promptement. M. de Clèves se consola de la perdre de vue, dans l'espérance de savoir qui elle était; mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point: il demeura si touché de sa beauté, et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions, qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires.."
Le prince de Clèves brûle d'épouser la jeune fille mais se heurte à l'opposition de son propre père. Celui-ci meurt peu après, et bravant plusieurs intrigues, le prince demande et obtient sa main. Mais, si sa fiancée éprouve pour lui estime et reconnaissance, elle ne lui témoigne aucune inclination, et il en souffre dès avant leur -mariage. Quelque temps après leur union, le duc De Nemours, le seigneur le plus brillant de son temps, revient â Paris et semble sur le point d'épouser la reine Élisabeth d'Angleterre. Survient un bal, et la rencontre entre le prince et la jeune femme, devenue Mme de Clève: c'est le coup de foudre, partagé...
"Mme de Cleves avait ouï parler de ce prince à tout le monde, comme de ce qu'il y ait de mieux fait et de plus agréable à la cour; et surtout Mme la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte, et lui en avait parlé tant de fois, qu'elle lui avait donné de la curiosité, et même de l'impatience de le voir. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver au bal et au festin royal qui se faisaient au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure; : le bal commença; et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser, et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne; mais il était aussi difficile de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration.
Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point.
"Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude ; mais, comme Mme de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. - Je crois, dit Mme la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. - Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. - Vous devinez fort bien, répondit Mme la Dauphine; et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours, à ne pas vouloir avouer que vous le connaissez sans jamais l'avoir vu."
La reine les interrompit pour faire continuer le bal : M. de Nemours prit la reine Dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté, et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours, avant qu'il allât en Flandre ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que Mme de Clèves".
La passion vient de naître de la rencontre, désormais, la suite du roman va se poursuivre essentiellement dans l'analyse des progrès de la passion dans l'âme de Mme De Clèves, en dépit de ses efforts pour rester maîtresse d'elle-même.
Cette analyse des sentiments est d'une subtilité sans équivalent, ainsi lorsque Mme de Clèves, se demandant si Nemours ne serait pas éprise de la reine Dauphine, voit naître en elle un sentiment de jalousie qui la contraint à s'avouer à elle-même l'amour qu'elle éprouve pour lui. Elle renonce alors à fermer son coeur à cet amour, "elle ne se flatta plus de l'espérance de ne le pas aimer; elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque." Mais cette attitude est impossible à tenir, ainsi lorsque Nemours dérobe son portrait...
"La reine Dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les belles personnes de la cour, pour les envoyer à la reine sa mère. Le jour qu'on achevait celui de Mme de Clèves, Mme la Dauphine vint passer l'après-dînée chez elle. M. de Nemours ne manqua pas de s'y
trouver : il ne laissait échapper aucune occasion de voir Mme de Clèves, sans laisser croire néanmoins qu'il les cherchât. Elle était si belle ce jour-là qu'il en serait devenu amoureux, quand il ne l'aurait pas été : il n'osait pourtant avoir les yeux attachés sur elle pendant qu'on la peignait, et il craignait de laisser trop voir le plaisir qu'il avait à la regarder.
Mme la Dauphine demanda à M. de Clèves un petit- portrait qu'il avait de sa femme, pour le voir auprès de celui qu'on achevait; tout le monde dit son sentiment de l'un et l'autre, et Mme de Clèves ordonna au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure de celui qu'on venait d'apporter. Le peintre, pour lui obéir, ôta le portrait de la boîte où il était, et, après y avoir travaillé, il le remit sur la table.
Il y avait longtemps que M. de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Mme de Clèves. Lorsqu'il vit celui-ci, qui était à M. de Clèves, il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé ; et il pensa que, parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre.
Mme la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Mme de Clèves, qui était debout devant elle. Mme de Clèves aperçut par un des rideaux qui n'était qu'à demi fermé, M. de Nemours, le dos contre la table, qui était au pied du lit, et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur la table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait, et elle en fut si troublée que Mme la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda ce qu'elle regardait. M. de Nemours se tourna à ces paroles ; il rencontra les yeux de Mme de Clèves, qui étaient encore attachés sur lui, et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire.
Mme de Clèves n'était pas peu embarrassée : la raison voulait qu'elle demandât son portrait; mais en le demandant publiquement c'était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle, et, en le lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à lui parler de sa passion. Enfin elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser, et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle lui pouvait faire, sans qu'il sût même qu'elle la lui faisait. M. de Nemours, qui remarquait son embarras, et qui en devinait quasi la cause, s'approcha d'elle, et lui dit tout bas : "Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez, je n'ose vous en demander davantage"; et il se retira après ces paroles et n'attendit point la réponse.
Mme la Dauphine sortit pour s'aller promener, suivie de toutes les dames, et M. de Nemours alla se renfermer chez lui, ne pouvant soutenir en public la joie d'avoir un portrait de Mme de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable; il aimait la plus aimable personne de la cour; il s'en faisait aimer malgré elle, et il voyait dans toutes ses actions cette sorte de trouble et d'embarras que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse.
Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin ; comme on trouvait la boîte où il devait être, l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé et l'on crut qu'il était tombé par hasard. M. de Clèves était affligé de cette perte, et, après qu'on eut encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait croire qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelque amant caché, à qui elle avait donné ce portrait, ou qui l'avait dérobé, et qu'un autre qu'un amant ne se serait pas contenté de la peinture sans la boîte."
L'AVEU DE Mme de CLEVES - M. de Clèves presse sa femme de revenir à la cour, une cour qu'elle a décidé de fuir pour ne plus rencontrer Nemours et succomber à nouveau. Tout concourt à devoir se livrer. Le récit s'achemine progressivement vers l'aveu par la princesse de Clèves de son amour pour le duc de Nemours. Lors de la publication du roman, on se passionna pour ou contre la nécessité de se livrer à un tel aveu. On ira jusqu'à penser, plus tard, que "la Comtesse de Tende" n'a été écrite uniquement que pour motiver l'aveu...
La scène se passe à Coulommiers, dans un pavillon...
"Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en aie eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge, et maîtresse de sa conduite, demeure exposée au milieu de la cour. - Que me faites-vous envisager, madame? s'écria M. de Clèves! je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser."
Mme de Clèves ne répondit point, et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé : "Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. - Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à un mari; mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons pour m'éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître, si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore Mme de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande mille pardons, si j'ai des sentiments qui vous déplaisent : du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que, pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu : conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez."
M. de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes, et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant : "Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne, et pardonnez si dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estíme et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femmes au monde; mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais existé. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre, elle dure encore : je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire ? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché, par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant un autre fait ce que je n'ai pu faire : j'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant; mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne pas me donner une sûreté; il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini : vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari mais, madame, achevez, et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter.
- Je vous supplie de ne me le point demander, répondit-elle; je suis résolue de ne pas vous le dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. - Ne craignez point, madame, reprit M. de Clèves ; je connais trop le monde pour ignorer que la considération d'un mari n'empêche pas que l'on ne soit amoureux de sa femme. On doit haïr ceux qui le sont, et non pas s'en plaindre; et, encore une fois, madame, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. - Vous m'en presseriez inutilement, répliqua-t-elle; j'ai de la force pour taire ce que je ne crois pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher."
Les conséquences de l'aveu sont désastreuses. M. de Clèves est trop passionnément épris de sa femme pour pouvoir dominer sa jalousie. Il fait surveiller Nemours, en qui il a deviné son rival, et un rapport malheureux lui donne à croire que sa femme lui est infidèle. Ce qui est faux. Clèves accable la jeune femme de reproches qu'elle ne mérite pas, allant jusqu'à lui reprocher de s'être confiée à lui. Il ne peut survivre à une telle situation...
"..Sitôt qu'il le vit, il jugea, par son visage et par son silence, qu'il n'avait que des choses fâcheuses à lui apprendre. Il demeura quelque temps saisi d'affliction, la tête baissée, sans pouvoir parler ; enfin, il lui fit signe de la main de se retirer :
− Allez, lui dit-il, je vois ce que vous avez à me dire, mais je n'ai pas la force de l'écouter.
− Je n'ai rien à vous apprendre, lui répondit le gentilhomme, sur quoi on puisse faire de jugement assuré.
Il est vrai que M. de Nemours a entré deux nuits de suite dans le jardin de la forêt, et qu'il a été le jour d'après à Coulommiers avec Mme de Mercoeur.
− C'est assez, répliqua M. de Clèves c'est assez, en lui faisant encore signe de se retirer, et je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement.
Le gentilhomme fut contraint de laisser son maître abandonné à son désespoir. Il n'y en a peut-être jamais eu un plus violent, et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un coeur aussi passionné que M. de Clèves, ont ressenti en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse, et la honte d'être trompé par une femme.
M. de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si grands accidents, que, dès ce moment, sa maladie parut très dangereuse. On en donna avis à Mme de Clèves ; elle vint en diligence. Quand elle arriva, il était encore plus mal, elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Il lui parut même qu'il recevait avec peine les services qu'elle lui rendait, mais enfin elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie.
D'abord qu'elle fut à Blois, où la cour était alors, M. de Nemours ne put s'empêcher d'avoir de la joie de savoir qu'elle était dans le même lieu que lui. Il essaya de la voir et alla tous les jours chez M. de Clèves, sur le prétexte de savoir de ses nouvelles, mais ce fut inutilement. Elle ne sortait point de la chambre de son mari et avait une douleur violente de l'état où elle le voyait. M. de Nemours était désespéré qu'elle fût si affligée ; il jugeait aisément combien cette affliction renouvelait l'amitié qu'elle avait pour M. de Clèves, et combien cette amitié faisait une diversion dangereuse à la passion qu'elle avait dans le coeur. Ce sentiment lui donna un chagrin mortel pendant quelque temps, mais, l'extrémité du mal de M. de Clèves lui ouvrit de nouvelles espérances. Il vit que Mme de Clèves serait peut-être en liberté de suivre son inclination, et qu'il pourrait trouver dans l'avenir une suite de bonheur[s] et de plaisirs durables. Il ne pouvait soutenir cette pensée, tant elle lui donnait de trouble et de transports, et il en éloignait son esprit par la crainte de se trouver trop malheureux, s'il venait à perdre ses espérances.
Cependant M. de Clèves était presque abandonné des médecins. Un des derniers jours de son mal, après avoir passé une nuit très fâcheuse, il dit sur le matin qu'il voulait reposer. Mme de Clèves demeura seule dans sa chambre, il lui parut qu'au lieu de reposer, il avait beaucoup d'inquiétude. Elle s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit, le visage tout couvert de larmes. M. de Clèves avait résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle, mais les soins qu'elle lui rendait, et son affliction, qui lui paraissait quelquefois véritable et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie, lui causaient des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne les put renfermer en lui-même.
− Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers eût si peu de suite ? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister ? Je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé, je l'avoue à ma honte, j'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris ? J'eusse, peut-être, ignoré toute ma vie que vous aimiez M. de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable, et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée, et dont j'ai été si cruellement trompé, ou pour vivre séparé de cette même personne, et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous ? Elle a été au-delà de ce que vous en avez vu, madame, je vous en ai caché la plus grande partie, par la crainte de vous importuner, ou de perdre quelque chose de votre estime, par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin je méritais votre coeur ; encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir, et que je ne puis plus le désirer. Adieu, madame, vous regretterez quelque jour un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimée, comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en vous témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Mais ma mort vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux ; sans qu'il vous en coûte des crimes. Qu'importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je ne serai plus, et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux.
Mme de Clèves était si éloignée de s'imaginer que son mari pût avoir des soupçons contre elle qu'elle écouta toutes ces paroles sans les comprendre, et sans avoir d'autre idée, sinon qu 'il lui reprochait son inclination pour M. de Nemours; enfin, sortant tout d'un coup de son aveuglement :
- Moi, des crimes! s'écria-t-elle; la pensée même m'en est inconnue. La vertu la plus austère ne peut inspirer d'autre conduite que celle que j'ai eue; et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin.
- Eussiez-vous souhaité, répliqua M. de Clèves, en la regardant avec dédain, que je l'eusse été des nuits que vous avez passées avec M. de Nemours? Ah! Madame, est-ce de vous dont je parle, quand je parle d'une femme qui a passé des nuits avec un homme?
- Non, Monsieur, reprit-elle; non, ce n'est pas de moi dont vous parlez. Je n'ai jamais passé ni de nuits ni de moments avec M. de Nemours. Il ne m 'a jamais vue en particulier; je ne l'ai jamais souffert, ni écouté, et j'en ferais tous les serments...
- N'en dites pas davantage, interrompit M. de Clèves; de faux serments ou un aveu me feraient peut-être une égale peine.
Mme de Clèves ne pouvait répondre; ses larmes et sa douleur lui ôtaient la parole; enfin, faisant un effort :
- Regardez-moi du moins; écoutez-moi, lui dit-elle. S 'il n'y allait que de mon intérêt, je souffrirais ces reproches; mais il y va de votre vie. Écoutez-moi, pour l'amour de vous-même : il est impossible qu'avec tant de vérité, je ne vous persuade mon innocence.
- Plût à Dieu que vous me la puissiez persuader, s'écria-t-il; mais que me pouvez-vous dire? M. de Nemours n'a-t-il pas été à Coulommiers avec sa sœur? Et n'avait-il pas passé les deux nuits précédentes avec vous dans le jardin de la forêt?
- Si c'est là mon crime, répliqua.-t-elle, il m'est aisé de me justifier. je ne vous demande point de me croire; mais croyez tous vos domestiques, et sachez si j'allai dans le jardin de la forêt la veille que M. de Nemours vint à Coulommiers, et si je n'en sortis pas le soir d'auparavant deux heures plus tôt que je n 'avais accoutumé.
Elle lui conta ensuite comme elle avait cru voir quelqu'un dans ce jardin. Elle lui avoua qu'elle avait cru que c'était M. de Nemours. Elle lui parla avec tant d'assurance, et la vérité se persuade si aisément lors même qu'elle n'est pas vraisemblable, que M. de Clèves fut presque convaincu de son innocence."
Mme de Clèves a avoué à son mari l'inclination qui la porte vers le duc de Nemours. Torturé par la jalousie, et abusé par de fausses rumeurs, le prince de Clèves en meurt. Libre désormais, la princesse décide néanmoins de se retirer du monde, non sans avoir avoué sa passion à Nemours ..
« - Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle, et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation, mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre.
Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments, et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître; néanmoins je ne saurais vous avouer, sans honte, que la certitude de n'être plus aimée de vous, comme je le suis, me paraît un si horrible malheur, que, quand je n'aurais point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferais toute ma félicité ? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur; peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre : je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre; et mes actions involontaires, ou les choses que le hasard vous a apprises, vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter.
- Ah ! Madame, reprit monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez : vous me faites trop d'injustice, et vous me faites trop voir combien vous êtes éloignée d'être prévenue en ma faveur.
- J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire; mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie, et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore; je ne ferais plus votre bonheur; je vous verrais pour une autre comme vous auriez été pour moi. J'en aurais une douleur mortelle, et je ne serais pas même assurée de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître, et que je souffris de si cruelles peines le soir que la reine me donna cette lettre de madame de Thémines, que l'on disait qui s'adressait à vous, qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux.
Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez; mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperais pas souvent. Dans cet état néanmoins, je n'aurais d'autre parti à prendre que celui de la souffrance; je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant; mais en fait-on à un mari, quand on n'a à lui reprocher que de n'avoir plus d'amour ? Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours monsieur de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre ? Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes : il faut que je demeure dans l'état où je suis, et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais.
- Hé ! croyez-vous le pouvoir, Madame ? s'écria monsieur de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore, et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile que vous ne pensez, Madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère, qui n'a presque point d'exemple; mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et j'espère que vous les suivrez malgré vous.
- Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves; je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de monsieur de Clèves serait faible, s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos; et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous. »
LE REFUS DE MADAME DE CLÈVES - La mort de son mari va plonger Madame de Clèves dans une douleur indicible. Cependant le temps passe et la passion reprend ses droits : lorsque Nemours ose reparaître devant elle, elle lui avoue certes son amour, mais c'est pour lui déclarer aussitôt que jamais elle ne sera à lui. Le devoir vis-à-vis de son mari certes lui impose ce choix, comment épouserait-elle celui qui a causé, fût-ce sans le vouloir, la mort du prince de Clèves? Mais d'autres sentiments, plus subtils, interviennent aussi...
« Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher; il y en a peu à qui vous ne plaisiez; mon expérience me fait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais amoureux et aimé, et je ne me tromperais pas souvent; dans cet état, néanmoins, je n'aurais d'autre parti à prendre que celui de la souffrance; je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant; mais en fait-on à un mari, quand on n'a qu'à lui reprocher de n'avoir plus d'amour? Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir M. de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre? Il est impossible, continua-t-elle, de passer pardessus des raisons si fortes : il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais.
- Hé! croyez-vous le pouvoir, madame? s'écria M. de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple ; mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et j'espère que vous les suivrez malgré vous.
- Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua Mme de Clèves; je me défie de mes forces au milieu de mes raisons; ce que je crois devoir à la mémoire de M. de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos ; et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir; mais, quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous."
M. de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les mouvements dont il était agité. Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de Mme de Clèves n'était pas insensible; et, regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par les larmes : "Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de M. de Clèves? Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre, ou pourquoi ne vous ai-je pas connu avant que d'être engagée? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible?
- Il n'y a point d'obstacle, madame, reprit M. de Nemours, vous seule vous opposez à mon bonheur : vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer.
- Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire, M. de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes; ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu; croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également, quoi que je fasse. Adieu, lui dit-elle voici une conversation qui me fait honte. Rendez-en compte à M. le vidame; j'y consens, et je vous en prie."
Après avoir longuement réfléchi, la princesse de Clèves prend sa décision irrévocable, son renoncement est définitif. Si dur qu'il lui soit de renoncer a celui qu'elle aime, elle ne peut supporter l'idée qu'un jour, peut-être, il cessera de l'aimer et qu'elle sera livrée alors aux tortures de la jalousie. Et renonçant à l'amour, elle renonce au monde ...
"Cette vue si longue et si prochaine de la mort fit paraître à Mme de Clèves les choses de cette vie de cet œil si différent dont on les voit dans la santé. La nécessité de mourir, dont elle se voyait si proche, l'accoutuma à se détacher de toutes choses, et la longueur de sa maladie lui en fit une habitude. Lorsqu'elle revint de cet état, elle trouva néanmoins que M. de Nemours n'était pas effacé de son cœur, mais elle appela à son secours, pour se défendre contre lui, toutes les raisons qu'elle croyait avoir pour ne l'épouser jamais. Il se passa un assez grand combat en elle-même. Enfin elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donnés : la pensée de la mort lui avait reproché la mémoire de M. de Clèves. Ce souvenir, qui s'accordait avec son devoir, s'imprima fortement dans son cœur. Les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissent aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées".
Sa santé, qui demeura considérablement affaiblie, lui aida à conserver ses sentiments; mais, comme elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages, elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes, ni revenir dans les lieux où était ce qu'elle avait aimé. Elle se retira, sur le prétexte de changer d'air, dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour.
A la première nouvelle qu'en eut M. de Nemours, il sentit le poids - de cette retraite, et il en vit l'importance. Il crut, dans ce moment, qu'il n'avait plus rien à espérer; la perte de ses espérances ne l'empêcha pas de mettre tout en usage pour faire revenir Mme de Clèves. Il fit écrire la reine, il fit écrire le vidame, il l'y fit aller; mais tout fut inutile. Le vidame la vit : elle ne lui dit point qu'elle eût pris des résolutions. Il jugea néanmoins qu'elle ne reviendrait jamais.
Enfin M. de Nemours y alla lui-même, sur le prétexte d'aller à des bains. Elle fut extrêmement troublée et surprise d'apprendre sa venue. Elle lui fit dire, par une personne de mérite qu'elle aimait et qu'elle avait alors auprès d'elle, qu'elle le priait de ne pas trouver étrange si elle ne s'exposait point au péril de le voir et de détruire, par sa présence, des sentiments qu'elle devait conserver ; qu'elle voulait bien qu'il sût qu'ayant trouvé que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui, les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais ; qu'elle ne pensait plus qu'à celles de l'autre vie, et qu'il ne lui restait aucun sentiment que le désir de le voir dans les mêmes dispositions où elle était.
M. de Nemours pensa expirer de douleur en présence de celle qui lui parlait. Il la pria vingt fois de retourner à Mme de Clèves, afin de faire en sorte qu'il la vît; mais cette personne lui dit que Mme de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire autre chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît, aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toute sorte d'espérances de revoir jamais une personne qu'il aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point encore, et il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de la faire changer de dessein.
Enfin, des années entières étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et sa passion. Mme de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse, et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères, et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables."
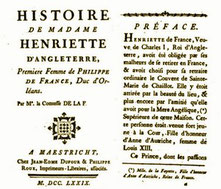
1684 -"Histoire d'Henriette d'Angleterre, Duchesse d'Orléans, 1661-1670"
"La mort de cette princesse ne me laissa ni le dessein ni le goût de continuer cette histoire, et j'écrivis seulement les circonstances de sa mort dont je fus témoin", c'est ainsi que madame de La Fayette termine son ouvrage alors qu'elle était devenue plus que la dame d'honneur de la princesse après son mariage, mais une véritable amie et avait décidé, à son instigation, de lui prêter sa plume pour écrire sa vie. "L'année 1665 le comte de Guiche fut exilé. Un jour qu'elle (Madame) me faisoit le récit de quelques circonstances assez extraordinaires de sa passion pour elle, - Ne trouvez-vous pas, me dit-elle, que, si tout ce qui m'est arrivé et les choses qui y ont relation étoit écrit, cela composeroit une jolie histoire? Vous écrivez bien, ajouta-t-elle, écrivez, je vous fournirai de bons mémoires...."
Monsieur de La Fayette, en épousant Mademoiselle de La Vergne, la fit belle-sœur de Louise de La Fayette, ce qui lui permit d'approcher la princesse Henriette d'Angleterre, fille d'Henriette de France, la veuve de Charles Ier roi d'Angleterre, qui fut exécuté en 1649. La mère et la fille, deux chemins qui se croisèrent tout en s'ignorant. Henriette de France s'était réfugiée en France en 1644, puis avait accompagné son fils Charles II à Londres en 1660, lors de sa restauration; elle revint en France en 1669 pour mourir dans son monastère de Chaillot (Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Marie de France). C'est plus tard, en 1646 que sa fille, Henriette d'Angleterre (1644-1670) quitta l'Angleterre pour la France, alors en pleine Fronde. Puis la Restauration poussa au devant de la scène Charles II, qui récupère le trône d'Angleterre, et redonne une certaine importance à Henriette d'Angleterre, sa soeur, âgée alors de seize ans, et ignorée jusque-là. En 1661, à l'âge de dix-sept ans, elle épouse son cousin Philippe Ier, duc d'Orléans (Monsieur), alliance imposée des Bourbons et des Stuarts, mais Monsieur penchait plus pour le chevalier de Lorraine. Aux alentours des années 1665-1667, la Cour de France bruisse de bien d'histoires, l'intérêt de Louis XIV pour Henriette, les jalousies d'Anne d'Autriche et de Marie-Thérèse, les choix du roi en matière de maîtresses, Louise de La Vallière puis, en 1667, la marquise de Montespan. En 1670, au retour d'une entrevue diplomatique avec Charles II visant à rapprocher les deux royaumes, Henriette mourut brusquement à 26 ans (cf. Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Anne d'Angleterre).
Dans une première partie, Madame de La Fayette nous décrit l'atmosphère de la Cour, portraits et amours du roi, puis aborde dans la seconde partie l'historique du mariage de Madame, et le moment "où le Roi connut, en la voyant de plus près, combien il avoit été injuste en ne la trouvant pas la plus belle personne du monde et ce nouvel attachement fit grand bruit"....
"L'attachement que le Roi avoit pour Madame commença bientôt à faire du bruit et à être interprété diversement. La Reine mère en eut d'abord beaucoup de chagrin ; il lui parut que Madame lui ôtoit absolument le Roi, et qu'il lui donnoit toutes les heures qui avoient accoutumé d'être pour elle. La grande jeunesse de Madame lui persuada qu'il seroit facile d'y remédier et que, lui faisant parler par l'abbé de Montaigu et par quelques personnes qui dévoient avoir quelque crédit sur son esprit, elle l'obligeroit à se tenir plus attachée à sa personne, et de n'attirer pas le Roi dans des divertissemens qui en étoient éloignés.
Madame étoit lasse de l'ennui et de la contrainte qu'elle avoit essuyée auprès de la Reine sa mère. Elle crut que la Reine sa belle-mère vouloit prendre sur elle une pareille autorité ; elle fut occupée de la joie d'avoir ramené le Roi à elle et de savoir par lui-même que la Reine mère tâchoit de l'en éloigner. Toutes ces choses la détournèrent tellement des mesures qu'on vouloit lui faire prendre, que même elle n'en garda plus aucune. Elle se lia d'une manière étroite avec la comtesse de Soissons, qui étoit alors l'objet de la jalousie de la Reine et de l'aversion de la Reine mère, et ne pensa plus qu'à plaire au Roi comme belle- sœur. Je crois qu'elle lui plut d'une autre manière ; je crois aussi qu'elle pensa qu'il ne lui plaisoit que comme un beau-frère, quoiqu'il lui plût peut-être davantage : mais enfin, comme ils étoient tous deux in- finiment aimables et tous deux nés avec des dispositions galantes, qu'ils se voyoient tous les jours, au milieu des plaisirs et des divertissemens, il parut aux yeux de tout le monde qu'ils avoient l'un pour l'autre cet agrément qui précède d'ordinaire les grandes passions.
Cela fit bientôt beaucoup de bruit à la Cour. La Reine mère fut ravie de trouver un prétexte si spécieux de bienséance et de dévotion pour s'opposer à l'attachement que le Roi avoit pour Madame. Elle n'eut pas de peine à faire entrer Monsieur dans ses sentimens ; il étoit jaloux par lui-même, et il le devenoit encore davantage par l'humeur de Madame, qu'il ne trouvoit pas aussi éloignée de la galanterie qu'il l'auroit souhaité.
L'aigreur s'augmentoit tous les jours entre la Reine mère et elle. Le Roi donnoit toutes les espérances à Madame, mais il se ménageoit néanmoins avec la Reine mère ; en sorte que, quand elle redisoit à Monsieur ce que le Roi lui avoit dit, Monsieur trouvoit assez de matière pour vouloir persuader à Madame que le Roi n'avoit pas pour elle autant de considération qu'il lui en témoignoit ; tout cela faisoit un cercle de redites et de démêlés qui ne donnoit pas un moment de repos ni aux uns ni aux autres. Cependant le Roi et Madame, sans s'expliquer entre eux de ce qu'ils sentoient l'un pour l'autre, continuèrent de vivre d'une manière qui ne laissoit douter à personne qu'il n'y eût entre eux plus que de l'amitié.
Le bruit s'en augmenta fort, et la Reine mère et Monsieur en parlèrent si fortementau Roi et à Madame, qu'ils commencèrent à ouvrir les yeux et à faire peut-être des réflexions qu'ils n'avoient point encore faites ; enfin ils résolurent de faire cesser ce grand bruit et, par quelque motif que ce pût être, ils convinrent entre eux que le Roi feroit l'amoureux de quelque personne de la Cour. Ils jetèrent les yeux s'ur celles qui paroissoient les plus propres à ce dessein, et choisirent entre autres mademoiselle de Pons, parente du maréchal d'Albret, et qui, pour être nouvellement venue de province, n'avoit pas toute l'habileté imaginable ; ils jetèrent aussi les yeux sur Chemerault, une des filles de la Reine, fort coquette, et sur La Vallière, qui étoit une fille de Madame, fort jolie, fort douce et fort naïve. La fortune de cette fille étoit médiocre ; sa mère s'étoit remariée à Saint-Remi, premier maître d'hôtel de feu M. le duc d'Orléans ; ainsi elle avoit presque toujours été à Orléans ou à Blois. Elle se trouvoit très-heureuse d'être auprès de Madame. Tout le monde la trouvoit jolie ; plusieurs jeunes gens avoient pensé à s'en faire aimer ; le comte de Guiche s'y étoit attaché plus que les autres..."
Parmi les trois personnes qui servaient ainsi de masques pour égarer la cour, se trouvait la fameuse Mademoiselle de la Vallière, le Comte de Guiche revint à Madame, et tous deux s'avancèrent d'un pas vers l'inévitable. La troisième partie, toute d'intrigues, raconte l'histoire du roi et de La Vallière, l'exil de Guiche. La quatrième partie se termine de manière extrêmement abrupte avec le récit de l’agonie d’Henriette, la douleur de Mme de la Fayette est palpable...
"M. de Condom se rapprocha et lui donna le crucifix ; elle le prit et l'embrassa avec ardeur. M. de Condom lui parloit toujours et elle lui répondoit avec le même jugement que si elle n'eût pas été malade, tenant toujours le crucifix attaché sur sa bouche; la mort seule le lui fit abandonner. Les forces lui manquèrent, elle le laissa tomber et perdit la parole et la vie quasi en même temps. Son agonie n'eut qu'un moment ; et, après deux ou trois petits mouvemens convulsifs dans la bouche, elle expira à deux heures et demie du matin, et neuf heures après avoir commencé à se trouver mal."
... Et l'ouvrage ne fut publié qu'en 1720..

Mme de Sévigné (1626-1696)
Marie de Rabutin-Chantal naquit à Paris en 1626. Orpheline à l'âge de sept ans, elle fut élevée par son oncle Christophe de Coulanges, abbé de Livry, qui lui fit donner une éducation très soignée. Elle épouse en 1644 le marquis de Sévigné, gentilhomme séduisant mais volage et dépensier, qui meurt en duel en 1651. Veuve avec deux enfants, - en 1646, elle avait mis au monde une fille, Françoise-Marguerite, puis, en 1648, un garçon -, elle renonce à se remarier, fréquente la société mondaine et les salons littéraires, en particulier l'hôtel de Rambouillet, où elle se lie d'amitié avec La Rochefoucauld, le cardinal de Retz ou encore Fouquet.
Elle vit tantôt à Paris, tantôt à Livry, tantôt aux "Rochers", près de Vitré. Le mariage de sa fille tendrement chérie lui cause un grand chagrin : cette dernière suit en 1669 son mari, le comte de Grignan, nommé lieutenant général en Provence. Dès lors, elle lui envoie de nombreuses lettres où elle lui exprime sa tendresse et la tient au courant des événements et des potins de sa vie quotidienne. Un long séjour de Mme de Grignan à Paris, trois séjours de Mme de Sévigné à Grignan, les rapprochent sans diminuer l'ardeur de cette affection maternelle à laquelle nous devons l'essentiel de la correspondance la plus riche, la plus intéressante, la plus artiste de notre littérature. La plupart des 1 500 lettres sont adressées à sa fille Mme de Grignan, mais on trouve aussi d'autres correspondants (Bussy-Rabutin, le marquis de Pomponne, Mme de La Fayette). La première mention de Mlle de La Vergne dans la correspondance de Mme de Sévigné est de 1652...
Cette oeuvre ne sera d'ailleurs jamais diffusée au XVIIe siècle, mais publiée seulement en 1726, à titre largement posthume, par sa petite fille, Madame de Simiane, qui hélas sélectionne et censure -beaucoup, corrige et surtout détruit les originaux. C'est au cours d'un de ces trois séjours à Grignan que Mme de Sévigné meurt de la petite vérole en I696....

PORTRAIT DE MADAME DE SEVIGNE PAR MADAME DE LA FAYETTE, SOUS LE NOM d'UN INCONNU...
Madame de la Fayette écrivit vers l'année 1659 un portrait de Madame de Sévigné, elle avait alors trente-trois ans...
"Tous ceux qui se mêlent de peindre les belles se tuent de les embellir pour leur plaire, et n'oseraient leur dire un seul mot de leurs défauts. Pour moi, Madame, grâce au privilège d'inconnu dont je jouis auprès de vous, je m'en vais vous peindre tout hardiment, et vous dire vos vérités bien à mon aise, sans crainte de m'attirer votre colère. Je suis au désespoir de n'en avoir que d'agréables à vous conter; car ce me serait un grand plaisir si, après vous avoir reproché mille défauts, je me voyais cet hiver aussi bien reçu de vous que mille gens qui n'ont fait toute leur vie que vous importuner de louanges.
Je ne veux point vous en accabler, ni m'amuser à vous dire que votre taille est admirable, que votre teint a une beauté et une fleur qui assurent que vous n'avez que vingt ans; que votre bouche, vos dents et vos cheveux sont incomparables. Je ne veux point vous dire toutes ces choses, votre miroir vous le dit assez : mais comme vous ne vous amusez pas à lui parler, il ne peut vous dire combien vous êtes aimable quand vous parlez ; et c'est ce que je veux vous apprendre. Sachez donc, Madame, si par hasard vous ne le savez pas, que votre esprit pare et embellit si fort votre personne, qu'il n'y en a point sur la terre d'aussi charmante, lorsque vous êtes animée dans une conversation d'où la contrainte est bannie. Tout ce que vous dites a un tel charme et vous sied si bien, que vos paroles attirent les ris et les grâces autour de vous, et le brillant de votre esprit donne un si grand éclat à votre teint et à vos yeux, que, quoi- qu'il semble que l'esprit ne dût toucher que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux; et que, quand on vous écoute, on ne voit plus qu'il manque quelque chose à la régularité de vos traits, et l'on vous cède la beauté du monde la plus achevée. Vous pouvez juger que si je vous suis inconnu, vous ne m'êtes pas inconnue; et qu'il faut que j'aie eu plus d'une fois l'honneur de vous voir et de vous entendre, pour avoir démêlé ce qui fait en vous cet agrément dont tout le monde est surpris.
Mais je veux encore vous faire voir. Madame, que je ne connais pas moins les qualités solides qui sont en vous, que je fais les agréables dont on est touché. Votre âme est grande, noble, propre à dispenser des trésors, et incapable de s'abaisser aux soins d'en amasser. Vous êtes sensible à la gloire et à l'ambition, et vous ne Têtes pas moins aux plaisirs : vous paraissez née pour eux, et il semble qu'ils soient faits pour vous; votre présence augmente les divertissements, et les divertissements augmentent votre beauté, lorsqu'ils vous environnent. Enfin la joie est l'état véritable de votre âme, et le chagrin vous est plus contraire qu'à qui que ce soit. Vous êtes naturellement tendre et passionnée; mais, à la honte de notre sexe, cette tendresse vous a été inutile, et vous l'avez renfermée dans le vôtre, en la donnant à Madame de La Fayette.
Ah! Madame, s'il y avait quelqu'un au monde d'assez heureux pour que vous ne l'eussiez pas trouvé indigne du trésor dont elle jouit, et qu'il n'eût pas tout mis en usage pour le posséder, il mériterait de souffrir seul toutes les disgrâces à quoi l'amour peut soumettre tous ceux qui vivent sous son empire. Quel bonheur d'être le maître d'un cœur comme le vôtre, dont les sentiments fussent expliqués par cet esprit galant que les dieux vous ont donné! Votre cœur, Madame, est sans doute un bien qui ne peut se mériter; jamais il n'y en eut un si généreux, si bien fait et si fidèle. Il y a des gens qui vous soupçonnent de ne pas le montrer toujours tel qu'il est; mais au contraire vous êtes si accoutumée à n'y rien sentir qui ne vous soit honorable, que même vous y laissez voir quelquefois ce que la prudence vous obligerait de cacher. Vous êtes la plus civile et la plus obligeante personne qui ait jamais été; et, par un air libre et doux qui est dans toutes vos actions, les plus simples compliments de bienséance paraissent en votre bouche des protestations d'amitié ; et tous les gens qui sortent d'auprès de vous s'en vont persuadés de votre estime et de votre bienveillance, sans qu'ils puissent se dire à eux-mêmes quelle marque vous leur avez donnée de l'une et de l'autre. Enfin, vous avez reçu des grâces du ciel qui n'ont jamais été données qu'à vous; et le monde vous est obligé de lui être venue montrer mille agréables qualités qui jusqu'ici lui avaient été inconnues. Je ne veux point m'embarquer à vous les dépeindre toutes, car je romprais le dessein que j'ai fait de ne pas vous accabler de louanges; et, de plus, Madame, pour vous en donner qui fussent
Dignes de vous, et dignes de paraître,
Il faudrait être votre amant,
Et je n'ai pas l'honneur de l'être ..."
Une singulière parodie des derniers vers de Voiture, par Sarrazin...
(Claude Lefèbvre, "Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné", 1665, Musée Carnavalet)
L'épistolière - Les lettres de Mme de Sévigné sont le plus vivant reportage sur la vie et l'histoire, au jour le jour, du dernier tiers du XVIIe siècle. Les grands événements de la cour, de la ville et de la province y sont évoqués : le procès de Fouquet, le passage du Rhin, les troubles en Bretagne, le mariage de Lauzun, la mort de Vatel, les échos mondains sur la faveur croissante de Mme de Maintenon, la disgrâce de Pomponne, l'affaire des poisons, les grandes premières théâtrales, rien ne manque a ce commentaire minutieux des petits et grands événements du royaume; les faits divers du voisinage s'y insèrent tout naturellement, comme dans une conversation vive et spontanée, le style est très imagé, la langue hardie, savoureuse, riche de trouvailles plaisantes : un incendie spectaculaire, le geste furieux d'un exalté mystique qui se donne des coups de couteau, la sottise de Mme Paul, qui, malgré son âge, épouse un benêt de vingt-cinq ans, voilà des petits faits qui piquent notre curiosité....

En 1670, "l'histoire romanesque de Mademoiselle et de M. de Lauzun" fournit un sujet digne de la littérature, "c'est le juste sujet d'une tragédie dans toutes les règles du théâtre. Nous en réglions les actes et les scènes l'autre jour : nous prenions quatre jours au lieu de vingt-quatre heures, et c'étoit une pièce parfaite. Jamais il ne s'est vu de tels changements en si peu de temps; jamais vous n'avez vu une émotion si générale; jamais vous n'avez ouï une si extraordinaire nouvelle. M. de Lauzun a joué son personnage en perfection : il a soutenu ce
malheur avec une fermeté, un courage, et pourtant une douleur mêlée d'un profond respect, qui Tout fait admirer de tout le monde. Ce qu'il a perdu est sans prix; mais les bonnes grâces du Roi, qu'il a conservées, sont sans prix aussi, et sa fortune ne paroît pas déplorée. Mademoiselle a fort bien fait aussi : elle a bien pleuré ; elle a recommencé aujourd'hui à rendre ses devoirs au Louvre, dont elle avoit reçu toutes les visites. Voilà qui est fini." (Mme de Sévigné à Coulanges, mercredi 24 décembre 1670)
L'épisode inspirera nos littérateurs tant la distance sociale entre les deux personnages est immense, la réputation aussi, on parle d'elle, on la condamne, tant dans les Réflexions de La Rochefoucauld que dans les Mémoires du cardinal de Retz. De qui s'agit, d'un personnage hors du commun en cette moitié du XVIIe siècle, la Grande Mademoiselle, Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693), la digne fille de l'éternel conspirateur, du rival de Richelieu et de Mazarin, Gaston d'Orléans, et de sa première femme, Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. C'est elle qui, le 2 juillet 1652, sauve les débris de l'armée de Condé en ouvrant les portes de Paris, et doit se retirer sur ses terres de Saint-Fargeau (de 1652 à 1667) dans la suite de la défaite des rebelles. Mais surtout, c'est encore elle qui, après avoir dédaigné tant de princes, et manqué d’épouser Louis XIV, crée un scandale quand, revenue à la Cour, elle s'éprend à quarante-deux ans du duc de Lauzun et l'épouse secrètement malgré Louis XIV et après avoir renoncé à une partie de sa fortune. La surprise est totale à Paris lorsqu'on apprend ce mariage, et c'est l'occasion pour Mme De Sévigné de se livrer à un véritable exercice de virtuosité littéraire pour en apprendre à ses cousins la nouvelle en la personne d'Emmanuel de Coulanges. Lauzun se lassera bien vite de son épouse et celle-ci entrera en dévotion pour mourir en 1693....
A Paris, ce lundi 15 décembre 1670.
"Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie : enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste ; une chose que l'on ne peut pas croire à Paris (comment la pourrait-on croire à Lyon ?) ; une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde ; une chose qui comble de joie Mme de Rohan et Mme d'Hauterive ; une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue ; une chose qui se fera dimanche, et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire ; devinez-la : je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue aux chiens? Eh bien! il faut donc vous la dire : M. de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui ? Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Mme de Coulanges dit : "Voilà qui est bien difficile à deviner; c'est Mme de La Vallière. - Point du tout, Madame. - C'est donc Mlle de Retz? - Point du tout, vous êtes bien provinciale. - Vraiment nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est Mlle Colbert. - Encore moins. - C'est assurément Mlle de Créquy. - Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire : il épouse, dimanche, au Louvre, avec la permission du Roi, Mademoiselle, Mademoiselle de..., Mademoiselle..., devinez le nom : il épouse Mademoiselle, ma foi! par ma foi! ma foi jurée! Mademoiselle, la Grande Mademoiselle; Mademoiselle, fille de feu Monsieur ; Mademoiselle, petite-fille de Henri IV; Mlle d'Eu, Mlle de Dombes, Mlle de Montpensier, Mlle d'Orléans, Mademoiselle, cousine germaine du Roi; Mademoiselle, destinée au trône; Mademoiselle, le seul parti de France qui fût digne de Monsieur.
Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer ; si enfin vous nous dites des injures : nous trouverons que vous avez raison; nous en avons fait autant que vous.
Adieu : les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non."
Mme De Sévigné assiste à une représentation d'Esther, de Racine, par les demoiselles de Saint-Cyr, un événement mondain plus encore que théâtral et toute l'importance de l'évènement tient seul fait que le roi lui ait donné publiquement quelque attention. Au fond, rien n'a changé de nos jours...
A Paris, ce lundi 219 février 1689.
Je fis ma cour l'autre jour à Saint-Cyr, plus agréablement que je n'eusse jamais pensé. Nous y allâmes samedi, Mme de Coulanges, Mme de Bagnols, l'abbé Têtu et moi. Nous trouvâmes nos places gardées. Un officier dit à Mme de Coulanges que Mme de Maintenon lui faisait garder un siège auprès d'elle : vous voyez quel honneur. "Pour vous, Madame, me dit-il, vous pouvez choisir." Je me mis avec Mme de Bagnols au second banc derrière les duchesses. Le maréchal de Bellefonds vint se mettre, par choix, à mon côté droit, et devant c'étaient Mmes d'Auvergne, de Coislin, de Sully.
Nous écoutâmes, le maréchal et moi, cette tragédie avec une attention qui fut remarquée, et de certaines louanges sourdes et bien placées, qui n'étaient peut-être pas sous les fontanges de toutes les dames. Je ne puis vous dire l'excès de l'agrément de cette pièce : c'est une chose qui n'est pas aisée a représenter, et qui ne sera jamais imitée; c'est un rapport de la musique, des vers, des chants, des personnes, si parfait et si complet, qu'on n'y souhaite rien, les filles qui font des rois et des personnages sont faites exprès: on est attentif, et on n'a point d'autre peine que celle de voir finir une si aimable pièce tout y est simple, tout y est innocent, tout y est sublime et touchant : cette fidélité de l'histoire sainte donne du respect; tous les chants convenables aux paroles, qui sont tirés des Psaumes ou de la Sagesse, et mis dans le sujet, sont d'une beauté qu'on ne soutient pas sans larmes : la mesure de l'approbation qu'on donne à cette pièce, c'est celle du goût et de l'attention.
J'en fus charmée, et le maréchal aussi, qui sortit de la place, pour aller dire au Roi combien il était content, et qu'il était auprès d'une dame qui était bien digne d'avoir vu Esther. Le Roi vint vers nos places, et après avoir tourné, il s'adressa à moi, et me dit : "Madame, je suis assuré que vous avez été contente."
Moi, sans m'étonner, je répondis : "Sire, je suis charmée, ce que je sens est au-dessus des paroles." Le Roi me dit : "Racine a bien de l'esprit". Je lui dis: "« Sire, il en a beaucoup; mais en vérité ces jeunes personnes en ont beaucoup aussi : elles entrent dans le sujet comme si elles n'avaient jamais fait autre chose." Il me dit : "Ah! pour cela, il est vrai." Et puis Sa Majesté s'en alla, et me laissa l'objet de l'envie : comme il n'y avait quasi que moi de nouvelle venue, il eut quelque plaisir de voir mes sincères admirations sans bruit et sans éclat. M. le prince, Mme la princesse me vinrent dire un mot; Mme de Maintenon, un éclair : elle s'en allait avec le Roi; je répondis à tout, car j'étais en fortune.."

L'inquiétude maternelle - Ces lettres sont aussi des lettres d'amour. Mme de Sévigné exprime avec une ardeur, une impatience et une exigence extrêmes son amour exclusif pour une fille dont elle ne put jamais se résoudre à être séparée.
Le 6 août 1670, Mme de Sévigné écrit au sieur de Grignan, son gendre : "Est-ce qu'en vérité je ne vous ai pas donné la plus jolie femme du monde? Peut-on être plus honnête, plus régulière? Peut-on vous aimer plus tendrement? Peut-on avoir des sentiments plus chrétiens? Peut-on souhaiter plus passionnément d'être avec vous? Et peut-on avoir plus d'attachement à tous ses devoirs? Cela est assez ridicule, que je dise tant de bien de ma tille; mais c'est que j'admire sa conduite comme les autres, et d'autant plus que je la vois de plus près; et qu'à vous dire vrai, quelque bonne opinion que j'eusse d'elle sur les choses principales, je ne croyais point du tout qu'elle dût être exacte sur toutes les autres au point qu'elle l'est. Je vous assure que le monde aussi lui rend bien justice, et qu'elle ne perd aucune des louanges qui lui sont dues...". Mme de Grignan a quitté sa mère le 4 février 1671 et celle-ci lui écrit le surlendemain : "Il me semblait qu'on m'arrachait le corps et l'âme... Toutes mes pensées me faisaient mourir." Près d'un mois plus tard, les jours sont passés sans atténuer la douleur de Mme De Sévigné...
Mardi 3 mars 1671.
"Je vous assure, ma chère bonne, que je songe à vous continuellement, et je sens tous les jours ce que vous me dîtes une fois, qu'il ne fallait point appuyer sur ces pensées. Si l'on ne glissait pas dessus, on serait toujours en larmes, c'est-à-dire moi. Il n'y a lieu dans cette
maison qui ne me blesse le cœur. Toute votre chambre me tue; j'y ai fait mettre un paravent tout au milieu, pour rompre un peu la vue d'une fenêtre sur ce degré par où je vous vis monter dans le carrosse de d'Hacquevil1e, et par où je vous rappelai. Je me fais peur quand
je pense combien alors j'étais capable de me jeter par la fenêtre, car je suis folle quelquefois : ce cabinet, où je vous embrassai sans savoir ce que je faisais; ces Capucins, où j'allai entendre la messe; ces larmes qui tombaient de mes yeux à terre, comme si c'eût été de l'eau qu'on eût répandue; Sainte-Marie, Mme de la Fayette, mon retour dans cette maison, votre appartement, la nuit et le lendemain; et votre première lettre, et toutes les autres, et encore tous les jours, et tous les entretiens de ceux qui entrent dans mes sentiments: ce pauvre d'Hacqueville est le premier; je n'oublierai jamais la pitié qu'il eut de moi. Voilà donc où j'en reviens : il faut glisser sur tout cela, et se bien garder de s'abandonner à ses pensées et aux mouvements de son cœur. J'aime mieux m'occuper de la vie que vous faites présentement; cela me fait une diversion, sans m'éloigner pourtant de mon sujet et de mon objet, qui est ce qui s'appelle poétiquement l'objet aimé.
Je songe donc à vous, et je souhaite toujours de vos lettres; quand je viens d'en recevoir, j'en voudrais bien encore. J'en attends présentement, et reprendrai ma lettre, quand j'en aurai reçu. J'abuse de vous, ma chère bonne; j'ai voulu aujourd'hui me permettre cette lettre d'avance : mon cœur en avait besoin, je n'en ferai pas une coutume."
Mais voici que M. de Grignan, venu au-devant de sa femme à Pont-Saint-Esprit, sont dans l'obligation de traverser le Rhône à Avignon, mais un très mauvais temps a rendu le passage difficile. Mme De Sévigné exprime alors toutes ses craintes de voir sa fille exposée aux pires dangers, l'imagination aidant...
Mercredi.
"Ah! ma bonne, quelle peinture de l'état où vous avez été! et que je vous aurais mal tenu ma parole, si je vous avais promis de n'être point effrayée d'un si grand péril! Mais il est impossible de se représenter votre vie si proche de sa fin, sans frémir. Ce Rhône qui fait peur à tout le monde, ce pont d'Avignon où l'on a tort de passer, même après avoir pris toutes ses mesures! Un tourbillon de vent vous jette violemment sous une arche. Par quel miracle n'avez-vous pas été brisés et noyés dans un moment? Et M. de Grignan vous laisse embarquer pendant un orage; et quand vous êtes téméraire, il trouve plaisant de l'être encore plus que vous au lieu de vous faire attendre que l'orage soit passé, il veut bien vous exposer. Ah, mon Dieu! qu'il eût bien mieux été d'être timide et de vous dire que si vous n'aviez point de peur, il en avait, lui, et de ne point souffrir que vous traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu'il faisait! Que j'ai de peine à comprendre sa tendresse en cette occasion! Je ne soutiens pas cette pensée, j'en frissonne, et je m'en suis réveillée avec des sursauts dont je ne suis pas la maîtresse. Trouvez-vous toujours que le Rhône ne soit que de l'eau? De bonne foi, n'avez-vous point été effrayée d'une mort si proche et si inévitable? Mais encore serais-je un peu consolée si cela vous rendait moins hasardeuse à l'avenir, et si une aventure comme celle-là vous faisait voir les dangers comme ils sont."
Mme De Sévigné, profondément chrétienne, aborde dans cette lettre à sa fille le grand sujet des fins dernières de l'homme, mais avec ce ton qui lui est propre, , chacun a son style, écrira-t-elle, le mien n'est pas laconique ...
A Paris, mercredi 16 mars 1672.
"Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants; mais je suis encore plus dégoûtée de la mort : je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse : je suis embarquée dans la vie sans mon consentement; il faut que j'en sorte, cela m'assomme; et comment en sortirai-je? Par où? par quelle porte? quand sera-ce? en quelle disposition ? Souffrirai-je mille et mille douleurs, qui me feront mourir désespérée? Aurai-je un transport au cerveau? Mourrai-je d'un accident? Comment serai-je avec Dieu ? Qu'aurai-je à lui présenter? La crainte, la nécessité feront-elles mon retour vers lui? N'aurai-je aucun autre sentiment que celui de la peur ? Que puis-je espérer? suis-je digne du paradis? suis-je digne de l'enfer? Quelle alternative! Quel embarras! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude ; mais rien n'est si naturel, et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ces pensées, et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène, que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement. Point du tout; mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice : cela m'aurait ôté bien des ennuis, et m'aurait donné le Ciel bien sûrement et bien aisément."
Aucune réserve d'amour-propre ou de dignité maternelle, aucune fausse pudeur n'atténuent le ton de ces lettres ou s'affirme une sensibilité ardente, qui inspirera les pages consacrées a la mort de Turenne et à celle du jeune duc de Longueville. Un siècle avant "la Nouvelle Héloïse" de Rousseau, les lettres adressées à Mme de Grignan sont déjà, par l'expression et le contenu, les confessions d'une âme affinée par la sensibilité, la délicatesse et l'humour....
"A Madame de Grignan. A Paris, mercredi 27 septembre 1679.
Je suis venue ici un jour ou deux, avec le bon abbé, pour mille petites affaires. Ah, mon Dieu!
ma très-aimable, quel souvenir que le jour de votre départ! J'en solennise souvent la mémoire; je ne puis encore du tout en soutenir la pensée; on dit qu'il faut la chasser, elle revient toujours. Il y a justement aujourd'hui quinze jours, ma chère enfant, que je vous voyais et vous embrassais encore : il me semble que je ne pourrai jamais avoir le courage de passer un mois, et deux mois, et trois mois. Ah! ma fille, c'est une éternité! J'ai des bouffées et des heures de tendresse que je ne puis contenir. Quelle possession vous avez prise de mon cœur, et quelle "trace" vous avez faite "dans la tête". Vous avez raison d'en être bien persuadée; vous ne sauriez aller trop loin; ne craignez point de passer le but; allez, allez, portez vos idées où vous voudrez, elles n'iront pas au delà; et pour vous, ma fille, ah! ne croyez point que j'aie pour remède à ma tendresse la pensée de n'être pas aimée de vous : non, non, je crois que vous m'aimez, je m'abandonne sur ce pied-là, et j'y compte sûrement. Vous me dites que votre cœur est comme je le puis souhaiter, et comme je ne le crois pas : défaites-vous de cette pensée; il est comme je le souhaite, et comme je le crois.
Voilà qui est dit, je n'en parlerai plus; je vous conjure de vous en tenir là, et de croire vous-même qu'un mot, un seul mot sera toujours capable de me remettre cette vérité devant les yeux, qui est toujours dans le fond de mon cœur, et que vous y trouverez quand vous voudrez m'ôter les illusions et les fantômes qui ne font que passer; mais je vous l'ai dit une fois, ma fille, ils me font peur et me font transir, tout fantômes qu'ils sont : ôtez-les-moi donc, il vous est aisé; et vous y trouverez toujours, je dis toujours, le même cœur persuadé du vôtre, ce cœur qui vous aime uniquement, et que vous appelez votre bien avec justice, puisqu'il ne peut vous manquer. Finissons ce chapitre, qui ne finirait pas naturellement, la source étant inépuisable, et parlons, ma chère enfant, de toutes les fatigues infinies de votre voyage.
Pourquoi prendre la route de Bourgogne, puisqu'elle est si cruelle? C'est la diligence, je comprends bien cela. Enfin, vous voilà arrivée à Grignan. J'ai reçu toutes vos lettres aimables de Chagny, de Châlons, du bateau, de Lyon; j'ai tout reçu à la fois. Je comptais fort juste: je vous vis arriver vendredi à Lyon; je n'avais pas vu M. de Gordes, ni la friponnerie de vous attacher à un grand bateau pour vous faire aller doucement, et épargner les chevaux; mais j'avais vu tous les compliments de Châlons; j'avais vu le beau temps qui vous a accompagnée jusque-là, le soleil et la lune faisant leur devoir à l'envi; j'avais vu votre chambre chez Mme de Rochebonne, mais je ne savais pas qu'elle eût une si belle vue. Je ne sais pas bien si vous êtes partis le dimanche ou le lundi; mais je sais que très assurément vous étiez hier au soir à Grignan, car je compte sur l'honnêteté du Rhône. Vous voilà donc, ma chère enfant, dans votre château : comment vous y portez-vous? Le temps est un peu changé ici depuis quatre jours; la bise vous a-t-elle reçue? vous reposez-vous? Il faut un peu rapaiser votre sang, qui a été terriblement ému pendant le voyage, et c'est pour cela que le repos vous est absolument nécessaire. Pour moi, je ne veux qu'une feuille de votre écriture, aimant mieux prendre sur moi-même, car je préfère votre santé à toutes choses, à ma propre satisfaction, qui ne peut être solide que quand vous vous porterez bien."
Cette femme qui n'écrivit que des lettres intimes est un des plus grands écrivains classiques : non seulement elle parle une langue aisée, souple et précise par le vocabulaire et la syntaxe, mais encore elle a un sens inné de la composition narrative qui suscite la curiosité et tient l'attention en éveil, le don de l'humour, quand elle présente sous forme de devinette le rhumatisme qui la torture, ou se peint en piteux appareil sous la douche thermale de Vichy; elle sait également saisir et traduire le pittoresque d'un soleil couchant admiré aux "Rochers", les magnifiques muscats et figues de Grignan, les couleurs vives des feuillages d'automne : "Je suis venue ici achever les beaux jours, et dire adieu aux feuilles: elles sont encore toutes aux arbres; elles n'ont fait que changer de couleur: au lieu d'être vertes, elles sont aurore, et de tant de sortes d'aurore que cela compose un brocart d'or riche et magnifique... "(A Livry, 3 novembre 1677)
Guilleragues (1628-1685)
Gabriel-Joseph de La Vergne, vicomte de Guilleragues (1628-1685) et premier président de la Cour des Aides de Bordeaux, familier des salons où paraissaient Mmes de Sévigné et de La Fayette. Il serait connu comme l'auteur d'une supercherie littéraire très réussie, les Lettres d'une religieuse portugaise. En 1669 avait été en effet publié par ses soins un petit livre anonyme intitulé "Lettres portugaises" traduites en français et regroupant cinq lettres d'amour adressées, d'après un avis du libraire, par une religieuse portugaise depuis son couvent à un officier de marine français qui l'aurait séduite puis abandonnée. Le succès est grand (20 éditions au XVIIe siècle) et le public y croit, tout le XVIIIe siècle en parle, tant l'analyse de l'abandon et de la rupture amoureuse est finement retranscrit, au point que le Portugal a longtemps revendiqué cette oeuvre. Mais très vite, le bruit court que peut-être le traducteur, Guilleragues, aurait présenté comme des lettres authentiques les produits de son imagination. On découvre vers 1840 qu'une certaine Maria Ana Alcoforado a vécu à Beja de 1640 à 1723 et prit le voile vers ses douze ans et que le chevalier à qui ces lettres étaient écrites était le comte de Chamilly, dit alors le comte de Saint- Léger. Au fond il importe peu, le texte est singulier quant à son extrême concision...

1669 - "Lettres d'une religieuse portugaise"
Première lettre...
« Considère mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah ! malheureux, tu as été trahi, et tu m'as trahie par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisirs ne te cause présentement qu'un mortel désespoir, qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. Quoi! cette absence, à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ces yeux dans lesquels je voyais tant d'amour, et qui me faisaient connaître des mouvements qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toutes choses, et qui enfin me suffisaient? Hélas! les miens sont privés de la seule lumière qui les animait, il ne leur reste que des larmes, et je ne les ai employés à aucun usage qu'à pleurer sans cesse, depuis que j'appris que vous étiez enfin résolu à un éloignement qui m'est si insupportable, qu'il me fera mourir en peu de temps.
Cependant il me semble que j'ai quelque attachement pour des malheurs dont vous êtes la seule cause: je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vu, et je sens quelque plaisir en vous la sacrifiant. J'envoie mille fois le jour mes soupirs vers vous, ils vous cherchent en tous lieux, et ils ne me rapportent, pour toute récompense de tant d'inquiétudes, qu'un avertissement trop sincère que me donne ma mauvaise fortune, qui a la cruauté de ne souffrir pas que je me flatte, et qui me dit à tous moments: cesse, cesse, Mariane infortunée, de te consumer vainement, et de chercher un amant que tu ne verras jamais; qui a passé les mers pour te fuir, qui est en France au milieu des plaisirs, qui ne pense pas un seul moment à tes douleurs, et qui te dispense de tous ces transports, desquels il ne te sait aucun gré.
Mais non, je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous, et je suis trop intéressée à vous justifier: je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oubliée. Ne suis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne me plus souvenir de tous les soins que vous avez pris de me témoigner de l'amour? J'ai été si charmée de tous ces soins, que je serais bien ingrate si je ne vous aimais avec les mêmes emportements que ma passion me donnait, quand je jouissais des témoignages de la vôtre. Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels? et faut-il que, contre leur nature, ils ne servent qu'à tyranniser mon coeur?
Hélas! votre dernière lettre le réduisit en un étrange état: il eut des mouvements si sensibles qu'il fit, ce semble, des efforts pour se séparer de moi et pour vous aller trouver; je fus si accablée de toutes ces émotions violentes, que je demeurai plus de trois heures abandonnée de tous mes sens: je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous, puisque je ne puis la conserver pour vous; je revis enfin, malgré moi, la lumière, je me flattais de sentir que je mourais d'amour; et d'ailleurs j'étais bien aise de n'être plus exposée à voir mon coeur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents, j'ai eu beaucoup de différentes indispositions: mais, puis-je jamais être sans maux, tant que je ne vous verrai pas? Je les supporte cependant sans murmurer, puisqu'ils viennent de vous.
Quoi? est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé? Mais il n'importe, je suis résolue à vous adorer toute ma vie, et à ne voir jamais personne; et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne? Vous trouverez, peut-être, plus de beauté (vous m'avez pourtant dit, autrefois, que j'étais assez belle), mais vous ne trouverez jamais tant d'amour, et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles, et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier, et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendriez passer quelque temps avec moi.
Hélas! pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrais pas en Portugal l'effet de vos promesses: j'irais, sans garder aucune mesure, vous chercher, vous suivre, et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être, je ne veux point nourrir une espérance qui me donnerait assurément quelque plaisir, et je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. J'avoue cependant que l'occasion que mon frère m'a donnée de vous écrire a surpris en moi quelques mouvements de joie, et qu'elle a suspendu pour un moment le désespoir où je suis. Je vous conjure de me dire pourquoi vous vous êtes attaché à m'enchanter comme vous avez fait, puisque vous saviez bien que vous deviez m'abandonner? Et pourquoi avez-vous été si acharné à me rendre malheureuse? que ne me laissiez-vous en repos dans mon cloître? vous avais-je fait quelque injure?
Mais je vous demande pardon: je ne vous impute rien; je ne suis pas en état de penser à ma vengeance, et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant, il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre; il ne saurait séparer nos coeurs; l'amour, qui est plus puissant que lui, les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne, écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez quelque soin de m'apprendre l'état de votre coeur et de votre fortune; surtout venez me voir.
Adieu, je ne puis quitter ce papier, il tombera entre vos mains, je voudrais bien avoir le mesme bonheur: Hélas! insensée que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu, je n'en puis plus. Adieu, aymez-moy toujours; et faites-moy soufirir encore plus de maux."
La quatrième lettre nous indique que le lieutenant de l'officier vient enfin de se manifester, justifiant l'absence par une tempête qui les "a obligé de relascher au royaume d'Algaruë". Dès lors le ton semble changer ...
"je crains que vous n'ayez beaucoup souffert sur la mer, et cette appréhension m'a tellement occupée, que je n'ay plus pensé à tous mes maux. Estes-vous bien persuadé que vostre Lieutenant prenne plus de part que moy à tout ce qui vous arrive?"
Mais très rapidement le constat s'impose à nouveau...
"Pourquoi en est-il mieux informé, et enfin pourquoi ne m'avez-vous point écrit? Je suis bien malheureuse, si vous n'en avez trouvé
aucune occasion depuis vostre départ! et je le suis bien davantage, si vous en avez trouvé sans m'écrire; vostre injustice et vostre ingratitude sont extrêmes: mais je serois au désespoir si elles vous attiroient quelque malheur..."
Le dialogue reprend avec l'absent, les joies qu'il a suscitées, parfois surprenantes, les mouvements et espoirs qu'elle a décelés en elle, puis la soudaine incompréhension qui suit le silence, brutal ...
"Qu'on a de peine à se résoudre à soupçonner longtemps la bonne foi de ceux qu'on aime! je say bien que la moindre excuse vous suffit, et sans que vous preniez le soin de m'en faire, l'amour que j'ay pour vous, vous sert si fidèlement, que je ne puis consentir à vous trouver coupable, que pour jouir du sensible plaisir de vous justifier moy-mesme. Vous m'avez consommée par vos assiduités, vous m'avez enflamée par vos transports, vous m'avez charmée par vos complaisances, vous m'avez asseurée par vos sermens, mon inclination violente m'a séduite, et les suites de ces commencements si agréables et si heureux, ne sont que des larmes, que des soupirs, et qu'une mort funeste, sans que je puisse y porter aucun remède.
Il est vrai que j'ay eu des plaisirs bien surprenans en vous aimant: mais ils me coûtent d'estranges douleurs, et tous les mouvemens, que vous me causez sont extrêmes. Si j'avois résisté avec opiniâtreté à vostre amour, si je vous avois donné quelque sujet de chagrin, et de jalousie, pour vous enflâmer davantage, si vous aviez remarqué quelque ménagement artificieux dans ma conduite, si j'avois enfin voulu opposer ma raison à l'inclination naturelle que j'ay pour vous, dont vous me fistes bientost appercevoir (quoy que mes efforts eussent esté sans doute inutiles) vous pourriez me punir sévèrement, et vous servir de vostre pouvoir : mais vous me parustes aimable, avant que vous m'eussiez dit que vous m'aimiez, vous me témoignastes une grande Passion, j'en fus ravie, et je m'abandonnay à vous aimer éperdûement.
Vous n'estiez point aveuglé comme moy, pourquoy avez-vous donc souffert que je devinsse en l'estat où je me trouve ? Qu'est-ce que vous vouliez faire de tous mes emportements, qui ne pouvoient vous estre que très-importuns ? Vous sçaviez bien que vous ne seriez pas toujours en Portugal, et pourquoy m'y avez-vous voulu choisir pour me rendre si malheureuse ? Vous eussiez trouvé sans doute en ce pays quelque femme qui eust été plus belle, avec laquelle vous eussiez eu autant de plaisirs, puisque vous n'en cherchiez que de grossiers, qui vous eût fidèlement aimé aussi longtemps qu'elle vous eut veu, que le temps eust pu consoler de vostre absence, et que vous auriez pu quitter sans perfidie et sans cruauté : ce procédé est bien plus d'un Tyran, attaché à persécuter, que d'un Amant, qui ne doit penser qu'à plaire ?
Hélas ! Pourquoy exercez-vous tant de rigueur sur un cœur qui est à vous ? Je say bien que vous estes aussi facile à vous laisser persuader contre moy, que je l'ay esté à me laisser persuader en vostre faveur; j'aurois résisté, sans avoir besoin de tout mon amour, et sans m'appercevoir que j'eusse rien fait d'extraordinaire, à de plus grandes raisons, que ne peuvent estre celles, qui vous ont obligé à me quitter : elles m'eussent paru bien faibles, et il n'y en a point, qui eussent jamais pu m'arracher d'auprès de vous : mais vous avez voulu profiter des prétextes, que vous avez trouvés de retourner en France..."
Enfin, la cinquième et dernière lettre, la plus surprenante de toutes, celle de la rupture définitive, de la prise de conscience, non par une Religieuse, mais par une jeune femme au destin singulier, enfermée trop tôt, et qui aura tout juste eu le temps d'entrevoir et de faire l'expérience du monde extérieur tel qu'il est à travers l'amour d'un homme...
"... j'estois jeune, j'estois crédule, on m'avoit enfermée dans ce Couvent depuis mon enfance, je n'avois veu que des gens désagréables, je n'avois jamais entendu les louanges que vous me donniez incessamment; il me sembloit que je vous devois les charmes et la beauté que vous me trouviez, et dont vous me faisiez appercevoir; j'entendois dire du bien de vous, tout le monde me parloit en vostre faveur, vous faisiez tout ce qu'il falloit pour me donner de l'Amour; mais je suis, enfin, revenue de cet enchantement, vous m'avez donné de grands secours, et j 'advoue que j'en avois un extrême besoin : En vous renvoyant vos Lettres, je garderai soigneusement les deux dernières que vous m'avez écrites, et je les relirai encore plus souvent que je n'ai leu les premières, afin de ne retomber plus dans mes faiblesses....."
