- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Jean de La Fontaine (1621-1695), "Fables" (1668-1678) - Mme de La Sablière (1640-193) - François Bernier (1620-1688) - Marie-Anne Mancini (1649-1714), duchesse de Bouillon - ...
Last update 10/10/2021

"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi
Me fasse peur ni me soucie?
Un boeuf est plus puissant que toi :
Je le mène à ma fantaisie."
La poésie, écrira La Fontaine, doit nous laisser "dans les plus beaux sujets quelque chose à penser". Quelque chose à penser? De l'œuvre de La Fontaine, on n'a retenu que les" Fables", le Monde n'a retenu que ses Fables, mais des Fables uniques en leur genre et de plus en plus reléguées dans quelque coin obscur de notre culture, et, secondairement, les Contes, où se donne toute sa verve libertine.
"La fable n'était chez La Fontaine que la forme préférée d'un génie bien plus vaste que ce genre de poésie", écrira Sainte-Beuve. La nature humaine y est exposée telle qu'elle est observée, et toujours observable, condensée dans sa forme en une minuscule histoire, un chef d'oeuvre de psychologie dont la leçon de morale, au bout du compte, n'est qu'un des aspects, - "la raison du plus fort est toujours la meilleure", "Apprenez que tout flatteur Vit aux dépens de celui qui j'écoute", "rien ne sert de courir, il faut partir à point", "qu'entre nos ennemis Les plus à craindre sont souvent les plus petits" -, tant certaines évocations sont inoubliables, - "Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe", "L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours".
Un La Fontaine qui a pratiqué par ailleurs tous les genres, on l'oublie souvent, le théâtre, le récit en prose, le récit de voyage sous forme épistolaire (Voyage en Limousin) et la narration romanesque (Psyché), et la poésie, tant dans le registre héroïque (Adonis) qu'élégiaque ou galant, tant dans les petits poèmes mondains de circonstance que dans les poèmes religieux, la poésie didactique (Poème du Quinquina, 1682) ou encore dans le discours en vers (Discours à Mme de La Sablière). Dans ce dernier Discours, La Fontaine conteste Descartes et la théorie des animaux-machines, "Nul sentiment, point d'âme; en elle tout est corps", et imagine par la suite une échelle continue des êtres. Non seulement, en artiste, il attribue aux bêtes un caractère en harmonie avec leur aspect physique, mais il ne décrit pas, il évoque, d'un trait suggestif, extraordinaire, - "le héron au long bec emmanché d'un long cou", " un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras", " Dame belette au long corsage" -.
Il réussit ainsi à concevoir un monde animal représentatif de la société de ces êtres humains qu'il observe depuis des décennies. Le mépris de ses sujets par le Lion-Roi, le Loup et le Renard-courtisans, les rats, grenouilles et fourmis - bourgeois des villes s'affairant pour tirer leur épingle d'un jeu truqué par avance. Car c'est bien de l'être humain dont nous parle Jean de La Fontaine, avec le même regard pessimiste que Molière ou La Bruyère, et ce pessimisme constant interroge sur notre humanité aujourd'hui comme hier...
"Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l’abrégé de ce qu’il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l’homme, il prit la qualité dominante de chaque bête : de ces pièces si différentes il composa notre espèce ; il fit cet ouvrage qu’on appelle « le petit monde ». Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu’elles nous représentent confirme les personnes d’âge avancé dans les connaissances que l’usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent. Comme ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n’en connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu’on peut ; il leur faut apprendre ce que c’est qu’un lion, un renard, ainsi du reste ; et pourquoi l’on compare quelquefois un homme à ce renard ou à ce lion. C’est à quoi les fables travaillent ; les premières notions de ces choses proviennent d’elles...." (Préface)
Quant aux paysages, La Fontaine procède de même et sait tenir dans le cadre étroit de sa fable, toute la terre, tout le ciel, mais aussi un clair ruisseau, des bois, un chemin qui monte, des sensations, toute une ébauche poétique que nous achevons par notre lecture : "A l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière Précipite ses traits dans l'humide séjour; Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière. Et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encor jour." (Les Lapins.) "J'ai passé plus avant, écrira-t-il, les arbres et les plantes Sont devenus chez moi créatures parlantes" (Contre ceux qui ont le goût difficile)...
Mais le fabuliste s'enferme lui-même dans sa propre fable, ne pouvant échapper à l'absolutisme ambiant qui impose à toute existence sa condition de vie. Les Fables sont écrites par un auteur qui connaît parfaitement son siècle et les moeurs de son siècle. Etre sociable, dans ce XVIIe siècle, mais au fond quelque soit le siècle, c'est prendre place dans un système de soumission à des lois communes, mais plus encore dans un vaste et précis ensemble de subordination des êtres humains, les uns par rapport aux autres. Selon le rang que l'on occupe, la condition de vie et le caractère vont différer : "Les obsèques de la Lionne" ou "Les animaux malades de la peste" traduisent parfaitement la comédie de l'étiquette et de la majesté à laquelle se soumettent tous les êtres humains confrontés à un pouvoir officialisé ou non, et, quelque part, aujourd'hui comme hier...
Mais ces fables sont aussi écrites au moment où Louis XIV, revendiquant sa part de la succession d'Espagne, s'empare de la Franche-Comté et se heurte à la Triple Alliance des Hollandais, Anglais et Suédois, qui lui imposent leur médiation, la fameuse Paix d'Aix-la-Chapelle, en 1668). Louis XIV va donc s'évertuer à détruire cette alliance pour isoler la Hollande, qu'il envahit en 1672. Dès 1673, Guillaume d'Orange parvient à former une nouvelle coalition qui obtint la paix de Nimègue (1678). Et l'on voit, notamment dans la dernière partie des "Fables", un La Fontaine soutien de la cause royale dont "La Ligue des Rats" est un exemple frappant...
A ne vivre que sous protection, que par dédicaces hyperboliques et flatteries sans mesure, tout le paradoxe de l'humaine nature... Au fond, plus simplement, en étant terre à terre, la morale de la fable est éminemment pratique, il s'agit de bien connaître les données naturelles de ce singulier personnage qu'est l'être humain en société et d'agir en conséquence pour survivre et s'adapter...
(Rigaud, Portrait de Jean de La Fontaine, 1690, Musée Carnavalet)

Jean de La Fontaine (1621-1695)
Né en 1621 à Château-Thierry, en Champagne, où son père exerce la charge de maître des Eaux et Forêts, charge qu'il rependra en 1652, il passe toute son enfance dans cette province, milieu rural et champêtre dont son œuvre, dit-on, porte la marque. Ni Marot, ni Rabelais, ni Horace, ni Térence ne lui enseignèrent, semble-t-il ce que lui ont appris ses longues flâneries dans la campagne de Château-Thierry et sur les coteaux de la Marne. Le poète s'est lentement formé au spectacle de la nature, il est alors sans doute le seul écrivain qui soit resté presque jusqu'à la quarantaine aussi proche de la Nature.
Il lisait beaucoup, il rêvait davantage, mais il quittait son livre, abandonnait sa rêverie pour contempler le tableau que le hasard du jour ou de la saison plaçait sous ses yeux: "C'est ainsi que ma Muse, aux bords d'une onde pure, Traduisoit en langue des Dieux Tout ce que disent sous les cieux Tant d'êtres empruntant la voix de la nature.." Passe une promeneuse matinale, "Une jeune ingénue en ce lieu se vient rendre, Et goûter la fraîcheur sur ses bords toujours verts. Son voile au gré des vents va flottant dans les airs; Sa parure est sans art; elle a l'air de bergère, Une beauté naïve, une taille légère.." En traversant le bois Pierre, La Fontaine croise un bûcheron qui lentement gravit la pente de la colline: "un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, Sous le faix du fagot, aussi bien que des ans, Gémissant et courbé, marchoit à pas pesants, Et tàchoit de gagner sa chaumine enfumée.."
Devenu avocat au Parlement après avoir été tenté par la théologie, Jean de La Fontaine épouse Marie Héricart, il a 26 ans, elle en a 14, lui apporte une belle dot mais restera une précieuse de province, loin du bon vivant qu'il est, rêveur et amateur d'aventures galantes. Jean de La Fontaine exerça, après son père, la charge de maître des eaux et forêts.
Épicurien et nonchalant, il aura la chance de trouver tout au long de sa vie des protecteurs dévoués : le surintendant Fouquet auquel il témoigne un attachement émouvant après sa disgrâce, Madame de La Sablière chez qui il passe plus de vingt ans (1672-1693) et Madame d'Hervart chez qui il meurt en 1693.
Son oeuvre est une oeuvre de maturité. Le premier recueil des Fables paraît en 1668, quelques années après la publication des Contes et Nouvelles et le second recueil paraîtra en 1678. Cependant, durant les deux dernières années de sa vie, il renoncera à la vie mondaine, reniera ses Contes, volontiers licencieux et, pour cette raison, frappé par la censure, se consacrera à la méditation, enfin s'en approchera sans être réellement convaincu. C'est dans cet état d'esprit qu'il mourra en 1695...
1657-1685 - En 1658, La Fontaine est à Paris, il a 37 ans, fréquente les salons littéraires et décide de se consacrer à la littérature. il rencontre Pélisson, Furetière, Tallemant des Réaux, admire les odes héroïques de Malherbe, s'intéresse à Voiture, se nourrit de Rabelais, de Marot, de Boccace, qu'il imitera dans ses Contes, et étudie Homère et Platon. Féru d'Antiquité - il se rangera aux côtés des Anciens lors de la querelle des Anciens et des Modernes -, il publie une comédie, l'Eunuque (1654), imitée de Térence, puis un poème héroïque, l' "Adonis "(1658) qui lui vaudra l'admiration et la protection du surintendant Fouquet, rival de Colbert et protecteur des arts. Il figurera ainsi parmi les protégés du surintendant, Mlle de Scudéry, Scarron, Corneille, Perrault, Molière. C'est ainsi qu'après avoir connu la bourgeoisie provinciale, il fait connaissance des grands seigneurs, magistrats et financiers....

Nicolas Fouquet (1615-1680), "Adonis" - Dans le cours de l'année 1657, La Fontaine est présenté au surintendant Fouquet, il a alors trente-six ans. Poète inconnu, qui vient de débarquer de Château-Thierry et se retrouve à la cour de Fouquet, La Fontaine n'a pour tout bagage qu'une comédie imitée de Térence et dont les comédiens n'ont point voulu. « Je n'ai pas, dit-il, assez de vanité pour espérer que ces fruits de ma solitude vous puissent plaire. Les plus beaux vergers du Parnasse en produisent peu qui méritent de vous être offerts. » Et Le premier ouvrage dédié à Fouquet sera le poème d'Adonis.
Fouquet, depuis sept ans, est procureur général au Parlement de Paris, depuis quatre ans surintendant des finances avec Servien, il a conquis la confiance de Mazarin, au Parlement, il désarme ou achète les adversaires du ministre, tandis que, financier inventif, il comble au jour le jour les vides que creusent dans le trésor public les dépenses de la guerre et les exactions de Mazarin lui-même. Dès lors, pour assurer son pouvoir et déjouer les retours de la fortune, il se ménage secrètement les moyens de tenter un coup d'État; il a ses diplomates et sa police. En même temps, il se fait des partisans, des amis, une cour, une clientèle. Il a su retenir auprès de lui des financiers comme La Basinière et d'Hervart, des courtisans comme La Feuillade, Créqui, Lauzun, des femmes réputées pour leur esprit ou leur beauté comme Mme du Plessis-Bellière, Mme de Sévigné, Mme d'Uxelles, Mme de Brienne. Sa seconde femme, Marie-Madeleine de Castille, beauté brune aux mains fines et à la taille svelte, lui apporte le secours de sa grâce et de son esprit. Fidèle à la tradition de Richelieu, continuée par Mazarin, il réunit des collections de tableaux, de livres, de manuscrits, d'antiques et de curiosités de toutes sortes. Il protège et pensionne des poètes, des artistes et des savants. Il sort d'une famille parlementaire et fut élevé parmi des amateurs de livres, de tableaux et de médailles. Il aime véritablement les lettres. S'il a remis à Pellisson le soin de gouverner et de rémunérer le peuple et quémandeur des écrivains, il reçoit ses pensionnés, il lit leurs vers, il protège une foule de littérateurs médiocres, mais Scarron, Benserade, Mlle de Scudéry, Quinault, Corneille ont part à ses bienfaits. Enfin, non content d'embellir sa maison de Saint-Mandé et d'y accumuler des livres rares et des œuvres d'art, il vient de commencer à Vaux la construction d'un château magnifique. Les plans en ont été signés par l'architecte Le Vau, au mois d'août 1656, et déjà les bâtiments sortent de terre; André Le Nôtre ordonne les parterres, les eaux et les bosquets; Le Brun esquisse les compositions qui décoreront les plafonds et les voûtes; à Rome, Poussin modèle les Termes qui orneront les jardins. La Fontaine retrouve ici parmi les familiers de la maison nombre de poètes qu'il avait déjà rencontrés à Paris, il goûte à la douceur de l'art de plaire qu'il affectionne particulièrement, et la pension n'est pas sans conséquence.
"Adonis" ne fut publié que onze ans plus tard à la suite des Amours de Psyché et de Cupidon. L'épître à Fouquet avait alors disparu. «Jamais , écrira La Harpe, les jardins d'Armide, ce brillant édifice de l'imagination , n'ont rien offert de plus séduisant que les lieux enchantés où le poème d'Adonis transporte le lecteur.». Ce premier poème de La Fontaine est certes une laborieuse imitation des Métamorphoses d'Ovide et encombré de préciosités, mais il y dépeint par exemple le bonheur des deux amants cachés au fond des bois, avec un talent qui est déjà le sien..
"Tout ce qui naît de doux en l'amoureux empire,
Quand d'une égale ardeur l'un pour l'autre on soupire,
Et que, de la contrainte ayant banni les lois,
On se peut assurer au silence des bois....
Jours devenus moments, moments filés de soie,
Agréables soupirs, pleurs enfants de la joie.
Vœux, serments et regards, transports, ravissements.
Mélange dont se fait le bonheur des amants.
Tout par ce couple heureux fut lors mis en usage.
Tantôt ils choisissoient l'épaisseur d'un ombrage :
Là, sous des chênes vieux où leurs chiffres gravés
Se sont avec les troncs accrus et conservés,
Mollement étendus, ils consumoient les heures.
Sans avoir pour témoins, en ces sombres demeures,
Que les chantres des bois, pour confidents qu'Amour,
Qui seul guidoit leurs pas en cet heureux séjour.
Tantôt sur des tapis d'herbe tendre et sacrée
Adonis s'endormoit auprès de Cythérée,
Dont les yeux, enivrés par des charmes puissants,
Attachoient aux héros leurs regards languissants.
Bien souvent ils chantoient les douceurs de leurs peines, ....
Souvent pour divertir leur ardeur mutuelle.
Ils dansoient aux chansons, de Nymphes entourés.
Combien de fois la lune a leurs pas éclairés
Et, couvrant de ses rais l'émail d'une prairie,
Les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie!
Combien de fois le jour a vu les antres creux
Complices des larcins de ce couple amoureux!
Mais n'entreprenons pas d'ôter le voile sombre
De ces plaisirs amis du silence et de l'ombre."
Mais un poème de six cents vers, et du genre héroïque, n'était pas un divertissement de salon, la mode est à des ouvrages plus brefs, moins soutenus, c'est le goût du surintendant et de tous ceux qui vivaient de ses faveurs. La Fontaine le suivra sans se faire prier. «On ne considère en France que ce qui plaît, écrira-t-il dans la préface de ses Fables, c'est la grande règle et pour ainsi dire la seule». La Fontaine ne fut jamais à demeure chez Fouquet et faisait de fréquents voyages à Château-Thierry pour y exercer sa charge de maître des eaux et forêts..
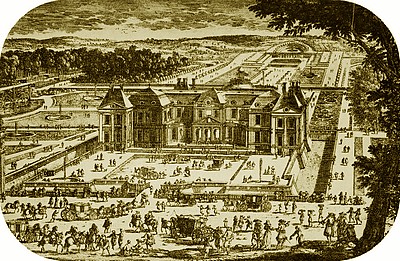
1658 - "Le Songe de Vaux"
Poète de cour, La Fontaine entreprend, à la demande de son protecteur, une description, en vers et en prose, des futures merveilles que reflèteront le château de Vaux-le-Vicomte, près de Melun, et où Fouquet construit avec orgueil son univers. Mais la décoration du château ne sera pas encore terminée quand surviendra la disgrâce de Fouquet. La Fontaine avait alors sous les yeux les estampes du graveur Israël Silvestre où toutes choses étaient représentées comme il était destiné qu'elles soient, d'où l'artifice du songe. La Fontaine implore le dieu du Sommeil et lui demande de faire apparaître en songe les merveilles de Vaux. Le dieu l'exauce, et le dormeur croit assister au débat de quatre fées, Palatiane (l'Architecture), Apellanire (la Peinture), Hortésie (le Jardinage) et Calliopée (la Poésie). Chacune ayant contribué à la beauté de Vaux, décrivent en alexandrins élégants leurs contributions, tout n'y est pas égal mais l'essentiel est là. Mais ces les Muses fastueusement drapées qui décorent une des salles de Vaux n'étaient bien plus belles «dans le silence des bois» : "Quoi? Je vous trouve ici, mes divines maîtresses!... J'avois beau vous chercher sur les bords d'un ruisseau. Mais quelle fête cause un luxe si nouveau? Pourquoi vous vêtez-vous de robes éclatantes? Muses, qu'avez-vous fait de ces jupes volantes Avec quoi, dans les bois, sans jamais vous lasser, Parmi la cour de Faune, on vous voyoit danser?..." A la même date, La Fontaine compose la comédie de "Clymène", mélange de ballet, de pastorale et de satire littéraire, qu'il débute en rendant hommage à Malherbe et à Voiture. En 1659, on donnait alors les représentations des "Précieuses ridicules" de Molière et de "L'OEdipe" de Corneille....
"Sous les lambris moussus de ce sombre palais ,
Écho ne répond point, et semble être assoupie :
La molle Oisiveté , sur le seuil accroupie ,
N'en bouge nuit et jour, et fait qu'aux environs
Jamais le chant des coqs, ni le bruit des clairons ,
Ne viennent au travail inviter la nature ;
Un ruisseau coule auprès, et forme un doux murmure.
Les simples dédiés au dieu de ce séjour
Sont les seules moissons qu’on cultive à l'entour :
De leurs fleurs en tout temps sa demeure est semée.
Il a presque toujours la paupière fermée.
Je le trouvai dormant sur un lit de pavots :
Les Songes l'entouraient sans troubler son repos;
De fantômes divers une cour mensongère ,
Vains et frêles enfants d'une vapeur légère ,
Troupe qui sait charmer le plus profond ennui ,
Prête aux ordres du dieu , volait autour de lui.
Là, cent figures d’air en leurs moules gardées,
Là , des biens et des maux les légères idées,
Prévenant nos destins , trompant notre désir,
Formaient des magasins de peine ou de plaisir.
Je regardais sortir et rentrer ces merveilles :
Telles vont au butin les nombreuses abeilles;
Et tel, dans un état de fourmis composé ,
Le peuple rentre et sort , en cent parts divisé.
Confus , je m'écriai : Toi que chacun réclame,
Sommeil , je ne viens pas t'implorer dans ma flamme;
Conte à d'autres que moi ces mensonges charmants
Dont tu flattes les vœux des crédules amants ;
Les merveilles de Vaux me tiendront lieu d'Aminte :
Fais que par ces démons leur beauté me soit peinte.
Tu sais que j'ai toujours honoré tes autels ;
Je t'offre plus d'encens que pas un des mortels :
Doux Sommeil , rends-loi donc à ma juste prière.
A ces mots , je lui vis entrouvrir la paupière ;
Et , refermant les yeux presque au même moment :
Contentez ce mortel , dit-il languissamment.
Tout ce peuple obéit sans tarder davantage :
Des merveilles de Vaux ils m'offrirent l'image ;
Comme marbres taillés leur troupe s'entassa ;
En colonne aussitôt celui-ci se plaça ;
Celui-là chapiteau vint s'offrir à ma vue ;
L’un se fit piédestal , l'autre se fit statue ;
Artisans qui peu chers , mais qui, prompts et subtils,
N'ont besoin pour bâtir de marbre ni d'outils ..."

1661 - Mais alors que La Fontaine compose le "Songe de Vaux", Fouquet est disgracié, arrêté et enfermé par le roi.
Le 22 août 1661, La Fontaine écrivait à Maucroix qui se trouvait alors à Rome en mission secrète pour les affaires du surintendant. Dans une longue lettre, mêlée de prose et de vers, il lui faisait le récit de la fête que Fouquet venait d'offrir au Roi, cinq jours auparavant, dans les jardins de Vaux. Mais Louis XIV supportait impatiemment le faste de ce sujet prêt à la rébellion. Et quand Fouquet commit l'imprudence de convoiter jusqu'aux faveurs de Mlle de La Vallière, sa perte fut résolue et le spectacle des merveilles de Vaux ne fit qu'exaspérer sa colère. Quelques jours plus tard, le 5 septembre, Fouquet fut arrêté à Nantes sur l'ordre du Roi et restera en prison jusqu'à sa mort.
La Fontaine se trouve ainsi privé de son protecteur et poursuivi par la disgrâce royale pour sa fidélité au surintendant. Sollicitant la clémence du Roi, malgré Colbert, son attitude ne manque pas de courage : "Elégie aux nymphes de Vaux", 1661, "Ode au roi pour M. Fouquet", 1663.
Mais il juge par la suite prudent de s'éloigner de la capitale et part un temps dans le Limousin. D'autant qu'une déclaration royale du 8 février 1661 punissait d'une amende de 2 000 livres quiconque avait usurpé la noblesse et pris le titre d'écuyer. La Fontaine se sent menacer, se tourne vers Godefroy-Maurice duc de Bouillon, seigneur de Château-Thierry, puis accompagner son oncle Jannart, substitut de Fouquet exilé à Limoges en vertu d'une lettre de cachet....
1662 - "Elégie aux nymphes de Vaux"
Poème composée pour prendre la défense du surintendant Fouquet (Oronte), un appel à la compassion et à l'indulgence qui prend pour destinataires les statues qui ornaient le parc de Vaux-le-Vicomte, Pellisson fera de même mais de manière plus explicite..
"Remplissez l'air de cris en vos grottes profondes,
Pleurez, nymphes de Vaux, faites croître vos ondes,
Et que l'Anqueuil enflé ravage les trésors
Dont les regards de Flore ont embelli ses bords.
On ne blâmera pas vos larmes innocentes ;
Vous pouvez donner cours à vos douleurs pressantes.
Chacun attend de vous ce devoir généreux ;
Les destins sont contents : Oronte est malheureux.
Vous l'avez vu naguère au bord de vos fontaines.
Qui, sans craindre du Sort les faveurs incertaines,
Plein d'éclat, plein de gloire, adoré des mortels.
Recevait des honneurs qu'on ne doit qu'aux autels.
Hélas ! qu'il est déchu de ce bonheur suprême !
Que vous le trouveriez différent de lui-même !
Pour lui les plus beaux jours sont de secondes nuits :
Les soucis dévorants, les regrets, les ennuis,
Hôtes infortunés de sa triste demeure.
En des gouffres de maux le plongent à toute heure.
Voilà le précipice où l'ont enfin jeté
Les attraits enchanteurs de la prospérité.
Dans les palais des rois cette plainte est commune :
On n'y connaît que trop les jeux de la Fortune,
Ses trompeuses faveurs, ses appas inconstants ;
Mais on ne les connaît que quand il n'est plus temps.
Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles,
Qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,
Il est bien malaisé de régler ses désirs :
Le plus sage s'endort sur la foi des zéphyrs.
Jamais un favori ne borne sa carrière ;
Il ne regarde pas ce qu'il laisse en arrière;
Et tout ce vain amour des grandeurs et du bruit
Ne le saurait quitter qu'après l'avoir détruit.
Tant d'exemples fameux que l'histoire en raconte
Ne suffisaient-ils pas, sans la perte d'Oronte?
Ah ! si ce faux éclat n'eut pas fait ses plaisirs,
Si le séjour de Vaux eût borné ses désirs,
Qu'il pouvait doucement laisser couler son âge !
Vous n'avez pas chez vous ce brillant équipage,
Cette foule de gens qui s'en vont chaque jour
Saluer à longs flots le soleil de la Cour ;
Mais la faveur du Ciel vous donne en récompense -
Du repos, du loisir, de l'ombre et du silence,
Un tranquille sommeil, d'innocents entretiens :
Et jamais à la cour on ne trouve ces biens.
Mais quittons ces pensers : Oronte nous appelle.
Vous, dont il a rendu la demeure si belle,
Nymphes, qui lui devez vos plus charmants appas,
Si le long de vos bords Louis porte ses pas,
Tâchez de l'adoucir, fléchissez son courage.
Il aime ses sujets, il est juste, il est sage ;
Du titre de clément rendez-le ambitieux :
C'est par là que les rois sont semblables aux dieux.
Du magnanime Henri qu'il contemple la vie ;
Dès qu'il put se venger, il en perdit l'envie.
Inspirez à Louis cette même douceur :
La plus belle victoire est de vaincre son cœur.
Oronte est à présent un objet de clémence ;
S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance,
Il est assez puni par son sort rigoureux ;
Et c'est être innocent que d'être malheureux."

1663 - Lettres à sa femme, relation du voyage de Paris en Limousin...
A Clamart. ce 25 août 1663.
"Vous n'avez jamais voulu lire d'autres voyages que ceux des chevaliers de la Table ronde; mais le nôtre mérite bien que vous le lisiez. Il s'y rencontrera pourtant des matières peu convenables à votre goût : c'est à moi de les assaisonner, si je puis, en telle sorte qu'elles vous plaisent ; et c'est à vous de louer en cela mon intention, quand elle ne serait pas suivie du succès. Il pourra même arriver, si vous goûtez ce récit, que vous en goûterez après de plus sérieux. Vous ne jouez, ni ne travaillez, ni ne vous souciez du ménage ; et, hors le temps que vos bonnes amies vous donnent par charité, il n'y a que les romans qui vous divertissent. C'est un fonds bientôt épuisé. Vous avez lu tant de fois les vieux, que vous les savez; il s'en fait peu de nouveaux, et, parmi ce peu, tous ne sont pas bons : ainsi vous demeurerez souvent à sec. Considérez, je vous prie, l'utilité que ce vous serait, si, en badinant, je vous avais accoutumée à l'histoire, soit des lieux, soit des personnes: vous auriez de quoi vous désennuyer toute votre vie, pourvu que ce soit sans intention de rien retenir, moins encore de rien citer. Ce n'est pas une bonne qualité pour une femme d'être savante, et c'en est une très mauvaise d'affecter de paraitre telle.
Nous partîmes donc de Paris le 23 du courant, après que M. Jannart eut reçu les condoléances de quantité de personnes de condition et de ses amis. M. le lieutenant criminel en usa généreusement, libéralement, royalement : il ouvrit sa bourse, et nous dit que nous n'avions qu'à puiser. Le reste du voisinage fit des merveilles. Quand il eût été question de transférer le quai des Orfèvres, la cour du Palais, et le Palais même, à Limoges, la chose ne se serait pas autrement passée. Enfin, ce n'était chez nous que processions de gens abattus et tombés des nues. Avec tout cela, je ne pleurai point; ce qui me fait croire que j'acquerrai une grande réputation de constance dans cette affaire ...
Nous irons prendre au Bourg-la-Reine la commodité du carrosse de Poitiers, qui y passe tous les dimanches. Là se doit trouver un valet de pied du roi, qui a ordre de nous accompagner jusqu'à Limoges. Je vous écrirai ce qui nous arrivera en chemin, et ce qui me semblera digne d'être observé. Cependant faites bien mes recommandations à notre marmot, et dites-lui que peut-être j'amènerai de ce pays-là quelque beau petit chaperon pour le faire jouer, et pour lui tenir compagnie."
1664-1672 - De retour à Paris, La Fontaine reprend le fil de sa vie littéraire et, pour vivre, il se place sous la protection de Madame, la duchesse d'Orléans, de 1664 à 1672. Il réside dans l'austère palais du Luxembourg, la maison y est triste et dévote et ses gages annuels ne sont guère élevés sa fonction lui laisse de grands loisirs : il peut souvent retourner à Château-Thierry, surtout aller retrouver ses amis, festoyer avec eux, leur lire ses vers. D'ailleurs il n'était plus, comme chez Fouquet, obligé à une redevance poétique. Il se contenta, durant son séjour au Luxembourg, de rimer une gentille épître pour le petit chien de Mme d'Orléans, et un sonnet amoureux pour la divine Poussay, fille d'honneur de Mme d'Alençon.
Les quatre années de 1664 à 1668 sont celles où La Fontaine publie ses premiers chefs-d'œuvre : en 1664, un premier recueil de "Nouvelles en vers", en 1665, la première partie des "Contes et Nouvelles"; en 1666, la deuxième partie des "Contes et Nouvelles", et en 1668, les six premiers livres des "Fables". Passé la quarantaine, La Fontaine semble soudainement abandonner sa nonchalance proverbiale et ses succès littéraires vont lui ouvrir les salons de Mme De La Fayette, où il rencontre La Rochefoucauld, de Mme de Sévigné, de Mme de La Sablière, devient familier du duc de Bouillon et de la jeune duchesse, Marie-Anne Mancini, qui restera sa protectrice pendant trente ans, la plus jeune des cinq nièces de Mazarin...


1664-1674 - Publication des "Contes"
1664-1665, période charnière, pour un quatuor, Molière, Racine, Boileau et La Fontaine, auxquels se joint Chapelle.
Le Tartuffe est de 1664, le Misanthrope de 1666. Les premières satires de Boileau parurent en 1666. La Thèbaïde de Racine est de 1664, Alexandre de 1665, Andromaque de 1667. La Fontaine et Molière ont en 1665 le premier quarante- quatre ans, le second quarante-trois; Boileau a vingt-neuf ans et Racine vingt-six. Molière était dans tout l'éclat de sa renommée. Poète galant, La Fontaine devient conteur, sous l'influence de la duchesse de Bouillon : en décembre 1664, janvier 1665, janvier 1666, il publie ses recueils de "Contes et Nouvelles" en vers, tirés de Boccace et de l'Arioste, mais de très nombreuses autres sources, d'auteurs grecs (Anacréon, Athénée), italiens (Pétrone, L'Arétin) et d'auteurs français de la fin du XVe siècle et de la première moitié du XVIe. Il trouvera son public et La Fontaine s'efforcera de répondre à ses détracteurs dans le second recueil de ses Contes et Nouvelles. «S'il y a quelque chose dans nos écrits qui puisse faire impression sur les âmes, ce n'est nullement la gaieté de ces contes ; elle passe légèrement : je craindrois plutôt une douce mélancolie, où les romans les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger, et qui est une grande préparation pour l'amour». ...
Les premiers Contes parurent en 1664, tirés de Boccace et de L'Arioste, et c'est seulement onze ans plus tard qu'une sentence de police viendra les interdire. "En matière de vers et de prose, l'extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes.." (préface de la seconde édition), 11 contes et nouvelles : Joconde, Richard Minutolo, Le Cocu battu et content, Le Mari confesseur, Le Savetier, La Vénus callipyge, Les Deux Amis, Le Glouton, Soeur Jeanne, Le Juge de Mesle, Le Paysan qui avait offensé son Seigneur.
Joconde
Jadis régnait en Lombardie
Un prince aussi beau que le jour,
Et tel, que des beautés qui régnaient a sa cour
La moitié lui portait envie,
L’autre moitié brûlait pour lui d’amour.
Un jour en se mirant : Je fais, dit-il, gageure
Qu’il n’est mortel dans la nature
Qui me soit égal en appas
Et gage, si l’on veut, la meilleure province
De mes états ;
Et s’il s’en rencontre un, je promets foi de prince
De le traiter si bien, qu’il ne s’en plaindra pas.
À ce propos s’avance un certain gentilhomme
D’auprès de Rome.
« Sire, dit-il, si Votre Majesté
Est curieuse de beauté,
Qu’elle fasse venir mon frère ;
Aux plus charmants il n’en doit guerre :
Je m’y connais un peu ; soit dit sans vanité.
Toutefois en cela pouvant m’être flatté,
Que je n’en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames :
Du soin de guérir leurs flammes
Il vous soulagera, si vous le trouvez bon :
Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune,
Outre que tant d’amour vous serait importune,
Vous n’auriez jamais fait, il vous faut un second.
Là-dessus Astolphe répond
(C’est ainsi qu’on nommait ce roi de Lombardie) :
Votre discours me donne une terrible envie
De connaître ce frère : amenez-le-nous donc.
Voyons si nos beautés en seront amoureuses,
Si ses appas le mettront en crédit :
Nous en croirons les connaisseuses,
Comme très bien vous avez dit. »
Le gentilhomme part, et va quérir Joconde.
(C’est le nom que ce frère avait).
À la campagne il vivait,
Loin du commerce et du monde.
Marié depuis peu : content, je n’en sais rien.
Sa femme avait de la jeunesse,
De la beauté, de la délicatesse ;
Il ne tenait qu’à lui qu’il ne s’en souvint bien.
Son frère arrive, et lui fait l’ambassade ;
Enfin il le persuade.
Joconde d’une part regardait l’amitié
D’un roi puissant, et d’ailleurs fort aimable ;
Et d’autre part aussi, sa charmante moitié
Triomphait d’être inconsolable,
Et de lui faire des adieux
À tirer les larmes des yeux.
« Quoi tu me quittes, disait-elle,
As-tu bien l’âme assez cruelle,
Pour préférer à ma constante amour,
Les faveurs de la cour ?
Tu sais qu’à peine elles durent un jour ;
Qu’on les conserve avec inquiétude,
Pour les perdre avec désespoir.
Si tu te lasses de me voir,
Songe au moins qu’en ta solitude
Le repos règne jour et nuit :
Que les ruisseaux n’y font du bruit,
Qu’afin de t’inviter à fermer la paupière.
Crois-moi, ne quitte point les hôtes de tes bois,
Ces fertiles vallons, ces ombrages si cois,
Enfin moi qui devrais me nommer la première...
1667, second Livre des Contes, avec deux privilèges du roi des 20 octobre 1 665 et 6 juin 1667, privilèges qui furent révoqués en 1675 par une ordonnance de police, rendue contre le même ouvrage. Seize contes et nouvelles : Le Faiseur d'oreilles et le raccommodeur de moules, Les Cordeliers de Catalogne, Le Berceau, Le Muletier, L'Oraison de saint Julien, La Servante justifiée, La Gageure des trois commères, Le Calendrier des Vieillards, A Femme Avare Galant Escroc, On ne s'avise jamais de tout, Le Villageois qui cherche son veau, L'Anneau d'Hans Carvel, Le Gascon puni, La Fiancée du roi de Garbe, L'Ermite, Mazet Lamporechio.
La servante justifiée (Livre II)
Un homme donc avait belle servante.
Il la rendit au jeu d’amour savante.
Elle était fille à bien armer un lit,
Pleine de suc, et donnant appétit ;
Ce qu’on appelle en français bonne robe.
Par un beau jour cet homme se dérobe
D’avec sa femme ; et d’un très grand matin
S’en va trouver sa servante au jardin.
Elle faisait un bouquet pour madame :
C’était sa fête. Voyant donc de la femme
Le bouquet fait, il commence à louer
L’assortiment ; tâche à s’insinuer :
S’insinuer en fait de chambrière,
C’est proprement couler sa main au sein :
Ce qui fut fait. La servante soudain
Se défendit : mais de quelle manière ?
Sans rien gâter : c’était une façon
Sur le marché ; bien savait sa leçon.
La belle prend les fleurs qu’elle avait mises
En un monceau, les jette au compagnon.
Il la baisa pour en avoir raison :
Tant et si bien qu’ils en vinrent aux prises.....
Les "Oies de frère Philippe" (livre III)
".... Chassez les soupirants, belles, souffrez mon livre :
Je réponds de vous corps pour corps.
Mais pourquoi les chasser? ne sauroit-on bien vivre
Qu'on ne s'enferme avec les morts?
Le monde ne vous connoît guères,
S'il croit que les faveurs sont chez vous familières :
Non pas que les heureux amants
Soient ni phénix ni corbeaux blancs;
Aussi ne sont-ce fourmilières.
Ce que mon livre en dit doit passer pour chansons.
J'ai servi des beautés de toutes les façons :
Qu'ai- je gagné? Très peu de chose,
Rien. Je m'aviserois sur le tard d'être cause
Que la moindre de vous commît le moindre mal!
Contons, mais contons bien : c'est le point principal;
C'est tout; à cela près, censeurs, je vous conseille
De dormir, comme moi, sur l'une et l'autre oreille.
Censurez, tant qu'il vous plaira,
Méchants vers et phrases méchantes,
Mais, pour bons tours, laissez-les là.
Ce sont choses indifférentes;
Je n'y vois rien de périlleux.
Les mères, les maris, me prendront aux cheveux
Pour dix ou douze contes bleus!
Voyez un peu la belle affaire !
Ce que je n'ai pas fait, mon livre iroit le faire?
Beau sexe, vous pouvez le lire en sûreté....."
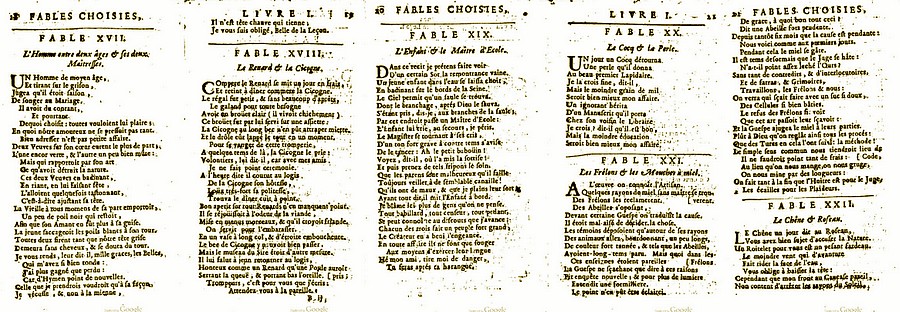

1668 - Parution du premier recueil des "Fables" (livres I à VI)...
Ce n'est pas sans surprise que l'on peut voir La Fontaine écrire son premier recueil de Fables. Rien ne le laissait pressentir. "Une ample comédie à cent actes divers, Et dont la scène est l'Univers". A 47 ans, La Fontaine publie son premier recueil des Fables, qui l'immortaliseront, et des œuvres de circonstance pour se ménager les faveurs avec un "Recueil de Poésies Chrétiennes", offert dès la fin de 1670 à l'aîné des jeunes Conti.
Ses Fables s'inspirent essentiellement, dans ce premier recueil, du grec Esope (VIe s. av. JC) et des fables latines de Phèdre (Ier s. ap.JC). A cela s'ajoute sa sensibilité propre, et toute son expérience de forestier, de bourgeois de petite ville, de badaud de Paris, de poète de cour, d'homme de lettres mêlé aux artistes, un amas confus d'observations narquoises ou d'impressions vagues, tout ce qui l'a intéressé, diverti, ému, tout cela va servir à nourrir son œuvre. Dédiant au Dauphin son Premier Recueil composé pour les enfants, La Fontaine insiste sur ses intentions morales : "Je me sers d'animaux pour instruire les hommes", et nous livre ses deux méthodes favorites, la satire ("Je tâche d'y tourner le vice en ridicule, Ne pouvant l'attaquer avec les bras d'Hercule") et le contraste ("J'oppose quelquefois, par une double image, Le vice à la vertu, la sottise au bon sens.").
Dans les six premiers livres des Fables, le lyrisme garde des mesures. Le poète semble avoir scrupule de découvrir son cœur ("Je m'emporte un peu trop", II, 13). Il n'en sera pas de même dans les recueils suivants, sa sensibilité se sera enrichie, son expression sera moins retenue. Nous serons à mille lieues d'Ésope...
Donc, premier recueil, 124 fables, dont (I) La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, Le Rat de ville et le Rat des champs, Le Loup et l'Agneau, La Mort et le Bûcheron. (II) Le Lion et le Moucheron, La Colombe et la Fourmi, Le Lièvre et les Grenouilles, L'Aigle et l'Escarbot (III) Le Meunier, son fils et l'Âne, Le Renard et le Bouc, Les Grenouilles qui demandent un Roi, Le Loup et la Cigogne, (IV) (V) Le Pot de terre et le Pot de fer, Le Laboureur et ses Enfants, (VI) Le Cerf se voyant dans l'eau, Le Lièvre et la Tortue, Le Cheval et l'Âne, Le Chien qui lâche sa proie pour l'ombre, La Jeune Veuve...

FABLES - LIVRE I
LA CIGALE ET LA FOURMI
La Cigale, ayant chanté
Tout L'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la Bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Août, foi d'animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise :
Eh bien! dansez maintenant. »

FABLES - LIVRE I
LE CORBEAU ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces Bois. »
A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie :
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui j'écoute.
cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
Le corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
(illustrations de Grandville)

FABLES - LIVRE I
LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF
Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : « Regardez bien, ma soeur,
Est-ce assez ? dites-moi : n'y suis-je point encore ?
- Nenni. - M'y voici donc? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point. » La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,
Tout petit Prince a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages.

FABLES - LIVRE I
LE LOUP ET LE CHIEN
Un Loup n'avait que les os et la peau ;
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille ;
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
là quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haines, et pauvres diables,
Dont la condition et de mourir de faim.
Car quoi ? Bien d'assuré ; point de hanche lippée
Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin. »
Le Loup reprit : « Que me faudra-t-il faire?
- Presque rien, dit le Chien ; donner la chasse aux gens
Portant bâtons, et mendiants;
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons ;
Sans parler de mainte caresse.
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien pelé :
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi? rien? - Peu
- Mais encore ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le Loup ; vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? - Pas toujours, mais qu'importe ?
- Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore.

FABLES - LIVRE I
LES DEUX MULETS
Deux Mulets cheminaient ; l'un d'avoine chargé ;
L'autre ponant l'argent de la Gabelle.
Celui-ci, glorieux d'une charge si belle,
N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.
Il marchait d'un pas relevé,
Et frisait sonner sa sonnette ;
Quand, l'ennemi se présentant,
Comme il en voulait à l'argent,
Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,
Le saisit au hein, et l'arrête.
Le Mulet se défendant
Se sent percer de coups : il gémit, il soupire.
« Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ?
Ce Mulet qui me suit du danger se retire ;
Et moi j'y tombe, et je péris.
- Ami, lui dit son camarade,
Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi :
Si tu n'avais servi qu'un Meunier, comme moi,
Tu ne serais pas si malade. »

FABLES - LIVRE I.
LA GENISSE, LA CHEVRE ET LA BREBIS EN SOCIETE AVEC LE LION
La Génisse, la Chèvre, et leur soeur la Brebis,
Avec un fier Lion, seigneur du voisinage,
Firent société, dit-on, au temps jadis,
Et mirent en commun le gain et le dommage.
Dans les lacs de la Chèvre un Cerf se trouva pris.
Vers ses associés aussitôt elle envoie.
Eux venus, le Lion par ses ongles compta,
Et dit : « Nous sommes quatre à partager la proie. «
Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ;
Prit pour lui la première en qualité de Sire :
« Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison,
C’est que je m’appelle Lion :
A cela l’on n’a rien à dire.
La seconde, par droit, me doit échoir encor :
Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort
Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.
Si quelqu’une de vous touche à la quatrième,
Je l’étranglerai tout d’abord.

L'HIRONDELLE ET LES PETITS OISEAUX
Une Hirondelle en ses voyages
Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu.
Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages,
Et devant qu'ils fussent éclos,
Les annonçait aux Matelots.
Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème,
Elle vit un Manant en couvrir maints sillons.
« Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux Oisillons.
Je vous plains : car pour moi, dans ce péril extrême,
Je saurai m'éloigner, ou vivre en quelque coin.
Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?
Un jour viendra, qui n'est pas loin,
Que ce qu'elle répand sera votre ruine.
De là naîtront engins à vous envelopper,
Et lacets pour vous attraper ;
Enfin mainte et mainte machine
Qui causera dans la saison
Votre mort ou votre prison ;
C'est la cage ou le chaudron.
C'est pourquoi, leur dit l'Hirondelle,
Mangez ce grain, et croyez-moi. »
Les Oiseaux se moquèrent d'elle,
Ils trouvaient aux champs trop de quoi.
Quand la chènevière fut verte,
L'Hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin
Ce qu'a produit ce maudit grain ;
Ou soyez sûrs de votre perte.
- Prophète de malheur, babillarde, dit-on,
Le bel emploi que tu nous donnes !
Il nous faudrait mille personnes
Pour éplucher tout ce canton. »
La chanvre étant tout à fait crue,
L'Hirondelle ajouta : Ceci ne va pas bien;
Mauvaise graine est tôt venue ;
Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a crue en rien,
Dès que vous verrez que la terre
Sera couverte, et qu'à leurs blés
Les gens n'étant plus occupés
Feront aux oisillons la guerre ;
Quand reginglettes et réseaux
Attraperont petits oiseaux,
Ne volez plus de place en place ;
Demeurez au logis, ou changez de climat :
« Imitez le Canard, la Grue et la Bécasse.
Mais vous n'êtes pas en état
De passer comme nous les déserts et les ondes,
Ni d'aller chercher d'autres mondes ;
C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr :
C'est de vous renfermer aux trous de quelque mur. »
Les Oisillons, las de l'entendre,
Se mirent à jaser aussi confusément
Que frisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre
Ouvrait la bouche seulement.
Il en prit aux uns comme aux autres :
Maint Oisillon se vit esclave retenu.
Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres,
Et ne croyons le mal que quand il est venu.

FABLES - LIVRE I
LES VOLEURS ET L'ÂNE
Pour un âne enlevé deux voleurs se battaient :
L’un voulait le garder; l’autre le voulait vendre.
Tandis que coups de poing trottaient,
Et que nos champions songeaient à se défendre,
Arrive un troisième larron
Qui saisit maître Aliboron.
L’âne, c’est quelquefois une pauvre province :
Les voleurs sont tel ou tel prince,
Comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois.
Au lieu de deux, j’en ai rencontré trois :
Il est assez de cette marchandise.
De nul d’eux n’est souvent la province conquise :
Un quart voleur survient, qui les accorde net
En se saisissant du baudet.

FABLES - LIVRE I
LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS
Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'ortolans.
Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis :
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,
Bien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête,
Pendant qu'ils étaient en train.
A la porte de la Salle
Ils entendirent du bruit;
Le Rat de ville détale,
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt;
Et le citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le Rustique;
Demain vous viendrez chez moi ;
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi.
Mais rien ne vient m'interrompre ;
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre. »

FABLES - LIVRE I
LE LOUP ET L'AGNEAU
La raison du plus fort est toujours la meilleure ;
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?
Dit cet animal plein de rage ;
Tu seras châtié de ta témérité.
ô - Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
A Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau ; je tette encore ma mère.
. - Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos Bergers, et vos Chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange
Sans autre forme de procès.

FABLES - LIVRE I
L'ENFANT ET LE MAÎTRE D'ECOLE
Dans ce récit je prétends faire voir
D’un certain sot la remontrance vaine.
Un jeune enfant dans l’eau se laissa choir,
En badinant sur les bords de la Seine.
Le Ciel permit qu’un saule se trouva
Dont le branchage, après Dieu, le sauva.
S’étant pris, dis-je, aux branches de ce saule ;
Par cet endroit passe un Maître d’école.
L’Enfant lui crie : Au secours, je péris.
Le Magister se tournant à ses cris,
D’un ton fort grave à contre-temps s’avise
De le tancer. Ah le petit babouin !
Voyez, dit-il, où l’a mis sa sottise !
Et puis prenez de tels fripons le soin.
Que les parents sont malheureux, qu’il faille
Toujours veiller à semblable canaille !
Qu’ils ont de maux, et que je plains leur sort !
Ayant tout dit, il mit l’enfant à bord.
Je blâme ici plus de gens qu’on ne pense.
Tout babillard, tout censeur, tout pédant,
Se peut connaître au discours que j’avance :
Chacun des trois fait un peuple fort grand ;
Le Créateur en a béni l’engeance.
En toute affaire ils ne font que songer
Aux moyens d’exercer leur langue.
Hé, mon ami, tire-moi de danger :
Tu feras après ta harangue.

FABLES - LIVRE I
L'HOMME ENTRE DEUX ÂGES, ET SES DEUX MAÎTRESSES
Un homme de moyen âge,
Et tirant sur le grison,
Jugea qu’il était saison
De songer au mariage.
Il avait du comptant,
Et partant
De quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire ;
En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant ;
Bien adresser n’est pas petite affaire.
Deux veuves sur son coeur eurent le plus de part :
L’une encor verte, et l’autre un peu bien mûre,
Mais qui réparait par son art
Ce qu’avait détruit la nature.
Ces deux Veuves, en badinant,
En riant, en lui faisant fête,
L’allaient quelquefois testonnant,
C’est-à-dire ajustant sa tête.
La Vieille à tous moments de sa part emportait
Un peu du poil noir qui restait,
Afin que son amant en fût plus à sa guise.
La Jeune saccageait les poils blancs à son tour.
Toutes deux firent tant, que notre tête grise
Demeura sans cheveux, et se douta du tour.
Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les Belles,
Qui m’avez si bien tondu ;
J’ai plus gagné que perdu :
Car d’Hymen point de nouvelles.
Celle que je prendrais voudrait qu’à sa façon
Je vécusse, et non à la mienne.
Il n’est tête chauve qui tienne,
Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.

LA MORT ET LE BUCHERON
Un Malheureux appelait tous les jours
La Mort à son secours.
« ô Mon, lui disait-il, que tu me sembles belle
Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. ».
La Mon crut en venant l'obliger en effet.
Elle happe à sa porte, elle entre, elle se montre.
Que vois-je ! cria-t-il, ôtez-moi cet objet ;
Qu'il est hideux ! que sa rencontre
Me cause d'horreur et d'effroi !
N'approche pas ô Mort ; ô mort, retire-toi.
Mécénas fut un galant homme :
Il a dit quelque part : Qu'on me rende impotent,
Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme
Je vive, c'est assez, je suis plus que content.
Ne viens jamais, à Mort ; on t'en dit tout autant.
Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur :
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier, et la corvée
Lui font d'un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort ; elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu'il faut faire.
C'est, dit-il, afin de m'aider
A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d'où nous sommes :
Plutôt souffrir que mourir,
C'est la devise des hommes.

FABLES - LIVRE I
LE COQ ET LA PERLE
Un jour un coq détourna
Une perle, qu’il donna
Au beau premier lapidaire.
” Je la crois fine, dit-il;
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire. “
Un ignorant hérita
D’un manuscrit, qu’il porta
Chez son voisin le libraire.
” Je crois, dit-il, qu’il est bon ;
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire.

FABLES - LIVRE I.
LE RENARD ET LA CIGOGNE
Compère le Renard se mit un jour en frais,
Et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts :
Le Galant pour toute besogne
Avait un brouet clair (il vivait chichement).
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette.
La Cigogne au long bec n'en put attraper miette ;
Et le Drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, la cigogne le prie :
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie.
A l'heure dite il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse ;
Loua très fort sa politesse,
Trouva le dîner cuit à point.
Bon appétit surtout ;
Renards n'en manquent point.
Il se réjouissait à l'odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande.
On servit pour l'embarrasser
En un vase à long col et d'étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer,
Mais le museau du Sire était d'autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l'oreille.
Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :
Attendez-vous à la pareille.

LE CHENE ET LE ROSEAU
Le Chêne un jour dit au Roseau :
« Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d'aventure.
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du Soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon ; tout me semble Zéphir.
Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage ;
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La Nature envers vous me semble bien injuste.
- Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie :
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.

FABLES - LIVRE II
LE LION ET LE MOUCHERON
C'est l'une des fables qui montre tout le génie d'un La Fontaine qui parvient à nous faire vivre intensément un combat des plus homériques et une fin d'une simplicité singulière, en utilisant comme naturellement une infinité de ressources littéraires, tant dans le choix des mots que dans la versification. Plus que dans toute autre de ses fables, ici, "la peinture des attitudes et des mouvements rejoint celle des caractères...".
Certes Esope donnait à La Fontaine á peu près tous les éléments de sa fable, mais on peut juger par comparaison de l'extraordinaire inventivité et efficacité de l'auteur : « Un moucheron s'approcha d'un lion et lui dit : « Je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu prétends le contraire, en quoi consiste ta force? Tu déchires avec tes griffes et tu mords avec tes dents? Une femme qui se bat avec son mari en fait autant. Mais moi je suis beaucoup plus fort que toi. Si tu veux, engageons le combat." Et le moucheron sonna de la trompette, puis bondit sur son adversaire, lui mordant le museau, dans la partie dépourvue de poils, autour des narines. Le lion se déchirait de ses propres griffes, jusqu'au moment où il renonça au combat. Alors le moucheron, vainqueur du lion, sonna de la trompette, entonna un chant de victoire et s'envola. Mais, empêtré dans le filet d'une araignée, pendant qu'elle le dévorait, il se lamentait de périr, lui qui faisait la guerre aux plus puissants, sous les coups d'un vil animal, une araignée."...
"Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre!"
C'est en ces mots que le Lion
Parlait un jour au Moucheron.
L'autre lui déclara la guerre.
"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi
Me fasse peur ni me soucie?
Un boeuf est plus puissant que toi :
Je le mène à ma fantaisie."
A peine il achevait ces mots
Que lui-même il sonna la charge,
Fut le trompette et le héros.
Dans l'abord il se met au large.
Puis prend son temps, fond sur le cou
Du lion, qu'il rend presque fou.
Le quadrupède écume, et son oeil étincelle ;
Il rugit ; on se cache, on tremble à l'environ :
Et cette alarme universelle
Est l'ouvrage d'un moucheron.
Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle,
Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau,
Tantôt entre au fond du naseau.
La rage alors se trouve à son faîte montée.
L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir
Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée
Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.
Le malheureux Lion se déchire lui-même,
Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs,
Bat l'air, qui n'en peut mais ; et sa fureur extrême
Le fatigue, l'abat : le voilà sur les dents.
L'insecte du combat se retire avec gloire :
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,
Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin
L'embuscade d'une araignée ;
Il y rencontre aussi sa fin.
Quelle chose par là nous peut être enseignée?
J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis
Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;
L'autre, qu'aux grands périls tel a pu se soustraire
Qui périt pour la moindre affaire.

FABLES - LIVRE II
LE LION ET LE RAT
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux Fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion,
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie :
Le Roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu'au sortir des forêts
Le Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

LA COLOMBE ET LA FOURMI
Le long d'un clair ruisseau buvait une Colombe,
Quand sur l'eau se penchant une Fourmis y tombe;
Et dans cet Océan l'on eût vu la Fourmis
S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive.
La Colombe aussitôt usa de charité ;
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté,
Ce fut un promontoire où la Fourmis arrive.
Elle se sauve; et là-dessus
Passe un certain Croquant qui marchait les pieds nus.
Ce Croquant par hasard avait une arbalète ;
Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus,
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête,
La Fourmis le pique au talon.
Le Vilain retourne la tête.
La Colombe l'entend, part, et tire de long.
Le soupé du Croquant avec elle s'envole :
Point de Pigeon pour une obole.

FABLES - LIVRE II
LE LOUP PLAIDANT CONTRE LE RENARD PAR DEVANT LE SINGE
Un Loup disait que l'on l'avait volé :
Un Renard, son voisin, d'assez mauvaise vie,
Pour ce prétendu vol par lui fut appelé.
Devant le Singe il fut plaidé,
Non point par Avocats, mais par chaque Partie.
Thémis n'avait point travaillé,
De mémoire de Singe, à fait plus embrouillé.
Le Magistrat suait en son lit de Justice.
Après qu'on eut bien contesté,
Répliqué, crié, tempêté,
Le Juge, instruit de leur malice,
Leur dit : "Je vous connais de longtemps, mes amis,
Et tous deux vous paierez l'amende ;
Car toi, Loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris ;
Et toi, Renard, as pris ce que l'on te demande. "
Le juge prétendait qu'à tort et à travers
On ne saurait manquer, condamnant un pervers.
Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe étoient une chose à censurer: mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis...

LE LIEVRE ET LES GRENOUILLES
Un Lièvre en son gîte songeait
Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait :
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
Les gens de naturel peureux
Sont, disait-il, bien malheureux :
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite.
Jamais un plaisir pur ; toujours assauts divers :
Voilà comme je vis : cette crainte maudite
M'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle ?
Je crois même qu'en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi.
Ainsi raisonnait notre Lièvre,
Et cependant faisait le guet.
Il était douteux, inquiet ;
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
Le mélancolique Animal,
En rêvant à cette matière,
Entend un léger bruit : ce lui fut un signal
Pour s'enfuir devers sa tanière.
Il s'en alla passer sur le bord d'un Étang :
Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes;
Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.
Oh ! dit-il, j'en fais faire autant
Qu'on m'en fait faire ! ma présence
Effraie aussi les gens ! je mets l'alarme au camp !
Et d'où me vient cette vaillance?
Comment ! des Animaux qui tremblent devant moi !
Je suis donc un foudre de guerre?
Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre,
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

FABLES - LIVRE II
CONSEIL TENU PAR LES RATS
Un Chat nommé Rodilardus,
Faisait de Rats telle déconfiture,
Que l’on n’en voyait presque plus,
Tant il en avait mis dedans la sépulture.
Le peu qu’il en restait n’osant quitter son trou,
Ne trouvait à manger que le quart de son sou ;
Et Rodilard passait chez la gent misérable,
Non pour un Chat, mais pour un Diable.
Or un jour qu’au haut et au loin
Le galant alla chercher femme ;
Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa Dame,
Le demeurant des Rats tint Chapitre en un coin
Sur la nécessité présente.
Dès l’abord leur Doyen, personne fort prudente,
Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard,
Attacher un grelot au cou de Rodilard ;
Qu’ainsi quand il irait en guerre,
De sa marche avertis ils s’enfuiraient sous terre.
Qu’il n’y savait que ce moyen.
Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen,
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d’attacher le grelot.
L’un dit : Je n’y vais point, je ne suis pas si sot :
L’autre, Je ne saurais. Si bien que sans rien faire
On se quitta. J’ai maints Chapitres vus,
Qui pour néant se sont ainsi tenus ;
Chapitres, non de Rats, mais Chapitres de Moines,
Voire Chapitres de Chanoines.
Ne faut-il que délibérer ?
La Cour en Conseillers foisonne ;
Est-il besoin d’exécuter ?
L’on ne rencontre plus personne.

FABLES - LIVRE II
LES DEUX TAUREAUX ET UNE GRENOUILLE
Deux taureaux combattaient à qui posséderait
Une Génisse avec l’empire.
Une Grenouille en soupirait.
" Qu’avez-vous ? se mit à lui dire
Quelqu’un du peuple coassant.
-Eh ! ne voyez-vous pas, dit-elle,
Que la fin de cette querelle
Sera l’exil de l’un ; que l’autre, le chassant,
Le fera renoncer aux campagnes fleuries ?
Il ne régnera plus sur l’herbe des prairies,
Viendra dans nos marais régner sur les roseaux,
En nous foulant aux pieds jusques aux fond des eaux,
Tantôt l’une, et puis l’autre, il faudra qu’on pâtisse
Du combat qu’a causé Madame la Génisse. "
Cette crainte était de bon sens.
L’un des Taureaux en leur demeure
S’alla cacher à leurs dépens :
Il en écrasait vingt pas heure.
Hélas ! on voit que de tout temps
Les petits ont pâti des sottises des grands.

LE COQ ET LE RENARD
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois.
Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle :
Paix générale cette fois.
Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse ;
Ne me retarde point de grâce :
Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.
Les tiens et toi pouvez vaquer
Sans nulle crainte à vos affaires :
Nous vous y servirons en frères.
Faites-en les feux dès ce soir.
Et cependant viens recevoir
Le baiser d'amour fraternelle.
Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais
Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle
Que celle
De cette paix.
Et ce m'est une double joie
De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,
Qui, je m'assure, sont courriers
Que pour ce sujet on envoie.
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser tous.
- Adieu, dit le Renard : ma traite est longue à faire.
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire
Une autre fois. Le Galant aussitôt
Tire ses grègues, gagne au haut,
Mal content de son stratagème ;
Et notre vieux Coq en soi-même
Se mit à rire de sa peur ;
Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

LE CORBEAU VOULANT IMITER L'AIGLE
L'Oiseau de Jupiter enlevant un Mouton,
Un Corbeau témoin de l'affaire,
Et plus faible de reins, mais non pas moins glouton,
En voulut sur l'heure autant faire.
Il tourne à l'entour du troupeau,
Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau,
Un vrai Mouton de sacrifice :
On l'avait réservé pour la bouche des Dieux.
Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux :
Je ne sais qui fut ta nourrice ;
Mais ton corps me paraît en merveilleux état :
Tu me serviras de pâture.
Sur l'Animal bêlant, à ces mots, il s'abat.
La moutonnière créature
Pesait plus qu'un fromage ; outre que sa toison
Était d'une épaisseur extrême,
Et mêlée à peu près de la même façon
Que la barbe de Polyphème.
Elle empêtra si bien les serres du Corbeau
Que le pauvre Animal ne put faire retraite :
Le Berger vient, le prend, l'encage bien et beau,
Le donne à ses enfants pour servir d'amusette.
Il faut se mesurer, la conséquence est nette.
Mal prend aux Volereaux de faire les Voleurs.
L'exemple est un dangereux leurre :
Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands Seigneurs :
Où la Guêpe a passé, le Moucheron demeure.

LA LICE ET SA COMPAGNE
Une Lice étant sur son terme,
Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant,
Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent,
De lui prêter sa hutte, où la Lice s’enferme.
Au bout de quelque temps sa Compagne revient.
La Lice lui demande encore une quinzaine.
Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu’à peine.
Pour faire court, elle l’obtient.
Ce second terme échu, l’autre lui redemande
Sa maison, sa chambre, son lit.
La Lice cette fois montre les dents, et dit :
Je suis prête à sortir avec toute ma bande,
Si vous pouvez nous mettre hors.
Ses enfants étaient déjà forts.
Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette.
Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,
Il faut que l’on en vienne aux coups ;
Il faut plaider, il faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME
Un homme chérissait éperdument sa Chatte ;
Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate,
Qui miaulait d'un ton fort doux :
Il était plus fou que les fous.
Cet homme donc, par prières, par larmes,
Par sortilèges et par charmes,
Fait tant qu'il obtient du Destin
Que sa Chatte en un beau matin
Devient femme, et le matin même
Maître sot en fait sa moitié.
Le voilà fou d'amour extrême,
De fou qu'il était d'amitié.
Jamais la Dame la plus belle
Ne charma tant son Favori
Que fut cette Épouse nouvelle
Son hypocondre de Mari.
Il l'amadoue, elle le flatte ;
Il n'y trouve plus rien de Chatte,
Et poussant l'erreur jusqu'au bout,
La croit femme en tout et par tout,
Lorsque quelques Souris qui rongeaient de la natte
Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.
Aussitôt la Femme est sur pieds :
Elle manqua son aventure.
Souris de revenir, Femme d'être en posture.
Pour cette fois elle accourut à point ;
Car ayant changé de figure,
Les Souris ne la craignaient point.
Ce lui fut toujours une amorce,
Tant le naturel a de force.
Il se moque de tout, certain âge accompli.
Le vase est imbibé, l'étole a pris son plis.
En vain de son train ordinaire
On le veut désaccoutumer.
Quelque chose qu'on puisse faire,
On ne saurait le réformer.
Coups de fourche ni d'étrivières
Ne lui font changer de manières ;
Et, trissiez-vous embâtonnés,
Jamais vous n'en serez les Maîtres.
Qu'on lui ferme la porte au nez,
Il reviendra par les fenêtres.

LE LION ET L'ÂNE CHASSANT
Le Roi des animaux se mit un jour en tête
De giboyer. Il célébrait sa fête.
Le gibier du Lion ce ne sont pas moineaux ;
Mais beaux et bons Sangliers, Daims et Cerfs bons et beaux.
Pour réussir dans cette affaire,
Il se servit du ministère
De l’Âne à la voix de Stentor.
L’Âne à Messer Lion fit office de Cor.
Le Lion le posta, le couvrit de ramée,
Lui commanda de braire, assuré qu’à ce son
Les moins intimidés fuiraient de leur maison.
Leur troupe n’était pas encore accoutumée
À la tempête de sa voix :
L’air en retentissait d’un bruit épouvantable :
La frayeur saisissait les hôtes de ces bois.
Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable
Où les attendait le Lion.
N’ai-je pas bien servi dans cette occasion ?
Dit l’Âne, en se donnant tout l’honneur de la chasse ;
Ouï, reprit le Lion, c’est bravement crié.
Si je ne connaissais ta personne et ta race,
J’en serais moi-même effrayé.
L’Âne s’il eût osé se fût mis en colère,
Encor qu’on le raillât avec juste raison :
Car qui pourrait souffrir un Âne fanfaron ?
Ce n’est pas là leur caractère.

L'ÂNE CHARGE D'EPONGES, ET L'ÂNE CHARGE DE SEL
Un Ânier, son Sceptre à la main,
Menait en Empereur Romain
Deux Coursiers à longues oreilles.
L’un d’éponges chargé marchait comme un Courrier ;
Et l’autre se faisant prier
Portait, comme on dit, les bouteilles.
Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins
Par monts, par vaux, et par chemins
Au gué d’une rivière à la fin arrivèrent,
Et fort empêchés se trouvèrent.
L’Ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là,
Sur l’Âne à l’éponge monta,
Chassant devant lui l’autre bête,
Qui voulant en faire à sa tête
Dans un trou se précipita,
Revint sur l’eau, puis échappa :
Car au bout de quelques nagées
Tout son sel se fondit si bien,
Que le Baudet ne sentit rien
Sur ses épaules soulagées.
Camarade Épongier prit exemple sur lui,
Comme un Mouton qui va dessus la foi d’autrui.
Voilà mon Âne à l’eau, jusqu’au col il se plonge
Lui, le Conducteur, et l’Éponge.
Tous trois burent d’autant ; l’Ânier et le Griffon
Firent à l’éponge raison.
Celle-ci devint si pesante,
Et de tant d’eau s’emplit d’abord,
Que l’Âne succombant ne put gagner le bord.
L’Ânier l’embrassait dans l’attente
D’une prompte et certaine mort.
Quelqu’un vint au secours : qui ce fut, il n’importe ;
C’est assez qu’on ait vu par là qu’il ne faut point
Agir chacun de même sorte.
J’en voulais venir à ce point.


FABLES - LIVRE III
LE MEUNIER, SON FILS ET L'ÂNE
L’Invention des Arts étant un droit d’aînesse,
Nous devons l’Apologue à l’ancienne Grèce.
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner,
Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.
La feinte est un pays plein de terres désertes.
Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.
Je t’en veux dire un trait assez bien inventé.
Autrefois à Racan Malherbe l’a conté.
Ces deux rivaux d’Horace, héritiers de sa Lyre,
Disciples d’Apollon, nos Maîtres pour mieux dire,
Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins ;
(Comme ils se confiaient leurs pensers et leurs soins)
Racan commence ainsi : Dites-moi, je vous prie,
Vous qui devez savoir les choses de la vie,
Qui par tous ses degrés avez déjà passé,
Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé ;
À quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j’y pense.
Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance.
Dois-je dans la Province établir mon séjour ?
Prendre emploi dans l’Armée ? ou bien charge à la Cour ?
Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes.
La guerre a ses douceurs, l’Hymen a ses alarmes.
Si je suivais mon goût, je saurais où buter ;
Mais j’ai les miens, la Cour, le peuple à contenter.
Malherbe là-dessus. Contenter tout le monde !
Écoutez ce récit avant que je réponde.
J’ai lu dans quelque endroit, qu’un Meunier et son fils,
L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,
Mais garçon de quinze ans, si j’ai bonne mémoire,
Allaient vendre leur Âne un certain jour de foire.
Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,
On lui lia les pieds, on vous le suspendit ;
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre ;
Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.
Le premier qui les vit, de rire s’éclata.
Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ?
Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense.
Le Meunier à ces mots connaît son ignorance.
Il met sur pieds sa bête, et la fait détaler.
L’Âne, qui goûtait fort l’autre façon d’aller
Se plaint en son patois. Le Meunier n’en a cure.
Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure
Passent trois bons Marchands. Cet objet leur déplut.
Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :
Oh là oh, descendez, que l’on ne vous le dise,
Jeune homme qui menez Laquais à barbe grise.
C’était à vous de suivre, au vieillard de monter.
Messieurs, dit le Meunier, il vous faut contenter.
L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte ;
Quand trois filles passant, l’une dit : C’est grand’ honte,
Qu’il faille voir ainsi clocher ce jeune fils ;
Tandis que ce nigaud, comme un Évêque assis,
Fait le veau sur son Âne, et pense être bien sage.
Il n’est, dit le Meunier, plus de Veaux à mon âge.
Passez votre chemin, la fille, et m’en croyez.
Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,
L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.
Au bout de trente pas une troisième troupe
Trouve encore à gloser. L’un dit : Ces gens sont fous,
Le Baudet n’en peut plus, il mourra sous leurs coups.
Hé quoi, charger ainsi cette pauvre Bourrique !
N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?
Sans doute qu’à la Foire ils vont vendre sa peau.
Parbleu, dit le Meunier, est bien fou du cerveau,
Qui prétend contenter tout le monde et son père.
Essayons toutefois, si par quelque manière
Nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux.
L’Âne se prélassant marche seul devant eux.
Un quidam les rencontre, et dit : Est-ce la mode,
Que Baudet aille à l’aise, et Meunier s’incommode ?
Qui de l’Âne ou du Maître est fait pour se laisser ?
Je conseille à ces gens de le faire enchâsser.
Ils usent leurs souliers, et conservent leur Âne :
Nicolas au rebours ; car quand il va voir Jeanne,
Il monte sur sa bête, et la chanson le dit.
Beau trio de Baudets ! le Meunier repartit :
Je suis Âne, il est vrai, j’en conviens, je l’avoue ;
Mais que dorénavant on me blâme, on me loue ;
Qu’on dise quelque chose, ou qu’on ne dise rien ;
J’en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien.
Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;
Allez, venez, courez, demeurez en Province ;
Prenez femme, Abbaye, Emploi, Gouvernement ;
Les gens en parleront, n’en doutez nullement.

FABLES - LIVRE III
LE RENARD ET LE BOUC
Capitaine Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc des plus hauts encornés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ;
L’autre était passé maître en fait de tromperie.
La soif les obligea de descendre en un puits.
Là chacun d’eux se désaltère.
Après qu’abondamment tous deux en eurent pris,
Le Renard dit au Bouc : « Que ferons-nous, compère ?
Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi ;
Mets-les contre le mur. Le long de ton échine
Je grimperai premièrement ;
Puis sur tes cornes m’élevant,
À l’aide de cette machine,
De ce lieu-ci je sortirai,
Après quoi je t’en tirerai.
– Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je loue
Les gens bien sensés comme toi.
Je n’aurais jamais, quant à moi,
Trouvé ce secret, je l’avoue. »
Le Renard sort du puits, laisse son compagnon,
Et vous lui fait un beau sermon
Pour l’exhorter à patience.
« Si le ciel t’eût, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n’aurais pas, à la légère,
Descendu dans ce puits. Or, adieu, j’en suis hors.
Tâche de t’en tirer, et fais tous tes efforts :
Car pour moi, j’ai certaine affaire
Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin. »
En toute chose il faut considérer la fin.

LES GRENOUILLES QUI DEMANDENT UN ROI
Les Grenouilles, se lassant
De l’état démocratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
Il leur tomba du ciel un Roi tout pacifique :
Ce Roi fit toutefois un tel bruit en tombant,
Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S’alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux,
Dans les trous du marécage,
Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;
Or c’était un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première
Qui, de le voir s’aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant.
Une autre la suivit, une autre en fit autant,
Il en vint une fourmilière ;
Et leur troupe à la fin se rendit familière
Jusqu’à sauter sur l’épaule du Roi.
Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue.
« Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue. »
Le Monarque des Dieux leur envoie une Grue,
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir,
Et Grenouilles de se plaindre ;
Et Jupin de leur dire : « Eh quoi ! votre désir
À ses lois croit-il nous astreindre ?
Vous auriez dû premièrement
Garder votre gouvernement ;
Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier Roi fût débonnaire et doux :
De celui-ci contentez-vous,
De peur d’en rencontrer un pire. »

LA GOUTTE ET L'ARAIGNEE
Quand l’Enfer eut produit la Goutte et l’Araignée,
« Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter
D’être pour l’humaine lignée
Également à redouter.
Or, avisons aux lieux qu’il vous faut habiter.
Voyez-vous ces cases étroites,
Et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés ?
Je me suis proposé d’en faire vos retraites.
Tenez donc, voici deux bûchettes ;
Accommodez-vous, ou tirez.
– Il n’est rien, dit l’Aragne, aux cases qui me plaise. »
L’autre, tout au rebours, voyant les palais pleins
De ces gens nommés médecins,
Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.
Elle prend l’autre lot, y plante le piquet,
S’étend à son plaisir sur l’orteil d’un pauvre homme,
Disant : « Je ne crois pas qu’en ce poste je chôme,
Ni que d’en déloger et faire mon paquet
Jamais Hippocrate me somme. »
L’Aragne cependant se campe en un lambris,
Comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie,
Travaille à demeurer : voilà sa toile ourdie,
Voilà des moucherons de pris.
Une servante vient balayer tout l’ouvrage.
Autre toile tissue, autre coup de balai.
Le pauvre bestion tous les jours déménage.
Enfin, après un vain essai,
Il va trouver la Goutte. Elle était en campagne,
Plus malheureuse mille fois
Que la plus malheureuse Aragne.
Son hôte la menait tantôt fendre du bois,
Tantôt fouir, houer. Goutte bien tracassée
Est, dit-on, à demi pansée.
« Oh ! je ne saurais plus, dit-elle, y résister.
Changeons, ma sœur l’Aragne. » Et l’autre d’écouter :
Elle la prend au mot, se glisse en la cabane :
Point de coup de balai qui l’oblige à changer.
La Goutte, d’autre part, va tout droit se loger
Chez un prélat qu’elle condamne
À jamais du lit ne bouger.
Cataplasmes, Dieu sait ! Les gens n’ont point de honte
De faire aller le mal toujours de pis en pis.
L’une et l’autre trouva de la sorte son compte,
Et fit très sagement de changer de logis.

LE LOUP ET LA CIGOGNE
Les Loups mangent gloutonnement.
Un Loup donc étant de frairie,
Se pressa, dit-on, tellement,
Qu’il en pensa perdre la vie.
Un os lui demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,
Prés de là passe une Cigogne.
Il lui fait signe, elle accourt.
Voilà l’Opératrice aussitôt en besogne.
Elle retira l’os ; puis pour un si bon tour
Elle demanda son salaire.
Votre salaire ? dit le Loup,
Vous riez, ma bonne commère.
Quoi, ce n’est pas encor beaucoup
D’avoir de mon gosier retiré votre cou ?
Allez, vous êtes une ingrate ;
Ne tombez jamais sous ma patte.

LE LOUP ET LES BREBIS
Après mille ans et plus de guerre déclarée,
Les Loups firent la paix avecque les Brebis.
C’était apparemment le bien des deux partis ;
Car si les Loups mangeaient mainte bête égarée,
Les bergers de leur peau se faisaient maints habits.
Jamais de liberté, ni pour les pâturages,
Ni d’autre part pour les carnages :
Ils ne pouvaient jouir qu’en tremblant de leurs biens.
La paix se conclut donc : on donne des otages ;
Les Loups, leurs louveteaux ; et les Brebis, leurs chiens.
L’échange en étant fait aux formes ordinaires
Et réglé par des commissaires,
Au bout de quelque temps que messieurs les louvats
Se virent Loups parfaits et friands de tuerie,
lls vous prennent le temps que dans la bergerie
Messieurs les Bergers n’étaient pas,
Étranglent la moitié des agneaux les plus gras,
Les emportent aux dents, dans les bois se retirent.
Ils avaient averti leurs gens secrètement.
Les chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement,
Furent étranglés en dormant :
Cela fut sitôt fait qu’à peine ils le sentirent.
Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échappa.
Nous pouvons conclure de là
Qu’il faut faire aux méchants guerre continuelle.
La paix est fort bonne de soi,
J’en conviens ; mais de quoi sert-elle
Avec des ennemis sans foi ?

LA BELETTE ENTREE DANS UN GRENIER
Damoiselle Belette, au corps long et fluet,
Entra dans un grenier par un trou fort étroit :
Elle sortait de maladie.
Là, vivant à discrétion,
La galante fit chère lie,
Mangea, rongea : Dieu sait la vie,
Et le lard qui périt en cette occasion !
La voilà, pour conclusion,
Grasse, mafflue et rebondie.
Au bout de la semaine, ayant dîné son soûl,
Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou,
Ne peut plus repasser, et croit s’être méprise
Après avoir fait quelques tours,
« C’est, dit-elle, l’endroit : me voilà bien surprise ;
J’ai passé par ici depuis cinq ou six jours. »
Un Rat, qui la voyait en peine,
Lui dit : « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l’on le dit à bien d’autres ;
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
Leurs affaires avec les vôtres. »

LE RENARD ET LES RAISINS
Certain Renard gascon, d’autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galant en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n’y pouvait atteindre :
« Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. »
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
FABLES - LIVRE IV
Fable I. -Le lion amoureux
Fable II. -Le berger et !a mer
Fable III. -La mouche et la fourmi
Fable IV. -Le jardinier et son seigneur
Fable V. - L'âne et le petit chien
Fable VI. -Le combat des rats et des belettes
Fable VII. -Le singe et le dauphin
Fable VIII. - L'homme et l'idole de bois
Fable IX. -Le geai paré des plumes du paon
Fable X. -Le chameau et les bâtons flottants.
Fable XI. -La grenouille et le rat.
Fable XII -Tribut envoyé par les animaux à Alexandre.
Fable XIIL -Le cheval s'étant voulu venger du cerf.
Fable XIV - Le renard et le buste
Fable XV - Le loup, la chèvre et le chevreau
Fable XVI - Le loup, la mère et l'enfant
Fable XVII. - Parole de Socrate
Fable XVIII. - Le vieillard et ses enfants
Fable XIX. -L'oracle et l'impie
Fable XX. - L'avare qui a perdu son trésor
Fable XXI. - L'œil du maître
Fable XXII. -L'alouette et ses petits, avec le maître d'un champ.

FABLES - LIVRE IV
LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR
Un amateur du jardinage,
Demi-bourgeois, demi-manant,
Possédait en certain village
Un jardin assez propre, et le clos attenant.
Il avait de plant vif fermé cette étendue.
Là croissait à plaisir l’oseille et la laitue,
De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet,
Peu de jasmin d’Espagne, et force serpolet.
Cette félicité par un lièvre troublée
Fit qu’au Seigneur du Bourg notre homme se plaignit.
« Ce maudit animal vient prendre sa goulée
Soir et matin, dit-il, et des pièges se rit ;
Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit :
Il est sorcier, je crois. – Sorcier ? je l’en défie,
Repartit le Seigneur . Fût-il diable, Miraut,
En dépit de ses tours, l’attrapera bientôt.
Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie.
– Et quand ? – Et dès demain, sans tarder plus longtemps. »
La partie ainsi faite, il vient avec ses gens.
« Çà, déjeunons, dit-il : vos poulets sont-ils tendres ?
La fille du logis, qu’on vous voie, approchez :
Quand la marierons-nous ? quand aurons-nous des gendres ?
Bonhomme, c’est ce coup qu’il faut, vous m’entendez
Qu’il faut fouiller à l’escarcelle. »
Disant ces mots, il fait connaissance avec elle,
Auprès de lui la fait asseoir,
Prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir,
Toutes sottises dont la belle
Se défend avec grand respect ;
Tant qu’au père à la fin cela devient suspect.
Cependant on fricasse, on se rue en cuisine.
« De quand sont vos jambons ? ils ont fort bonne mine.
– Monsieur, ils sont à vous. – Vraiment ! dit le Seigneur,
Je les reçois, et de bon cœur. »
Il déjeune très bien ; aussi fait sa famille,
Chiens, chevaux, et valets, tous gens bien endentés :
Il commande chez l’hôte, y prend des libertés,
Boit son vin, caresse sa fille.
L’embarras des chasseurs succède au déjeuné.
Chacun s’anime et se prépare :
Les trompes et les cors font un tel tintamarre
Que le bonhomme est étonné.
Le pis fut que l’on mit en piteux équipage
Le pauvre potager ; adieu planches, carreaux ;
Adieu chicorée et poireaux ;
Adieu de quoi mettre au potage.
Le lièvre était gîté dessous un maître chou.
On le quête ; on le lance, il s’enfuit par un trou,
Non pas trou, mais trouée, horrible et large plaie
Que l’on fit à la pauvre haie
Par ordre du Seigneur ; car il eût été mal
Qu’on n’eût pu du jardin sortir tout à cheval.
Le bonhomme disait : « Ce sont là jeux de prince. »
Mais on le laissait dire ; et les chiens et les gens
Firent plus de dégât en une heure de temps
Que n’en auraient fait en cent ans
Tous les lièvres de la province.
Petits princes, videz vos débats entre vous :
De recourir aux rois vous seriez de grands fous.
Il ne les faut jamais engager dans vos guerres,
Ni les faire entrer sur vos terres.
FABLES - LIVRE V
Fable I. - Le bûcheron et Mercure.
Fable II. - Le pot de terre et le pot de fer
Fable III - Le petit poisson et le pêcheur
Fable IV. -Les oreilles du lièvre.
Fable V. -Le renard ayant la queue coupée.
Fable VI. -La vieille et les deux servantes.
Fable VII. -Le satyre et le passant.
Fable VIII. -Le cheval et le loup
Fable IX - Le Laboureur et ses enfants
Fable X. - La montagne qui accouche.
Fable XI. - La fortune et le jeune enfant.
Fable XII. - Les médecins
Fable XIII. -La poule aux œufs d'or
Fable XIV. - L'âne portant des reliques
Fable XV. - Le cerf et la vigne
Fable XVI. - Le serpent et la lime
Fable XVII. - Le lièvre et la perdrix
Fable XVIII. - L'aigle et le hibou
Fable XIX. - Le lion s'en allant en guerre
Fable XX. - L'ours et les deux compagnons
Fable XXI. - L'âne vêtu de la peau du lion

LE PETIT POISSON ET LE PÊCHEUR
Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie.
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c’est folie ;
Car de le rattraper il n’est pas trop certain.
Un Carpeau qui n’était encore que fretin
Fut pris par un Pêcheur au bord d’une rivière.
Tout fait nombre, dit l’homme en voyant son butin ;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le en notre gibecière.
Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière :
Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir
Au plus qu’une demi-bouchée ;
Laissez-moi Carpe devenir :
Je serai par vous repêchée.
Quelque gros Partisan m’achètera bien cher,
Au lieu qu’il vous en faut chercher
Peut-être encor cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi ; rien qui vaille.
– Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le Pêcheur ;
Poisson, mon bel ami, qui faites le Prêcheur,
Vous irez dans la poêle ; et vous avez beau dire,
Dès ce soir on vous fera frire.
Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras :
L’un est sûr, l’autre ne l’est pas.

LE POT DE TERRE ET LE POT DE FER
Le Pot de fer proposa
Au Pot de terre un voyage.
Celui-ci s’en excusa,
Disant qu’il ferait que sage
De garder le coin du feu :
Car il lui fallait si peu,
Si peu, que la moindre chose
De son débris serait cause :
Il n’en reviendrait morceau.
« Pour vous, dit-il, dont la peau
Est plus dure que la mienne,
Je ne vois rien qui vous tienne.
– Nous vous mettrons à couvert,
Repartit le Pot de fer :
Si quelque matière dure
Vous menace, d’aventure,
Entre deux je passerai,
Et du coup vous sauverai. »
Cette offre le persuade.
Pot de fer son camarade
Se met droit à ses côtés.
Mes gens s’en vont à trois pieds,
Clopin-clopant, comme ils peuvent,
L’un contre l’autre jetés
Au moindre hoquet qu’ils trouvent.
Le Pot de terre en souffre ; il n’eut pas fait cent pas
Que par son compagnon il fut mis en éclats,
Sans qu’il eût lieu de se plaindre.
Ne nous associons qu’avecque nos égaux ;
Ou bien il nous faudra craindre
Le destin d’un de ces pots.

LE LABOUREUR ET SES ENFANTS
Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
FABLES - LIVRE VI
Fable I. - Le pâtre et le lion
Fable II. - Le lion et le chasseur
Fable III. - Phébus et Borée
Fable IV. - Jupiter et le métayer
Fable V. - Le cochet, le chat, et le souriceau
Fable VI. - Le renard, le singe et les animaux
Fable VII. - Le mulet se vantant de sa généalogie
Fable VIII. - Le vieillard et l'âne
Fable IX. - Le cerf se voyant dans l'eau
Fable X - Le Lièvre et la tortue
Fable XI. - L'âne et ses maître
Fable XII. - Le soleil et les grenouilles
Fable XIII. - Le villageois et le serpent
Fable XIV. - Le lion malade et le renard
Fable XV. - L'oiseleur, l'autour et l'alouette
Fable XVI - Le cheval et l'âne
Fable XVII. - Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre
Fable XVIII. - Le Chartier embourbé
Fable XIX - Le charlatan
Fable XX. - La Discorde
Fable XXI - La jeune veuve.

LE LIEVRE ET LA TORTUE
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. – Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l’animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
– Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s’évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. A la fin quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?

LE CHEVAL ET L'ÂNE
En ce monde il se faut l'un l'autre secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
C'est sur toi que le fardeau tombe.
Un Ane accompagnait un Cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre Baudet si chargé qu'il succombe.
Il pria le Cheval de l'aider quelque peu :
Autrement il mourrait devant qu'être à la ville.
La prière, dit-il, n'en est pas incivile :
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu.
Le Cheval refusa, fit une pétarade :
Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu'il avait tort.
Du Baudet, en cette aventure,
On lui fit porter la voiture,
Et la peau par-dessus encor.

LE CHIEN QUI LÂCHE SA PROIE POUR L'OMBRE
Chacun se trompe ici-bas :
On voit courir après l’ombre
Tant de fous qu’on n’en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au Chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.
Ce Chien, voyant sa proie en l’eau représentée,
La quitta pour l’image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d’un coup agitée ;
À toute peine il regagna les bords,
Et n’eut ni l’ombre ni le corps.

LA JEUNE VEUVE
La perte d’un époux ne va point sans soupirs :
On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.
Sur les ailes du Temps la tristesse s’envole ;
Le Temps ramène les plaisirs.
Entre la Veuve d’une année
Et la Veuve d’une journée
La différence est grande : on ne croirait jamais
Que ce fût la même personne ;
L’une fait fuir les gens, et l’autre a mille attraits :
Aux soupirs vrais ou faux celle-là s’abandonne ;
C’est toujours même note et pareil entretien.
On dit qu’on est inconsolable :
On le dit ; il n’en est rien,
Comme on verra par cette fable,
Ou plutôt par la vérité.
L’époux d’une jeune beauté
Partait pour l’autre monde. À ses côtés sa femme
Lui criait : « Attends-moi, je te suis ; et mon âme,
Aussi bien que la tienne, est prête à s’envoler. »
Le mari fait seul le voyage.
La belle avait un père, homme prudent et sage ;
Il laissa le torrent couler.
À la fin, pour la consoler :
« Ma fille, lui dit-il, c’est trop verser de larmes :
Qu’a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes ?
Puisqu’il est des vivants, ne songez plus aux morts.
Je ne dis pas que tout à l’heure
Une condition meilleure
Change en des noces ces transports ;
Mais après certain temps souffrez qu’on vous propose
Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose
Que le défunt. – Ah ! dit-elle aussitôt,
Un cloître est l’époux qu’il me faut. »
Le père lui laissa digérer sa disgrâce.
Un mois de la sorte se passe ;
L’autre mois, on l’emploie à changer tous les jours
Quelque chose à l’habit, au linge, à la coiffure :
Le deuil enfin sert de parure,
En attendant d’autres atours.
Toute la bande des Amours
Revient au colombier ; les jeux, les ris, la danse
Ont aussi leur tour à la fin :
On se plonge soir et matin
Dans la fontaine de Jouvence.
Le père ne craint plus ce défunt tant chéri ;
Mais comme il ne parlait de rien à notre belle :
« Où donc est le jeune mari
Que vous m’avez promis ? » dit-elle.
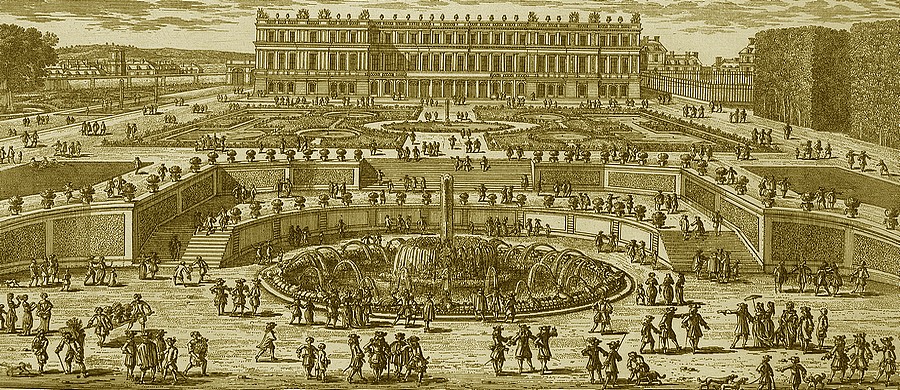

En 1669, La Fontaine est honoré d'une audience à Versailles pour présenter à Louis XIV ses "Amours de Psyché et de Cupidon". De la fameuse légende antique, au sens si profond, Apulée su tirer un roman et La Fontaine en fit un «conte plein de merveilleux à la vérité, mais d'un merveilleux accompagné de badineries» (Préface), mais c'est l'unique roman de la Fontaine, et il dérouta quelque peu ses contemporains. Il faut ajouter qu'il conte tout à la fois une histoire, et l'histoire de l'écriture de celle-ci, n'omettant aucune des difficultés qu'il a pu rencontrer dans la construction de son unique roman...
Le roman comprend deux livres. Le premier s'ouvre par un morceau célèbre, l'entretien de quatre poètes dans le parc de Versailles, Polyphile (La Fontaine), Acante (Racine), Ariste (Boileau) et Gélaste (Molière peut-être, Chapelle sans doute). Nos quatre promeneurs ont alors sous les yeux le théâtre et la galerie improvisés le 16 mai 1664 pour le divertissement des Plaisirs de l'île enchantée. "Quatre amis dont la connoissance avoit commencé par le Parnasse", et dont les réunions se tenaient sans doute soit dans une chambre que Boileau avait louée tout exprès dans la rue du Colombier, soit à la Croix-de- Lorraine, au Mouton-Blanc, à la Pomme-de-Pin, ou dans quelque autre cabaret. Après avoir célébré la gloire de Louis XIV, les quatre amis visitent donc l'intérieur du palais, passent dans le jardin et obtiennent qu'on les laisse dans la grotte de Thétis, vaste salle de rocaille où, parmi les cascades et les jets d'eau, se dressent l'Apollon de Girardon et les Chevaux de Mars. Dans un coin de la grotte, ils s'assoient autour de La Fontaine qui prend son cahier et commence les Aventures de Psyché; un récit que viendront interrompre des intermèdes littéraires...
"Quatre amis, dont la connaissance avait commencé par le Parnasse, lièrent une espèce de société que j'appellerais académie si leur nombre eût été plus grand, et qu'ils eussent autant regardé les muses que le plaisir. La première chose qu'ils firent, ce fut de bannir d'entre eux les conversations réglées, et tout ce qui sent sa conférence académique. Quand ils se trouvaient ensemble et qu'ils avaient bien parlé de leurs divertissements, si le hasard les faisait tomber sur quelque point de science ou de belles-lettres, ils profitaient de l'occasion : c'était toutefois sans s'arrêter trop longtemps à une même matière, voltigeant de propos en autres, comme des abeille qui rencontreraient en leur chemin diverses sortes de fleurs. L'envie, la malignité, ni la cabale, n'avaient de voix parmi eux. Ils adoraient les ouvrages des anciens, ne refusaient point à ceux des modernes les louanges qui leur sont dues, parlaient des leurs avec modestie, et se donnaient des avis sincères lorsque quelqu'un d'eux tombait dans la maladie du siècle, et faisait un livre, ce qui arrivait rarement.
Polyphile (La Fontaine) y était le plus sujet (c'est le nom que je donnerai à l'un de ces quatre amis). Les aventures de Psyché lui avaient semblé fort propres pour être contées agréablement. Il y travailla longtemps sans en parler à personne ; enfin il communiqua son dessein à ses trois amis, non pas pour leur demander s'il continuerait, mais comment ils trouvaient à propos qu'il continuât. L'un lui donna un avis, l'autre un autre: de tout cela il ne prit que ce qu'il lui plut. Quand l'ouvrage fut achevé, il demanda jour et rendez-vous pour le lire.
Acante (Racine) ne manqua pas, selon sa coutume, de proposer une promenade en quelque lieu, hors de la ville, qui fût éloigné, et où peu de gens entrassent: on ne les viendrait point interrompre: ils écouteraient cette lecture avec moins de bruit et plus de plaisir. Il aimait extrêmement les jardins, les fleurs, les ombrages. Polyphile lui ressemblait en cela; mais on peut dire que celui-ci aimait toutes choses. Ces passions, qui leur remplissaient le cœur d'une certaine tendresse, se répandaient jusqu'en leurs écrits, et en formaient le principal caractère. Ils penchaient tous deux vers le lyrique, avec cette différence qu'Acante avait quelque chose de plus touchant, Polyphile de plus fleurie. Des deux autres amis, que j'appellerai Ariste et Gélaste, l'un était sérieux sans être incommode; l'autre était fort gai.
La proposition d'Acante fut approuvée. Ariste dit qu'il y avait de nouveaux établissements à Versailles: il fallait les aller voir, et partir matin, afin d'avoir le loisir de se promener après qu'ils auraient entendu les aventures de Psyché. La partie fut incontinent conclue: dès le lendemain ils l'exécutèrent. Les jours étaient encore assez longs, et la saison belle: c'était pendant le dernier automne.
Nos quatre amis, étant arrivés à Versailles de fort bonne heure, voulurent voir, avant le diner, la ménagerie : c'est un lieu rempli de plusieurs sortes de volatiles et de quadrupèdes, la plupart très rares et de pays éloignés....
Comme nos gens avaient encore du loisir, ils firent un tour à l'orangerie. La beauté et le nombre des orangers et des autres plantes qu'on y conserve ne se saurait exprimer. Il y a tel de ces arbres qui a résisté aux attaques de cent hivers...
La nécessité de manger fit sortir nos gens de ce lieu si délicieux. Tout leur dîner se passa à s'entretenir des choses qu'ils avaient vues, et à parler du monarque pour qui on a assemblé tant de beaux objets. Les réflexions de nos quatre amis finirent avec leur repas. Ils retournèrent au château, virent les dedans, que je ne décrirai point: ce serait une œuvre infinie...
Du château ils passèrent dans les jardins, et prièrent celui qui les conduisait de les laisser dans la grotte jusqu'à ce que la chaleur fût adoucie ; ils avaient fait apporter des sièges. Leur billet venait de si bonne part qu'on leur accorda ce qu'ils demandaient: même, afin de rendre le lieu plus frais, on en fit jouer les eaux.
... Les quatre amis ne voulurent point être mouillés; ils prièrent celui qui leur faisait voir la grotte de réserver ce plaisir pour le bourgeois ou pour l'Allemand, et de les placer en quelque coin où ils fussent à couvert de l'eau. Ils furent traités comme ils souhaitaient. Quand leur conducteur les eut quittés, ils s'assirent à l'entour de Polyphile, qui prit son cahier; et, ayant toussé pour se nettoyer la voix, il commença."
Dans cette première partie, on nous conte que Psyché était si belle que Vénus en fut jalouse. Un oracle fait connaître que la jeune fille deviendra l'épouse d'un monstre. Pour éviter une telle disgrâce, elle quitte ses parents. Un char la transporte dans un lieu solitaire : soudainement, elle se sent soulever et enlever par le Zéphyr, qui la porte dans un palais dont elle tombe sous le charme. La belle y trouve un mari plein d'égards et de tendresse; mais un mari dont elle n'entend que la voix, il demeure pour sa femme absolument invisible. Rien ne manquerait à la satisfaction de Psyché, si ce n'était l'obstination de son époux à n'être jamais vu d'elle. Elle s'ouvre à lui du désir qui l'obsède...
"Nos amants s'entretenaient à leur ordinaire, et la jeune épouse, qui ne songeait qu'aux moyens de voir son mari, ne perdait pas une seule occasion de lui en parler. De discours en autre ils vinrent aux merveilles de ce séjour. Après que la belle eut fait une longue énumération des plaisirs qu'elle y rencontrait, disait-elle, de tous côtés, il se trouva qu'à son compte le principal point y manquait. Son mari ne voyait que trop où elle avait dessein d'en venir; mais, comme entre amants les contestations sont quelquefois bonnes à plus d'une chose, il voulut qu'elle s'expliquât, et lui demanda ce que ce pouvait être que ce point d'une si grande importance, vu qu'il avait donné ordre aux fées que rien ne manquât. « Je n'ai que faire des fées pour cela, repartit la belle : voulez-vous me rendre tout à fait heureuse ? je vous en enseignerai un moyen bien court: il ne faut... Mais je vous l'ai dit tant de fois inutilement, que je n'oserais plus vous le dire.
— Non, non, reprit le mari, n'appréhendez pas de m'être importune : je veux bien que vous me traitiez comme on fait les dieux ; ils prennent plaisir à se faire demander cent fois une même chose : qui vous a dit que je ne suis pas de leur naturel? »
Notre héroïne, encouragée par ces paroles, lui repartit : « Puisque vous me le permettez, je vous dirai franchement que tous vos palais, tous vos meubles, tous vos jardins, ne sauraient me récompenser d'un moment de votre présence, et vous voulez que j'en sois tout à fait privée : car je ne puis appeler présence un bien où les yeux n'ont aucune part.
— Quoi ! je ne suis pas maintenant de corps auprès de vous, reprit le mari, et vous ne me touchez pas?
— Je vous touche, repartit-elle, et sens bien que vous avez une bouche, un nez, des yeux, un visage, tout cela proportionné comme il faut, et, selon que je m'imagine, assorti de traits qui n'ont pas leurs pareils au monde ; mais jusqu'à ce que j'en sois assurée, cette présence de corps dont vous me parlez est présence d'esprit pour moi.
— Présence d'esprit! » repartit l'époux. Psyché l'empêcha de continuer, et lui dit en l'interrompant : « Apprenez-moi du moins les raisons qui vous rendent si opiniâtre.
— Je ne vous les dirai pas toutes, reprit l'époux ; mais, afin de vous contenter en quelque façon, examinez la chose en vous-même ; vous serez contrainte de m'avouer qu'il est à propos pour l'un et pour l'autre de demeurer en l'état où nous nous trouvons. Premièrement, tenez-vous certaine que du moment que vous n'aurez plus rien à souhaiter, vous vous ennuierez : et comment ne vous ennuieriez-vous pas? les dieux s'ennuient bien ; ils sont contraints de se faire de temps en temps des sujets de désir et d'inquiétude : tant il est vrai que l'entière satisfaction et le dégoût se tiennent la main! Pour ce qui me touche, je prends un plaisir extrême à vous voir en peine; d'autant plus que votre imagination ne se forge guère de monstres, j'entends d'images de ma personne, qui ne soient très agréables. Et pour vous dire une raison plus particulière, vous ne doutez pas qu'il n'y ait quelque chose en moi de surnaturel. Nécessairement je suis dieu, ou je suis démon, ou bien enchanteur. Si vous trouvez que je sois démon, vous me haïrez ; et si je suis dieu, vous cesserez de m'aimer, ou du moins vous ne m'aimerez plus avec tant d'ardeur ; car il s'en faut bien qu'on aime les dieux aussi violemment que les hommes. Quant au troisième, il y a des enchanteurs agréables : je puis être de ceux-là; et possible suis-je tous les trois ensemble. Ainsi le meilleur pour vous est l'incertitude, et que vous ayez toujours de quoi désirer: c'est un secret dont on ne s'était pas encore avisé. Demeurons-en là, si vous m'en croyez : je sais ce que c'est d'amour, et le dois savoir.»
Psyché se paya de ces raisons, ou, si elle ne s'en paya, elle fit semblant de s'en payer."
Cependant la curiosité et l'ennui continuent de travailler l'esprit de la jeune épousée. Ses deux sœurs viennent lui rendre visite et parviennent à la persuader que son époux est un être méchant, qu'il faut le tuer. Munie d'un poignard et d'une lampe, elle approche en tremblant de l'Amour endormi, et voilà qu'il lui apparaît, pour la première fois, dans sa beauté de jeune dieu. Mais une goutte d'huile brûlante est tombée de la lampe, la douleur le réveille, que la colère et l'indignation vont redoubler... Mais comment finir l'histoire? La réponse va dériver sur une comparaison entre comédie et tragédie, le plaisir de rire et celui de pleurer....
"Je vous soutiens donc, reprend Gélaste, que, les choses étant égales, la plus saine partie du monde préférera toujours la comédie à la tragédie. Que dis-je, la plus saine partie du monde ? mais tout le monde. Je vous demande où le goût universel d'aujourd'hui se porte. La cour, les dames, les cavaliers, les savants, le peuple, tout demande la comédie, point de plaisir, que la comédie. Aussi voyons-nous qu'on se sert indifféremment de ce mot de comédie pour qualifier tous les divertissements du théâtre. On n'a jamais dit : Les tragédiens, ni : Allons à la tragédie.
— Vous en savez mieux que moi la véritable raison, dit Ariste, et que cela vient du mot de bourgade, en grec. Comme cette érudition serait longue, et qu'aucun de nous ne l'ignore, je la laisse à part, et m'arrêterai seulement à ce que vous dites. Parce que le mot de comédie est pris abusivement pour toutes les espèces du dramatique, la comédie est préférable à la tragédie : n'est-ce pas là bien conclure? Cela fait voir seulement que la comédie est plus commune ; et parce qu'elle est plus commune, je pourrais dire qu'elle touche moins les esprits.
— Voilà bien conclure à votre tour, répliqua Gélaste: le diamant est plus commun que certaines pierres ; donc le diamant touche moins les yeux. Hé! mon ami! ne voyez-vous pas qu'on ne se lasse jamais de rire? On peut se lasser du jeu, de la bonne chère, mais de rire, point. Avez- vous entendu dire à qui que ce soit : Il y a huit jours entiers que nous rions; je vous prie, pleurons aujourd'hui?
— Vous sortez toujours, dit Ariste, de notre thèse, et apportez des raisons si triviales que j'en ai honte pour vous .
— Voyez un peu l'homme difficile ! reprit Gélaste. Et vraiment, puisque vous voulez que je discoure de la comédie et du rire en philosophe platonicien, j'y consens; faites-moi seulement la grâce de m'écouter. Le plaisir dont nous devons faire le plus de cas est toujours celui qui convient le mieux à notre nature; car c'est s'unir à soi-même que de le goûter. Or y-a-t-il rien qui nous convienne mieux que le rire? Il n'est pas moins naturel à l'homme que la raison; il lui est même particulier : vous ne trouverez aucun animal qui rie, et en rencontrerez quelques-uns qui pleurent. Je vous défie, tout sensible que vous êtes, de jeter des larmes aussi grosses que celles d'un cerf qui est aux abois, ou du cheval de ce pauvre prince dont on voit Ia pompe funèbre dans l'onzième livre de l'Enéide. Tombez d'accord de ces vérités ; je vous laisserai après pleurer tant qu'il vous plaira : vous tiendrez compagnie au cheval du pauvre Pallas,et moi je rirai avec tous les hommes. »
La conclusion de Gélaste fit rire ses trois amis, Ariste comme les autres : après quoi celui-ci dit : « Je vous nie vos deux propositions, aussi bien la seconde que la première. Quelque opinion qu'ait eue l'école jusqu'à présent, je ne conviens pas avec elle que le rire appartienne à l'homme privativement au reste des animaux. Il faudrait entendre la langue de ces derniers pour connaître qu'ils ne rient point. Je les tiens sujets à toutes nos passions : il n'y a, pour ce point-là, de différence entre nous et eux que du plus au moins, et en la manière de s'exprimer. Quant à votre première proposition, tant s'en faut que nous devions toujours courir après les plaisirs qui nous sont les plus naturels, et que nous avons le plus à notre commandement, que ce n'est pas même un plaisir de posséder une chose très commune. De là vient que dans Platon l'Amour est fils de la pauvreté, voulant dire que nous n'avons de passion que pour les choses qui nous manquent, et dont nous sommes nécessiteux. Ainsi le rire, qui nous est, à ce que vous dites, si familier, sera, dans la scène, le plaisir des laquais et du menu peuple; le pleurer, celui des honnêtes gens.
— Vous poussez la chose un peu trop loin, dit Acante ; je ne tiens pas que le rire soit interdit aux honnêtes gens. — Je ne le tiens pas non plus, reprit Arisle. Ce que je dis n'est que pour payer Gélaste de sa monnaie. Vous savez combien nous avons ri en lisant Térence, et combien je ris en voyant les Italiens: je laisse à la porte ma raison et mon argent, et je ris après tout mon soûl. Mais que les belles tragédies ne nous donnent une volupté plus grande que celle qui vient du comique, Gélaste ne le niera pas lui-même, s'il y veut faire réflexion.
— Il faudrait, repartit froidement Gélaste, condamner à une très grosse amende ceux qui font ces tragédies dont vous nous parlez. Vous allez là pour vous réjouir, et vous y trouvez un homme qui pleure auprès d'un autre homme, et cet autre auprès d'un autre, et tous ensemble avec la comédienne qui représente Andromaque, et la comédienne avec le poète : c'est une chaîne de gens qui pleurent, comme dit votre Platon. Est-ce ainsi que l'on doit contenter ceux qui vont là pour se réjouir ?
— Ne dites point qu'ils y vont pour se réjouir, reprit Ariste; dites qu'ils y vont pour se divertir. Or je vous soutiens, avec le même Platon, qu'il n'y a divertissement égal à la tragédie, ni qui mène plus les esprits où il plait au poète. Le mot dont se sert Platon fait que je me figure le même poète se rendant maître de tout un peuple, et faisant aller les âmes comme des troupeaux et comme s'il avait en ses mains la baguette du dieu Mercure. Je vous soutiens, dis-je, que les maux d'autrui nous divertissent, c'est-à-dire qu'ils nous attachent l'esprit.
— Ils peuvent attacher le vôtre agréablement, poursuivit Gélaste, mais non pas le mien. En vérité, je vous trouve de mauvais goût. Il vous suffît que l'on vous attache l'esprit ; que ce soit avec des charmes agréables ou non, avec les serpents de Tisiphone, il ne vous importe. Quand vous me feriez passer l'effet de la tragédie pour une espèce d'enchantement, cela ferait-il que l'effet de la comédie n'en fût un aussi? Ces deux choses étant égales, serez-vous si fou que de préférer la première à l'autre?
— Mais vous-même, reprit Ariste, osez-vous mettre en comparaison le plaisir du rire avec la pitié? la pitié, qui est un ravissement, une extase? Et comment ne le serait-elle pas, si les larmes que nous versons pour nos propres maux sont (au sentiment d'Homère, non pas tout à fait au mien); si les larmes, dis-je, sont, au sentiment de ce divin poète, une espèce de volupté? Car en cet endroit- il fait pleurer Achille et Priam, l'un du souvenir de Patrocle, l'autre de la mort du dernier de ses enfants ; il dit qu'ils se soûlent de ce plaisir; il les fait jouir du pleurer, comme si c'était quelque chose de délicieux.
— Le ciel vous veuille envoyer beaucoup de jouissances pareilles! reprit Gélaste; je n'en serai nullement jaloux. Ces extases de la pitié n'accommodent pas un homme de mon humeur. Le rire a pour moi quelque chose de plus vif et de plus sensible : enfin le rire me rit davantage. Toute la nature est en cela de mon avis. Allez-vous-en à la cour de Cythérée, vous y trouverez des ris, et jamais de pleurs.
— Nous voici déjà retombés, dit Ariste, dans ces raisons qui n'ont aucune solidité : vous êtes le plus frivole défenseur de la comédie que j'aie vu depuis longtemps.
— Et nous voici retombés dans le platonisme, répliqua Gélaste : demeurons-y donc, puisque cela vous plaît tant. Je m'en vais vous dire quelque chose d'essentiel contre le pleurer, et veux vous convaincre par ce même endroit d'Homère dont vous avez fait votre capital. Quand Achille a pleuré son saoûl (par parenthèse, je crois qu'Achille ne riait pas de moins bon courage ; tout ce que font les héros, ils le font dans le suprême degré de perfection); lorsque Achille, dis-je, s'est rassasié de ce beau plaisir de verser des larmes, il dit à Priam : "Vieillard, tu es misérable : telle est la condition des mortels, ils passent leur vie dans les pleurs. Les dieux seuls sont exempts de mal, et vivent là-haut à leur aise, sans rien souffrir." Que répondrez-vous à cela?
— Je répondrai, dit Ariste, que les mortels sont mortels quand ils pleurent de leurs douleurs; mais, quand ils pleurent des douleurs d'autrui, ce sont proprement des dieux.
— Les dieux ne pleurent ni d'une façon ni d'une autre, reprit Gélaste : pour le rire, c'est leur partage. Qu'il ne soit ainsi : Homère dit en un autre endroit que, quand les bienheureux Immortels virent Vulcain, qui boitait dans leur maison, il leur prit un rire inextinguible. Par ce mot d'inextinguible, vous voyez qu'on ne peut trop rire ni trop longtemps; par celui de bienheureux, que la béatitude consiste au rire.
— Par ces deux mots que vous dites, reprit Ariste, je vois qu'Homère a failli, et ne vois rien autre chose. Platon l'en reprend dans son troisième de la "République". Il le blâme de donner aux dieux un rire démesuré, et qui serait même indigne de personnes tant soit peu considérables.
— Pourquoi voulez-vous qu'Homère ait plutôt failli que Platon? répliqua Gélaste. Mais laissons les autorités, et n'écoutons que la raison seule. Nous n'avons quà examiner sans prévention la comédie et la tragédie. Il arrive assez souvent que cette dernière ne nous touche point : car le bien ou le mal d'autrui ne nous touche que par rapport à nous-mêmes, et en tant que nous croyons que pareille chose nous peut arriver, l'amour- propre faisant sans cesse que l'on tourne les yeux sur soi. Or, comme la tragédie ne nous représente que des aventures extraordinaires, et qui vraisemblablement ne nous arriveront jamais, nous n'y prenons point de part, et nous sommes froids, à moins que l'ouvrage ne soit excellent, que le poète ne nous transforme, que nous ne devenions d'autres hommes par son adresse, et ne nous mettions en la place de quelque roi. Alors j'avoue que la tragédie nous touche, mais de crainte, mais de colère, mais de mouvements funestes qui nous renvoient au logis pleins des choses que nous avons vues, et incapables de tout plaisir. La comédie, n'employant que des aventures ordinaires et qui peuvent nous arriver, nous touche toujours plus ou moins, selon son degré de perfection. Quand elle est fort bonne, elle nous fait rire. La tragédie nous attache, si vous voulez ; mais la comédie nous amuse agréablement et mène les âmes aux Champs-Elysées, au lieu que vous les menez dans la demeure des malheureux. Pour preuve infaillible de ce que j'avance, prenez garde que, pour effacer les impressions que la tragédie avait faites en nous, on lui faisait souvent succéder un divertissement comique ; mais de celui-ci à l'autre il n'y a point de retour ; ce qui vous fait voir que le suprême degré du plaisir, après quoi il n'y a plus rien, c'est la comédie. Quand on vous la donne, vous vous en retournez content et de belle humeur; quand on ne vous la donne pas, vous vous en retournez chagrin et rempli de noires idées. C'est ce qu'il y a à gagner avec les Orestes et les Œdipes, tristes fantômes qu'a évoqués le poète magicien dont nous avons parlé tantôt. Encore serions-nous heureux s'ils excitaient le terrible toutes les fois que l'on nous les fait paraître ; cela vaut mieux que de s'ennuyer ; mais où sont les habiles poètes qui nous dépeignent ces choses au vif ? Je ne veux pas dire que le dernier soit mort avec Euripide ou avec Sophocle ; je dis seulement qu'il n'y en a guère. La difficulté n'est pas si grande dans le comique ; il est plus assuré de nous toucher, en ce que ses incidents sont d'une telle nature que nous nous les appliquons à nous-mêmes plus aisément.
— Cette fois-là, dit Ariste, voilà des raisons solides, et qui méritent qu'on y réponde ; il faut y tâcher. Le même ennui qui nous fait languir pendant une tragédie où nous ne trouvons que de médiocres beautés, est commun à la comédie et à tous les ouvrages de l'esprit, particulièrement aux vers : je vous le prouverais aisément si c'était la question ; mais, ne s'agissant que de comparer deux choses également bonnes, chacune selon son genre, et la tragédie, à ce que vous dites vous- même, devant l'être souverainement, nous ne devons considérer la comédie que dans un pareil degré. En ce degré donc vous dites qu'on peut passer de la tragédie à la comédie ; et de celle-ci à l'autre, jamais. Je vous le confesse, mais je ne tombe pas d'accord de vos conséquences ni de la raison que vous apportez. Celle qui me semble la meilleure, est que dans la tragédie nous faisons une grande contention d'âme ; ainsi on nous représente ensuite quelque chose qui délasse notre cœur, et nous remet en l'état où nous étions avant le spectacle, afin que nous en puissions sortir ainsi que d'un songe. Par votre propre raisonnement, vous voyez déjà que la comédie touche beaucoup moins que la tragédie. Il reste à prouver que cette dernière est beaucoup plus agréable que l'autre. Mais auparavant, de crainte que la mémoire ne m'en échappe, je vous dirai qu'il s'en faut bien que la tragédie nous renvoie chagrins et mal satisfaits, la comédie tout à fait contents et de belle humeur ; car, si nous apportons à la tragédie quelque sujet de tristesse qui nous soit propre, la compassion en détourne l'effet ailleurs, et nous sommes heureux de répandre pour les maux d'autrui les larmes que nous gardions pour les nôtres. La comédie, au contraire, nous faisant laisser notre mélancolie à la porte, nous la rend lorsque nous sortons. Il ne s'agit donc que du temps que nous employons au spectacle et que nous ne saurions mieux employer qu'à la pitié. Premièrement, niez-vous qu'elle soit plus noble que le rire ?
— Il y a si longtemps que nous disputons, repartit Gélaste, que je ne vous veux plus rien nier...."

Marie-Anne Mancini (1649-1714, portrait par Benedetto Gennari, 1672–1673)..
La Fontaine dédiera "Psyché" à la duchesse de Bouillon sur un ton cérémonieux qui bientôt fera place à la plus galante familiarité. A treize ans, la nièce Mazarin, dont la soeur Marie Mancini fut le premier grand amour de Louis XIV, avait épousé Godefroy- Maurice, duc de Bouillon (il en vait quinze), qui, la même année, obtenait du Roi, en échange de la principauté de Sedan, le duché de Château-Thierry, celui d'Albret et les comtés d'Auvergne et d'Évreux. Peu de temps après son mariage, il s'en guerroyer contre les Turcs, et sa femme s'en fut demeurer à Château-Thierry, La Fontaine lui voua une affection qui jamais ne se démentit, et le duc revint de la guerre, La Fontaine continua de fréquenter à l'hôtel de Bouillon, rue des Petits-Champs, et plus tard dans la maison du quai Malaquais que la duchesse avait achetée au financier La Basinière et dont Mansart avait exécuté la construction. Le Brun les peintures et Le Nôtre les parterres : La Fontaine respirait avec délice l'air de libertinage qui régnait alors chez les Bouillon...
"Peut-on s'ennuyer en des lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
D'une aimable et vive princesse,
A pied blanc et mignon, à brune et longue tresse?
Nez troussé? C'est un charme encor selon mon sens :
C'en est même un des plus puissants.
Pour moi, le temps d'aimer est passé, je l'avoue,
Et je mérite qu'on me loue
De ce libre et sincère aveu,
Dont pourtant le public se souciera très peu :
Que j'aime ou n'aime pas, c'est pour lai même chose ;
Mais, s'il arrive que mon cœur
Retourne à l'avenir dans sa première erreur,
Nez aquilins et longs n'en seront pas la cause."

1671, Livre troisième des Contes,
13 contes et nouvelles, Les oies du Frère Philippe, La Mandragore, Les Rémois, La Coupe enchantée, Le Faucon, La Courtisane amoureuse, Nicaise, Le Bât, Le Baiser rendu, Alis malade, L'Amour mouillé, Le Petit Chien...
Mme de Sévigné, dans sa lettre du 13 mars 1671, annonce à sa fille qu'elle lui envoie la troisième partie des Contes qui viennent de paraître, et que dans sa lettre du 6 mai elle lui fait surtout l'éloge des "Oies de frère Philippe", des "Rémois", du "Petit chien qui secoue des perles et des pierreries". Le 1er mars 1672, elle se prépare à lui envoyer encore des contes de La Fontaine pour la divertir; elle y revient le 9 mars, de nouveaux contes donc, mis au jour depuis le volume de 1671, sans doute de ceux qui constitueront la quatrième partie.
L'Amour Mouillé...
J'étois couché mollement,
Et, contre mon ordinaire,
Je dormois tranquillement,
Quand un enfant s'en vint faire
A ma porte quelque bruit.
Il pleuvoit fort cette nuit :
Le vent, le froid et l'orage
Contre l'enfant faisoient rage.
« Ouvrez, dit-il, je suis nu. »
Moi, charitable et bonhomme,
J'ouvre au pauvre morfondu,
Et m'enquiers comme il se nomme.
« Je te le dirai tantôt,
Repartit-il, car il faut
Qu'auparavant je m'essuie. »
J'allume aussitôt du feu.
Il regarde si la pluie
N'a point gâté quelque peu
Un arc dont je me méfie.
Je m'approche toutefois,
Et de l'enfant prends les doigts,
Les réchauffe ; et dans moi-même
Je dis : « Pourquoi craindre tant ?
Que peut-il ? C'est un enfant :
Ma couardise est extrême
D'avoir eu le moindre effroi ;
Que seroit-ce si chez moi
J'avois reçu Polyphème ? »
L'enfant, d'un air enjoué,
Ayant un peu secoué
Les pièces de son armure
Et sa blonde chevelure,
Prend un trait, un trait vainqueur,
Qu'il me lance au fond du coeur.
« Voilà, dit-il, pour ta peine.
Souviens-toi bien de Climène,
Et de l'Amour, c'est mon nom.
- Ah ! je vous connois, lui dis-je,
Ingrat et cruel garçon !
Faut-il que qui vous oblige
Soit traité de la façon ! »
Amour fit une gambade ;
Et le petit scélérat
Me dit : « Pauvre camarade,
Mon arc est en bon état,
Mais ton coeur est bien malade. »

1673-1692 - A la mort de duchesse d'Orléans, La Fontaine s'installe chez son amie Mme de La Sablière (1640-1693), où il restera de 1673 à 1693....
"Elle était, dit un de ses portraits, d'une taille médiocre, mais aisée et tout à fait proportionnée. Elle avait des cheveux d'un blond cendré, le plus beau qu'on puisse imaginer; les yeux bleus, doux, fins et brillants, quoiqu'ils ne fussent pas des plus grands; le tour du visage ovale; le teint vif et uni; la peau d'une blancheur à éblouir; les plus belles mains et la plus belle gorge du monde. Joignez à tout cela un certain air touchant de douceur et d'enjouement, répandu sur toute sa personne...." (le Mercure galant de juillet 1678; tableau de Henri ou Charles Beaubrun, Château de Bussy-Rabutin).
Marguerite Hessein avait épousé, en 1654, Antoine Rambouillet de La Sablière, fils du financier Rambouillet, un des titulaires des cinq grosses fermes. Mais il était aussi considéré comme homme d'esprit et de plaisir. Quant à Mme de La Sablière, elle fut considérée comme l'une des femmes les plus distinguées d'un siècle où les femmes eurent un rôle particulièrement important. Elle eut cette originalité d'aimer tant la science que la littérature. Le célèbre François Bernier (1620-1688), son ami particulier et auteur du fameux "Voyage dans les États du Grand Mogol" (1671), et qui logeait chez elle, lui avait enseigné l'histoire naturelle et l'anatomie, et l'avait initiée aux hautes spéculations de la philosophie; c'est pour elle qu'il fit un excellent abrégé des ouvrages de Gassendi, où le système de ce précurseur de Newton et de Locke se trouve exposé avec le plus de clarté. On recevait chez elle la bonne et la libre compagnie, les grands seigneurs mauvais sujets, Lauzun, Brancas, Rochefort, le duc de Foix; les savants, les poètes, Chaulieu et La Fontaine. M. de La Sablière, qui n'était plus jeune (il était né vers 1615), après de nombreuses galanteries, s'éprit de la fille d'un Hollandais nommé Vanghangel et dont la soudaine mort l'affecta irrémédiablement. Quant à Mme de La Sablière, son attachement au marquis de La Fare précipitera sa chute...
C'est donc chez Mme de La Sablière que La Fontaine mène une vie mondaine assez brillante, fréquentant les écrivains les plus renommés de son temps et compose ses chefs-d'œuvre, les grandes fables du recueil de 1678- 1679 : les Animaux malades de la peste; la Laitière et le Pot au lait; le Chat, la Belette et le petit Lapin; la Mort et le Mourant; le Savetier et le Financier ; le Chien qui porte au cou le dîner de son maître; les Obsèques de la Lionne; les Deux Pigeons; le Paysan du Danube... Elle est l'amie qui va donc rayonner dans la vie de La Fontaine, où ni l'épouse ni les maîtresses ne se sont fait une place.
Dans cette période de vingt ans, il va tenter sa voie dans tous les genres, tel que le poème janséniste de "La Captivité de Saint Malc" (1673) ou un livret d'opéra pour Lulli, "Daphné" (1674) avec lequel il ne tarde pas à se brouiller (la satire du Florentin), une Ode pour la Paix (1674), le poème didactique du Quinquina (1682), une poésie dramatique (Astrée, 1691)....
Mais surtout, entre 1672 et 1678, La Fontaine se mêle aux discussions des philosophes et savants habitués du salon de Mme de La Sablière, Roberval ou Bernier, un disciple de Gassendi. Le Second recueil des Fables porte sans doute témoignage de ces discussions. Un Gassendi qui contestait Descartes, un Epicurien qui croyait en la Providence, en sa bonté...

1674, Livre quatrième, 16 contes et nouvelles, La Fontaine, malgré les interventions assez neutres de ces Messieurs de Port-Royal, poursuit sans relâche l'écriture de ses Contes : Comment l'esprit vient aux Filles, L'Abesse malade, Les Troqueurs, Le Cas de conscience, Le Diable de Papefiguière, Féronde ou le Purgatoire, Le Psautier, Le roi Candaule et le Maître en droit, Le Diable en enfer, La Jument du compère Pierre, Pâté d'Anguille, Les Lunettes, Le Cuvier, La Chose impossible, Le Magnifique, Le Tableau.
Ces contes, encore plus "libres" que les précédents furent publiés sans autorisation et leur vente sera interdite en avril 1675. Quant au Livre cinquième des Contes et Nouvelles, qui compte 10 textes, La Clochette, Le Fleuve Scamandre, La Confidente sans le savoir ou le Stratagème, Les Aveux indiscrets, La Matrone d'Ephèse, Belphégor, Les Quiproquo, Philémon et Beaucis, Les Filles de Minée, il n'est pas le résultat d'un choix de La Fontaine mais des critiques et éditeurs qui se chargèrent de publier son oeuvre à titre posthume...
Et c'est à cette époque que le duc du Maine reçut pour ses étrennes un petit théâtre, «la Chambre du Sublime», avec des figures de cire. Dans la chambre, le jeune duc, entouré de seigneurs et de dames ; sur le seuil, Despréaux qui, armé d'une fourche, écartait quelques mauvais poètes ; Racine était auprès de lui, il faisait signe à La Fontaine d'approcher. Un petit théâtre qui exprime parfaitement l'idée qu'on se fait à ce moment de La Fontaine : on voit en lui un poète qui, par le génie, approche des Boileau et des Racine. La Fontaine va achever de le prouver en donnant son second recueil...
1673, Molière mourut le 17 février. La Fontaine lui fit une épitaphe prouvant à quel point il l'appréciait. Restait Racine, ils se rencontreront bientôt chez la célèbre actrice Mme de Champmeslé, et maîtresse du dramaturge. A l'égard de Boileau, la situation sera plus délicate, ce dernier ne sachant que penser de l'auteur des Fables. Boileau et racine seront nommés par la suite historiographes de cour et s'éloigneront du fabuliste. Il est vrai que celui-ci se disperse beaucoup. On voit déjà par les lettres de Mme de Sévigné que ses nouvelles fables (Le Curé et le Mort, la Laitière et le Pot au lait) circulaient en 1672, que telle autre (La Cour du lion) était connue en 1674, telle autre (le Coche et la Mouche) en 1676...

1678-1679 - Parution du second recueil des "Fables" (livres VII à XI)
"Je suis chose légère et vole à tout sujet" - Le second recueil parut en deux fois: les livres VII et VllI, en 1678; les livres IX, X, XI, en 1679 », L'ensemble était dédié à Mme de Montespan et dès l'Avertissement, La Fontaine indique qu'il lui a donné "un air et un tour un peu différent", des sujets plus complexes, plus riches (Les Animaux malades de la peste, Le Rat qui s'est retiré du monde, L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la Fortune), des fables orientales qui marquent l'influence de l'indien Pilpay (Livre des Lumières, trad. 1664), mis à la mode par le grand voyageur Bernier, hôte de Mme de La Sablière (L'Homme qui court après la Fortune, Les Deux Aventuriers et le Talisman). Ayant épuisé le fonds traditionnel des sujets antiques, le fabuliste puise donc en d'autres sources (Babrius, Aphthonius, Horace, Aulu-Gelle, Rabelais, Bonaventure des Périers) et se tourne plus vers l'être humain, sa vision devient plus sociale et philosophique. Mme de Sévigné fera part du plaisir qu'elle rencontra avec M. de la Rochefoucauld de quelques cinq ou six fables de ce recueil...
"Voici un second recueil de fables que je présente au public. J'ai jugé à propos de donner à la plupart de celles-ci un air et un tour un peu différent de celui que j'ai donné aux premières, tant à cause de la différence des sujets, que pour remplir de plus de variété mon ouvrage. Les traits familiers que j'ai semés avec assez d'abondance dans les deux autres parties convenaient bien mieux aux inventions d'Esope qu'à ces dernières, où j'en use plus sobrement pour ne pas tomber en des répétitions ; car le nombre de ces traits n'est pas infini. Il a donc fallu que j'aie cherché d'autres enrichissements, et étendu davantage les circonstances de ces récits, qui d'ailleurs me semblaient le demander de la sorte. Pour peu que le lecteur y prenne garde, il le reconnaîtra lui-même ; ainsi je ne tiens pas qu'il soit nécessaire d'en étaler ici les raisons, non plus que de dire où j'ai puisé ces derniers sujets. Seulement je dirai, par reconnaissance, que j'en dois la plus grande partie à Pilpay, sage indien. Son livre a été traduit en toutes les langues. Les gens du pays le croient fort ancien, et original à l'égard d'Ésope, si ce n'est Esope lui-même sous le nom du sage Locman. Quelques autres m'ont fourni des sujets assez heureux. Enfin j'ai tâché de mettre en ces deux dernières parties toute la diversité dont j'étais capable."
Dans ce second recueil, 87 fables, dont (VII) Les Animaux malades de la peste, Le Rat qui s'est retiré du monde, Le Coche et la Mouche, La Laitière et le Pot au lait, Le Curé et le Mort, Le Chat, la Belette et le Petit Lapin, L'Homme qui court après la fortune et l'Homme qui l'attend dans son lit (VIII) Le Savetier et le Financier, Les obsèques de la Lionne, (IX) L'Huître et les Plaideurs, Le Loup et le Chien maigre (X) La Tortue et les deux Canards, Le Loup et les Bergers, (XI) Le Lion, le Singe et les Deux Ânes...

FABLES - LIVRE VII
LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n'épiaient
La douce et l'innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J'ai dévoré force moutons.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m'est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.
- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d'honneur.
Et quant au Berger l'on peut dire
Qu'il était digne de tous maux,
Etant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L'âne vint à son tour et dit : J'ai souvenance
Qu'en un pré de Moines passant,
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

LE HERON
Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où
Le héron au long bec emmanché d’un long cou :
Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ;
Ma commère la carpe y faisait mille tours
Avec le brochet son compère.
Le héron en eût fait aisément son profit :
Tous approchaient du bord ; l’oiseau n’avait qu’à prendre.
Mais il crut mieux faire d’attendre
Qu’il eût un peu plus d’appétit :
Il vivait de régime, et mangeait à ses heures.
Après quelques moments l’appétit vint : l’oiseau,
S’approchant du bord, vit sur l’eau
Des tanches qui sortaient du fond de ces demeures.
Le mets ne lui plut pas, il s’attendait à mieux,
Et montrait un goût dédaigneux
Comme le rat du bon Horace.
Moi, des tanches ! dit-il ; moi, héron, que je fasse
Une si pauvre chère ! Et pour qui me prend-on ?
La tanche rebutée, il trouva du goujon.
Du goujon ! c’est bien là le dîner d’un héron !
J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux dieux ne plaise !
Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon
Qu’il ne vit plus aucun poisson.
La faim le prit : il fut tout heureux et tout aise
De rencontrer un limaçon.
Ne soyons pas si difficiles :
Les plus accommodants, ce sont les plus habiles ;
On hasarde de perdre en voulant trop gagner.
Gardez-vous de rien dédaigner,
Surtout quand vous avez à peu près votre compte.
Bien des gens y sont pris. Ce n’est pas aux hérons
Que je parle : écoutez, humains, un autre conte :
Vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons.

LE COCHE ET LA MOUCHE
Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,
Et de tous les côtés au Soleil exposé,
Six forts chevaux tiraient un Coche.
Femmes, Moine, Vieillards, tout était descendu.
L’attelage suait, soufflait, était rendu.
Une Mouche survient, et des chevaux s’approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l’un, pique l’autre, et pense à tout moment
Qu’elle fait aller la machine,
S’assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;
Aussitôt que le char chemine,
Et qu’elle voit les gens marcher,
Elle s’en attribue uniquement la gloire ;
Va, vient, fait l’empressée ; il semble que ce soit
Un Sergent de bataille allant en chaque endroit
Faire avancer ses gens, et hâter la victoire.
La Mouche en ce commun besoin
Se plaint qu’elle agit seule, et qu’elle a tout le soin ;
Qu’aucun n’aide aux chevaux à se tirer d’affaire.
Le Moine disait son Bréviaire ;
Il prenait bien son temps ! Une femme chantait ;
C’était bien de chansons qu’alors il s’agissait !
Dame Mouche s’en va chanter à leurs oreilles,
Et fait cent sottises pareilles.
Après bien du travail, le Coche arrive au haut.
Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt :
J’ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.
Çà, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine.
Ainsi certaines gens, faisant les empressés,
S’introduisent dans les affaires :
Ils font partout les nécessaires,
Et, partout importuns, devraient être chassés.

LA LAITIERE ET LE POT AU LAIT
Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple, et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l’argent,
Achetait un cent d’oeufs, faisait triple couvée ;
La chose allait à bien par son soin diligent.
Il m’est, disait-elle, facile,
D’élever des poulets autour de ma maison :
Le Renard sera bien habile,
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;
Il était quand je l’eus de grosseur raisonnable :
J’aurai le revendant de l’argent bel et bon.
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ;
La dame de ces biens, quittant d’un oeil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari
En grand danger d’être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l’appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ?
Picrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous ?
Chacun songe en veillant, il n’est rien de plus doux :
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes :
Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;
Je m’écarte, je vais détrôner le sophi ;
On m’élit roi, mon peuple m’aime ;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ;
Je suis gros Jean comme devant.

LE CHAT, LA BELETTE ET LE PETIT LAPIN
Du palais d'un jeune Lapin
Dame Belette, un beau matin,
S'empara : c'est une rusée.
Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée.
Elle porta chez lui ses pénates, un jour
Qu'il était allé faire à l'Aurore sa cour
Parmi le thym et la rosée.
Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,
Janot Lapin retourne aux souterrains séjours.
La Belette avait mis le nez à la fenêtre.
"O Dieux hospitaliers ! que vois-je ici paraître?
Dit l'animal chassé du paternel logis.
Holà! Madame la Belette,
Que l'on déloge sans trompette,
Ou je vais avertir tous les Rats du pays."
La dame au nez pointu répondit que la terre
Etait au premier occupant.
C'était un beau sujet de guerre,
Qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant.
"Et quand ce serait un royaume,
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi
En a pour toujours fait l'octroi
A Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi ! "
Jean Lapin allégua la coutume et l'usage ;
« Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils,
L'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis
Le premier occupant, est-ce une loi plus sage?
- Or bien, sans crier davantage,
Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis."
C'était un Chat vivant comme un dévot ermite,
Un Chat faisant la chattemite,
Un saint homme de Chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
Jean Lapin pour juge l'agrée.
Les voilà tous deux arrivés
Devant Sa Majesté fourrée.
Grippeminaud leur dit : "Mes enfants, approchez,
Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause."
L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose.
Aussitôt qu'à portée il vit les contestants,
Grippeminaud, le bon apôtre,
Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.
Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois
Les petits souverains se rapportant aux rois.
FABLES - LIVRE VIII
Fable I. - La mort et le mourant
Fable II. — Le savetier et le financier
Fable III. — Le lion, le loup et le renard
Fable IV. — Le pouvoir des fables
Fable V. — L'homme et la puce
Fable VI. — Les femmes et le secret
Fable VII. — Le chien qui porte à son cou le dîné de son maître
Fable VIII. — Le rieur et les poissons
Fable IX. — Le rat et l'huître
Fable X. — L'ours et l'amateur des jardins
Fable XI. — Les deux amis
Fable XII. — Le cochon, la chèvre et le mouton
Fable XIII. — Tircis et Amarante
Fable XIV . - Les obsèques de la lionne.
Fable XV. - Le rat et l'éléphant.
Fable XVI. - L'horoscope.
Fable XVII. - L'âne et le chien.
Fable XVIII. - Le bassa et le marchand.
Fable XIX. - L'avantage de la science.
Fable XX. - Jupiter et les tonnerres.
Fable XXI. - Le faucon et le chapon.
Fable XXII. - Le chat et le rat.
Fable XXIII. - Le torrent et la rivière.
Fable XXIV. - L'éducation.
Fable XXV. - Les deux chiens et l'âne mort.
Fable XXVI. - Démocrite et les Abdéritains.
Fable XXVII. - Le loup et le chasseur.

LA MORT ET LE MOURANT
La Mort ne surprend point le sage :
Il est toujours prêt à partir,
S’étant su lui-même avertir
Du temps où l’on se doit résoudre à ce passage.
Ce temps, hélas ! embrasse tous les temps :
Qu’on le partage en jours, en heures, en moments,
Il n’en est point qu’il ne comprenne
Dans le fatal tribut ; tous sont de son domaine ;
Et le premier instant où les enfants des rois
Ouvrent les yeux à la lumière,
Est celui qui vient quelquefois
Fermer pour toujours leur paupière.
Défendez-vous par la grandeur ;
Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse ;
La mort ravit tout sans pudeur :
Un jour le monde entier accroîtra sa richesse.
Il n’est rien de moins ignoré ;
Et puisqu’il faut que je le die,
Rien où l’on soit moins préparé.
Un Mourant, qui comptait plus de cent ans de vie,
Se plaignait à la Mort que précipitamment
Elle le contraignait de partir tout à l’heure,
Sans qu’il eût fait son testament,
Sans l’avertir au moins. « Est-il juste qu’on meure
Au pied levé ? dit-il ; attendez quelque peu ;
Ma femme ne veut pas que je parte sans elle ;
Il me reste à pourvoir un arrière-neveu ;
Souffrez qu’à mon logis j’ajoute encore une aile.
Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle !
– Vieillard, lui dit la mort, je ne t’ai point surpris
Tu te plains sans raison de mon impatience :
Eh ! n’as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris
Deux mortels aussi vieux ; trouve-m’en dix en France.
Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis
Qui te disposât à la chose :
J’aurais trouvé ton testament tout fait,
Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait.
Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause
Du marcher et du mouvement,
Quand les esprits, le sentiment,
Quand tout faillit en toi ? Plus de goût, plus d’ouïe ;
Toute chose pour toi semble être évanouie ;
Pour toi l’astre du jour prend des soins superflus :
Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus.
Je t’ai fait voir tes camarades,
Ou morts, ou mourants, ou malades ;
Qu’est-ce que tout cela, qu’un avertissement ?
Allons, vieillard, et sans réplique.
Il n’importe à la république
Que tu fasses ton testament. »
La Mort avait raison : je voudrais qu’à cet âge
On sortît de la vie ainsi que d’un banquet,
Remerciant son hôte ; et qu’on fit son paquet :
Car de combien peut-on retarder le voyage ?
Tu murmures, vieillard ; vois ces jeunes mourir,
Vois-les marcher, vois-les courir
À des morts, il est vrai, glorieuses et belles,
Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles.
J’ai beau te le crier ; mon zèle est indiscret :
Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.

LES OBSEQUES DE LA LIONNE
La satire, tour à tour ironique, amusée et véhémente, prend pour cible l'étiquette et le cérémonial de cour, le monarque infatué et naïf, les courtisans serviles à l'égard du roi et impitoyables à l'égard d'autrui. Pour en tempérer l'audace, La Fontaine met en scène des animaux. Mais en entremêlant délibérément des mots et des détails disparates dont les uns conviennent à des animaux et les autres à des hommes, il accentue le caractère conventionnel de cet élément traditionnel de la fable et en tire de délicieux effets de fantaisie burlesque (VIII, I4).
La femme du lion mourut;
Aussitôt chacun accourut
Pour s'acquitter envers le prince
De certains compliments de consolation
Qui sont surcroît d 'affliction.
Il fit avertir sa province
Que les obsèques se feraient
Un tel jour, en tel lieu; ses prévôts y seraient
Pour régler la cérémonie,
Et pour placer la compagnie.
Jugez si chacun s'y trouva.
Le prince aux cris s'abandonna,
Et tout son antre en résonna;
Les lions n 'ont point d 'autre temple.
On entendit, à son exemple,
Rugir en leur patois messieurs les courtisans.
Je définis la cour un pays où les gens,
Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents,
Sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être,
Tâchent au moins de le paraître :
Peuple caméléon, peuple singe du maître;
On dirait qu'un esprit anime mille corps :
C 'est bien là que les gens sont de simples ressorts.
Pour revenir à notre affaire,
Le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire?
Cette mort le vengeait : la reine avait jadis
Etranglé sa femme et son fils.
Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire,
Et soutint qu'il l'avait vu rire.
La colère du roi, comme dit Salomon,
Est terrible; et surtout celle du roi lion;
Mais ce cerf n 'avait pas accoutumé de lire.
Le monarque lui dit : "Chétif hôte des bois,
Tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix.
Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes
Nos sacrés ongles : venez, loups,
Vengez la reine; immolez tous
Ce traître à ses augustes mânes."
Le cerf reprit alors : "Sire, le temps des pleurs
Est passé; la douleur est ici superflue.
Votre digne moitié, couchée entre des fleurs,
Tout près d 'ici m'est apparue;
Et je l'ai d 'abord reconnue :
« Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi,
Quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes;
Aux champs Elysiens j'ai goûté mille charmes,
Conversant avec ceux qui sont saints comme moi.
Laisse agir quelque temps le désespoir du roi :
J'y prends plaisir." A peine on eut ouï la chose,
Qu'on se mit à crier : "Miracle! Apothéose!"
Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni.
Amusez les rois par des songes,
Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges;
Quelque indignation dont leur cœur soit rempli,
Ils goberont l'appât; vous serez leur ami.
FABLES - LIVRE IX
Fable I. — Le dépositaire infidèle
Fable II. - Les deux pigeons
Fable III. — Le singe et le léopard
Fable IV. — Le gland et la citrouille
Fable V. — L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin
Fable VI. — Le statuaire et la statue de Jupiter
Fable VII. — La souris métamorphosée en fille
Fable VIII. — Le fou qui vend la sagesse
Fable IX. — L'huître et les plaideurs
Fable X. — Le loup et le chien maigre
Fable XI. — Rien de trop
Fable XII. — Le cierge
Fable XIII. — Jupiter et le passager
Fable XIV. — Le chat et le renard
Fable XV. — Le trésor et les deux hommes
Fable XVI. — Le singe et le chat
Fable XVII. — Le milan et le rossignol
Fable XVIII. — Le berger et son troupeau

LES DEUX PIGEONS
Deux Pigeons s’aimaient d’amour tendre :
L’un d’eux, s’ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L’autre lui dit : « Qu’allez-vous faire ?
Voulez-vous quitter votre frère ?
L’absence est le plus grand des maux :
Non pas pour vous, cruel ! Au moins, que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage.
Encore, si la saison s’avançait davantage !
Attendez les zéphyrs : qui vous presse ? un corbeau
Tout à l’heure annonçait malheur à quelque oiseau.
Je ne songerai plus que rencontre funeste,
Que faucons, que réseaux. Hélas, dirai-je, il pleut :
Mon frère a-t-il tout ce qu’il veut,
Bon soupé, bon gîte, et le reste ? »
Ce discours ébranla le cœur
De notre imprudent voyageur ;
Mais le désir de voir et l’humeur inquiète
L’emportèrent enfin. Il dit : « Ne pleurez point ;
Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite :
Je reviendrai dans peu conter de point en point
Mes aventures à mon frère ;
Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère
N’a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint
Vous sera d’un plaisir extrême.
Je dirai : J’étais là ; telle chose m’advint :
Vous y croirez être vous-même. »
À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu.
Le voyageur s’éloigne : et voilà qu’un nuage
L’oblige de chercher retraite en quelque lieu.
Un seul arbre s’offrit, tel encore que l’orage
Maltraita le Pigeon en dépit du feuillage.
L’air devenu serein, il part tout morfondu,
Sèche du mieux qu’il peut son corps chargé de pluie ;
Dans un champ à l’écart voit du blé répandu,
Voit un pigeon auprès : cela lui donne envie ;
Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d’un lacs,
Les menteurs et traîtres appas.
Le lacs était usé ; si bien que, de son aile,
De ses pieds, de son bec, l’oiseau le rompt enfin :
Quelque plume y périt, et le pis du destin
Fut qu’un certain vautour, à la serre cruelle,
Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle
Et les morceaux du lacs qui l’avait attrapé,
Semblait un forçat échappé.
Le vautour s’en allait le lier, quand des nues
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues.
Le Pigeon profita du conflit des voleurs,
S’envola, s’abattit auprès d’une masure,
Crut, pour ce coup, que ses malheurs
Finiraient par cette aventure ;
Mais un fripon d’enfant (cet âge est sans pitié)
Prit sa fronde, et du coup tua plus d’à moitié
La volatile malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité,
Traînant l’aile et tirant le pied,
Demi-morte et demi-boiteuse,
Droit au logis s’en retourna :
Que bien, que mal, elle arriva,
Sans autre aventure fâcheuse.
Voilà nos gens rejoints ; et je laisse à juger
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.
Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ?
Que ce soit aux rives prochaines.
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau ;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.
J’ai quelquefois aimé : je n’aurais pas alors,
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas ! quand reviendront de semblables moments ?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ?
Ah ! si mon cœur osait encore se renflammer !
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête ?
Ai-je passé le temps d’aimer ?
FABLES - LIVRE X
Fable I. — L'homme et la couleuvre
Fable II. - La tortue et les deux canards
Fable III. — Les poissons et le cormoran
Fable IV, — L'enfouisseur et son compère
Fable V. — Le loup et les bergers
Fable VI. — L'araignée et l'hirondelle
Fable VII. — La perdrix et les coqs
Fable VIII. — Le chien à qui on a coupé les oreilles
Fable IX. — Le berger et le roi
Fable X. — Les poissons et le berger qui joue de la flûte
Fable XI. — Les deux perroquets, le roi et son fils
Fable XII. — La lionne et l'ourse
Fable XIII. — Les deux aventuriers et le talisman
Fable XIV. - Les lapins
Fable XV. — Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi.

LA TORTUE ET LES DEUX CANARDS
Une Tortue était, à la tête légère,
Qui lasse de son trou voulut voir le pays.
Volontiers on fait cas d’une terre étrangère :
Volontiers gens boiteux haïssent le logis.
Deux Canards à qui la Commère
Communiqua ce beau dessein,
Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire :
Voyez-vous ce large chemin ?
Nous vous voiturerons par l’air en Amérique.
Vous verrez mainte République,
Maint Royaume, maint peuple ; et vous profiterez
Des différentes mœurs que vous remarquerez.
Ulysse en fit autant. On ne s’attendait guère
De voir Ulysse en cette affaire.
La Tortue écouta la proposition.
Marché fait, les oiseaux forgent une machine
Pour transporter la pèlerine.
Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.
Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâcher prise :
Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout.
La Tortue enlevée on s’étonne partout
De voir aller en cette guise
L’animal lent et sa maison,
Justement au milieu de l’un et l’autre Oison.
Miracle, criait-on ; Venez voir dans les nués
Passer la Reine des Tortues.
La Reine : Vraiment oui ; Je la suis en effet ;
Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait
De passer son chemin sans dire aucune chose ;
Car lâchant le bâton en desserrant les dents,
Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.
Son indiscrétion de sa perte fut cause.
Imprudence, babil, et sotte vanité,
Et vaine curiosité
Ont ensemble étroit parentage ;
Ce sont enfants tous d’un lignage.

LES LAPINS
(Discours à M. le duc de la Rochefoucauld)
Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte
L'homme agit, et qu'il se comporte,
En mille occasions, comme les animaux :
"Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts
Que ses sujets, et la nature
A mis dans chaque créature
Quelque grain d'une masse où puisent les esprits;
J'entends les esprits corps, et pétris de matière. "
Je vais prouver ce que je dis.
A l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière
Précipite ses traits dans l'humide séjour,
Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière,
Et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encor jour,
Au bord de quelque bois sur un arbre je grimpe,
Et, nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe,
Je foudroie, à discrétion,
Un lapin qui n'y pensait guère.
Je vois fuir aussitôt toute la nation
Des lapins, qui, sur la bruyère,
L'oeil éveillé, l'oreille au guet,
S'égayaient, et de thym parfumaient leur banquet.
Le bruit du coup fait que la bande
S'en va chercher sa sûreté
Dans la souterraine cité :
Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande
S'évanouit bientôt; je revois les lapins,
Plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains.
Ne reconnaît-on pas en cela les humains?
Dispersés par quelque orage,
A peine ils touchent le port
Qu'ils vont hasarder encor
Même vent, même naufrage;
Vrais lapins, on les revoit
Sous les mains de la Fortune.
Joignons à cet exemple une chose commune.
Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit,
Qui n'est pas de leur détroit,
Je laisse à penser quelle fête!
Les chiens du lieu, n'ayant en tête
Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coups de dents,
Vous accompagnent ces passants
Jusqu'aux confins du territoire.
Un intérêt de biens, de grandeur, et de gloire,
Aux gouverneurs d'États, à certains courtisans,
A gens de tous métiers, en fait tout autant faire.
On nous voit tous, pour l'ordinaire,
Piller le survenant, nous jeter sur sa peau.
La coquette et l'auteur sont de ce caractère :
Malheur à l'écrivain nouveau!
Le moins de gens qu'on peut à l'entour du gâteau,
C'est le droit du jeu, c'est l'affaire.
Cent exemples pourraient appuyer mon discours;
Mais les ouvrages les plus courts
Sont toujours les meilleurs. En cela, j'ai pour guide
Tous les maîtres de l'art, et tiens qu'il faut laisser
Dans les plus beaux sujets quelque chose à penser :
Ainsi ce discours doit cesser.
Vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide,
Et dont la modestie égale la grandeur,
Qui ne pûtes jamais écouter sans pudeur
La louange la plus permise,
La plus juste et la mieux acquise;
Vous enfin, dont à peine ai-je encore obtenu
Que votre nom reçût ici quelques hommages.
Du temps et des censeurs défendant mes ouvrages,
Comme un nom qui, des ans et des peuples connu,
Fait honneur à la France, en grands noms plus féconde
Qu'aucun climat de l'univers,
Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde
Que vous m'avez donné le sujet de ces vers.
FABLES - LIVRE XI
Fable I. — Le lion
Fable II. — Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter
Fable III. — Le fermier, le chien et le renard
Fable IV. — Le songe d'un habitant du Mogol
Fable V. — Le lion, le singe et les deux ânes
Fable VI. — Le loup et le renard
Fable VII. —Le paysan du Danube
Fable VIII. — Le vieillard et les trois jeunes hommes
Fable IX. — Les souris et le chat-huant
ÉPILOGUE
C'est ainsi que ma muse, aux bords d'une onde pure,
Traduisait en langue des dieux
Tout ce que disent sous les cieux
Tant d'êtres empruntant la voix de la nature.
Trucheman de peuples divers,
Je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage :
Car tout parle dans l'univers;
Il n'est rien qui n'ait son langage....

En 1678, Mme de La Sablière se retire du monde pour se faire garde-malade et se convertir au jansénisme. La raison? Sa rupture avec La Fare (1679) et la perte de son mari (1680), et une époque sujette à la dévotion et à la pénitence...
Le marquis de La Fare, alors âgé de trente-deux ans, se fit aimer, follement aimer, de Mme de La Sablière, qui en avait alors trente-six. La Fare était un homme de cour et de débauche, il avait beaucoup courtisé Mme de Montespan, mais, ayant appris qu'il chassait sur les terres du Roi, s'était replié vers la marquise de Rochefort, puis vint Mme de La Sablière. Mais La Fare était volage et joueur, il allait chez la Champmeslé, La Fontaine l'y rencontrait, il était aussi l'amant d'une fille d'opéra, Louison, sœur de Fanchon, qui était la maîtresse du grand-prieur de Vendôme, mais la plus redoutable des rivales de Mme de La Sablière fut la bassette, le jeu qui faisait alors fureur. Mme de Sévigné nous rapporté tous les éléments de cette rupture. Mme de La Sablière ne quittera La Fare que pour se donner à Dieu. Désormais elle suivait une voie qui n'était pas le chemin de La Fontaine. Elle quitta progressivement son hôtel rue Saint-Honoré, où elle continua quelque temps d'héberger La Fontaine, de lire ses vers, mais finit par aller loger à l'hôpital des Incurables avec une seule servante, et se mit sous la direction de l'abbé de Rancé. Elle mourut le 6 janvier 1693...
La Fontaine se replia alors vers Condé, à Chantilly, chez les Vendôme, neveux de Mme de Bouillon, et doit à 70 ans toujours lutter pour maintenir ses protections...
Pour les Conti, les neveux du grand Gondé, il a composé des dédicaces, des épîtres, des épithalames. A l'aîné, Louis-Armand de Conti, il a envoyé un opuscule, intitulé "Comparaison d'Alexandre, de César et de Monsieur le Prince", de sa prose la plus solide. Les Vendôme, arrière-petits-fîls de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, étaient, par leur mère, Laure Mancini, neveux de la duchesse de Bouillon, qui elle-même était cousine des Conti. La Fontaine était donc en pays de connaissance au château d'Anet où le duc tenait sa cour. Il retrouvera la même société à Paris dans l'hôtel du Temple, que le chevalier de Vendôme occupe en sa qualité de grand-prieur. Les mœurs des Vendôme, les fêtes d'Anet, les débauches du Temple forment un des chapitres les plus connus de la chronique à scandales pendant la dernière partie du règne de Louis XIV, Saint-Simon en a tant parlé. Lorsque La Fontaine publia "Philémon et Baucis", où il dépeint la félicité de deux vieux époux dont "Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent la flamme", il dédie cette idylle au duc de Vendôme. Et racontant les dernières nouvelles de la société du Temple, on peut y lire les agréments de la vieillesse d'un La Fontaine: "Nous faisons au Temple merveilles. / L'autre jour on but vingt bouteilles; / Renier en fut l'architriclin. / La nuit étant sur son déclin, / Lorsque j'eus vidé mainte coupe, / Lanjamet, aussi de la troupe. / Me ramena dans mon manoir. / Je lui donnai, non le bonsoir. / Mais le bonjour : la blonde Aurore, / En quittant le rivage maure. / Nous avoit à table trouvés, / Nos verres nets et bien lavés, / Mais nos yeux étant un peu troubles, / Sans pourtant voir les objets doubles..."
1684 - Louis XIV refusa toujours à La Fontaine les faveurs dont il combla Racine et Boileau. Il faut ajouter, pour tenter d'expliquer cela, que La Fontaine appartenait à une société qui vivait en marge du règne, hors de Versailles, il était par ses amitiés et ses mœurs, des familiers de l'hôtel de Bouillon et plus tard du Temple, où les libertins s'assemblaient; il appartenait aussi par son esprit libre et frondeur qui n'avait pas le respect attendu de la majesté royale, que l'on relise les Animaux malades de la peste, les Obsèques de la Lionne, le Tribut envoyé par les Animaux à Alexandre, et bien d'autres fables. A Racine discutant avec lui sur l'autorité absolue des rois, et alléguant les pouvoirs donnés par Dieu à Saûl, La Fontaine a ces mots : «Si les rois sont maîtres de nos biens, de nos vies et de tout, il faut qu'ils aient le droit de nous regarder comme des fourmis à leur égard, et je me rends si vous me faites voir que cela soit autorisé par l'Écriture.» *Racine savait parfaitement inventer imperturbablement un texte sacré quand il le fallait. La Fontaine quant à lui n'était pas si mauvais courtisan, ne manqua aucune occasion de louer le Roi en prose ou en vers, de maudire les ennemis du royaume, de célébrer les exploits et la sagesse de Louis XIV..
Après bien des difficultés et après avoir promis de ne plus écrire de "Contes", la mort de Colbert, l'élection de Boileau, La Fontaine est enfin reçu à l'Académie française et honore sa protectrice en prononçant le "Discours à Mme de La Sablière", il y raconte sa vie sous forme de confession et semble constater son incapacité de vertu...
1684 - Discours à Mme de La Sablière
Désormais que ma muse, aussi bien que mes jours,
Touche de son déclin l'inévitable cours,
Et que de ma raison le flambeau va s'éteindre,
Irai-je en consumer les restes à me plaindre,
Et, prodigue d'un temps par la Parque attendu,
Le perdre à regretter celui que j'ai perdu ?
Si le ciel me réserve encor quelque étincelle
Du feu dont je brillais dans ma saison nouvelle,
Je la dois employer, suffisamment instruit
Que le plus beau couchant est voisin de la nuit.
Le temps marche toujours; ni force, ni prière,
Sacrifices ni vœux, n'allongent la carrière :
Il faudrait ménager ce qu'on va nous ravir.
Mais qui vois-je que vous sagement s'en servir ?
Si quelques-uns Pont fait, je ne suis pas du nombre:
Des solides plaisirs je n'ai suivi que l'ombre;
J'ai toujours abusé du plus cher de nos biens.
Les pensers amusants, les vagues entretiens,
Vains enfans du loisir, délices chimériques,
Les romans et le jeu, peste des républiques,
Par qui sont dévoyés les esprits les plus droits,
Ridicule fureur qui se moque des lois,
Cent autres passions, des sages condamnées,
Ont pris comme à l'envi la leur de mes années.
L'usage des vrais biens répareraít ces maux:
Je le sais, et je cours encore à des biens faux...
Si faut-il qu'à la fin de tels pensers nous quittent;
Je ne vois plus d'instants qui ne m'en sollicitent :
Je recule, et peut-être attendrais-je trop tard :
Car qui sait les momens prescrits à son départ?
Quels qu'ils soient, ils sont courts : à quoi les emploîrai-je ?
Si j'étais sage, Iris (mais c'est un privilège
Que la nature accorde à bien peu d'entre nous),
Si j'avais un esprit aussi réglé que vous,
Je suivrais vos leçons, au moins en quelque chose :
Les suivre en tout, c'est trop; il faut qu'on se propose
Un plan moins difficile à bien exécuter,
Un chemin dont sans crime on se puisse écarter.
Ne point errer est chose au-dessus de mes forces :
Mais aussi. de se prendre à toutes les amorces,
Pour tous les faux brillans courir et s'empresser,
J'entends que l'on me dit : « Quand donc veux-tu cesser?
Douze lustres et plus ont roulé sur ta vie :
De soixante soleils la course entresuivie
Ne t'a pas vu goûter un moment de repos ;
Quelque part que tu sois, on voit à tout propos
L'inconstance d'une âme en ses plaisirs légère.
Inquiète, et partout hôtesse passagère;
Ta conduite et tes vers, chez toi tout s'en ressent :
On te veut là-dessus dire un mot en passant.
Tu changes tous les jours de manière et de style;
Tu cours en un moment de Terence à Virgile :
Ainsi rien de parfait n'est sorti de tes mains.
Eh bien! prends, si tu veux, encor d'autres chemins:
Invoque des neuf Sœurs la troupe toute entlère ;
Tente tout, au hasard de gâter la matière :
On le souffre, excepté tes contes d'autrefois."
J'ai presque envie, Iris, de suivre cette voix;
J'en trouve l'éloquence aussi sage que forte.
Vous ne parleriez pas ni mieux, ni d'autre sorte :
Serait-ce point de vous qu'elle viendrait aussi ?
Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi,
Papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles
A qui le bon Platon compare nos merveilles :
Je suis chose légère, et vole à tout sujet;
Je vais de fleur en fleur, et d'objet en objet;
A beaucoup de plaisir je mêle un peu de gloire,
J'irais plus haut peut-être au temple de Mémoire,
Si dans un genre seul j'avais usé mes jours;
Mais, quoi! je suis volage en vers comme en amours."
1684, Reçu à l'Académie, La Fontaine est alors en pleine renommée. De grands esprits, comme Fénelon et La Bruyère, reconnaissent son génie. Ses vieux amis, Racine et Boileau, qui cependant appartiennent à l'ordre nouveau, lui portent admiration. Dans les salons et les ruelles où l'invitent les femmes les plus renommées pour leur esprit, il se fait accompagner d'un ami qui récite ses fables, voire ses contes, car il n'ose se fier à sa mémoire. Le public s'amuse des singularités de sa vie...
1687 - "Epître à Huet" - Lors de la querelle des Anciens et des Modernes, et malgré son amitié pour Perrault, La Fontane prend parti pour les Anciens. Racine, Boileau, La Bruyère ou La Fontaine ne nient pas l'importance des écrivains modernes, mais Homère et Virgile sont leurs "dieux du Parnasse"...
"Je vous fais un présent capable de me nuire:
Chez vous Quintulien s'en va tous nous détruire:
Car enfln qui le suit ? qui de nous aujourd'hui
S'égale aux anciens tant estimés chez lui?
Tel est mon sentiment, tel doit être le vôtre.
Mais si votre suffrage en entraîne quelque autre,
Il ne fait pas la foule; et je vois des auteurs
Qui, plus savants que moi, sont -moins admirateurs.
Si vous les en croyez, on ne peut, sans faiblesse,
Rendre hommage aux esprits de Rome et de la Grèce.
"Craindre ces écrivains! on écrit tant chez nous!
La France excelle aux arts, ils y fleurissent tous;
Notre prince avec art nous conduit aux alarmes ;
Et sans art nous louerions le succès de ses armes ?
Dieu n'aimerait-il plus à former des talents ?
Les Romains et les Grecs sont-ils seuls excellents ?"
Ces discours sont fort beaux, mais fort souvent frivoles :
Je ne vois point l'effet répondre à ces paroles:
Et, faute d'admirer les Grecs et les Romains,
On s'égare en voulant tenir d'autres chemins.
Quelques imitateurs, sot bétail, je l'avoue,
Suivent en vrais moutons le pasteur de Mantoue.
J'en use d'autre sorte, et, me laissant guider,
Souvent à marcher seul j'ose me hasarder.
On me verra toujours pratiquer cet usage.
Mon imitation n'est pas un esclavage :
Je ne prends que l'idée, et les tours, et les lois
Que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois.
Si d'ailleurs quelque endroit, plein chez eux d'excellence.
Peut entrer dans mes vers sans nulle violence,
Je l'y transporte, et veux qu'il n'ait rien d'affecté.
Tâchant de rendre mien cet air d'antiquité.
Je vois avec douleur ces routes méprisées :
Art et guides, tout est dans les Champs-Elysées.
J'ai beau les évoquer, j'ai beau vanter leurs traits,
On me laisse tout seul admirer leurs attraits.
Térence est dans mes mains; je m'instruis dans Horace;
Homère et son rival sont mes dieux du Parnasse.
Je le dis aux rochers, on veut d'autres discours :
Ne pas louer son siècle est parler à des sourds.
Je le loue, et je sais qu'il n'est pas sans mérite;
Mais, près de ces grands noms, notre gloire est petite :
Tel de nous, dépourvu de leur solidité,
N'a qu'un peu d'agrément, sans nul fonds de beauté.
Je ne nomme personne : on peut tous nous connaître.
Je pris certain auteur autrefois pour mon maître :
Il pensa me gâter; à la fin, grâce aux dieux,
Horace, par bonheur, me dessilla les yeux.
L'auteur avait du bon, du meilleur, et la France
Estimait dans ses vers le tour et la cadence.
Qui ne les eût prisés? j'en demeurai ravi;
Mais ses traits ont perdu quiconque l'a suivi.
Son trop d'esprit s'épand en trop de belles choses :
Tous métaux y sont or, toutes fleurs y sont roses.
On me dit là-dessus : De quoi vous plaignez-vous ?
De quoi? Voilà mes gens aussitôt en courroux
Ils se moquent de moi, qui, plein de ma lecture,
Vais partout prêchant l'art de la simple nature.
Ennemi de ma gloire et de mon propre bien,
Malheureux, je m'attache à ce goût ancien..."

En décembre 1692. La Fontaine tombe malade et se convertit. Il était alors dans sa soixante-douzième année et demeurait encore chez Mme de La Sablière, rue Saint-Honoré. Celle-ci lui envoie un abbé qui finit par obtenir du vieux poète une conversion solennelle et retentissante : il renie ses Contes et brûle une pièce de théâtre qu'il vient d'achever.
Toute religion avait jusque-là été absente de sa vie, il croyait en Dieu, mais son imagination était principalement hantée de mythologie dont toutes ses fables sont pétries à un point que nous ne sommes plus en capacité de saisir. La lecture des Provinciales l'avait diverti et lui avait inspiré une épigramme et une amusante ballade : Escobar suit un chemin de velours, où il approuvait la condamnation de Jansenius, « auteur de vains débats ». Enfin, il venait tout juste de publier la troisième partie de ses Contes qui finit par "le Petit Chien", et allait publier la quatrième qui commence par "Comment l'esprit vient aux filles". Le 13 février 1693, accompagné d'une délégation de l'Académie française, l'abbé Pouget porta le Saint-Sacrement au malade qui était sur un fauteuil : "Ii est d'une notoriété qui n'est que trop publique, que j'ai eu le malheur de composer un livre de contes infâmes. En le composant, je n'ai pas cru que ce fût un ouvrage aussi pernicieux qu'il l'est. On m'a sur cela ouvert les yeux, et je conviens que c'est un livre abominable. Je suis très fâché de l'avoir écrit...."
1693-1695 - A la mort de Mme de La Sablière, La Fontaine est accueilli chez les d'Hervart et trouve un peu de sérénité dans leur somptueux hôtel de la rue Plâtrière. Il passa les deux dernières années de sa vie dans cette somptueuse maison dont les plafonds décorés par Mignard représentaient l'apothéose de Psyché et l'histoire d'Apollon. C'est une seconde Mme de La Sablière, Françoise le Rogois de Bretonvilliers, qui avait épousé le financier d'Hervart, que rencontra La Fontaine. Elle était d'une rare beauté et le mutuel amour des deux époux émerveillait le poète. « Comment, écrivait-il, M. d'Hervart cesseroit-il d'aimer une femme souverainement jolie, complaisante, d'humeur égale, d'un esprit doux et qui l'aime de tout son cœur? » Et Mme d'Hervart entoura le vieux poète de soins et d'affection. La Fontaine se met à traduire des hymnes et des psaumes....

1694 - Les Fables (livre XII)
La Fontaine trouve encore la force de publier en septembre 1694 le Livre XII des Fables, 29 fables ...
Fable I. — Les compagnons d'Ulysse
Fable II. — Le chat et les deux moineaux
Fable III. — Du thésauriseur et du singe
Fable IV. — Les deux chèvres
Fable V. — Le vieux chat et la jeune souris
Fable VI. — Le loup et le renard
Fable VII. — Le milan, le roi et le chasseur
Fable VIII. — Lé renard, les mouches et le hérisson
Fable IX. — L'Amour et la Folie
LE CORBEAU, LA GAZELLE, LA TORTUE ET LE RAT
Je vous gardais un temple dans mes vers :
Il n’eût fini qu’avecque l’Univers.
Déjà ma main en fondait la durée
Sur ce bel Art qu’ont les Dieux inventé,
Et sur le nom de la Divinité
Que dans ce temple on aurait adorée.
Sur le portail j’aurais ces mots écrits
Palais sacré de la déesse Iris ;
Non celle-là qu’a Junon à ses gages ;
Car Junon même et le maître des Dieux
Serviraient l’autre, et seraient glorieux
Du seul honneur de porter ses messages.
L’apothéose à la voûte eût paru ;
Là, tout l’Olympe en pompe eût été vu
Plaçant Iris sous un dais de lumière.
Les murs auraient amplement contenu
Toute sa vie ; agréable matière,
Mais peu féconde en ces événements
Qui des États font les renversements.
Au fond du temple eût été son image :
Avec ses traits, son souris, ses appas,
Son art de plaire et de n’y penser pas,
Ses agréments à qui tout rend hommage.
J’aurais fait voir à ses pieds des mortels
Et des héros, des demi-dieux encore,
Même des dieux : ce que le monde adore
Vient quelquefois parfumer ses autels.
J’eusse en ses yeux fait briller de son âme
Tous les trésors, quoique imparfaitement :
Car ce coeur vif et tendre infiniment,
Pour ses amis, et non point autrement ;
Car cet esprit, qui, né du firmament,
A beauté d’homme avec grâces de femme,
Ne se peut pas, comme on veut exprimer.
Ô vous, Iris, qui savez tout charmer,
Qui savez plaire en un degré suprême,
Vous que l’on aime à l’égal de soi-même
(Ceci soit dit sans nul soupçon d’amour ;
Car c’est un mot banni de votre cour,
Laissons-le donc), agréez que ma Muse
Ce que chez vous nous voyons estimer
Achève un jour cette ébauche confuse.
J’en ai placé l’idée et le projet,
Pour plus de grâce, au devant d’un sujet
Où l’amitié donne de telles marques,
Et d’un tel prix, que leur simple récit
Peut quelque temps amuser votre esprit.
Non que ceci se passe entre monarques :
N’est pas un roi qui ne sait point aimer :
C’est un mortel qui sait mettre sa vie
Pour son ami. J’en vois peu de si bons.
Quatre animaux, vivants de compagnie,
Vont aux humains en donner des leçons.
La Gazelle, le Rat, le Corbeau, la Tortue,
Vivaient ensemble unis : douce société.
Le choix d’une demeure aux humains inconnue
Assurait leur félicité.
Mais quoi ! l’homme découvre enfin toutes retraites.
Soyez au milieu des déserts,
Au fond des eaux, en haut des airs,
Vous n’éviterez point ses embûches secrètes.
La Gazelle s’allait ébattre innocemment,
Quand un chien, maudit instrument
Du plaisir barbare des hommes,
Vint sur l’herbe éventer les traces de ses pas.
Elle fuit. Et le Rat, à l’heure du repas
Dit aux amis restants : « D’où vient que nous ne sommes
Aujourd’hui que trois conviés ?
La Gazelle déjà nous a-t-elle oubliés ? »
À ces paroles, la Tortue
S’écrie, et dit : « Ah ! si j’étais
Comme un corbeau d’ailes pourvue,
Tout de ce pas je m’en irais
Apprendre au moins quelle contrée,
Quel accident tient arrêtée
Notre compagne au pied léger ;
Car, à l’égard du coeur, il en faut mieux juger. »
Le Corbeau part à tire d’aile :
Il aperçoit de loin l’imprudente Gazelle
Prise au piège, et se tourmentant.
Il retourne avertir les autres à l’instant ;
Car, de lui demander quand, pourquoi, ni comment
Ce malheur est tombé sur elle,
Et perdre en vains discours cet utile moment,
Comme eût fait un maître d’école,
Il avait trop de jugement.
Le Corbeau donc vole et revole.
Sur son rapport les trois amis
Tiennent conseil. Deux sont d’avis
De se transporter sans remise
Aux lieux où la Gazelle est prise.
« L’autre, dit le Corbeau, gardera le logis :
Avec son marcher lent, quand arriverait-elle ?
Après la mort de la Gazelle. »
Ces mots à peine dits, ils s’en vont secourir
Leur chère et fidèle compagne,
Pauvre chevrette de montagne.
La Tortue y voulut courir :
La voilà comme eux en campagne,
Maudissant ses pieds courts avec juste raison,
Et la nécessité de porter sa maison.
Rongemaille (le Rat eut à bon droit ce nom)
Coupe les noeuds du lacs : on peut penser la joie.
Le chasseur vient, et dit : « Qui m’a ravi ma proie ? »
Rongemaille, à ces mots, se retire en un trou,
Le Corbeau sur un arbre, en un bois la Gazelle :
Et le chasseur à demi fou
De n’en avoir nulle nouvelle,
Aperçoit la Tortue, et retient son courroux.
« D’où vient, dit-il, que je m’effraie ?
Je veux qu’à mon souper celle-ci me défraie. »
Il la mit dans son sac. Elle eût payé pour tous,
Si le Corbeau n’en eût averti la Chevrette.
Celle-ci, quittant sa retraite,
Contrefait la boiteuse, et vient se présenter.
L’homme de suivre, et de jeter
Tout ce qui lui pesait : si bien que Rongemaille
Autour des noeuds du sac tant opère et travaille
Qu’il délivre encore l’autre soeur,
Sur qui s’était fondé le souper du chasseur.
Pilpay conte qu’ainsi la chose s’est passée.
Pour peu que je voulusse invoquer Apollon,
J’en ferais, pour vous plaire, un ouvrage aussi long
Que l’Iliade ou l’Odyssée.
Rongemaille ferait le principal héros,
Quoique à vrai dire ici chacun soit nécessaire.
Porte-maison l’Infante y tient de tels propos,
Que Monsieur du Corbeau va faire
Office d’espion, et puis de messager.
La Gazelle a d’ailleurs l’adresse d’engager
Le chasseur à donner du temps à Rongemaille.
Ainsi chacun en son endroit
S’entremet, agite, et travaille.
À qui donner le prix ? Au coeur si l’on m’en croit.
Que n’ose et que ne peut l’amitié violente !
Cet autre sentiment que l’on appelle amour
Mérite moins d’honneurs ; cependant chaque jour
Je le célèbre et je le chante.
Hélas ! il n’en rend pas mon âme plus contente.
Vous protégez sa soeur, il suffit ; et mes vers
Vont s’engager pour elle à des tons tout divers.
Mon maître était l’Amour : j’en vais servir un autre,
Et porter par tout l’Univers
Sa gloire aussi bien que la vôtre.
Fable XI. — La forêt et le bûcheron
Fable XII. — Le renard, le loup et le cheval
Fable XIII. — Le renard et !es poulets d'inde
Fable XIV. — Le philosophe scythe
Fable XV. — L'éléphant et le singe de Jupiter
Fable XVI. — Un fou et un sage
Fable XVII. — Le renard anglais
Fable XVIII. — Daphnis et Alcimadure
Fable XIX. — Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire
Quelques mois plus tard, le 13 avril 1695, il rendra le dernier soupir, et son ami Maucroix écrit dans ses Mémoires :
"Le 13... mourut à Paris mon très cher et très fidèle ami M. de La Fontaine. Nous avons été amis plus de cinquante ans, et je remercie Dieu d'avoir conduit l'amitié extrême que je lui portais jusqu'à une assez grande vieillesse, sans aucune interruption ni refroidissement, pouvant dire que je l'ai tendrement aimé, et autant le dernier jour que le premier.... C'était l'âme la plus sincère et la plus candide que j'aie jamais connue : jamais de déguisement : je ne sais s'il a menti en sa vie. C'était au reste un très bel esprit, capable de tout ce qu'il voulait entreprendre. Ses fables, au sentiment des plus habiles, ne mourront jamais et lui feront honneur dans toute la postérité." ...
