- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Molière (1622-1673), "L’École des femmes" (1662), "Dom Juan ou le Festin de pierre" (1665), "Le Misanthrope" (1666), "L'Avare" (1668), "Tartuffe" (1669), "Le Bourgeois gentilhomme" (1670), "Les Femmes savantes" (1672) - Edme Boursault (1638-1701) - ...
Last update 10/10/2021

"C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens" - 1661, Louis XIV, à la mort de Mazarin, décide toutefois de gouverner seul, il n’a que 24 ans et ce geste porte déjà la marque distinctive d'une monarchie absolue, par laquelle l’autorité est un droit divin, et le roi le représentant de Dieu sur terre. - 1662-1672, dix années, en fait quatre à cinq années, ont fait de Molière l'un des grands peintres de la nature humaine et c'est au travers de six comédies de caractères (Tartuffe, Le Misanthrope, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Femmes savantes, Le Malade imaginaire) qu'il a su "entrer comme il faut dans le ridicules des hommes". Mais sous une représentation qui se veut comique et satirique, on a fort justement remarqué la gravité de son théâtre, et pourtant tout est fait pour ne pas assombrir ses comédies : opposition des personnages, parodie des situations, langage à double sens. Boileau le surnomma "le Contemplateur", et ses adversaires le présentèrent comme un personnage inquiétant qui "ne va pas sans ses yeux ni sans ses oreilles". Et si Goethe trouvait que ses pièces touchaient à la tragédie, cette "tragédie", ce "sentiment tragique de la comédie", est peut être dans les contradictions d'un Molière cherchant une voie entre réflexion sur la nature humain et comique d'expression, luttant contre les rivalités des autres troupes et l'hostilité des bien-pensants, et pourtant, au final, l'un des plus grand pourvoyeur à temps plein des divertissements royaux, attentif aux goûts de Louis XIV pour les ballets, la musique, les spectacles délassants...
Comme chez La Fontaine ou La Bruyère, on trouve dans les comédies de Molière un tableau complet de la société contemporaine, les habitués du salon de Célimène, les marquis vaniteux, les grands seigneurs désinvoltes et cyniques, la bourgeoisie parisienne, et la province qui fournit valets et servantes. Riche d'idées, de jugements, sa Comédie humaine est un vaste rassemblement d'êtres réels, et non de types généraux et simplifiés; ses personnages, enracinés dans leur époque, leur quartier, leur classe sociale (qu'ils s'appellent Harpagon, Monsieur Jourdain, Alceste, Dom Juan ou Dorine), sont complexes, nuancés, parfois en contradiction avec eux-mêmes; au total, fort différents les uns des autres, comme les hommes que nous rencontrons chaque jour. Molière classe et apprécie ses personnages selon leur sincérité, leur bon sens et tout simplement leur bonté. Il a en horreur l'hypocrisie, la tromperie, le mensonge des faux dévots, les prudes de toutes sortes. Il raille tout ce qui est pédant, vaniteux, compliqué, se moque des petits marquis, des précieux, des faux savants. Il déteste ceux qui font souffrir les autres par cupidité, par jalousie, par égoïsme ou par sottise. Cette œuvre est d'un comique constant et vigoureux, comique de satire qui nous venge des personnages odieux, rire purificateur qui repousse les stupidités et les malveillances, mais aussi verve spontanée, gaieté de bon aloi, joie de vivre, de jouer et d'être un homme parmi les hommes.
La principale distraction de Louis XIV sera le théâtre. Jusqu'en 1673, il y a trois troupes : celle du théâtre de Bourgogne, dite "troupe royale" avec la permission de Louis XIII, où brillent Montfleury, la Champmeslé et Baron, le théâtre du Marais que domine le célèbre Mondory, et enfin la troupe de Molière. Ces deux dernières fusionnent en 1673, puis la troupe de l'hôtel de Bourgogne les rejoint a son tour en 1680, pour former la Comédie-Française. Le public aime vraiment la comédie et les comédiens; c'est le public du parterre, remuant, gouailleur, tapageur, mais vif et prompt à l'enthousiasme, plus encore que les privilégiés dont certains font parade sur la scène même et osent troubler la pièce en arrivant en retard...
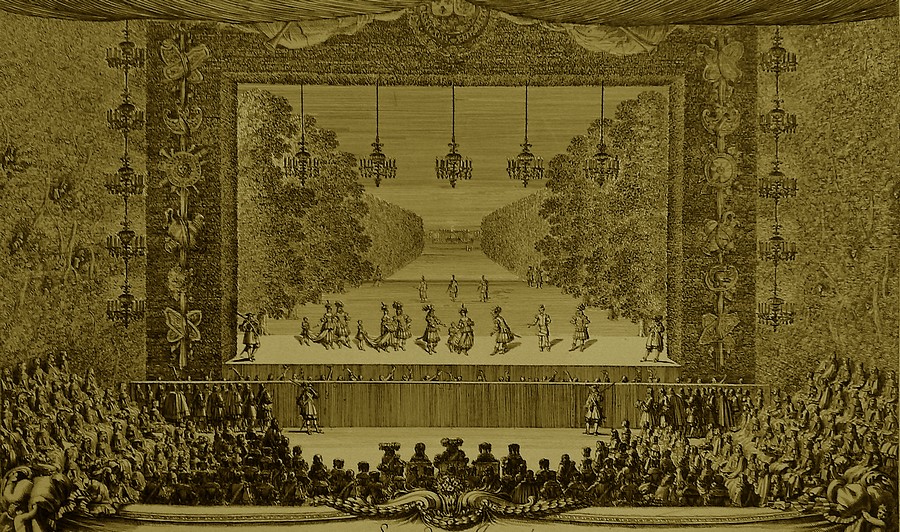
Molière (1622-1673)
Jean-Baptiste Poquelin, fils de Jean Poquelin, marchand tapissier du roi, naît a Paris en janvier 1622. Après avoir reçu une solide éducation, il prend la décision de se faire comédien et en 1643 il signe un contrat avec l'Illustre Théâtre, c'est-à-dire avec la comédienne Madeleine Béjart et sa famille, prend en 1644 le nom de Molière, rencontre d'inévitables difficultés matérielles et se heurte à des rivalités de toutes sortes : l'Illustre Théâtre, dont il est devenu le directeur, fait faillite en 1645. De 1645 à 1658, les comédiens mènent une vie de voyages et d'aventures, parcourant le midi et l'ouest de la France. Molière fait jouer en 1653 l' "Etourdí", que suivra "le Dépít amoureux", joué à Béziers en 1656.
Rentré a Paris en 1658, Molière, dont la troupe a obtenu la protection de Monsieur, frère du roi, donne en 1659 "les Précíeuses Rídícules" et en 1661 "Dom Garcíe de Navarre", une tragi-comédie qui fut un échec. Il épouse en 1662 Armande Béjart, sœur de Madeleine, qui a vingt ans de moins que lui. La représentation de "l'Ecole des Femmes", la même année, provoque des discussions passionnées. "Tartuffe" en 1664 rencontre l'hostilité des dévots; la pièce est interdite et ne sera représentée en public, grâce au soutien du roi, qu'en 1669. Molière donne ensuite "Dom Juan" (1665), "le Misanthrope" (1666), "l'Avare" (1668), "le Bourgeois Gentilhomme" (1670), "les Femmes Savantes" (1672). A la quatrième représentation du "Malade imaginaire" (1673) il a une défaillance sur la scène et meurt quelques heures plus tard.
«C'est, à mon sens, écrivait Sainte-Beuve, comme un bienfait public que de faire aimer Molière à plus de gens.
«Aimer Molière, en effet, j'entends l'aimer sincèrement et de tout son coeur, c'est, savez-vous? avoir une garantie en soi contre bien des défauts, bien des travers et des vices d'esprit. C'est ne pas aimer d'abord tout ce qui est incompatible avec Molière, tout ce qui lui était contraire en son temps, ce qui lui eût été insupportable du nôtre.
« Aimer Molière, c'est être guéri jamais, je ne parle pas de la basse et infâme hypocrisie, mais du fanatisme, de l'intolérance et de la dureté en ce genre, de ce qui fait anathématiser et maudire ; c'est apporter un correctif à l'admiration même pour Bossuet et pour tous ceux qui, à son image, triomphent, ne fût-ce qu'en paroles, de leur ennemi mort ou mourant; qui usurpent je ne sais quel langage sacré et se supposent involontairement, le tonnerre en main, au lieu et place du Très-Haut. Gens éloquents et sublimes, vous l'êtes beaucoup trop pour moi!
«Aimer Molière, c'est être également à l'abri et à mille lieues de cet autre fanatisme politique, froid, sec et cruel, qui ne rit pas, qui sent son sectaire, qui, sous prétexte de puritanisme, trouve moyen de pétrir et de combiner tous les fiels, et d'unir dans une doctrine amère les haines, les rancunes et les jacobinismes de tous les temps. C'est ne pas être moins éloigné, d'autre part, de ces âmes fades et molles qui, en présence du mal, ne savent ni s'indigner ni haïr.
" Aimer Molière, c'est être assuré de ne pas aller donner dans l'admiration béate et sans limite pour une Humanité qui s'idolâtre et qui oublie de quelle étoffe elle est faite et qu'elle n'est toujours, quoi qu'elle fasse, que l'humaine et chétive nature. C'est ne pas la mépriser trop pourtant, cette commune humanité dont on rit, dont on est, et dans laquelle on se replonge chaque fois avec lui par une hilarité bienfaisante.
«Aimer et chérir Molière, c'est être antipathique à toute manière dans le langage et dans l'expression; c'est ne pas s'amuser et s'attarder aux grâces mignardes, aux finesses cherchées, aux coups de pinceau léchés, au marivaudage en aucun genre, au style miroitant et artificiel.
«Aimer Molière, c'est n'être disposé â aimer ni le faux bel esprit ni la science pédante ; c'est savoir reconnaître à première vue nos Trissotins et nos Vadius jusque sous leurs airs galants et rajeunis; c'est ne pas se laisser prendre aujourd'hui plus qu'autrefois à l'éternelle Philaminte, cette précieuse de tous les temps, dont la forme seulement change et dont le plumage se renouvelle sans cesse ; c'est aimer la santé et le droit sens de l'esprit chez les autres comme pour soi. — Je ne fais que donner la note et le motif; on peut continuer et varier sur ce ton.
«Aimer et préférer ouvertement Corneille, comme le font certains esprits que je connais, c'est sans doute une belle chose et, en un sens, bien légitime; c'est vouloir habiter et marquer son rang dans le monde des grandes âmes ; et pourtant n'est-ce pas risquer, avec la grandeur et le sublime, d'aimer un peu la fausse gloire, d'aller jusqu'à ne pas détester l'enflure et l'emphase, un air d'héroïsme à tout propos? Celui qui aime passionnément Corneille peut n'être pas ennemi d'un peu de jactance.
"Aimer, au contraire, et préférer Racine, ah ! c'est sans doute aimer avant tout l'élégance, la grâce, le naturel et la vérité (au moins relativement), la sensibilité, une passion touchante et charmante; mais n'est-ce pas cependant aussi, sous ce type unique de perfection, laisser s'introduire dans son goût et dans son esprit de certaines beautés convenues et trop adoucies, de certaines mollesses et langueurs trop chères, de certaines délicatesses excessives, exclusives ?
Enfin, tant aimer Racine, c'est risquer d'avoir trop de ce qu'on appelle en France le goût et qui rend si dégoûtés.
«Aimer Boileau.... Mais non, on n'aime pas Boileau, on l'estime, on le respecte ; on admire sa probité, sa raison, par instants sa verve, et, si l'on est tenté de l'aimer, c'est uniquement pour cette équité souveraine qui lui a fait rendre une si ferme justice aux grands poètes ses contemporains, et en particulier à celui qu'il proclame le premier de tous, à Molière.
" Aimer La Fontaine, c'est presque la même chose qu'aimer Molière ; c'est aimer la nature, toute la nature, la peinture naïve de l'humanité, une représentation de la grande comédie " aux cent actes divers, " se déroulant, se découpant à nos yeux en mille petites scènes avec des grâces et des nonchalances qui vont si bien au bonhomme, avec des faiblesses aussi et des laisser-aller qui ne se rencontrent jamais dans le simple et mâle génie, le maître des maîtres. Mais pourquoi irais-je les diviser ? La Fontaine et Molière, on ne les sépare pas, on les aime ensemble.»

1659 - "Les Précieuses ridicules"
Au Louvre, le 24 octobre 1658, devant le roi et la cour, Molière avait joué "Nicomède" sans grand succès, mais avait terminé le spectacle avec la farce du 'Docteur amoureux". Autorisé à jouer au théâtre du Petit-Bourbon, c'est avec "Les Précieuses ridicules" que la "Troupe de Monsieur" obtient son premier succès en novembre 1659, une véritable farce, avec masques et visages enfarinés, mais qui inaugure une nouvelle orientation de la comédie, celle de la peinture des moeurs. Molière obtint du roi la salle du Petit-Bourbon puis celle du Palais-Royal (à partir de 1660) où il remporte de nombreux succès en tant qu’auteur, acteur et directeur de troupe...
"J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte; et jusqu'à mes chaussettes, je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne faiseuse." - Cathos et Magdelon, de jeunes «précieuses», rêvant d'aventures et d'amours raffinées telles qu'on peut les lire dans les romans de l'époque, éprises de musique et de littérature, et ne supportant que la fréquentation de beaux esprits. Gorgibus, père de l'une et oncle de l'autre, veut les marier à de jeunes gens qui ont de la fortune ou un titre de noblesse, et encourage donc La Grange et Du Croisy à leur faire la cour. Ceux-ci, vertement repoussés par Cathos et Magdelon à cause de leur manque de raffinement et de galanterie, en font part à Gorgibus, et entendent se venger des deux jeunes femmes . Gorgibus se plaint de la coquetterie de Cathos et Magdelon, et leur reproche d'avoir éconduit La Grange et Du Croisy, les jeunes femmes lui exposent leur idéal de galanterie et leur vision romanesque du mariage, laissant Gorgibus à une incompréhension indignée et leur promettant de les marier de force à qui il voudra....
(Scène 4)
GORGIBUS: Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépense pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur? Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour maris?
MAGDELON: Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là?
CATHOS: Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne?
GORGIBUS: Et qu'y trouvez-vous à redire?
MAGDELON: La belle galanterie que la leur! Quoi? débuter d'abord par le mariage!
GORGIBUS: Et par où veux-tu donc qu'ils débutent? par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions?
MAGDELON: Ah! mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses.
GORGIBUS: Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnêtes gens que de débuter par là.
MAGDELON: Mon Dieu! Que, si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini! La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane, et qu'Aronce de plain-pied fût marié à Clélie!
GORGIBUS: Que me vient conter celle-ci?
MAGDELON: Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux; ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelque jardin, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée; et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux, qui paraît à notre rougeur, et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements, et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue! Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé; et j'ai mal au coeur de la seule vision que cela me fait.
GORGIBUS: Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien du haut style.
CATHOS: En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie? Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de Tendre, et que billets-doux, petits-soins, billets-galants et jolis-vers sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de rubans.! Mon Dieu, quels amants sont-ce là! quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leurs hauts-de-chausses ne soient assez larges.
GORGIBUS: Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Cathos, et vous, Magdelon.
MAGDELON: Eh! de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges, et nous appelez autrement.
GORGIBUS: Comment, ces noms étranges! Ne sont-ce pas vos noms de baptême?
MAGDELON: Mon Dieu, que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Cathos ni de Magdelon? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde?
CATHOS: Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là; et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi, et celui d'Aminte que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord.
GORGIBUS: Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve: je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines; et pour ces Messieurs dont il est question, je connais leurs familles et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour maris. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge."
Les précieuses se désolent du sort qu'entend leur faire Gorgibus, lorsqu'on vient leur annoncer la visite du «marquis de Mascarille», qui arrive en chaise à porteurs. Celui-ci fait à Magdelon et Cathos des compliments ampoulés qui les ravissent, et leur lit un poème absurde de sa composition qui les bouleverse....
(Scène 9)
MAGDELON: Hélas! Qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison, pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie.
MASCARILLE: Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens.
CATHOS: C'est une vérité incontestable.
MASCARILLE: Il y fait un peu crotté; mais nous avons la chaise.
MAGDELON: Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps.
MASCARILLE: Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit est des vôtres?
MAGDELON: Hélas! nous ne sommes pas encore connues; mais nous sommes en passe de l'être, et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du Recueil des Pièces Choisies.
CATHOS: Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses.
MASCARILLE: C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne: ils me rendent tous visite; et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits.
MAGDELON: Eh! mon Dieu, nous vous serons obligées de la dernière obligation, si vous nous faites cette amitié; car enfin il faut avoir la connaissance de tous ces Messieurs-là, si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris, et vous savez qu'il y en a tel dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu'il faut savoir de nécessité, et qui sont de l'essence du bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé: "Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet; une telle a fait des paroles sur un tel air; celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance; celui-là a composé des stances sur une infidélité; Monsieur un tel écrivit hier au soir un sixain à Mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les huit heures; un tel auteur a fait un tel dessein; celui-là en est à la troisième partie de son roman; cet autre met ses ouvrages sous la presse." C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies; et si l'on ignore ces choses, je ne donnerais pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir.
CATHOS: En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule, qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour; et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu.
MASCARILLE: Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait; mais ne vous mettez pas en peine: je veux établir chez vous une académie de beaux esprits, et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de vers dans Paris que vous ne sachiez par coeur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux; et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, deux cents chansons, autant de sonnets, quatre cents épigrammes et plus de mille madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits.
MAGDELON: Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela.
MASCARILLE: Les portraits sont difficiles, et demandent un esprit profond: vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas.
CATHOS: Pour moi, j'aime terriblement les énigmes.
MASCARILLE: Cela exerce l'esprit, et j'en ai fait quatre encore ce matin, que je vous donnerai à deviner.
MAGDELON: Les madrigaux sont agréables, quand ils sont bien tournés.
MASCARILLE: C'est mon talent particulier; et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine.
MAGDELON: Ah! certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire au moins, si vous le faites imprimer.
MASCARILLE: Je vous en promets à chacune un, et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition; mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent.
MAGDELON: Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé.
MASCARILLE: Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous die un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amies que je fus visiter; car je suis diablement fort sur les impromptus.
CATHOS: L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.
MASCARILLE: Écoutez donc.
MAGDELON: Nous y sommes de toutes nos oreilles.
MASCARILLE
Oh, oh! je n'y prenais pas garde:
Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde,
Votre oeil en tapinois me dérobe mon coeur.
Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur!
CATHOS: Ah! mon Dieu! voilà qui est poussé dans le dernier galant.
MASCARILLE: Tout ce que je fais a l'air cavalier; cela ne sent point le pédant.
MAGDELON: Il en est éloigné de plus de deux mille lieues.
MASCARILLE: Avez-vous remarqué ce commencement: oh, oh? Voilà qui est extraordinaire: oh, oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup: oh, oh! La surprise: oh, oh!
MAGDELON: Oui, je trouve ce oh, oh! Admirable.
On annonce ensuite le «vicomte de Jodelet», ami de Mascarille, et qui se vante d'exploits militaires fictifs, se déshabillant à moitié pour faire admirer ses cicatrices. Impressionnées par la belle prestance et la galanterie de ces visiteurs, Cathos et Magdelon font venir des musiciens pour pourvoir danser et un bal commence. Arrivent alors La Grange et Du Croisy qui se battent avec Mascarille et Jodelet et révèlent que les deux galants n'étaient que leurs valets déguisés. Les deux précieuses, mortifiées d'avoir été ainsi trompées, doivent en plus subir la colère de Gorgibus, qui les bat en maudissant leur extravagance..

1660 - "Sganarelle"
Une nouvelle farce et un nouveau succès, avec des personnages à visage découvert, Sgnarelle et Lucinde, sa fille, Clitandre, son amant, M.Guillaume, vendeur de tapisserie, M. Josse, orfèvre, nombre de médecins, Aminte, Lucrèce, Lisette, suivante de Lucinde. La scène est à Paris, dans une salle de la maison de Sganarelle...
ACTE I, Scène première
SGANARELLE: Ah! L'étrange chose que la vie! Et que je puis bien dire, avec ce grand philosophe de l'antiquité, que qui terre a, guerre a, et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre! Je n'avais qu'une femme, qui est morte.
M. GUILLAUME: Et combien donc en voulez-vous avoir?
SGANARELLE: Elle est morte, Monsieur Guillaume mon ami. Cette perte m'est très sensible, et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étais pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent dispute ensemble; mais enfin la mort rajuste toutes choses. Elle est morte: je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. De tous les enfants que le Ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une fille, et cette fille est toute ma peine. Car enfin je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable, dont il n'y a pas moyen de la retirer, et dont je ne saurais même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit, et j'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Vous êtes ma nièce; vous, ma voisine; et vous, mes compères et mes amis: je vous prie de me conseiller tout ce que je dois faire.
M. JOSSE: Pour moi, je tiens que la braverie, que l'ajustement est la chose qui réjouit le plus les filles; et si j'étais que de vous, je lui achèterais, dès aujourd'hui, une belle garniture de diamants, ou de rubis, ou d'émeraudes.
M. GUILLAUME: Et moi, si j'étais en votre place, j'achèterais une belle tenture de tapisserie de verdure, ou à personnages, que je ferais mettre dans sa chambre, pour lui réjouir l'esprit et la vue.
AMINTE: Pour moi, je ne ferais point tant de façon; et je la marierais fort bien, et le plus tôt que je pourrais, avec cette personne qui vous la fit, dit-on, demander il y a quelque temps.
LUCRÈCE: Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout propre pour le mariage. Elle est d'une complexion trop délicate et trop peu saine, et c'est la vouloir envoyer bientôt en l'autre monde, que de l'exposer, comme elle est, à faire des enfants. Le monde n'est point du tout son fait, et je vous conseille de la mettre dans un couvent, où elle trouvera des divertissements qui seront mieux de son humeur.
SGANARELLE: Tous ces conseils sont admirables assurément; mais je les tiens un peu intéressés, et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse, et votre conseil sent son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vous vendez des tapisseries, Monsieur Guillaume, et vous avez la mine d'avoir quelque tenture qui vous incommode. Celui que vous aimez, ma voisine, a, dit-on, quelque inclination pour ma fille, et vous ne seriez pas fâchée de la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons pour cela; mais le conseil que vous me donnez de la faire religieuse, est d'une femme qui pourrait bien souhaiter charitablement d'être mon héritière universelle. Ainsi, Messieurs et Mesdames, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Voilà de mes donneurs de conseils à la mode."

1661 - "L'Ecole des Maris", "Les Fâcheux"
Mais Molière doit désormais prouver qu'il n'est pas qu'un auteur de "farces" parmi d'autres. Il va inaugurer sa nouvelle salle du Palais-Royal en janvier 1661 avec "Don Garcie de Navarre", une comédie héroïque en cinq actes et en vers. C'est un échec, la tragédie ne lui permet pas de franchir cette profondeur d'expression qu'il recherche au-delà de la farce et de la comédie d'intrigue. En quelques mois il termine "L'Ecole des Maris" (juin 1661) et retrouve son public en mêlant encore une fois comédie d'intrigue, farce, et peinture de mœurs et de caractères. S'y ajoute un nouvel élément, une thèse morale en faveur de l'éducation des filles, un thème que porte le personnage d'Ariste, le frère de Sganarelle. Quelques semaines plus tard, à Vaux, aux fêtes données par Fouquet en l'honneur du roi, Molière remporte un nouveau succès avec une comédie-ballet, "Les Fâcheux", (août 1661), mais encore et toujours introduit une nouvelle gradation, celle de portraits-satiriques dont le naturel séduit. Louis XIV, dit-on, qui commence à s'intéresser à Molière...
La fortune semble sourire à Molière, il a 40 ans, il épouse Armande, sœur de Madeleine Béjart (janvier 1662) : elle a vingt ans de moins que lui et ne tardera pas à éveiller sa jalousie...
(L'Ecole des Maris, Acte I, scène 2)
ARISTE, le frère de Sganarelle
Mon frère, son discours ne doit que faire rire.
Elle a quelque raison en ce qu'elle veut dire:
Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté;
On le retient fort mal par tant d'austérité;
Et les soins défiants, les verrous et les grilles
Ne font pas la vertu des femmes ni des filles.
C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir,
Non la sévérité que nous leur faisons voir.
C'est une étrange chose, à vous parler sans feinte,
Qu'une femme qui n'est sage que par contrainte.
En vain sur tous ses pas nous prétendons régner:
Je trouve que le coeur est ce qu'il faut gagner,
Et je ne tiendrais, moi, quelque soin qu'on se donne,
Mon honneur guère sûr aux mains d'une personne
À qui, dans les désirs qui pourraient l'assaillir,
Il ne manquerait rien qu'un moyen de faillir.
SGANARELLE
Chansons que tout cela!
ARISTE
Soit; mais je tiens sans cesse
Qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse,
Reprendre ses défauts avec grande douceur,
Et du nom de vertu ne lui point faire peur.
Mes soins pour Léonor ont suivi ces maximes:
Des moindres libertés je n'ai point fait des crimes.
À ses jeunes désirs j'ai toujours consenti,
Et je ne m'en suis point, grâce au Ciel, repenti.
J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies,
Les divertissements, les bals, les comédies;
Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps
Fort propres à former l'esprit des jeunes gens;
Et l'école du monde, en l'air dont il faut vivre
Instruit mieux, à mon gré, que ne fait aucun livre.
Elle aime à dépenser en habits, linge et noeuds:
Que voulez-vous? je tâche à contenter ses voeux;
Et ce sont des plaisirs qu'on peut, dans nos familles,
Lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes filles.
Un ordre paternel l'oblige à m'épouser;
Mais mon dessein n'est pas de la tyranniser.
Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère,
Et je laisse à son choix liberté tout entière.
Si quatre mille écus de rente bien venants,
Une grande tendresse et des soins complaisants
Peuvent, à son avis, pour un tel mariage,
Réparer entre nous l'inégalité d'âge,
Elle peut m'épouser; sinon, choisir ailleurs.
Je consens que sans moi ses destins soient meilleurs;
Et j'aime mieux la voir sous un autre hyménée,
Que si contre son gré sa main m'était donnée.
SGANARELLE
Hé! qu'il est doucereux! c'est tout sucre et tout miel.
ARISTE
Enfin, c'est mon humeur, et j'en rends grâce au ciel.
Je ne suivrais jamais ces maximes sévères,
Qui font que les enfants comptent les jours des pères.
SGANARELLE
Mais ce qu'en la jeunesse on prend de liberté
Ne se retranche pas avec facilité;
Et tous ses sentiments suivront mal votre envie,
Quand il faudra changer sa manière de vie.
ARISTE
Et pourquoi la changer?
SGANARELLE
Pourquoi?
ARISTE
Oui.
SGANARELLE
Je ne sais.
Un des procédés habituels de Molière est d'opposer deux personnages, deux idées, ce qui permet de mettre en lumière ce que chacun des deux personnages, chacune des deux idées a de plus excessif ou de plus caricatural. Ainsi ici, acte I, scène 1, Aristide et Sganarelle, en soutenant chacun leur opinion, s'obligent à en montrer toutes les conséquences, avec un double déclenchement: en recommandant à Alceste d'accepter le monde tel qu'il est, Philinte en fait une violente satire...
SGANARELLE
Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant,
Et que chacun de nous vive comme il l'entend.
Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage
Et soyez assez vieux pour devoir être sage,
Je vous dirai pourtant que mes intentions
Sont de ne prendre point de vos corrections,
Que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre,
Et me trouve fort bien de ma façon de vivre.
ARISTE
Mais chacun la condamne.
SGANARELLE
Oui, des fous comme vous,
Mon frère.
ARISTE
Grand merci : le compliment est doux.
SGANARELLE
Je voudrois bien savoir, puisqu'il faut tout entendre,
Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.
ARISTE
Cette farouche humeur, dont la sévérité
Fuit toutes les douceurs de la société,
A tous vos procédés inspire un air bizarre,
Et, jusques à l'habit, vous rend chez vous barbare.
SGANARELLE
Il est vrai qu'à la mode il faut m'assujettir,
Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir !
Ne voudriez−vous point, par vos belles sornettes,
Monsieur mon frère aîné (car, Dieu merci, vous l'êtes
D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer,
Et cela ne vaut point la peine d'en parler),
Ne voudriez−vous point, dis−je, sur ces matières,
De vos jeunes muguets m'inspirer les manières ?
M'obliger à porter de ces petits chapeaux
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,
Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure
Des visages humains offusque la figure ?
De ces petits pourpoints sous les bras se perdants,
Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendants ?
De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces,
Et de ces cotillons appelés hauts−de−chausses ?
De ces souliers mignons, de rubans revêtus,
Qui vous font ressembler à des pigeons pattus ?
Et de ces grands canons où, comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves,
Et par qui nous voyons ces Messieurs les galants
Marcher écarquillés ainsi que des volants ?
Je vous plairois, sans doute, équipé de la sorte ;
Et je vous vois porter les sottises qu'on porte.
ARISTE
Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder,
Et jamais il ne faut se faire regarder.
L'un et l'autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage,
N'y rien trop affecter, et sans empressement
Suivre ce que l'usage y fait de changement.
Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode
De ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode,
Et qui dans ses excès, dont ils sont amoureux,
Seroient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux ;
Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde,
De fuir obstinément ce que suit tout le monde,
Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous,
Que du sage parti se voir seul contre tous.
SGANARELLE
Cela sent son vieillard, qui, pour en faire accroire,
Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire.
ARISTE
C'est un étrange fait du soin que vous prenez
A me venir toujours jeter mon âge au nez,
Et qu'il faille qu'en moi sans cesse je vous voie
Blâmer l'ajustement aussi bien que la joie,
Comme si, condamnée à ne plus rien chérir,
La vieillesse devoit ne songer qu'à mourir,
Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée,
Sans se tenir encor malpropre et rechignée.
SGANARELLE
Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement
A ne démordre point de mon habillement.
Je veux une coiffure, en dépit de la mode,
Sous qui toute ma tête ait un abri commode ;
Un beau pourpoint bien long et fermé comme il faut,
Qui, pour bien digérer, tienne l'estomac chaud ;
Un haut−de−chausses fait justement pour ma cuisse ;
Des souliers où mes pieds ne soient point au supplice.
Ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux :
Et qui me trouve mal, n'a qu'à fermer les yeux.

1662 – "L’Ecole des femmes"
La première de ses grandes comédies. Invité à la cour pour y faire représenter ses œuvres, Molière suscita dès ce moment des jalousies, qui se manifestèrent avec un éclat particulier au lendemain de la création d'une de ses comédies les plus réussies, l'Ecole des femmes (décembre 1662). Le sujet de cette pièce, qui soulevait des questions importantes (l'institution du mariage et l'éducation des filles), tranchait nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à l'italienne. Innovation littéraire en même temps que critique originale de la société du temps, elle irrita certains auteurs concurrents autant qu'elle choqua les tenants de la morale traditionnelle. Elle eut cependant un succès retentissant, ce qui ne contribua pas à apaiser le débat.
Le quadragénaire Arnolphe rêvait d'une femme parfaitement fidèle et soumise à ses volontés. Il a pris soin de choisir autrefois, à la campagne, une fillette de 4 ans et l'a formée selon sa "méthode", l'ignorance totale de la vie. Agnès a maintenant 17 ans et, en attendant de l'épouser, son tuteur la tient jalousement enfermée. Mais lorsqu'elle aperçoit un jour, en l'absence d'Arnolphe, le jeune Horace, Agnès se sent invinciblement attirée par son charme. Méprise aidant, Arnolphe devient le confident d'Horace. Ne se doutant pas qu'Arnolphe, ami de son propre père, et M. de la Souche, tuteur d'Agnès, ne sont qu'une même personne, le jeune homme lui confie qu'il doit enlever Agnès le soir même. Toute l'intrigue va reposer sur cette méprise. Agnès avoue ingénument â Arnolphe son attirance pour Horace, mais le tuteur jaloux lui présente cet amour hors du mariage comme un crime et lui enjoint de chasser le jeune homme à coups de pierre. Elle obéit, et, pour la préparer â l'épouser, Arnolphe lui fait lire
les rébarbatives "Maximes du Mariage". Mais il apprend bientôt d'Horace lui-même que la pierre lancée par Agnès s'accompagnait d'une déclaration d'amour! Arnolphe redouble de vigilance.. Mais tout s'arrange pour ceux qui s'aiment...
L’Ecole des femmes - Acte I, scène 1, "Epouser une sotte est pour n'être point sot.."
CHRYSALDE
Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main ?
ARNOLPHE
Oui. Je veux terminer la chose dans demain.
CHRYSALDE
Nous sommes ici seuls, et l'on peut, ce me semble,
Sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble.
Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon coeur ?
Votre dessein, pour vous, me fait trembler de peur,
Et, de quelque façon que vous tourniez l'affaire,
Prendre femme est à vous un coup bien téméraire.
ARNOLPHE
Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous
Vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous ;
Et votre front, je crois, veut que du mariage
Les cornes soient partout l'infaillible apanage.
CHRYSALDE
Ce sont coups de hasard, dont on n'est point garant ;
Et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend.
Mais, quand je crains pour vous, c'est cette raillerie
Dont cent pauvres maris ont souffert la furie :
Car enfin, vous savez qu'il n'est grands, ni petits,
Que de votre critique on ait vus garantis :
Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes,
De faire cent éclats des intrigues secrètes...
ARNOLPHE
Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi
Où l'on ait des maris si patients qu'ici ?
Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces
Qui sont accommodés chez eux de toutes pièces ?
L'un amasse du bien dont sa femme fait part
A ceux qui prennent soin de le faire cornard ;
L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme,
Voit faire tous les jours des présents à sa femme,
Et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu
Parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu.
L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guères ;
L'autre en toute douceur laisse aller les affaires,
Et, voyant arriver chez lui le damoiseau,
Prend fort honnêtement ses gants et son manteau.
L'une, de son galant, en adroite femelle,
Fait fausse confidence à son époux fidèle,
Qui dort en sûreté sur un pareil appas,
Et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas ;
L'autre, pour se purger de sa magnificence,
Dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense,
Et le mari benêt, sans songer à quel jeu,
Sur les gains qu'elle fait rend des grâces à Dieu.
Enfin, ce sont partout des sujets de satire,
Et, comme spectateur, ne puis-je pas en rire ?
Puis-je pas de nos sots...
CHRYSALDE
Oui ; mais qui rit d'autrui
Doit craindre qu'en revanche on rie aussi de lui.
J'entends parler le monde, et des gens se délassent
A venir débiter les choses qui se passent ;
Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis,
Jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits.
J'y suis assez modeste ; et bien qu'aux occurrences
Je puisse condamner certaines tolérances,
Que mon dessein ne soit de souffrir nullement
Ce que quelques maris souffrent paisiblement,
Pourtant je n'ai jamais affecté de le dire ;
Car enfin il faut craindre un revers de satire,
Et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas
De ce qu'on pourra faire, ou bien ne faire pas.
Ainsi, quand à mon front, par un sort qui tout mène,
Il serait arrivé quelque disgrâce humaine,
Après mon procédé, je suis presque certain
Qu'on se contentera de s'en rire sous main ;
Et peut-être qu'encor j'aurai cet avantage,
Que quelques bonnes gens diront que c'est dommage.
Mais de vous, cher compère, il en est autrement ;
Je vous le dis encor, vous risquez diablement.
Comme sur les maris accusés de souffrance
De tout temps votre langue a daubé d'importance,
Qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné,
Vous devez marcher droit, pour n'être point berné ;
Et, s'il faut que sur vous on ait la moindre prise,
Gare qu'aux carrefours on ne vous tympanise,
Et...
ARNOLPHE
Mon Dieu ! notre ami, ne vous tourmentez point :
Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point.
Je sais les tours rusés et les subtiles trames
Dont pour nous en planter savent user les femmes.
Et comme on est dupé par leurs dextérités,
Contre cet accident j'ai pris mes sûretés ;
Et celle que j'épouse a toute l'innocence
Qui peut sauver mon front de maligne influence.
CHRYSALDE
Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot...
ARNOLPHE
Epouser une sotte est pour n'être point sot.
Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage ;
Mais une femme habile est un mauvais présage ;
Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens
Pour avoir pris les leurs avec trop de talents.
Moi, j'irais me charger d'une spirituelle
Qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle ;
Qui de prose et de vers ferait de doux écrits,
Et que visiteraient marquis et beaux esprits,
Tandis que, sous le nom du mari de madame,
Je serais comme un saint que pas un ne réclame ?
Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut ;
Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut.
Je prétends que la mienne, en clartés peu sublime,
Même ne sache pas ce que c'est qu'une rime :
Et, s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon,
Et qu'on vienne à lui dire à son tour : <<Qu'y met-on ? >>
Je veux qu'elle réponde : <<Une tarte à la crème>> ;
En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême :
Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler,
De savoir prier Dieu, m'aimer, coudre, et filer.
CHRYSALDE
Une femme stupide est donc votre marotte ?
ARNOLPHE
Tant, que j'aimerais mieux une laide bien sotte
Qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit.
CHRYSALDE
L'esprit et la beauté...
ARNOLPHE
L'honnêteté suffit.
CHRYSALDE
Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête
Puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête ?
Outre qu'il est assez ennuyeux, que je croi,
D'avoir toute sa vie une bête avec soi,
Pensez-vous le bien prendre, et que sur votre idée
La sûreté d'un front puisse être bien fondée ?
Une femme d'esprit peut trahir son devoir ;
Mais il faut pour le moins, qu'elle ose le vouloir ;
Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire,
Sans en avoir l'envie et sans penser le faire.
ARNOLPHE
A ce bel argument, à ce discours profond,
Ce que Pantagruel à Panurge répond :
Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte,
Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte ;
Vous serez ébahi, quand vous serez au bout,
Que vous ne m'aurez rien persuadé du tout.
CHRYSALDE
Je ne vous dis plus mot.
ARNOLPHE
Chacun a sa méthode,
En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode :
Je me vois riche assez pour pouvoir, que je croi,
Choisir une moitié qui tienne tout de moi,
Et de qui la soumise et pleine dépendance
N'ait à me reprocher aucun bien ni naissance.
Un air doux et posé, parmi d'autres enfants,
M'inspira de l'amour pour elle dès quatre ans.
Sa mère se trouvant de pauvreté pressée,
De la lui demander il me vint en pensée ;
Et la bonne paysanne, apprenant mon désir,
A s'ôter cette charge eut beaucoup de plaisir.
Dans un petit couvent, loin de toute pratique,
Je la fis élever selon ma politique ;
C'est-à-dire, ordonnant quels soins on emploierait
Pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait.
Dieu merci, le succès a suivi mon attente ;
Et, grande, je l'ai vue à tel point innocente,
Que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait,
Pour me faire une femme au gré de mon souhait.
Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure
A cent sortes de gens est ouverte à toute heure
Je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir,
Dans cette autre maison où nul ne me vient voir ;
Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle,
Je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle.
Vous me direz : Pourquoi cette narration ?
C'est pour vous rendre instruit de ma précaution.
Le résultat de tout est qu'en ami fidèle
Ce soir je vous invite à souper avec elle ;
Je veux que vous puissiez un peu l'examiner,
Et voir si de mon choix on me doit condamner.
Acte V, scène 4 - Arnolphe nous expose sa souffrance, - situation douloureuse d'un homme qui aime, qui ne sait ni se faire aimer ni trouver les mots pour émouvoir, et qui en a désespérément conscience -, et pourtant nous ne pouvons que le trouver grotesque et odieux...
... ARNOLPHE
Mon visage, friponne,
Dans cette occasion rend vos sens effrayés,
Et c'est à contre-coeur qu'ici vous me voyez.
Je trouble en ses projets l'amour qui vous possède.
(Agnès regarde si elle ne verra point Horace.)
N'appelez point des yeux le galant à votre aide:
Il est trop éloigné pour vous donner secours.
Ah! ah! si jeune encor, vous jouez de ces tours!
Votre simplicité, qui semble sans pareille,
Demande si l'on fait les enfants par l'oreille;
Et vous savez donner des rendez-vous la nuit,
Et pour suivre un galant vous évader sans bruit!
Tudieu! comme avec lui votre langue cajole!
Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école.
Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris?
Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits?
Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardie?
Ah! coquine, en venir à cette perfidie!
Malgré tous mes bienfaits former un tel dessein!
Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein,
Et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate,
Cherche à faire du mal à celui qui le flatte!
AGNÈS
Pourquoi me criez-vous?
ARNOLPHE
J'ai grand tort en effet!
AGNÈS
Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait.
ARNOLPHE
Suivre un galant n'est pas une action infâme?
AGNÈS
C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme:
J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché
Qu'il se faut marier pour ôter le péché.
ARNOLPHE
Oui. Mais pour femme, moi je prétendais vous prendre;
Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre.
AGNÈS
Oui. Mais, à vous parler franchement entre nous,
Il est plus pour cela selon mon goût que vous.
Chez vous le mariage est fâcheux et pénible,
Et vos discours en font une image terrible;
Mais, las! il le fait, lui, si rempli de plaisirs,
Que de se marier il donne des désirs.
ARNOLPHE
Ah! c'est que vous l'aimez, traîtresse!
AGNÈS
Oui, je l'aime.
ARNOLPHE
Et vous avez le front de le dire à moi-même!
AGNÈS
Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas?
ARNOLPHE
Le deviez-vous aimer, impertinente?
AGNÈS
Hélas!
Est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause;
Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose.
ARNOLPHE
Mais il fallait chasser cet amoureux désir.
AGNÈS
Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir?
ARNOLPHE
Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire?
AGNÈS
Moi? point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire?
ARNOLPHE
Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui.
Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte?
AGNÈS
Vous?
ARNOLPHE
Oui.
AGNÈS
Hélas! non.
ARNOLPHE
Comment, non!
AGNÈS
Voulez-vous que je mente?
ARNOLPHE
Pourquoi ne m'aimer pas, Madame l'impudente?
AGNÈS
Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer:
Que ne vous êtes-vous, comme lui, fait aimer?
Je ne vous en ai pas empêché, que je pense.
ARNOLPHE
Je m'y suis efforcé de toute ma puissance;
Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous.
AGNÈS
Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous;
Car à se faire aimer il n'a point eu de peine.
ARNOLPHE
Voyez comme raisonne et répond la vilaine!
Peste! une précieuse en dirait-elle plus?
Ah! je l'ai mal connue; ou, ma foi! là-dessus
Une sotte en sait plus que le plus habile homme.
Puisque en raisonnement votre esprit se consomme,
La belle raisonneuse, est-ce qu'un si long temps
Je vous aurai pour lui nourrie à mes dépens?
AGNÈS
Non. Il vous rendra tout jusques au dernier double.
ARNOLPHE
Elle a de certains mots où mon dépit redouble.
Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir,
Les obligations que vous pouvez m'avoir?
AGNÈS
Je ne vous en ai pas d'aussi grandes qu'on pense.
ARNOLPHE
N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance?
AGNÈS
Vous avez là dedans bien opéré vraiment,
Et m'avez fait en tout instruire joliment!
Croit-on que je me flatte, et qu'enfin, dans ma tête,
Je ne juge pas bien que je suis une bête?
Moi-même, j'en ai honte; et, dans l'âge où je suis,
Je ne veux plus passer pour sotte, si je puis.
ARNOLPHE
Vous fuyez l'ignorance, et voulez, quoi qu'il coûte,
Apprendre du blondin quelque chose?
AGNÈS
Sans doute.
C'est de lui que je sais ce que je peux savoir:
Et beaucoup plus qu'à vous je pense lui devoir.
ARNOLPHE
Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade
Ma main de ce discours ne venge la bravade.
J'enrage quand je vois sa piquante froideur,
Et quelques coups de poing satisferaient mon coeur.
AGNÈS
Hélas! vous le pouvez, si cela vous peut plaire.
ARNOLPHE
Ce mot et ce regard désarme ma colère,
Et produit un retour de tendresse et de coeur,
Qui de son action efface la noirceur.
Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses
Les hommes soient sujets à de telles faiblesses!
Tout le monde connaît leur imperfection:
Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion;
Leur esprit est méchant, et leur âme fragile;
Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile,
Rien de plus infidèle: et malgré tout cela,
Dans le monde on fait tout pour ces animaux-là.
Hé bien! faisons la paix. Va, petite traîtresse,
Je te pardonne tout et te rends ma tendresse.
Considère par là l'amour que j'ai pour toi,
Et me voyant si bon, en revanche aime-moi.
AGNÈS
Du meilleur de mon coeur je voudrais vous complaire:
Que me coûterait-il, si je le pouvais faire?
ARNOLPHE
Mon pauvre petit coeur, tu le peux, si tu veux.
(Il fait un soupir.)
Écoute seulement ce soupir amoureux,
Vois ce regard mourant, contemple ma personne,
Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne.
C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi,
Et tu seras cent fois plus heureuse avec moi.
Ta forte passion est d'être brave et leste:
Tu le seras toujours, va, je te le proteste;
Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai,
Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai;
Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire:
Je ne m'explique point, et cela, c'est tout dire.
(à part.)
Jusqu'où la passion peut-elle faire aller!
Enfin à mon amour rien ne peut s'égaler:
Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate?
Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte?
Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux?
Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux:
Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme.
AGNÈS
Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme:
Horace avec deux mots en ferait plus que vous.
ARNOLPHE
Ah! c'est trop me braver, trop pousser mon courroux.
Je suivrai mon dessein, bête trop indocile,
Et vous dénicherez à l'instant de la ville.
Vous rebutez mes voeux et me mettez à bout;
Mais un cul de couvent me vengera de tout."
Acte II, scène 5 - Arnolphe, tuteur de la jeune Agnès, s'est efforcé de l'élever dans l'ignorance la plus complète. Mais le jeune Horace, qui le connaît sous un nom d'emprunt, vient lui raconter qu'il a fait la connaissance d'une belle jeune fille, qui est précisément Agnès. Aussi Arnolphe s'empresse-t-il d'interroger sa pupille..
ARNOLPHE : La promenade est belle.
AGNES : Fort belle.
ARNOLPHE : Le beau jour !
AGNES : Fort beau.
ARNOLPHE : Quelle nouvelle ?
AGNES : Le petit chat est mort.
ARNOLPHE : C'est dommage ; mais quoi !
Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi.
Lorsque j'étais aux champs, n'a-t-il point fait de pluie ?
AGNES : Non.
ARNOLPHE : Vous ennuyait-il ?
AGNES : Jamais je ne m'ennuie.
ARNOLPHE : Qu'avez-vous fait encor ces neuf ou dix jours-ci ?
AGNES : Six chemises, je pense, et six coiffes aussi.
ARNOLPHE, ayant un peu rêvé. : Le monde, chère Agnès, est une étrange chose !
Voyez la médisance, et comme chacun cause !
Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu
Etait, en mon absence, à la maison venu ;
Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues.
Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues,
Et j'ai voulu gager que c'était faussement...
AGNES : Mon Dieu ! ne gagez pas, vous perdriez vraiment.
ARNOLPHE : Quoi ! c'est la vérité qu'un homme...
AGNES : Chose sûre,
Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure.
ARNOLPHE, bas, à part. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité
Me marque pour le moins son ingénuité.
(Haut.) Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne,
Que j'avais défendu que vous vissiez personne.
AGNES : Oui ; mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi ;
Et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi.
ARNOLPHE : Peut-être. Mais enfin contez-moi cette histoire.
AGNES : Elle est fort étonnante, et difficile à croire.
J'étais sur le balcon à travailler au frais,
Lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès
Un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue,
D'une humble révérence aussitôt me salue :
Moi, pour ne point manquer à la civilité,
Je fis la révérence aussi de mon côté.
Soudain il me refait une autre révérence ;
Moi, j'en refais de même une autre en diligence ;
Et lui d'une troisième aussitôt repartant,
D'une troisième aussi j'y repars à l'instant.
Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle
Me fait à chaque fois révérence nouvelle ;
Et moi, qui tous ces tours fixement regardais,
Nouvelle révérence aussi je lui rendais :
Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue,
Toujours comme cela je me serais tenue,
Ne voulant point céder, ni recevoir l'ennui
Qu'il me pût estimer moins civile que lui.
ARNOLPHE : Fort bien.
AGNES : Le lendemain, étant sur notre porte,
Une vieille m'aborde, en parlant de la sorte :
<<Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir,
Et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir !
Il ne vous a pas fait une belle personne,
Afin de mal user des choses qu'il vous donne ;
Et vous devez savoir que vous avez blessé
Un coeur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé.>>
ARNOLPHE, à part. : Ah ! suppôt de Satan ! exécrable damnée !
AGNES : Moi, j'ai blessé quelqu'un ? fis-je tout étonnée.
<<Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon ;
Et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon.>>
Hélas ! qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ?
Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose ?
<<Non, dit-elle ; vos yeux ont fait ce coup fatal,
Et c'est de leurs regards qu'est venu tout son mal.>>
Eh, mon Dieu ! ma surprise est, fis-je, sans seconde ;
Mes yeux ont-ils du mal, pour en donner au monde ?
<<Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas,
Ma fille, ont un venin que vous ne savez pas,
En un mot, il languit, le pauvre misérable ;
Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable,
Que votre cruauté lui refuse un secours,
C'est un homme à porter en terre dans deux jours.>>
Mon Dieu ! j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande.
Mais pour le secourir qu'est-ce qu'il me demande ?
<<Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir
Que le bien de vous voir et vous entretenir ;
Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine,
Et du mal qu'ils ont fait être la médecine.>>
Hélas ! volontiers, dis-je ; et, puisqu'il est ainsi,
Il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici.
ARNOLPHE, à part. : Ah ! sorcière maudite, empoisonneuse d'âmes,
Puisse l'enfer payer tes charitables trames !
AGNES : Voilà comme il me vit, et reçut guérison.
Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison ?
Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience
De le laisser mourir faute d'une assistance ?
Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir,
Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir.
ARNOLPHE, bas, à part. : Tout cela n'est parti que d'une âme innocente
Et j'en dois accuser mon absence imprudente,
Qui sans guide a laissé cette bonté de moeurs
Exposée aux aguets des rusés séducteurs.
Je crains que le pendard, dans ses voeux téméraires,
Un peu plus haut que jeu n'ait poussé les affaires.
AGNES : Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble, un petit.
Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit ?
ARNOLPHE : Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites,
Et comme le jeune homme a passé ses visites.
AGNES : Hélas ! si vous saviez comme il était ravi,
Comme il perdit son mal sitôt que je le vi,
Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette,
Et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette,
Vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous...
ARNOLPHE : Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ?
AGNES : Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde,
Et me disait des mots les plus gentils du monde,
Des choses que jamais rien ne peut égaler,
Et dont, toutes les fois que je l'entends parler,
La douceur me chatouille, et là dedans remue
Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue.
ARNOLPHE, bas, à part. : O fâcheux examen d'un mystère fatal,
Où l'examinateur souffre seul tout le mal !
(Haut.) Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses,
Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
AGNES : Oh ! tant ! il me prenait et les mains et les bras,
Et de me les baiser il n'était jamais las.
ARNOLPHE : Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?
(La voyant interdite.) Ouf !
AGNES : Eh ! il m'a...
ARNOLPHE : Quoi ?
AGNES : Pris...
ARNOLPHE : Euh ?
AGNES : Le...
ARNOLPHE : Plaît-il ?
AGNES : Je n'ose,
Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
ARNOLPHE : Non.
AGNES : Si fait.
ARNOLPHE : Mon Dieu ! non.
AGNES : Jurez donc votre foi.
ARNOLPHE : Ma foi, soit.
AGNES : Il m'a pris... Vous serez en colère.
ARNOLPHE : Non.
AGNES : Si.
ARNOLPHE : Non, non, non, non. Diantre ! que de mystère !
Qu'est-ce qu'il vous a pris ?
AGNES : Il...
ARNOLPHE, à part. : Je souffre en damné.
AGNES : Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné.
A vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
ARNOLPHE, reprenant haleine. : Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre
S'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.
AGNES : Comment ! est-ce qu'on fait d'autres choses ?
ARNOLPHE : Non pas.
Mais, pour guérir du mal qu'il dit qui le possède,
N'a-t-il point exigé de vous d'autre remède ?
AGNES : Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé,
Que pour le secourir j'aurais tout accordé.
ARNOLPHE, bas, à part. : Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte :
Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte.
Chut. (Haut.) De votre innocence, Agnès, c'est un effet ;
Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait.
Je sais qu'en vous flattant le galant ne désire
Que de vous abuser, et puis après s'en rire.
AGNES : Oh ! point ! Il me l'a dit plus de vingt fois à moi.
ARNOLPHE : Ah ! vous ne savez pas ce que c'est que sa foi.
Mais enfin apprenez qu'accepter des cassettes,
Et de ces beaux blondins écouter les sornettes,
Que se laisser par eux, à force de langueur,
Baiser ainsi les mains et chatouiller le coeur,
Est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse.
AGNES : Un péché, dites-vous ? Et la raison, de grâce ?
ARNOLPHE : La raison ? La raison est l'arrêt prononcé
Que par ces actions le ciel est courroucé.
AGNES : Courroucé ! Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce ?
C'est une chose, hélas ! si plaisante et si douce !
J'admire quelle joie on goûte à tout cela ;
Et je ne savais point encor ces choses-là.
ARNOLPHE : Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses,
Ces propos si gentils, et ces douces caresses ;
Mais il faut le goûter en toute honnêteté,
Et qu'en se mariant le calme en soit ôté.
AGNES : N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie ?
ARNOLPHE : Non.
AGNES : Mariez-moi donc promptement, je vous prie.
ARNOLPHE : Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi ;
Et pour vous marier on me revoit ici.
AGNES : Est-ll possible ?
ARNOLPHE : Oui.
AGNES : Que vous me ferez aise !
ARNOLPHE : Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise.
AGNES : Vous nous voulez, nous deux...
ARNOLPHE : Rien de plus assuré.
AGNES : Que. si cela se fait, je vous caresserai !
ARNOLPHE : Eh ! la chose sera de ma part réciproque.
AGNES : Je ne reconnais point, pour moi, quand on se moque.
Parlez-vous tout de bon ?
ARNOLPHE : Oui, vous le pourrez voir.
AGNES : Nous serons mariés ?
ARNOLPHE : Oui.
AGNES : Mais quand ?
ARNOLPHE : Dès ce soir.
AGNES, riant. : Dès ce soir ?
ARNOLPHE : Dès ce soir. Cela vous fait donc rire ?
AGNES : Oui.
ARNOLPHE : Vous voir bien contente est ce que je désire.
AGNES : Hélas ! que je vous ai grande obligation,
Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction !
ARNOLPHE : Avec qui ?
AGNES : Avec.... Là...
ARNOLPHE : Là... Là n'est pas mon compte,
A choisir un mari vous êtes un peu prompte.
C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout prêt,
Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît,
Dût le mettre au tombeau le mal dont il vous berce
Qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce ;
Que, venant au logis, pour votre compliment,
Vous lui fermiez au nez la porte honnêtement :
Et lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre,
L'obligiez tout de bon à ne plus y paraître.
M'entendez-vous, Agnès ? Moi, caché dans un coin,
De votre procédé je serai le témoin.
AGNES : Las ! il est si bien fait ! C'est...
ARNOLPHE : Ah ! que de langage !
AGNES : Je n'aurai pas le coeur...
ARNOLPHE : Point de bruit davantage. Montez là-haut.
AGNES : Mais quoi ! voulez-vous...
ARNOLPHE : C'est assez.
Je suis maître, je parle ; allez, obéissez."

1663 - La fameuse querelle de l'Ecole des femmes, qui occupa toute l'actualité littéraire de l'année 1663, avec ses libelles, ses textes satiriques et ses perfidies (on accusa notamment le dramaturge d'entretenir des relations incestueuses avec Armande Béjart, la fille de Madeleine, qu'il avait épousée en 1662, et qu'on présentait comme sa propre fille), témoigne de l'extrême violence des adversaires de Molière. Celui-ci répliqua en 1663 par deux pièces ayant valeur de manifestes, la "Critique de l'Ecole des femmes" et "l'Impromptu de Versailles", dans lesquelles il se mit en scène avec ses comédiens pour tourner en dérision ses détracteurs (petits marquis, fausses prudes et comédiens de l'Hôtel de Bourgogne). Les détracteurs ne cessèrent pas leurs attaques pour autant, mais Molière jouissait de la protection du roi et recevait régulièrement de lui des commandes pour les fêtes de la cour, en particulier les grandes fêtes dites des «Plaisirs de l'Ile enchantée», pour lesquelles Molière écrivit une comédie galante, la Princesse d'Elide, dont Jean-Baptiste Lully signa la musique...

Edme Boursault (1638-1701), secrétaire de la duchesse d'Angoulême, auteur de comédies (le Mercure galant, 1683), est surtout célèbre par sa critique de l'École des femmes de Molière : en quête de célébrité, il fait représenter à l'Hôtel de Bourgogne, en 1663, "Le Portrait du peintre ou la Contre-critique de L'École des femmes", une comédie satirique dirigée contre Molière, ce qui lui vaut une réponse cinglante dans L'Impromptu de Versailles. Il recommence pourtant trois ans plus tard avec la "Satire des satires", dirigée contre Boileau, mais interdite à la représentation, puis s'attaquera à Racine, avant de se réconcilier avec Boileau ainsi qu'avec Molière en 1678. Son œuvre, qui présente une grande variété, constitue un bon témoignage sur les mœurs du temps. Bien que plusieurs comédies pourtant médiocres (Le Mercure galant, 1679, Les Mots à la mode, 1694) attirent d'abord l'attention sur lui, c'est surtout par ses lettres (Lettres à Babet, 1669), écrites de manière alerte, qu'il suscite autant de considération...
1663 - "Critique de L'École des femmes"
Molière répliqua l'année suivante, en juin 1663, par cette comédie où Dorante et Uranie sont opposés au pédant Lysidas, indigné de l'insuccès des pièces sérieuses alors que les "bagatelles" et les sottises de Molière font courir tout Paris (Acte I, scène 6). Molière sait fort bien que les règles du théâtre en particulier (règle des trois unités) ne sont pas des dogmes et qiuAristote ne les a pas promulguées comme des dogmes. Mais pour lui, s'il est une toute première règle c'est de satisfaire le public..
DORANTE
Vous croyez donc, Monsieur Lysidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux, et que les pièces comiques sont des niaiseries qui ne méritent aucune louange?
URANIE
Ce n'est pas mon sentiment, pour moi. La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée; mais la comédie a ses charmes, et je tiens que l'une n'est pas moins difficile à faire que l'autre.
DORANTE
Assurément, Madame; et quand, pour la difficulté, vous mettriez un plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentiments, de braver en vers la Fortune, accuser les Destins, et dire des injures aux Dieux, que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir, où l'on ne cherche point de ressemblance; et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor, et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent ; et vous n'avez rien fait, si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n'être point blâmé, de dire des choses qui soient de bon sens et bien écrites; mais ce n'est pas
assez dans les autres, il y faut plaisanter; et c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ...
URANIE
Mais, de grâce, Monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts, dont Je ne me suis point aperçue.
LYSIDAS
Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d'abord, Madame, que cette comédie pèche contre toutes les règles de l'art.
URANIE
Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là, et que je ne sais point les règles de l'art.
DORANTE
Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles, dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde; et cependant ce ne sont que quelques observations aisées, que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes; et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d'Horace et d'Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses, et que chacun ne soit pas juge du plaisir qu'il y prend ?
URANIE
J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là : c'est que ceux qui parlent le plus des règles, et qui les savent mieux que les autres, font des comédies que personne ne trouve belles.
DORANTE
Et c'est ce qui marque, Madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassantes. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public, et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnements pour nous empêcher d'avoir du plaisir.
URANIE
Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent; et, lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort, et si les règles d'Aristote me défendaient de rire.
DORANTE
C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente, et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du Cuisinier français.
URANIE
Il est vrai; et j'admire les raffinements de certaines gens sur des choses que nous devons sentir nous-mêmes. »

1663 - "L'Impromptu de Versailles"
En octobre 1663, "L'Impromptu de Versailles" présente encore une fois sa défense tout en se moquant de ses adversaires. MOLIÈRE y est en marquis ridicule, BRÉCOURT, en homme de qualité, DE LA GRANGE, en marquis ridicule, DU CROISY, en poète, LA THORILLIÈRE, en marquis fâcheux, BÉJART, en homme qui fait le nécessaire, MADEMOISELLE DU PARC, en marquise façonnière, MADEMOISELLE BÉJART, en prude, MADEMOISELLE DE BRIE, en sage coquette, MADEMOISELLE MOLIÈRE, en satirique spirituelle, MADEMOISELLE DU CROISY, en peste doucereuse, MEDEMOISELLE HERVÉ, en servante précieuse. La scène est à Versailles dans la salle de la Comédie... "..Pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Est-il auteur qui ne doive trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve?.."
La riposte est animée, Donneau de Visé, Montfleury, et Robinet, mais Molière a définitivement conquis le roi. Et pour répondre à ses désirs, il écrit rapidement "Le Mariage forcé", qui sera joué au Louvre en janvier 1664. Il s'agit d'une comédie-ballet où, pour la première fois, les intermèdes de danse sont rattachés à l'intrigue. Molière devient le fournisseur des divertissements royaux...

1664 - "Tartuffe"
En 1664, aux grandes fêtes des Plaisirs de l'Ile Enchantée, à Versailles, Molière présente "La Princesse d'Elide", une comédie romanesque et précieuse, reprend "Les Fâcheux" et "Le Mariage Forcé", et , le 12 mai, se risque à la représentation de "Tartuffe", dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux dévots - s'attaquant notamment aux excès de la Compagnie du Saint-Sacrement -. C'est le scandale, la pièce est interdite par le roi sous la pression des dévots qui se sentent visés. Molière tente de s'assurer de l'appui de Madame, de Condé, du Cardinal Chigi, légat du Pape, mais la fameuse "cabale des dévots" est la plus forte : il ne peut jouer sa pièce qu'en privé, chez Monsieur et chez la Princesse Palatine.
Acte I - On parle beaucoup de Tartuffe dans les deux premiers actes de la pièce. Madame Pernelle, rangée du côté de son fils Orgon, s'emporte contre son entourage mal disposé envers Tartuffe, personnage pieux et respectable selon elle, un faux dévot selon les autres. Orgon et Madame Pernelle ont loué sa sainteté. Dorine, Cléante, Damis ont déploré son influence néfaste et l'importance qu'il a prise dans la maison. Madame Pernelle reproche à sa bru, Elmire, d'être trop excentrique et dépensière et au frère de celle-ci, Cléante, d'être trop moralisateur. Elle traite Damis, son petit-fils, de fou et elle s'indigne de l'impertinence de Dorine. Elle loue donc le ciel de leur avoir permis de recueillir chez eux Tartuffe, cet ''homme de bien'', car '' c'est contre le péché que son coeur se courrouce, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse''.
DAMIS
Votre Monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute.
MADAME PERNELLE
C'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute ;
Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux
De le voir querellé par un fou comme vous.
DAMIS
Quoi ? je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique
Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique,
Et que nous ne puissions à rien nous divertir,
Si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir ?
DORINE
S'il le faut écouter et croire à ses maximes,
On ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes ;
Car il contrôle tout, ce critique zélé.
MADAME PERNELLE
Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé.
C'est au chemin du Ciel qu'il prétend vous conduire,
Et mon fils à l'aimer vous devrait tous induire.
DAMIS
Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien
Qui me puisse obliger à lui vouloir du bien :
Je trahirais mon coeur de parler d'autre sorte ;
Sur ses façons de faire à tous coups je m'emporte ;
J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat
Il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat.
DORINE
Certes c'est une chose aussi qui scandalise,
De voir qu'un inconnu céans s'impatronise,
Qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers
Et dont l'habit entier valait bien six deniers,
En vienne jusque-là que de se méconnaître,
De contrarier tout, et de faire le maître.
MADAME PERNELLE
Hé ! merci de ma vie ! il en irait bien mieux,
Si tout se gouvernait par ses ordres pieux.
DORINE
Il passe pour un saint dans votre fantaisie :
Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie.
MADAME PERNELLE
Voyez la langue !
DORINE
À lui, non plus qu'à son Laurent,
Je ne me fierais, moi, que sur un bon garant.
MADAME PERNELLE
J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être ;
Mais pour homme de bien, je garantis le maître.
Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez
Qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités.
C'est contre le péché que son coeur se courrouce,
Et l'intérêt du Ciel est tout ce qui le pousse...."
Acte II - Orgon fait part à Marianne, sa fille, de son projet de la marier à Tartuffe. Incrédule, celle-ci ne trouve rien à dire. Dorine, quant à elle, intervient et confronte Orgon avec l'idée de cette alliance insensée. Ne pouvant la faire taire, Orgon se met en colère. Dorine réprimandera sa jeune maîtresse qui a manqué de fermeté face à son père. S'il est vrai qu'elle aime Valère, il faut qu'elle s'affirme et qu'elle tienne tête à son père. Profondément découragée, Marianne laisse entendre qu'elle préfère mourir que souscrire à un tel mariage. Dans la dernière scène de l'acte, Valère, dépité, confronte Marianne avec la rumeur du mariage de celle-ci avec Tartuffe. Marianne trouve son approche un peu légère et elle se vexe. Pour punir Valère, elle prend, elle aussi, une attitude de légèreté. Il s'ensuit un dialogue teinté de reproches réciproques qui débouchera sur une impasse. C'est Dorine qui interviendra pour les réconcilier et leur faire comprendre l'absurdité de leur querelle. Elle leur proposera de gagner du temps pour déjouer le projet d'Orgon et de faire intervenir Elmire pour arriver à leurs fins.
"Ah! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme!" - Tartuffe apparaît enfin en personne à la scène 2 de l'Acte III, avec toute son "affectation" et ses démonstrations de vertu et de piété; mais, presque sans transition, il se conduit de façon étrange au cours de son entrevue avec Elmire. Dès l'acte III, scène 3 est mise en évidence la duplicité du personnage, qui n'est pas seulement un faux dévot, dont les déclarations religieuses et les protestations vertueuses sont purement intéressées et factices, mais encore un homme profondément immoral et cynique. Cette hypocrisie est mise en valeur par la finesse et l'intégrité discrète et pourtant ferme d'Elmire : obligée d'écouter Tartuffe, car elle songe à l'amour de Mariane, sa fille, pour Valère, elle réussit, sans vaine brusquerie, à garder ses distances et se tire avec adresse d'un pas fort délicat. Damis s'est caché dans un placard et écoute la conversation entre Tartuffe et Elmire. Alors que celle-ci tente d'entretenir Tartuffe sur la question du mariage controversé, Tartuffe profite qu'ils sont seul à seul pour lui faire une cour très entreprenante et très compromettante. Profondément choqué, Damis surgit de sa cachette et s'engage à dénoncer la perfidie de Tartuffe auprès de son père. Orgon ne peut se résoudre à croire à la fausseté de Tartuffe et préfère croire à de la méchanceté de la part de son fils qu'il finit par renier...
Acte III, scène 2, Tartuffe paraît enfin, "Couvrez ce sein que je ne saurais voir..."
TARTUFFE, apercevant Dorine.
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline,
Et priez que toujours le Ciel vous illumine.
Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers
Des aumônes que j'ai partager les deniers.
DORINE
Que d'affectation et de forfanterie!
TARTUFFE
Que voulez-vous?
DORINE
Vous dire.
TARTUFFE. Il tire un mouchoir de sa poche.
Ah! mon Dieu, je vous prie,
Avant que de parler prenez-moi ce mouchoir.
DORINE
Comment?
TARTUFFE
Couvrez ce sein que je ne saurais voir:
Par de pareils objets les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées.
DORINE
Vous êtes donc bien tendre à la tentation,
Et la chair sur vos sens fait grande impression!
Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte:
Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte,
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas,
Que toute votre peau ne me tenterait pas.
TARTUFFE
Mettez dans vos discours un peu de modestie,
Ou je vais sur-le-champ vous quitter la partie.
DORINE
Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos,
Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots.
Madame va venir dans cette salle basse,
Et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.
TARTUFFE
Hélas! très volontiers.
DORINE, en soi-même.
Comme il se radoucit!
Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.
TARTUFFE
Viendra-t-elle bientôt?
DORINE
Je l'entends, ce me semble.
Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble.
Acte III, scène 3 - "Ouf! vous me serrez trop. - C'est par excès de zèle..."
TARTUFFE
Que le Ciel à jamais par sa toute bonté
Et de l'âme et du corps vous donne la santé,
Et bénisse vos jours autant que le désire
Le plus humble de ceux que son amour inspire!
ELMIRE
Je suis fort obligée à ce souhait pieux.
Mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux.
TARTUFFE
Comment de votre mal vous sentez-vous remise?
ELMIRE
Fort bien; et cette fièvre a bientôt quitté prise.
TARTUFFE
Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut
Pour avoir attiré cette grâce d'en haut;
Mais je n'ai fait au Ciel nulle dévote instance
Qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
ELMIRE
Votre zèle pour moi s'est trop inquiété.
TARTUFFE
On ne peut trop chérir votre chère santé,
Et pour la rétablir j'aurais donné la mienne.
ELMIRE
C'est pousser bien avant la charité chrétienne,
Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés.
TARTUFFE
Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez.
ELMIRE
J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire,
Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
TARTUFFE
J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux,
Madame, de me voir seul à seul avec vous:
C'est une occasion qu'au Ciel j'ai demandée,
Sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée.
ELMIRE
Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien,
Où tout votre coeur s'ouvre, et ne me cache rien.
TARTUFFE
Et je ne veux aussi pour grâce singulière
Que montrer à vos yeux mon âme tout entière,
Et vous faire serment que les bruits que je fais
Des visites qu'ici reçoivent vos attraits
Ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine,
Mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne,
Et d'un pur mouvement.
ELMIRE
Je le prends bien aussi,
Et crois que mon salut vous donne ce souci.
TARTUFFE. Il lui serre le bout des doigts.
Oui, Madame, sans doute, et ma ferveur est telle.
ELMIRE
Ouf! vous me serrez trop.
TARTUFFE
C'est par excès de zèle.
De vous faire aucun mal je n'eus jamais dessein,
Et j'aurais bien plutôt.
Il lui met la main sur le genou.
ELMIRE
Que fait là votre main?
TARTUFFE
Je tâte votre habit: l'étoffe en est molleuse.
ELMIRE
Ah! de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.
Elle recule sa chaise, et Tartuffe rapproche la sienne.
TARTUFFE
Mon Dieu! que de ce point l'ouvrage est merveilleux!
On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux;
Jamais, en toute chose, on n'a vu si bien faire.
ELMIRE
Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire.
On tient que mon mari veut dégager sa foi,
Et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi?
TARTUFFE
Il m'en a dit deux mots; mais, Madame, à vrai dire,
Ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire;
Et je vois autre part les merveilleux attraits
De la félicité qui fait tous mes souhaits.
ELMIRE
C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre.
TARTUFFE
Mon sein n'enferme pas un coeur qui soit de pierre.
ELMIRE
Pour moi, je crois qu'au Ciel tendent tous vos soupirs,
Et que rien ici-bas n'arrête vos désirs.
TARTUFFE
L'amour qui nous attache aux beautés éternelles
N'étouffe pas en nous l'amour des temporelles;
Nos sens facilement peuvent être charmés
Des ouvrages parfaits que le Ciel a formés.
Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles;
Mais il étale en vous ses plus rares merveilles:
Il a sur votre face épanché des beautés
Dont les yeux sont surpris, et les cours transportés,
Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature,
Sans admirer en vous l'auteur de la nature,
Et d'une ardente amour sentir mon coeur atteint,
Au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint.
D'abord j'appréhendai que cette ardeur secrète
Ne fût du noir esprit une surprise adroite;
Et même à fuir vos yeux mon coeur se résolut,
Vous croyant un obstacle à faire mon salut.
Mais enfin je connus, Ô beauté toute aimable,
Que cette passion peut n'être point coupable,
Que je puis l'ajuster avecque la pudeur,
Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon coeur.
Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande
Que d'oser de ce coeur vous adresser l'offrande;
Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté,
Et rien des vains efforts de mon infirmité;
En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude,
De vous dépend ma peine ou ma béatitude,
Et je vais être enfin, par votre seul arrêt,
Heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît.
ELMIRE
La déclaration est tout à fait galante,
Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante.
Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein,
Et raisonner un peu sur un pareil dessein.
Un dévot comme vous, et que partout on nomme.
TARTUFFE
Ah! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme;
Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas,
Un coeur se laisse prendre, et ne raisonne pas.
Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange;
Mais, Madame, après tout, je ne suis pas un ange;
Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais,
Vous devez vous en prendre à vos charmants attraits.
Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine,
De mon intérieur vous fûtes souveraine;
De vos regards divins l'ineffable douceur
Força la résistance où s'obstinait mon coeur;
Elle surmonta tout, jeûnes, prières, larmes,
Et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes.
Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois,
Et pour mieux m'expliquer j'emploie ici la voix.
Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne
Les tribulations de votre esclave indigne,
S'il faut que vos bontés veuillent me consoler
Et jusqu'à mon néant daignent se ravaler,
J'aurai toujours pour vous, Ô suave merveille,
Une dévotion à nulle autre pareille.
Votre honneur avec moi ne court point de hasard,
Et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part.
Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles,
Sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles,
De leurs progrès sans cesse on les voit se targuer;
Ils n'ont point de faveurs qu'ils n'aillent divulguer,
Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie,
Déshonore l'autel où leur coeur sacrifie.
Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret,
Avec qui pour toujours on est sûr du secret:
Le soin que nous prenons de notre renommée
Répond de toute chose à la personne aimée,
Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cour,
De l'amour sans scandale et du plaisir sans peur.
ELMIRE
Je vous écoute dire, et votre rhétorique
En termes assez forts à mon âme s'explique.
N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur
À dire à mon mari cette galante ardeur,
Et que le prompt avis d'un amour de la sorte
Ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte?
TARTUFFE
Je sais que vous avez trop de bénignité,
Et que vous ferez grâce à ma témérité,
Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse
Des violents transports d'un amour qui vous blesse,
Et considérerez, en regardant votre air,
Que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair.
ELMIRE
D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être;
Mais ma discrétion se veut faire paraître.
Je ne redirai point l'affaire à mon époux;
Mais je veux en revanche une chose de vous:
C'est de presser tout franc et sans nulle chicane
L'union de Valère avecque Mariane,
De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir
Qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir...
"Et ce n'est pas pécher que pécher en silence.." - Acte IV - Cléante confronte Tartuffe avec le fait que Damis ait été renvoyé de chez lui et que Tartuffe ait accepté un héritage qui ne lui revient pas de juste droit. Tartuffe ne veut pas que Damis revienne et considère qu'il fera bon usage des biens qu'il recevra car ils serviront '' pour la gloire du Ciel et le bien du prochain''. Marianne livre son désespoir à son père de se voir promise à Tartuffe. Face à l'incrédulité et à l'aveuglement d'Orgon, Elmire propose à ce dernier de se cacher afin qu'il assiste à une scène qu'elle va provoquer et qui n'aura d'autre but que de révéler les intentions malhonnêtes de Tartuffe. Orgon résiste à l'idée, puis il finit par accepter. Elmire dit à son mari, caché sous la table, d'intervenir quand bon lui semblera. La scène, qui durera trop longtemps pour la pauvre Elmire au supplice de subir les avances de Tartuffe, se révélera très probante pour Orgon. Dégoûté et révolté par la scène à laquelle il vient d'assister, il renvoie Tartuffe sur le champ. Celui-ci rappelle à Orgon que c'est lui, à présent, Tartuffe qui est le maître de la maison. A Elmire, incrédule, Orgon est obligé d'avouer que la donation est déjà '' chose faite''....
Scène V, TARTUFFE, ELMIRE, ORGON.
TARTUFFE
On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler.
ELMIRE
Oui. L'on a des secrets à vous y révéler.
Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise,
Et regardez partout de crainte de surprise.
Une affaire pareille à celle de tantôt
N'est pas assurément ici ce qu'il nous faut.
Jamais il ne s'est vu de surprise de même;
Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême,
Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts
Pour rompre son dessein et calmer ses transports.
De mon trouble, il est vrai, j'étais si possédée,
Que de le démentir je n'ai point eu l'idée ;
Mais par là, grâce au Ciel, tout a bien mieux été,
Et les choses en sont en plus de sûreté.
L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage,
Et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage.
Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements,
Il veut que nous soyons ensemble à tous moments ;
Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée,
Me trouver ici seule avec vous enfermée,
Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un coeur
Un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur.
TARTUFFE
Ce langage à comprendre est assez difficile,
Madame, et vous parliez tantôt d'un autre style.
ELMIRE
Ah ! si d'un tel refus vous êtes en courroux,
Que le coeur d'une femme est mal connu de vous !
Et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre
Lorsque si faiblement on le voit se défendre !
Toujours notre pudeur combat dans ces moments
Ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments.
Quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte,
On trouve à l'avouer toujours un peu de honte ;
On s'en défend d'abord ; mais de l'air qu'on s'y prend,
On fait connaître assez que notre coeur se rend,
Qu'à nos voeux par honneur notre bouche s'oppose,
Et que de tels refus promettent toute chose.
C'est vous faire sans doute un assez libre aveu,
Et sur notre pudeur me ménager bien peu ;
Mais puisque la parole enfin en est lâchée,
À retenir Damis me serais-je attachée,
Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur
Écouté tout au long l'offre de votre coeur,
Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire,
Si l'offre de ce coeur n'eût eu de quoi me plaire ?
Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer
À refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer,
Qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre,
Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre,
Et l'ennui qu'on aurait que ce noeud qu'on résout
Vînt partager du moins un coeur que l'on veut tout ?
TARTUFFE
C'est sans doute, Madame, une douceur extrême
Que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime.
Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits
Une suavité qu'on ne goûta jamais.
Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude,
Et mon coeur de vos voeux fait sa béatitude ;
Mais ce coeur vous demande ici la liberté
D'oser douter un peu de sa félicité.
Je puis croire ces mots un artifice honnête
Pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête ;
Et s'il faut librement m'expliquer avec vous,
Je ne me fierai point à des propos si doux,
Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire,
Ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire,
Et planter dans mon âme une constante foi
Des charmantes bontés que vous avez pour moi.
ELMIRE. Elle tousse pour avertir son mari.
Quoi ? vous voulez aller avec cette vitesse,
Et d'un coeur tout d'abord épuiser la tendresse ?
On se tue à vous faire un aveu des plus doux ;
Cependant ce n'est pas encore assez pour vous,
Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire,
Qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire ?
TARTUFFE
Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer.
Nos voeux sur des discours ont peine à s'assurer.
On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire,
Et l'on veut en jouir avant que de le croire.
Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés,
Je doute du bonheur de mes témérités ;
Et je ne croirai rien, que vous n'ayez, Madame,
Par des réalités su convaincre ma flamme.
ELMIRE
Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit,
Et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit !
Que sur les cours il prend un furieux empire,
Et qu'avec violence il veut ce qu'il désire !
Quoi ? de votre poursuite on ne peut se parer,
Et vous ne donnez pas le temps de respirer ?
Sied-il bien de tenir une rigueur si grande,
De vouloir sans quartier les choses qu'on demande,
Et d'abuser ainsi par vos efforts pressants
Du faible que pour vous vous voyez qu'ont les gens ?
TARTUFFE
Mais si d'un oeil bénin vous voyez mes hommages,
Pourquoi m'en refuser d'assurés témoignages ?
ELMIRE
Mais comment consentir à ce que vous voulez,
Sans offenser le Ciel, dont toujours vous parlez ?
TARTUFFE
Si ce n'est que le Ciel qu'à mes voeux on oppose,
Lever un tel obstacle est à moi peu de chose,
Et cela ne doit pas retenir votre coeur.
ELMIRE
Mais des arrêts du Ciel on nous fait tant de peur !
TARTUFFE
Je puis vous dissiper ces craintes ridicules,
Madame, et je sais l'art de lever les scrupules.
Le Ciel défend, de vrai, certains contentements,
(C'est un scélérat qui parle.)
Mais on trouve avec lui des accommodements.
Selon divers besoins, il est une science
D'étendre les liens de notre conscience,
Et de rectifier le mal de l'action
Avec la pureté de notre intention.
De ces secrets, Madame, on saura vous instruire ;
Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire.
Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi.
Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi.
Vous toussez fort, Madame.
ELMIRE
Oui, je suis au supplice.
TARTUFFE
Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ?
ELMIRE
C'est un rhume obstiné, sans doute ; et je vois bien
Que tous les jus du monde ici ne feront rien.
TARTUFFE
Cela certes est fâcheux.
ELMIRE
Oui, plus qu'on ne peut dire.
TARTUFFE
Enfin votre scrupule est facile à détruire :
Vous êtes assurée ici d'un plein secret,
Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait ;
Le scandale du monde est ce qui fait l'offense,
Et ce n'est pas pécher que pécher en silence.
ELMIRE, après avoir encore toussé.
Enfin je vois qu'il faut se résoudre à céder,
Qu'il faut que je consente à vous tout accorder,
Et qu'à moins de cela je ne dois point prétendre
Qu'on puisse être content, et qu'on veuille se rendre.
Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là,
Et c'est bien malgré moi que je franchis cela ;
Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire,
Puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire,
Et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants,
Il faut bien s'y résoudre, et contenter les gens.
Si ce consentement porte en soi quelque offense,
Tant pis pour qui me force à cette violence ;
La faute assurément n'en doit pas être à moi.
TARTUFFE
Oui, Madame, on s'en charge ; et la chose de soi.
ELMIRE
Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie,
Si mon mari n'est point dans cette galerie.
TARTUFFE
Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez ?
C'est un homme, entre nous, à mener par le nez ;
De tous nos entretiens il est pour faire gloire,
Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire.
ELMIRE
Il n'importe : sortez, je vous prie, un moment,
Et partout là dehors voyez exactement...."
Acte V - L'imposture de Tartuffe est démasquée aux yeux de tous. Orgon, profondément marqué par les événements, jure qu'il ne fera plus jamais confiance aux gens de bien. A quoi, Cléante lui répond que cette mauvaise expérience ne doit pas corrompre son jugement et qu'il ne faut pas confondre'' les coeurs de tous les gens de bien'' et qu'il faut savoir démêler ''la vertu d'avec les apparences''. Madame Pernelle ne veut pas croire aux accusations qui pèsent sur Tartuffe jusqu'à l'apparition de Monsieur Loyal, chargé d'une ordonnance visant à faire évacuer les lieux par Orgon et sa famille. Surviennent ensuite Tartuffe et un exempt ( officier de police). L'affaire étant parvenue aux oreilles du roi, celui-ci, dans sa grande sagesse et se souvenant des services loyaux rendus par Orgon pendant la Fronde, a décidé de renverser l'accusation et de faire emprisonner Tartuffe tout en restituant les biens à Orgon et à sa famille...

1665 - "Dom Juan"
En février 1665, après l'interdiction de Tartuffe, Molière se hâte d'écrire une nouvelle comédie sur un sujet plus traditionnel, Dom Juan. Mais il persiste dans la veine de Tartuffe et fait de Dom Juan, un grand seigneur débauché, un impie, un hypocrite de dévotion châtié par la vengeance divine. En quelques semaines la cabale des dévots se déchaîne à nouveau et fait supprimer la pièce : elle ne sera imprimée qu'après la mort de l'auteur.
Louis XIV lui manifeste pourtant sa protection. De 1664 à 1671 le roi commanda en tout à Molière quinze pièces de théâtre, et la troupe ne cessa de faire des séjours à la cour, y donnant près de deux cents représentations (les Amants magnifiques, 1670; le Bourgeois gentilhomme, 1670; Psyché, 1671; la Comtesse d'Escarbagnas, 1671). Dans l'été de 1665, Molière devient chef de la Troupe du Roi et joue "L'Amour Médecin", une comédie-ballet satire des médecins de la cour. L'année 1665 reste une année sombre pour Molière, deux de ses pièces ont été interdites coup sur coup, il commence à cracher le sang et doit s'interrompre plusieurs mois. Et se brouille avec Racine, qui lui avait confié "La Thébaîde" mais qui lui préfère maintenant l'Hôtel de Bourgogne.
"Un grand seigneur méchant homme est une terrible chose." (Acte I) Dom Juan , libertin et débauché, abandonne sa femme Elvire et a décidé d'enlever une jeune fiancée. Il traite avec désinvolture et sadisme Done Elvire, qui le menace de la vengeance céleste. (Acte II). Un paysan, Pierrot, raconte à sa promise comment il a sauvé des eaux un gentilhomme et son valet. Dom Juan aperçoit Charlotte, et lui fait aussitôt la cour, en présence de Sganarelle. Pierrot est mal reçu de Charlotte, et malmené par le héros qu'il a sauvé. Mathurine paraît, et le grand seigneur fait simultanément la cour aux deux paysannes. Douze hommes recherchent Dom Juan, qui s'enfuit en échangeant ses vêtements avec Sganarelle. (Acte III). Sganarelle et Dom Juan discutent de leurs croyances, le valet reproche son impiété à son maître. Ils rencontrent un pauvre que le libertin entreprend en vain de faire blasphémer.
Acte III, scène 2 - Egaré dans une forêt avec son valet Sganarelle, Dom Juan demande son chemin à un pauvre, mais lui prend l'envie soudaine de provoquer ce dernier qui vit loin du monde pour prier Dieu, pour un louis, pourrait-il commettre un péché mortel?
DOM JUAN
Ce que je crois ?
SGANARELLE
Oui.
DOM JUAN
Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.
SGANARELLE
La belle croyance [et les beaux articles de foi] que voilà ! Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique ? Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que pour avoir bien étudié on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, Monsieur, je n'ai point étudié comme vous. Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris ; mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon, qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres−là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là−haut, et si tout cela s'est bâti de lui−même. Vous voilà vous, par exemple, vous êtes là : est−ce que vous vous êtes fait tout seul, et n'a−t−il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? Pouvez−vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre : ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ces... ce poumon, ce coeur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là, et qui... Oh ! dame, interrompez−moi donc si vous voulez : je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt ; vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice.
DOM JUAN
J'attends que ton raisonnement soit fini.
SGANARELLE
Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauroient expliquer. Cela n'est−il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'aie quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut ? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droit, à gauche, en avant, en arrière, tourner...
(Il se laisse tomber en tournant.)
DOM JUAN
Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé.
SGANARELLE
Morbleu ! je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez : il m'importe bien que vous soyez damné !
DOM JUAN
Mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là−bas, pour lui demander le chemin.
SGANARELLE
Holà, ho, l'homme ! ho, mon compère ! ho, l'ami ! un petit mot s'il vous plaît.
SGANARELLE
Enseignez−nous un peu le chemin qui mène à la ville.
LE PAUVRE
Vous n'avez qu'à suivre cette route, Messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelque temps il y a des voleurs ici autour.
DOM JUAN
Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon coeur.
LE PAUVRE
Si vous vouliez, Monsieur, me secourir de quelque aumône ?
DOM JUAN
Ah ! ah ! ton avis est intéressé, à ce que je vois.
LE PAUVRE
Je suis un pauvre homme, Monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans, et je ne manquerai pas de prier le Ciel qu'il vous donne toute sorte de biens.
DOM JUAN
Eh ! prie−le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres.
SGANARELLE
Vous ne connaissez pas Monsieur, bonhomme ; il ne croit qu'en deux et deux sont quatre et en quatre et quatre sont huit.
DOM JUAN
Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?
LE PAUVRE
De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose.
DOM JUAN
Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ?
LE PAUVRE
Hélas ! Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde.
DOM JUAN
Tu te moques : un homme qui prie le Ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires.
LE PAUVRE
Je vous assure, Monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents.
DOM JUAN
Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ! ah ! je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer.
LE PAUVRE
Ah ! Monsieur, voudriez−vous que je commisse un tel péché ?
DOM JUAN
Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne, si tu jures ; tiens, il faut jurer.
LE PAUVRE
Monsieur !
DOM JUAN
A moins de cela, tu ne l'auras pas.
SGANARELLE
Va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal.
DOM JUAN
Prends, le voilà ; prends, te dis−je, mais jure donc.
LE PAUVRE
Non, Monsieur, j'aime mieux mourir de faim.
DOM JUAN
Va, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois−je là ? un homme attaqué par trois autres ? La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette lâcheté.
(Il court au lieu du combat.)
SGANARELLE
Mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas ; mais, ma foi ! le secours a servi, et les deux ont fait fuir les trois.
Dom Juan secourt un inconnu attaqué par des voleurs. C'est l'un des frères d'Elvire qui n'a jamais vu Dom Juan. Son frère, Dom Alsonse, paraît, reconnaît Dom Juan et veut le tuer, mais Dom Carlos s'y oppose au nom de l'honneur. Dom Juan aperçoit le tombeau d'un commandeur qu'il a tué autrefois ; il invite par bravade la statue à diner, qui accepte d'un mouvement de la tête...
Acte IV, scène 5
....
DOM JUAN
Peste soit l'insolent ! Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais−tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie ?
SGANARELLE
Moi ? Non.
DOM JUAN
C'est un frère d'Elvire.
SGANARELLE
Un...
DOM JUAN
Il est assez honnête homme, il en a bien usé, et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui.
SGANARELLE
Il vous seroit aisé de pacifier toutes choses.
DOM JUAN
Oui ; mais ma passion est usée pour Done Elvire, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurois me résoudre à renfermer mon coeur entre quatre murailles. Je te l'ai dit vingt fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon coeur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres ?
SGANARELLE
Vous ne le savez pas ?
DOM JUAN
Non, vraiment.
SGANARELLE
Bon ! c'est le tombeau que le Commandeur faisoit faire lorsque vous le tuâtes.
DOM JUAN
Ah ! tu as raison. Je ne savois pas que c'étoit de ce côté−ci qu'il étoit. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du Commandeur, et j'ai envie de l'aller voir.
SGANARELLE
Monsieur, n'allez point là.
DOM JUAN
Pourquoi ?
SGANARELLE
Cela n'est pas civil, d'aller voir un homme que vous avez tué.
DOM JUAN
Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonne grâce, s'il est galant homme. Allons, entrons dedans.
(Le tombeau s'ouvre, où l'on voit un superbe mausolée et la statue du Commandeur.)
SGANARELLE
Ah ! que cela est beau ! Les belles statues ! le beau marbre ! les beaux piliers ! Ah ! que cela est beau ! Qu'en dites−vous, Monsieur ?
DOM JUAN
Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort ; et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé, durant sa vie, d'une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire.
SGANARELLE
Voici la statue du Commandeur.
DOM JUAN
Parbleu ! le voilà bon, avec son habit d'empereur romain !
SGANARELLE
Ma foi, Monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie, et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feroient peur, si j'étois tout seul, et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir.
DOM JUAN
Il auroit tort, et ce seroit mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande−lui s'il veut venir souper avec moi.
SGANARELLE
C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois.
DOM JUAN
Demande−lui, te dis−je.
SGANARELLE
Vous moquez−vous ? Ce seroit être fou que d'aller parler à une statue.
DOM JUAN
Fais ce que je te dis.
SGANARELLE
Quelle bizarrerie ! Seigneur Commandeur... je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me la fait faire. Seigneur Commandeur, mon maître Dom Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. (La Statue baisse la tête.) Ha !
DOM JUAN
Qu'est−ce ? qu'as−tu ? Dis donc, veux−tu parler ?
Sganarelle fait le même signe que lui a fait la Statue et baisse la tête.
SGANARELLE
La Statue...
DOM JUAN
Eh bien ! que veux−tu dire, traître ?
SGANARELLE
Je vous dis que la Statue...
DOM JUAN
Eh bien ! La Statue ? je t'assomme, si tu ne parles.
SGANARELLE
La Statue m'a fait signe.
DOM JUAN
La peste le coquin !
SGANARELLE
Elle m'a fait signe, vous dis−je : il n'est rien de plus vrai. Allez−vous−en lui parler vous−même pour voir. Peut−être...
DOM JUAN
Viens, maraud, viens, je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le Seigneur Commandeur voudroit−il venir souper avec moi ?
(La Statue baisse encore la tête.)
SGANARELLE
Je ne voudrois pas en tenir dix pistoles. Eh bien ! Monsieur ?
DOM JUAN
Allons, sortons d'ici.
SGANARELLE
Voilà de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire.
(Acte IV) Dom Juan refuse de croire au prodige et interdit à Sganarelle d'en reparler. Un laquais annonce la visite d'un créancier, Mr Dimanche, dont Dom Juan se joue habilement. Puis de son père, le vieux Dom Louis, et ses propos moralisateurs. Done Elvire, métamorphosée, implore Dom Juan de sauver son âme. En vain. Dom Juan accepte par défi de dîner à la table de la statue du commandeur..
Acte IV, Scène 4, la Satire VIII de Juvénal qui inspira la satire V de Boileau qui traite de la véritable "noblesse de coeur" se retrouve ici exprimée, en vain, par Dom Louis, mais qu'importe à Dom Juan...
LA VIOLETTE : Monsieur, voilà Monsieur votre père.
DOM JUAN : Ah ! me voici bien : il me fallait cette visite pour me faire enrager.
DOM LOUIS : Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. à dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre ; et si vous êtes las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Hélas ! que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au Ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées ! J'ai souhaité un fils avec des ardeurs nonpareilles ; je l'ai demandé sans relâche avec des transports incroyables ; et ce fils, que j'obtiens en fatiguant le Ciel de voeux, est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel oeil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes, dont on a peine, aux yeux du monde, d'adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes affaires, qui nous réduisent, à toutes heures, à lasser les bontés du Souverain, et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis ? Ah ! quelle bassesse est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ? êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité ? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu'il suffise d'en porter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sorti d'un sang noble lorsque nous vivons en infâmes ? Non, non, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler ; et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous, nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leurs vertus, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né : ils vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage ; au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferais plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme, que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous.
DOM JUAN : Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler.
DOM LOUIS : Non, insolent, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurai, plus tôt que tu ne penses, mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du Ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître.
Il sort.
Acte V : Dom Juan joue la comédie de la conversion et feint le repentir devant son père, il fait l'apologie de l'hypocrisie religieuse devant un Sganarelle scandalisé. Dom Carlos vient réclamer réparation, mais le héros refuse, au nom du ciel, de lui donner satisfaction. Sganarelle met vainement son maître en garde. Dom Juan négligera un dernier avertissement du ciel sous la forme d'un spectre : la statue tendra la main vers Dom Juan qui sera foudroyé et entraîné aux enfers...
Acte V, scène II -
SGANARELLE: Ah! Monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti! Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au Ciel, tous mes souhaits accomplis.
DOM JUAN: La peste le benêt!
SGANARELLE: Comment, le benêt?
DOM JUAN: Quoi? tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon coeur?
SGANARELLE: Quoi? ce n'est pas. Vous ne. Votre. Oh! quel homme! quel homme! quel homme!
DOM JUAN: Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes.
SGANARELLE: Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante?
DOM JUAN: Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas; mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme; et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un père dont j'ai besoin, et me mettre à couvert, du côté des hommes, de cent fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses.
SGANARELLE: Quoi? vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien?
DOM JUAN: Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi, qui se mêlent de ce métier, et qui se servent du même masque pour abuser le monde!
SGANARELLE: Ah! quel homme! quel homme!
DOM JUAN: Il n'y a plus de honte maintenant à cela, l'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertus. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoiqu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lie à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti; qui en choque un, se les jette tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touchés: ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres, ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse, qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues, et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelque baissement de tête, un soupir mortifié, et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire.
C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver, et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher, et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers, et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrai. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du Ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets, qui sans connaissance de cause crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle.
SGANARELLE: O Ciel ! qu'entends-je ici ? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira, battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi, si vous voulez : il faut que je décharge mon coeur, et qu'en valet fidèle je vous dise ce que je dois. Sachez, Monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise ; et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche ; la branche est attachée à l'arbre ; qui s'attache à l'arbre, suit de bons préceptes ; les bons préceptes valent mieux que les belles paroles ; les belles paroles se trouvent à la cour ; à la cour sont les courtisans ; les courtisans suivent la mode ;la mode vient de la fantaisie ; la fantaisie est une faculté de l'âme ; l'âme est ce qui nous donne la vie ; la vie finit par la mort ; la mort nous fait penser au Ciel ; le ciel est au-dessus de la terre ; la terre n'est point la mer ; la mer est sujette aux orages ; les orages tourmentent les vaisseaux ; les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote ; un bon pilote a de la prudence ; la prudence n'est point dans les jeunes gens ; les jeunes gens doivent obéissance aux vieux ; les vieux aiment les richesses ; les richesses font les riches ; les riches ne sont pas pauvres ; les pauvres ont de la nécessité ; nécessité n'a point de loi ; qui n'a point de loi vit en bête brute ; et, par conséquent, vous serez damné à tous les diables..."

1666 - "Le Misanthrope"
"Trahi de toutes parts, accablé d'injustices, Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices, Et chercher sur la terre un endroit écarté Où d'être homme d'honneur ont ait la liberté." - En 1666, malgré ses ennuis, Molière va donner le 4 juin 1666 sa plus fine comédie, "Le Misanthrope" et, deux mois plus tard, le 6 août, la meilleure de ses farces, "Le Médecin malgré lui" (6 août). A la fin de l'année, nous le retrouvons aux fêtes de Saint-Germain, où, docile amuseur du roi, il contribue au Ballet des Muses de Benserade, avec les délicatesses précieuses de "Mélicerte", une comédie-pastorale héroïque (2 décembre), avec le livret de "la Pastorale Comique" (5 janvier 1667) et une comédie-ballet, "Le Sicilien ou l'Amour Peintre" (14 février).
"Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux" est une comédie en cinq actes en vers créée le 4 juin 1666. Elle est inspirée du "Dyscolos" de Ménandre. Le drame d'Alceste qui aime et se croit aimé, Alceste, idéaliste, qui prétend se comporter sans hypocrisie, qui attribue aux "vices du temps" les défauts qu'il voit en Célimène et entretient l'espoir d'en "purger son âme". Il clame son intransigeance face au pouvoir et à ses compromissions (et préfère par exemple perdre un procès où son bon droit est établi plutôt que d'influencer le juge comme le fait son adversaire), mais il est épris de Célimène, jeune femme mondaine et coquette...
Acte 1 - Scène 1 - À Paris, sous Louis XIV, en 1666, un salon de riche apparence, au premier étage d'une demeure aristocratique. On y voit peu de meubles, comme c'était l'usage. Entrent vivement de jeunes seigneurs très élégants. L'un est vêtu à la dernière mode, l'autre de couleurs plus austères, avec un rien qui rappelle la mode ancienne. Ce dernier est Alceste. Il va se jeter sur une chaise et est rejoint par Philinte ; il demande à Alceste les raisons de son mécontentement. Alceste est furieux parce que Philinte vient de prodiguer des marques d'amitié à un homme qu'il connaît à peine. Philinte lui rappelle les exigences de la politesse. L'opinion d'Alceste est qu'on a le devoir de dire la vérité partout et à tout le monde. Il ne voit qu'hypocrisie dans la politesse, et même dans tous les faits et gestes de l'humanité. Ainsi il a un procès : il aime mieux le perdre que de se conformer à l'usage en allant visiter ses juges. Philinte se moque de lui et lui montre une de ses inconséquences : lui, le passionné de franchise, il aime une coquette médisante, Célimène. Alceste se calme et convient de sa faiblesse.
ALCESTE
Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur,
On ne lâche aucun mot qui ne parte du coeur.
PHILINTE
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie,
Il faut bien le payer de la même monnoie,
Répondre, comme on peut, à ses empressements,
Et rendre offre pour offre, et serments pour serments.
ALCESTE
Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode
Qu'affectent la plupart de vos gens à la mode;
Et je ne hais rien tant que les contorsions
De tous ces grands faiseurs de protestations,
Ces affables donneurs d'embrassades frivoles,
Ces obligeants diseurs d'inutiles paroles,
Qui de civilités avec tous font combat,
Et traitent du même air l'honnête homme et le fat.
Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse,
Vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse,
Et vous fasse de vous un éloge éclatant,
Lorsque au premier faquin il court en faire autant?
Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située
Qui veuille d'une estime ainsi prostituée.
Et la plus glorieuse a des régals peu chers,
Dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers:
Sur quelque préférence une estime se fonde,
Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde.
Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps,
Morbleu! vous n'êtes pas pour être de mes gens;
Je refuse d'un coeur la vaste complaisance
Qui ne fait de mérite aucune différence;
Je veux qu'on me distingue; et pour le trancher net,
L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
PHILINTE
Mais, quand on est du monde, il faut bien que l'on rende
Quelques dehors civils que l'usage demande.
ALCESTE
Non, vous dis-je, on devrait châtier, sans pitié,
Ce commerce honteux de semblants d'amitié.
Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre
Le fond de notre coeur dans nos discours se montre,
Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments
Ne se masquent jamais sous de vains compliments.
PHILINTE
Il est bien des endroits où la pleine franchise
Deviendrait ridicule et serait peu permise;
Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur,
Il est bon de cacher ce qu'on a dans le coeur.
Serait-il à propos et de la bienséance
De dire à mille gens tout ce que d'eux on pense?
Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît,
Lui doit-on déclarer la chose comme elle est?
ALCESTE
Oui.
PHILINTE
Quoi? Vous iriez dire à la vieille milie
Qu'à son âge il sied mal de faire la jolie,
Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun?
ALCESTE
Sans doute.
PHILINTE
À Dorilas, qu'il est trop importun,
Et qu'il n'est, à la cour, oreille qu'il ne lasse
À conter sa bravoure et l'éclat de sa race?
ALCESTE
Fort bien.
PHILINTE
Vous vous moquez.
ALCESTE
Je ne me moque point,
Et je vais n'épargner personne sur ce point.
Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville
Ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile;
J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font;
Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie.
Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain.
PHILINTE
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage,
Je ris des noirs accès où je vous envisage,
Et crois voir en nous deux, sous mêmes soins nourris,
Ces deux frères que peint l'Ecole des maris,
Dont...
ALCESTE
Mon Dieu! Laissons là vos comparaisons fades.
PHILINTE
Non: tout de bon, quittez toutes ces incartades.
Le monde par vos soins ne se changera pas;
Et puisque la franchise a pour vous tant d'appas,
Je vous dirai tout franc que cette maladie,
Partout où vous allez, donne la comédie,
Et qu'un si grand courroux contre les moeurs du temps
Vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
ALCESTE
Tant mieux, morbleu! tant mieux, c'est ce que je demande;
Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande:
Tous les hommes me sont à tel point odieux,
Que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
PHILINTE
Vous voulez un grand mal à la nature humaine!
ALCESTE
Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.
PHILINTE
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception,
Seront enveloppés dans cette aversion?
Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes...
ALCESTE
Non: elle est générale, et je hais tous les hommes:
Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants,
Et les autres, pour être aux méchants complaisants,
Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
De cette complaisance on voit l'injuste excès
Pour le franc scélérat avec qui j'ai procès:
Au travers de son masque on voit à plein le traître;
Partout il est connu pour tout ce qu'il peut être;
Et ses roulements d'yeux et son ton radouci
N'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici.
On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde,
Par de sales emplois s'est poussé dans le monde,
Et que par eux son sort de splendeur revêtu
Fait gronder le mérite et rougir la vertu.
Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne,
Son misérable honneur ne voit pour lui personne;
Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit,
Tout le monde en convient, et nul n'y contredit.
Cependant sa grimace est partout bienvenue:
On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue;
Et s'il est, par la brigue, un rang à disputer,
Sur le plus honnête homme on le voit l'emporter.
Têtebleu! Ce me sont de mortelles blessures,
De voir qu'avec le vice on garde des mesures;
Et parfois il me prend des mouvements soudains
De fuir dans un désert l'approche des humains.
PHILINTE
Mon Dieu, des moeurs du temps mettons-nous moins en peine,
Et faisons un peu grâce à la nature humaine.
Ne l'examinons point dans la grande rigueur,
Et voyons ses défauts avec quelque douceur.
Il faut, parmi le monde, une vertu traitable;
À force de sagesse, on peut être blâmable;
La parfaite raison fuit toute extrémité,
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.
Cette grande raideur des vertus des vieux âges
Heurte trop notre siècle et les communs usages;
Elle veut aux mortels trop de perfection:
Il faut fléchir au temps sans obstination;
Et c'est une folie à nulle autre seconde
De vouloir se mêler de corriger le monde.
J'observe, comme vous, cent choses tous les jours,
Qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours;
Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître,
En courroux, comme vous, on ne me voit point être;
Je prends tout doucement les hommes comme ils sont,
J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font;
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville,
Mon flegme est philosophe autant que votre bile.
Scène 2 - Un jeune marquis, Oronte, s'adressant à Alceste, se répand en compliments excessifs et en louanges inattendues, et parvient à lui faire entendre un sonnet au goût du jour, dont il est l'auteur, pour lui demander son avis, qui sera, il en est sûr, très élogieux. Alceste s'efforce d'éviter l'épreuve, mais il est obligé d'écouter le sonnet. Philinte multiplie les éloges. Alceste, embarrassé, cherche des faux-fuyants et bientôt développe une critique précise qui blesse gravement Oronte. Ils se querellent. Oronte sort, se considérant comme offensé...
Scène 3 - Alceste se trouve ainsi impliqué dans une affaire d'honneur, un embarras qui vient s'ajouter à son procès. Il a retrouvé sa mauvaise humeur à l'égard de Philinte, qui sort pourtant avec lui, ne voulant pas le laisser seul...
Acte 2 - Scène 1 - Alceste apparaît avec une jeune femme élégante, Célimène, qu'il ramène chez elle. Alceste lui reproche son attitude, lui exprime sa jalousie. Mais elle rétorque en montrant à Alceste son ridicule et ses contradictions. Il voudrait pourtant poser à Célimène la grande question du mariage : veut-elle l'épouser ou non ? Mais, scène 2, au moment où il va parler, le valet de Célimène, Basque, annonce l'arrivée d'Acaste, jeune marquis à la mode. Voici, scène 3, que Célimène accepte de le recevoir malgré les protestations d'Alceste. Un autre marquis, Clitandre, est annoncé (scène 4), Célimène retient Alceste qui veut partir. La scène 5, la «Scène des portraits», voit une grande conversation s'engager avec les deux marquis, rejoint par Philinte et Éliante, cousine de Célimène. Célimène médit spirituellement des personnes de leur connaissance lorsque Alceste, resté d'abord silencieux, prend feu contre l'esprit médisant que ces flatteurs entretiennent chez Célimène. Elle riposte. On rit de lui. La discussion s'aigrit. Éliante et Philinte essaient d'apaiser les choses. La scène 6 termine l'acte, se présente un officier de police chargé de convoquer Alceste au tribunal des Maréchaux. C'est là une conséquence de sa querelle avec Oronte. Alceste est obligé de partir, mais il se promet de revenir au plus tôt pour mettre fin à l'incertitude où le tient Célimène....
Acte 3 - Scène 1 - Acaste et Clitandre, les deux marquis, restés seuls, rivalisent de suffisance : chacun se déclare le préféré de Célimène. Plutôt que de se quereller, ils s'engagent l'un et l'autre à céder la place devant une marque certaine de cette préférence.
Voici un portrait emblématique de la comédie de caractère, le "fat"...
CLITANDRE
Cher Marquis, je te vois l'âme bien satisfaite :
Toute chose t'égaye, et rien ne t'inquiète.
En bonne foi, crois−tu, sans t'éblouir les yeux,
Avoir de grands sujets de paroître joyeux ?
ACASTE
Parbleu ! je ne vois pas, lorsque je m'examine,
Où prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine.
J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison
Qui se peut dire noble avec quelque raison ;
Et je crois, par le rang que me donne ma race,
Qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe
Pour le coeur, dont sur tout nous devons faire cas,
On sait, sans vanité, que je n'en manque pas,
Et l'on m'a vu pousser, dans le monde, une affaire
D'une assez vigoureuse et gaillarde manière.
Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût
A juger sans étude et raisonner de tout,
A faire aux nouveautés, dont je suis idolâtre,
Figure de savant sur les bancs du théâtre,
Y décider en chef, et faire du fracas
A tous les beaux endroits qui méritent des has.
Je suis assez adroit ; j'ai bon air, bonne mine,
Les dents belles surtout, et la taille fort fine.
Quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter,
Qu'on seroit mal venu de me le disputer.
Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être,
Fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître.
Je crois qu'avec cela, mon cher Marquis, je croi
Qu'on peut, par tout pays, être content de soi.
CLITANDRE
Oui ; mais, trouvant ailleurs des conquêtes faciles,
Pourquoi pousser ici des soupirs inutiles ?
ACASTE
Moi ? Parbleu ! je ne suis de taille ni d'humeur
A pouvoir d'une belle essuyer la froideur.
C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires,
A brûler constamment pour des beautés sévères,
A languir à leurs pieds et souffrir leurs rigueurs,
A chercher le secours des soupirs et des pleurs,
Et tâcher, par des soins d'une très−longue suite,
D'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite.
Mais les gens de mon air, Marquis, ne sont pas faits
Pour aimer, à crédit, et faire tous les frais.
Quelque rare que soit le mérite des belles,
Je pense, Dieu merci ! qu'on vaut son prix comme elles ;
Que pour se faire honneur d'un coeur comme le mien,
Ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien.
Et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances,
Il faut qu'à frais communs se fassent les avances.
CLITANDRE
Tu penses donc, Marquis, être fort bien ici ?
ACASTE
J'ai quelque lieu, Marquis, de le penser ainsi.
CLITANDRE
Crois−moi, détache−toi de cette erreur extrême ;
Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi−même.
ACASTE
Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet.
CLITANDRE
Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait ?
ACASTE
Je me flatte.
CLITANDRE
Sur quoi fonder tes conjectures ?
ACASTE
Je m'aveugle.
CLITANDRE
En as−tu des preuves qui soient sûres ?
ACASTE
Je m'abuse, te dis−je.
CLITANDRE
Est−ce que de ses voeux
Célimène t'a fait quelques secrets aveux ?
ACASTE
Non, je suis maltraité.
CLITANDRE
Réponds−moi, je te prie.
ACASTE
Je n'ai que des rebuts.
CLITANDRE
Laissons la raillerie,
Et me dis quel espoir on peut t'avoir donné.
ACASTE
Je suis le misérable, et toi le fortuné :
On a pour ma personne une aversion grande,
Et quelqu'un de ces jours il faut que je me pende.
CLITANDRE
O çà, veux−tu, Marquis, pour ajuster nos voeux,
Que nous tombions d'accord d'une chose tous deux ?
Que qui pourra montrer une marque certaine
D'avoir meilleure part au coeur de Célimène,
L'autre ici fera place au vainqueur prétendu,
Et le délivrera d'un rival assidu ?
ACASTE
Ah ! parbleu ! tu me plais avec un tel langage,
Et du bon de mon coeur à cela je m'engage.
Mais, chut !
Alors que Célimène de retour marque sa surprise de leur présence (scène 2), ils se retireront (scène 3) à l'arrivée d'une visiteuse dont Célimène a entendu rouler le carrosse dans la cour. C'est Arsinoé la prude, dont Célimène a le temps de faire aux deux marquis un portrait vinaigré avant qu'elle n'ait monté l'escalier. L'entrée d'Arsinoé (scène 4), plus prompte que ne l'attendait Célimène, offre à celle-ci l'occasion d'un changement immédiat dans l'attitude, le ton et les paroles. Les marquis s'en vont. Arsinoé, prétendant renseigner Célimène sur sa réputation, multiplie contre elle les sous-entendus, supposant que sa vie élégante et son esprit cachent une conduite en réalité scandaleuse, et se permet même de lui donner des conseils. Sans quitter les dehors de la politesse, Célimène riposte brillamment et montre bien à la prude que son hypocrisie est percée à jour....
(Acte III, scène 4)
ARSINOÉ
À quoi qu'en reprenant on soit assujettie,
Je ne m'attendais pas à cette repartie,
Madame, et je vois bien, par ce qu'elle a d'aigreur,
Que mon sincère avis vous a blessée au cœur.
CELIMENE
Au contraire, Madame ; et si l'on était sage,
Ces avis mutuels seraient mis en usage :
On détruirait par là, traitant de bonne foi1,
Ce grand aveuglement où chacun est pour soi.
Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle
Nous ne continuions cet office fidèle [sens : vérité qu'on dit aux amis],
Et ne prenions grand soin de nous dire, entre nous,
Ce que nous entendrons, vous de moi, moi de vous.
ARSINOÉ
Ah ! Madame, de vous je ne puis rien entendre :
C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre.
CELIMENE
Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout,
Et chacun a raison suivant l'âge ou le goût.
Il est une saison pour la galanterie ;
Il en est une aussi propre à la pruderie.
On peut, par politique, en prendre le parti,
Quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti :
Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces2.
Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces :
L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps,
Madame, comme on sait, d'être prude à vingt ans.
ARSINOE
Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage,
Et vous faites sonner terriblement votre âge.
Ce que de plus que vous on en pourrait avoir
N'est pas un si grand cas pour s'en tant prévaloir;
Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte,
Madame, à me pousser3 de cette étrange sorte.
CELIMENE
Et moi, je ne sais pas, Madame, aussi pourquoi
On vous voit, en tous lieux, vous déchaîner sur moi.
Faut-il de vos chagrins, sans cesse, à moi vous prendre ?
Et puis-je mais4 des soins qu'on ne va pas vous rendre ?
Si ma personne aux gens inspire de l'amour,
Et si l'on continue à m'offrir chaque jour
Des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte,
Je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute :
Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas
Que pour les attirer vous n'ayez des appas.
ALCESTE
Puissiez-vous, pour goûter de vrais contentements,
L'un pour l'autre à jamais garder ces sentiments!
Trahi de toutes parts, accablé d'injustices,
Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices,
Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d'être homme d'honneur ont ait la liberté.
Scène 5 - Alceste, absent depuis la fin de l'acte précédent, arrive à propos. Arsinoé essaie de le séduire et promet de lui prouver que Célimène le trahit. Elle l'emmène chez elle ; elle a réussi à éveiller au moins son inquiétude. Acte 4 - Scène 1 - Pendant qu'Alceste est encore chez Arsinoé, Philinte raconte à Éliante que l'affaire du sonnet s'est terminée en sauvant les apparences d'une réconciliation entre Oronte et Alceste. Elle regrette la passion d'Alceste pour Célimène et Éliante avoue son penchant pour Alceste. Un Alceste qui revient, furieux (scène 2): il a en main une lettre tendre de Célimène adressée à Oronte et qu'Arsinoé lui a procurée. Se sentant trahi, Alceste veut se venger et offre son amour à Éliante, qui sent bien que ce revirement n'est pas sérieux. Alors qu'Éliante et Philinte s'esquivent, Célimène entre (scène 3) et doit se défendre face à Alceste, et parvient à transformer le jaloux en suppliant : Alceste, décontenancé et pris à nouveau sous le charme, lui demande pardon et s'avoue plus épris que jamais tout en regrettant sa propre faiblesse. Le tête-à-tête est interrompu (scène 4) par l'arrivée de Du Bois, valet d'Alceste, qui lui apporte une mauvaise nouvelle, son procès semble perdu et lui-même risque d'être arrêté. L'acte 5 confirme (scène 1), la perte de son procès, Alceste ressent une haine de plus en plus vive contre l'humanité toute entière et se dit décidé à fuir la société, ce qui l'entraînera à emmener Célimène avec lui.
Le voici (scène 2), avec Oronte sommant Célimène de choisir entre eux deux, mais elle cherche à éviter de répondre, tente d'appeler Éliante à son secours (scène 3), mais en vain. La situation s'envenime (scène 4), accompagnés d'Arsinoé, les deux marquis, Acaste et Clitandre, reviennent, apportant des billets doux que Célimène aurait écrit pour chacun d'eux, ils en font lecture à voix haute et les prétendants de Célimène s'y découvrent tous ridiculisés et trompés. Indignés, Acaste, Clitandre et Oronte s'en vont, suivis de près par Arsinoé, qui espérait consoler Alceste, mais repart définitivement déçue. Alceste, lui, reste là, encore prêt à pardonner à Célimène et à l'épouser, si elle accepte de le suivre pour vivre avec lui à la campagne. Célimène hésite, puis refuse. Alceste déclare alors son intention de rompre avec elle et de se retirer dans la solitude. Éliante accorde sa main à Philinte. Philinte espère qu'il convaincra Alceste de demeurer à Paris....
ALCESTE
Hé bien! je me suis tu, malgré ce que je vois,
Et j'ai laissé parler tout le monde avant moi:
Ai-je pris sur moi-même un assez long empire,
Et puis-je maintenant...?
CÉLIMÈNE
Oui, vous pouvez tout dire:
Vous en êtes en droit, lorsque vous vous plaindrez,
Et de me reprocher tout ce que vous voudrez.
J'ai tort, je le confesse, et mon âme confuse
Ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse.
J'ai des autres ici méprisé le courroux,
Mais je tombe d'accord de mon crime envers vous.
Votre ressentiment, sans doute, est raisonnable:
Je sais combien je dois vous paraître coupable,
Que toute chose dit que j'ai pu vous trahir,
Et qu'enfin vous avez sujet de me haïr.
Faites-le, j'y consens.
ALCESTE
Hé! le puis-je, traîtresse?
Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse?
Et quoique avec ardeur je veuille vous haïr,
Trouvé-je un cour en moi tout prêt à m'obéir?
(à Eliante et Philinte.)
Vous voyez ce que peut une indigne tendresse,
Et je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse.
Mais, à vous dire vrai, ce n'est pas encor tout,
Et vous allez me voir la pousser jusqu'au bout,
Montrer que c'est à tort que sages on nous nomme,
Et que dans tous les cours il est toujours de l'homme.
Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits;
J'en saurai, dans mon âme, excuser tous les traits,
Et me les couvrirai du nom d'une faiblesse
Où le vice du temps porte votre jeunesse,
Pourvu que votre cour veuille donner les mains
Au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains,
Et que dans mon désert, où j'ai fait voeu de vivre,
Vous soyez, sans tarder, résolue à me suivre:
C'est par là seulement que, dans tous les esprits,
Vous pouvez réparer le mal de vos écrits,
Et qu'après cet éclat, qu'un noble cour abhorre,
Il peut m'être permis de vous aimer encore.
CÉLIMÈNE
Moi, renoncer au monde avant que de vieillir,
Et dans votre désert aller m'ensevelir?
ALCESTE
Et s'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde,
Que vous doit importer tout le reste du monde?
Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contents?
CÉLIMÈNE
La solitude effraye une âme de vingt ans:
Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte,
Pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte.
Si le don de ma main peut contenter vos voeux,
Je pourrai me résoudre à serrer de tels noeuds;
Et l'hymen...
ALCESTE
Non: mon cour à présent vous déteste,
Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste.
Puisque vous n'êtes point, en des liens si doux,
Pour trouver tout en moi, comme moi tout en vous,
Allez, je vous refuse, et ce sensible outrage
De vos indignes fers pour jamais me dégage.

1666 - "Le Médecin malgré lui"
"Et serais-je devenu médecin, sans m'en être aperçu?" - Dans cette pièce qui passe pour une farce sans conséquence, Molière mêle le thème du couple à celui de la médecine. La relation de couple est présentée dans ses trois états : la mésentente comme pain quotidien pour Sganarelle et Martine, la résignation et le doute qui laissent une place à la tentation pour Lucas et Jacqueline, et le nuage rose et délicieux de l'Amour pour les jeunes premiers, Léandre et Lucinde. L'humour est présent dès le départ. La scène de ménage qui ouvre la pièce est à juste titre une des plus célèbres du théâtre classique. Chaque réplique fait mouche. On passe insensiblement des reproches divers aux injures les plus variées et des injures aux coups. Un voisin qui vient au secours de la femme battue sert de bouc émissaire. ''Je te pardonne mais je me vengerai'' murmure Martine quand son mari s'en va couper du bois...
ACTE I, Scène première
Sganarelle, Martine, en se querellant.
SGANARELLE: Non, je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître.
MARTINE: Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines.
SGANARELLE: Ô la grande fatigue que d'avoir une femme! et qu'Aristote a bien raison, quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon!
MARTINE: Voyez un peu l'habile homme, avec son benêt d'Aristote!
SGANARELLE: Oui, habile homme: trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin, et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par coeur.
MARTINE: Peste du fou fieffé!
SGANARELLE: Peste de la carogne!
MARTINE: Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisai d'aller dire oui!
SGANARELLE: Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine!
MARTINE: C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâces au Ciel de m'avoir pour ta femme? et méritais-tu d'épouser une personne comme moi?
SGANARELLE: Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces! Hé! morbleu! ne me fais point parler là-dessus: je dirais de certaines choses.
MARTINE: Quoi? que dirais-tu?
SGANARELLE: Baste, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver.
MARTINE: Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai?
SGANARELLE: Tu as menti: j'en bois une partie.
MARTINE: Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis.
SGANARELLE: C'est vivre de ménage.
MARTINE: Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais.
SGANARELLE: Tu t'en lèveras plus matin.
MARTINE: Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison.
SGANARELLE: On en déménage plus aisément.
MARTINE: Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire.
Le Médecin que Molière nous donne à voir n'est pas un vrai médecin, c'est Sganarelle, un bûcheron plein de ressources et d'astuces, déguisé ''malgré lui'' en médecin. On peut donc rire de lui, de son diagnostic, de ses explications, de ses remèdes. On s'aperçoit peu à peu que cette parodie de la médecine n'est pas si loin de notre vécu. La blouse blanche a remplacé la robe noire, les virus et les microbes ont pris la place des humeurs et des vapeurs, mais la relation du malade au médecin est restée pareille. La peur de la maladie et de la mort mettent le médecin sur un piédestal. Le discours médical, incompréhensible par définition et par fonction, ne répond pas à la question du malade: ''pourquoi suis-je malade?''
Vexée et dans le but de se venger de son mari, Martine va croire à deux serviteurs cherchant un médecin pour la fille de leur maître qu’elle connaît l’homme qui leur faut. C’est un excellent médecin, qui a accompli de nombreux miracles et dont la réputation n’est plus à faire. Elle leur indique où il se trouve en leur précisant qu’il nie parfois son savoir et qu’afin de leur faire avouer, il leur faut le battre. Et à force d’être roué de coup par les deux domestiques de Géronte, Sganarelle avoue être médecin, ce qui est totalement faux, et on mène ce dernier au logis du maître. On lui présenta la malade, qu’il trouva fort à sa convenance, ainsi que la nourrice, femme de Lucas, l’une des domestiques (farce absolue, Sganarelle tente de toucher les tétons de la nourrice: "Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice, et que je visite son sein..."). Lucinde a mystérieusement perdu la parole et iIl faut absolument qu’elle recouvre celle-ci car cette maladie retarde son mariage avec le mari que son père lui avait choisi, Horace, alors qu'elle est éprise de Léandre.
(Scène IV)
SGANARELLE: Est-ce là la malade?
GÉRONTE: Oui, je n'ai qu'elle de fille; et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir.
SGANARELLE: Qu'elle s'en garde bien! il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin.
GÉRONTE: Allons, un siège.
SGANARELLE: Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez.
GÉRONTE: Vous l'avez fait rire, Monsieur.
SGANARELLE: Tant mieux: lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien! de quoi est-il question? qu'avez-vous? quel est le mal que vous sentez?
LUCINDE répond par signes, en portant sa main à sa bouche, à sa tête, et sous son menton: Han, hi, hon, han.
SGANARELLE: Eh! que dites-vous?
LUCINDE continue les mêmes gestes: Han, hi, hon, han, han, hi, hon.
SGANARELLE: Quoi?
LUCINDE: Han, hi, hon.
SGANARELLE, la contrefaisant: Han, hi, hon, han, ha: je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là?
GÉRONTE: Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusques ici on en ait pu savoir la cause; et c'est un accident qui a fait reculer son mariage.
SGANARELLE: Et pourquoi?
GÉRONTE: Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses.
SGANARELLE: Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie! Je me garderais bien de la vouloir guérir.
GÉRONTE: Enfin, Monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal.
SGANARELLE: Ah! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup?
GÉRONTE: Oui, Monsieur.
SGANARELLE: Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs?
GÉRONTE: Fort grandes.
SGANARELLE: C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez?
GÉRONTE: Oui.
SGANARELLE: Copieusement?
GÉRONTE: Je n'entends rien à cela.
SGANARELLE: La matière est-elle louable?
GÉRONTE: Je ne me connais pas à ces choses.
SGANARELLE, se tournant vers la malade: Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette.
GÉRONTE: Eh oui, Monsieur, c'est là son mal; vous l'avez trouvé tout du premier coup.
SGANARELLE: Ah, ah!
JACQUELINE: Voyez comme il a deviné sa maladie!
SGANARELLE: Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, et vous eût été dire: "C'est ceci, c'est cela"; mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette.
GÉRONTE: Oui; mais je voudrais bien que vous me pussiez dire d'où cela vient.
SGANARELLE: Il n'est rien de plus aisé: cela vient de ce qu'elle a perdu la parole.
GÉRONTE: Fort bien; mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole?
SGANARELLE: Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue.
GÉRONTE: Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue?
SGANARELLE: Aristote, là-dessus, dit. de fort belles choses.
GÉRONTE: Je le crois.
SGANARELLE: Ah! c'était un grand homme!
GÉRONTE: Sans doute.
SGANARELLE, levant son bras depuis le coude: Grand homme tout à fait: un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savants nous appelons humeurs peccantes; peccantes, c'est-à-dire. humeurs peccantes; d'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant. pour ainsi dire. à. entendez-vous le latin?
GÉRONTE: En aucune façon.
SGANARELLE, se levant avec étonnement: Vous n'entendez point le latin!
GÉRONTE: Non.
SGANARELLE, en faisant diverses plaisantes postures: Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo haec Musa, "la Muse" , bonus, bona, bonum, Deus sanctus, estne oratio latinas? Etiam, "oui", Quare, "pourquoi?" Quia substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum, et casus.
GÉRONTE: Ah! que n'ai-je étudié?
JACQUELINE: L'habile homme que velà!
Un Léandre qui, pour entrer au domicile de sa belle, se fait passer pour apothicaire. Sganarelle et Léandre retournent ainsi tous deux au logis de Géronte : Lucinde retrouve la parole pour dire qu’elle n’épouserait personne d’autre que Léandre, ce que son père refuse. Mais le dénouement verra tout ce joli monde se réconcilier...
1667 - Profitant du séjour du roi à l'armée des Flandres, Molière donne le 5 août 1667 une représentation publique de "Panulphe ou l'imposteur", un Tartuffe remanié et adouci. Mais le premier président du Parlement et membre de la Compagnie, Lamoignon, interdit la pièce, et l'archevêque de Paris excommunie les spectateurs. Molière tombe malade, et le théâtre reste fermé jusqu'à Noël...
1668 - Molière se reprend, mais il semble avoir abandonné un peu de sa verve critique des moeurs de son temps : en janvier, "Amphitryon" joue la carte du délassement, en juillet, c'est une comédie, "George Dandin", puis le 9 septembre, une puissante comédie de caractère, "L'Avare"...

1668 - "L’Avare"
L'Avare ou l’École du mensonge est une comédie de Molière en 5 actes et en prose, créée au théâtre du Palais-Royal, le 9 septembre 1668. Le sujet est fortement inspiré d’une pièce de Plaute, La Marmite...
Harpagon, vieil avare tyrannique, a entrepris de réduire le train de vie de sa maison. Par la pratique de l’usure, il ne cesse d'accroître sa fortune. Veuf, il abrite sous son toit ses deux enfants, sa fille Élise et son fils Cléante. Élise est amoureuse de Valère, le fils d’un noble napolitain exilé, cachant son identité sous un faux nom, mais elle n’ose envisager un mariage sans l’accord de son père. Valère, pour vivre auprès d’elle, a donc imaginé de se faire engager comme majordome d’Harpagon. Cléante, quant à lui, souhaite épouser Mariane, jeune fille sans fortune vivant avec sa mère. Harpagon, grâce à l’entremetteuse Frosine, nourrit lui aussi un projet matrimonial avec la jeune fille. Mais tout s'accélère lorsque Cléante essaie de rassembler une grosse somme d’argent ; l’usurier qu’on lui indique n’est autre que son père. Harpagon a entretemps dissimulé dans son jardin une cassette remplie de dix mille écus, un trésor caché qui en vient à l'obséder tant il craint d'être volé. Son manège a été repéré par La Flèche, le valet de Cléante, qui voit dans le coffre une solution aux difficultés d’argent de son maître.
(Acte I, Scène 3) - HARPAGON, LA FLÈCHE.
HARPAGON: Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence.
LA FLÈCHE: Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps.
HARPAGON: Tu murmures entre tes dents.
LA FLÈCHE: Pourquoi me chassez-vous?
HARPAGON: C'est bien à toi, pendard, à me demander des raisons: sors vite, que je ne t'assomme.
LA FLÈCHE: Qu'est-ce que je vous ai fait?
HARPAGON: Tu m'as fait que je veux que tu sortes.
LA FLÈCHE: Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.
HARPAGON: Va-t'en l'attendre dans la rue, et ne sois point dans ma maison planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe, et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître, dont les yeux maudits assiégent toutes mes actions, dévorent ce que je possède, et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler.
LA FLÈCHE: Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable, quand vous renfermez toutes choses, et faites sentinelle jour et nuit?
HARPAGON: Je veux renfermer ce que bon me semble, et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards, qui prennent garde à ce qu'on fait? Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
LA FLÈCHE: Vous avez de l'argent caché?
HARPAGON: Non, coquin, je ne dis pas cela. (à part.) J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
LA FLÈCHE: Hé! que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose?
HARPAGON: Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. (Il lève la main pour lui donner un soufflet.) Sors d'ici, encore une fois.
LA FLÈCHE: Hé bien! je sors.
HARPAGON: Attends. Ne m'emportes-tu rien?
LA FLÈCHE: Que vous emporterais-je?
HARPAGON: Viens çà, que je voie. Montre-moi tes mains.
LA FLÈCHE: Les voilà.
HARPAGON: Les autres.
LA FLÈCHE: Les autres?
HARPAGON: Oui.
LA FLÈCHE: Les voilà.
HARPAGON: N'as-tu rien mis ici dedans?
LA FLÈCHE: Voyez vous-même.
HARPAGON. Il tâte le bas de ses chausses: Ces grands hauts-de-chausses sont propres à devenir les recéleurs des choses qu'on dérobe; et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.
LA FLÈCHE: Ah! qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint! et que j'aurais de joie à le voler!
HARPAGON: Euh?
LA FLÈCHE: Quoi?
HARPAGON: Qu'est-ce que tu parles de voler?
LA FLÈCHE: Je dis que vous fouilliez bien partout, pour voir si je vous ai volé.
HARPAGON: C'est ce que je veux faire.
Il fouille dans les poches de LA FLÈCHE.
LA FLÈCHE: La peste soit de l'avarice et des avaricieux!
HARPAGON: Comment? que dis-tu?
LA FLÈCHE: Ce que je dis?
HARPAGON: Oui: qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux?
LA FLÈCHE: Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.
HARPAGON: De qui veux-tu parler?
LA FLÈCHE: Des avaricieux.
HARPAGON: Et qui sont-ils ces avaricieux?
LA FLÈCHE: Des vilains et des ladres.
HARPAGON: Mais qui est-ce que tu entends par là?
LA FLÈCHE: De quoi vous mettez-vous en peine?
HARPAGON: Je me mets en peine de ce qu'il faut.
LA FLÈCHE: Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?
HARPAGON: Je crois ce que je crois; mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela.
LA FLÈCHE: Je parle. Je parle à mon bonnet.
HARPAGON: Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette.
LA FLÈCHE: M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux?
HARPAGON: Non; mais je t'empêcherai de jaser, et d'être insolent. Tais-toi.
LA FLÈCHE: Je ne nomme personne.
HARPAGON: Je te rosserai, si tu parles.
LA FLÈCHE: Qui se sent morveux, qu'il se mouche.
HARPAGON: Te tairas-tu?
LA FLÈCHE: Oui, malgré moi.
HARPAGON: Ha, ha!
LA FLÈCHE, lui montrant une des poches de son justaucorps: Tenez, voilà encore une poche: êtes-vous satisfait?
HARPAGON: Allons, rends-le-moi sans te fouiller.
LA FLÈCHE: Quoi?
HARPAGON: Ce que tu m'as pris.
LA FLÈCHE: Je ne vous ai rien pris du tout.
HARPAGON: Assurément?
LA FLÈCHE: Assurément.
HARPAGON: Adieu: va-t'en à tous les diables.
LA FLÈCHE: Me voilà fort bien congédié.
HARPAGON: Je te le mets sur ta conscience, au moins. Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort, et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là.
Après avoir découvert que son fils se couvrait de dettes, Harpagon apprend que ce dernier est épris de Mariane. Ainsi le père se trouve-t-il en concurrence avec son fils. Sa fureur est alors portée à son comble. Il entend écarter son fils au nom de l’obéissance due à l’autorité paternelle et l’obliger à s’engager dans un mariage contre nature avec la riche veuve qu’il lui destine.
Peu après, il découvre qu’on lui a dérobé sa chère cassette et sombre dans un délire paranoïaque...
(Acte III, scène 7)
HARPAGON. Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau:
Au voleur! au voleur! à l'assassin! au meurtrier! Justice, juste Ciel! je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin. (Il se prend lui-même le bras.) Ah! c'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami! on m'a privé de toi; et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie; tout est Fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde: sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus; je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris? Euh? que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure; et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice, et faire donner la question à toute la maison: à servantes, à valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Eh! de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous, et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après...
Valère, dénoncé, et qui ignore ce qu’on lui reproche, avoue vouloir épouser Élise. La tension monte à son paroxysme en présence d’un commissaire venu enquêter sur le vol. Mais tout va heureusement se résoudre. Valère fait connaître sa véritable identité et retrouve son père et sa sœur, qui n’est autre que Mariane. Cléante épousera Mariane, Valère épousera Élise, tandis qu’Harpagon reste seul avec sa cassette...
Le 5 février 1669, Molière peut enfin représenter au Palais-Royal, avec le soutien du roi, "Tartufe ou l'Imposteur", avec un succès indéniable. L'époque a évolué, cinq années ont passé et le jansénisme a été écrasé...
1669-1670 - Devenu grand pourvoyeur des divertissements royaux, Molière donne aux fêtes de Chambord, en octobre 1669, une comédie-ballet, "M. de Pourceaugnac". A Saint-Germain, supplantant Benserade, il organise un Divertissement Royal où il insère la comédie des "Amants Magnifiques" en février 1670. Et c'est à la demande du roi lui-même qu'il écrit, en collaboration avec Lulli, "Le Bourgeois Gentilhomme", une comédie-ballet qui sera jouée à Chambord en octobre 1670. En 1671, en collaboration cette fois avec Corneille et Quinault, il composera "Psyché", une tragédie-ballet "à machines", puis revient à la farce avec "Les Fourberies de Scapin" et "La Comtesse d'Escarbagnas".
"M. de Pourceaugnac" - "Messieurs, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie?" - On y voit Molière entre Paris et la Province reconstituer le langage de chaque milieu et condition : Eraste est amoureux de Julie, fille d'Oronte ; mais ce dernier veut la donner à M. de Pourceaugnac, gentilhomme provincial qui arrive à Paris pour connaître la jeune fille. Les intrigants Sbrigani et Nérine, au service d'Eraste, vont s'ingénier à rendre la vie parisienne intenable au provincial et à lui faire reprendre au plus vite le chemin du retour. Éraste va donc lui offre l'hospitalité dans sa maison et le confie à deux médecins à qui il l'a présenté d'avance comme un parent devenu fou. Pourceaugnac croit qu'il s'agit de deux maîtres d'hôtel chargés de lui faire faire bonne chère...
Acte I, scène 8, avant que ne surviennent dans une Course célèbre, des apothicaires armés de seringues, que Pourceaugnac s'enfuit dans la salle, où les apothicaires le poursuivent parmi les spectateurs...
PREMIER MÉDECIN: Ce m'est beaucoup d'honneur, Monsieur, d'être choisi pour vous rendre service.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Je suis votre serviteur.
PREMIER MÉDECIN: Voici un habile homme, mon confrère, avec lequel je vais consulter la manière dont nous vous traiterons.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Il ne faut point tant de façons, vous dis-je, et je suis homme à me contenter de l'ordinaire.
PREMIER MÉDECIN: Allons, des sièges.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Voilà, pour un jeune homme, des domestiques bien lugubres!
PREMIER MÉDECIN: Allons, Monsieur: prenez votre place, Monsieur.
Lorsqu'ils sont assis, les deux Médecins lui prennent chacun une main, pour lui tâter le pouls.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, présentant ses mains: Votre très humble valet. (Voyant qu'ils lui tâtent le pouls.) Que veut dire cela?
PREMIER MÉDECIN: Mangez-vous bien, Monsieur?
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Oui, et bois encore mieux.
PREMIER MÉDECIN: Tant pis: cette grande appétition du froid et de l'humide est une indication de la chaleur et sécheresse qui est au dedans. Dormez-vous fort?
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Oui, quand j'ai bien soupé.
PREMIER MÉDECIN: Faites-vous des songes?
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Quelquefois.
PREMIER MÉDECIN: De quelle nature sont-ils?
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: De la nature des songes. Quelle diable de conversation est-ce là?
PREMIER MÉDECIN: Vos déjections, comment sont-elles?
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Ma foi! je ne comprends rien à toutes ces questions, et je veux plutôt boire un coup.
PREMIER MÉDECIN: Un peu de patience, nous allons raisonner sur votre affaire devant vous, et nous le ferons en français, pour être plus intelligibles.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau?
PREMIER MÉDECIN: Comme ainsi soit qu'on ne puisse guérir une maladie qu'on ne la connaisse parfaitement, et qu'on ne la puisse parfaitement connaître sans en bien établir l'idée particulière, et la véritable espèce, par ses signes diagnostiques et prognostiques, vous me permettrez, Monsieur notre ancien, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit, avant que de toucher à la thérapeutique, et aux remèdes qu'il nous conviendra faire pour la parfaite curation d'icelle. Je dis donc, Monsieur, avec votre permission, que notre malade ici présent est malheureusement attaqué, affecté, travaillé de cette sorte de folie que nous nommons fort bien mélancolie hypocondriaque, espèce de folie très fâcheuse, et qui ne demande pas moins qu'un Esculape comme vous, consommé dans notre art, vous, dis-je, qui avez blanchi, comme on dit, sous le harnois, et auquel il en a tant passé par les mains de toutes les façons. Je l'appelle mélancolie hypocondriaque, pour la distinguer des deux autres; car le célèbre Galien établit doctement à son ordinaire trois espèces de cette maladie que nous nommons mélancolie, ainsi appelée non-seulement par les Latins, mais encore par les Grecs, ce qui est bien à remarquer pour notre affaire: la première, qui vient du propre vice du cerveau; la seconde, qui vient de tout le sang, fait et rendu atrabilaire; la troisième, appelée hypocondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelque partie du bas-ventre et de la région inférieure, mais particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation porte au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épaisses et crasses, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation aux fonctions de la faculté princesse, et fait la maladie dont, par notre raisonnement il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit, pour diagnostique incontestable de ce que je dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand sérieux que vous voyez; cette tristesse accompagnée de crainte et de défiance, signes pathognomoniques et individuels de cette maladie, si bien marquée chez le divin vieillard Hippocrate; cette physionomie, ces yeux rouges et hagards, cette grande barbe, cette habitude du corps, menue, grêle, noire et velue, lesquels signes le dénotent très affecté de cette maladie, procédante du vice des hypocondres: laquelle maladie, par laps de temps naturalisée, envieillie, habituée, et ayant pris droit de bourgeoisie chez lui, pourrait bien dégénérer ou en manie, ou en phthisie, ou en apoplexie, ou même en fine frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie, car ignoti nulla est curatio morbi, il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devons faire à Monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore obturante, et à cette cacochymie luxuriante par tout le corps, je suis d'avis qu'il soit phlébotomisé libéralement, c'est-à-dire que les saignées soient fréquentes et plantureuses: en premier lieu de la basilique, puis de la céphalique. Et même, si le mal est opiniâtre, de lui ouvrir la veine du front, et que l'ouverture soit large, afin que le gros sang puisse sortir; et en même temps, de le purger, désopiler, et évacuer par purgatifs propres et convenables, c'est-à-dire par cholagogues, mélanogogues, et caetera; et comme la véritable source de tout le mal est ou une humeur crasse et féculente, ou une vapeur noire et grossière qui obscurcit, infecte et salit les esprits animaux, il est à propos ensuite qu'il prenne un bain d'eau pure et nette, avec force petit-lait clair, pour purifier par l'eau la féculence de l'humeur crasse, et éclaircir par le lait clair la noirceur de cette vapeur; mais, avant toute chose, je trouve qu'il est bon de le réjouir par agréables conversations, chants et instruments de musique, à quoi il n'y a pas d'inconvénient de joindre des danseurs, afin que leurs mouvements, disposition et agilité puissent exciter et réveiller la paresse de ses esprits engourdis, qui occasionne l'épaisseur de son sang, d'où procède la maladie. Voilà les remèdes que j'imagine, auxquels pourront être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs par Monsieur notre maître et ancien, suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'il s'est acquise dans notre art. Dixi.
SECOND MÉDECIN: à Dieu ne plaise, Monsieur, qu'il me tombe en pensée d'ajouter rien à ce que vous venez de dire! Vous avez si bien discouru sur tous les signes, les symptômes et les causes de la maladie de Monsieur; le raisonnement que vous en avez fait est si docte et si beau, qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou, et mélancolique hypocondriaque; et quand il ne le serait pas, il faudrait qu'il le devînt, pour la beauté des choses que vous avez dites, et la justesse du raisonnement que vous avez fait. Oui, Monsieur, vous avez dépeint fort graphiquement, graphice depinxisti, tout ce qui appartient à cette maladie: il ne se peut rien de plus doctement, sagement, ingénieusement conçu, pensé, imaginé, que ce que vous avez prononcé au sujet de ce mal, soit pour la diagnose, ou la prognose, ou la thérapie; et il ne me reste rien ici, que de féliciter Monsieur d'être tombé entre vos mains, et de lui dire qu'il est trop heureux d'être fou, pour éprouver l'efficace et la douceur des remèdes que vous avez si judicieusement proposés. Je les approuve tous, manibus et pedibus descendo in tuam sententiam. Tout ce que j'y voudrais ajouter, c'est de faire les saignées et les purgations en nombre impair: numero deus impari gaudet; de prendre le lait clair avant le bain; de lui composer un fronteau où il entre du sel: le sel est symbole de la sagesse; de faire blanchir les murailles de sa chambre, pour dissiper les ténèbres de ses esprits: album est disgregativum visus; et de lui donner tout à l'heure un petit lavement, pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes, dont, s'il a à guérir, il doit recevoir du soulagement. Fasse le Ciel que ces remèdes, Monsieur, qui sont les vôtres, réussissent au malade selon notre intention!
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Messieurs, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie?
PREMIER MÉDECIN: Non, Monsieur, nous ne jouons point.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Qu'est-ce que tout ceci? et que voulez-vous dire avec votre galimatias et vos sottises?
PREMIER MÉDECIN: Bon, dire des injures. Voilà un diagnostique qui nous manquait pour la confirmation de son mal, et ceci pourrait bien tourner en manie.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Avec qui m'a-t-on mis ici?
Il crache deux ou trois fois.
PREMIER MÉDECIN: Autre diagnostique: la sputation fréquente.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Laissons cela, et sortons d'ici.
PREMIER MÉDECIN: Autre encore: l'inquiétude de changer de place.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Qu'est-ce donc que toute cette affaire? et que me voulez-vous?
PREMIER MÉDECIN: Vous guérir, selon l'ordre qui nous a été donné.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Me guérir?
PREMIER MÉDECIN: Oui.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Parbleu! je ne suis pas malade.
PREMIER MÉDECIN: Mauvais signe, lorsqu'un malade ne sent pas son mal.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Je vous dis que je me porte bien.
PREMIER MÉDECIN: Nous savons mieux que vous comment vous vous portez, et nous sommes médecins, qui voyons clair dans votre constitution.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Si vous êtes médecins, je n'ai que faire de vous; et je me moque de la médecine.
PREMIER MÉDECIN: Hon, hon: voici un homme plus fou que nous ne pensons.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC: Mon père et ma mère n'ont jamais voulu de remèdes, et ils sont morts tous deux sans l'assistance des médecins.
PREMIER MÉDECIN: Je ne m'étonne pas s'ils ont engendré un fils qui est insensé. Allons, procédons à la curation, et par la douceur exhilarante de l'harmonie, adoucissons, lénifions, et accoisons l'aigreur de ses esprits, que je vois prêts à s'enflammer."

1670 - "Le Bourgeois gentilhomme"
Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet en cinq actes en prose de Molière, représentée pour la première fois le 14 octobre 1670, devant la cour de Louis XIV, au château de Chambord par la troupe de Molière. La musique est de Jean-Baptiste Lully, les ballets de Pierre Beauchamp, les décors de Carlo Vigarani et les costumes turcs du chevalier d'Arvieux. Cette pièce incarne le genre de la comédie-ballet à la perfection et reste même l'un des seuls chefs-d'œuvre du genre en regroupant les meilleurs comédiens et musiciens du temps. Elle répondait au goût de l'époque pour ce qui était nommé les turqueries, l'Empire ottoman étant alors un sujet de préoccupation universel dans les esprits, et que l'on cherchait à apprivoiser. L'origine de l'œuvre est liée au scandale provoqué par l'ambassadeur turc Suleyman Aga qui, lors de sa visite à la cour de Louis XIV en 1669, avait affirmé la supériorité de la cour ottomane sur celle du Roi-Soleil. Plus encore que dans L'Avare, Le Malade imaginaire ou Dom Juan, Molière semble négliger toute intrigue et concevoir ses comédies autour d'un personnage central dont il représente tous les aspects de son caractère.
Nous sommes en 1670 dans la maison de Monsieur Jourdain, un bourgeois de Paris. Afin de devenir un homme de qualité, Monsieur Jourdain a engagé un maître de musique, un maître à danser, un maître de philosophie et un maître d’armes qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d’en faire un homme instruit...
Acte I, Scène II - MONSIEUR JOURDAIN, DEUX LAQUAIS, MAÎTRE DE MUSIQUE, MAÎTRE à DANSER, VIOLONS, MUSICIENS ET DANSEURS.
MONSIEUR JOURDAIN: Hé bien, Messieurs? Qu'est-ce? me ferez-vous voir votre petite drôlerie?
MAÎTRE à DANSER: Comment? quelle petite drôlerie?
MONSIEUR JOURDAIN: Eh la. comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse.
MAÎTRE à DANSER: Ah, ah!
MAÎTRE DE MUSIQUE: Vous nous y voyez préparés.
MONSIEUR JOURDAIN: Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité; et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir.
MONSIEUR JOURDAIN: Je vous prie tous deux de ne vous point en aller, qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir.
MAÎTRE à DANSER: Tout ce qu'il vous plaira.
MONSIEUR JOURDAIN: Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Nous n'en doutons point.
MONSIEUR JOURDAIN: Je me suis fait faire cette indienne-ci.
MAÎTRE à DANSER: Elle est fort belle.
MONSIEUR JOURDAIN: Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Cela vous sied à merveille.
MONSIEUR JOURDAIN: Laquais! holà, mes deux laquais!
PREMIER LAQUAIS: Que voulez-vous, Monsieur?
MONSIEUR JOURDAIN: Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. (Aux deux maîtres.) Que dites-vous de mes livrées?
MAÎTRE à DANSER: Elles sont magnifiques.
MONSIEUR JOURDAIN. Il entr'ouvre sa robe, et fait voir un haut-de-chausses étroit de velours rouge, et une camisole de velours vert, dont il est vêtu: Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Il est galant.
MONSIEUR JOURDAIN: Laquais!
PREMIER LAQUAIS: Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN: L'autre laquais!
SECOND LAQUAIS: Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN: Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela?
MAÎTRE à DANSER: Fort bien. On ne peut pas mieux.
MONSIEUR JOURDAIN: Voyons un peu votre affaire.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandée. C'est un de mes écoliers, qui a pour ces sortes de choses un talent admirable.
MONSIEUR JOURDAIN: Oui, mais il ne fallait pas faire faire cela par un écolier, et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Il ne faut pas, Monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement.
MONSIEUR JOURDAIN: Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non; redonnez-la-moi, cela ira mieux.
MUSICIEN, chantant:
Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême,
Depuis qu'à vos rigueurs vos beaux yeux m'ont soumis;
Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime,
Hélas! que pourriez-vous faire à vos ennemis?
MONSIEUR JOURDAIN: Cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort; je voudrais que vous la pussiez un peu ragaillardir par-ci, par-là.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Il faut, Monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles.
MONSIEUR JOURDAIN: On m'en apprit un tout à fait joli, il y a quelque temps. Attendez. Là. comment est-ce qu'il dit?
MAÎTRE à DANSER: Par ma foi! je ne sais.
MONSIEUR JOURDAIN: Il y a du mouton dedans.
MAÎTRE à DANSER: Du mouton?
MONSIEUR JOURDAIN: Oui. Ah!
Monsieur Jourdain chante.
Je croyais Janneton
Aussi douce que belle,
Je croyais Janneton
Plus douce qu'un mouton:
Hélas! hélas! elle est cent fois,
Mille fois plus cruelle,
Que n'est le tigre aux bois.
N'est-il pas joli?
MAÎTRE DE MUSIQUE: Le plus joli du monde.
MAÎTRE à DANSER: Et vous le chantez bien.
MONSIEUR JOURDAIN: C'est sans avoir appris la musique.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Vous devriez l'apprendre, Monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble.
MAÎTRE à DANSER: Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses.
MONSIEUR JOURDAIN: Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique?
MAÎTRE DE MUSIQUE: Oui, Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN: Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrai prendre; car, outre le Maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un Maître de philosophie, qui doit commencer ce matin.
MAÎTRE DE MUSIQUE: La philosophie est quelque chose; mais la musique, Monsieur, la musique.
MAÎTRE à DANSER: La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique.
MAÎTRE à DANSER: Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Sans la musique, un état ne peut subsister.
MAÎTRE à DANSER: Sans la danse, un homme ne saurait rien faire.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique.
MAÎTRE à DANSER: Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques, et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser.
MONSIEUR JOURDAIN: Comment cela?
MAÎTRE DE MUSIQUE: La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes?
MONSIEUR JOURDAIN: Cela est vrai.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble, et de voir dans le monde la paix universelle?
MONSIEUR JOURDAIN: Vous avez raison.
MAÎTRE à DANSER: Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un état, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours: "Un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire"?
MONSIEUR JOURDAIN: Oui, on dit cela.
MAÎTRE à DANSER: Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser?
MONSIEUR JOURDAIN: Cela est vrai, vous avez raison tous deux.
MAÎTRE à DANSER: C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique.
MONSIEUR JOURDAIN: Je comprends cela à cette heure.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Voulez-vous voir nos deux affaires?
MONSIEUR JOURDAIN: Oui.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique.
MONSIEUR JOURDAIN: Fort bien.
MAÎTRE DE MUSIQUE: Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers.
MONSIEUR JOURDAIN: Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout.
MAÎTRE à DANSER: Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers; et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leurs passions.
MONSIEUR JOURDAIN: Passe, passe. Voyons....
M. Jourdain a commandé ce ballet pour une personne de qualité qui doit venir dîner le soir même. Le maître à danser lui assure que tout sera prêt. M. Jourdain demande qu’on lui apprenne à faire la révérence pour une marquise, Dorimène, la dame qui doit venir dîner. Soudain, un laquais annonce l’arrivée du maître d’armes. Le maître d’armes enseigne à M. Jourdain l’art du maniement de l’épée. Tout le secret des armes consiste à donner et à ne pas recevoir. Le maître d’armes affirme que son art l’emporte sur tous les autres, dont la musique et la danse. Une violente dispute éclate alors entre les trois maîtres et M. Jourdain essaie de les calmer. Le maître de philosophie fait son entrée. M. Jourdain lui demande de rétablir la paix. Le philosophe affirme que la raison doit être maîtresse de tous nos actes et la colère est une passion honteuse qui fait d’un homme une bête féroce. Un homme sage doit être au-dessus de toutes les injures et il doit y répondre avec la modération et la patience. Le maître de philosophie affirme ensuite que la philosophie domine tous les autres arts. La dispute reprend de plus belle entre les différents maîtres …..
Acte I, Scène 4, la fameuse scène du Bourgeois Gentilhomme, d'un M. Jourdain qui découvre la prose, "Par ma foi! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour; mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment..."
MAÎTRE de philosophie, monsieur Jourdain.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, en raccommodant son collet: Venons à notre leçon.
MONSIEUR JOURDAIN: Ah! Monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal, qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre?
MONSIEUR JOURDAIN: Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant; et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences, quand j'étais jeune.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Ce sentiment est raisonnable: nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela, et vous savez le latin sans doute.
MONSIEUR JOURDAIN: Oui, mais faites comme si je ne le savais pas: expliquez-moi ce que cela veut dire.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort.
MONSIEUR JOURDAIN: Ce latin-là a raison.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences?
MONSIEUR JOURDAIN: Oh! oui, je sais lire et écrire.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique?
MONSIEUR JOURDAIN: Qu'est-ce que c'est que cette logique?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit.
MONSIEUR JOURDAIN: Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La première, la seconde, et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories; et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures barbara, celarent, darii, ferio, baralipton, etc.
MONSIEUR JOURDAIN: Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus joli.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Voulez-vous apprendre la morale?
MONSIEUR JOURDAIN: La morale?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Oui.
MONSIEUR JOURDAIN: Qu'est-ce qu'elle dit cette morale?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions, et.
MONSIEUR JOURDAIN: Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables; et il n'y a morale qui tienne, je me veux mettre en colère tout mon soûl, quand il m'en prend envie.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Est-ce la physique que vous voulez apprendre?
MONSIEUR JOURDAIN: Qu'est-ce qu'elle chante cette physique?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles, et les propriétés du corps; qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons.
MONSIEUR JOURDAIN: Il y a trop de tintamarre là dedans, trop de brouillamini.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Que voulez-vous donc que je vous apprenne?
MONSIEUR JOURDAIN: Apprenez-moi l'orthographe.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Très volontiers.
MONSIEUR JOURDAIN: Après vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix; et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix: a, e, i, o, u.
MONSIEUR JOURDAIN: J'entends tout cela.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La voix A se forme en ouvrant fort la bouche: A.
MONSIEUR JOURDAIN: A, A. Oui.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut: A, E.
MONSIEUR JOURDAIN: A, E, A, E. Ma foi! oui. Ah! que cela est beau!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A, E, I.
MONSIEUR JOURDAIN: A, e, i, i, i, i. Cela est vrai. Vive la science!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La voix o se forme en rouvrant les mâchoires, et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas: o.
MONSIEUR JOURDAIN: O, o. Il n'y a rien de plus juste. A, e, i, o, i, o. Cela est admirable! I, o, i, o.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un o.
MONSIEUR JOURDAIN: O, o, o. Vous avez raison, o. Ah! la belle chose, que de savoir quelque chose!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: La voix u se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait: u.
MONSIEUR JOURDAIN: U, u. Il n'y a rien de plus véritable: u.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que: u.
MONSIEUR JOURDAIN: U, u. Cela est vrai. Ah! que n'ai-je étudié plus tôt, pour savoir tout cela?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes.
MONSIEUR JOURDAIN: Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: da.
MONSIEUR JOURDAIN: Da, da. Oui. Ah! les belles choses! les belles choses!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: fa.
MONSIEUR JOURDAIN: Fa, fa. C'est la vérité. Ah! mon père et ma mère, que je vous veux de mal!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Et l'r, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement: rra.
MONSIEUR JOURDAIN: R, r, ra; r, r, r, r, r, ra. Cela est vrai. Ah! l'habile homme que vous êtes! et que j'ai perdu de temps! R, r, r, ra.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.
MONSIEUR JOURDAIN: Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Fort bien.
MONSIEUR JOURDAIN: Cela sera galant, oui.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire?
MONSIEUR JOURDAIN: Non, non, point de vers.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Vous ne voulez que de la prose?
MONSIEUR JOURDAIN: Non, je ne veux ni prose ni vers.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Il faut bien que ce soit l'un, ou l'autre.
MONSIEUR JOURDAIN: Pourquoi?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Par la raison, Monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose, ou les vers.
MONSIEUR JOURDAIN: Il n'y a que la prose ou les vers?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Non, Monsieur: tout ce qui n'est point prose est vers; et tout ce qui n'est point vers est prose.
MONSIEUR JOURDAIN: Et comme l'on parle qu'est-ce que c'est donc que cela?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: De la prose.
MONSIEUR JOURDAIN: Quoi? quand je dis: "Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit" , c'est de la prose?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Oui, Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN: Par ma foi! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour; mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Mettre que les feux de ses yeux réduisent votre coeur en cendres; que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un.
MONSIEUR JOURDAIN: Non, non, non, je ne veux point tout cela; je ne veux que ce que je vous ai dit: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Il faut bien étendre un peu la chose.
MONSIEUR JOURDAIN: Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet; mais tournées à la mode; bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les diverses manières dont on les peut mettre.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: On les peut mettre premièrement comme vous avez dit: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien: D'amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos yeux beaux d'amour me font, belle Marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d'amour me font. Ou bien: Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d'amour.
MONSIEUR JOURDAIN: Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Celle que vous avez dite: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
MONSIEUR JOURDAIN: Cependant je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon coeur, et vous prie de venir demain de bonne heure.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: Je n'y manquerai pas.
MONSIEUR JOURDAIN: Comment? mon habit n'est point encore arrivé?
SECOND LAQUAIS: Non, Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN: Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur! Au diable le tailleur! La peste étouffe le tailleur! Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur...
Acte III - Qui sera donc le gendre de Monsieur Jourdain? Au moment d'aller en ville pour montrer son habit, Monsieur Jourdain essuie les moqueries de sa servante Nicole et les sarcasmes de sa femme, qui lui reproche de fréquenter les nobles, de négliger sa maison et de ne pas s'occuper du mariage de leur fille Lucile (scène III).
Madame Jourdain
Ah, ah ! voici une nouvelle histoire. Qu'est−ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage−là ? Vous moquez−vous du monde, de vous être fait enharnacher de la sorte ? et avez−vous envie qu'on se raille partout de vous ?
Monsieur Jourdain
Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi.
Madame Jourdain
Vraiment on n'a pas attendu jusqu'à cette heure, et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde.
Monsieur Jourdain
Qui est donc tout ce monde−là, s'il vous plaît ?
Madame Jourdain
Tout ce monde−là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison : on diroit qu'il est céans carême−prenant tous les jours ; et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé.
Nicole
Madame parle bien. Je ne saurois plus voir mon ménage propre ; avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville, pour l'apporter ici ; et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à frotter les planchers que vos biaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours.
Monsieur Jourdain
Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne.
Madame Jourdain
Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrois bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez.
Nicole
Et d'un grand maître tireur d'armes, qui vient, avec ses battements de pied, ébranler toute la maison, et nous déraciner tous les carriaux de notre salle ?
Monsieur Jourdain
Taisez−vous, ma servante, et ma femme.
Madame Jourdain
Est−ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes ?
Nicole
Est−ce que vous avez envie de tuer quelqu'un ?
Monsieur Jourdain
Taisez−vous, vous dis−je : vous êtes des ignorantes l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela.
Madame Jourdain
Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue.
Monsieur Jourdain
Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle ; mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses.
Nicole
J'ai encore ouï dire, Madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie.
Monsieur Jourdain
Fort bien : je veux avoir de l'esprit, et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens.
Madame Jourdain
N'irez−vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet, à votre âge ?
Monsieur Jourdain
Pourquoi non ? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collége
Nicole
Oui, ma foi ! cela vous rendroit la jambe bien mieux faite.
Monsieur Jourdain
Sans doute.
Madame Jourdain
Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison.
Monsieur Jourdain
Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez−vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure ?
Madame Jourdain
Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte.
Monsieur Jourdain
Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici ?
Madame Jourdain
Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère.
Monsieur Jourdain
Je ne parle pas de cela, vous dis−je. Je vous demande : ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure, qu'est−ce que c'est ?
Madame Jourdain
Des chansons.
Monsieur Jourdain
Hé non ! ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure ?
Madame Jourdain
Hé bien ?
Monsieur Jourdain
Comment est−ce que cela s'appelle ?
Madame Jourdain
Cela s'appelle comme on veut l'appeler.
Monsieur Jourdain
C'est de la prose, ignorante.
Madame Jourdain
De la prose ?
Monsieur Jourdain
Oui, de la prose. Tout ce qui est prose, n'est point vers ; et tout ce qui n'est point vers, n'est point prose. Heu, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais−tu bien comme il faut faire pour dire un U ?
Nicole
Comment ?
Monsieur Jourdain
Oui. Qu'est−ce que tu fais quand tu dis un U ?
Nicole
Quoi ?
Monsieur Jourdain
Dis un peu, U, pour voir ?
Nicole
Hé bien, U.
Monsieur Jourdain
Qu'est−ce que tu fais ?
Nicole
Je dis U.
Monsieur Jourdain
Oui ; mais quand tu dis U, qu'est−ce que tu fais ?
Nicole
Je fais ce que vous me dites.
Monsieur Jourdain
O l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes ! Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas : U, vois−tu ? U. Je fais la moue : U.
Nicole
Oui, cela est biau.
Madame Jourdain
Voilà qui est admirable.
Monsieur Jourdain
C'est bien autre chose, si vous aviez vu O, et Da, Da, et Fa, Fa.
Madame Jourdain
Qu'est−ce donc que tout ce galimatias−là ?
Nicole
De quoi est−ce que tout cela guérit ?
Monsieur Jourdain
J'enrage quand je vois des femmes ignorantes.
Madame Jourdain
Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens−là, avec leurs fariboles.
Nicole
Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes, qui remplit de poudre tout mon ménage.
Monsieur Jourdain
Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au coeur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. (Il fait apporter les fleurets et en donne un à Nicole.) Tiens. Raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela, et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué ; et cela n'est−il pas beau, d'être assuré de son fait, quand on se bat contre quelqu'un ? Là, pousse−moi un peu pour voir.
Nicole
Hé bien, quoi ?
(Nicole lui pousse plusieurs coups.)
Monsieur Jourdain
Tout beau, holà, oh ! doucement. Diantre soit la coquine !
Nicole
Vous me dites de pousser.
Monsieur Jourdain.
Oui ; mais tu me pousses en tierce, avant que de pousser en quarte, et tu n'as pas la patience que je pare.
Madame Jourdain
Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies, et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse.
Monsieur Jourdain
Lorsque je hante la noblesse, je fais paroître mon jugement, et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.
Madame Jourdain
Camon vraiment ! il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles, et vous avez bien opéré avec ce beau Monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné.
Monsieur Jourdain
Paix ! Songez à ce que vous dites. Savez−vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui ? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au Roi tout comme je vous parle. N'est−ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable, que l'on voye venir chez moi si souvent une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami, et me traite comme si j'étois son égal ? Il a pour moi des bontés qu'on ne devineroit jamais ; et, devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi−même confus.
Madame Jourdain
Oui, il a des bontés pour vous, et vous fait des caresses ; mais il vous emprunte votre argent.
Monsieur Jourdain
Hé bien ! ne m'est−ce pas de l'honneur, de prêter de l'argent à un homme de cette condition−là ? et puis−je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami ?
Madame Jourdain
Et ce seigneur que fait−il pour vous ?
Monsieur Jourdain
Des choses dont on seroit étonné, si on les savoit.
Madame Jourdain
Et quoi ?
Monsieur Jourdain
Baste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien, et avant qu'il soit peu.
Madame Jourdain
Oui, attendez−vous à cela.
Monsieur Jourdain
Assurément : ne me l'a−t−il pas dit ?
Madame Jourdain
Oui, oui : il ne manquera pas d'y faillir.
Monsieur Jourdain
Il m'a juré sa foi de gentilhomme.
Madame Jourdain
Chansons.
Monsieur Jourdain
Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr.
Madame Jourdain
Et moi, je suis sûre que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler.
Monsieur Jourdain
Taisez−vous : le voici.
Madame Jourdain
Il ne nous faut plus que cela. Il vient peut−être encore vous faire quelque emprunt ; et il me semble que j'ai dîné quand je le vois.
Monsieur Jourdain
Taisez−vous, vous dis−je.
Survient Dorante, ce seigneur qui parle de Monsieur Jourdain dans la chambre du roi, mais qui vit à ses dépens et abuse de sa crédulité. Au désespoir de sa femme, Monsieur Jourdain accepte encore de prêter de l'argent à Dorante, qui s'est chargé d'offrir une bague à cette fameuse marquise dont rêve le Bourgeois et dont on sait le nom : Dorimène (scène IV). Alors qu'il prépare la réception que Dorante veut offrir ù Dorimène aux frais de son bienfaiteur, Monsieur Jourdain, à demi découvert par son épouse et sa servante, quitte la place (scène VI). Surviennent Cléonte, amoureux de Lucile, et son valet Covielle, qui courtise Nicole. Une scène de dépit amoureux éclate entre les deux amants (scène X). Mais tout finit par une réconciliation et Madame Jourdain, qui soutient le parti de Cléonte, conseille a celui-ci de profiter du retour de Monsieur Jourdain pour lui demander la main de Lucile. Le malheureux jeune homme se
voit brutalement évincé parce qu'il a eu l`honnêteté de ne pas se faire passer pour gentilhomme (scène XII). Fureur de Madame Jourdain qui sort à la poursuite de son mari, tandis que Covielle propose à son jeune maître un stratagème. Dorante reparaît en compagnie de Dorimène, qui s'inquiète de toutes les dépenses qu'à ses yeux Dorante fait pour elle. Monsieur Jourdain se pavane devant Dorimène, qui ne comprend pas son manège (scène XIX). - Actes IV ET V. A la fin du festin, Madame Jourdain surgit pour interrompre les ridicules compliments dans lesquels s'empêtre Monsieur Jourdain. Outrée, Dorimène sort en compagnie de Dorante (acte IV, scène ll). La dispute entre les deux époux est à peine terminée qu'on voit arriver Covielle, déguisé en Turc, et qui annonce au Bourgeois épanoui que le fils du Grand Turc a vu Lucile, s'est follement épris d'elle et veut l'épouser sur le champ. Il s'agit bien entendu de Cléonte, également déguisé en Turc. Mais cela nécessite une petite cérémonie : il faut que Monsieur Jourdain soit, de la main de son futur gendre, élevé ù la dignité de "Mamamouchi" (acte IV, scène V). Monsieur Jourdain accepte, et la cérémonie a lieu en présence de Dorante, qui consent, dans son propre intérêt, à favoriser l'intrigue. A peine remis des coups de bâton qu'il a reçus durant la cérémonie, mais fier de son titre et de son turban, Monsieur Jourdain voit revenir son épouse, qui croit son mari devenu fou et veut l'empêcher de sortir (acte V, scène première). Elle sera, dans son entêtement, longue à découvrir la supercherie et à faire semblant de s'incliner (acte V, scène VII). L'action se termine donc par un triple mariage : le notaire viendra établir les contrats de Lucile et de Cléonte, de Dorimène et de Dorante, de Nicole et de Covielle. Monsieur Jourdain, que rien ne peut détromper, assistera, avec toute la compagnie, au fameux ballet qui avait été préparé...

1671 - "Les Fourberies de Scapin"
"Que diable allait-il faire dans cette galère?" - Cette comédie en 3 actes et en prose a été créée au Palais Royal le 24 mai 1671 . Elle s’inscrit dans la tradition de la comédie italienne dans laquelle Molière a déjà excellé au début de sa carrière (l'Étourdi, 1655) et vient à la suite des grandes pièces, le Tartuffe (1664), Dom Juan (1665), le Misanthrope (1666) . Elle ne connaît lors de sa création qu'un faible succès. Il est alors reproché à Molière la grossièreté de ses procédés comiques et l'immoralité du sujet. Boileau critique son côté populaire et Fénelon, l'exagération des caractères.
Naples. Octave a épousé en secret Hyacinthe, une jeune orpheline qu’il a rencontrée par hasard et dont il est tombé immédiatement amoureux. Il se désespère en raison du retour prématuré de son père Argante. En effet ce dernier, qui ignore ce mariage, souhaite le marier à la fille de son ami Géronte, une jeune inconnue qui a momentanément disparu. Le fils de Géronte, Léandre, est lui secrètement amoureux de Zerbinette une jeune esclave égyptienne. Cette dernière risque d’être enlevée si Léandre ne rachète pas rapidement sa liberté. Octave se confie à Scapin , le valet de son ami Léandre. Scapin est un valet rusé, jamais à court d’idées : « A vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du Ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberies; et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et j'ai renoncé à toutes choses depuis certain chagrin d'une affaire qui m'arriva ».
Touché par l’amour des deux jeunes gens et impatient d'essayer de nouvelles ruses , Scapin accepte de les aider. Il va s’attacher pour cela la collaboration de Silvestre, valet d’Octave. Le vieil Argante est fou de colère , car il vient d’apprendre le mariage secret de son fils et menace de le déshériter. C’est alors qu’intervient Scapin qui fait croire au vieil homme que son fils, ayant été surpris chez sa belle, n'a eu d'autre issue que de l’épouser. Tout n’est pas perdu, suggère le fourbe Scapin, car le frère de Hyacinthe serait prêt à un arrangement en échange d’une forte somme d’argent. La force de conviction de Scapin , puis les menaces physiques de ce prétendu frère ( en fait, Sylvestre, le valet complice, déguisé) parviennent à convaincre Argante. Il se résigne à donner les deux cents pistoles à Scapin……
Acte II, scène 7, "la scène de la galère" est célèbre, "Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je veux m'en mêler", s`écriait Scapin au début de la pièce, le voici en pleine action, Géronte, Scapin :
SCAPIN (feignant de ne pas voir Géronte)
O Ciel ! ô disgrâce imprévue ! ô misérable père ! Pauvre Géronte, que feras-tu ?
GERONTE
(à part) Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé ?
SCAPIN (même jeu)
N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte ?
GERONTE
Qu'y a-t-il, Scapin ?
SCAPIN (courant sur le théâtre, sans vouloir entendre ni voir Géronte)
Où pourrai-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ?
GERONTE (courant après Scapin)
Qu'est-ce que c'est donc ?
SCAPIN (même jeu)
En vain je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver.
GERONTE
Me voici.
SCAPIN (même jeu)
Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner.
GERONTE (arrêtant Scapin)
Holà ! es-tu aveugle, que tu ne me vois pas ?
SCAPIN
Ah ! Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer.
GERONTE
Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ?
SCAPIN
Monsieur...
GERONTE
Quoi ?
SCAPIN
Monsieur votre fils...
GERONTE
Hé bien ! mon fils...
SCAPIN
Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde.
GERONTE
Et quelle ?
SCAPIN
Je l'ai trouvé tantôt, tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, où vous m'avez mêlé assez mal à propos, et, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. La, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde.
GERONTE
Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ?
SCAPIN
Attendez, Monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que, si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure cinq cents écus, il va nous emmener votre fils en Alger.
GERONTE
Comment ! diantre, cinq cents écus !
SCAPIN
Oui, Monsieur ; et, de plus, il ne m'a donné pour cela que deux heures.
GERONTE
Ah ! le pendard de Turc ! m'assassiner de la façon !
SCAPIN
C'est à vous, Monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
GERONTE
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN
Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
GERONTE
Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
SCAPIN
La justice en peine mer ! Vous moquez-vous des gens ?
GERONTE
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN
Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
GERONTE
Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
SCAPIN
Quoi, Monsieur ?
GERONTE
Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils, et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande.
SCAPIN
Eh ! Monsieur, songez-vous à ce que vous dites ? et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ?
GERONTE
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN
Il ne devinait pas ce malheur. Songez, Monsieur, qu'il ne m'a donné que deux heures.
GERONTE
Tu dis qu'il demande...
SCAPIN
Cinq cents écus.
GERONTE
Cinq cents écus ! N'a-t-il point de conscience ?
SCAPIN
Vraiment oui, de la conscience à un Turc !
GERONTE
Sait-il bien ce que c'est que cinq cents écus ?
SCAPIN
Oui, Monsieur, il sait que c'est mille cinq cents livres.
GERONTE
Croit-il, le traître, que mille cinq cents livres se trouvent dans le pas d'un cheval ?
SCAPIN
Ce sont des gens qui n'entendent point de raison.
GERONTE
Mais que diable allait-il faire à cette galère ?
SCAPIN
Il est vrai ; mais quoi ! on ne prévoyait pas les choses. De grâce, Monsieur, dépêchez.
GERONTE
Tiens, voila la clef de mon armoire.
SCAPIN
Bon.
GERONTE
Tu l'ouvriras.
SCAPIN
Fort bien.
GERONTE
Tu trouveras une grosse clef du côté gauche, qui est celle de mon grenier.
SCAPIN
Oui.
GERONTE
Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras aux fripiers pour aller racheter mon fils.
SCAPIN (en lui rendant la clef)
Eh ! Monsieur, rêvez-vous ? Je n'aurais pas cent francs de tout ce que vous dites ; et, de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné.
GERONTE
Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN
Oh ! que de paroles perdues ! Laissez là cette galère, et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas ! mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger ! Mais le Ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père.
GERONTE
Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme.
SCAPIN
Dépêchez-vous donc vite, Monsieur, je tremble que l'heure ne sonne.
GERONTE
N'est-ce pas quatre cents écus que tu dis ?
SCAPIN
Non, cinq cents écus.
GERONTE
Cinq cents écus ?
SCAPIN
Oui.
GERONTE
Que diable allait-il faire à cette galère ?
SCAPIN
Vous avez raison. Mais hâtez-vous.
GERONTE
N'y avait-il point d'autre promenade ?
SCAPIN
Cela est vrai. Mais faites promptement.
GERONTE
Ah ! maudite galère !
SCAPIN
(à part) Cette galère lui tient au coeur.
GERONTE
Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. (Il lui présente sa bourse, qu'il ne laisse pourtant pas aller, et, dans ses transports, il fait aller son bras de côté et d'autre, et Scapin le sien pour avoir la bourse.) Tiens ! Va-t'en racheter mon fils.
SCAPIN (tendant la main)
Oui, Monsieur.
GERONTE (retenant la bourse qu'il fait semblant de vouloir donner à Scapin)
Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat.
SCAPIN (tendant toujours la main)
Oui.
GERONTE (même jeu)
Un infâme.
SCAPIN
Oui.
GERONTE (même jeu)
Un homme sans foi, un voleur.
SCAPIN
Laissez-moi faire.
GERONTE (même jeu)
Qu'il me tire cinq cents écus contre toute sorte de droit.
SCAPIN
Oui.
GERONTE (même jeu)
Que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie.
SCAPIN
Fort bien.
GERONTE
Et que, si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui.
SCAPIN
Oui.
GERONTE (remettant sa bourse dans sa poche et s'en allant)
Va, va vite requérir mon fils.
SCAPIN (allant après lui)
Holà ! Monsieur.
GERONTE
Quoi ?
SCAPIN
Où est donc cet argent ?
GERONTE
Ne te l'ai-je pas donné ?
SCAPIN
Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche.
GERONTE
Ah ! c'est la douleur qui me trouble l'esprit.
SCAPIN
Je le vois bien.
GERONTE
Que diable allait-il faire dans cette galère ? Ah ! maudite galère ! Traître de Turc à tous les diables !
SCAPIN (seul)
Il ne peut digérer les cinq cents écus que je lui arrache ; mais il n'est pas quitte envers moi, et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.
Acte III, scène II, c'est la scène du sac dans lequel Scapin a mis Géronte sous prétexte de le dérober à des spadassins, Scapin se venge ainsi de Géronte qui l'a dénoncé à Léandre et feint à plusieurs reprises d'être attaqué par les reîtres dont il imite la voix et frappe à coups redoublés sur le sac jusqu'au moment où sa fourberie est éventée...
GERONTE
Hé bien ! Scapin, comment va l'affaire de mon fils ?
SCAPIN
Votre fils, Monsieur, est en lieu de sûreté ; mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis.
GERONTE
Comment donc ?
SCAPIN
A l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer.
GERONTE
Moi ?
SCAPIN
Oui.
GERONTE
Et qui ?
SCAPIN
Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa soeur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage, et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous, et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même deçà et delà des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent, et occupent par pelotons toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni a gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains.
GERONTE
Que ferai-je, mon pauvre Scapin ?
SCAPIN
Je ne sais pas, Monsieur, et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête, et... Attendez. (Il se retourne, et fait semblant d'aller voir au bout du théâtre s'il n'y a personne.)
GERONTE (en tremblant)
Eh ?
SCAPIN (en revenant)
Non, non, non, ce n'est rien.
GERONTE
Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ?
SCAPIN
J'en imagine bien un ; mais je courrais risque, moi, de me faire assommer.
GERONTE
Eh ! Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie.
SCAPIN
Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours.
GERONTE
Tu en seras récompensé, je t'assure ; et je te promets cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé.
SCAPIN
Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac, et que...
GERONTE (croyant voir quelqu'un)
Ah !
SCAPIN
Non, non, non, non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans, et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main-forte contre la violence.
GERONTE
L'invention est bonne.
SCAPIN
La meilleure du monde. Vous allez voir. (A part.) Tu me paieras l'imposture.
GERONTE
Eh ?
SCAPIN
Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond, et surtout prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas, quelque chose qui puisse arriver.
GERONTE
Laisse-moi faire. Je saurai me tenir...
SCAPIN
Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. (En contrefaisant sa voix.) "Quoi ! jé n'aurai pas l'abantage dé tuer cé Géronte et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est ?" (A Géronte, avec sa voix ordinaire.) Ne branlez pas. (Reprenant son ton contrefait.) "Cadedis ! jé lé trouberai, se cachât-il au centre de la terre." (A Géronte, avec son ton naturel.) Ne vous montrez pas. (Tout le langage gascon est supposé de celui qu'il contrefait, et le reste de lui.) "Oh ! l'homme au sac. --Monsieur. --Jé té vaille un louis, et m'enseigne où peut être Géronte. --Vous cherchez le seigneur Géronte ? --Oui, mordi ! jé lé cherche. --Et pour quelle affaire, Monsieur ? --Pour quelle affaire ? --Oui. --Jé beux, cadédis ! lé faire mourir sous les coups de vâton. --Oh ! Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. --Qui, cé fat de Géronte, cé maraud, cé vélître ? --Le seigneur Géronte, Monsieur, n'est ni fat, ni maraud, ni bélître, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. --Comment ! tu mé traîtes, à moi, avec cette hauteur ? --Je défends, comme je dois, un homme d'honneur qu'on offense. --Est-ce que tu es des amis dé cé Géronte ? --Oui, Monsieur, j'en suis. --Ah ! cadédis ! tu es dé ses amis, à la vonne hure (Il donne plusieurs coups de bâton sur le sac.) Tiens ! boilà cé qué jé té vaille pour lui. Ah ! ah ! ah ! ah ! Monsieur. Ah ! ah ! Monsieur, tout beau ! Ah ! doucement, ah ! ah ! ah ! --Va, porte-lui cela dé ma part. Adiusias !" --Ah ! Diable soit le Gascon ! Ah ! (en se plaignant et remuant le dos, comme s'il avait reçu les coups de bâton).
GERONTE (mettant la tête hors du sac)
Ah ! Scapin, je n'en puis plus.
SCAPIN
Ah ! Monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable.
GERONTE
Comment ! c'est sur les miennes qu'il a frappé.
SCAPIN
Nenni, Monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait.
GERONTE
Que veux-tu dire ? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore.
SCAPIN
Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules.
GERONTE
Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner...
SCAPIN (lui remet la tête dans le sac)
Prenez garde, en voici un autre qui a la mine d'un étranger. (Cet endroit est de même que celui du Gascon pour le changement de langage et le jeu de théâtre.) "Parti, moi courir comme une Basque, et moi ne pouvre point troufair de tout le jour sti tiable de Gironte." (A Géronte, avec sa voix ordinaire.) Cachez-vous bien. "Dites-moi un peu, fous, Monsir l'homme, s'il ve plaît, fous savoir point où l'est sti Gironte que moi cherchair ? --Non, Monsieur, je ne sais point ou est Géronte. --Dites-moi-le, fous, frenchemente, moi li fouloir pas grande chose à lui. L'est seulemente pour le donnair une petite régal sur le dos d'une douzaine de coups de bâtonne, et de trois ou quatre petites coups d'épée au trafers de son poitrine. --Je vous assure, Monsieur, que je ne sais pas où il est. --Il me semble que j'y fois remuair quelque chose dans sti sac. --Pardonnez-moi, Monsieur. --Li est assurément quelque histoire là-tetans. --Point du tout, Monsieur. --Moi l'avoir enfie de tonner ain coup d'épée dans sti sac. --Ah ! Monsieur, gardez-vous-en bien. --Montre-le-moi un peu, fous, ce que c'être là. --Tout beau ! Monsieur. --Quement ? tout beau ? --Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. --Et moi, je le fouloir foir, moi. --Vous ne le verrez point. --Ah ! que de badinemente ! --Ce sont hardes qui m'appartiennent. --Montre-moi fous, te dis-je. --Je n'en ferai rien. --Toi ne faire rien ? --Non. --Moi pailler de ste bâtonne dessus les épaules de toi. --Je me moque de cela. --Ah ! toi faire le trôle ! --(Donnant des coups de bâton sur le sac et criant comme s'il les recevait.) --Ahi ! ahi ! ahi ! Ah ! Monsieur, ah ! ah ! ah ! --Jusqu'au refoir. L'être là un petit leçon pour li apprendre à toi à parlair insolentemente." --Ah ! Peste soit du baragouineux ! Ah !
GERONTE (sortant la tête du sac)
Ah ! je suis roué.
SCAPIN
Ah ! je suis mort.
GERONTE
Pourquoi diantre faut-il qu'ils frappent sur mon dos ?
SCAPIN (lui remettant la tête dans le sac)
Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. (Il contrefait plusieurs personnes ensemble.) "Allons, tâchons à trouver ce Géronte, cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Furetons de tous les côtés. Par où irons-nous ? Tournons par là. Non, par ici. A gauche. A droite. Nenni. Si fait." (A Géronte, avec sa voix ordinaire.) Cachez-vous bien. "Ah ! camarades, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. --Eh ! Messieurs, ne me maltraitez point. --Allons, dis-nous où il est. Parle. Hâte-toi. Expédions. Dépêche vite. Tôt. --Eh ! Messieurs, doucement. (Géronte met doucement la tête hors du sac et aperçoit la fourberie de Scapin.) --Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. --J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. --Nous allons t'assommer. --Faites tout ce qu'il vous plaira. --Tu as envie d'être battu ? --Je ne trahirai point mon maître. --Ah ! tu en veux tâter ? Voilà... --Oh !" (Comme il est prêt de frapper, Géronte sort du sac et Scapin s'enfuit.)
GERONTE
Ah ! infâme ! Ah ! traître ! Ah ! scélérat ! C'est ainsi que tu m'assassines ! "

1672 - "Les Femmes savantes"
Molière renoue enfin avec sa grande comédie humaine avec "Les Femmes Savantes", pièce à laquelle il travaillait depuis plus de deux ans et qui fut un succès. Pièce en cinq actes et en vers et comédie de mœurs, centrée sur le mariage d'Henriette et de Clitandre; elle fut créée au Théâtre du Palais-Royal le 11 mars 1672. Henriette et Clitandre sont amants, mais pour se marier, ils vont devoir obtenir le soutien de la famille de la jeune fille. Le père et l'oncle sont favorables au mariage ; mais la mère, Philaminte, soutenue par la tante et la sœur d'Henriette, veut lui faire épouser un faux savant aux dents longues, Trissotin, qui mène par le bout du nez ces « femmes savantes ».
Chrysale, bon bourgeois matérialiste, réprouve les éclats de son épouse, Philaminte, une maîtresse femme, ainsi que la pédanterie de Bélise, sa sœur, une vieille fille sentimentale, et de sa fille Armande, à l'esprit quelque peu calculateur. Ces trois beaux-esprits épris de poésie et de science, qui n'ont que dédain pour les choses domestiques, entendent renvoyer Martine, une servante qui commet le crime d'estropier la grammaire....
Acte I, scène 3 - Molière nous apporte ici le jugement d'un homme de bon sens sur les excès ridicules du snobisme de la science et des belles-lettres chez certaines bourgeoises de son temps et brosse le portrait bref mais vigoureux d'un "héros d'esprit", l'ineffable Trissotin. Mais il nous introduit aussi au sein d'une famille réelle, analyse les rapports entre le mari et la femme - à laquelle on ne résiste guère -, laisse voir la diplomatie intime d'Henriette, fine et avisée qui ne désire qu'une chose : être heureuse avec Clitandre qui l'aime et qu'elle aime. Ainsi nous ne suivons pas seulement une discussion d'idées; nous regardons vivre des hommes sensés ou ridicules, nous prenons parti, nous raillons ou nous aimons....
HENRIETTE
Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise.
CLITANDRE
Elle mérite assez une telle franchise,
Et toutes les hauteurs de sa folle fierté
Sont dignes tout au moins de ma sincérité.
Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père,
Madame.
HENRIETTE
Le plus sûr est de gagner ma mère:
Mon père est d'une humeur à consentir à tout,
Mais il met peu de poids aux choses qu'il résout;
Il a reçu du Ciel certaine bonté d'âme,
Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme;
C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu
Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu.
Je voudrais bien vous voir pour elle, et pour ma tante,
Une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante,
Un esprit qui, flattant les visions du leur,
Vous pût de leur estime attirer la chaleur.
CLITANDRE
Mon coeur n'a jamais pu, tant il est né sincère,
Même dans votre soeur flatter leur caractère,
Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût.
Je consens qu'une femme ait des clartés de tout;
Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante afin d'être savante;
Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait,
Elle sache ignorer les choses qu'elle sait;
De son étude enfin je veux qu'elle se cache,
Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache,
Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots,
Et clouer de l'esprit à ses moindres propos.
Je respecte beaucoup Madame votre mère;
Mais je ne puis du tout approuver sa chimère,
Et me rendre l'écho des choses qu'elle dit,
Aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit.
Son Monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme,
Et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme,
Qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits
Un benêt dont partout on siffle les écrits,
Un pédant dont on voit la plume libérale
D'officieux papiers fournir toute la halle.
HENRIETTE
Ses écrits, ses discours, tout m'en semble ennuyeux,
Et je me trouve assez votre goût et vos yeux;
Mais, comme sur ma mère il a grande puissance,
Vous devez vous forcer à quelque complaisance.
Un amant fait sa cour où s'attache son coeur,
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.
CLITANDRE
Oui, vous avez raison; mais Monsieur Trissotin
M'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin.
Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages,
À me déshonorer en prisant ses ouvrages;
C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru,
Et je le connaissais avant que l'avoir vu.
Je vis, dans le fatras des écrits qu'il nous donne,
Ce qu'étale en tous lieux sa pédante personne:
La constante hauteur de sa présomption,
Cette intrépidité de bonne opinion,
Cet indolent état de confiance extrême
Qui le rend en tout temps si content de soi-même,
Qui fait qu'à son mérite incessamment il rit,
Qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit,
Et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée
Contre tous les honneurs d'un général d'armée.
HENRIETTE
C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela.
Alors qu'Armande, dépitée par l'abandon de Clitandre qui s'est lassé de ses froideurs, affecte de mépriser le mariage, sa jeune sœur Henriette entend au contraire épouser ce même Clitandre, devenu amoureux d'elle. Mais Philaminte compte marier Henriette contre sa volonté à Trissotin, un poète pédant et intéressé qui profite du travers de ces femmes prétentieuses et qui se couvre de ridicule au cours d'un affrontement verbal avec l'helléniste Vadius...
Acte III, scène 3
Henriette
Excusez−moi, Monsieur, je n'entends pas le grec.
Philaminte
J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect.
Vadius
Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage
A vous rendre aujourd'hui, Madame, mon hommage,
Et j'aurai pu troubler quelque docte entretien.
Philaminte
Monsieur, avec du grec on ne peut gâter rien.
Trissotin
Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose,
Et pourroit, s'il vouloit, vous montrer quelque chose.
Vadius
Le défaut des auteurs, dans leurs productions,
C'est d'en tyranniser les conversations,
D'être au Palais, au Cours, aux ruelles, aux tables,
De leurs vers fatigants lecteurs infatigables.
Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens
Qu'un auteur qui partout va gueuser des encens,
Qui des premiers venus saisissant les oreilles,
En fait le plus souvent les martyrs de ses veilles.
On ne m'a jamais vu ce fol entêtement ;
Et d'un Grec là−dessus je suis le sentiment,
Qui, par un dogme exprès, défend à tous ses sages
L'indigne empressement de lire leurs ouvrages.
Voici de petits vers pour de jeunes amants,
Sur quoi je voudrois bien avoir vos sentiments.
Trissotin
Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres.
Vadius
Les Grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres.
Trissotin
Vous avez le tour libre, et le beau choix des mots.
Vadius
On voit partout chez vous l'ithos et le pathos.
Trissotin
Nous avons vu de vous des églogues d'un style
Qui passe en doux attraits Théocrite et Virgile
Vadius
Vos odes ont un air noble, galant et doux,
Qui laisse de bien loin votre Horace après vous.
Trissotin
Est−il rien d'amoureux comme vos chansonnettes ?
Vadius
Peut−on voir rien d'égal aux sonnets que vous faites ?
Trissotin
Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux ?
Vadius
Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux ?
Trissotin
Aux ballades surtout vous êtes admirable.
Vadius
Et dans les bouts−rimés je vous trouve adorable.
Trissotin
Si la France pouvoit connoître votre prix,
Vadius
Si le siècle rendoit justice aux beaux esprits,
Trissotin
En carrosse doré vous iriez par les rues.
Vadius
On verroit le public vous dresser des statues.
Hom ! C'est une ballade, et je veux que tout net
Vous m'en...
Trissotin
Avez−vous vu certain petit sonnet
Sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ?
Vadius
Oui, hier il me fut lu dans une compagnie.
Trissotin
Vous en savez l'auteur ?
Vadius
Non ; mais je sais fort bien
Qu'à ne le point flatter son sonnet ne vaut rien.
Trissotin
Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.
Vadius
Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable ;
Et, si vous l'avez vu, vous serez de mon goût.
Trissotin
Je sais que là−dessus je n'en suis point du tout,
Et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables.
Vadius
Me préserve le Ciel d'en faire de semblables !
Trissotin
Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur ;
Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur.
Vadius
Vous !
Trissotin
Moi.
Vadius
Je ne sais donc comment se fit l'affaire.
Trissotin
C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire.
Vadius
Il faut qu'en écoutant j'aye eu l'esprit distrait,
Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet.
Mais laissons ce discours et voyons ma ballade.
Trissotin
La ballade, à mon goût, est une chose fade.
Ce n'en est plus la mode ; elle sent son vieux temps.
Vadius
La ballade pourtant charme beaucoup de gens.
Trissotin
Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise.
Vadius
Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise.
Trissotin
Elle a pour les pédants de merveilleux appas.
Vadius
Cependant nous voyons qu'elle ne vous plaît pas.
Trissotin
Vous donnez sottement vos qualités aux autres.
Vadius
Fort impertinemment vous me jetez les vôtres.
Trissotin
Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.
Vadius
Allez, rimeur de balle, opprobre du métier.
Trissotin
Allez, fripier d'écrits, impudent plagiaire.
Vadius
Allez, cuistre...
Philaminte
Eh ! Messieurs, que prétendez−vous faire ?
Trissotin
Va, va restituer tous les honteux larcins
Que réclament sur toi les Grecs et les Latins.
Vadius
Va, va−t'en faire amende honorable au Parnasse
D'avoir fait à tes vers estropier Horace.
Trissotin
Souviens−toi de ton livre et de son peu de bruit.
Vadius
Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit.
Trissotin
Ma gloire est établie ; en vain tu la déchires.
Vadius
Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des Satires.
Trissotin
Je t'y renvoie aussi.
Vadius
J'ai le contentement
Qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement :
Il me donne, en passant, une atteinte légère,
Parmi plusieurs auteurs qu'au Palais on révère ;
Mais jamais, dans ses vers, il ne te laisse en paix,
Et l'on t'y voit partout être en butte à ses traits.
Trissotin
C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable.
Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable.
Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler,
Et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler ;
Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire
Sur qui tout son effort lui semble nécessaire ;
Et ses coups contre moi redoublés en tous lieux
Montrent qu'il ne se croit jamais victorieux.
Vadius
Ma plume t'apprendra quel homme je puis être.
Trissotin
Et la mienne saura te faire voir ton maître.
Vadius
Je te défie en vers, prose, grec, et latin.
Trissotin
Hé bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin.
Henriette, soutenue par son père, son oncle Ariste et la servante Martine, résiste à ce mariage, alors qu'au contraire Armande veut bien respecter la volonté de sa mère en épousant Clitandre, alors même que celui-ci n'a plus du tout de penchant pour elle. Deux clans vont alors s'opposer devant le notaire mandé pour les noces et l'on craint que le faible Chrysale ne cède devant la volonté de sa femme, quand on apprend que la famille est ruinée. Aussitôt, Trissotin se retire sans vergogne, alors que Clitandre redouble de zèle et d'amour pour Henriette; en fait, il ne s'agissait que d'une ruse d'Ariste destinée à démasquer le caractère intéressé de Trissotin et tout peut rentrer dans l'ordre : Henriette épouse Clitandre et Armande, fort dépitée, est invitée à se consoler avec la philosophie....

1673 - "Le Malade imaginaire"
La fin de la vie de Molière est marquée par la maladie, la perte de son fils, celle de sa vieille amie Madeleine Béjart, et par des difficultés matérielles et l'importance croissante d'un Lulli à qui Louis XIV accorde le monopole de la musique et des ballets. "Le Malade imaginaire" sera la dernière comédie écrite par Molière, une comédie-ballet en trois actes qui sera représentée au Théâtre du Palais-Royal le 10 février 1673 par la troupe de Molière. Elle puise son inspiration dans la commedia dell'arte, la musique est de Marc-Antoine Charpentier et les ballets de Pierre Beauchamp. La pièce est centrée sur le personnage d'Argan, un personnage délirant (il est le "malade imaginaire"), qui a décidé de marier sa fille Angélique à un médecin (Thomas Diafoirus), lequel médecin est le neveu de Monsieur Purgon, lui-même médecin d'Argan....
Pris d'une défaillance au cours de la quatrième représentation qu'il s'était obstiné à donner, - Molière lui-même jouait le rôle d'Argan -, il meurt quelques heures plus tard, il meurt en crachant le sang. Armande dut faire intervenir Louis XIV pour obtenir de l'archevêque des funérailles nocturnes et une sépulture chrétienne...
Acte II, Scène II
ARGAN : Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, douze allées, et douze venues ; mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long, ou en large.
TOINETTE : Monsieur, voilà un.
ARGAN : Parle bas, pendarde : tu viens m'ébranler tout le cerveau, et tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades.
TOINETTE : Je voulais vous dire, Monsieur.
ARGAN : Parle bas, te dis-je.
TOINETTE : Monsieur.
Elle fait semblant de parler.
ARGAN : Eh ?
TOINETTE : Je vous dis que.
Elle fait semblant de parler.
ARGAN : Qu'est-ce que tu dis ?
TOINETTE, haut : Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous.
ARGAN : Qu'il vienne.
Toinette fait signe à Cléante d'avancer.
CLÉANTE : Monsieur.
TOINETTE, raillant : Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de Monsieur.
CLÉANTE : Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux.
TOINETTE, feignant d'être en colère : Comment " qu'il se porte mieux " ? Cela est faux : Monsieur se porte toujours mal.
CLÉANTE : J'ai ouï dire que Monsieur était mieux, et je lui trouve bon visage.
TOINETTE : Que voulez-vous dire avec votre bon visage ? Monsieur l'a fort mauvais, et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté.
ARGAN : Elle a raison.
TOINETTE : Il marche, dort, mange, et boit tout comme les autres ; mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade.
ARGAN : Cela est vrai.
CLÉANTE : Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de Mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours ; et comme son ami intime, il m'envoie à sa place, pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant elle ne vînt à oublier ce qu'elle sait déjà.
ARGAN : Fort bien. Appelez Angélique.
TOINETTE : Je crois, Monsieur, qu'il sera mieux de mener Monsieur à sa chambre.
ARGAN : Non ; faites-la venir.
TOINETTE : Il ne pourra lui donner leçon comme il faut, s'ils ne sont en particulier.
ARGAN : Si fait, si fait.
TOINETTE : Monsieur, cela ne fera que vous étourdir, et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes, et vous ébranler le cerveau.
ARGAN : Point, point : j'aime la musique, et je serai bien aise de. Ah ! la voici. Allez-vous-en voir, vous, si ma femme est habillée.
"Que faire donc quand on est malade? - Rien, mon frère." - Acte III, scène 3, Béralde, l'interprète de Molière, fait une critique en règle de la médecine...
BÉRALDE: Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation.
ARGAN: Voilà qui est fait.
BÉRALDE: De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrai vous dire.
ARGAN: Oui.
BÉRALDE: Et de raisonner ensemble, sur les affaires dont nous avons à parler, avec un esprit détaché de toute passion.
ARGAN: Mon Dieu! oui. Voilà bien du préambule.
BÉRALDE: D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfants qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un convent?
ARGAN: D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble?
BÉRALDE: Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles, et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle ne fût ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses.
ARGAN: Oh çà! nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu: c'est elle qui fait tout le mal, et tout le monde lui en veut.
BÉRALDE: Non, mon frère; laissons-la là: c'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toute sorte d'intérêt, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable: cela est certain. N'en parlons point, et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin?
ARGAN: Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut.
BÉRALDE: Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente un parti plus sortable pour elle.
ARGAN: Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi.
BÉRALDE: Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, ou pour elle, ou pour vous?
ARGAN: Il doit être, mon frère, et pour elle, et pour moi, et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin.
BÉRALDE: Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire?
ARGAN: Pourquoi non?
BÉRALDE: Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature?
ARGAN: Comment l'entendez-vous, mon frère?
BÉRALDE: J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderais point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.
ARGAN: Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve, et que Monsieur Purgon dit que je succomberais, s'il était seulement trois jours sans prendre soin de moi?
BÉRALDE: Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous, qu'il vous envoiera en l'autre monde.
ARGAN: Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine?
BÉRALDE: Non, mon frère, et je ne vois pas que, pour son salut, il soit nécessaire d'y croire.
ARGAN: Quoi? vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde, et que tous les siècles ont révérée?
BÉRALDE: Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes; et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie, je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.
ARGAN: Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre?
BÉRALDE: Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusques ici, où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.
ARGAN: Les médecins ne savent donc rien, à votre compte?
BÉRALDE: Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser; mais, pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout.
ARGAN: Mais toujours faut-il demeurer d'accord que, sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres.
BÉRALDE: Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose; et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et des promesses pour des effets.
ARGAN: Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous; et nous voyons que, dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins.
BÉRALDE: C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art.
ARGAN: Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.
BÉRALDE: C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre Monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse: c'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds; un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner; qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile, et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire: c'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en un besoin il ferait à lui-même.
ARGAN: C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin venons au fait. Que faire donc quand on est malade?
BÉRALDE: Rien, mon frère.
ARGAN: Rien?
BÉRALDE: Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies.
ARGAN: Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses.
BÉRALDE: Mon Dieu! mon frère, ce sont pures idées, dont nous aimons à nous repaître; et, de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations, que nous venons à croire, parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions; lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le coeur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années: il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.
ARGAN: C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête, et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.
BÉRALDE: Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler: les plus habiles gens du monde; voyez-les faire: les plus ignorants de tous les hommes.
ARGAN: Hoy! Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois, et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet.
BÉRALDE: Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine; et chacun, à ses périls et fortune, peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et, pour vous divertir, vous mener voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière.
ARGAN: C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
BÉRALDE: Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine.
ARGAN: C'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine; voilà un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces Messieurs-là.
BÉRALDE: Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins.
ARGAN: Par la mort non de diable! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence; et quand il sera malade, je le laisserais mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirais: "crève, crève! cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la Faculté".
BÉRALDE: Vous voilà bien en colère contre lui.
ARGAN: Oui, c'est un malavisé, et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis.
BÉRALDE: Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours.
ARGAN: Tant pis pour lui s'il n'a point recours aux remèdes.
BÉRALDE: Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie; mais que, pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal.
ARGAN: Les sottes raisons que voilà! Tenez, mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal.
BÉRALDE: Je le veux bien, mon frère; et, pour changer de discours, je vous dirai que, sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un convent; que, pour le choix d'un gendre, il ne vous faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit, sur cette matière, s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage.
"....C'étoit le vendredi 17 février 1673, à dix heures du soir, une heure au plus après avoir quitté le théâtre, que Molière rendit ainsi le dernier soupir, âgé de cinquante et un ans un mois et deux ou trois jours. Le curé de Saint-Eustache, sa paroisse, lui refusa la sépulture ecclésiastique, comme n'ayant pas été réconcilié avec l'Eglise. La veuve de Molière adressa, le 20 février, une requête à l'archevêque de Paris, Harlay de Champvalon. Accompagnée du curé d'Auteuil, elle courut à Versailles se jeter aux pieds du roi; mais le bon curé saisit l'occasion pour se justifier lui-même du soupçon de jansénisme, et le roi le fit taire. Et puis, il faut tout dire , Molière étoit mort, il ne pouvoit plus désormais amuser Louis XIV; et l'égoïsme immense du monarque, cet égoïsme hideux, incurable, qui nous est mis à nu par Saint Simon, reprenoit le dessus. Louis XIV congédia brusquement le curé et la veuve ; en même temps il écrivit à l'archevêque d'aviser à quelque terme moyen. Il fut décidé qu'on accorderait un peu de terre, mais que le corps s'en irait directement et sans être présenté à l'église. Le 21 février, au soir, le corps, accompagné de deux ecclésiastiques, fut porté au cimetière de Saint-Joseph, rue Montmartre. Deux cents personnes environ suivoient, tenant chacune un flambeau ; il ne se chanta aucun chant funèbre. Dans la journée même des obsèques, la foule, toujours fanatique, s'étoit assemblée autour de la maison mortuaire avec des apparences hostiles; on la dissipa en lui jetant de l'argent. Il fut moins aisé de la dissiper au convoi de Louis XIV...." (Sainte-Beuve)
