- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Bernard de Fontenelle (1657-1757), "De l'origine des fables" (1684), "Entretiens sur la pluralité des mondes habités" (1686), "Histoire des Oracles" (1687), "Dialogue des Morts" - Fénelon (1651-1715), "Les Aventures de Télémaque" (1699), "Lettre à l'Académie" (1714) - ...
Last update 10/10/2021

Un frémissement de certains esprits en cette fin du XVIIe siècle. "La sédition s'allume peu à peu", une évolution progressive que Fénelon ose prévoir, presque incidemment, en condamnant l'absolutisme et le luxe d'un Roi qui s'apparente à un astre, le Soleil : "Avez-vous cherché à connaître, sans vous flatter, quelles sont les bornes de votre autorité. Ce que c'est que la royauté réglée par les lois? " (Examen de conscience).
Fontenelle, un "bel esprit" d’abord auteur de petits vers, de pastorales, de tragédies sans succès, semble avoir observé «le mouvement qui se fait continuellement dans l’esprit des peuples, ces goûts qui se succèdent insensiblement les uns les autres, cette espèce de guerre qu’ils se font en se chassant et en se détruisant, cette révolution éternelle d’opinions et de coutumes». Et poursuit-il, «ce n’est pas au hasard qu’un goût succède à un autre ; il y a ordinairement une liaison nécessaire mais cachée», et le bel esprit ne saurait se suffire à lui-même, le goût du "public" semble avoir insensiblement évoluer en cette fin du XVIIe siècle, l’astronomie intéresserait-elle désormais les marquises. Et comme incidemment, penser le monde en "scientifique" entraîne irrésistiblement le chute de la métaphysique...
(Nicolas de Largillière (1656–1746), Portrait de Fontenelle, Musée des Beaux-Arts de Chartres)
1687 - La littérature semble mener sa propre histoire, sur des sujets qui semblent d'une importante toute relative, alors que s'effrite tout un monde de la pensée. Ainsi, la Querelle des Anciens et des Modernes oppose pendant plusieurs années ceux qui se tournent vers les auteurs du passé (Boileau, Racine, La Fontaine, La Bruyère) et ceux qui veulent rompre avec ce passé (Perrault, Fontenelle). Au cours des dernières années du siècle, un mouvement, qui est le reflet d'un état d'esprit général, s'opère vers une émancipation de la pensée et de l'art. Nous verrons que l'ampleur du mouvement est plus important qu'il n'y paraît.
Mais dans un premier temps, c'est la remise en question le culte de l'Antiquité qui, depuis la Renaissance, n'a cessé de croître, qui semble poser question. En effet, les apports de la civilisation dans tous les domaines ouvraient des perspectives nouvelles sur le génie proprement «moderne» et certains esprits des plus hardis, tels Descartes et Pascal, en prônant les conquêtes de l'esprit humain, s'étaient faits partisans du progrès contre le préjugé rétrograde de la supériorité des Anciens...
Une vraie querelle éclata donc . On vit Charles Perrault, l'auteur des contes, déclarer la guerre aux Anciens et tenter de les démystifier : "Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous; Et l'on peut comparer, sans crainte d'être injuste Le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste..." On vit Boileau contre-attaquer avec de violentes épigrammes, telle celle-ci : "Sur ce qu'on avait lu à l'Académie des vers contre Homère et contre Virgile"
"Clio, vint l'autre jour, se plaindre au dieu des vers
Qu'en certain lieu de l'univers
On traitait d'auteurs froids, de poètes stériles,
Les Homères et les Virgiles.
« Cela ne saurait être; on s'est moqué de vous,
Reprit Apollon en courroux;
Où peut-on avoir dit une telle infamie?
Est-ce chez les Hurons, chez les Topinambous?
- C'est à Paris. - C'est donc dans l'hôpital des fous?
- Non, c'est au Louvre, en pleine Académie."
Cependant de 1688 à 1692, la défense des "Modernes" va leur assurer un solide succès. Leurs armes, plus eficaces que l'injure ou l'épigramme, seront des "raisons", autrement dit des arguments. "La Dígressíon sur les Anciens et les Modernes", de Fontenelle et les "Parallèles des Anciens et des Modernes", de Perrault sont publiés la même année, en 1688. Rejoignant Pascal (Fragment d'un Traité du vide, publié qu'en 1779), dans cette comparaison de l'humanité avec un seul homme, Fontenelle introduit dans la «querelle» un élément de réflexion philosophique :
"La nature a entre les mains une certaine pâte qui est toujours la même, qu'elle tourne et retourne sans cesse en mille façons, et dont elle forme les hommes, les animaux et les plantes; et certainement elle n'a point formé Platon, Démosthène, ni Homère d'une argile plus fine ni mieux préparée que nos philosophes, nos orateurs et nos poètes d'aujourd'hui...
La comparaison des hommes de tous les siècles à un seul homme peut s'étendre sur toute notre question des anciens et des modernes. Un bon esprit cultivé est, pour ainsi dire, composé de tous les esprits des siècles précédents; ce n'est qu'un même esprit qui s'est cultivé pendant tout ce temps-là. Ainsi cet homme, qui a vécu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, a eu son enfance, où il ne s'est occupé que des besoins les plus pressants de la vie, sa jeunesse où il a assez bien réussi aux choses d'imagination, telles que la poésie et l'éloquence, et où même il a commencé à raisonner, mais avec moins de solidité que de feu. Il est maintenant dans l'âge de la virilité, où il raisonne avec plus de force et plus de lumières que jamais...
Rien n'arrête tant le progrès des choses, rien ne borne tant les esprits, que l'admiration excessive des anciens. Parce qu'on s'était tout dévoué à l'autorité d'Aristote, et qu'on ne cherchait la vérité que dans ses écrits énigmatiques, et jamais dans la nature, non seulement la philosophie n'avançait en aucune façon, mais elle était tombée dans un abîme de galimatias et d'idées inintelligibles, d'où l'on a eu toutes les peines du monde à la retirer... Si l'on allait s'entêter un jour de Descartes et le mettre à la place d'Aristote, ce serait à peu près le même inconvénient..."
L'intelligence et la clairvoyance de Fontenelle devaient gagner l'opinion à la cause de son parti; la victoire des «Modernes» sera soulignée par son élection à l'Académie en 1691. Mais La Bruyère et Boileau reviendront à la charge : après une trêve plus apparente que réelle qui devait pourtant durer vingt ans, il y eut encore des escarmouches. Mais l'opinion avait changé.
Fénelon, que son respect pour les Anciens n'empêchait pas d'admirer ses contemporains, fut le conciliateur des deux partis. Il écrit dans sa Lettre sur les occupations de l'Académíe (1714) :
"Je n'ai garde de vouloir juger; je propose seulement aux hommes qui ornent notre siècle de ne mépriser point ceux que tant de siècles ont admirés. Je ne vante point les Anciens comme des modèles sans imperfection; je ne veux point ôter à personne l'espérance de les vaincre, je souhaite au contraire de voir les Modernes victorieux par l'étude des Anciens même qu'ils auront vaincus. Mais je croírais m'égarer au delà de mes bornes, si je me mêlais de juger jamais pour le prix entre les combattants...
C'était la fin de la querelle. Le XVIIIe siècle avec son ouverture aux problèmes politiques et sociaux et son sens des réalités contemporaines, consacrera la victoire définitive des «Modernes» : cette victoire aura des prolongements considérables.
"La Royauté réglée par des lois" - Et dans ce nouvel horizon qui se dessine progressivement, surgit un Fénelon, précurseur de Montesquieu et de Voltaire : chez aucun autre écrivain du XVIIe siècle le politique tiendra autant de place : "Lettre à Louis XIV" (1694), "Télémaque" (1695), "De l'Examen de conscience d'un roi" et ses "Tables de Chaulnes" (1711) reflètent son rejet de l'absolutisme, de l'égoïsme et du despotisme d'un roi-soleil qui ne parle ni n'évoque que son 'bon-plaisir" et qui jette par son exemple une société dans la corruption des âmes les plus "pures" : "vous rapportez tout à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre et que tout le reste n'eût été créé que pour vous être sacrifié. C'est au contraire vous que Dieu n'a mis au monde que pour votre peuple..."

Avec Fontenelle en illustrateur, l'Art de raisonner d'un Descartes aboutit, par un singulier retournement de situation, à installer en cette fin du XVIIe siècle deux orientations d'une même logique de notre connaissance à venir, l'élaboration de la pensée scientifique et la ruine de la Métaphysique, une scission qui va s'installer définitivement dans notre paysage intellectuel et notre corps social, deviendra une thématique permanente de la construction de notre discours scientifique occidental : une scission qui pourtant était loin de paraître aussi évidente que cela...
Comment la pensée de Descartes, en ce début du siècle, qui était parvenu, semble-t-il, à élaborer une rationalité, des principes et une métaphysique supportant la religion, a-t-elle pu se retourner contre elle en un demi-siècle, entre le "Discours de la Méthode" (1637), et les "Entretiens sur la pluralité des mondes" (1686). Fontenelle, aujourd'hui comme jadis, peu écouté, est un maillon important dans l'histoire de la pensée humaine, au moins dans sa version française, qui mène à ce retour de réflexion. La Querelle des Anciens et des Modernes est certes une curiosité littéraire que l'on aime évoquer, mais Fontenelle qui, sans doute, n'a pas écrit l'ouvrage fondamental que l'on pouvait espérer de lui, pose le moment clé de cette histoire fondatrice du Siècle des Lumières.
Descartes demande à la géométrie le modèle d'une méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, à user en tout de sa raison le mieux qu'il se peut, à concevoir plus nettement et distinctement ses objets, bref à ne recevoir pour vrai que ce que l'on connaît évidemment être tel. Mais, observe Fontenelle dans la "Préface à son Histoire de l'Académie des Sciences (1702), où il rend hommage au philosophe comme "ayant donné le ton à tout son siècle" par "le nouvel art de raisonner" qu'il a établi : "L'esprit géométrique n'est pas si attaché à la géométrie qu'il n'en puisse être tiré et transporté à d'autres connaissances. Un ouvrage de morale, de politique, de critique, peut-être même d'éloquence, en sera plus beau, toutes choses d'ailleurs égales, s'il est fait de main de géomètre. L'ordre, la netteté, la précision, l'exactitude qui règnent dans les bons livres depuis un certain temps pourraient bien avoir leur première source dans cet esprit géométrique et qui se répand plus que jamais" (Préface sur l'utilité des mathématiques et de la physique, Fontenelle). En fait, il apparaît rapidement qu'on ne peut appliquer le nouvel art de raisonner aux vérités de la foi comme à toutes les autres, nous avons changé de monde...
Fontenelle, un "inquiet" en philosophie, un "curieux" en sciences, esprit subtil, ingénieux, dégagé des opinions et des coutumes que le goût du jour adopte mais qui sont en "révolution éternelle" (Sur l'Histoire), soucieux de connaître toutes choses, et surtout le fond des choses, leurs liaisons et leurs appartenances; Fontenelle, dont La Bruyère, dans le cruel
portrait qu'il a tracé de lui sous le nom de Lydias, "composé du pédant et du précieux", disait : "Entrez dans son magasin, il y a à choisir", mais qui sut pourtant, en homme d'esprit, presque en grand esprit, faire lui-même un choix, et, tout en se gardant de "divulguer nos mystères dans le peuple", le proposer, avec tous les agréments dont il sait le parer, à une "petite troupe choisie" de femmes, de beaux esprits, d'esprits cultivés, avides de mieux connaître cette science partout à la mode, qu'il s'agit de ramener à sa véritable destination. (Jacques Chevalier).
C'est à quoi il va s'efforcer dans son "Histoire des oracles" (1687) et dans l'opuscule "sur L'origine des fables", où il dénonce ce combat, avec des armes acérées dont il fait un prudent usage, cet amour du merveilleux et des fables, fruit de l'ignorance, maintenues par l`habitude, qui constitue le principal obstacle à la science, ainsi qu'on le voit "pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait". C'est à quoi vont viser ses "Entretiens sur la pluralité des mondes", de peu antérieurs (1686), où Fontenelle s'attache à montrer dans la science le modèle de la certitude, le point d'appui stable de toutes nos connaissances. Et dans le même temps, la configuration intellectuelle mesurant par excellence la petitesse de l'homme comparée à l'immensité de l'univers, et sa "folie de croire que toute la nature, sans exception, est destinée à nos usages".
Or, de qui tient-il ces vérités majeures qui, selon lui, éclairent tout l'homme et sa situation dans le monde? De Copernic, à qui il sait "bon gré d'avoir rabattu la vanité des hommes, qui s'étaient mis à la plus belle place de l'univers". Mais encore, et surtout, de Descartes. C'est Descartes qui lui a appris que "tout le jeu de la nature consiste dans les figures et dans les mouvements des corps". A la physique cartésienne, dans laquelle Pierre Bayle ne voyait qu'une "hypothèse ingénieuse" (1681), et à laquelle Voltaire oppose et préfère le système de Newton (Lettres philosophiques XIV et XV), Fontenelle demeura fidèle jusqu'au bout, puisque à l'âge de quatre-vingt-quinze ans il écrivait encore à la défense de Descartes sa Théorie des tourbillons avec des réflexions sur l'attraction (1752).
A cette même date, un La Mettrie, un Helvétius et un d'Holbach, tiraient du mécanisme de Descartes, séparé de son auteur, Dieu, de toutes autres conclusions. Ainsi, plus encore que de la science, c'est de la méthode cartésienne que se recommande Fontenelle, et, avec lui, singulièrement, tout le XVIIIe siècle. Parlant de Descartes et de ce qu'il a appris de lui, Fontenelle écrit: "C'est lui, à ce qu'il me semble, qui a amené cette nouvelle méthode de raisonner, beaucoup plus estimable que sa philosophie même, dont une bonne partie se trouve fausse ou incertaine selon les propres règles qu'il ne nous pas apprises" (Digressions sur les anciens et les modernes)..
De Descartes, on retient donc la méthode. Et de la méthode cartésienne, prise comme norme, on retient une règle : celle de l'évidence, ou des idées claires et distinctes. Pour Descartes, le type des idées claires et distinctes, c'est l'idée de Dieu, c'est l'idée de notre âme : idées qui ne sont ni adventices, ni factices, mais véritablement innées, en ce sens qu'elles sont toujours en nous, en puissance du moins, qu'elles existent indépendamment de notre pensée et s'imposent à elle. En effet, dit-il, il n'y a "rien au monde qui soit de soi plus évident et plus certain que l'existence de Dieu", laquelle est "la première et la plus essentielle de toutes les vérités qui peuvent être et la seule d'où procèdent toutes les autres"; et s'il y en a "plusieurs qui se persuadent qu'il y a de la difficulté à le connaître", c'est "qu'ils n'élèvent jamais leur esprit au-delà des choses sensibles, et qu'ils sont tellement accoutumés à ne rien considérer qu'en l'imaginant, qui est une façon de penser particulière pour les choses matérielles, que tout ce qui n'est pas imaginable leur semble n'être pas intelligible... tout de même que si, pour ouïr les sons ou sentir les odeurs, ils se voulaient servir de leurs yeux ..." (Discours de la méthode).
Mais voilà, le monde a changé, les "philosophes" de cette fin du XVIIe ont appris, à l'école des Anglais, a à s'en tenir aux données sensibles, et à taxer de "métaphysique", c'est-à-dire de "chimérique", toute tentative de les dépasser. La véritable métaphysique ne va plus au-delà...
(La Famille du Grand Dauphin, 1687, peinture de Pierre Mignard, Musée national du Château, Versailles)

Bernard de Fontenelle (1657-1757)
Sainte-Beuve écrit, dans le troisième volume de ses Causeries du lundi : « Il y a deux Fontenelle très distincts, bien que, dans une étude attentive, on n'ait pas de peine à retrouver toujours l'un jusqu'au milieu de l'autre. Il y a le Fontenelle bel esprit, coquet, pincé, damoiseau, fade auteur d'églogues et d'opéras, rédacteur du Mercure galant, en guerre ou en chicane avec les Racine, les Despréaux, les La Fontaine; le Fontenelle loué par de Visé et flagellé par La Bruyère; et à travers ce Fontenelle primitif, à l'esprit mince, au goût détestable, il y en a un autre qui s'annonce de bonne heure et se dégage lentement, patiemment, mais avec sûreté, fermeté et certitude; le Fontenelle disciple de Descartes en liberté d'esprit et en étendue d'horizon, l'homme le plus dénué de toute idée préconçue, de toute prévention dans l'ordre de la pensée et dans les matières de l'entendement; com- prenant le monde moderne et l'instrument, en partie nouveau, de raisonnement exact et perfectionné qu'on y exige, s'en servant avec finesse, avec justesse et précision, y insinuant l'agrément qui fait pardonner la rigueur et qui y réconcilie les moins sévères; en un mot, il y a le Fontenelle, non plus des ruelles ni de l'Opéra, mais de l'Académie des sciences, le premier et le plus digne organe de ces corps savants que lui-même a conçus dans toute leur grandeur et leur universalité, quand il les a nommés les Etats généraux de la littérature et de l'intelligence. »
Bernard le Bovier de Fontenelle, natif de Rouen, neveu de Thomas Corneille, vient très tôt à Paris; esprit fort intelligent et curieux, il est aussi un homme du monde et des salons (Mme de Lambert, Mme de Tencin, Mme Geoffrin), un bel de profession type tel que LaBruyère les détestait. Il écrit des vers précieux, collabore au Mercure Galant, s'intéresse au théâtre. Coup sur coup il écrit en 1686, la "Relation de l'île de Bornéo", les "Entretiens dur la pluralité des Mondes" et l' "Histoire des Oracles", des oeuvres de vulgarisation et de critique qui le rendent célèbre. Il intervient de même dans la querelle sur l'interprétation de la philosophie de René Descartes qui oppose Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche (Doutes sur le système physique des causes occasionales, 1686).
Élu à l'Académie française en 1691, il prend résolument le parti des Modernes contre les Anciens, et montre sa confiance dans les progrès de l'humanité et la diffusion des connaissances (Digression sur les Anciens et les Modernes, 1688). Membre de l'Académie des Sciences, il joue un grand rôle dans la vulgarisation des connaissances nouvelles et s'efforce de mettre l'astronomie à la portée du public cultivé, les "Entretiens sur la pluralité des mondes" en constituent l'exemple le plus célèbre. En 1727, il publie une "Géométrie de l'Infini" et en 1752, il édite une "Théorie des Tourbillons cartésiens"....
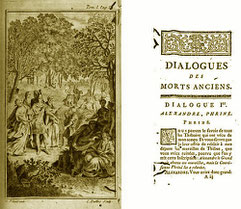
1683 - "Les Dialogues des morts"
"Vous imaginez que l'esprit humain ne cherche que le vrai?" - L'action la plus durable du Fontenelle bel esprit et vulgarisateur critique est celle qu'il exerce comme philosophe ou plutôt comme maître à penser. Dès 1683, le "Dialogue des morts", où apparaissent Socrate, Montaigne, Sénèque, Lulle, constitue une sorte de manuel du scepticisme. "L'Histoire des oracles", inspiré de l'ouvrage historique d'un médecin hollandais, est en fait un catalogue de toutes les erreurs humaines touchant la prédiction de l'avenir, et par suite tout le "merveilleux" des religions antiques...
" HOMERE, ESOPE
Homère. — En vérité, toutes les fables que vous venez de me réciter ne peuvent être assez admirées. Il faut que vous ayez beaucoup d'art, pour déguiser ainsi en petits contes les instructions les plus importantes que la morale puisse donner, et pour couvrir vos pensées sous des images aussi justes et aussi familières que celles-là.
Ésope. — Il m'est bien doux d'être loué sur cet art, par vous qui l'avez si bien entendu.
Homère. — Moi? je ne m'en suis jamais piqué.
Ésope. — Quoi! n'avez-vous pas prétendu cacher de grands mystères dans vos ouvrages?
Homère. — Hélas! point du tout.
Ésope. — Cependant, tous les savants de mon temps le disaient; il n'y avait rien dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée à quoi ils ne donnassent les allégories les plus belles du monde. Ils soutenaient que tous les secrets de la théologie, de la physique, de la morale, et des mathématiques même, étaient renfermés dans ce que vous aviez écrit. Véritablement il y avait quelque difficulté à les développer; où l'un trouvait un sens moral, l'autre en trouvait un physique : mais après cela, ils convenaient que vous aviez tout su, et tout dit à qui le comprenait bien.
Homère. — Sans mentir, je m'étais bien douté que de certaines gens ne manqueraient point d'entendre finesse où je n'en avais point entendu. Comme il n'est rien tel que de prophétiser des choses éloignées, en attendant l'événement, il n'est rien. tel aussi que de débiter des fables, en attendant l'allégorie.
Ésope. — Il fallait que vous fussiez bien hardi, pour vous reposer sur vos lecteurs du soin de mettre des allégories dans vos poèmes. Où en eussiez-vous été, si on les eût pris au pied de la lettre?
Homère. — Hé bien, ce n'eût pas été un grand malheur.
Ésope. — Quoi! ces dieux qui s'estropient les uns les autres; ce foudroyant Jupiter qui, dans une assemblée de divinités, menace l'auguste Junon de la battre; ce Mars, qui étant blessé par Diomède, crie, dites-vous, comme neuf ou dix mille hommes, et n'agit pas comme un seul (car au lieu de mettre tous les Grecs en pièces, il s'amuse à s'aller plaindre de sa blessure à Jupiter); tout cela eût été bon sans allégorie !
Homère. — Pourquoi non? Vous imaginez que l'esprit humain ne cherche que le vrai; détrompez-vous. L'esprit humain et le faux sympathisent extrêmement. Si vous avez la vérité à dire, vous ferez fort bien de l'envelopper dans des fables; elle en plaira beaucoup plus. Si vous voulez dire des fables, elles pourront bien plaire, sans contenir aucune vérité. Ainsi, le vrai a besoin d'emprunter la figure du faux, pour être agréablement reçu dans l'esprit humain : mais le faux y entre bien sous sa propre figure ; car c'est le lieu de sa naissance et de sa demeure ordinaire, et le vrai y est étranger. Je vous dirai bien plus : quand je me fusse tué à imaginer des fables allégoriques, il eût bien pu arriver que la plupart des gens auraient pris la fable comme une chose qui n'eût point été trop hors d'apparence, auraient laissé là l'allégorie ; et, en effet, vous devez savoir que mes dieux, tels qu'ils sont, et tous mystères à part, n'ont point été trouvés ridicules.
Ésope. — Cela me fait trembler; je crains furieusement que l'on ne croie que les bêtes aient parlé, comme elles font dans mes apologues.
Homère. — Voilà une plaisante peur.
Esope. - Hé quoi, si on a bien cru que les dieux aient pu tenir les discours que vous leur avait fait tenir, pourquoi ne croira-t-on pas que les bêtes aient parlé de la manière dont je les ai fait parler?
Homère. — Ah! ce n'est pas la même chose. Les hommes veulent bien que les dieux soient aussi fous qu'eux; mais ils ne veulent pas que les bêtes soient aussi sages.
SOCRATE, MONTAIGNE
Montaigne. — C'est donc vous, divin Socrate? Que j'ai de joie de vous voir ! Je suis tout fraîchement venu en ce pays-ci, et dès mon arrivée, je me suis mis à vous y chercher. Enfin, après avoir rempli mon livre de votre nom et de vos éloges, je puis m'entretenir avec vous, et apprendre comment vous possédiez cette vertu si naïve, dont les allures étaient si naturelles, et qui n'avaient point d'exemple, même dans les heureux siècles où vous viviez.
Socrate. — Je suis bien aise de voir un mort qui me paraît avoir été philosophe : mais comme vous êtes nouvellement venu de là-haut, et qu'il y longtemps que je n'ai vu ici personne (car on me laisse assez seul, il n'y a pas beaucoup de presse à rechercher ma conversation), trouvez bon que je vous demande des nouvelles. Comment va le monde? N'est- il pas bien changé?
Montaigne. — Extrêmement. Vous ne le connaîtriez pas.
Socrate. — J'en suis ravi. Je m'étais toujours bien douté qu'il fallait qu'il devînt meilleur et plus sage qu'il n'était de mon temps,
Montaigne. — Que voulez-vous dire? il est plus fou et plus corrompu qu'il n'a jamais été. C'est le changement dont je voulais parler, et je m'attendais bien à savoir de vous l'histoire du temps que vous avez vu, et où régnait tant de probité et de droiture.
Socrate. — Et moi, je m'attendais au contraire à apprendre des merveilles du siècle où vous venez de vivre. Quoi! les hommes d'à présent ne se sont point corrigés des sottises de l'antiquité?
Montaigne. — Je crois que c'est parce que vous êtes ancien, que vous parlez de l'antiquité si familièrement; mais sachez qu'on a grand sujet d'en regretter les mœurs, et que de jour en jour tout empire.
Socrate. — Cela se peut-il? Il me semble que de mon temps les choses allaient déjà bien de travers. Je croyais qu'à la fin, elles prendraient un train plus raisonnable, et que les hommes profiteraient de l'expérience de tant d'années.
Montaigne. — Eh! les hommes l'ont-ils des expériences? Ils sont faits comme les oiseaux, qui se laissent toujours prendre dans les mêmes filets où l'on a déjà pris cent mille oiseaux de leur espèce. Il n'y a personne qui n'entre tout neuf dans la vie, et les sottises des pères sont perdues pour les enfants.
Socrate. — Mais quoi, ne fait-on point d'expérience? Je croirais que le monde devrait avoir une vieillesse plus sage et plus réglée que n'a été sa jeunesse.
Montaigne. — Les hommes de tous les siècles ont les mêmes penchants, sur lesquels la raison n'a aucun pouvoir. Ainsi, partout où il y a des hommes, il y a des sottises, et les mêmes sottises.
Socrate. — Et sur ce pied-là, comment voudriez-vous que les siècles de l'antiquité eussent mieux valu que le siècle d'aujourd'hui?
Montaigne. — Ah I Socrate, je savais bien que vous aviez une manière particulière de raisonner, et d'envelopper si adroitement ceux à qui vous aviez affaire, dans les arguments dont ils ne prévoyaient pas la conclusion, que vous les ameniez où il vous plaisait; et c'est ce que vous appeliez être la sage-femme de leurs pensées, et les faire accoucher. J'avoue que me voilà accouché d'une proposition toute contraire à celle que j'avançais : cependant, je ne saurais encore me rendre. Il est sûr qu'il ne se trouve plus de ces âmes vigoureuses et roides de l'antiquité, des Aristide, des Phocion, des Périclès, ni enfin des Socrate.
Socrate. — A quoi tient-il? Est-ce que la nature s'est épuisée, et qu'elle n'a plus la force de produire ces grandes âmes? Et pourquoi se serait-elle encore épuisée en rien, hormis en hommes raisonnables? Aucun de ses ouvrages n'a encore dégénéré ; pourquoi n'y aurait-il que les hommes qui dégénérassent?
Montaigne. — C'est un point de fait; ils dégénèrent. Il semble que la nature nous ait autrefois montré quelques échantillons de grands hommes, pour nous persuader qu'elle en aurait su faire, si elle avait voulu, et qu'ensuite elle ait fait tout le reste avec assez de négligence.
Socrate. — Prenez garde à une chose. L'antiquité est un objet d'une espèce particulière; l'éloignement le grossit. Si vous eussiez connu Aristide, Phocion, Périclès et moi, puisque vous voulez me mettre de ce nombre, vous eussiez trouvé dans votre siècle des gens qui nous ressemblaient. Ce qui fait d'ordinaire qu'on est si prévenu pour l'antiquité, c'est qu'on a du chagrin contre son siècle, et l'antiquité en profite. On met les anciens bien haut, pour abaisser ses contemporains. Quand nous vivions, nous estimions nos ancêtres plus qu'ils ne méritaient; et à présent, notre postérité nous estime plus que nous ne méritons : mais et nos ancêtres, et nous, et notre postérité, tout cela est bien égal; et je crois que le spectacle du monde serait bien ennuyeux pour qui le regarderait d'un certain œil, car c'est toujours la même chose.
Montaigne. — J'aurais cru que tout était en mouvement, que tout changeait, et que les siècles différents avaient leurs différents caractères, comme les hommes. En effet, ne voit-on pas des siècles savants, et d'autres qui sont ignorants? n'en voit-on pas de sérieux et de badins, de polis et de grossiers?
Socrate. — Il est vrai.
Montaigne. — Et pourquoi donc n'y aurait-il pas des siècles plus vertueux, et d'autres plus méchants?
Socrate. — Ce n'est pas une conséquence. Les habits changent; mais ce n'est pas à dire que la figure des corps change aussi. La politesse ou la grossièreté, la science ou l'ignorance, le plus ou le moins d'une certaine naïveté, le génie sérieux ou badin, ce ne sont là que les dehors de l'homme, et tout cela change : mais le cœur ne change point, et tout l'homme est dans le cœur. On est ignorant dans un siècle, mais la mode d'être savant peut venir, on est intéressé, mais la mode d'être désintéressé ne viendra point. Sur ce nombre prodigieux d'hommes assez déraisonnables qui naissent en cent ans, la nature en a peut-être deux ou trois douzaines de raisonnables, qu'il faut qu'elle répande par toute la terre; et vous jugez bien qu'ils ne se trouvent jamais nulle part en assez grande quantité, pour y faire une mode de vertu et de droiture.
Montaigne. — Cette distribution d'hommes raisonnables se fait-elle également? Il pourrait y avoir des siècles mieux partagés les uns que les autres.
Socrate. — Tout au plus il y aurait quelque inégalité imperceptible. L'ordre général de la nature a l'air bien constant.
STRATON, RAPHAËL D'URBIN
Straton. — Je ne m'attendais pas que le conseil que je donnai à mon esclave dût produire des effets si heureux. Il me valut là-haut la vie et la royauté tout ensemble; et ici, il m'attire l'admiration de tous les sages.
Raphaël d'Urbin. — Et quel est ce conseil?
Straton. — J'étais à Tyr. Tous les esclaves de cette ville se révoltèrent, et égorgèrent leurs maîtres; mais un esclave que j'avais eut assez d'humanité pour épargner ma vie, et pour me dérober à la fureur de tous les autres. Ils convinrent de choisir pour roi celui d'entre eux, qui, à un certain jour, apercevrait le premier le lever du soleil. Ils s'assemblèrent dans une campagne. Toute cette multitude avait les yeux attachés sur la partie orientale du ciel, d'où le soleil devait sortir : mon esclave seul, que j'avais instruit de ce qu'il avait à faire, regardait vers l'occident. Vous ne doutez pas que les autres ne le traitassent de fou. Cependant, en leur tournant le dos, il vit les premiers rayons du soleil qui paraissent sur le haut d'une tour fort élevée, et ses compagnons en étaient encore à chercher vers l'orient le corps même du
soleil. On admira la subtilité d'esprit qu'il avait eue; mais il avoua qu'il me la devait, et que je vivais encore, et aussitôt je fus élu roi comme un homme divin.
Raphaël d'Urbin. — Je vois bien que le conseil que vous donnâtes à votre esclave vous fut fort inutile; mais je ne vois pas ce qu'il avait d'admirable.
Straton. — Ah ! tous les philosophes qui sont ici vous répondront pour moi, que j'appris à mon esclave ce que tous les sages doivent pratiquer; que pour trouver la vérité, il faut tourner le dos à la multitude, et que les opinions communes sont la règle des opinions saines, pourvu qu'on les prenne à contresens.
Raphaël d'Urbin. — Ces philosophes-là parlent bien en philosophes. C'est leur métier de médire des opinions communes et des préjugés; cependant il n'y a rien de plus commode, ni de plus utile.
Straton. — A la manière dont vous en parlez, on devine bien que vous ne vous êtes pas mal trouvé de les suivre.
Raphaël d'Urbln. — Je vous assure que si je me déclare pour les préjugés, c'est sans intérêt; car, au contraire, ils me donnèrent dans le monde un assez grand ridicule. On travaillait à Rome dans les ruines pour en retirer des statues, et comme j'étais bon sculpteur et bon peintre, on m'avait choisi pour juger si elles étaient antiques. Michel-Ange, qui était mon concurrent, fit secrètement une statue de Bacchus parfaitement belle. Il lui rompit un doigt après l'avoir faite, et l'enfouit dans un lieu où il savait qu'on devait creuser. Dès qu'on l'eut trouvée, je déclarai qu'elle était antique. Michel-Ange soutint que c'était une figure moderne. Je me fondais principalement sur la beauté de la statue, qui, dans les principes de l'art, méritait de venir d'une main grecque; et à force d'être contredit, je poussai le Bacchus jusqu'au temps de Polyclète ou de Phidias. A la fin, Michel-Ange montra le doigt rompu, ce qui était un raisonnement sans réplique. On se moqua de ma préoccupation; mais sans cette préoccupation, qu'eussé-je fait? J'étais juge, et cette qualité veut qu'on décide.
Straton. — Vous eussiez décidé selon la raison.
Raphaël d'Urbin — Et la raison décide-t-elle? Je n'eusse jamais su en la consultant, si la statue était antique ou non ; j'eusse seulement su qu'elle était très belle : mais le préjugé vient au secours, qui me dit qu'une belle statue doit être antique : voilà une décision et je juge.
Straton. — Il se pourrait bien faire que la raison ne fournirait pas des principes incontestables sur des matières aussi peu importantes que celles-là: mais sur tout ce qui regarde la conduite des hommes, elle a des décisions très sûres; le malheur est qu'on ne la consulte pas.
Raphaël d'Urbin. — Consultons-la sur quelque point, pour voir ce quelle établira. Demandons-lui s'il faut qu'on pleure ou qu'on rie à la mort de ses amis et de ses parents. D'un côté, vous dira-t-elle, ils sont perdus pour vous; pleurez. D'un autre côté, ils sont délivrés des misères de la vie; riez. Voilà des réponses de la raison; mais la coutume du pays nous détermine. Nous pleurons, si elle nous l'ordonne : et nous pleurons si bien, que nous ne concevons pas qu'on puisse rire sur ce sujet-là : ou nous en rions, et nous en rions si bien, que nous ne concevons pas qu'on puisse pleurer.
Straton. — La raison n'est pas toujours si irrésolue. Elle laisse à faire au préjugé ce qui ne mérite pas qu'elle le fasse elle-même; mais sur combien de choses très considérables a-t-elle des idées nettes, d'où elle tire des conséquences qui ne le sont pas moins?
Raphael d'Urbln. — Je suis fort trompé si elles ne sont en petit nombre, ces idées nettes.
Straton. — Il n'importe; on ne doit ajouter qu'à elles une foi entière.
Raphael d'Urbin. — Cela ne se peut, parce que la raison nous propose un trop petit nombre de maximes certaines, et que notre esprit est fait pour en croire davantage. Ainsi, le surplus de son inclination à croire va au profit des préjugés, et les fausses opinions achèvent de la remplir.
Straton. — Et quel besoin de se jeter dans l'erreur? Ne peut-on pas dans les choses douteuses suspendre son jugement? La raison s'arrête, quand elle ne sait quel chemin prendre.
Raphael d'Urbin. — Vous dites vrai; elle n'a point alors d'autres secrets, pour ne point s'écarter, que de ne pas faire un seul pas; mais cette situation est un état violent pour l'esprit humain; il est en mouvement, il faut qu'il aille. Tout le monde ne sait pas douter : on a besoin de lumières pour y parvenir, et de force pour s'en tenir là. D'ailleurs, le doute est sans action, et il faut de l'action parmi les hommes.
Straton. — Aussi doit-on conserver les préjugés de la coutume pour agir comme un autre homme; mais on doit se défaire des préjugés de l'esprit, pour penser en homme sage.
Raphael d'Urbin. — Il vaut mieux les conserver tous. Vous ignorez apparemment les deux réponses de ce vieillard Samnite, à qui ceux de sa nation envoyèrent demander ce qu'ils avaient à faire, quand ils eurent enfermé dans le pas des Fourches Caudines toute l'armée des Romains, leurs ennemis mortels, et qu'ils furent en pouvoir d'ordonner souverainement de leur destinée. Le vieillard répondit que l'on passât au fil de l'épée tous les Romains. Son avis parut trop dur et trop cruel, et les Samnites renvoyèrent vers lui pour lui en représenter les inconvénients. Il répondit que l'on donnât la vie à tous les Romains sans condition. On ne suivit ni l'un ni l'autre conseil, et on s'en trouva mal. Il en va de même des préjugés; il faut les conserver tous, ou les exterminer tous absolument. Autrement, ceux dont vous vous êtes défait vous font entrer en défiance de toutes les opinions qui vous restent. Le malheur d'être trompé sur bien des choses, n'est pas récompensé par le plaisir de l'être sans le savoir; et vous n'avez ni les lumières de la vérité, ni l'agrément de l'erreur.
Straton. — S'il n'y a pas de moyen d'éviter l'alternative que vous proposez, on ne doit pas balancer à prendre son parti. Il faut se défaire de tous ses préjugés.
Raphaël d'Urbin. — Mais la raison chassera de notre esprit toutes ces anciennes opinions, et n'en mettra pas d'autres en la place. Elle y causera une espèce de vide. Et qui peut le soutenir? Non, non, avec aussi peu de raison qu'en ont tous les hommes, il leur faut autant de préjugés qu'ils ont accoutumé d'en avoir. Les préjugés sont le supplément de la raison. Tout ce qui manque d'un côté on le trouve de l'autre.
FERNAND CORTEZ, MONTEZUME
Fernand Cortez. — Avouez la vérité. Vous étiez bien grossiers, vous autres Américains, quand vous preniez les Espagnols pour des hommes descendus de la sphère du feu, parce qu'ils avaient du canon, et quand leurs navires vous paraissaient de grands oiseaux qui volaient sur la mer.
Montézume. — J'en tombe d'accord. Mais je veux vous demander si c'était un peuple poli que les Athéniens.
Fernand Cortez. — Comment! ce sont eux qui ont enseigné la politesse au reste des hommes.
Montézume. — Et que dites-vous de la manière dont se servit le tyran Pisistrate pour rentrer dans la citadelle d'Athènes, d'où il avait été chassé? N'habilla-t-il pas une femme en Minerve (car on dit que Minerve était la déesse qui protégeait Athènes)? Ne monta-t-il pas sur un chariot avec cette déesse de sa façon, qui traversa toute la ville avec lui, en le tenant par la main, et en criant aux Athéniens : "Voici Pisistrate que je vous amène, et que je vous ordonne de recevoir?" Et ce peuple, si habile et si spirituel, ne se soumit-il pas à ce tyran, pour plaire à Minerve, qui s'en était expliquée de sa propre bouche?
Fernand Cortez. — Qui vous en a tant appris sur le chapitre des Athéniens?
Montézume. — Depuis que je suis ici, je me suis mis à étudier l'histoire par les conversations que j'ai eues avec différents morts. Mais enfin, vous conviendrez que les Athéniens étaient un peu plus dupes que nous. Nous n'avions jamais vu de navires ni de canons : mais ils avaient vu des femmes ; et quand Pisistrate entreprit de les réduire sous son obéissance parle moyen de sa déesse, il leur marqua assurément moins d'estime, que vous ne nous en marquâtes en nous subjuguant avec votre artillerie.
Fernand Cortez. — Il n'y a point de peuple qui ne puisse donner une fois dans un panneau grossier. On est surpris; la multitude entraîne les gens de bon sens. Que vous dirai-je? Il se joint encore à cela des circonstances qu'on ne peut pas deviner, et qu'on ne remarquerait peut-être pas, quand on les verrait.
Montézume. — Mais a-ce été par surprise que les Grecs ont cru dans tous les temps, que la science de l'avenir était contenue dans un trou souterrain, d'où elle sortait en exhalaisons? Et par quel artifice leur avait-on persuadé, que quand la lune était éclipsée ils pouvaient la faire revenir de son évanouissement par un bruit effroyable? Et pourquoi n'y avait-il qu'un petit nombre de gens qui osassent se dire à l'oreille, qu'elle était obscurcie par l'ombre de la terre? Je ne dis rien des Romains, et de ces dieux qu'ils priaient à manger dans leurs jours de réjouissances, et de ces poulets sacrés, dont l'appétit décidait de tout dans la capitale du monde. Enfin, vous ne sauriez me reprocher une sottise de nos peuples d'Amérique, que je ne vous en fournisse une plus grande de vos contrées; et même je m'engage à ne vous mettre en ligne de compte que des sottises grecques ou romaines.
Fernand Cortez. — Avec ces sottises-là cependant les Grecs et les Romains ont inventé tous les arts et toutes les sciences, dont vous n'aviez pas la moindre idée.
Montézume. — Nous étions bien heureux d'ignorer qu'il y eût des sciences au monde; nous n'eussions peut-être pas eu assez de raison pour nous empêcher d'être savants. On n'est pas toujours capable de suivre l'exemple de ceux d'entre les Grecs qui apportèrent tant de soins à se préserver de la contagion des sciences de leurs voisins. Pour les arts, l'Amérique avait trouvé des moyens de s'en passer, plus admirables peut-être que les arts mêmes de l'Europe. Il est aisé de faire des histoires, quand on sait écrire, mais nous ne savions point écrire, et nous faisions des histoires. On peut faire des ponts, quand on sait bâtir dans l'eau; mais la difficulté est de n'y savoir point bâtir, et de faire des ponts. Vous devez vous souvenir que les Espagnols ont trouvé dans nos terres des énigmes où ils n'ont rien entendu; je veux dire, par exemple, des pierres prodigieuses, qu'ils ne concevaient pas qu'on eût pu élever sans machines aussi haut qu'elles étaient élevées. Que dites-vous à tout cela? Il me semble que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas trop bien prouvé les avantages de l'Europe sur l'Amérique.
Fernand Cortez. — Ils sont assez prouvés par tout ce qui peut distinguer les peuples polis d'avec les peuples barbares. La civilité règne parmi nous; la force et la violence n'y ont point de lieu; toutes les puissances y sont modérées par la justice; toutes les guerres y sont fondées sur des causes légitimes; et môme, voyez à quel point nous sommes scrupuleux, nous n'allâmes porter la guerre dans votre pays, qu'après que nous eûmes examiné fort rigoureusement s'il nous appartenait, et décidé cette question pour nous.
Montézume. — Sans doute, c'était traiter des barbares avec plus d'égards qu'ils ne méritaient; mais je crois que vous êtes civils et justes les uns avec les autres, comme vous étiez scrupuleux avec nous. Qui ôterait à l'Europe ses formalités, la rendrait bien semblable à l'Amérique. La civilité mesure tous vos pas, dicte toutes vos paroles, embarrasse tous vos discours, et gêne toutes vos actions; mais elle ne va point jusqu'à vos sentiments; et toute la justice qui devrait se trouver dans vos desseins, ne se trouve que dans vos prétextes.
Fernand Cortez. — Je ne vous garantis point les cœurs : on ne voit les hommes que par dehors. Un héritier qui perd un parent, et gagne beaucoup de bien, prend un habit noir. Est-il bien affligé? Non, apparemment. Cependant, s'il ne le prenait pas, il blesserait la raison.
Montézume. — J'entends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas la raison qui gouverne parmi vous, mais du moins elle fait sa protestation que les choses devraient aller autrement qu'elles ne vont; que les héritiers, par exemple, devraient regretter leurs parents : ils reçoivent cette protestation; et pour lui en donner acte, ils prennent un habit noir. Vos formalités ne servent qu'à marquer un droit qu'elle a, et que vous ne lui laissez pas exercer; et vous ne faites pas, mais vous représentez ce que vous devriez faire.
Fernand Cortez. — N'est-ce pas beaucoup? La raison a si peu de pouvoir chez vous, qu'elle ne peut seulement rien mettre dans vos actions, qui vous avertisse de ce qui y devrait être.
Montézume. — Mais vous vous souvenez d'elle aussi inutilement, que de certains Grecs dont on m'a parlé ici, se souvenaient de leur origine. Ils s'étaient établis dans la Toscane, pays barbare selon eux, et peu à peu ils en avaient si bien pris les coutumes, qu'ils avaient oublié les leurs. Ils sentaient pourtant je ne sais quel déplaisir d'être devenus barbares, et tous les ans, à certain jour, ils s'assemblaient : ils lisaient en grec les anciennes lois qu'ils ne suivaient plus, et qu'à peine entendaient-ils encore; ils pleuraient, et puis se séparaient. Au sortir de là, ils reprenaient gaiement la manière de vivre du pays. Il était question chez eux des lois grecques comme chez vous de la raison. Ils savaient que ces lois étaient au monde; ils en faisaient mention, mais légèrement et sans fruit : encore les regrettaient-ils en quelque sorte; mais pour la raison que vous avez abandonnée vous ne la regrettez point du tout. Vous avez pris l'habitude de la connaître et de la mépriser.
Fernand Cortez. — Du moins, quand on la connaît mieux, on est bien plus en état de la suivre.
Montézume. — Ce n'est donc que par cet endroit que nous vous cédons? Ah I que n'avions-nous des vaisseaux pour aller découvrir vos terres, et que ne nous avisions-nous de décider qu'elles nous appartenaient! Nous eussions eu autant de droit de les conquérir, que vous en eûtes de conquérir les nôtres.

1684 - "De l'Origine des Fables"
Court traité dans lequel Fontenelle attribue la croyance au surnaturel à l'ignorance des premiers hommes, et ces "fables" constituent toute "l'histoire des erreurs de l'esprit humain" : "tous les hommes se ressemblent si fort qu'il n'y a point de peuple dont les sottises ne doivent nous faire trembler". Et de la critique des mythes païens au christianisme, il n'y qu'un pas que Fontenelle ne franchit pas encore : critiquant les suppositions par lesquelles les chrétiens des premiers siècles attribuaient les oracles païens aux démons, il ajoutera non sans prudence, dans L'Histoire des Oracle, qu'il "ne prétend point par là affaiblir l'autorité, ni attaquer le mérite de ces grands hommes, "mais que "si avec les vrais titres de notre religion ils nous en ont laissé d'autres qui peuvent être suspects, c'est à nous à ne recevoir d'eux que ce qui est légitime, et à pardonner à leur zèle de nous avoir fourni plus de titres qu'il ne nous en faut..."
"On nous a si fort accoutumés pendant notre enfance aux fables des Grecs que, quand nous sommes en état de raisonner. Nous ne nous avisons plus de les trouver aussi étonnantes qu'elles le sont. Mais si l'on vient à se défaire des yeux de l'habitude, il ne se peut qu'on ne soit épouvanté de voir toute l'ancienne histoire d'un peuple qui n'est qu'un amas de chimères, de rêveries et d'absurdités. Serait-il possible qu'on eût donné tout cela pour vrai ? A quel dessein nous l'aurait-on donné pour faux ? Quel aurait été cet amour des hommes pour des faussetés manifestes et ridicules et pourquoi ne durerait-il plus? Car les fables des Grecs n'étaient pas comme les romans qu'on nous donne pour ce qu'ils sont et non pas pour des histoires ; il n'y a pas d'autre histoire ancienne que les fables. Éclaircissons, s'il se peut, cette matière; étudions l'esprit humain dans une de ses plus étranges productions; c'est là, bien souvent, qu'il se donne le mieux à connaître... Les premiers hommes ont raconté à leurs enfants des choses fausses pour cette raison que l'on a besoin d'une espèce d'effort et d'une attention particulière pour dire exactement la vérité. De plus, croira-t-on ce que je vais dire? Il y a eu de la philosophie même dans ces siècles grossiers et elle a beaucoup servi à la naissance des fables. Les hommes qui ont un peu plus de génie que les autres sont naturellement portés à rechercher la cause de ce qu'ils voient. D'où peut venir cette rivière qui coule toujours? a dû dire un contemplatif de ces siècles-là. Étrange sorte de philosophe ; mais qui aurait peut-être été un Descartes dans ce siècle-ci. Après une longue méditation, il a trouvé fort heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait soin de verser toujours cette eau de dedans une cruche. Mais qui lui fournissait toujours cette eau? Le contemplatif n'allait pas si loin. [De même] pour rendre raison des tonnerres et des foudres, on se représentait volontiers un Dieu de figure humaine lançant sur nous des flèches de feu, idée manifestement prise sur des objets très familiers.
... De cette philosophie grossière qui régna nécessairement dans les premiers siècles sont nés les dieux et les déesses. Les hommes voyaient bien des choses qu'ils n'eussent pas pu faire : lancer les foudres, exciter les vents, agiter les flots de la mer, tout cela était beaucoup au-dessus de leur pouvoir; ils imaginèrent des êtres plus puissants qu'eux et capables de produire ces grands effets. Il fallait bien que ces êtres-là fussent faits comme des hommes; quelle autre figure auraient-ils pu avoir ? Et, du moment qu'ils sont de figure humaine, l'imagination leur attribue naturellement tout ce qui est humain ; les voilà hommes en toutes manières, à cela près qu'ils sont toujours un peu plus puissants que les hommes.
LES DIEUX BRUTES
De là vient une chose à laquelle on n'a peut-être pas encore fait réflexion : c'est que, dans toutes les divinités que les païens ont imaginées, ils y ont fait dominer l'idée de pouvoir et n'ont eu presque aucun égard ni à la sagesse, ni à la justice, ni à tous les autres attributs qui suivent la nature divine. Rien ne prouve mieux que ces divinités sont fort anciennes et ne marque mieux le chemin que l'imagination a suivi en les formant. Les premiers hommes ne connaissaient point de plus belle qualité que la force du corps, la sagesse et la justice n'avaient pas seulement de nom dans les langues anciennes, comme elles n'en ont pas encore aujourd'hui chez les barbares de l'Amérique. D'ailleurs, la première idée que les hommes prirent de quelque être supérieur, ils la prirent sur des effets extraordinaires, et nullement sur l'ordre réglé de l'univers qu'ils n'étaient point capables de reconnaître et d'admirer. Ainsi ils imaginèrent des dieux dans un temps où ils n'avaient rien de plus beau à leur donner que du pouvoir, et ils les imaginèrent sur ce qui portait des marques de pouvoir et non sur ce qui en portait de sagesse. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient imaginé plusieurs dieux, souvent opposés les uns aux autres, cruels, bizarres, injustes, ignorants; tout cela n'est pas directement contraire à l'idée de force et de pouvoir, qui est la seule
qu'ils eussent prise... Cicéron a dit quelque part qu'il aurait mieux aimé qu'Homère eût transporté les qualités des dieux aux hommes, que de transporter comme il l'a fait les qualités des hommes aux dieux; mais Cicéron en demandait trop ; ce qu'il appelait en son temps les qualités des dieux n'était nullement connu du temps d'Homère. Les païens ont toujours copié leurs divinités d'après eux-mêmes; ainsi, à mesure que les hommes sont devenus plus parfaits, les dieux le sont devenus aussi davantage. Les premiers hommes sont fort brutaux et ils donnent tout à la force; les dieux seront presque aussi brutaux et seulement un peu plus puissants : voilà les dieux d'Homère.
Les hommes commencent à avoir des idées de la sagesse et de la justice ; les dieux y gagnent ; ils commencent à être sages et justes et le sont toujours de plus en plus à mesure que ces idées se perfectionnent parmi les hommes : voilà les dieux du temps de Cicéron et ils valaient bien mieux que ceux du temps d'Homère, parce que de bien meilleurs philosophes y avaient mis la main.
LA FORMATION SPONTANÉE DES HISTOIRES FABULEUSES
Nous allons voir maintenant que sur ces fondements les hommes ont en quelque sorte pris plaisir à se tromper eux-mêmes. Ce que nous appelons la philosophie des premiers siècles se trouve tout à fait propre à se lier à l'histoire des faits. Un jeune homme est tombé dans une rivière et l'on ne saurait retrouver son corps. Qu'est-il devenu? La philosophie enseigne qu'il y a dans cette rivière de jeunes filles qui la gouvernent; les jeunes filles ont enlevé le jeune homme; cela est tout naturel ; on n'a pas besoin de preuves pour le croire. Un homme dont on ne connaît pas la naissance a quelque talent extraordinaire; il y a des dieux qui sont faits comme les hommes ; on n'examine pas davantage qui sont ses parents ; il est fils de quelqu'un de ces dieux-là. Que l'on considère la plus grande partie des fables, on trouvera qu'elles ne sont qu'un mélange de faits avec la philosophie du temps qui expliquait commodément ce que les faits avaient de merveilleux et qui se liait avec eux très naturellement. Comme les histoires de faits véritables, mêlées de ces fausses imaginations, eurent beaucoup de cours on commença à en forger qui étaient sans aucun fondement, ou, tout au moins, on ne remarqua plus les faits un peu remarquables sans les revêtir des ornements que l'un avait reconnus qui étaient propres à plaire. Ces ornements étaient faux, peut-être même que quelquefois on les donnait pour tels, et cependant les histoires ne passaient pas pour être fabuleuses.
Cela s'entendra par une comparaison de notre histoire moderne avec l'ancienne. Dans les temps où l'on a eu le plus d'esprit, comme dans le siècle d'Auguste et dans celui-ci, on a aimé à raisonner sur les actions des hommes, à en pénétrer les motifs et à en connaître les caractères. Les historiens de ces siècles se sont accommodés à ce goût; ils se sont bien gardés d'écrire les faits nûment et sèchement; ils les ont accompagnés de motifs et y ont mêlé des portraits de leurs personnages. Croyons-nous que ces portraits et ces motifs soient exactement vrais? Y avons-nous la même foi qu'aux faits? Non, nous savons fort bien que les historiens les ont devinés comme ils ont pu et qu'il est presque impossible qu'ils aient deviné tout à fait juste. Cependant, nous ne trouvons pas mauvais que les historiens aient recherché cet embellissement qui ne sort point de la vraisemblance, et c'est à cause de cette vraisemblance que ce mélange de faux que nous reconnaissons qui peut être dans nos histoires, ne nous les fait pas regarder comme des fables. De même, après que, par les voies que nous avons dites, les anciens peuples eurent pris le goût de ces histoires où il entrait des dieux, des déesses et en général du merveilleux, on ne débita plus d'histoires qui n'en fussent ornées. On savait que cela pouvait n''être pas vrai; mais, en ces temps-là, il était vraisemblable, et c'en était assez pour conserver à ces fables la qualité d'histoires. Encore aujourd'hui les Arabes remplissent leurs histoires de prodiges et de miracles, le plus souvent ridicules et grotesques. Sans doute cela n'est pris chez eux que pour des ornements auxquels on n'a garde d'être trompé parce que c'est entre eux une espèce de convention d'agir ainsi. Mais quand ces sortes d'histoires passent chez d'autres peuples qui ont le goût de vouloir qu'on écrive les faits dans leur exacte vérité, ou elles sont crues au pied de la lettre, ou du moins on se persuade qu'elles ont été crues par ceux qui les ont publiées et par ceux qui- les ont reçues sans contradiction. Certainement le malentendu est considérable..."

1686 - "L'Histoire des Oracles"
Secret des oracles, imposture des prêtres - Fontenelle prend ici une attitude vraiment scientifique et philosophique : il n'admet que les vérités observées et démontrées. Aussi étudie-t-il de façon critique les croyances antérieures au christianisme. Il s'arrête là, mais sous-entend que la même méthode peut bien s'appliquer aussi au christianisme...
"Quand la Pythie se mettait sur le trépied, c'était dans son sanctuaire, lieu obscur et éloigné d'une petite chambre où se tenaient ceux qui venaient consulter l'oracle. L'ouverture même de ce sanctuaire était couverte de feuillages de laurier; et ceux à qui on permettait d'en approcher n'avaient garde d'y rien voir. D 'où croyez-vous que vienne la diversité avec laquelle les anciens parlent de la forme de leurs Oracles? C'est qu'ils ne voyaient point ce qui se passait dans le fond de leurs temples. Par exemple, ils ne s'accordent point les uns avec les autres sur l 'oracle de Dodone (ancienne ville d'Epire où se trouvait un temple de Zeus)) ; et cependant que devait-il y avoir de plus connu des Grecs? Aristote, au rapport de Suidas, dit qu'à Dodone il y a deux colonnes, sur l'une desquelles est un bassin d'airain, et sur l'autre la statue d'un enfant qui tient un fouet, dont les cordes étant aussi d'airain, font du bruit contre le bassin, lorsqu'elles y sont poussées par le vent. Démon, selon le même Suidas, dit que l'oracle de Jupiter Dodonéen est tout environné de bassins qui, aussitôt que l'un est poussé contre l'autre, se communiquent ce mouvement en rond, et font un bruit qui dure assez de temps. D 'autres disent que c'était un chêne résonnant qui secouait ses branches et ses feuilles lorsqu'il était consulté, et qui déclarait ses volontés par des prêtresses nommées Dodonides.
Il paraît bien, par tout cela, qu'il n'y avait que le bruit de constant, parce qu'on l'entendait du dehors; mais comme on ne voyait point le dedans du lieu où se rendait l'oracle, on ne savait que par conjecture ou par le rapport infidèle des prêtres ce qui causait le bruit. Il se trouve pourtant dans l'histoire que quelques personnes ont eu le privilège d'entrer dans ces sanctuaires; mais ce n'était pas des gens moins considérables qu'Alexandre et Vespasien. Strabon rapporte de Callisthène qu'Alexandre entra seul avec le prêtre dans le sanctuaire d'Ammon et que tous les autres n'entendirent l'oracle que du dehors.
Tacite dit aussi que Vespasien, étant à Alexandrie et ayant déjà des desseins sur l'empire, voulut consulter l'oracle de Sérapis; mais qu'il fit auparavant sortir tout le monde du temple. Peut-être cependant n'entra-t-il pas pour cela dans le sanctuaire. A ce compte, les exemples
d'un tel privilège seront très rares; car mon auteur avoue qu'il n'en connaît point d'autres que ces deux-là, si ce n'est peut-être qu'on veuille ajouter ce que Tacite dit de Titus, à qui le prêtre de la Vénus de Paphos ne voulut découvrir qu'en secret beaucoup de grandes choses qui regardaient les desseins qu'il méditait alors; mais cet exemple prouve encore moins que celui de Vespasien la liberté que des prêtres accordaient aux grands d'entrer dans les sanctuaires de leurs temples. Sans doute il fallait un grand crédit pour les obliger à la confidence de leurs mystères, et même ils ne faisaient qu'à des princes naturellement intéressés à leur garder le secret et qui, dans le cas où ils se trouvaient, avaient quelque raison particulière de faire valoir les oracles."
Quant aux premiers chrétiens qui croyaient aux démons et leurs attribuaient quelques "miracles", c'est au fond par paresse et pour éviter tout raisonnement qu'ils s'en remettaient au respect aveugle de l'autorité et de la tradition. Or la première précaution dans tout raisonnement est d'abord de s'assurer des faits...
"Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de sept ans, il lui en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l'université de Helmstad, écrivit en 1595 l' Histoire de cette dent, et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant, pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs.
Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rullandus en écrit encore l'histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d'or, et Rullandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit de la dent, et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent, avec beaucoup d'adresse; mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l'orfèvre.
Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que, non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. De grands physiciens ont fort bien trouvé pourquoi les lieux souterrains sont chauds en hiver, et froids en été. De plus grands physiciens ont trouvé depuis peu que cela n'était pas. Les discussions historiques sont encore plus susceptibles de cette sorte d'erreur. On raisonne sur ce qu'ont dit les historiens ; mais ces historiens n'ont-ils été ni passionnés, ni crédules, ni mal instruits, ni négligents? Il en faudrait trouver un qui eût été spectateur de toutes choses, indifférent, et appliqué. Surtout quand on écrit des faits qui ont liaison avec la religion, il est assez difficile que, selon le parti dont on est, on ne donne à une fausse religion des avantages qui ne lui sont point dus ou qu'on ne donne à la vraie de faux avantages dont elle n'a pas besoin. Cependant on devrait être persuadé qu'0n ne peut jamais ajouter de la vérité à celle qui est vraie, ni en donner à celles qui sont fausses...."
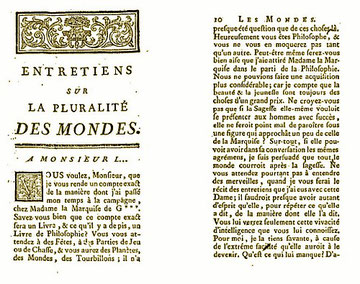
1686 - "Entretiens sur la pluralité des mondes habités"
Ses Entretiens sur la pluralité des mondes portent sur l’astronomie, la constitution des galaxies et la vie sur les autres planètes (le mot pluralité du titre désigne l’hypothèse selon laquelle elles seraient habitées). Les Entretiens relèvent de la tradition du dialogue philosophique. Dans un jardin de Haute-Normandie, le soir, une jeune marquise et un narrateur féru d’astronomie sont réunis pour parler des étoiles. «Je suis sçavante!» s’exclamera finalement la jeune femme, convaincue par les arguments de son interlocuteur. Les travaux de vulgarisation de Fontenelle sont publiés en français, alors que le latin avait été jusque-là la principale langue de diffusion de la science. Et c’est encore en latin que Daniel Listorp (1631-1684) discutait les travaux de l’astronome Nicolas Copernic. Fontenelle, quant à lui, servira de modèle de rédaction scientifique aux collaborateurs de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, et aussi à des astronomes de la fin du XVIIIe siècle, tel Jérôme de Lalande (1732-1807). Celui-ci publiera une Astronomie des dames, qui sera réunie en 1820 aux Entretiens sur la pluralité des mondes.
Premier soir : Que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même, et autour du soleil
« Nous allâmes donc un soir après souper nous promener dans le parc. Il faisait un frais délicieux, qui nous récompensait d'une journée fort chaude que nous avions essuyée. La Lune était levée il y avait peut-être une heure et ses rayons, qui ne venaient à nous qu'entre les branches des arbres, faisaient un agréable mélange d'un blanc fort vif, avec tout ce vert qui paraissait noir. Il n'y avait pas un nuage qui dérobât ou qui obscurcît la moindre étoile, elles étaient toutes d'un or pur et éclatant, et qui était encore relevé par le fond bleu où elles sont attachées. Ce spectacle me fit rêver; et peut-être sans la marquise eussé-je rêvé assez longtemps; mais la présence d'une si aimable dame ne me permit pas de m'abandonner à la Lune et aux étoiles. Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que le jour même n'est pas si beau qu'une belle nuit ? Oui, me répondit-elle, la beauté du jour est comme une beauté blonde qui a plus de brillant; mais la beauté de la nuit est une beauté brune qui est plus touchante. Vous êtes bien généreuse, repris-je, de donner cet avantage aux brunes, vous qui ne l'êtes pas. Il est pourtant vrai que le jour est ce qu'il y a de plus beau dans la nature, et que les héroïnes de romans, qui sont ce qu'il y a de plus beau dans l'imagination, sont presque toujours blondes. Ce n'est rien que la beauté, répliqua-t-elle, si elle ne touche. Avouez que le jour ne vous eût jamais jeté dans une rêverie aussi douce que celle où je vous ai vu près de tomber tout à l'heure à la vue de cette belle nuit. J'en conviens, répondis-je; mais en récompense, une blonde comme vous me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde, avec toute sa beauté brune. Quand cela serait vrai, répliqua-t-elle, je ne m'en contenterais pas. Je voudrais que le jour, puisque les blondes doivent être dans ses intérêts, fût aussi le même effet. Pourquoi les amants, qui sont bons juges de ce qui touche, ne s'adressent-ils jamais qu'à la nuit dans toutes les chansons et dans toutes les élégies que je connais ? Il faut bien que la nuit ait leurs remerciements, lui dis-je; mais, reprit-elle, elle a aussi toutes leurs plaintes. Le jour ne s'attire point leurs confidences; d'où cela vient-il ? C'est apparemment, répondis-je, qu'il n'inspire point je ne sais quoi de triste et de passionné. Il semble pendant la nuit que tout soit en repos. On s'imagine que les étoiles marchent avec plus de silence que le soleil, les objets que le ciel présente sont plus doux, la vue s'y arrête plus aisément; enfin on en rêve mieux, parce qu'on se flatte d'être alors dans toute la nature la seule personne occupée à rêver. Peut-être aussi que le spectacle du jour est trop uniforme, ce n'est qu'un soleil, et une voûte bleue, mais il se peut que la vue de toutes ces étoiles semées confusément, et disposées au hasard en mille figures différentes, favorise la rêverie, et un certain désordre de pensées où l'on ne tombe point sans plaisir. J'ai toujours senti ce que vous me dites, reprit-elle, j'aime les étoiles, et je me plaindrais volontiers du soleil qui nous les efface. Ah ! m'écriai-je, je ne puis lui pardonner de me faire perdre de vue tous ces mondes. Qu'appelez-vous tous ces mondes ? me dit-elle, en me regardant, et en se tournant vers moi. Je vous demande pardon, répondis-je. Vous m'avez mis sur ma folie, et aussitôt mon imagination s'est échappée. Quelle est donc cette folie ? reprit-elle. Hélas ! répliquai-je, je suis bien fâché qu'il faille vous l'avouer, je me suis mis dans la tête que chaque étoile pourrait bien être un monde. Je ne jurerais pourtant pas que cela fût vrai, mais je le tiens pour vrai, parce qu'il me fait plaisir à croire. C'est une idée qui me plaît, et qui s'est placée dans mon esprit d'une manière riante. Selon moi, il n'y a pas jusqu'aux vérités auxquelles l'agrément ne soit nécessaire. Eh bien, reprit-elle, puisque votre folie est si agréable, donnez-la moi, je croirai sur les étoiles tout ce que vous voudrez, pourvu que j'y trouve du plaisir. Ah ! Madame, répondis-je bien vite, ce n'est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière; c'en est un qui est je ne sais où dans la raison, et qui ne fait rire que l'esprit. Quoi donc, reprit-elle, croyez-vous qu'on soit incapable des plaisirs qui ne sont que dans la raison ? Je veux tout à l'heure vous faire voir le contraire, apprenez-moi vos étoiles. Non, répliquai-je, il ne me sera point reproché que dans un bois, à dix heures du soir, j'aie parlé de philosophie à la plus aimable personne que je connaisse. Cherchez ailleurs vos philosophes.
J'eus beau me défendre encore quelque temps sur ce ton-là, il fallut céder. Je lui fis du moins promettre pour mon honneur, qu'elle me garderait le secret, et quand je fus hors d'état de m'en pouvoir dédire, et que je voulus parler, je vis que je ne savais pas où commencer mon discours; car avec une personne comme elle, qui ne savait rien en matière de physique, il fallait prendre les choses de bien loin, pour lui prouver que la Terre pouvait être une planète, et les planètes autant de terres, et toutes les étoiles autant de soleils qui éclairaient des mondes. J'en revenais toujours à lui dire qu'il aurait mieux valu s'entre tenir de bagatelles, comme toute personne raisonnable auraient fait en notre place. A la fin cependant, pour lui donner une idée générale de la philosophie, voici par où je commençai. »
Second Soir - Fontenelle semble croire au progrès des connaissances que porte l'esprit critique, mais l'idée n'est pas encore aussi affirmée qu'elle le sera au siècle suivant, trop fragile tant est extrême la "bizarrerie" du genre humain... Irons-nous dans la lune, s'interroge notre marquise?
"Ces gens de la lune, reprit-elle, on ne les connaîtra jamais, cela est désespérant. - Si je vous répondais sérieusement, répliquai-je, qu'on ne sait ce qui arrivera, vous vous moqueriez de moi, et je le mériterais sans doute. Cependant je me défendrais assez bien, si je le voulais. J'ai une pensée très ridicule, qui a un air de vraisemblance qui me surprend ; je ne sais où elle peut l'avoir pris, étant aussi impertinente qu'elle est. Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y avoir un jour du commerce entre la terre et la lune. Remettez-vous dans l'esprit l'état où était l'Amérique avant qu'elle eût été découverte par Christophe Colomb. Ses habitants vivaient dans une ignorance extrême. Loin de connaître les sciences, ils ne connaissaient pas les arts les plus simples et les plus nécessaires. Ils allaient nus, ils n'avaient point d'autres armes que l'arc ; ils n'avaient jamais conçu que des hommes pussent être portés par des animaux ; ils regardaient la mer comme un grand espace défendu aux hommes, qui se joignait au ciel, et au delà duquel il n'y avait rien...
Cependant voilà un beau jour le spectacle du monde le plus étrange et le moins attendu qui se présente à eux. De grands corps énormes qui paraissent avoir des ailes blanches, qui volent sur la mer, qui vomissent le feu de toutes parts, et qui viennent jeter sur le rivage des gens inconnus, tout écaillés de fer, disposant comme ils veulent des monstres qui courent sous eux, et tenant en leur main des foudres dont ils terrassent tout ce qui leur résiste. D'où sont-ils venus? Qui a pu les amener par-dessus les mers? Qui a mis le feu en leur disposition? Sont-ce les enfants du Soleil? Car assurément ce ne sont pas des hommes. Je ne sais, Madame, si vous entrez comme moi dans la surprise des Américains ; mais jamais il ne peut y en avoir eu une pareille dans le monde.
Après cela, je ne veux plus jurer qu'il ne puisse y avoir commerce quelque jour entre la lune et la terre. Les Américains eussent-ils cru qu'il eût dû y en avoir entre l'Amérique et l'Europe qu'ils ne connaissaient seulement pas ? Il est vrai qu'il faudra traverser ce grand espace d'air et de ciel qui est entre la terre et la lune. Mais ces grandes mers paraissaient-elles aux Américains plus propres à être traversées ?
- En vérité, dit la Marquise en me regardant, vous êtes fou. - Qui vous dit le contraire ?, répondis-je. - Mais je veux vous le prouver, reprit-elle ; je ne me contente pas de l'aveu que vous en faites. Les Américains étaient si ignorants, qu'ils n'avaient garde de soupçonner qu'on pût se faire des chemins au travers des mers si vastes ; mais nous qui avons tant de connaissances, nous nous figurerions bien qu'on pût aller par les airs, si l'on pouvait effectivement y aller. - On fait plus que se figurer la chose possible, répliquai-je, on commence déjà à voler un peu; plusieurs personnes différentes ont trouvé le secret de s'ajuster des ailes qui les soutiennent en l'air, de leur donner du mouvement, et de passer par-dessus des rivières. A la vérité, ce n'a pas été un vol d'aigle et il en a quelquefois coûté à ces nouveaux oiseaux un bras ou une jambe mais enfin cela ne représente encore que les premières planches que l'on a mises sur l'eau, et qui ont été le commencement de la navigation. De ces planches-là, il y avait bien loin jusqu'à de gros navires qui pussent faire le tour du monde. Cependant peu à peu sont venus les gros navires. L'art de voler ne fait encore que de naître ; il se perfectionnera, et quelque jour on ira jusqu'à la lune. Prétendons-nous avoir découvert toutes choses, ou les avoir mises à un point qu'on n'y puisse rien ajouter ? Eh ! de grâce, consentons qu'il y ait encore quelque chose à faire pour les siècles à venir..."
CINQUIÈME SOIR - Que les Étoiles fixes sont autant de Soleils, dont chacun éclaire un Monde.
"Quand le ciel n'était que celte voûte bleue où les étoiles étaient clouées, l'univers me paraissait petit et étroit; je m'y sentais comme oppressé. Présentement qu'on a donné infiniment plus d'étendue et de profondeur à cette voûte, en la partageant en mille et mille tourbillons, il me semble que je respire avec plus de liberté, et que je suis dans un plus grand air..."
(Extraits).
"La marquise sentit une vraie impatience de savoir ce que les Etoiles fixes deviendraient. — Seront-elles habitées comme les planètes? me dit-elle. Ne le seront- elles pas? Enfin, qu'en ferons-nous? — Vous le devineriez peut-être, si vous en aviez bien envie, répondis-je. — Les étoiles fixes ne sauraient être moins éloignées de la Terre que de vingt-sept mille six cent soixante fois la distance d'ici au soleil, qui est de trente-trois millions de lieues: et si vous fâchiez un astronome, il les mettrait encore plus loin. La distance du soleil à Saturne, qui est la planète la plus éloignée, n'est que de trois cent trente millions de lieues; ce n'est rien par rapport à la distance du soleil ou de la terre aux étoiles fixes, et on ne prend pas la peine de la compter. Leur lumière, comme vous voyez, est assez vive et assez éclatante. Si elles la recevaient du soleil, il faudrait qu'elles la reçussent déjà bien faible après un si épouvantable trajet; il faudrait que, par une réflexion qui l'affaiblirait encore beaucoup, elles nous la renvoyassent à cette même distance. Il serait impossible qu'une lumière, qui aurait essuyé une réflexion, et fait deux fois un semblable chemin, eût cette force et cette vivacité qu'a celle des étoiles fixes. Les voilà donc lumineuses par elles-mêmes, et toutes, en un mol, autant de soleils.
— Ne me trompé-je point, s'écria la marquise, ou si je vois où vous me voulez mener? M'allez-vous dire : "Les étoiles fixes sont autant de soleils; notre soleil est le centre d'un tourbillon qui tourne autour de lui : pourquoi chaque étoile fixe ne sera-t-elle pas aussi
le centre d'un tourbillon qui aura un mouvement autour d'elle? Notre soleil a des planètes qu'il éclaire; pourquoi chaque étoile fixe n'en aura-t-elle pas aussi qu'elle éclairera?" — Je n'ai à vous répondre, lui dis-je, que ce que répondit Phèdre à OEnone : C'est toi qui l'as nommé. — Mais, reprit-elle, voilà l'univers si grand que je m'y perds; je ne sais plus où je suis; je ne suis plus rien. Quoi, tout sera divisé en tourbillons jetés confusément les uns parmi les autres? Chaque étoile sera le centre d'un tourbillon, peut-être aussi grand que celui où nous sommes? Tout cet espace immense, qui comprend notre soleil et nos planètes, ne sera qu'une petite parcelle de l'univers? Autant d'espaces pareils que d'étoiles fixes? Cela me confond, me trouble, m'épouvante. — Et moi, répondis-je, cela me met à mon aise. Quand le ciel n'était que celte voûte bleue où les étoiles étaient clouées, l'univers me paraissait petit et étroit; je m'y sentais comme oppressé. Présentement qu'on a donné infiniment plus d'étendue et de profondeur à cette voûte, en la partageant en mille et mille tourbillons, il me semble que je respire avec plus de liberté, et que je suis dans un plus grand air, et assurément l'univers a toute une autre magnificence. La nature n'a rien épargné en le produisant; elle a fait une profusion de richesses tout à fait digne d'elle. Rien n'est si beau à se présenter que ce nombre prodigieux de tourbillons dont le milieu est occupé par un soleil qui fait tourner des planètes autour de lui. Les habitants d'une planète d'un de ces tourbillons infinis, voient de tous côtés les soleils des tourbillons dont ils sont environnés; mais ils n'ont garde d'en voir les planètes qui, n'ayant qu'une lumière faible, empruntée de leur soleil, ne la poussent point au delà de leur monde.
— Vous m'offrez, dit-elle, une espèce de perspective si longue, que la vue n'en peut attraper le bout. Je vois clairement les habitants de la terre; ensuite vous me faites voir ceux de la lune et des autres planètes de notre tourbillon assez clairement à la vérité, mais moins que ceux de la terre. Après eux viennent les habitants des planètes des autres tourbillons. Je vous avoue qu'ils sont tout à fait dans l'enfoncement, et que quelque effort que je fasse pour les voir, je ne les aperçois presque point. Et en effet, ne sont-ils pas presque anéantis par l'expression même dont vous êtes obligé de vous servir en parlant d'eux?
Il faut que vous les appeliez les habitants d'une des planètes de l'un de ces tourbillons, dont le nombre est infini. Nous-mêmes, à qui la même expression convient, avouez que vous ne sauriez presque plus nous démêler au milieu de tant de mondes. Pour moi, je commence à voir la terre si effroyablement petite, que je ne crois pas avoir désormais d'empressement pour aucune chose. Assurément, si on a tant d'ardeur de s'agrandir, si on fait desseins sur desseins, si on se donne tant de peine, c'est que l'on ne connaît pas les tourbillons. Je prétends bien que ma paresse profite de mes nouvelles lumières ; et quand on me reprochera mon indolence, je répondrai : Ah! si vous saviez ce que c'est que les étoiles fixes! — Il faut qu'Alexandre ne l'ait pas su, répliquai-je ; car un certain auteur qui tient que la lune est habitée, dit fort sérieusement qu'il n'était pas possible qu'Aristote ne fût dans une opinion si raisonnable (comment une vérité eût-elle échappé à Aristote?); mais qu'il n'en voulut jamais rien dire, de peur de fâcher Alexandre, qui eût été au désespoir de voir un monde qu'il n'eût pas pu conquérir. A plus forte raison lui eût-on fait mystère des tourbillons des étoiles fixes, quand on les eût connus en ce temps-là; c'eût été faire trop mal sa cour que de lui en parler. Pour moi, qui les connais, je suis bien fâché de ne pouvoir tirer d'utilité de la
connaissance que j'en ai. Ils ne guérissent tout au plus, selon votre raisonnement, que de l'ambition et de l'inquiétude et je n'ai point ces maladies-là...."

1688 - "Digression sur les anciens et les modernes"
LE CARTESIANISME
"Et, en effet, ce qu'il y a de principal dans la philosophie, et ce qui de là se répand sur tout, je veux dire la manière de raisonner, s'est extrêmement perfectionné dans ce siècle. Je doute fort que la plupart des gens entrent dans la remarque que je vais faire : je la ferai cependant pour ceux qui se connaissent en raisonnements; et je puis me vanter que c'est avoir du courage, que de s'exposer, pour l'intérêt de la vérité, à la critique de tous les autres, dont le nombre n'est assurément pas méprisable. Sur quelque matière que ce soit, les anciens sont assez sujets à ne pas raisonner dans la dernière perfection.
Souvent de faibles convenances, de petites similitudes, des jeux d'esprit peu solides, des discours vagues et confus, passent chez eux pour des preuves; aussi rien ne leur coûte à prouver : mais ce qu'un ancien démontrait en se jouant, donnerait, à l'heure qu'il est, bien de la peine à un pauvre moderne; car de quelle rigueur n'est-on pas sur les raisonnements?
On veut qu'ils soient intelligibles, on veut qu'ils soient justes, on veut qu'ils concluent. On aura la malignité de démêler la moindre équivoque, ou d'idées, ou de mots ; on aura la dureté de condamner la chose du monde la plus ingénieuse, si elle ne va pas au fait.
Avant Descartes, on raisonnait plus commodément; les siècles passés sont bien heureux de n'avoir pas eu cet homme-là. C'est lui, à ce qu'il me semble, qui a amené cette nouvelle méthode de raisonner, beaucoup plus estimable que sa philosophie même, dont une bonne partie se trouve fausse ou incertaine, selon les propres règles qu'il nous a apprises. Enfin il règne non seulement dans nos bons ouvrages de physique et de métaphysique, mais dans ceux de religion, de morale, de critique, une précision et une justesse qui, jusqu'à présent, n'avaient été guère connues.
LE BONHEUR
Voici une matière la plus intéressante de toutes, dont tout le monde parle, que les philosophes, surtout les anciens, ont traitée avec beaucoup d'étendue : mais quoique très intéressante, elle est dans le fond assez négligée; quoique tout le monde en parle, peu
de gens y pensent; et quoique les philosophes l'aient beaucoup traitée, ç'a a été si philosophiquement, que les hommes n'en peuvent tirer guère de profit.
On entend ici par le mot de bonheur un état, une situation telle qu'on en désirât la durée sans changement; et en cela le bonheur est différent du plaisir, qui n'est qu'un sentiment agréable, mais court et passager, et qui ne peut jamais être un état. La douleur aurait bien plutôt le privilège d'en pouvoir être un.
A mesurer le bonheur des hommes seulement pur le nombre et la vivacité des plaisirs qu'ils ont dans le cours de leur vie, peut-être y a-t-il un assez grand nombre de conditions assez égales, quoique fort différentes. Celui qui a moins de plaisirs les sent plus vivement : il en sent une infinité que les autres ne sentent plus ou n'ont jamais sentis; et à cet égard la nature fait assez son devoir de mère commune. Mais si, au lieu de considérer ces instants répandus dans la vie de chaque homme, on considère le fond des vies mêmes, on voit qu'il est fort inégal; qu'un homme qui a, si l'on veut pendant sa journée, autant de bons moments qu'un autre, est tout le reste du temps beaucoup plus mal à son aise, et que la compensation cesse entièrement d'avoir lieu. C'est donc l'état qui fait le bonheur, mais ceci est très fâcheux pour le genre humain. Une infinité d'hommes sont dans des états qu'ils ont raison de ne pas aimer; un nombre presque aussi grand sont incapables de se contenter d'aucun état : les voilà donc presque tous exclus du bonheur, et il ne leur reste pour ressource que des plaisirs, c'est-à-dire des moments semés çà et là sur un fond triste qui en sera un peu égayé. Les hommes, dans ces moments, reprennent les forces nécessaires à leur malheureuse situation et se remontent pour souffrir.
Celui qui voudrait fixer son état, non par la crainte d'être pis, mais parce qu'il serait content, mériterait le nom d'heureux : on le reconnaîtrait entre tous les autres hommes à une espèce d'immobilité dans sa situation ; il n'agirait que pour s'y conserver, et non pas pour en sortir. Mais cet homme-là a-t-il paru en quelque endroit de la terre? On en pourrait douter, parce qu'on ne s'aperçoit guère de ceux qui sont dans cette immobilité fortunée; au lieu que les malheureux qui s'agitent composent le tourbillon du monde, et se font bien sentir les uns aux autres par les chocs violents qu'ils se donnent. Le repos même de l'heureux, s'il est aperçu, peut passer pour être forcé, et tous les autres sont intéressés à n'en pas prendre une idée plus avantageuse. Ainsi l'existence de l'homme heureux pourrait être assez facilement contestée. Admettons-la cependant ne fût-ce que pour nous donner des espérances agréables : mais il est vrai que, retenues dans de certaines bornes, elles ne seront pas chimériques.
Quoi qu'en disent les fiers stoïciens, une grande partie de notre bonheur ne dépend pas de nous. Si l'un d'eux, pressé par la goutte, lui a dit : Je n'avouerai pourtant pas que tu sois un mal; il a dit la plus extravagante parole qui soit jamais sortie de la bouche d'un philosophe. Un empereur de l'univers, enfermé aux petites-maisons, déclare naïvement un sentiment dont il a le malheur d'être plein ; celui-ci, par engagement de système, nie un sentiment très vif, et en même temps l'avoue par l'effort qu'il fait pour le nier. N'ajoutons pas à tous les maux que la nature et la fortune peuvent nous envoyer, la ridicule et inutile vanité de nous croire invulnérables.
Il serait moins déraisonnable de se persuader que notre bonheur ne dépend point du tout de nous; et presque tous les hommes ou le croient, ou agissent comme s'ils le croyaient. Incapables de discernement et de choix, poussées par une impétuosité aveugle, attirés par des objets qu'ils ne voient qu'au travers de mille nuages, entraînés les uns par les autres sans savoir où ils vont, ils composent une multitude confuse et tumultueuse, qui semble n'avoir d'autre dessein que de s'agiter sans cesse. Si, dans tout ce désordre, des rencontres favorables peuvent en rendre quelques-uns heureux pour quelques moments, à la bonne heure; mais il est bien sur qu'ils ne sauront ni prévenir ni modérer le choc de tout ce qui peut les rendre malheureux. Ils sont absolument à la merci du hasard.
Nous pouvons quelque chose à notre bonheur, mais ce n'est que par nos façons de penser; et il faut convenir que cette condition est assez dure. La plupart ne pensent que comme il plaît à tout ce qui les environne; ils n'ont pas un certain gouvernail qui leur puisse servir à tourner leurs pensées d'un autre côté quelles n'ont été poussées par le courant. Les autres ont des pensées si fortement pliées vers le mauvais côté, et si inflexibles, qu'il serait inutile de les vouloir tourner d'un autre. Enfin, quelques-uns à qui ce travail pourrait réussir, et serait même assez facile, le rejettent parce que c'est un travail, et en dédaignent le fruit qu'ils croient trop médiocre. Que serait-ce que ce misérable bonheur factice pour lequel il faudrait tant raisonner? Vaut-il la peine qu'on s'en tourmente? On peut le laisser aux philosophes avec leurs autres chimères : tant d'étude pour être heureux empêcherait de l'être.
Ainsi il n'y a qu'une partie de notre bonheur qui puisse dépendre de nous; et de cette petite partie peu de gens en ont la disposition ou en tirent le profit. Il faut que les caractères, ou faibles et paresseux, ou impétueux et violents, ou sombres et chagrins, y renoncent tous. Il en reste quelques-uns, doux et modérés, et qui admettent plus volontiers les idées ou les impressions agréables : ceux-là peuvent travailler utilement à se rendre heureux. II est vrai que par la faveur de la nature ils le sont déjà assez, et que le secours de la philosophie ne paraît pas leur être fort nécessaire; mais il n'est presque jamais que pour ceux qui en ont le moins de besoin; et ils ne laissent pas d'en sentir l'importance : surtout quand il s'agit du bonheur, ce n'est pas à nous de rien négliger.
Écoutons donc la philosophie, qui prêche dans le désert une petite troupe d'auditeurs qu'elle a choisis, parce qu'ils savaient déjà une bonne partie de ce qu'elle peut leur apprendre. Afin que le sentiment du bonheur puisse entrer dans l'âme, ou du moins afin qu'il y puisse séjourner, il faut avoir nettoyé la place, et chassé tous les maux imaginaires. Nous sommes d'une habileté infinie à en créer; et quand nous les avons une fois produits, il nous est très difficile de nous en défaire. Souvent même il semble que nous aimions notre malheureux ouvrage, et que nous nous y complaisions. Les maux imaginaires ne sont pas tous ceux qui n'ont rien de corporel, et ne sont que dans l'esprit; mais seulement ceux qui tirent leur origine de quelque façon de penser fausse, ou du moins problématique. Ce n'est pas un mal imaginaire que le déshonneur; mais c'en est un que la douleur de laisser de grands biens après sa mort à des héritiers en ligne collatérale, et non pas en ligne directe, ou à des filles, et non pas à des fils. Il y a tel homme dont la vie est empoisonnée par un semblable chagrin. Le bonheur n'habite point dans des têtes de cette trempe; il lui en faut ou qui soit naturellement plus saines, ou qui aient le courage de se guérir. Si l'on est susceptible des maux imaginaires, il y en a tant, qu'on sera nécessairement la proie de quelqu'un. La principale force de ces sortes de monstres consiste en ce qu'on s'y soumet, sans oser ni les attraper, ni même les envisager : si on les considérait quelque temps d'un œil fixe, ils seraient à demi vaincus.
Assez souvent aux maux réels nous ajoutons des circonstances imaginaires qui les aggravent. Ou 'un malheur ait quelque chose de singulier, non seulement ce qu'il a de réel nous afflige, mais sa singularité nous irrite et nous aigrit. Nous nous représentons une fortune, un destin, je ne sais quoi, qui met de l'art et de l'esprit à nous faire un malheur d'une nature particulière. Mais qu'est-ce que tout cela? employons un peu notre raison, et ces fantômes disparaissent. Un malheur commun n'en est pas réellement moindre, un malheur singulier n'en est pas moins possible, ni moins inévitable. Un homme qui a la peste, lui cent millième, est-il moins à plaindre que celui qui a une maladie bizarre et inconnue? ..."

Fénelon (1651-1715)
"Souvenez-vous, ô Télémaque, qu'il y a deux choses pernicieuses, dans le gouvernement des peuples, auxquelles on n'apporte presque jamais aucun remède : la première est une autorité injuste et trop violente dans les rois; la seconde est le luxe, qui corrompt les mœurs..."
Fénelon est un précurseur, il annonce, en cette fin du XVIIe siècle, le XVIIIe de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau par sa condamnation de l'absolutisme et sa défense de la simplicité des moeurs, mais il vit ses espoirs d'évolution sociale brisés par ses choix politiques, - il joua le duc de Bourgogne contre Louis XIV -, et plus encore par la condamnation du quiétisme, doctrine qui avait su séduire son âme mystique...
Né en 1651 au château de Fénelon, dans le Périgord, François de Salignac de la Motte-Fénelon entre au séminaire de Saint-Sulpice. Ordonné prêtre en 1655, à 24 ans, il devient supérieur de la "Congrégation des Nouvelles Catholiques" qui réunissait de jeunes protestantes récemment converties dont il faut entretenir la foi. De 1685 à 1687, à la demande de Bossuet, il assume la tâche difficile de diriger une mission auprès des protestants de Saintonge, soumis extérieurement au catholicisme au lendemain de la Révocation de l'Edit de Nantes. Sans être un apôtre de la mais doutant de l'efficacité de la contrainte, il s'acquitte de sa mission au mieux de la religion et des intérêts royaux. A son retour de Saintonge, il fait imprimer le "Traité de l'Education des Filles" (1687), écrit quelques années avant pour la duchesse de Beauvilliers, et est devenu le véritable directeur spirituel des duchesses de Beauvilliers et de Chevreuse, filles de Colbert, et même de Mme de Maintenon.
En 1689 le duc de Beauvilliers est désigné comme gouverneur du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, et Fénelon est alors nommé précepteur du prince., un élève violent, orgueilleux, excessif, mais sensible et plein d'intelligence. A l'exemple de Bossuet, lorsqu'il était en 1670 devenu précepteur du Dauphin, Fénelon rédige lui-même des ouvrages pédagogiques, mais mieux adaptés à l'esprit d'un enfant : les Fables, les Dialogues des Morts, et surtout Télémaque. Il est élu à l'Académie française et est bientôt nommé archevêque de Cambrai.
Mais l'affaire du quiétisme provoque sa disgrâce. La publication de son "Télémaque", où l'on voit une satire du roi et de la cour, achève de le discréditer. C'est une foi profonde qui semble animer Fénelon dans sa réflexion "révolutionnaire", le politique rejoint ici la révélation mystique, comme chez Bossuet, le même désir sincère de faire régner la justice de Dieu et l'amour des hommes : "Que vois-je dans toute la Nature? Dieu, Dieu partout, et encore Dieu seul. Quand je pense, Seigneur, que tout l'être est en vous, vous épuisez et vous engloutissez, ô abîme de vérité, toute ma pensée; je ne sais ce que je deviens, tout ce qui n 'est point vous disparaît, et à peine me reste-t-il de quoi me trouver encore moi-même. Qui ne voit point n'a rien vu; qui ne vous goûte point n'a jamais rien senti, il est comme s'il n'était pas." (Existence de Dieu.)
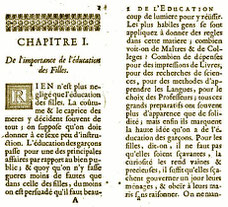
1687 - "Traité de l'Education des Filles"
La duchesse de Beauvilliers, occupée de l'éducation de ses huit filles, pria Fénelon, l'ami de la famille, de la diriger et le jeune abbé, âgé de quelque trente ans, composa son premier ouvrage, de l'Éducation des Filles. Ce fut un événement que l'apparition en 1687 de ce traité. L'abbé Fleury, dans son Traité du choix et de la méthode des Études (1686) avait déjà noté que «Ce sera sans doute un grand paradoxe de dire que les femmes doivent apprendre autre chose que le catéchisme, la couture et divers petits ouvrages; chanter, danser, s'habiller à la mode et faire bien la révérence, car voilà d'ordinaire toute leur éducation. » Les écrivains de la seconde génération du XVIIe siècle furent en effet moins favorables aux femmes. Un Ménage, annonçant le succès des Caractères de La Bruyère, ajoutait que «si l'ouvrage avait paru trente ou quarante ans plus tôt il aurait eu moins de réputation, parce que les femmes y sont trop maltraitées et que, pour lors, elles étaient en possession de décider. Et, de fait, La Bruyère ne leur attribuait d'autre supériorité que celle du style épistolaire «en raison de l'art qu'elles possèdent de faire dans un seul mot tout un sentiment et de rendre délicatement une pensée délicate.» Fénelon pense différemment, ou presque, c'est une toute autre époque...
"De l'importance de l'éducation des filles. Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. La coutume et le caprice des mères y décident souvent de tout : on suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instruction. L'éducation des garçons passe pour une des principales affaires par rapport au bien public ; et, quoiqu'on n'y fasse guère moins de fautes que dans celle des filles, du moins on est persuadé qu'il faut beaucoup de lumières pour y réussir. Les plus habiles gens se sont appliqués à donner des règles dans cette matière. Combien voit-on de maîtres et de collèges ! Combien de dépenses pour des impressions de livres, pour des recherches de sciences, pour des méthodes d'apprendre les langues, pour le choix des professeurs! Tous ces grands préparatifs ont souvent plus d'apparence que de solidité; mais, enfin, ils marquent la haute idée qu'on a de l'éducation des garçons. Pour les filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes, la curiosité les rend vaines et précieuses; il suffit qu'elles sachent gouverner un jour leurs ménages, et obéir à leurs maris sans raisonner. On ne manque pas de se servir de l'expérience qu'on a de beaucoup de femmes que la science a rendues ridicules. Après quoi, on se croit en droit d'abandonner aveuglément les filles à la conduite de mères ignorantes et indiscrètes. Il est vrai qu'il faut craindre de faire des savantes ridicules. Les femmes ont d'ordinaire l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes; aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études dont elles pourraient s'entêter : elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées; ainsi elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie et à la théologie. La plupart même des arts mécaniques ne leur conviennent pas : elles sont faites pour des exercices modérés. Leur corps, aussi bien que leur esprit, est moins fort et moins robuste que celui des hommes. En revanche, la nature leur a donné en partage l'industrie, la propreté et l'économie, pour les occuper tranquillement dans leurs maisons.
Mais que s'ensuit-il de la faiblesse naturelle des femmes? Plus elles sont faibles, plus il est important de les fortifier. N'ont-elles pas des devoirs à remplir, mais des devoirs qui sont les fondements de toute la vie humaine? Ne sont-ce pas les femmes qui ruinent ou qui soutiennent les maisons, qui règlent tout le détail des choses domestiques, et qui, par conséquent, décident de ce qui touche le plus près à tout le genre humain? Par là elles ont la principale part aux bonnes ou aux mauvaises mœurs de presque tout le monde. Une femme judicieuse, appliquée et pleine de religion, est l'âme de toute une grande maison ; elle y met l'ordre pour les biens temporels et pour le salut. Les hommes mêmes qui ont toute l'autorité en public, ne peuvent, par leurs délibérations, établir un bien effectif, si les femmes ne leur aident à l'exécuter. Le monde n'est point un fantôme, c'est l'assemblage de toutes les familles. Et qui est-ce qui peut les policer avec un soin plus exact que les femmes, qui, outre leur autorité naturelle et leur assiduité dans leur maison, ont encore l'avantage d'être nées soigneuses, attentives au détail, industrieuses, insinuantes et persuasives?
Mais les hommes peuvent-ils espérer pour eux-mêmes quelque douceur de vie, si leur plus étroite société, qui est celle du mariage, se tourne en amertume? Mais les enfants, qui feront dans la suite tout le genre humain, que deviendront-ils si les mères les gâtent dès leurs premières années?
Voilà donc les occupations des. femmes, qui ne sont guère moins importantes au public que celles des hommes, puisqu'elles ont une maison à régler, un mari à rendre heureux, des enfants à bien élever : ajoutez que la vertu n'est pas moins pour les femmes que pour les hommes : sans parler du bien ou du mal qu'elles peuvent faire au public, elles sont la moitié du genre humain racheté du sang de Jésus-Christ et destiné à la vie éternelle. Enfin, il faut considérer, outre le bien que font les femmes quand elles sont bien élevées, le mal qu'elles causent dans le monde quand elles manquent d'une éducation qui leur inspire la vertu. Il est constant que la mauvaise éducation des femmes fait plus de mal que celle des hommes, puisque les désordres des hommes viennent souvent et de la mauvaise éducation qu'ils ont reçue de leurs mères, et des passions que d'autres femmes leur ont inspirées dans un âge plus avancé.
Quelles intrigues se présentent à nous dans les histoires! quel renversement des lois et des mœurs! quelles guerres sanglantes! quelles nouveautés contre la religion ! quelles révolutions d'État causées par le dérèglement des femmes! Voilà ce qui prouve l'importance de bien élever les filles : cherchons-en les moyens.
Inconvénients des éducations ordinaires. L'ignorance d'une fille est cause qu'elle s'ennuie, et qu'elle ne sait à quoi s'occuper innocemment. Quand elle est venue jusqu'à un certain âge sans s'appliquer aux choses solides, elle n'en peut avoir ni le goût ni l'estime; tout ce qui est sérieux lui paraît triste; tout ce qui demande une attention suivie la fatigue; la pente aux plaisirs, qui est forte pendant la jeunesse, l'exemple des personnes du même âge qui sont plongées dans l'amusement, tout sert à lui faire craindre une vie réglée et laborieuse. Dans ce premier âge, elle manque d'expérience et d'autorité pour gouverner quelque chose dans la maison de ses parents; elle ne connaît pas même l'importance de s'y appliquer, à moins que sa mère n'ait pris soin de la lui faire remarquer en détail. Si elle est de condition, elle est exempte du travail des mains : elle ne travaillera donc que quelques heures du jour, parce qu'on dit, sans savoir pourquoi, qu'il est honnête aux femmes de travailler; mais souvent ce ne sera qu'une contenance, et elle ne s'accoutumera point à un travail suivi. En cet état, que fera-t-elle? La compagnie d'une mère qui l'observe, qui la gronde, qui croit la bien élever en ne lui pardonnant rien, qui se compose avec elle, qui lui fait essuyer ses humeurs, qui lui paraît toujours chargée de tous les soucis domestiques, la gêne et la rebute: elle a autour d'elle des femmes flatteuses qui, cherchant à s'insinuer par des complaisances basses et dangereuses, suivent toutes ses fantaisies, et l'entretiennent de tout ce qui peut la dégoûter du bien; la piété lui paraît une occupation languissante, et une règle ennemie de tous les plaisirs...."

L'affaire du quiétisme, dans laquelle s'illustra Fénelon, et qui opposa les deux plus grands évêques du XVIIe siècle, Bossuet et Fénelon, signa la fin du mysticisme et du Siècle des saints en France. - Le quiétisme est la doctrine du prêtre espagnol Molinos, exposée dans sa "Guide spirituelle" (1675) et condamnée dès 1687 comme hérétique. Ce mysticisme pousse à l'union totale avec Dieu jusqu'à rendre notre âme si étrangère au corps qu'elle n'est plus responsable des fautes qu'il peut commettre. En France, Mme Guyon va exposer, notamment dans son "Moyen court de faire oraison", une sorte de quiétisme atténué. Sans admettre l'irresponsabilité de l'âme dans les désordres du corps, elle fait consister la perfection spirituelle dans un acte continuel de contemplation et d'amour, un abandon total à Dieu qui aboutit à "l'état d'oraison", un état de "quiétude" parfaite qui renferme à lui seul tous les actes de la religion : il dispense ainsi de toute réflexion sur Dieu, sur ses attributs, sur Jésus-Christ, exclut le désir du salut, de la sanctífication et la crainte de l'enfer, et va jusqu'à rendre inutile la pratique de la confession, de la mortification et de toutes les bonnes oeuvres. Fénelon fut séduit par cet amour de Dieu dépouillé de toute attache terrestre, épuré de tout désir de récompenses et de crainte des châtiments. Dès l'époque où il devint précepteur du duc de Bourgogne, il connut Mme Guyon dès 1688 et l'introduisit dans la petite société religieuse des duchesses de Beauvilliers et de Chevreuse. Mme De Maintenon, séduite à son tour, lui ouvre Saint-Cyr, et la maison devient presque entièrement quiétiste.
Mais cette effervescence du quiétisme alerte l'évêque de Chartres qui fait chasser Mme Guyon en 1693, à la surprise d'une Mme de Maintenon, qui commença à se détacher de Fénelon. Ce dernier conseille à Mme Guyon de soumettre ses livres au jugement de Bossuet, alors évêque de Meaux. Mais celui-ci juge rapidement que cette doctrine peut conduire à négliger toutes pratiques religieuses et à se passer de la hiérarchie ecclésiastique pour communiquer directement avec Dieu, dans une sorte de déisme. Fénelon répond en invoquant l'autorité des grands mystiques comme sainte Thérèse et saint François de Sales.
1694-1696 - La Conférence d'Issy (1694-1696) va condamner trente-quatre propositions quiétistes et affirmer les obligations du christianisme positif, tout en admettant, à la demande de Fénelon, les principes essentiels de la perfection mystique, atteinte exceptionnellement par quelques grands saints.
La querelle ne s'apaise pas pour autant lorsque Fénelon refuse d'approuver une "Instruction sur les Etats d'oraison" rédigée par Bossuet et défend l'intégrité de Mme Guyon en publiant les "Explications des Maximes des Saints" (1697) et allant jusqu'à porter son livre au jugement du pape. S'engage une querelle et une véritable guerre de brochures qui se termine par l'intervention de Louis XIV qui précipite la disgrâce de Fénelon...
DE L'ÉDUCATION DU DUC DE BOURGOGNE
Fables. — Dialogues des Morts. — Télémaque.
FABLES - L'Abeille et la Mouche.
"Un jour une abeille aperçut une mouche auprès de sa ruche. Que viens-tu faire ici? lui dit-elle d'un ton furieux. Vraiment, c'est bien à toi, vil animal, à te mêler avec les reines de l'air! Tu as raison, répondit froidement la mouche : on a toujours tort de s'approcher d'une nation aussi fougueuse que la vôtre. Rien n'est plus sage que nous, dit l'abeille : nous seules avons des lois et une république bien policée; nous ne broutons que des fleurs odoriférantes : nous ne faisons que du miel délicieux, qui égale le nectar. Ote-toi de ma présence, vilaine mouche importune, qui ne fais que bourdonner et chercher ta vie sur des ordures. Nous vivons comme nous pouvons, répondit la mouche! La pauvreté n'est pas un vice, mais la colère en est un grand. Vous faites du miel qui est doux, mais votre cœur est toujours amer, vous êtes sages dans vos lois mais emportées dans votre conduite. Votre colère qui pique vos ennemis vous donne la mort, et votre folle cruauté vous fait plus de mal qu'à personne. Il vaut mieux avoir des qualités moins éclatantes, avec plus de modération."

1692 - "Le Dialogues des morts"
Composé pour l'édification du jeune duc de Bourgogne dans le but de susciter chez ce dernier l'amour du passé, et au travers de personnages célèbres, de Socrate à Louis XI, présenter les grands principes moraux et humains qui la noblesse de l'esprit....
"Socrate et Alcibiade.
Le bon gouvernement est celui où les citoyens sont élevés dans le respect des lois, dans l'amour de la pairie et du genre humain, qui est la grande patrie.
Socrate. — Vous voilà devenu bien sage à vos dépens, et aux dépens de tous ceux que vous avez trompés. Vous pourriez être le digne héros d'une seconde Odyssée : car vous avez vu les mœurs d'un plus grand nombre de peuples dans vos voyages qu'Ulysse n'en vit dans les siens. Alcibiade. — Ce n'est pas l'expérience qui me manque, mais la sagesse; mais, quoique vous vous moquiez de moi, vous ne sauriez nier qu'un homme n'apprenne bien des choses quand il voyage, et qu'il étudie sérieusement les mœurs de tant de peuples.
Socrate. — Il est vrai que cette étude, si elle était bien faite pourrait beaucoup agrandir l'esprit : mais il faudrait un vrai philosophe, un homme tranquille et appliqué, qui ne fût point dominé comme vous par l'ambition et par le plaisir; un homme sans passion et sans préjugé, qui chercherait tout ce qu'il y aurait de bon en chaque peuple, et qui découvrirait ce que les lois de chaque pays lui ont apporté de bien et de mal. Au retour d'un tel voyage, ce philosophe serait un excellent législateur. Mais vous n'avez jamais été l'homme qu'il fallait pour donner des lois; votre talent était pour les violer. A peine étiez-vous hors de l'enfance que vous conseillâtes à votre oncle Périclès d'engager la guerre, pour éviter de rendre compte des deniers publics. Je crois même qu'après votre mort vous seriez encore un dangereux garde des lois.
Alcibiade. — Laissez-moi là, je vous prie; le fleuve d'oubli doit effacer toutes mes fautes : parlons des mœurs des peuples. Je n'ai trouvé partout que des coutumes, et fort peu de lois. Tous les barbares n'ont d'autres règles que l'habitude et l'exemple de leurs pères. Les Perses mêmes, dont on a tant vanté les mœurs du temps de Cyrus, n'ont aucune trace de cette vertu. Leur valeur et leur magnificence montrent un assez beau naturel; mais il est corrompu par la mollesse et par le faste le plus grossier. Leurs rois, encensés comme des idoles, ne sauraient être honnêtes gens, ni connaître la vérité; l'humanité ne peut soutenir avec modération une puissance aussi désordonnée que la leur. Ils s'imaginent que tout est fait pour eux; ils se jouent du bien, de l'honneur et de la vie des autres hommes. Rien ne marque tant de barbarie dans une nation que cette forme de gouvernement; car il n'y a plus de lois, et la volonté d'un seul homme, dont on flatte toutes les passions, est la loi unique.
Socrate. — Ce pays-là ne convenait guère à un génie aussi libre et aussi hardi que le vôtre. Mais ne trouvez- vous pas aussi que la liberté d'Athènes est dans une autre extrémité?
Alcibiade. — Sparte est ce que j'ai vu de meilleur.
Socrate. — La servitude des Ilotes ne vous paraît elle pas contraire à l'humanité ? Remontez hardiment aux vrais principes, défaites-vous de tous les préjugés : avouez qu'en cela les Grecs sont eux-mêmes un peu barbares. Est-il permis à une partie des hommes de traiter l'autre comme des bêtes de charge?
Alcibiade. — Pourquoi non, si c'est un peuple subjugué?
Socrate. — Le peuple subjugué est toujours peuple; le droit de conquête est un droit moins fort que celui de I'humanité. Ce qu'on appelle conquête devient le comble de la tyrannie et l'exécration du genre humain, à moins que le conquérant n'ait fait sa conquête par une guerre juste, et n'ait rendu heureux le peuple conquis, en lui donnant de bonnes lois. Il n'est donc pas permis aux Lacédémoniens de traiter si indignement les Ilotes, qui sont hommes comme eux. Quelle horrible barbarie que de voir un peuple qui se joue de la vie d'un autre, et qui compte pour rien ses mœurs et son repos! De même qu'un chef de famille ne doit jamais s'entêter pour la grandeur de sa maison, jusqu'à vouloir troubler la paix et la liberté publique de tout le peuple, dont lui et sa famille ne sont qu'un membre; de même c'est une conduite insensée, brutale et pernicieuse, que le chef d'une nation mette sa gloire à augmenter la puissance de son peuple, en troublant le repos et la liberté des peuples voisins. Un peuple n'est pas moins un membre du genre humain, qui est la société générale, qu'une famille est un membre d'une nation particulière. Chacun doit infiniment plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dans laquelle il est né; il est donc infiniment plus pernicieux de blesser la justice de peuple à peuple que de la blesser de famille à famille contre sa république. Renoncer au sentiment, non seulement c'est manquer de politesse et tomber dans la barbarie, mais c'est l'aveuglement le plus dénaturé des brigands et des sauvages : c'est n'être plus homme, c'est être anthropophage.
Alcibiade. — Vous vous fâchez! il me semble que vous étiez de meilleure humeur dans le monde; vos ironies piquantes avaient quelque chose de plus enjoué.
Socrate. — Je ne saurais être enjoué sur des choses si sérieuses. Les Lacédémoniens ont abandonné tous los arts pacifiques pour ne se réserver que celui de la guerre; et comme la guerre est le plus grand des maux, ils ne savent que faire du mal; ils s'en piquent, ils dédaignent tout ce qui n'est pas la destruction du genre humain et tout ce qui ne peut servir à la gloire brutale dune poignée d'hommes qu'on appelle les Spartiates. Il faut que d'autres hommes cultivent la terre pour les nourrir, pendant qu'ils se réservent pour ravager et pour dépeupler les terres voisines. Ils ne sont pas sobres et austères contre eux-mêmes, pour être justes et modérés à l'égard d'autrui : au contraire, ils sont durs et farouches contre tout ce qui n'est point la patrie, comme si la nature humaine n'était pas plus leur patrie que Sparte. La guerre est un mal qui déshonore le genre humain..."

De savoureux "Dialogues divers entre les cardinaux Richelieu et Mazarin et autres..." complètent l'oeuvre, Richelieu haranguant Mazarin et lui demandant s'il a achevé son oeuvre, renverser le parti Huguenot, abaisser les Grands, et de lui répondre qu'il a eu bien des choses à démêler, dont soutenir une "Régence orageuse", un "Roi inappliqué et jaloux du Ministre même qui le sert donne bien plus d'embarras dans le cabinet que la foiblesse & la confusion d'une Régence, vous aviez une Reine assez ferme & sous laquelle on pouvoit plus facilement mener les affaires sous un Roi épineux qui étoit toujours aigri contre moi par quelque favori naissant. Un lel Prince ne gouverne ny ne laiffe gouverner: il faut le servir malgré lui..."
1694-1711 - Exilé dès lors dans son diocèse, il soutient une controverse avec les jansénistes, écrit des lettres de direction, prêche le Carême, et pratique si largement la charité que sa réputation de piété et de sainteté se répand jusqu'à Versailles. Il est resté en relations avec le duc de Bourgogne, et si l'élève devenait roi, le précepteur serait premier ministre. Pour le préparer à son futur rôle, Fénelon rédige "l'Examen de conscience d'un roi", écho de la mystérieuse "Lettre à Louis XIV" écrite, semble-t-il, vers 1694, où il expose avec une extrême hardiesse la vérité sur la misère de la France et la nécessité de réformes libérales : "Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir... Tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains, et personne ne peut plus vivre que de vos dons.... Cette gloire, qui endurcit votre cœur, vous est plus chère que la justice, que votre propre repos, que la conservation de vos peuples, qui périssent tous les jours de maladies causées par la famine... Si le Roi, dit-on, avait un cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain et à les faire respirer après tant de maux, qu'à garder quelques places de la frontière, qui causent la guerre?.."
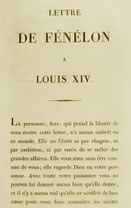
1694 - "Lettre à Louis XIV", écrite par Fénelon vers 1694-1695, non signée et l'on ne sait si elle fut effectivement remise au roi...
"La personne, Sire, qui prend la liberté de vous écrire cette lettre n'a aucun intérêt en ce monde. Elle ne l'écrit ni par chagrin, ni par ambition, ni par envie de se mêler des grandes affaires. Elle vous aime sans être connue de vous; elle regarde Dieu en votre personne. Avec toute votre puissance vous ne pouvez lui donner aucun bien qu'elle désire, et il n'y a aucun mal qu'elle ne souffrît de bon cœur pour vous faire connaître les vérités nécessaires à votre salut. Si elle vous parle fortement, n'en soyez pas étonné, c'est que la vérité est libre et forte. Vous n'êtes guère accoutumé à l'entendre. Les gens accoutumés à être flattés prennent aisément pour chagrin, pour âpreté et pour excès ce qui n'est que la vérité toute pure. C'est la trahir que de ne vous la montrer pas dans toute son étendue. Dieu est témoin que la personne qui vous parle le fait avec un cœur plein de zèle, de respect, de fidélité, et d'attendrissement sur tout ce qui regarde votre véritable intérêt.
Vous êtes né, Sire, avec un cœur droit et équitable; mais ceux qui vous ont élevé ne vous ont donné pour science de gouverner que la défiance, la jalousie, l'éloignement de la vertu, la crainte de tout mérite éclatant, le goût des hommes souples et rampants, la hauteur, et l'attention à votre seul intérêt. Depuis environ trente ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes des l'Etat, pour faire monter jusqu'au comble votre autorité, qui était devenue la leur, parce qu'elle était dans leurs mains. On n'a plus parlé de l`Etat ni des règles; on n'a parlé que du Roi et de son bon plaisir. On a poussé vos revenus et vos dépenses à l'infini. On vous a élevé jusqu'au ciel pour avoir effacé, disait-on, la grandeur de vos prédécesseurs ensemble, c'est-a-dire pour avoir appauvri la France entière, afin d'introduire à la cour un luxe monstrueux et incurable. Ils ont voulu vous élever sur les ruines de toutes les conditions de l'Etat, comme si vous pouviez être grand en ruinant tous vos sujets sur qui votre grandeur est fondée... Ils vous ont accoutumé à recevoir sans cesse des louanges outrées qui vont jusqu'à l'idolâtrie, et que vous auriez du, pour votre honneur, rejeter avec indignation. On a rendu votre nom odieux et toute la nation française insupportable à nos voisins On n'a conservé aucun ancien allié, parce qu'on n'a voulu que des esclaves... Les traités de paix signés par les vaincus ne sont point signés librement: on signe le couteau sous la gorge; on signe comme on donne sa bourse quand il faut la donner ou mourir.
(...) Cependant vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu'ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée; les villes et la campagne se dépeuplent; tous les métiers languissent et ne nourrissent plus leurs ouvriers. Tout commerce est anéantit. Par conséquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre Etat, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse, dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d'Etat. Vous êtes importuné de la foule de gens qui demandent et qui murmurent. C'est vous-même, Sire, qui vous êtes attiré tous ces embarras; car, tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains, et personne ne peut plus vivre que de vos dons. Voilà ce grand royaume si florissant sous un roi qu'on nous dépeint tous les jours comme les délices du peuple, et qui le serait en effet si les conseils flatteurs ne l'avaient point empoisonné.
Le peuple même (il faut tout dire), qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en vous, commence à perdre l'amitié, la confiance et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus; il est plein d'aigreur et de désespoir. La sédition s'allume peu à peu de toutes parts. Ils croient que vous n'avez aucune pitié de leurs maux, que vous n'aimez que votre autorité et votre gloire. Si le Roi, dit-on, avait un cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain, et à les faire respirer après tant de maux, qu'à garder quelques places de la frontière qui causent la guerre? Quelle réponse à cela, Sire ? Les émotions populaires qui étaient inconnues depuis si longtemps deviennent fréquentes. Paris même, si près de vous, n'en est pas exempt. Les magistrats sont contraints de tolérer l'insolence des matins, et de faire couler sous main quelque monnaie pour les apaiser; ainsi on paye ceux qu'il faudrait punir. Vous êtes réduit à la honteuse et déplorable extrémité, ou de laisser la sédition impunie, et de l'accroître par cette impunité, ou de faire massacrer avec inhumanité des peuples que vous mettez au désespoir en leur arrachant, par vos impôts pour cette guerre, le pain qu'ils tâchent de gagner à la sueur de leurs visages.
Mais, pendant qu'ils manquent de pain, vous manquez vous-même d'argent, et vous ne voulez pas voir l'extrémité où vous êtes réduit. Parce que vous avez toujours été heureux, vous ne pouvez vous imaginer que vous cessiez jamais de l'être. Vous craignez d'ouvrir les yeux; vous craignez qu'on ne vous les ouvre; craignez d'être réduit à rabattre quelque chose de votre gloire. Cette gloire, qui endurcit votre cœur, vous est plus chère que la justice, que votre propre repos, que la conservation de vos peuples qui périssent tous les jours des maladies causées par la famine, enfin que votre salut éternel incompatible avec cette idole de gloire. Voilà, Sire, l'état où vous êtes."
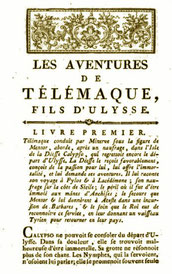
1699 - Les Aventures de Télémaque
En quoi consiste l'autorité du roi? - La politique tient dans les œuvres de Fénelon, plus de place que chez aucun autre écrivain du XVIIe siècle. Le "Télémaque", rédigé vers 1695, est sous une forme légendaire et romancée une initiation à l'art d'être roi, et surtout l'art de gouverner autrement que ne le fait le présent roi. Le sujet est censé permettre au précepteur, par ailleurs excellent helléniste, réveiller dans l'esprit de son élève mille souvenirs d'Homère et de Virgile, mythologie, tempêtes, batailles, concours athlétiques, songes, descente aux enfers, descriptions, images et comparaisons..
Accompagné de Mentor (qui n'est autre que Minerve), Télémaque, parti à la recherche de son père, est jeté par la tempête sur l'île de Calypso. Au cours du récit qu'il fait à la déesse, inconsolable depuis le départ d'Ulysse, de ses aventures, nous le voyons en Sicile où il échappe à la mort, en Egypte où il étudie la sage administration de Sésostris, à Tyr où il admire la prospérité d'un peuple de commerçants, puis échappe par miracle à la tyrannie du cruel Pygmalion. Après avoir résisté, grâce aux conseils de Mentor, aux dangereuses voluptés de Chypre, l'île de Vénus, il reprend la mer, on y plonge dans les peintures d'un Lebrun, le grand maître d'oeuvre de Versailles jusqu'en 1678....
En condamnant le despotisme et en prônant chez le monarque le souci du bien public, la justice et l'humanité, Fénelon annonce la monarchie libérale et vertueuse que définira Montesquieu, tandis qu'en condamnant le luxe il annonce les principes de Jean-Jacques Rousseau. On comprendra la sympathie qu'eurent pour Fénelon les philosophes du XVIIIe siècle. Louis XIV crut y voir une satire de son règne, le portait d'Idoménée lui ressemble étrangement, et exila l'auteur dans son diocèse de Cambrai...
(Télémaque, Livre I)
«Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant; les nymphes qui la servaient n'osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île: mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse, qu'elle y avait vu tant de fois auprès d'elle. Souvent elle demeurait immobile sur le rivage de la mer, qu'elle arrosait de ses larmes, et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau d'Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux.
Tout à coup, elle aperçut les débris d'un navire qui venait de faire naufrage, des bancs de rameurs mis en pièces, des rames écartées çà et là sur le sable, un gouvernail, un mât, des cordages flottant sur la côte; puis elle découvre de loin deux hommes, dont l'un paraissait âgé; l'autre, quoique jeune, ressemblait à Ulysse. Il avait sa douceur et sa fierté, avec sa taille et sa démarche majestueuse. La déesse comprit que c'était Télémaque, fils de ce héros. Mais, quoique les dieux surpassent de loin en connaissance tous les hommes, elle ne put découvrir qui était cet homme vénérable dont Télémaque était accompagné: c'est que les dieux supérieurs cachent aux inférieurs tout ce qu'il leur plaît; et Minerve, qui accompagnait Télémaque sous la figure de Mentor, ne voulait pas être connue de Calypso.
Cependant Calypso se réjouissait d'un naufrage qui mettait dans son île le fils d'Ulysse, si semblable à son père. Elle s'avance vers lui; et, sans faire semblant de savoir qui il est.
- D'où vous vient - lui dit-elle - cette témérité d'aborder en mon île? Sachez, jeune étranger, qu'on ne vient point impunément dans mon empire.
Elle tâchait de couvrir sous ces paroles menaçantes la joie de son coeur, qui éclatait malgré elle sur son visage.
Télémaque lui répondit:
- O vous, qui que vous soyez, mortelle ou déesse (quoique à vous voir on ne puisse vous prendre que pour une divinité), seriez-vous insensible au malheur d'un fils, qui, cherchant son père à la merci des vents et des flots, a vu briser son navire contre vos rochers?
- Quel est donc votre père que vous cherchez? - reprit la déesse.
- Il se nomme Ulysse - dit Télémaque - c'est un des rois qui ont, après un siège de dix ans, renversé la fameuse Troie. Son nom fut célèbre dans toute la Grèce et dans toute l'Asie, par sa valeur dans les combats et plus encore par sa sagesse dans les conseils. Maintenant, errant dans toute l'étendue des mers, il parcourt tous les écueils les plus terribles. Sa patrie semble fuir devant lui. Pénélope, sa femme, et moi, qui suis son fils, nous avons perdu l'espérance de le revoir. Je cours, avec les mêmes dangers que lui, pour apprendre où il est. Mais que dis-je? peut-être qu'il est maintenant enseveli dans les profonds abîmes de la mer. Ayez pitié de nos malheurs; et, si vous savez, ô déesse, ce que les destinées ont fait pour sauver ou pour perdre Ulysse, daignez en instruire son fils Télémaque.
Calypso, étonnée et attendrie de voir dans une si vive jeunesse tant de sagesse et d'éloquence, ne pouvait rassasier ses yeux en le regardant; et elle demeurait en silence. Enfin elle lui dit:
- Télémaque, nous vous apprendrons ce qui est arrivé à votre père. Mais l'histoire en est longue: il est temps de vous délasser de tous vos travaux. Venez dans ma demeure, où je vous recevrai comme mon fils: venez; vous serez ma consolation dans cette solitude; et je ferai votre bonheur, pourvu que vous sachiez en jouir.
Télémaque suivait la déesse environnée d'une foule de jeunes nymphes, au-dessus desquelles elle s'élevait de toute la tête, comme un grand chêne dans une forêt élève ses branches épaisses au-dessus de tous les arbres qui l'environnent. Il admirait l'éclat de sa beauté, la riche pourpre de sa robe longue et flottante, ses cheveux noués par-derrière négligemment mais avec grâce, le feu qui sortait de ses yeux et la douceur qui tempérait cette vivacité. Mentor, les yeux baissés, gardant un silence modeste, suivait Télémaque.
On arriva à la porte de la grotte de Calypso, où Télémaque fut surpris de voir, avec une apparence de simplicité rustique, tout ce qui peut charmer les yeux. On n'y voyait ni or, ni argent, ni marbre, ni colonnes, ni tableaux, ni statues: cette grotte était taillée dans le roc, en voûte pleine de rocailles et de coquilles; elle était tapissée d'une jeune vigne qui étendait ses branches souples également de tous côtés. Les doux zéphyrs conservaient en ce lieu, malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraîcheur. Des fontaines, coulant avec un doux murmure sur des prés semés d'amarantes et de violettes, formaient en divers lieux des bains aussi purs et aussi clairs que le cristal; mille fleurs naissantes émaillaient les tapis verts dont la grotte était environnée. Là on trouvait un bois de ces arbres touffus qui portent des pommes d'or, et dont la fleur, qui se renouvelle dans toutes les saisons, répand le plus doux de tous les parfums; ce bois semblait couronner ces belles prairies et formait une nuit que les rayons du soleil ne pouvaient percer. Là on n'entendait jamais que le chant des oiseaux ou le bruit d'un ruisseau, qui, se précipitant du haut d'un rocher, tombait à gros bouillons pleins d'écume et s'enfuyait au travers de la prairie. »
(TÉLÉMAQUE, Livre IV), l'Antiquité dans toute sa volupté sous les yeux de Télémaque et d'Hazael, son compagnon de voyage avec Mentor, le char d'Amphitrite, fille de l'Océan et épouse de Neptune...
"Pendant qu'Hazael et Mentor parlaient, nous aperçûmes des dauphins couverts d'une écaille qui paroissoit d'or et d'azur. En se jouant, ils soulevoient les flots avec beaucoup d'écume. Après eux venoient des Tritons, qui sonnoient de la trompette avec leurs conques recourbées. Ils environnoient le char d'Amphitrite , trainé par des chevaux marins plus blancs que la neige, et qui, fendant l'oncle salée, laissaient loin derrière eux un vaste sillon dans la mer. Leurs yeux étaient enflammés, et leurs bouches étaient fumantes. Le char de la déesse étoit une conque d'une merveilleuse figure; elle étoit d'une blancheur plus éclatante que l'ivoire, et les roues étaient d'or. Ce char sembloit voler sur la face des eaux paisibles. Une troupe de nymphes couronnées de fleurs nageoient en foule derrière le char, leurs beaux cheveux pendoient sur leurs épaules, et flottoicnt au gré du vent. La déesse tenait d'une main un sceptre d'or pour commander aux vagues, de l'autre elle portait sur ses genoux le petit dieu Palémon, son fils, pendant à sa mamelle. Elle avoit un visage serein et une douce majesté qui faisait fuir les vents séditieux et toutes les noires tempêtes. Les Tritons conduisoient les chevaux et tenoient les rênes dorées. Une grande voile de pourpre flottoit dans l'air au-dessus du char ; elle était à demi enflée par le souflle d'une multitude de petits zéphirs qui s'efforçoient de la pousser par leurs haleines. On voyoit au milieu des airs Eole empressé, inquiet et ardent. Son visage ridé et chagrin, sa voix menaçante, ses sourcils épais et pendants, ses yeux pleins d'un feu sombre et austere tenaient en silence les fiers Aquilons, et repoussoient tous les nuages. Les immenses baleines et tous les monstres marins, faisant avec leurs narines un flux et reflux de l'onde amere, sortaient à la hâte de leurs grottes profondes pour voir la déesse."
(Télémaque, livre V) Fénelon entend préparer le duc de Bourgogne à régner autrement, Mentor expose à Télémaque la vie "simple, frugale et laborieuse" qui assure le bonheur des Crétois et lui décrit le sage gouvernement par lequel Minos leur a donne la prospérité...
"Je lui demandai en quoi consistait l'autorité du roi, et il me répondit: "Il peut tout sur les peuples; mais les lois peuvent tout sur lui. Il a une puissance absolue pour faire le bien, et les mains liées dès qu'il veut faire le mal. Les lois, lui confient les peuples comme le plus précieux de tous les dépôts, à condition qu'il sera le père de ses sujets. Elles veulent qu'un seul homme serve, par sa sagesse et par sa modération, à la félicité de tant d'hommes; et non pas que tant d'hommes servent, par leur misère et par leur servitude lâche, à flatter l'orgueil et la mollesse d'un seul homme. Le roi ne doit rien avoir au-dessus des autres, excepté ce qui est nécessaire ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions, ou pour imprimer aux peuples le respect de celui qui doit soutenir les lois. D'ailleurs le roi doit être plus sobre, plus ennemi de la mollesse, plus exempt de faste et de hauteur, qu'aucune autre. Il ne doit point avoir plus de richesses et de plaisirs, mais plus de sagesse, de vertu et de gloire que le reste des hommes. Il doit être au dehors le défenseur de la patrie, en commandant les armées; et au dedans, le juge des peuples, pour les rendre bons, sages et heureux. Ce n'est point pour lui-même que les dieux l'ont fait roi : il ne l'est que pour être l'homme des peuples : c'est aux peuples qu'il doit tout son temps, tous ses soins, toute son affection : et il n'est digne de la royauté qu'autant qu'il s'oublie lui-même pour se sacrifier au bien public.
Minos n'a voulu que ses enfants régnassent après lui qu'à condition qu'ils régneraient suivant ces maximes : il aimait encore plus son peuple que sa famille. C'est par une telle sagesse qu'il a rendu la Crète si puissante et si heureuse; c'est par cette modération qu'il a effacé la gloire de tous les conquérants qui veulent faire servir les peuples à leur grandeur, c'est-à-dire à leur vanité ; enfin, c°est par sa justice qu'il a mérité d'être aux enfers le souverain juge des morts."
En Crète, Télémaque se distingue tant et si bien si bien aux concours athlétiques et aux "concours de sagesse" que les Crétois décident de le prendre pour roi. Mais, toujours en quête de son père, il s'est rembarqué, et la tempête l'a jeté sur l'île de Calypso. Emerveillée par ce récit, Calypso s'éprend de Télémaque, mais le jeune homme, victime de Vénus, est pris d'une violente passion pour la nymphe Eucharis. Pour l'arracher â cette dernière, Mentor n'a que la ressource de le précipiter à la mer, et tous deux gagnent â la nage un vaisseau phénicien. Sur le navire, Télémaque entend vanter le bonheur des habitants de la Bétique ÉTIQUE, "qui n'ont appris la sagesse qu'en étudiant la simple nature " Neptune les pousse alors dans le port de Salente, en Hespérie : ils y sont accueillis par Idoménée, roi chassé de Crète pour son despotisme.
".. Voyez-vous ces nymphes? disait-il à Mentor : combien sont-elles différentes de ces femmes de l'île de Chypre, dont la beauté était choquante à cause de leur immodestie! Ces beautés immortelles montrent une innocence, une modestie, une simplicité qui charme." Parlant ainsi, il rougissait sans savoir pourquoi. Il ne pouvait s'empêcher de parler; mais à peine avait-il commencé, qu'il ne pouvait continuer : ses paroles étaient entrecoupées, obscures, et quelquefois elles n'avaient aucun sens. Mentor lui dit : « Télémaque, les dangers de l'île de Chypre n'étaient rien, si on les compare à ceux dont vous ne vous défiez pas maintenant. Le vice grossier fait horreur : l'impudence brutale donne de l'indignation; mais la beauté modeste est bien plus dangereuse : en l'aimant, on croit n'aimer que la vertu; et insensiblement on se laisse aller aux appas trompeurs d'une passion qu'on n'aperçoit que quand il n'est presque plus temps de l'éteindre. Fuyez, ô mon cher Télémaque, fuyez ces nymphes, qui ne sont si discrètes que pour vous mieux tromper; fuyez les dangers de votre jeunesse : mais surtout fuyez cet enfant que vous ne connaissez pas. C'est l'Amour, que Vénus, sa mère, est venue apporter dans cette île, pour se venger du mépris que vous avez témoigné pour le culte qu'on lui rend à Cythère : il a blessé le cœur de la déesse Calypso; elle est passionnée pour vous : il a brûlé toutes les nymphes qui l'environnent; vous brûlez vous-même, ô malheureux jeune homme, presque sans le savoir. » Télémaque interrompait souvent Mentor, en lui disant: « Pourquoi ne demeurerions-nous pas dans cette île? Ulysse ne vit plus; il doit être depuis longtemps enseveli dans les ondes; Pénélope, ne voyant revenir ni lui ni moi, n'aura pu résister à tant de prétendants : son père Icare l'aura contrainte d'accepter un nouvel époux. Retournerai-je à Ithaque, pour la voir engagée dans de nouveaux liens et manquant à la foi qu'elle avait donnée à mon père? Les Ithaciens ont oublié Ulysse. Nous ne pourrions y retourner que pour chercher une mort assurée, puisque les amants de Pénélope ont occupé toutes les avenues du port, pour mieux assurer notre perte à notre retour. » Mentor répondait : « Voilà l'effet d'une aveugle passion. On cherche avec subtilité toutes les raisons qui la favorisent, et on se détourne de peur de voir toutes celles qui la condamnent. On n'est plus ingénieux que pour se tromper, et pour étouffer ses remords. Avez-vous oublié tout ce que les dieux ont fait pour vous ramener dans votre patrie? Comment êtes-vous sorti de la Sicile? Les malheurs que vous avez éprouvés en Egypte ne se sont-ils pas tournés tout à coup en prospérités? Quelle main inconnue vous a enlevé à tous les dangers qui menaçaient votre tête dans la ville de Tyr? Après tant de merveilles, ignorez-vous encore ce que les destinées vous ont préparé? Mais, que dis-je? vous en êtes indigne! Pour moi, je pars, et je saurai bien sortir de cette île. Lâche fils d'un père si sage et si généreux! menez ici une vie molle et sans honneur au milieu des femmes; faites, malgré les dieux, ce que votre père crut indigne de lui. »
Ces paroles de mépris percèrent Télémaque jusqu'au fond du cœur. Il se sentait attendri pour Mentor; sa douleur était mêlée de honte : il craignait l'indignation et le départ de cet homme si sage à qui il devait tant : mais une passion naissante, et qu'il ne connaissait pas lui-même, faisait qu'il n'était plus le même homme. « Quoi donc, disait-il à Mentor, les larmes aux yeux, vous ne comptez pour rien l'immortalité qui m'est offerte par la déesse? » « Je compte pour rien, répondait Mentor, tout ce qui est contre la vertu et contre les ordres des dieux. La vertu vous rappelle dans votre patrie pour revoir Ulysse et Pénélope; la vertu vous défend de vous abandonner à une folle passion. Les dieux, qui vous ont délivré de tant de périls pour vous préparer une gloire égale à celle de votre père, vous ordonnent de quitter cette île. L'amour seul, ce honteux tyran, peut vous y retenir. Hé! que feriez-vous d'une vie immortelle, sans vertu, sans gloire? Cette vie serait encore plus malheureuse, en ce qu'elle ne pourrait finir. »
Télémaque ne répondait à ce discours que par des soupirs. Quelquefois il aurait souhaité que Mentor l'eût arraché malgré lui de cette île; quelquefois il lui tardait que Mentor fût parti, pour n'avoir plus devant ses yeux cet ami sévère qui lui reprochait sa faiblesse. Toutes ces pensées contraires agitaient tour à tour son cœur, et aucune n'y était constante : son cœur était comme la mer, qui est le jouet de tous les vents contraires. Il demeurait souvent étendu et immobile sur le rivage de la mer, souvent dans le fond de quelque bois sombre, versant des larmes amères et poussant des cris semblables aux rugissements d'un lion. Il était devenu maigre, ses yeux creux étaient pleins d'un feu dévorant; à le voir pâle, abattu et défiguré, on aurait cru que ce n'était point Télémaque. Sa beauté, son enjouement, sa noble fierté s'enfuyaient loin de lui. Il périssait : tel qu'une fleur qui, étant épanouie le matin, répandait ses doux parfums dans la campagne et se flétrit peu à peu vers le soir; ses vives couleurs s'effacent; elle languit, elle se dessèche, et sa belle tête se penche, ne pouvant plus se soutenir : ainsi le fils d'Ulysse était aux portes de la mort.
Mentor, voyant que Télémaque ne pouvait résister à la violence de sa passion, conçut un dessein plein d'adresse pour le délivrer d'un si grand danger...."
(Livre VII) Quel est le secret des peuples heureux?
"Le fleuve Bétis coule dans un pays fertile, et sous un ciel doux, qui est toujours serein. Le pays a pris le nom du fleuve, qui se jette dans le grand Océan, assez près des colonnes d'Hercule et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, sépara autrefois la terre
de Tharsis d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir conservé les délices de l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes, et les rigoureux aquilons n'y soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs rafraîchissants, qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour. Ainsi toute l'année n'est qu'un heureux hymen du Printemps et de l'Automne, qui semblent se donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque année une double moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins, et d'autres arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de troupeaux, qui fournissent des laines fines recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent dans ce beau pays; mais les habitants, simples et heureux dans leur simplicité, ne daignent pas seulement compter l'or et l'argent parmi leurs richesses: ils n'estiment que ce qui sert véritablement aux besoins de l'homme.
« Quand nous avons commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l'or et l'argent parmi eux employés aux mêmes usages que le fer; par exemple, pour des socs de charrue. Comme ils ne faisaient aucun commerce au dehors, ils n'avaient besoin
d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays peu d'artisans : car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables nécessités des hommes; encore même la plupart des hommes en ce pays, étant adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les arts nécessaires pour leur vie simple et frugale.
« Les femmes filent cette belle laine, et en font des étoffes fines d'une merveilleuse blancheur : elles font le pain, apprêtent à manger; et ce travail leur est facile, car on vit en ce pays de fruit ou de lait, et rarement de viande. Elles emploient le cuir de leurs moutons à faire une chaussure légère pour elles, pour leurs maris et pour leurs enfants; elles font des tentes, dont les unes sont de peaux cirées et les autres d'écorces d'arbres; elles font et lavent tous les habits de la famille, et tiennent les maisons dans un ordre et une propreté admirables. Leurs habits sont aisés à faire; car, en ce doux climat, on ne porte qu'une pièce d'étoffe fine et légère, qui n'est point taillée et que chacun met à longs plis autour de son corps pour la modestie, lui donnant la forme qu'il veut. Les hommes n'ont d'autres arts à exercer, outre la culture des terres et la conduite des troupeaux, que l'art de mettre le bois et le fer en œuvre; encore même ne se servent-ils guère du fer, excepté pour les instruments nécessaires au labourage. Tous les arts qui regardent l'architecture leur sont inutiles; car ils ne bâtissent jamais de maisons. C'est, disent-ils, s'attacher trop à la terre, que de s'y faire une demeure qui dure beaucoup plus que nous; il suffit de se défendre des injures de l'air. Pour tous les autres arts estimés chez les Grecs, chez les Égyptiens et chez tous les autres peuples bien policés, ils les détestent, comme des inventions de la vanité et de la mollesse.
« Quand on leur parle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superbes, des meubles d'or et d'argent, des étoffes ornées de broderies et de pierres précieuses, des parfums exquis, des mets délicieux, des instruments dont l'harmonie charme, ils répondent en
ces termes : Ces peuples sont bien malheureux d'avoir employé tant de travail et d'industrie à se corrompre eux-mêmes! Ce superflu amollit, enivre, tourmente ceux qui le possèdent : il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir par l'injustice et par la violence. Peut-on nommer bien, un superflu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais? Les hommes de ces pays sont-ils plus sains et plus robustes que nous? vivent-ils plus longtemps? sont-ils plus unis entre eux? mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie? Au contraire, ils doivent être jaloux les uns des autres, rongés par une noire et lâche envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par l'avarice, incapables des plaisirs purs et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités « dont ils font dépendre tout leur bonheur..."
Toute la deuxième partie du roman se déroule autour de Salente. Au cours d'épisodes inspirés des épopées antiques, Télémaque va faire son apprentissage de chef militaire. S'il se distingue par ses exploits, il apprend aussi à dominer ses impulsions violentes, à se montrer équitable en toutes circonstances, à privilégier la paix sur la guerre. Mentor, resté à Salente, expose à Idoménée, jusque là abusé par les flatteur, les réformes qui assureront le bonheur et la prospérité de son peuple (LIVRE X). Salente cet âge d'or dont, bien avant ROUSSEAU, Fénelon politique et moraliste avait déjà concu le rêve. (TÉLÉMAQUE, Livre XVII.)
"Télémaque regardait de tous côtés avec étonnement, et disait à Mentor : "Voici un changement dont je ne comprends pas bien la raison. Est-il arrivé quelque calamité à Salente pendant mon absence? D'où vient qu'on n'y remarque plus cette magnificence qui éclatait partout avant mon départ? ]e ne vois plus ni or, ni argent, ni pierres précieuses; les habits sont simples : les bâtiments qu'on fait sont moins vastes et moins ornés ; les arts languissent, la ville est devenue une solitude."
Mentor lui répondit en souriant : "Avez-vous remarqué l'état de la campagne autour de la ville?
- Oui, reprit Télémaque; j'ai vu partout le labourage en honneur et les champs défrichés.
- Lequel vaut mieux, ajouta Mentor, ou une ville superbe en marbre, en or et en argent, avec une campagne négligée et stérile, ou une campagne cultivée et fertile, avec une ville médiocre et modeste dans ses mœurs? Une grande ville fort peuplée d'artisans occupés à amollir les moeurs par les délices de la vie, quand elle est entourée d'un royaume pauvre et mal cultivé, ressemble à un monstre dont la tête est d'une grosseur énorme et dont tout le corps, exténué et privé de nourriture, n'a aucune proportion avec cette tête. C'est le nombre du peuple et l'abondance des aliments qui font la vraie force et la vraie richesse d'un royaume.
Idoménée a maintenant un peuple innombrable et infatigable dans le travail, qui remplit toute l'étendue de son pays. Tout son pays n'est plus qu'une seule ville : Salente n'en est que le centre. Nous avons transporté de la ville dans la campagne les hommes qui manquaient à la campagne, et qui étaient superflus dans la ville. De plus, nous avons attiré dans ce pays beaucoup de peuples étrangers. Plus ces peuples se multiplient, plus ils multiplient les fruits de la terre par leur travail; cette multiplication si douce et si paisible augmente plus son royaume qu'une conquête.
On n'a rejeté de cette ville que les arts superflus, qui détournent les pauvres de la culture de la terre pour les vrais besoins, et qui corrompent les riches en les jetant dans le faste et dans la mollesse : mais nous n'avons fait aucun tort aux beaux-arts, ni aux hommes qui ont un vrai génie pour les cultiver. Ainsi Idoménée est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était quand vous admiriez sa magnificence. Cet éclat éblouissant cachait une faiblesse et une misère qui eussent bientôt renversé son empire : maintenant il a un plus grand nombre d'hommes, et il les nourrit plus facilement. Ces hommes, accoutumés au travail, à la peine et au mépris de la vie par l'amour des bonnes lois, sont tous prêts à combattre pour défendre ces terres cultivées de leurs propres mains. Bientôt cet Etat, que vous croyez déchu, sera la merveille de l'Hespérie.
"Souvenez-vous, ô Télémaque, qu'il y a deux choses pernicieuses, dans le gouvernement des peuples, auxquelles on n'apporte presque jamais aucun remède : la première est une autorité injuste et trop violente dans les rois; la seconde est le luxe, qui corrompt les mœurs."
"Quand les rois s'accoutument à ne connaître plus d'autres lois que leurs volontés absolues, et qu'ils ne mettent plus de frein à leurs passions, ils peuvent tout : mais à force de tout pouvoir, ils sapent les fondements de leur puissance; ils n'ont plus de règle certaine ni de maximes de gouvernement. Chacun à l'envi les flatte ; ils n'ont plus de peuple ; il ne leur reste que des esclaves, dont le nombre diminue chaque jour. Qui leur dira la vérité? Qui donnera des bornes à ce torrent? Tout cède; les sages s'enfuient, se cachent, et gémissent. Il n'y a qu'une révolution soudaine et violente qui puisse ramener dans son cours naturel cette puissance débordée : souvent même le coup qui pourrait la modérer l'abat sans ressource. Rien ne menace tant d'une chute funeste qu'une autorité qu'on pousse trop loin : elle est semblable à un arc trop tendu, qui se rompt enfin tout à coup si on le relâche : mais qui est-ce qui osera le relâcher?"
"L'autre mal, presque incurable, est le luxe. Comme la trop grande autorité empoisonne les rois, le luxe empoisonne toute une nation. On dit que ce luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des riches; comme si les pauvres ne pouvaient pas gagner leur vie plus utilement, en multipliant les fruits de la terre, sans amollir les riches par des raffinements de volupté. Toute une nation s'accoutume à regarder comme les nécessités de la vie les choses les plus superflues : ce sont tous les jours de nouvelles nécessités qu'on invente, et on ne peut plus se passer des choses qu'on ne connaissait point trente ans auparavant... Les proches parents du roi veulent imiter sa magnificence; les grands, celles des parents du roi; les gens médiocres veulent égaler les grands... Toute une nation se ruine, toutes les conditions se confondent. La passion d'acquérir du bien pour soutenir une vaine dépense corrompt les âmes les plus pures : il n'est plus question que d'être riche ; la pauvreté est une infamie... Mais qui remédiera à ces maux? Il faut changer le goût et les habitudes de toute une nation; il faut lui donner de nouvelles lois. Qui le pourra entreprendre, si ce n'est un roi philosophe ...?"
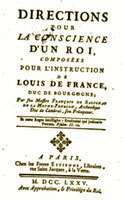
1699-1734 - Examen de conscience d'un roi
L'Examen de conscience fut tout d'abord joint par le marquis de Fénelon, neveu de l'auteur, à l'édition qu'il donna du Télémaque, en 1734, puis retranché et publié, seul, en 1747 en français et en anglais, Examen de conscience pour un roi, Proper heads of self-examination for a king...
Le duc de Bourgogne devait être roi; c'est à lui que s'adressait Fénelon quand il écrivit l'Examen de conscience sur les devoirs de la Royauté; c'es à lui qu'il pensait quand il faisait, de concert avec Chevreuse, les Tables de Chaulnes. Derrière son élève il voyait la France et le peuple qu'il voulait heureux. Dans la Correspondance politique avec le duc de Chevreuse, dans ses Mémoires, dans ses Entretiens avec Ramsay d'où est sorti l'Essai philosophique sur le gouvernement civil, Fénelon n'a qu'un but : le bonheur de la France sur le trône de laquelle il veut mettre un roi digne de saint Louis, l'idéal de sa royauté. C'est que le gouvernement de Louis XIV avait mis le pays dans un état précaire et inquiétant. Bossuet n'avait pas vu que la machine de l'État se détraquait sur la fin du XVIIe siècle; il n'a pas douté un seul instant de la perpétuité de la monarchie. Fénelon, plus clairvoyant, entendait les sourdes plaintes des peuples; à la cour même il avait démêlé ce qu'avait de fragile ce colosse monarchique. Il avait fait le diagnostic de la maladie mortelle de la royauté. Cette pièce un peu déclamatoire dans la forme, comme le genre le comportait, est une sorte de discours au duc de Bourgogne devenu roi. Il ne s'agit plus de la morale du roman du Télémaque, c'est une morale politique concrète, ce sont des conseils pressants (conseils sur la connaissance des hommes et le choix des ministres, conduite à leur égard, abus des favoris... etc). Fénelon embrasse tous les actes et toutes les pensées possibles d'un roi. Le but principal de l'auteur est visiblement d'inspirer à son royal lecteur un sentiment profond de la grandeur de la tâche qu'il aurait à remplir (Moïse Cagnac)..
« Avez-vous étudié la vraie forme du gouvernement de votre royaume ? Il ne suffit pas de savoir les lois qui règlent la propriété des terres et autres biens entre les particuliers : il s'agit de celles que vous devez garder entre votre nation et vous, entre vous et vos voisins... Avez-vous étudié les lois fondamentales et les coutumes qui ont force de loi pour le gouvernement général de votre nation particulière? Avez-vous cherché sans vous flatter quelles sont les bornes de votre autorité ? Savez-vous par quelles formes le royaume s'est gouverné sous les diverses races; ce qu'étaient les anciens Parlements et les États généraux qui leur ont succédé?... Croyez-vous que Dieu souffre que vous régniez, si vous régnez sans être instruit de ce qui doit borner et régler votre puissance ! »
Fénelon semblait sentir combien les peuples grandissaient comme les individus et que les monarchies absolues devaient se résoudre en monarchies constitutionnelles. Il demandait dans les Tables de Chaulnes, et dans sa correspondance avec Chevreuse, la décentralisation et les Assemblées provinciales : « Établissement d'Etats particuliers, écrit-il, dans toutes les provinces, comme en Languedoc » qui se trouvait si bien d'être gouverné de la sorte : « on n'y est pas moins soumis qu'ailleurs, on y est moins épuisé ». Il écrivait en 1710 au duc de Chevreuse, alors que la France décimée par la misère et la faim reculait devant les armées espagnoles : « Notre mal vient de ce que cette guerre n'a été jusqu'ici que l'affaire du roi... il faudrait en faire l'affaire véritable de tout le corps de la nation... il faudrait qu'il se répandît dans toute la nation une persuasion intime et constante que c'est la nation elle-même qui soutient le poids de la guerre... Alors chacun dirait en soi-même : il n'est plus question du passé, il est question de l'avenir. C'est la nation qui doit se sauver elle-même. » Dans son système politique fondé sur la justice et la vérité, il n'y a point de place pour la guerre; c'est la fraternité des peuples ; « un peuple n'est pas moins un membre du genre humain qui est la société générale, qu'une famille est un membre d'une nation particulière ».
« Tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de toute la terre. Tous les peuples sont frères et doivent s'aimer comme tels. Malheur à ces impies qui cherchent une gloire cruelle dans le sang! La guerre est quelquefois nécessaire, il est vrai, mais c'est la honte du genre humain qu'elle soit inévitable en certaines occasions. » Il maudit la guerre, « le plus grand des maux dont les dieux affligent les hommes ». Les terres incultes, le commerce troublé, les lois affaiblies, les mœurs corrompues : voilà le résultat de la guerre. Le succès des armes ne l'éblouit pas. Il sait que la guerre est presque aussi funeste au peuple victorieux qu'aux nations vaincues. Ce sont là des idées avancées dans cette société des Condé, des Turenne, des Villars. C'est l'espérance ou du moins le vœu de la suppression de la guerre. Et les grands principes de justice reviennent à chaque instant. Cela résonnait fortement aux oreilles du duc de Bourgogne : « Croyez-vous que les rois puissent employer d'abord la violence pour soutenir leurs prétentions sans avoir tenté toutes les voies de douceur et d'humanité? »
Mais la mort frappa le grand Dauphin et son fils, à un an de distance, et la France se réveilla un jour avec Louis XV...
1711-1715 - Brusquement, en 1711, la mort du Grand Dauphin, relaté par Saint-Simon avec un cynisme peu commun, élève le duc de Bourgogne au rang de Dauphin : tous les yeux se tournent alors vers Fénelon. Celui-ci rencontre le duc de Chevreuse à Chaulnes, en Picardie, et rédige avec lui les "Tables de Chaulnes" (1711), un récapitulatif de réformes pour redresser le royaume avec des États généraux aux pouvoirs politiques suffisamment étendus "pour abolir tous privilèges, toutes lettres d'État (de cachet) abusives" , le rejet de toute guerre qui épuise tant les Etats et dépeuple les pays, l'abandon du luxe corrupteur en faveur d'une vie saine conformes "aux vraies nécessités de la nature"....
Mais, quelques mois plus tard, en février 1712, la mort du Dauphin vient dissiper ces rêves. Désormais Fénelon, désabusé, cherche une consolation dans la littérature et donne en 1714 la "Lettre á l'Académie", publiée en 1716, et meurt en janvier 1715....

1714 - Fénelon, dans sa "Lettre à l'Académie" (1714) expose à ses confrères un programme ambitieux visant enrichir une langue, qu'il considère trop appauvrie depuis Malherbe, défend une éloquence structurée mais vivante, - "l'homme digne d'être écouté est celui qui ne sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour la vérité et la vertu" -, célèbre le pouvoir civilisateur de la poésie, critique la tragédie de son temps et défend la "couleur historique" dans l'écriture de l'histoire: "notre nation ne doit pas être peinte d'une façon uniforme, elle a eu des changements continuels", "les moeurs et l'état de tout le corps de la nation ont changé d'âge en âge.."
En 1694, Bossuet dans ses "Maximes et Réflexions sur la Comédie" avait vigoureusement attaqué Molière, auteur de pièces "où la vertu et la piété sont toujours ridicules, la corruption toujours excusée et toujours plaisante, et la pudeur toujours offensée". C'est le principe même du théâtre que Bossuet condamnera. Fénelon est l'un des premiers écrivains à défendre Molière et à le placer au-dessus des anciens, mais avec quelques réserves...
"Il faut avouer que Molière est un grand poète comique. Je ne crains pas de dire qu'il a enfoncé plus avant que Térence dans certains caractères ; il a embrassé une plus grande variété de sujets; il a peint par des traits forts presque tout ce que nous voyons de déréglé et de ridicule. Terence se borne à représenter des vieillards avares et ombrageux, de jeunes hommes prodigues et étourdis, des courtisanes avides et impudentes, des parasites bas et flatteurs, des esclaves imposteurs et scélérats. Ces caractères méritaient sans doute d'être traités suivant les moeurs des Grecs et des Romains. De plus, nous n'avons que six pièces de ce grand auteur. Mais enfin, Molière a ouvert un chemin tout nouveau. Encore une fois, je le trouve grand : mais ne puis-je pas parler en toute liberté de ses défauts?
En pensant bien, il parle souvent mal ll se sert des phrases les plus forcées et les moins naturelles. Terence dit en quatre mots, avec la plus élégante simplicité, ce que celui-ci ne dit qu'avec une multitude de métaphores qui approchent du galimatias. J'aime bien mieux sa prose que ses vers. Par exemple, l'Avare est moins mal écrit que les pièces qui sont en vers. Il est vrai que la versification française l'a gêné ; il est vrai même qu'il a mieux réussi pour les vers dans l'Amphítryon, où il a pris la liberté de faire des vers irréguliers. Mais en général, il me paraît, jusque dans sa prose, ne parler point assez simplement pour exprimer toutes les passions.
D'ailleurs, il a outré souvent les caractères : il a voulu, par cette liberté, plaire au parterre, frapper les spectateurs les moins délicats, et rendre le ridicule plus sensible. Mais quoiqu'on doive marquer chaque passion dans son plus fort degré, et par ses traits les plus vifs, pour en mieux montrer l'excès et la difformité, on n'a pas besoin de forcer la nature, et d'abandonner le vraisemblable...
Un autre défaut de Molière, que beaucoup de gens d'esprit lui pardonnent, et que je n'ai garde de lui pardonner, est qu'il a donné un tour gracieux au vice, avec une austérité ridicule et odieuse à la vertu. Je comprends que ses défenseurs ne manqueront pas de dire qu'il a traité avec honneur la vraie probité, qu'il n'a attaqué qu'une vertu chagrine et qu'une hypocrisie détestable. Mais, sans entrer dans cette longue discussion, je soutiens que Platon et les autres législateurs de l'antiquité païenne n'auraient jamais admis dans leur République un tel jeu sur les mœurs. Enfin, je ne puis m'empêcher de croire avec M. Despréaux que Molière, qui peint avec tant de force et de beauté les mœurs de son pays, tombe trop bas quand il imite le badinage de la Comédie italienne..." (Lettre à l'Académie, chap. VII.)
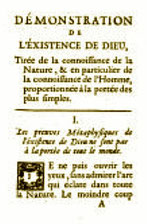
1712 - Démonstration de l’existence de Dieu tirée de la connaissance de la nature.
Au début du XVIIIe siècle, trois livres se lisaient dans toute l'Europe : les "Pensées" de Pascal, parues en 1670; le "Discours sur l'Histoire universelle" de Bossuet, en 1681, et "le traité de l'Existence de Dieu" en 1712, de Fénelon. On a souvent écrit que par sa littérature Fénelon avait fait du tort à sa philosophie. Son traité de l'Existence de Dieu doit être enrichi de ses Lettres sur quelques sujets de Métaphysique et de Religion, sa réfutation de Malebranche, ses entretiens avec Ramsay. Sa méthode dans la recherche de la vérité est toute cartésienne : « moi qui doute, je pense ; si je pense, quelque chose existe » et Fénelon non content d'adopter ces principes de Descartes, les commente, les développe, et paraît tenir encore plus que son maître à prolonger ce doute préalable jusqu'à ce qu'il ait enfin trouvé une raison solide pour en sortir. Les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, Fénelon les expose et les fait siennes. II reprend l'argument de saint Anselme déjà modifié par Descartes et lui donne une forme et un caractère personnels. Mais en même temps, il revient à la preuve des causes finales que Descartes a rejetée. La philosophie cartésienne divisait le monde en deux parties nettement séparées : d'un côté, le monde de la matière ou de l'étendue, qu'elle abandonnait au mécanisme: de l'autre, le monde de la pensée, dans lequel elle expliquait tout par l'action immédiate de Dieu. Or une des conséquences que Descartes avait cru pouvoir tirer de sa théorie mécaniste, c'était que la science devait étudier uniquement les causes efficientes et renoncer à l'étude des causes finales. Fénelon n'a pas pensé ainsi et a repris cette preuve, une des plus anciennes et d'autant plus populaires qu'elle s'adresse à l'entendement : l'intelligence comme cause du monde et de tout l'ordre remonte à Anaxagore! A Platon Fénelon emprunte la preuve des vérités éternelles; à Aristote, la preuve cosmologique. Et il ne parle d'aucune des preuves dites morales, ni du consentement universel, ni des aspirations du cœur. Les preuves traditionnelles suffisaient désormais, la preuve dite des causes finales s'imposait d'elle-même, on n'invoquait plus d'arguments métaphysiques : il faut dire que le kantisme avait miné la citadelle métaphysique, en mettant en question la valeur objective des idées...
En attendant, dans la la 1e partie du traité de l'Existence de Dieu, la question de la finalité telle qu'exposée par Fénelon est un modèle du genre...
"Preuves métaphysiques de l'existence de Dieu.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES. Tous mes soins pour douter ne me peuvent donc plus empêcher de croire certainement plusieurs vérités. La première est que je pense quand je doute. La seconde, que je suis un être pensant, c'est-à-dire dont la nature est de penser; car je ne connais encore que cela de moi. La troisième, d'où les deux autres premières dépendent, est qu'une même chose ne peut tout ensemble exister et n'exister pas; car, si je pouvais tout ensemble être et n'être pas, je pourrais aussi penser et n'être pas. La quatrième, que ma raison ne consiste que dans mes idées claires, et qu'ainsi je puis affirmer d'une chose tout ce qui est clairement renfermé dans l'idée de cette chose-là ; autrement, je ne pourrais conclure que je suis puisque je pense. Ce raisonnement n'a aucune force, qu'à cause que l'existence est clairement renfermée dans l'idée de la pensée. Penser est une action et une manière d'être; donc il est évident, par cet exemple, qu'on peut assurer d'une chose tout ce qui est clairement renfermé dans son idée : hésiter encore là-dessus, ce n'est plus exactitude et force d'esprit pour douter de ce qui est douteux; c'est légèreté et irrésolution; c'est inconstance d'un esprit flottant, qui ne sait rien saisir par un jugement ferme, qui n'embrasse ni ne suit rien, à qui la vérité connue échappe, et qui se laisse ébranler, contre ses plus parfaites convictions, par toutes sortes de pensées vagues.
Ce fondement immobile étant posé, je me réjouis de connaître quelques vérités; c'est là mon véritable bien; mais je suis bien pauvre : mon esprit se trouve rétréci dans quatre vérités; je n'oserais passer au delà sans crainte de tomber dans l'erreur. Ce que je connais n'est presque rien; ce que j'ignore est infini; mais peut-être que je tirerai insensiblement du peu que je connais déjà quelque partie de cet infini qui m'est jusqu'ici inconnu.
Je connais ce que j'appelle moi, qui pense, et à qui je donne le nom d'esprit. Hors de moi je ne connais encore rien; je ne sais s'il y a d'autres esprits que le mien, ni s'il y a des corps. Il est vrai que je crois apercevoir un corps, c'est-à-dire une étendue qui m'est propre, que je remue comme il me plaît, et dont les mouvements me causent de la douleur ou du plaisir. Il est vrai aussi que je crois voir d'autres corps à peu près semblables au mien, dont les uns se meuvent et les autres sont immobiles autour de moi. Mais je me tiens ferme à ma règle inviolable, qui est de douter sans relâche de tout ce qui peut être tant soit peu douteux.
Non seulement tous ces corps qu'il me semble apercevoir, tant le mien que les autres, mais encore tous les esprits qui me paraissent en société avec moi, qui me communiquent leurs pensées, et qui sont attentifs aux miennes, tous ces êtres, dis-je, peuvent n'avoir rien de
réel, et n'être qu'une pure illusion qui se passe tout entière au dedans de moi seul; peut-être suis-je moi seul toute la nature. N'ai-je pas l'expérience que, quand je dors, je crois voir, entendre, toucher, flairer, goûter ce qui n'est point et qui ne sera jamais? Tout ce qui me frappe pendant mon songe, je le porte au dedans de moi, et au dehors il n'y a rien de vrai. Ni les corps que j'imagine sentir, ni les esprits que je me représente en société de pensée avec le mien, ne sont ni esprits ni corps; ils ne sont, pour ainsi dire, que mon erreur. Qui me répondra, encore une fois, que ma vie entière ne soit point un songe et un charme que rien ne peut rompre? Il faut donc par nécessité suspendre encore mon jugement sur tous ces êtres qui me sont suspects de fausseté.
Étant ainsi comme repoussé par tout ce que je m'imagine connaître au dehors de moi, je rentre au dedans, et je suis encore étonné dans cette solitude au fond de moi-même. Je me cherche, je m'étudie; je vois bien que je suis; mais je ne sais ni comment je suis, ni si j'ai
commencé à être, ni par où j'ai pu exister. prodige! je ne suis sur que de moi-même ; et ce moi où je me renferme m'étonne, me surpasse, me confond et m'échappe, dès que je prétends le tenir. Me suis-je fait moi-même? Non, car pour faire il faut être: le néant ne fait rien : donc, pour me faire, il aurait fallu que j'eusse été avant que d'être; ce qui est une manifeste contradiction. Ai-je toujours été? Suis-je par moi-même?
Il me semble que je n'ai pas toujours été; je ne connais mon être que par la pensée, je suis un être pensant. Si j'avais toujours été, j'aurais toujours pensé: si j'avais toujours pensé, ne me souviendrais-je point de mes pensées? Ce que j'appelle mémoire, c'est ce qui fait
connaître ce que l'on a pensé autrefois. Mes pensées se replient sur elles-mêmes: en sorte qu'en pensant, je m'aperçois que je pense, et ma pensée se connaît elle-même; il m'en reste une connaissance, après même qu'elle est passée, qui fait que je la retrouve quand il me plaît, et c'est ce que j'appelle souvenir. Il y a donc bien de l'apparence que, si j'avais toujours pensé, je m'en souviendrais...."
Enfin notons que la correspondance de l'Archevêque de Cambrai, et notamment ses Lettres spirituelles, constituent pour nombre de spécialistes, mais pas que, la partie la plus intéressante de ses œuvres, ses correspondants, c'est le duc de Bourgogne et Mme de Maintenon, c'est Beauvilliers, Chevreuse et son fils, le duc de Chaulne, les duchesses, filles de Colbert, et leurs frères, Seignelay et Blainville, la duchesse de Gramont, née Hamilton, la comtesse de Montberon... "Pour la personne dont vous me parlez, vous n'avez qu'à faire ce que j'imagine que vous faites, qui est de l'attendre, de ne la pousser jamais, de la laisser presser intérieurement à Dieu seul, de lui dire ce que Dieu vous donne. quand elle vient à vous! de le lui dire doucement, avec amitié, support, patience et consolation...."
Dans une lettre très connue, adressée, croit-on, à Mme de Mortemart, Fénelon a fait lui-même son examen de conscience :
« Je ne veux jamais flatter qui que ce soit, et même dès le moment que j'aperçois dans ce que je dis ou dans ce que je fais, quelque recherche de moi-même, je cesse d'agir ou de parler ainsi. Mais je suis tout pétri de boue, et j'éprouve que je fais à tout moment des fautes, pour n'agir point par grâce. Je me retranche à m'apetisser à la vue de ma hauteur. Je tiens à tout d'une certaine façon et cela est incroyable; mais d'autre façon, j'y tiens peu, car je me laisse assez facilement détacher de la plupart des choses qui peuvent me flatter. Je n'en sens pas moins l'attachement foncier à moi-même. Au reste, je ne puis expliquer mon fond. Il m'échappe, il me parait changer à toute heure. Je n'en saurais guère rien dire qui ne me paraisse faux un moment après. Le défaut subsistant et facile à dire, c'est que je tiens à moi, et que l'amour- propre me décide souvent. J'agis même beaucoup par prudence naturelle et par un arrangement humain. Mon naturel est précisément opposé au vôtre. Vous n'avez point l'esprit complaisant et flatteur, comme je l'ai, quand rien ne me fatigue ni ne m'impatiente dans le commerce. Alors vous êtes bien plus sèche que moi : vous trouvez que je vais alors jusqu'à gâter les gens, et cela est vrai. Mais quand on veut de moi certaines attentions suivies qui me dérangent, je suis sec et tranchant, non par indifférence ou dureté, mais par impatience et par vivacité de tempérament. Au surplus, je crois presque tout ce que vous me dites : et pour le peu que je ne trouve pas en moi-même conforme à vos remarques, outre que j'y acquiesce de tout mon cœur, sans le connaitre, en attendant que Dieu me le montre, d'ailleurs je crois voir en moi infiniment pis, par une conduite de naturel et de naturel très mauvais..."
