- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

George Berkeley (1685-1753), "Essay towards a New Theory of Vision" (1709) - "Three Dialogues between Hylas and Philonous" (1713)...
Last update 10/10/2021

Et si le monde n'était que ma représentation? Avec George Berkeley (1685-1753), évêque de Cloyne, et sa formule célèbre, «esse est percipi aut percipere» (être c'est être perçu ou percevoir), c'est l'univers entier qui pivote et qui «marche sur la tête» (Hegel). Plus rien n'existe que le sujet qui perçoit.
Œuvre paradoxale : on crut lors de sa parution à une plaisanterie, Berkeley ne voulait pourtant que retrouver le sol ferme du sens commun que les philosophes – Descartes, voire Locke – avaient paru abandonner. Tout vient, selon Berkeley, du mauvais usage de la parole. La plus sûre méthode consistera donc à s'entendre sur ce que parler veut dire. Il faut «tirer le rideau des mots pour voir le magnifique arbre de la connaissance».
Certes, il existe des idées générales mais l'on ne peut passer de celles-ci aux réalités qu'elles sont censées désigner sans opérer un coup de force ruineux pour la vérité. Le général n'est jamais qu'un leurre commode pour faire le tri entre nos idées. Il ne désigne en rien la réalité qui, elle, est toujours particulière, individuelle. Les mots communs ne sont rien d'autre que d'utiles fictions et ne doivent être confondus en aucun cas avec les idées que nous donnent nos sens.
Le langage visuel, un langage qui, à la différence des signes auxquels l'être humain recourt pour signifier les choses, n'est pas d'institution humaine, mais, étant un langage naturel, ne peut être que d'institution divine. Et plus encore, il existe un même statut du visible et du tangible, c'est-à-dire que les idées du toucher, comme celles de la vue, comme celles de tous les autres sens, sont des symboles qui représentent et signifient à la pensée de l'être humain comme tous les objets des sens et nous apprennent à régler nos actions pour atteindre les choses nécessaires à la conservation de nos corps : dès lors, les données de la vue ne sont plus les signes d'autres signes, mais, comme les données du toucher, comme toutes les autres, elles sont signes d'objets réels, étant le langage de leur Auteur, Dieu...
Métaphysicien de talent, célèbre pour avoir défendu l'idéalisme, c'est-à-dire l'opinion selon laquelle la réalité consiste exclusivement en des esprits et leurs idées. Le système de Berkeley, bien qu'il en frappe plus d'un comme étant contre-intuitif, est suffisamment solide et flexible pour contrer la plupart des objections. Ses œuvres les plus étudiées, le "Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge" (Principes, en abrégé) et les "Trois Dialogues entre Hylas et Philonous" (Dialogues), sont magnifiquement écrites et riches d'arguments qui font le bonheur des philosophes contemporains. Berkeley était également un penseur d'envergure qui s'intéressait à la religion (qui était au cœur de ses motivations philosophiques), à la psychologie de la vision, aux mathématiques, à la physique, à la morale, à l'économie et à la médecine. Bien que nombre des premiers lecteurs de Berkeley l'aient accueilli avec incompréhension, il a influencé à la fois Hume et Kant...
(John Smibert (1688–1751), Portrait of George Berkeley, 1728-1730 (National Portrait Gallery)
(1729, John Smibert (American colonial era artist, 1688-1751), "The Bermuda Group Family portraits")

Le XVIIIe siècle n'a pas seulement posé et, dans une certaine mesure, élucidé les problèmes qui concernent l'origine, la nature et les lois de développement des sociétés humaines comme des espèces naturelles. Mais, suivant en cela la voie ouverte par Locke, ce XVIIe va s'attacher à scruter, par une analyse la plus précise possible et grâce aux ressources de la seule expérience interne, les fondements, l'étendue et la certitude de nos connaissances, en les rapportant constamment à leur origine, à leur nature et à leur développement dans l'esprit humain, sans se préoccuper des choses que notre sonde ne peut atteindre et qui excèdent la portée de l'entendement.
La première question, selon Locke, qui se pose, à qui examine tout ce qui est l'objet de notre entendement lorsque nous pensons, est de savoir comment l'homme vient à avoir toutes ces idées (II, 1), la source d'où l'entendement les tire, par quels moyens et par quelles opérations elles peuvent venir à l'esprit, et enfin, Locke termine par où, selon Berkeley, il aurait dû commencer, - ce que représentent et signifient les mots dont on fait usage pour les désigner (III, 1).
C'est sous cette forme que le problème s'est posé à Berkeley, comme à Hume, à Condillac et aux idéologues, avec cette différence, cependant, que Berkeley transfère aux idées le problème de la signification que Locke ne s'était explicitement posé qu'à propos des mots; ce qui l'amène à considérer les idées elles-mêmes et toutes les opérations et les produits de la pensée comme des signes, bref comme un langage dont il faudra tâcher de déceler celui qui nous le tient et chercher ce qu'il désigne, représente et signifie dans la réalité des choses et non pas seulement dans notre esprit et dans l'esprit des autres hommes : problème que Locke écarte, à propos de la signification des mots, comme une source d'obscurité et de confusion inévitable (III, 2, 5), pour s'en tenir à la convenance et disconvenance des idées entre elles, en reconnaissant toutefois que l'existence réelle et actuelle y est incluse, en sorte que nous pouvons connaître notre propre existence par intuition, l'existence de Dieu par démonstration et celle des autres hommes par sensation (IV, 9-11), mais sans que ces inférences soient proprement fondées dans son système de la connaissance.
Pour Berkeley, au contraire, ce problème de la réalité ou de l'existence est le problème central qui commande toutes ses spéculations et les mène à une fin, métaphysique et plus spécifiquement religieuse, qui en était le principe secret, et qui se situe à une profondeur que nos sondes, assurément, ne peuvent atteindre, mais dont elles nous décèlent l'existence.
Par là Berkeley, parti de l'empirisme de Locke, le dépasse singulièrement, comme il dépasse toute son époque, et il apparaît au XVIIIe siècle, parmi les philosophes des lumières, le seul philosophe digne de ce nom, et un métaphysicien dont l'intuition ne le cède en rien à celle des plus grands...
La philosophie de Berkeley, un empirisme immatérialiste, critique tout à la fois envers Locke et le rationalisme, doublé d'un nominalisme qui mène droit à une théorie originale de la signification?
On a beaucoup discuté sur le sens qu'il convient d'attribuer à la philosophie de Berkeley, sur son inspiration, sa nature, son unité, les influences dont elle témoigne, l'évolution de la pensée qu'elle reflète. Dans l'histoire des systèmes, qui n'en retient à l'ordinaire que la partie négative, Berkeley fait figure d'immatérialiste, ou, si l'on veut, d'idéaliste renforcé, et, par sa négation de la substance matérielle, il aurait préparé les voies à la théorie de Hume, qui applique à l'esprit, ou à la substance spirituelle, la même critique radicale que Berkeley avait appliquée à la matière. Mais c'est là travestir sa doctrine, c'est méconnaître l'intention profonde et le développement de sa pensée, du "Traité concernant les Principes de la connaissance humaine" (1710) et des "Dialogues entre Hylas et Philonoüs" (1713) à la "Siris" (1744) qui nous la livre dans son intégrité et sa pureté. Celui qui étudie attentivement l'œuvre de Berkeley dans son développement, ainsi qu'il le demande lui-même, ne peut manquer d'observer qu'il est passé de l'empirisme au rationalisme, du nominalisme au réalisme, du déisme au théisme, voire au théocentrisme, bref de Locke à Malebranche et à Platon.
Premiers éléments du développement de sa doctrine : Berkeley a non seulement réintégré, l'universel, non l'abstrait, dans le système du savoir (Traité, introduction, § 12-15), mais a ajouté à la connaissance des choses ou objets sensibles par les idées, la connaissance de l'esprit et des opérations de l'esprit par des notions génératrices du savoir véritable, dont la "Siris" montre qu'elles sont fondées in re dans l'Esprit infini. Cf de même la seconde édition du Traité (1734) et dans l'Alciphron...
Quelle est l'intuition profonde d'où procède et qu'exprime la doctrine de Berkeley? Une intuition, qui fait s'entrepénétrer, ainsi que l'a montré Bergson (L'intuition philosophique, conférence faite au Congrès de philosophie de Bologne le 10 avril 1911, rééditée dans La Pensée et le Mouvant, p. 143-153), les quatre thèses fondamentales de sa philosophie, idéalisme immatérialiste, nominalisme, spiritualisme volontariste, théisme, mais qui est quelque chose, tout à la fois, de beaucoup plus subtil, de plus concret et de plus précis : on la trouverait dans l'image médiatrice où la matière nous est présentée comme "une mince pellicule transparente située entre l'homme et Dieu", et qui, selon le cas, nous permet ou nous empêche d'apercevoir Dieu au travers. Cette pellicule, pour la plupart, forme écran; elle leur cache Dieu, les détourne de Lui, et soustrait à la Providence les affaires du monde. Mais ils ne s'aperçoivent pas, écrit-il dans l'Introduction au Traité, qu'ils ont soulevé la poussière et se plaignent ensuite de ne pas voir.
La tâche du philosophe, celle que Berkeley se propose dès le principe, sera donc d'écarter le brouillard ou le voile des mots et des idées abstraites, pour nous ramener au sens de la réalité, au sens de l'existence, qui, derrière tout ce que nous percevons, imaginons ou pensons, derrière tous les phénomènes de la nature, nous fera découvrir l'Agent actif qui en est la cause, Dieu....

George Berkeley (1685-1753)
George Berkeley naquit en 1685, à Dysert, dans le comté irlandais de Kilkenny, d'une famille d'origine anglaise. "J'étais défiant à l'âge de huit ans, écrit-il dans son Commonplace Book (ce précieux livre de notes que, de 1705 à 1708, il rédigeait à son propre usage), et par suite naturellement porté vers les nouvelles doctrines". En 1700, l'adolescent précoce devient l'élève de la grande université de Dublin, Trinity Collège : on y étudiait Descartes, Locke, Newton. Berkeley y passa treize ans, comme élève d'abord, puis comme maître. C'est là qu'il découvrit, âgé d'une vingtaine d'années, le grand principe, qui devait à ses yeux renouveler toute la philosophie. Ses camarades se demandaient, en ce temps, s'il serait le plus bel esprit ou le plus grand sot qui sortirait de l'université...
En 1709, Berkeley prend les ordres; la même année, il publie le premier ouvrage signé de son nom, le fameux "Essai sur une nouvelle théorie de la vision". A dessein, le "principe" (l'immatérialisme) n'y était pas encore explicitement dévoilé : Berkeley, désirant convaincre, craignait d'effaroucher le public par une exposition trop brusque.
Mais, l'année suivante, en 1710, la nouvelle philosophie apparaît dans tout son jour : Berkeley publie son "Traité des principes de la connaissance humaine", où sont examinées les principales causes d'erreur et de difficulté dans les sciences, ainsi que les fondements du scepticisme, de l'athéisme et de l'irréligion.
Cette révélation n'eut pas les effets qu'en attendait son auteur. Ayant demandé à son ami, Sir John Percival, de lui trouver à Londres des lecteurs et des critiques, Berkeley en recevait la réponse suivante : "Je n'ai fait que nommer le sujet de votre livre des Principes à quelques ingénieux amis que j'ai, et aussitôt ils le tournèrent en ridicule, tout en refusant de le lire : ce que je n'ai pu encore obtenir d'un seul. Un médecin de ma connaissance entreprit de décrire votre personne, et soutint qu'il fallait que vous fussiez fou, et que vous devriez prendre des remèdes. Un évêque vous prit en pitié, de ce qu'un désir vaniteux de lancer quelque chose de nouveau vous eût engagé à une telle entreprise; et quand je vous justifiai sur cette partie de votre caractère, et que j'énumérai eu outre d'autres qualités méritoires que vous possédez, il dit ne plus savoir que penser de vous. Un autre me dit qu'un homme ingénieux ne devait pas être découragé d'exercer sa verve, et qu'on n'avait pas fait moins grand cas d'Erasme pour avoir écrit à la louange de la folie; mais que vous n'êtes pas allé aussi loin qu'un gentleman de la ville, lequel affirme non seulement qu'il n'existe rien de tel que la Matière, mais que nous-mêmes n'avons pas la moindre existence."
En 1711, Berkeley vient lui-même à Londres : après la studieuse paix de Trinity Collège, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Bien accueilli par ses compatriotes Steele et Swift, il entre en relations avec les célébrités littéraires de l'époque. Cette année même, il publie ses "Dialogues d'Hylas et de Philonous", où la doctrine du Traité reparaît, non plus sous une forme dogmatique, mais sous l'aspect séduisant de dialogues platoniciens : Hylas, contradicteur têtu mais sincère, y défend en vain, jusqu'à sa conversion finale, l'existence de Ia substance matérielle. C'est un beau livre de propagande philosophique, à la fois ardente, habile et lucide. Le titre complet de l'ouvrage en signalait adroitement le dessein pieux et utile, sans en mentionner la thèse paradoxale : Trois Dialogues entre Hylas et Philonous, dont l'objet est de démontrer clairement la réalité et la perfection de la connaissance humaine, la nature incorporelle de l'âme et l'immédiate Providence d'une Divinité, contre les sceptiques et les athées; et aussi de faire connaître une méthode pour rendre les sciences plus simples, plus utiles et plus courtes.
L'élégant métaphysicien rencontra plus d'admirateurs que de disciples : le public eut l'oreille encore plus dure qu'Hylas. Les philosophes ne se rendirent pas davantage : malgré les instances de Berkeley, et à son grand dépit, l'illustre Clarke refusait également de réfuter l'immatérialisme ou de l'embrasser.
C'est ici que se placent les voyages de Berkeley : dix mois passés en France et en Italie (1713-1 714), comme chapelain de Lord Peterborough, chargé d'une ambassade extraordinaire en Sicile; puis, après un retour, nouveau voyage en Italie (1716-1721), comme précepteur du fils d'un évêque irlandais. Berkeley visita Rome et Naples : son journal de voyage témoigne d'un vif goût pour les arts et l'antiquité. Mais le philosophe, en lui, n'était pas mort : en revenant d'Italie, il s'arrête à Lyon pour écrire, en réponse à une question proposée par l'Académie des Sciences de Paris, sur la cause du mouvement, son curieux "De Motu"; le traité paraît, dès son retour à Londres, en 1721.
Un triste spectacle y attendait Berkeley : celui de la démoralisation et des désastres produits par la banqueroute de la Compagnie de la Mer du Sud. Il réfléchit dès lors passionnément aux questions sociales, qui ne se séparèrent jamais, dans son esprit, des questions morales et religieuses : son "Essai sur les moyens de prévenir la ruine de la Grande Bretagne" (1721) est le premier symptôme de cet idéalisme philanthropique et chrétien, qui allait bientôt le jeter dans la plus extraordinaire équipée. Une lettre à Percival, datée de mars 1723, nous révèle son dessein : jugeant l'Europe irrémédiablement corrompue, Berkeley tournait son espoir vers l'Amérique : il voulait fonder, dans le site idyllique des îles Bermudes, un collège destiné à la formation des missionnaires, sorte de foyer du christianisme et de la science, d'où devait rayonner sur le monde une civilisation régénérée. Cette idée s'empara entièrement de lui : l'héritage inattendu de Vanessa, l'amie de Swift, sembla venir à point pour en favoriser l'exécution. Berkeley, enthousiaste, chantait en vers son projet. Nommé, non sans difficultés, doyen de Derry, il réclamait instamment qu'on le déchargeât de son poste : « Mon coeur se brisera, écrivait-il à Swift, si je dois rester doyen en Irlande.
Revenu à Londres, il expose son plan dans une brochure (Proposition pour le développement des Eglises dans nos possessions lointaines et pour la conversion des sauvages au christianisme par la fondation d'un collège dans les iles Summer, autrement appelées îles de Bermuda, 1725), obtient des encouragements, des souscriptions, une charte du roi, et, sur un vote favorable de la Chambre des Communes, une promesse de vingt mille livres du ministre Robert Walpole. Enfin, en septembre 1728, fraîchement marié avec Anne Forster, qu'il avait choisie, écrit-il, «à cause de ses qualités d'esprit et de son goût sincère pour les livres», Berkeley, sans plus attendre, afin de couper court aux doutes naissants du public, fait voile pour le Nouveau Monde, avec sa femme, quelques compagnons et une bibliothèque de vingt mille volumes...
Il ne devait jamais fouler le sol des Bermudes ; s'étant arrêté à Rhode Island pour hiverner, il y passa plus de deux ans, d'abord à Newport, la capitale de l'île, puis dans sa rustique maison de Whitehall, qu'il fit construire, attendant en vain le paiement du subside promis, heureux d'ailleurs de sa vie calme, agreste et domestique, lisant beaucoup, méditant au bord de la mer, prêchant de temps en temps à Newport, recevant la visite des missionnaires et, notamment, de son disciple américain Samuel Johnson. C'est à Rhode Island que furent composés les sept dialogues à "Alciphron ou le petit Philosophe" (sept dialogues, contenant une apologie de la religion chrétienne contre ceux qu'on appelle libres penseurs, 1re édition 1732) : ce nom méprisant désigne les libres penseurs, que Berkeley déteste, et dont il réfute longuement les doctrines. Un jour enfin, Gibson, évêque de Londres, demandant à Walpole une réponse définitive au sujet du subside, le premier ministre d'Angleterre lui répondit : "Si vous me questionnez comme ministre, je dois et je puis vous assurer que l'argent sera payé sans le moindre doute, dès que l'intérêt public le permettra; mais si vous me demandez, comme à un ami, si le doyen Berkeley doit demeurer en Amérique, à attendre le paiement de vingt mille livres, je lui fais dire, de toutes mes forces, qu'il retourne chez lui en Europe et renonce à ses espoirs présents." Ce fut un rude coup pour Berkeley.
Au début de 1732, il débarquait en Angleterre et se fixait à Londres, avec sa femme et son petit enfant. La publication de l'Alciphron, acompagné d'une troisième édition de l'Essai sur la vision, ayant donné naissance à diverses critiques, Berkeley écrivit, en réponse à une lettre anonyme parue dans un journal de Londres, une courte "Défense et explication de la théorie de la vision" (Défense et explication de la théorie de la vision, ou du langage visuel montrant la Présence et la Providence immédiates d'une Divinité); puis, prenant contre les mathématiciens libres-penseurs une offensive hardie, il lance contre eux son "Analyste", singulier opuscule, où les obscurités du calcul newtonien des fluxions sont exploitées au profit des mystères du christianisme!
En voici le titre complet : "L'Analyste, ou Discours adressé à un mathématicien incroyant (c'est du fameux Halley qu'il s'agit), où l'on examine si l'objet, les principes et les conséquences de l'analyse moderne sont plus distinctement conçus, ou déduits avec plus d'évidence, que les mystères religieux et les choses de foi" (1734). L,' Analyste fut le point de départ d'une polémique générale, essentiellement mathématique : Berkeley renonça bientôt à s'y mêler.
Depuis 1734, il n'était plus à Londres : nommé, à cette époque, évêque de Cloyne, en Irlande, il passa dans ce pauvre diocèse la dernière période de sa vie. La plus grande partie de la population était catholique : l'évêque anglican sut se la concilier par sa tolérance et son zèle charitable. L'Irlande était misérable : il travailla avec ardeur à son relèvement. C'est dans ce but qu'il écrit son "Querist" (le Questionneur), dont les trois parties, parues successivement à Dublin, sans nom d'auteur, de 1735 à 1737, exprimaient, sous forme de questionnaire, ses idées sur l'économie sociale et le problème irlandais; publie, dans le journal de Dublin, une "Lettre sur une Banque nationale d'Irlande" (1737), et va lui-même soutenir ses vues à la Chambre irlandaise des Lords. légalement soucieux des intérêts spirituels de ses compatriotes, il dénonce, dans un "Discours aux magistrats et aux autorités à l'occasion de la licence et de l'irréligion énormes de ce temps", la récente fondation d'un club de libres penseurs. Sa bienfaisance et son enthousiasme allaient d'ailleurs trouver une nouvelle occasion de s'exercer.
En 1740, une épidémie, succédant à une famine, désola l'Irlande. Berkeley se souvint d'un remède américain, qu'il avait éprouvé à Rhode Island : il fît boire aux malades de l'eau de goudron, obtint, dans les cas les plus divers, d'admirables résultats, crut avoir découvert une panacée. Telle fut l'origine de cet étrange livre qui s'appelle : "Siris, chaîne de réflexions et de recherches philosophiques concernant les vertus de l'eau de goudron, ainsi que divers autres sujets connexes et qui naissent les uns des autres" (1744).
Berkeley, parti d'une utopie médicale, s'y élève par degrés jusqu'aux plus hauts sommets d'une métaphysique abstruse et mystique, dont ses précédents ouvrages ne contenaient, au plus, que le germe. Le public, au rebours des lecteurs d'aujourd'hui, ne prêta que peu d'attention à la partie métaphysique de l'ouvrage, mais se passionna pour la partie médicale. La "Siris" fut traduite, intégralement ou partiellement, en français, en allemand, en hollandais, en portugais; d'innombrables brochures attaquèrent ou soutinrent le nouveau remède. Un dispensaire d'eau de goudron s'ouvrit à Londres; la mode se mit de la partie. «Il est impossible, dit un contemporain, d'écrire maintenant une lettre sans teindre l'encre avec de l'eau de goudron. C'est le commun sujet de conversation., chez le riche comme chez le pauvre, en haut comme en bas de la société, et l'évêque de Cloyne en a fait quelque chose d'aussi fashionable que d'aller à Vauxhall ou à Ranelagh. Pourtant la Faculté en général et toute la bande des apothicaires sont fort en colère à la fois contre l'auteur et contre le livre : ce qui fait supposer à bien des gens que ce doit être une bonne chose.»
La Siris est le dernier ouvrage philosophique de Berkeley. Il ne se consacra plus, désormais, qu'à l'éducation de ses fils et à la mission sociale dont il se regardait comme investi. Lors du soulèvement jacobite de 1745, sa "Lettre aux catholiques irlandais du diocèse de Cloyne", d'un remarquable libéralisme, exhorte les habitants au maintien de la paix publique. Le même esprit anime, quelques années plus tard, la brochure intitulée : "Un mot aux sages, ou exhortation au clergé catholique romain d'Irlande par un membre de l'Eglise établie" (1749), et les courtes "Maximes sur le patriotisme" (1750) : Berkeley fait appel à la collaboration des protestants et des catholiques en vue de la prospérité irlandaise.
Vers 1750, sa santé s'altère ; frappé au cœur par la mort de son fils William, qui survint l'année suivante, il résolut d'aller finir ses jours dans la calme cité d'Oxford. Il eut encore le temps, durant les quelques mois qu'il y vécut, de faire paraître des "Mélanges", recueil de divers opuscules antérieurement publiés, et une troisième édition, corrigée, de l'Alciphron. Le 14 janvier 1753, la paralysie générale l'emporte soudain, à l'âge de soixante huit ans.

"Notes philosophiques - Commonplace Book" (1708)
Deux cahiers de petites dimensions dans lesquels Berkeley, dès sa jeunesse, notait ses idées, leur formation dans l'esprit du philosophe, entre 20 et 24 ans. Une des idées le plus fréquemment exprimées dans le Commonplace Book, avec celle d'un monde matériel qui n'existe que dans notre perception, est l'impossibilité pour l'esprit de former des idées abstraites. C’est chez Locke que Berkeley avait trouvé la doctrine des idées abstraites qu’il critique. On sait que l’idée abstraite est proprement pour Locke une fabrication de l’entendement, propre à la raison humaine, qu’il substitue à l’essence réelle mais inconnue des choses, pour pouvoir donner un sens aux mots du langage, et par conséquent pour pouvoir raisonner et communiquer ses idées...
A la première page Berkeley écrit :
"1. Question : N'y a-t-il pas deux sortes d'étendue visible, l'une confuse, l'autre perçue par le mouvement distinct, successif, de l'axe optique vers chaque point ?
2. Pas d'idées générales. Le contraire cause d'erreur et de confusion dans les mathématiques. A déclarer dans l'Introduction.
3. Le Principe peut être appliqué aux difficultés de conservation, de coopération, etc.
4. Il est puéril de la part des physiciens de rechercher la cause des attractions magnétiques. Leur recherche ne porte que sur des idées coexistantes.
5. Quaecumque in Scriptura militant adversus Copernicum, militant pro me.
6. Tout ce qui, dans les Ecritures, est en faveur de l'opinion vulgaire contre les savants, est aussi en ma faveur. Je suis en toutes choses du côté de la foule.
7. Je sais que je serai combattu par une secte puissante, mais je peux espérer d'être soutenu par ceux dont l'esprit est moins atteint de folie. Ce sont de beaucoup les plus nombreux, en particulier les moralistes, les prêtres, les politiques, en un mot, tous, sauf les mathématiciens et les physiciens. Je ne veux désigner par là que les partisans de l'hypothèse. Car les amis de la philosophie expérimentale ne trouveront rien à reprendre dans mes principes.
8. Newton prend ses principes pour accordés : je démontre les miens.
9. Il me faut bien expliquer ce que signifient : choses existantes, dans les maisons, les appartements, les champs, les grottes ; quand elles sont perçues ou non perçues et montrer comment la notion vulgaire est d'accord avec la mienne, quand nous examinons de près le sens et la définition du mot existence, lequel n'est pas une idée simple distincte de l'idée de percevoir ou d'être perçu.
10. Les scolastiques s'attachent à de belles questions, mais ils les traitent mal. Les mathématiciens prennent des sujets insignifiants sur lesquels ils font des raisonnements admirables. Assurément leur méthode et leur argumentation sont excellentes.
IL Dieu sait combien notre connaissance des êtres intelligents peut être accrue par les Principes..."
Une réflexion du Commonplace Book, d'une forme remarquablement hardie, nous révèle cette tendance de Berkeley à concevoir la réalité du représenté comme entièrement subordonnée à celle du représentatif : «Il n'existe proprement que des personnes, c'est-à-dire des choses conscientes. Toutes les autres choses ne sont pas tant des existences que des manières d'exister des personnes». Ce langage, sans doute, est exceptionnel : Berkeley se borne d'ordinaire à juxtaposer et à opposer, comme deux catégories radicalement différentes d'existences, les idées et les esprits; la formule "esse est percipi" n'est nullement une négation, mais seulement une définition, de l'existence propre aux choses corporelles. Seulement, cette existence, Berkeley n'a jamais songé, à la concevoir comme indépendante : les idées, dit-il, sont «des êtres dépendants, qui ne subsistent point par eux-mêmes, mais qui ont pour supports les esprits ou substances spirituelles dans lesquels ils existent» (Traité, § 89 : dépendent Seings, which subsist nol by themselves , but are supported by, or exist in, minds or spiritual substances). Maintenant, comment convient-il d'entendre ce rapport des idées avec les esprits dans lesquels elles se trouvent? Le rapport de l'idée à l'esprit est un rapport sui generis, et qui se conçoit le plus aisément du monde, pour peu qu'on ne se laisse pas abuser par les métaphores. Quand nous disons que les objets (ou les idées) sont dans l'intelligence, «il n'y a rien en cela que de très conforme à l'analogie générale de la langue, car la plupart des opérations mentales sont désignées par des mots empruntés aux choses sensibles» (Dial., III).
Ainsi l'existence des idées, c'est-à-dire des corps, appelle, comme un indispensable soutien, celle des esprits, ou, comme Berkeley ne craint pas de le dire, des substances spirituelles. On pourrait au premier abord s'étonner que Berkeley, après avoir mené contre la substance matérielle la plus vigoureuse attaque, ait renoncé devant la substance spirituelle aux exigences de son phénoménisme ; en d'autres termes, qu'il ait laissé, sur ce point, quelque chose à faire à David Hume. Et en effet, si, dans sa pensée définitive, la substance-esprit survit à la ruine de la substance matière, du moins le Commonplace Book nous révèle-t-il de la façon la plus nette une tendance au phénoménisme intégral. «L'esprit, écrit textuellement Berkeley, est un amas (congeries) de perceptions. Supprimez les perceptions et vous supprimez l'esprit. Posez les perceptions et vous posez l'esprit». «C'est l'existence même des idées qui constitue l'âme» (Cpl. B., p. 27, § 186).
L'esprit n'est pas, comme la matière, une inconcevable et insignifiante entité. La substance spirituelle nous est immédiatement connue, et de la façon la plus certaine qui soit au monde ; c'est une réalité vivante, si directement accessible à notre intuition, qu'il n'y a pas moyen de mettre son existence en doute. Si la Matière échappe à toute représentation : rien de plus aisé, au contraire, que de nous saisir nous-même comme esprit. « Ce que je suis moi-même, ce que je désigne par ce mot : moi, c'est cela même qui est signifié par âme ou substance spirituelle. Mais, si je disais que je ne suis rien, ou que je suis une idée ou notion, rien ne pourrait être plus évidemment absurde que l'une ou l'autre de ces propositions" (Traité, § 139. Cf. Cpl. B., p. 55, § 457).

"Essay towards a New Theory of Vision" (Essai sur une nouvelle théorie de la vision", 1709)
Le but de l'Essai sur la vision est de montrer en quoi consiste notre perception visuelle de la distance, de la grandeur et de la position des objets. Primitivement, la perception de ces qualités n'appartient qu'au tact, non à la vue. Plus tard seulement, à la suite d'expériences répétées, une association finit par s'établir entre les idées de distance, de grandeur, etc., et certaines sensations visuelles (ou certaines sensations musculaires correspondant aux mouvements des yeux) : dès lors, ces dernières, par les idées qu'elles suggèrent immédiatement, suffisent à nous faire juger de la grandeur, de la position, de la distance. Mais si la vue perçoit ces qualités, ce n'est jamais qu'à la façon dont nous voyons la honte sur un visage : nous croyons voir la distance ou la grandeur, en réalité nous n'en voyons que les signes. Dans cette "nouvelle théorie de la vision", l'oeil voit non pas la réalité, mais certains signes particuliers qui indiquent d'autres sensations, prouve l'existence d'un langage visuel, déterminé comme le langage usuel par le choix d'une Providence : ce qui est une preuve plus convaincante que toutes les autres, de l'existence de Dieu.
Prenons, par exemple, la perception visuelle de la distance. En quoi consiste- t-elle ? Tout d'abord, la vue ne saurait avoir une sensation immédiate de la distance; celle-ci n'étant, en effet, qu'une ligne perpendiculaire à l'œil, le point unique qu'elle projette sur le fond de l'œil demeure le même lorsqu'elle change. D'où vient donc que pourtant nous jugions par la vue de la distance des objets? L'explication ordinairement admise est une explication mathématique : nous calculerions la distance, soit d'après l'angle des axes optiques, soit d'après la divergence des rayons lumineux. Tout l'effort de Berkeley consiste à combattre ce type d'explication. Ces lignes, quand donc les percevons-nous? Ce calcul, quand donc l'opérons-nous? Jamais. Il suffit pour s'en convaincre de regarder en soi- même : si nous faisions de la géométrie quand nous percevons la distances, nous le saurions, car parler d'un raisonnement inconscient serait absurde. Comment, d'ailleurs, percevrions-nous ce qui, comme les lignes et les angles, n'a pas d'existence réelle? L'explication mathématique est donc fausse en son principe ; elle est, de plus, incapable de résoudre certaines difficultés d'optique, qui disparaîtront, au contraire, dans la théorie de Berkeley.
Si notre perception visuelle de la distance n'est ni une sensation immédiate, ni le résultat d'un calcul, qu'est-elle donc? C'est une «idée» tactile, suggérée par certaines sensations visuelles, ou par certaines sensations (musculaires) accompagnant la vision, auxquelles une constante expérience l'a préalablement associée. Cette explication, admise d'ordinaire pour le cas des très grandes distances, s'applique également aux autres cas. Les données immédiates qui suggèrent la distance, ce sont les sensations que nous font éprouver les mouvements d'accommodation de nos yeux; c'est aussi, dans certains cas, le degré de clarté ou de confusion de l'image. Ces données nous font juger de la distance, parce qu'elles y sont liées : mais le lien dont il s'agit n'est nullement une «connexion intrinsèque», qui ferait du jugement de distance la conclusion d'un raisonnement; c'est une association purement empirique, c'est-à-dire en changeant la liste des données visuelles qui servent de signes, la même théorie s'applique à la perception de la grandeur et à celle de la position.
J'éprouve telle sensation visuelle : cette sensation signifie pour moi telle distance ; la correspondance ne m'est révélée que par l'expérience, et rien n'empêcherait qu'elle fût tout autre. Nous ne saisissons pas, il n'y a pas de connexion intrinsèque entre cette idée de distance et la sensation visuelle qui l'évoque : c'est là un des thèmes de l'Essai, et la portée métaphysique en est grande. Il suffira à Berkeley d'étendre cette remarque à tous les phénomènes.
Mais, pour l'instant, Berkeley ne développe pas encore ces extrêmes conséquences métaphysiques : il se contente de soutenir avec insistance une thèse psychologique, qui, du moins dans sa pensée, les contient en germe, et où tout ce qui précède nous achemine : c'est celle de l'hétérogénéité radicale entre la vue et le toucher. L'étendue visuelle n'a rien de commun avec l'étendue tactile : il n'y a pas une idée qui appartienne à la fois aux deux sens. La vue n'a d'autre objet propre que la lumière et les couleurs : elle ne saisit directement ni la distance, ni la figure, ni le mouvement, ni même, d'après certains passages, l'extériorité, l'espace ; ou, si l'on peut parler d'idées visuelles de l'étendue, de la figure, du mouvement, toujours est-il qu'elles sont spécifiquement distinctes des idées tactiles de même nom.
Les preuves apportées par Berkeley en faveur de cette théorie reviennent toujours à invoquer l'expérience interne, l'intuition psychologique. Que le lecteur observe ce qui se passé en lui, et dise si j'ai raison : cette invitation perpétuelle est caractéristique de la méthode de Berkeley. "Les idées abstraites sont inconcevables", cela signifie : je n'arrive pas, moi, à les concevoir; essayez vous-même. «Vos métaphysiciens et vos théoriciens semblent posséder des facultés différentes de celles des hommes ordinaires, quand ils parlent des triangles. . . généraux et abstraits» : ce genre d'ironie lui est familier.
LA THEORIE DE LA VISION - LA PERCEPTION DE LA DISTANCE.
"1. — Mon dessein est de montrer la façon dont nous percevons par la vue la distance, la grandeur et la situation des objets. C'est aussi d'examiner la différence qu'il y a entre les idées de la vue et du toucher et de rechercher s'il y a quelque idée commune à ces deux sens. [En traitant de tout ceci, ceux qui ont écrit sur l'optique sont partis, à ce qu'il me semble, de principes erronés.]
2. - — Il est, je crois, admis par tout le monde que la distance, en soi et immédiatement, ne peut être vue. Car, la distance étant une ligne de direction perpendiculaire à l'œil, elle ne projette qu'un point unique sur le fond de l'œil, et ce point demeure invariablement le même, que la distance augmente ou diminue.
3. — Il est également reconnu, je crois, que l'estimation que nous faisons de la distance des objets très éloignés est plutôt un acte de jugement fondé sur l'expérience qu'un acte des sens. Par exemple, quand je perçois un grand nombre d'objets intermédiaires, tels que des maisons, des champs, des rivières et autres choses semblables, que je sais par expérience occuper un espace considérable.
j'en tire ce jugement ou cette conclusion que l'objet que je vois au delà de ceux-ci est situé à une grande distance. D'autre part, quand un objet m'apparaît comme faible et petit alors que je sais par expérience qu'il apparaît, à une courte distance, comme fort et grand, je conclus à l'instant qu'il est loin. C'est là, évidemment, le résultat de l'expérience; sans elle, de la faiblesse et de la petitesse, je n'aurais rien induit du tout touchant la distance des objets.
4. — Mais quand un objet est placé à une distance assez proche pour qu'il y ait un rapport appréciable entre l'intervalle des deux yeux et cette distance, l'opinion des savants est que les deux axes optiques (nous écartons l'hypothèse suivant laquelle nous ne verrions qu'avec un œil à la fois) convergeant vers l'objet, y font un angle, par le moyen duquel, selon qu'il est plus grand ou plus petit, l'objet est perçu comme plus proche ou plus éloigné.
5. — Entre cette façon d'évaluer la distance et la précédente, il y a une différence notable : en effet, tandis qu'il n'y avait pas de connexion nécessaire apparente entre une petite distance et une image grande et forte, ou entre une grande distance et une image petite et faible, une connexion très nécessaire apparaît ici entre un angle obtus et une courte distance, un angle aigu et une plus longue distance. Cela ne dépend pas le moins du monde de l'expérience, mais chacun peut évidemment savoir, avant de l'avoir constaté expérimentalement, que, plus le point de rencontre des axes optiques sera proche, plus l'angle compris entre eux sera grand, et que, plus il sera éloigné, plus l'angle compris entre eux sera petit.
6. — Il y a une autre méthode, mentionnée dans les ouvrages d'optique, pour expliquer la manière dont nous jugerions des distances par rapport auxquelles la largeur de la pupille a une grandeur appréciable : c'est la plus ou moins grande divergence des rayons qui, partis du point visible, tombent sur la pupille; on juge le plus rapproché le point qui est vu par les rayons les plus divergents, le plus éloigné, celui qui est vu par les rayons les moins divergents, et ainsi de suite, la distance apparente augmentant à mesure que la divergence des rayons décroît, jusqu'à ce qu'à la fin elle devienne infinie quand les rayons qui tombent sur la pupille sont sensiblement parallèles. Et c'est de cette manière, dit-on, que nous percevons la distance quand nous ne regardons qu'avec un seul œil.
7. — Dans ce cas encore il est évident que nous ne devons rien à l'expérience; car c'est une vérité certaine et nécessaire, que, plus les rayons directs tombant sur l'œil approchent du parallélisme, plus est éloigné leur point d'intersection, c'est-à-dire le point visible d'où ils émanent.
8. — Maintenant, quoique les explications rapportées ici sur la façon dont nous percevons par la vue les courtes distances soient reçues pour vraies, et que, en conséquence, on en fasse usage pour déterminer la position apparente des objets, elles ne m'en paraissent pas moins très peu satisfaisantes; et cela pour les raisons suivantes :
9. — [1°] Il est évident que, toutes les fois que l'esprit ne perçoit pas une idée immédiatement et par elle- même, il doit la percevoir par le moyen de quelque autre idée. Ainsi, par exemple, les passions qui sont dans l'esprit d'un autre me sont invisibles par elles-mêmes. Je puis néanmoins les percevoir par la vue, non pas sans doute immédiatement, mais au moyen de la coloration qu'elles produisent sur la physionomie. Nous voyons souvent la honte ou la crainte dans les regards d'un homme en percevant les changements de son visage qui rougit ou pâlit.
10. — En outre, il est évident qu'une idée qui n'est pas perçue elle-même ne peut être pour moi le moyen de percevoir une autre idée. Si je ne perçois pas la rougeur ou la pâleur du visage d'un homme elles-mêmes, il est impossible que je perçoive par elles les passions qui sont dans son esprit.
11. — Or, d'après le paragraphe 2, il est évident que la distance est imperceptible dans sa nature propre, et cependant elle est perçue par la vue. Il reste donc que cette perception soit donnée par le moyen de quelque autre idée perçue elle-même immédiatement dans l'acte de la vision.
12. — Mais ces lignes et ces angles, par le moyen desquels quelques personnes prétendent expliquer la perception de la distance, ne sont eux-mêmes nullement perçus et, à vrai dire, ceux à qui l'optique n'est point familière, n'y ont jamais pensé. Je fais appel à l'expérience du premier venu. Est-ce qu'à la vue d'un objet il en évalue la distance d'après la grandeur de l'angle formé par la rencontre des deux axes optiques? Ou pense-t-il jamais à la divergence plus ou moins grande des rayons qui arrivent d'un point sur notre pupille?
Et même, ne lui serait-il point parfaitement impossible de percevoir par les sens les différents angles suivant lesquels les rayons, d'après leur plus ou moins grande divergence, viennent frapper l'œil? Chaque homme est lui-même le meilleur juge de ce qu'il perçoit ou non. En vain me dira-t-on que je perçois certaines lignes et certains angles qui introduisent dans mon esprit les diverses idées de distance, tant que .je n'aurai moi-même conscience de rien de semblable.
13. — Ainsi, puisque ces angles et ces lignes ne sont pas eux-mêmes perçus par la vue, il résulte du § 10 que l'esprit ne juge point par eux de la distance des objets.
14. — [2°] La vérité de cette assertion sera encore plus évidente, si l'on considère que ces lignes et ces angles n'ont pas d'existence réelle dans la nature, puisqu'ils ne sont qu'une hypothèse imaginée par les mathématiciens et introduite par eux en optique, afin de pouvoir traiter de cette science selon une méthode géométrique.
13. — La [troisième et] dernière raison que je donnerai pour rejeter cette théorie, c'est que, lors même qu'on accorderait l'existence réelle de ces angles optiques, etc., et la possibilité pour l'esprit de les percevoir, ces principes ne se trouveraient pas encore suffisants pour expliquer les phénomènes de distance, comme on le montrera ci-après.
16. — Maintenant, puisqu'on a déjà montré que l'idée de distance est suggérée à l'esprit par l'intermédiaire de quelque autre idée qui, elle, est perçue dans l'acte même de la vision, il nous reste à chercher quelles sont les idées ou les sensations accompagnant la vision auxquelles nous pouvons supposer que soient liées les idées de distance et par lesquelles elles s'introduisent dans l'esprit. — D' abord il est certain par expérience que, quand nous regardons des deux yeux un objet rapproché, selon qu'il s'approche ou s'éloigne de nous, nous modifions la disposition de nos yeux, en diminuant ou en augmentant l'intervalle des pupilles. Cette disposition ou ce mouvement des yeux est accompagné d'une sensation, et c'est celle-ci, me semble-t-il, qui, dans ce cas, introduit dans l'esprit l'idée d'une distance plus ou moins grande.
17. — Ce n'est pas qu'il y ait aucune connexion naturelle ou nécessaire entre la sensation que nous percevons en tournant les yeux et une distance plus ou moins grande. Mais, parce que l'esprit a trouvé, par une expérience constante, que les sensations différentes correspondant aux dispositions différentes des yeux sont accompagnées chacune d'un degré différent de distance dans l'objet, il s'est formé une connexion ordinaire ou habituelle entre ces deux sortes d'idées : de sorte que l'esprit ne perçoit pas plus tôt la sensation provenant de la façon différente dont il tourne les yeux afin d'amener les pupilles plus près ou plus loin l'une de l'autre, qu'il perçoit du même coup l'idée différente de distance qu'il avait accoutumé d'unir à cette sensation. Tout de même que, si l'on entend un certain son, l'idée que l'habitude avait liée à ce son est immédiatement suggérée à l'entendement.
18. — Et je ne vois pas comment je pourrais facilement me tromper sur ce point. Je sais évidemment que la distance n'est pas perçue d'elle-même, — que, par conséquent, elle doit être perçue par le moyen de quelque autre idée, laquelle est perçue immédiatement et varie avec les différents degrés de la distance. Je sais aussi que la sensation provenant du mouvement des yeux est perçue immédiatement, d'elle-même, et que les divers degrés de cette sensation sont associés avec des distances différentes qui ne manquent jamais de les accompagner dans mon esprit, lorsque je vois distinctement, avec les deux yeux, un objet dont la distance est assez petite pour que, par rapport à elle, l'intervalle des deux yeux ait une grandeur notable.
19. — C'est, je le sais, une opinion reçue qu'en modifiant la disposition des yeux, l'esprit perçoit si l'angle des axes optiques, ou les angles latéraux compris entre l'intervalle des yeux et les axes optiques, deviennent plus grands ou plus petits, et que, en conséquence, par une sorte de géométrie naturelle, il juge que leur point d'intersection est plus proche ou plus éloigné. Mais je suis convaincu par ma propre expérience qu'il n'en est pas ainsi, puisque je n'ai pas conscience de faire servir à rien de pareil la perception que j'éprouve en tournant les yeux. Et, pour moi, porter ces jugements et en tirer ces conclusions, sans savoir que je le fais, me semble chose absolument incompréhensible.
20. — De tout cela il suit que le jugement que nous portons sur la distance d'un objet regardé avec les deux yeux est entièrement le résultat de l'expérience. Si nous n'avions pas constamment trouvé que certaines sensations, provenant de la disposition diverse des yeux, accompagnaient certains degrés d'éloignement, nous ne pourrions jamais en tirer ces jugements instantanés sur la distance des objets; pas plus que nous ne prétendrions juger des pensées d'un homme en lui entendant prononcer des mots que nous n'aurions jamais entendus auparavant.
21. — En second lien, un objet placé à une certaine distance de l'œil, distance à l'égard de laquelle la largeur de la pupille comporte une proportion appréciable, se voit plus confusément quand on le rapproche, lit, plus on le rapproche, plus son image devient confuse. Et, comme on éprouve constamment qu'il en est ainsi, il se forme dans l'esprit une connexion habituelle entre les divers degrés de confusion et de distance, une plus grande confusion impliquant toujours une moindre distance, et une moindre confusion une plus grande distance de l'objet.
22. — Cette image confuse de l'objet semble donc être l'intermédiaire par lequel l'esprit juge de la distance, dans les cas où ceux qui ont écrit sur l'optique avec le plus d'autorité veulent qu'il en juge par la divergence différente des rayons émanant d'un point lumineux et frappant la pupille. Personne, je crois, ne prétendra voir ou sentir ces angles imaginaires que l'on suppose formés par les rayons suivant leurs diverses inclinaisons sur l'œil. Mais personne ne peut s'empêcher de voir si l'objet apparaît plus ou moins confus. La conséquence manifeste de cette démonstration est donc que l'esprit se sert, non pas de la plus ou moins grande divergence des rayons, mais de la plus ou moins grande confusion de l'image pour déterminer par là la position apparente d'un objet.
23. — Et il ne sert à rien de dire qu'il n'y a pas de connexion nécessaire entre une vision confuse et une distance grande ou petite. Car je demande à qui l'on voudra quelle connexion nécessaire il voit entre la rougeur et la honte. Et cependant il n'a pas plus tôt vu cette couleur apparaître sur le visage d'un homme que se présente à son esprit l'idée de cette passion, dont on a observé que la rougeur était accompagnée.
J4. — Ce qui paraît avoir égaré en cette matière ceux qui traitent de l'optique, c'est qu'ils imaginent que les hommes jugent de la distance connue ils font d'une conclusion mathématique. Entre cette conclusion et les prémisses, à la vérité, il est absolument indispensable qu'il existe une connexion apparente, nécessaire; mais il en va tout autrement dans les jugements instantanés qu'on porte sur la distance. On ne saurait croire que les animaux, les enfants, ou même les gens adultes et raisonnables, toutes les fois qu'ils perçoivent qu'un objet s'approche ou s'éloigne d'eux, le fassent en vertu d'une démonstration géométrique.
25. — Pour qu'une idée en puisse suggérer une autre à l'esprit, il suffira qu'on ait observé qu'elles s'accompagnent, sans aucune démonstration de la nécessité de leur coexistence, ou sans qu'il soit besoin de savoir quelle raison les fait coexister ainsi. Il y a de ce fait d'innombrables exemples et personne ne peut les ignorer.
26. — Ainsi, une image plus confuse ayant été constamment accompagnée d'une plus courte distance, la première idée n'est pas plus tôt perçue qu'elle suggère la seconde à notre pensée. Et si ç'avait été la marche ordinaire de la nature que, plus un objet serait placé loin, plus son image fût confuse, il est certain que la même perception précisément qui nous fait aujourd'hui penser qu'un objet s'approche nous eût alors fait imaginer qu'il s'éloigne, attendu que cette perception, si l'on fait abstraction de l'habitude et de l'expérience, est également propre à produire l'idée d'une grande distance, ou d'une petite, ou d'aucune distance du tout.
27. — En troisième lieu, lorsqu'un objet est placé à la distance ci-dessus spécifiée, et qu'on l'approche de l'œil, nous pouvons cependant empêcher, au moins pour quelque temps, l'image de devenir plus confuse, par une tension de l'œil. En ce cas, cette sensation tient la place de la vision confuse, en aidant l'esprit à juger de la distance de l'objet, car on estime l'objet d'autant plus rapproché que l'effort ou la tension de l'œil pour arriver à la vision distincte est plus grand.
28. — J'ai noté ici les sensations où les idées qui me paraissent être les occasions constantes et générales grâce auxquelles s'introduisent dans l'esprit les différentes idées de proche distance. Il est vrai que, dans la plupart des cas, diverses autres circonstances contribuent à former notre idée de distance, à savoir, le nombre, la dimension, l'espèce particulière, etc., des choses vues. A ce sujet, comme en ce qui concerne toutes les autres occasions précédemment mentionnées qui suggèrent l'idée de distance, je remarquerai seulement qu'aucune d'entre elles n'a, de sa nature propre, ni relation ni connexion avec la distance; et elles ne pourraient en signifier les différents degrés, si, par expérience, on n'en avait pas constaté la connexion avec ceux-ci.
41. — C'est une conséquence évidente de ce qui a été exposé jusqu'ici qu'un aveugle de naissance, qui recouvrerait la vue, n'aurait tout d'abord aucune idée de la distance par la vue : le soleil et les étoiles, les objets les plus éloignés comme les plus rapprochés, tout lui semblerait être dans son œil, ou plutôt dans son esprit. Les objets introduits en lui par la vue ne lui sembleraient pas autre chose (et ne sont pas autre chose en réalité) qu'une série nouvelle de pensées ou de sensations, dont chacune serait aussi prés de lui que les sensations de douleur ou de plaisir, ou que les plus intimes passions de son âme. Car, lorsque nous jugeons que les objets perçus par la vue sont à une certaine distance, ou extérieurs à l'esprit, c'est uniquement le résultat de l'expérience, et un aveugle, dans les circonstances que nous supposons, ne pourrait pas encore y être arrivé.
42. — Il en est autrement, il est vrai, selon la supposition commune, — à savoir que l'homme juge de la distance par l'angle des axes optiques, exactement comme quelqu'un qui est dans l'obscurité ou comme un aveugle, d'après l'angle compris entre deux baguettes qu'il tient chacune dans une main. Car, s'il en était ainsi, il s'ensuivrait qu'un aveugle de naissance, rendu à la vue, n'aurait besoin d'aucune expérience nouvelle pour percevoir la distance par le regard. Mais la fausseté de cette affirmation a été, je pense, suffisamment démontrée.
43. — Et peut-être, en étudiant la chose de près, ne trouverons-nous pas que ceux-là mêmes qui, depuis leur naissance, ont grandi dans un exercice habituel et continu de la vue, se trouvent irrévocablement prédisposés à porter le jugement inverse, c'est-à-dire à penser que ce qu'ils voient est à une certaine distance d'eux-mêmes. Car, il semble aujourd'hui absolument reconnu par ceux qui ont un peu réfléchi sur cette question, que les couleurs, qui sont l'objet propre et immédiat de la vue, ne sont pas en dehors de l'esprit. — Mais, dira-t-on, par la vue nous avons aussi les idées d'étendue, de figure, de mouvement, toutes choses qui peuvent bien être pensées comme extérieures à l'esprit et comme distantes de lui, si la couleur ne peut pas l'être.
Pour répondre à cette objection, j'en appellerai à l'expérience de chacun : est-ce que l'étendue visible de tout objet ne nous paraît pas aussi proche de nous que la couleur de cet objet? Bien plus, les deux choses ne semblent- elles pas situées précisément à la même place? L'étendue que nous voyons n'est-elle pas colorée? et nous est-il possible même par la pensée de séparer et d'abstraire la couleur de l'étendue? En réalité là où est l'étendue, là, à coup sûr, est aussi la figure, et là le mouvement. Je ne parle que des qualités qui sont perçues par la vue.
44. — Mais pour expliquer plus complètement ce point, et pour montrer que les objets immédiats de la vue ne sont en aucune façon les idées ou les images de choses placées à distance, il est nécessaire que nous examinions de plus près encore cette question, et que nous observions avec le plus grand soin ce que signifie cette expression du langage courant : telle chose, que nous voyons, est à telle distance de nous. Supposons, par exemple, qu'en regardant la lune je dise qu'elle est distante de moi de cinquante ou soixante fois le rayon de la terre. Voyons de quelle lune il est alors question. Il est évident que ce ne peut être de la lune visible, ou de rien qui ressemble à cette lune visible, ou à ce que je vois, — c'est-à-dire en définitive une surface plane, ronde, lumineuse, d'environ trente points visibles de diamètre. Car, au cas où je serais transporté du lieu où je me tiens dans la direction de la lune, il est manifeste que cet objet varierait à mes yeux dans la mesure où j'en approcherais; et, lorsque je me serais avancé de cinquante ou soixante fois le rayon de la terre, bien loin de me trouver auprès d'une petite surface plate, ronde et lumineuse, je ne verrais plus rien qui lui ressemble, puisque depuis longtemps cet objet aurait disparu, et si je voulais le retrouver, il me faudrait retourner en arrière jusqu'à la terre d'où j'étais parti.
Ou bien encore, supposons que je perçoive par la vue l'idée faible et obscure de quelque chose dont je doute si c'est un homme, ou un arbre, ou une tour, mais que je juge se trouver à une distance d'environ un mille. Il est évident que je ne puis entendre par là que ce que je vois est à un mille de distance, ou que c'est l'image ou la ressemblance de quelque chose qui est à un mille, puisqu'à chaque pas que je fais dans cette direction, cette apparence se modifie, et d'obscure, petite et faible qu'elle était, devient claire, étendue et vive. Et quand je suis arrivé au bout du mille, ce que j'avais vu d'abord a complètement disparu, et je ne puis rien retrouver qui y ressemble.
45. — Dans ces exemples et les autres de ce genre, voici, je crois, la véritable explication de ce qui se passe : — Ayant depuis longtemps éprouvé que certaines idées perceptibles par le toucher, — comme la distance, la figure tangible, la solidité, — ont été associées avec certaines idées de la vue, lorsque je perçois ces idées de la vue, je conclus sur-le-champ que les idées tangibles, d'après le cours habituel et ordinaire des choses, vont vraisemblablement suivre. Regardant un objet, je perçois une certaine figure visible et une certaine couleur, à un certain degré de faiblesse, et avec d'autres circonstances, qui, d'après mes expériences précédentes, me déterminent à croire que si j'avance de tant de pas, de milles, etc., je serai affecté de telles et telles idées du toucher.
Si bien que, à parler proprement et exactement, je ne vois ni la distance elle-même, ni rien que je saisisse comme situé à distance. Je dis donc que ni la distance, ni les choses placées à distance ne sont proprement perçues elles-mêmes par la vue, pas plus que leurs idées. J'en suis persuadé, pour ce qui me concerne moi- même. Et je crois que quiconque voudra considérer attentivement ses propres pensées, et examiner ce qu'il entend en disant qu'il voit ceci ou cela à une certaine distance, sera d'accord avec moi que ce qu'il voit suggère seulement à son entendement cette croyance, que, après avoir dépassé une certaine distance, qui devra être mesurée par le mouvement de son corps, mouvement qui peut être perçu par le toucher, il en viendra à percevoir telles et telles idées tangibles, qui ont été habituellement associées à telles et telles idées visuelles.
Or, que chacun puisse être trompé par ces suggestions des sens, et qu'il n'y ait aucune connexion nécessaire entre les idées de la vue et les idées du toucher suggérées par elles, il n'y a pas à en chercher bien loin la preuve : la première glace, le premier tableau venu peuvent suffire à nous en convaincre. Ajoutez que. quand je parle d'idées tangibles, j'entends par ce mot idée tout ce qui est donné immédiatement par les sens, ou par l'entendement, — sens très large dans lequel le mot est habituellement employé par les modernes.
46. — Il résulte manifestement de ce que nous avons établi que les idées d'espace, d'extériorité, et de choses situées à distance ne sont pas, pour parler exactement, les objets de la vue; elles ne sont pas autrement perçues par l'œil que par l'oreille. Assis dans mon cabinet, j'entends une voiture passer dans la rue; je regarde par la fenêtre, et je la vois; je sors, et je monte dans cette voiture. Ainsi, le langage ordinaire ferait croire que j'ai, entendu, vu et touché la même chose, à savoir, la voiture. Il est certain pourtant que les idées introduites en moi par chacun de ces sens sont très différentes et distinctes l'une de l'autre; mais comme on a observé constamment qu'elles vont ensemble, on en parle comme d'une seule et même chose. Par les variations du bruit, je perçois les diverses distances de la voiture, et je sais qu'elle approche avant de regarder. Ainsi, par l'oreille je perçois la distance exactement de la même manière que par l'œil.
47. — Je ne dis pas pourtant que j'entends la distance, comme je dis que je la vois, car les idées perçues par l'ouïe ne sont pas aussi propres à être confondues avec les idées du toucher que les idées de la vue. C'est ainsi qu'on se laisse aisément persuader que les corps et les choses extérieures ne sont pas l'objet propre de l'ouïe, mais seulement les sons, par l'intermédiaire desquels l'idée de tel ou tel corps ou de la distance est suggérée à la pensée. Mais par contre il sera bien plus difficile d'amener quelqu'un à discerner la différence qui existe entre les idées de la vue et celles du toucher; et pourtant il est certain que ce n'est pas plus la même chose qu'un homme voit et qu'il touche que ce n'est la même chose qu'il entend et qu'il touche.
48. — Une des raisons de ce fait me semble être la suivante. On admet que c'est une grande absurdité d'imaginer qu'une seule et même chose puisse avoir plus d'une étendue et d'une figure. Or l'étendue et la figure d'un corps étant introduites dans l'esprit de deux manières, et cela indifféremment, soit par la vue, soit par le toucher, il semble s'ensuivre que l'étendue et la figure que nous voyons est la même que celle que nous touchons.
49. — Mais, si nous examinons la question avec soin et précision, on reconnaîtra que ce n'est jamais un seul et même objet que l'on voit et que l'on touche. Ce que l'on voit est une chose, et ce que l'on touche en est une autre. Si la figure et l'étendue visibles ne sont pas les mêmes que la figure et l'étendue tangibles, nous n'en devons pas inférer qu'une seule et même chose possède diverses étendues. La véritable conséquence à tirer, c'est que les objets de la vue et du toucher sont deux choses distinctes. Or, pour bien concevoir cette distinction, quelque réflexion est peut-être nécessaire. Et la difficulté semble fort accrue encore par ce fait que l'ensemble des idées visibles est désigné constamment par le même mot que l'ensemble des idées tangibles avec lesquelles les premières sont associées, ce qui provient nécessairement de l'usage et de l'objet du langage.
50. — Dès lors, pour traiter avec précision et le moins confusément possible de la vision, nous devons nous bien mettre dans l'esprit qu'il y a deux catégories d'objets saisis par l'œil, la première originellement et immédiatement, l'autre en second lieu, et par l'intermédiaire de la première. Les objets de la première sorte ni ne sont ni n'apparaissent extérieurs à l'esprit, ou à distance. Ils peuvent bien, à la vérité, devenir plus grands ou plus petits, plus confus ou plus distincts, ou plus faibles ; mais ils ne se rapprochent pas, et ne peuvent pas se rapprocher [ou même sembler le faire], ni s'éloigner de nous. Toutes les fois que nous disons d'un objet qu'il est à une certaine distance, qu'il vient plus près ou qu'il s'écarte, nous devons toujours entendre cela de la seconde catégorie d'objets, qui proprement sont du ressort du toucher, et ne sont pas tant perçus, en réalité, que suggérés par l'oeil de la même manière que les pensées par l'oreille.
31. — Nous n'entendons pas plus tôt prononcer à nos oreilles les mots d'une langue qui nous est familière qu'aussitôt les idées qui y correspondent se présentent d'elles-mêmes à notre esprit : c'est absolument dans le même moment que le son et sa signification pénètrent dans l'entendement, si intimement liés qu'il ne dépend pas de nous d'écarter l'un des deux, sans par cela même exclure l'autre également. Bien plus, nous agissons à tous égards connue si nous entendions proprement les pensées elles-mêmes. C'est ainsi également que les objets secondaires, c'est-à-dire ceux qui sont seulement suggérés par la vue, nous affectent parfois plus vivement et attirent plus notre attention que les objets propres de ce sens, à la suite desquels ils sont entrés dans notre esprit, et avec lesquels ils sont liés par une connexion beaucoup plus étroite que les idées avec les mots.
Voilà pourquoi nous trouvons si difficile de discerner entre les objets immédiats et les objets médiats de la vue, et pourquoi nous sommes si dis- posés à attribuer aux premiers ce qui ne se rapporte qu'aux seconds seuls. C'est qu'ils sont, pour ainsi dire, trop intimement enlacés, mêlés ensemble, et comme incorporés les uns aux autres. Et ce préjugé est confirmé et comme rivé à nos pensées par la longueur du temps écoulé, l'habitude du langage et le manque de réflexion.
Cependant je ne doute pas que quiconque voudra considérer attentivement ce que nous avons déjà dit et dirons encore sur cette matière avant de finir (surtout s'il poursuit cette étude dans ses propres pensées) sera à même de se délivrer de ce préjugé. En tout cas, l'on peut bien mettre un peu d'attention si l'on veut comprendre la nature réelle de la vision.
L'intuition interne, directe, voilà sur quoi s'appuient, et la théorie de la vision, et la négation des idées abstraites, et l'immatérialisme lui-même. Mais pourquoi donc tout le monde ne pratique-t-il pas spontanément cette méthode aussi infaillible que facile? C'est que, pour voir clair en soi-même, il importe d'abord d' "écarter le voile des mots". Le langage, comme il l'écrira dans l'introduction du Traité, produit des illusions nombreuses et funestes : la "doctrine des idées abstraites" est son pire méfait. Berkeley exhorte à maintes reprises son lecteur à ne pas s'en tenir au texte de l'Essai : le langage trahit nécessairement sa pensée, enveloppe de contradictions apparentes, superficielles, les conceptions que l'expérience interne rendrait immédiatement claires jusqu'à l'évidence.
La dernière partie de l'Essai est consacrée à démontrer cette thèse, que la géométrie ne se rapporte pas à l'étendue visible, mais bien à l'étendue tangible; ce n'est qu'un «corollaire» de la théorie de la vision. La véritable conclusion de l'ouvrage doit être cherchée un peu plus haut (§§ 147-148); elle est contenue dans cette formule : « Les objets propres de la vision constituent le langage universel de la nature. »
"147. — En somme, nous pouvons, je crois, conclure avec assurance que les objets propres de la vision constituent le langage universel de la nature, qui, par ce moyen, nous enseigne à régler nos actions de manière à acquérir les choses qui sont nécessaires à la conservation et au bien- être de notre corps, et aussi à éviter tout ce qui peut le blesser ou le détruire. C'est par les informations qu'ils nous donnent que nous sommes surtout guidés dans toutes les affaires et dans toutes les occupations de la vie. Et la manière dont ils nous indiquent les objets placés hors de nous et dont ils en sont les signes est la même que pour les langages et les signes d'institution humaine; c'est-à-dire qu'ils ne nous suggèrent point les choses signifiées en vertu de quelque ressemblance ou identité de nature, mais seulement par une association habituelle que l'expérience nous a fait remarquer entre eux.
148. — Supposez qu'un homme, qui est resté toujours aveugle, entende son guide lui dire qu'après avoir fait tant de pas il arrivera au bord d'un précipice ou qu'il sera arrêté par un mur : ces paroles ne lui sembleront elles pas merveilleuses et surprenantes? Il ne pourra concevoir qu'il soit possible à des mortels de former de semblables prédictions, qui lui paraissent aussi étranges et aussi inexplicables que les prophéties le semblent à d'autres. Même ceux qui ont le bonheur de jouir de la faculté de la vue peuvent pourtant y trouver (quoique l'habitude les y rende moins attentifs) des motifs suffisants d'admiration. L'art merveilleux, l'habileté avec laquelle la vue est adaptée aux fins et aux objets auxquels elle était évidemment destinée; l'étendue immense, le nombre et la variété des choses qu'elle suggère à la fois, avec tant de facilité, de rapidité et de plaisir, — tout cela nous apporte des sujets de longue et agréable méditation, et semble propre, mieux que toute autre considération, à nous faire entrevoir, comme par une analogie lointaine et un vague pressentiment, des choses qui sont placées au-dessus de ce que nous pouvons découvrir et comprendre avec certitude dans notre état présent."
(Essai d'une nouvelle Théorie de la Vision, Œuvres choisies de Berkeley, traduites par Beaulavon et Parodi. Paris, Alcan, 1895.)
Ici se dévoile l'arrière-pensée métaphysique (et théologique) de l'auteur. Nos sensations visuelles sont les signes des objets, et des signes d'une merveilleuse utilité : par leur connexion, tout empirique, mais régulière, avec les idées tactiles, elles deviennent pour notre action des guides infaillibles. Mais d'où viendrait, entre les différentes classes de données sensorielles, cette liaison, à la fois constante et purement extrinsèque, sinon d'une Providence qui l'ait instituée pour le plus grand bien des hommes? Il faut admirer « l'art merveilleux, l'habileté avec laquelle la vue est adaptée aux fins et aux objets auxquels elle était évidemment destinée... », et tout cela nous fait « entrevoir, comme par une analogie lointaine et un vague pressentiment, des choses qui sont placées au-dessus de ce que nous pouvons découvrir et comprendre avec certitude dans notre état présent. » La théorie de la vision nous mène jusqu'à Dieu ..

Chez Berkeley, en étroite connexion avec l'immatérialisme, nous rencontrons le "nominalisme", autrement dit une critique de la "doctrine des idées abstraites". Quoiqu'en Locke et les autres philosophes, il n'y a rien, suivant Berkeley, qui puisse s'appeler "idée générale et abstraite". Comment faut-il entendre cette négation? Il y a une sorte d'abstraction que Berkeley ne songe pas à nier, celle qui consiste à concevoir isolément une partie quelconque d'un tout, c'est-à-dire à séparer par la pensée ce qui est concrètement séparable. De même, Berkeley ne refuse pas à l'idée toute espèce de généralité; seulement cette généralité n'appartient pas à l'idée prise en elle-même : elle réside uniquement dans une certaine manière de l'envisager. Soit, par exemple, l'idée de triangle, sur laquelle raisonne le géomètre : est-elle, comme on le dit, l'idée d'un triangle qui ne serait ni isocèle ni équilatéral? Non, car une telle idée serait contradictoire : nul ne peut la former. Il n'y a donc dans l'esprit du géomètre qu'une idée «particulière». Et néanmoins la géométrie conserve son universalité : car, si l'idée du triangle ne peut être en elle-même que particulière, elle peut être «générale quant à sa signification»; l'idée d'un certain triangle peut servir à représenter n'importe quel triangle. Berkeley ne conteste donc pas l'existence d'idées générales, à condition qu'on mette la généralité, non dans l'idée elle-même, mais dans son rapport avec les autres idées du même genre, auxquelles elle sert de substitut. Ce qui lui paraît inadmissible, c'est l'existence d'idées générales et abstraites, au sens où abstrait est synonyme d'indéterminé et ne peut être pensé.
La doctrine de l'immatérialisme s'inspire ouvertement de l'esprit nominaliste. Si l'idée de substance matérielle est une pure chimère, c'est qu'elle présente tous les caractères d'une idée abstraite : la matière considérée à part des qualités sensibles, voilà qui est aussi inconcevable, et pour les mêmes raisons, que le triangle abstrait et indéterminé ; et la plupart des hommes ne s'attacheraient pas si obstinément à ce néant, s'ils ne s'attribuaient pas le pouvoir d'abstraire.
Le nouveau principe auquel va s'attacher Berkeley dans ses oeuvres à venir est donc celui de l'immatérialisme. La Matière n'existe pas : voilà la découverte qu'annonçaient aux hommes en prenant soin de ne pas la faire figurer sur la couverture, le Traité des Principes de la Connaissance et les Dialogues d'Hylas et de Philonous.
Elle était faite pour surprendre, et pendant longtemps les contre-sens s'accumulèrent sur elle. Ce que nie Berkeley, ce n'est en aucune façon l'existence des choses corporelles : loin d'être une doctrine sceptique, l'immatérialisme, comme on sait, prétend ruiner définitivement le scepticisme. Ce que Berkeley proclame un pur fantôme, c'est la Matière, avec une majuscule, c'est-à-dire la substance matérielle, considérée comme existant en soi et indépendamment de l'esprit. Les corps existent ; mais leur existence ne consiste que dans le fait d'être perçus.
Les choses (corporelles) sont des idées; on doit dire en parlant d'elles : esse est percipi. Ce n'est pas leur enlever l'existence que d'en définir le mode. Maintenant ces idées, qu'est-ce qui les perçoit? Des esprits. Une idée ne peut exister que dans un esprit ; et de ces esprits, on peut dire : esse est percipere. Formule incomplète, car l'esprit n'est pas seulement une faculté de percevoir, mais encore une faculté de vouloir. Tout ce qui existe peut se diviser en deux catégories, qui d'une part, ne laissent rien en dehors d'elles, et, d'autre part, diffèrent entre elles d'une façon tranchée : les idées et les esprits...
La doctrine de Berkeley est idéaliste. D'abord parce qu'elle est subjectiviste : les qualités sensibles ne sont que des idées, n'ont pas d'existence en dehors de l'esprit qui les perçoit; à cet égard Berkeley ne fait qu'étendre à toutes les qualités sans exception le caractère subjectif que d'autres philosophes avaient accordé à quelques-unes, savoir aux qualités dites secondes. Les corps sont des «représentés», et ne sont que cela.
A une condition toutefois, et voici le second aspect de cet idéalisme : c'est qu'il n'y ait rien de plus dans les corps que les qualités sensibles qu'on y perçoit; c'est que derrière ces qualités sensibles n'existe rien de tel qu'une substance, mystérieux substratum que nulle perception ne saisirait.
La critique de la matière présente donc une double signification, subjectiviste et phénoméniste : elle s'en prend à la fois à un certain réalisme, qui pose des choses hors de l'esprit, et à un certain substantialisme, qui pose des choses sous les qualités.
Une substance matérielle, une réalité indépendante de l'esprit: voilà les deux absurdités que Berkeley dénonce dans le «matérialisme», c'est-à-dire dans la doctrine suivant laquelle la matière existe. Philonous commence par convaincre Hylas de la subjectivité des qualités sensibles ; ce n'est qu'ensuite qu'il montre, en réponse aux objections d'Hylas, qu'il n'y a pas à chercher dans les corps autre chose que ces qualités...
Descartes et Locke s'entendaient pour distinguer d'avec les «qualités primaires », auxquelles ils prêtaient une réalité, objective, les «qualités secondes», simples façons de sentir. Chez Berkeley cette distinction perd sa raison d'être : toute qualité devient subjective. Considérons d'abord les températures, les saveurs, les odeurs, les sons, les couleurs : toutes ces «choses sensibles» ne peuvent exister que dans un esprit qui les perçoit. En effet, le plaisir et la douleur ne sont que des événements purement subjectifs : or une chaleur très intense, par exemple, est une douleur (entendez qu'elle ne forme, avec la douleur qui l'accompagne, qu'une seule perception ou idée), et il n'est pas de degré de chaleur qui ne puisse être, selon le cas, douleur ou plaisir : donc le chaud et le froid n'existent que dans le sujet qui les éprouve....
La matière, séparée des qualités sensibles, est un pur néant; c'est une idée abstraite, indéterminée, inconcevable. La substance matérielle n'échappe pas seulement aux prises de l'imagination sensible : elle n'est l'objet d'aucune représentation; quand on en parle, on ne sait pas ce qu'on dit. Elle n'est pour notre pensée rien de positif : donc elle n'est pas. La pensée ne peut sortir d'elle-même, donc une chose ne peut exister qu'en un esprit ...

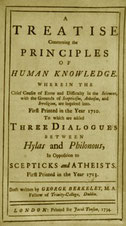
"Treatise concerning the Principles of Human Knowledge" (Traité des principes de la connaissance humaine, 1710)
Publié alors que George Berkeley (1685-1753), futur évêque de Cloyne, n'a que vingt-cinq ans, le Traité des principes de la connaissance humaine ne rencontra pas le succès que la postérité sut lui reconnaître. Berkeley part d'une évidence : les mots nous voilent la réalité. Plus que tout autre, celui de « matière » ne répond en rien à notre expérience : nous n'avons d'autre rapport à ce qui est que ce que nous percevons : « Être c'est être perçu » (Esse est percipi).
La structure du Traité est peu précise. Dans les 156 paragraphes que comporte cette œuvre, extrêmement dense, il est toutefois possible de distinguer trois séquences : la première (paragr. 1-33) expose de façon très condensée la doctrine de l'immatérialisme; la seconde (paragr. 34-84) réfute treize objections possibles ; la troisième (paragr. 85-156), enfin, montre les avantages de la doctrine mise en place.
L'immatérialisme ne s'oppose pas au sens commun, il ne va pas dans le sens des sceptiques, pas plus qu'il ne nie la réalité ou ne contredit les savants. Le monde n'est pas un songe, les critiques faisant de la pensée de Berkeley un « idéalisme fantastique » (Kant) n'ont pas été assez attentives à ses démonstrations. Dès lors que l'être des choses est d'être perçu, « il n'est pas possible qu'elles aient quelque existence en dehors des esprits ou choses pensantes qui les perçoivent » (paragr. 3).
"I . — Il est visible à quiconque porte sa vue sur les objets de la connaissance humaine, qu'ils sont ou des idées actuellement imprimées sur les sens, ou des idées perçues quand l'attention s'applique aux passions et aux opérations de l'esprit, ou enfin des idées formées à l'aide de la mémoire et de l'imagination, en composant, ou divisant, ou ne faisant simplement que représenter celles qui ont été perçues originairement suivant les manières qu'on vient de dire. Par la vue, j'ai les idées de la lumière et des couleurs avec leurs différents degrés et leurs variations. Par le toucher, je perçois le dur et le mou, le chaud et le froid, le mouvement et la résistance, et tout cela plus ou moins, eu égard au degré ou à la quantité. L'odorat me fournit des odeurs, le palais des saveurs, et l'ouïe apporte des sons à l'esprit, avec toutes leurs variétés de tons et de composition.
Et comme plusieurs de ces sensations sont observées en compagnie les unes des autres, il arrive qu'elles sont marquées d'un même nom, et du même coup réputées une même chose. Par exemple, une certaine couleur, une odeur, une figure, une consistance données, qui se sont offertes ensemble à l'observation, sont tenues pour une chose distincte, et le nom de pomme sert à la désigner. D'autres collections d'idées forment une pierre, un arbre, un livre, et autres pareilles choses sensibles, lesquelles étant agréables ou désagréables, excitent les passions de l'amour, de la haine, de la joie, de la peine, et ainsi de suite.
2. — Mais outre toute cette variété indéfinie d'idées ou objets de connaissance, il y a quelque chose qui les connaît. qui les perçoit, et exerce différentes opérations à leur propos, telles que vouloir, imaginer, se souvenir. Cet être actif percevant est ce que j'appelle esprit (mind, spirit), cime ou moi. Par ces mots je n'entends aucune de mes idées, mais bien une chose entièrement distincte d'elles, en laquelle elles existent, ou, ce qui est la même chose, par laquelle elles sont perçues; car l'existence d'une idée consiste à être perçue.
3. — Que ni nos pensées, ni nos passions, ni les idées formées par l'imagination n'existent hors de l'esprit, c'est ce que chacun accordera. Pour moi, il n'est pas moins évident que les diverses sensations ou idées imprimées sur les sens, quelque mêlées ou combinées qu'elles soient (c'est-à-dire quelques objets qu'elles composent par leurs assemblages), ne peuvent pas exister autrement qu'en un esprit qui les perçoit. Je crois que chacun peut s'assurer de cela intuitivement, si seulement il fait attention à ce que le mot exister signifie, quand il s'applique aux choses sensibles. La table sur laquelle j'écris, je dis qu'elle existe : c'est-à-dire, je la vois, je la sens; et si j'étais hors de mon cabinet, je dirais qu'elle existe, entendant par là que si j'étais dans mon cabinet je pourrais la percevoir, ou que quelque autre esprit la perçoit réellement. Il y a eu une odeur, cela veut dire : une odeur a été perçue; il y a eu un son : il a été entendu ; une couleur, une figure : elles ont été perçues par la vue ou le toucher. C'est là ce que je puis comprendre par ces expressions et autres semblables. Car pour ce qu'on dit de l'existence absolue des choses qui ne pensent point, existence qui serait sans relation avec ce fait qu'elles sont perçues, c'est ce qui m'est parfaitement inintelligible. Leur esse consiste dans le percipi, et il n'est pas possible qu'elles aient une existence quelconque hors des esprits ou choses pensantes qui les perçoivent.
4. — C'est, il est vrai, une opinion étrangement dominante parmi les hommes, que les maisons, les montagnes, les rivières, tous les objets sensibles en un mot, ont une existence naturelle, ou réelle, distincte du fait qu'ils sont perçus par l'entendement. Mais quelque grande que soit l'assurance qu'on a dans ce principe, et quelle que soit l'étendue de l'assentiment que lui donne le monde, toute personne qui aura le courage de le mettre en question pourra, si je ne me trompe, reconnaître qu'il implique une contradiction manifeste. Que sont, en effet, les objets qu'on vient de mentionner, si ce n'est des choses que nous percevons par les sens? Et ne répugne-t-il pas pleinement que l'un quelconque d'entre eux, ou quelqu'une de leurs combinaisons existent non-perçus?
5. — Si nous examinons cette opinion à fond, nous trouverons peut-être qu'elle dépend de la doctrine des idées abstraites. Car peut-il y avoir un procédé d'abstraction plus subtil que de distinguer l'existence des objets sensibles d'avec le fait d'être perçus, de manière à les concevoir existants non-perçus? La lumière et les couleurs, la chaleur et le froid, l'étendue et les figures, en un mot les choses que nous voyons et sentons, que sont-elles, qu'autant de sensations, notions, idées, ou impressions sur les sens? Et est-il possible de séparer, même par la pensée, aucune de ces choses d'avec la perception? Pour ma part, je pourrais tout aussi aisément séparer une chose d'avec elle-même. Je peux, il est vrai, dans mes pensées, séparer ou concevoir à part les unes des autres des choses que peut-être je n'ai jamais perçues par mes sens ainsi divisées. J'imagine le tronc d'un corps humain sans les membres, ou je conçois l'odeur d'une rose sans penser à la rose elle-même. Jusque-là, je ne nierai pas que je ne puisse abstraire, s'il est permis d'user de ce mot abstraction en ne l'étendant qu'à la conception, par des actes séparés, d'objets tels, qu'il soit possible qu'ils existent réellement ou soient effectivement perçus à part. Mais mon pouvoir d'imaginer ou de concevoir ne va pas au delà de la possibilité de la réelle existence ou perception. Ainsi, comme il m'est impossible de voir ou sentir quelque chose sans en avoir une sensation effective, il m'est pareillement impossible de concevoir dans mes pensées une chose sensible ou un objet, distinct de la sensation ou perception que j'en ai. [En vérité, l'objet et la sensation sont la même chose et ne peuvent s'abstraire l'un de l'autre.]
6. — Il y a des vérités si claires et naturelles pour l'esprit qu'un homme n'a besoin que d'ouvrir les yeux pour les voir. Dans le nombre, je place cette importante vérité : que tout le chœur céleste et tout le mobilier de la terre, en un mot tous ces corps qui composent l'ordre puissant du monde, ne subsistent point hors d'un esprit; que leur cire est d'être perçus ou connus; que, par conséquent, du moment qu'ils ne sont pas effectivement perçus par moi, ou qu'ils n'existent pas dans mon esprit [in my mind), ou dans celui de quelque autre esprit créé (created spirit), il faut qu'ils n'aient aucune sorte d'existence, ou bien qu'ils existent dans l'esprit [mind) de quelque [Spirit) étemel. Attribuer à quelqu'une de leurs parties une existence indépendante d'un esprit (of a spirit), cela est inintelligible et implique toute l'absurdité de l'abstraction. [Cette vérité doit éclater avec toute la lumière et l'évidence d'un axiome, si je peux seulement éveiller la réflexion du lecteur, et obtenir de lui qu'il se rende impartialement compte de ce qu'il entend lui-même, et qu'il porte sur ce sujet ses pensées libres, dégagées de la confusion des mots et de tout préjugé en faveur des erreurs reçues.]
7. — D'après ce qui a été dit, il est évident qu'il n'y a pas d'autre substance que l'Esprit [Spirit) ou ce qui perçoit. Mais pour démontrer ce point plus clairement, considérons que les qualités sensibles sont couleur, figure, mouvement, odeur, goût, etc., c'est-à-dire des idées perçues par les sens. Pour une idée, exister en une chose non percevante, c'est une contradiction manifeste, car avoir une idée ou la percevoir c'est tout un; cela donc en quoi la couleur, la figure, etc., existent doit les percevoir. Il suit de là clairement qu'il ne peut y avoir de substance ou substratum non pensant de ces idées.
8. — Mais, dira-t-on, quoique les idées elles-mêmes n'existent pas hors de l'esprit (mind), il peut y avoir des choses qui leur ressemblent et dont elles sont des copies ou images, lesquelles choses existent hors de l'esprit dans une substance non pensante. Je réponds qu'une idée ne peut ressembler à rien qu'à une idée; une couleur, une figure, ne peuvent ressembler à rien qu'à une autre couleur ou figure. Si nous regardons seulement un peu dans nos propres pensées, nous trouverons qu'il nous est impossible de concevoir une ressemblance si ce n'est entre nos idées.
De plus, ces originaux supposés, ou choses externes, desquelles nos idées seraient des portraits ou représentations, je demande si elles sont elles-mêmes percevables ou non. Si elles sont percevables, elles sont donc des idées, et nous avons gagné notre cause. Et si on dit qu'elle ne sont pas percevables, j'en appelle à qui que ce soit, y a-t-il de la raison à prétendre qu'une couleur est semblable à quelque chose d'invisible; que le dur ou le mou sont semblables à quelque chose d'intangible; et ainsi du reste ?
9. — Il y en a qui distinguent entre qualités primaires et qualités secondaires. Par celles-là, ils entendent l'étendue, la figure, le mouvement, le repos, la solidité ou impénétrabilité, et le nombre; par celles-ci, ils désignent toutes les autres qualités sensibles, telles que couleurs, sons, saveurs et autres pareilles. Ils reconnaissent que les idées de ce dernier genre ne sont pas des ressemblances de quelque chose d'existant hors de l'esprit, ou de non perçu, mais ils soutiennent que nos idées des qualités premières sont les types ou images de choses qui existent hors de l'esprit, en une substance non pensante, qu'ils appellent Matière. Nous avons donc à entendre par Matière une substance inerte, privée de sentiment, dans laquelle l'étendue, la figure et le mouvement subsistent réellement. Mais il est évident, d'après ce que nous avons déjà montré, que l'étendue, la figure et le mouvement ne sont que des idées existant dans l'esprit, et qu'une idée ne peut ressembler qu'à une autre idée, et que par conséquent ni celles-là, ni leurs archétypes, ne peuvent exister en une substance non percevante. Il est clair d'après cela que la notion même de ce qu'on appelle Matière ou substance corporelle implique contradiction. [En sorte qu'il ne me paraîtrait pas nécessaire d'employer beaucoup de temps à en faire ressortir l'absurdité. Mais voyant que l'opinion de l'existence de la matière semble avoir jeté de si profondes racines dans l'esprit des philosophes, et qu'elle mène tant de mauvaises conséquences à sa suite, j'aime mieux courir le risque de la prolixité et de l'ennui que d'omettre rien de ce qui peut servir à la pleine découverte et à l'extirpation de ce préjugé.]
10. — Ceux qui assurent que la figure, le mouvement et les autres finalités primaires ou originelles existent hors de l'esprit, dans une substance non pensante, reconnaissent bien en même temps que les couleurs, les sons, la chaleur, le froid et autres pareilles qualités secondaires ne sont pas dans le même cas : ce sont, nous disent-ils, des sensations qui existent dans l'esprit seulement, et qui dépendent occasionnellement des différents volumes, contextures et mouvements des menues particules de la matière. Ils regardent ce point comme une vérité non douteuse et se croient en état de le démontrer sans réplique. Or, il est certain que si ces qualités originelles sont inséparablement unies aux autres qualités sensibles, si elles ne peuvent s'en abstraire, même dans la pensée, il doit s'ensuivre de là qu'elles n'existent, elles non plus, que dans l'esprit. Je désire donc que chacun y réfléchisse, et cherche s'il lui est possible, en s'y exerçant, de concevoir, par n'importe quelle abstraction de pensée, l'étendue et le mouvement d'un corps en dehors de toutes les autres qualités sensibles. Quant à moi, je vois évidemment qu'il n'est point en mon pouvoir de me former une idée d'un corps étendu et en mouvement, à moins de lui donner en même temps quelque couleur, ou autre qualité sensible, de celles qui sont reconnues n'exister que dans l'esprit. En somme, l'étendue, la figure et le mouvement, séparés par abstraction de toutes les autres qualités, sont inconcevables. Là donc où les autres sont, celles-là doivent être aussi, à savoir dans l'esprit et nulle part ailleurs.
11. — De plus, le grand et le petit, le vite et le lent, n'existent pas hors de l'esprit, on l'accorde : ce sont de purs relatifs qui changent selon que varient la constitution ou la position des organes des sens. L'étendue qui existe hors de l'esprit n'est donc ni grande ni petite, le mouvement n'est ni vite ni lent, c'est-à-dire qu'ils ne sont rien du tout. Mais on dira : il y a une étendue en général, un mouvement en général. On le dira, et c'est ce qui montre combien l'opinion des substances étendues et mobiles existantes hors de l'esprit, dépend de cette étrange doctrine des idées abstraites. Et ici je ne puis m 'empêcher de remarquer à quel point ressemble à la vieille notion tant ridiculisée de la materia prima d'Aristote et de ses sectateurs, la description vague et indéterminée de la Matière, ou substance corporelle, où les philosophes modernes sont conduits par leurs principes. Sans l'étendue, la solidité ne peut se concevoir; mais puisque on a montré que l'étendue n'existe pas dans une substance non pensante, il doit en être de même de la solidité.
12. — Le nombre est entièrement la créature de l'esprit. On conviendra qu'il en est ainsi, alors même qu'on admettrait que les autres qualités peuvent exister hors de lui, si l'on veut seulement considérer qu'une même chose porte différentes dénominations numériques selon que l'esprit l'envisage .sous différents rapports. C'est ainsi que la même étendue est un, trois ou trente-six, suivant que l'esprit la rapporte au yard, au pied ou au pouce. Le nombre est si visiblement relatif, et dépendant de l'entendement, qu'il est étrange de penser que quelqu'un lui attribue une existence indépendante, hors de l'esprit. Nous disons : un livre, une page, une ligne, etc.; toute ces choses sont également des unités, et pourtant certaines d'entre elles contiennent plusieurs des autres. Il est clair que dans chaque cas les unités se rapportent à une combinaison particulière d'idées que l'esprit assemble arbitrairement.
13. — Je sais que, suivant quelques-uns, l'unité serait une idée simple, sans composition, accompagnant toutes les autres idées dans l'esprit. Mais je n'aperçois pas que je possède une telle idée répondant au mot unité. Si je la possédais, il me semble que je ne pourrais manquer de la trouver; et même elle serait la plus familière de toutes à mon entendement, puisque on dit qu'elle accompagne toutes les autres idées, et qu'elle est perçue par toutes les voies de la sensation et de la réflexion. Pour le faire bref, c'est une idée abstraite.
14. — J'ajouterai maintenant que, de la manière même dont les philosophes modernes prouvent que certaines qualités sensibles n'ont pas d'existence dans la matière, ou hors de l'esprit, on peut prouver que les autres qualités sensibles quelconques sont dans le même cas. Ainsi, l'on dit que le chaud et le froid sont des affections données dans l'esprit seulement, et non point du tout des types de choses réelles existant dans les substances corporelles qui les excitent, par cette raison que le même corps qui paraît froid à une main paraît chaud à l'autre.
D'après cela, pourquoi ne pas arguer aussi bien, pour prouver que la figure et l'étendue ne sont pas des types ou ressemblances de qualités existant dans la Matière, de ce que le même œil, pour des stations différentes, ou des yeux de différente structure, pour une même station, les voient varier; de sorte qu'elles ne peuvent être les images de quelque chose de fixe et de déterminé hors de l'esprit? Ou encore : il est prouvé que le doux n'est pas dans le corps sapide, attendu que, sans aucun changement dans ce corps, le doux devient amer, comme dans un cas de fièvre ou d'altération quelconque de l'organe du goût : n'est-il pas tout aussi raisonnable de dire que le mouvement n'est pas hors de l'esprit, puisque si la succession des idées dans l'esprit devient plus rapide, il est reconnu que le mouvement paraît plus lent, sans qu'il y ait aucune modification survenue en un objet externe ?
15. — Bref, qu'on examine les arguments qu'on croit manifestement bons pour prouver que les couleurs et les saveurs existent seulement dans l'esprit, on trouvera qu'on peut les faire valoir avec la même force pour l'étendue, la figure et le mouvement. Sans doute on doit convenir que cette manière d'argumenter ne démontre pas tant ceci : qu'il n'y a point étendue ou couleur dans un objet externe, qu'elles ne démontrent que nos sens ne nous apprennent point quelles sont la vraie étendue ou la vraie couleur de l'objet. Mais les arguments qui ont été représentés auparavant montrent pleinement l'impossibilité qu'une étendue, une couleur, ou toute autre qualité sensible existe dans un sujet non pensant, hors de l'esprit; ou, à dire vrai, l'impossibilité qu'il y ait telle chose qu'un objet externe.
16. — Mais examinons un peu l'opinion reçue. On dit que l'étendue est un mode ou accident de la Matière, et que la Matière est le substratum qui la supporte. Mais je voudrais qu'on m'expliquât ce qu'on entend par ce support de l'étendue par la Matière. Je n'ai pas, me direz-vous, d'idée de la Matière, et par conséquent je ne puis l'expliquer. — Je réponds qu'encore que vous n'en ayez pas une idée positive, si vous attachez un sens quelconque à ce que vous dites, vous devez au moins en avoir une idée relative ; si vous ignorez ce qu'elle est, il faut supposer que vous savez quelle relation elle soutient avec ses accidents, et ce que vous entendez quand vous dites qu'elle les supporte. Il est évident que "support" ne peut être pris dans le sens usuel ou littéral, comme quand nous parlons des piliers qui supportent une bâtisse. Comment donc faut-il comprendre ce mot? [Pour ma part, je suis incapable de découvrir aucun sens qui lui soit applicable].
17. — Si nous nous enquérons de ce que les philosophes les plus exacts ont eux-mêmes déclaré qu'ils entendaient par substance matérielle, nous trouverons qu'ils reconnaissent eux-mêmes n'attacher d'autre sens à ces mots que celui d'Être en général, en y joignant la notion relative de support des accidents. L'idée générale de l'Être me paraît à moi plus abstraite et plus incompréhensible qu'aucune autre, et, pour ce qui est de sa propriété de supporter les accidents, elle ne peut, je l'ai déjà remarqué, se comprendre avec la signification commune des mots ; il faut donc qu'on les entende autrement ; mais de quelle manière, ils ne nous l'expliquent pas. Aussi, quand je considère ces deux parties ou faces du sens composé des tenues de substance matérielle, je suis convaincu qu'aucune signification distincte ne leur est attachée. Mais pourquoi nous inquiéterions-nous davantage d'une discussion portant sur ce substratum matériel, ou support de la figure, du mouvement et des autres qualités sensibles? Ne suppose-t-il pas que ces qualités ont une existence hors de l'esprit, et n'est-ce pas là quelque chose de directement contradictoire et d'entière- ment inconcevable?
18. — Mais quand même il serait possible que les substances solides, figurées, mobiles, existassent hors de l'esprit, en correspondance avec les idées que nous avons des corps, comment nous est-il possible de le savoir? Ce ne peut être que par les sens ou par la raison. Mais par nos sens, nous n'avons connaissance que de nos sensations, de nos idées ou de ces choses qui sont immédiatement perçues, qu'on les nomme comme on voudra : elles ne nous informent nullement de l'existence de choses hors de l'esprit, ou non perçues, semblables à celles qui sont perçues. Les matérialistes eux-mêmes reconnaissent cette vérité. Il reste donc, si nous avons quelque connaissance des choses externes, que ce soit par la raison, en inférant leur existence de ce qui est immédiatement perçu par les sens.
Mais je ne vois point quelle raison peut nous porter à croire à l'existence de corps hors de l'esprit, à savoir induite de ce que nous percevons, quand les avocats de la Matière eux- mêmes ne prétendent pas qu'il y ait une connexion nécessaire entre ces corps et nos idées. Tout le monde avoue (et ce qu'on observe dans les songes, le délire, etc., met le fait hors de doute) que nous pouvons être affectés des mêmes idées que nous avons maintenant, et cela sans qu'il y ait au dehors des corps qui leur ressemblent.
Il est évident par là que la supposition des corps externes n'est point nécessaire pour la production de nos idées, puisque on accorde qu'elles sont quelquefois produites, et pourraient peut-être l'être toujours, dans le même ordre où nous les voyons actuellement, sans le concours de ces corps.
19. — Mais peut-être, quoiqu'il nous fût possible d'avoir toutes nos sensations sans eux, on regardera comme plus aisé de concevoir et d'expliquer la manière dont elles se produisent, en supposant des corps externes qui soient à leur ressemblance, qu'on ne le ferait autrement; et, en ce cas, il serait au moins probable qu'il y a telle chose que des corps, qui excitent leurs idées en nos esprits. Mais cela non plus ne saurait se soutenir; car si nous concédons aux matérialistes leurs corps extérieurs, de leur propre aveu ils n'en sont pas plus avancés pour savoir comment nos idées sont produites. Ils se reconnaissent eux-mêmes incapables de comprendre comment un corps peut agir sur un esprit (spirit) ou comment il est possible qu'il imprime une idée dans l'esprit (mind). Il est donc clair que la production des idées ou sensations dans nos esprits ne peut nous être une raison de supposer une Matière, ou des substances corporelles, puisque cette production, avec ou sans la supposition, demeure également inexplicable. Ainsi, fût-il possible que des corps existassent hors de l'esprit, tenir qu'il en existe en effet de tels, ce doit être nécessairement une opinion très précaire. C'est supposer, sans la moindre raison, que Dieu a créé des êtres innombrables qui sont entièrement inutiles et ne servent à aucune sorte de dessein.
20. — En résumé, s'il y avait des corps externes, il est impossible qu'ils vinssent jamais à notre connaissance; et, s'il n'y en avait pas, nous pourrions avoir exactement les mêmes raisons que nous avons maintenant de penser qu'il y en a. Supposez — ce dont personne ne contestera la possibilité — qu'une intelligence (an intelligence), sans le secours des corps externes, soit affectée de la même suite de sensations ou idées qui vous affectent et que celles-ci soient imprimées dans le même ordre et avec la même vivacité dans son esprit [in his mind) : je demande si cette intelligence n'aurait pas toutes les mêmes raisons que vous pouvez avoir pour croire à l'existence des substances corporelles représentées par ses idées et les excitant dans son esprit? Ceci ne saurait être mis en question, et cette seule considération suffirait pour inspirer à toute personne raisonnable des doutes sur la validité des arguments quels qu'ils soient qu'elle penserait avoir en faveur de l'existence des corps hors de l'esprit.
21. — S'il était nécessaire d'ajouter de nouvelles preuves contre l'existence de la matière, après ce qui a été dit, je pourrais mettre en avant les erreurs et les difficultés (pour ne pas parler des impiétés) qui sont nées de cette opinion. Elle a occasionné en philosophie de nombreuses controverses et disputes, et plus d'une aussi, de beaucoup plus grande importance, en religion. Mais je n'entrerai pas dans tout ce détail à cet endroit, tant parce que je crois les arguments a posteriori inutiles pour confirmer ce que j'ai, si je ne me trompe, suffisamment démontré a priori, que parce que j'aurai plus loin l'occasion de parler de quelques-uns.
22. — Je crains d'avoir donné lieu à un reproche de prolixité en traitant ce sujet. A quoi sert, en effet, de délayer ce qui a été démontré avec la dernière évidence en une ligne ou deux, pour quiconque est capable de la moindre réflexion? C'est assez que vous regardiez dans vos propres pensées, et que vous vous mettiez à l'épreuve pour découvrir si vous êtes capable de concevoir cela possible : qu'un son, une figure, un mouvement, une couleur existent hors de l'esprit, ou non perçus. Cette épreuve facile vous fera peut-être apercevoir que l'opinion que vous soutenez est en plein une contradiction.
C'est tellement vrai que je consens à faire dépendre tout le litige de ce seul point : si vous pouvez comprendre la possibilité qu'une substance étendue et mobile, ou en général une idée, ou quelque chose de semblable à une idée, existe autrement qu'en un esprit qui la conçoit, je suis prêt à vous donner gain de cause. Et quant à tout le système des corps externes que vous défendez, je vous en accorderai en ce cas l'existence, encore que vous ne puissiez m 'alléguer aucune raison que vous ayez d'y croire, ou m'apprendre à quoi ils peuvent être utiles, à supposer qu'ils existent. Je dis que la pure possibilité que vos opinions soient vraies, passera pour un argument prouvant qu'elles le sont.
23. — Mais, dites- vous, sûrement il n'y a rien qui me soit plus aisé que d'imaginer des arbres dans un parc, par exemple, ou des livres dans un cabinet, et personne à côté pour les percevoir. Je réponds : vous le pouvez, cela ne fait point difficulté, mais qu'est cela, je le demande, si ce n'est former dans votre esprit certaines idées que vous nommez livres et arbres, et en même temps omettre de former l'idée de quelqu'un qui puisse les percevoir? Mais vous-mêmes ne les percevez-vous pas, ou ne les pensez- vous pas pendant ce temps ?
Ceci ne fait donc rien à la question : c'est seulement une preuve que vous avez le pouvoir d'imaginer ou former des idées dans votre esprit, mais non pas que vous pouvez concevoir la possibilité que les objets de votre pensée existent hors de l'esprit. Pour en venir à bout, il est indispensable que vous conceviez qu'ils existent non conçus, ou non pensés, ce qui est une contradiction manifeste. Quand nous faisons tout notre possible pour concevoir l'existence des corps externes, nous ne faisons tout le temps que contempler nos propres idées. Mais l'esprit, ne prenant pas garde à lui-même, s'illusionne, et pense qu'il peut concevoir et qu'il conçoit en effet des corps existants non pensés, ou hors de l'esprit, quoiqu'en même temps ils soient saisis par lui et existent en lui.
Avec un peu d'attention chacun reconnaîtra la vérité et l'évidence de ce qui est dit ici. Il n'est donc pas nécessaire d'insister et d'apporter d'autres preuves contre l'existence de la substance matérielle.
24. — [Si les hommes pouvaient s'empêcher de s'amuser aux mots, nous pourrions, je crois, arriver promptement à nous entendre sur ce point.] Il est très aisé de s'assurer par la moindre investigation portant sur nos propres pensées, s'il est ou non possible pour nous de comprendre ce que signifie une existence absolue des objets sensibles en eux-mêmes ou hors de l'esprit. Pour moi, il est évident que ces mots expriment une contradiction directe, ou qu'ils n'expriment rien du tout. Et pour convaincre autrui qu'il en est bien ainsi, je ne sais pas de meilleur moyen ou plus facile que de prier chacun de porter tranquillement son attention sur ses propres pensées. Si, dans ce cas, le vide ou l'impossibilité de ces expressions vient à ressortir, il ne faut rien de plus pour opérer la conviction. C'est donc sur ceci que j'insiste : à savoir que les mots : existence absolue de choses non pensantes, ou sont dénués de sens ou impliquent contradiction. C'est ce que je répète, et que je cherche à inculquer, et que je recommande instamment aux pensées attentives du lecteur.
25. — Toutes nos idées, sensations, notions, ou les choses que nous percevons, à l'aide de quelques noms qu'on puisse les distinguer, sont visiblement inactives; elles n'enferment nul pouvoir ou action. Ainsi une idée, ou objet de pensée, ne peut produire ou amener un changement dans une autre idée. Pour s'édifier pleinement sur cette vérité, il ne faut rien de plus que la simple observation de nos idées. Car, puisque toutes, et toutes leurs parties sans exception, existent seulement dans l'esprit, il s'ensuit qu'il n'y a rien en elles que ce qui est perçu ; or quiconque examinera attentivement ses idées, qu'elles soient des sens ou de la réflexion, n'y apercevra ni pouvoir ni activité : il n'y a donc rien de tel en elles.
Avec un peu d'attention, nous découvrirons que l'être même d'une idée implique en elle passivité et inertie, en sorte qu'il est impossible qu'une idée fasse quelque chose, ou, à strictement parler, soit la cause de quelque chose. Une idée ne peut non plus être la ressemblance ou le type d'un être actif; c'est ce qui résulte de ce qu'on a dit (sect. 8, ci-dessus). Il s'ensuit de là clairement que l'étendue, la figure et le mouvement ne peuvent être la cause de nos sensations. Lors donc que l'on dit qu'elles sont les effets de pouvoirs résultant de la configuration, du nombre, du mouvement et de la grandeur des corpuscules, on doit être certainement dans le faux.
26. — Nous percevons une succession continuelle d'idées : les unes sont excitées à nouveau, d'autres sont changées ou disparaissent en entier. Il y a donc quelque cause de ces idées, de laquelle elles dépendent, qui les produit et qui les change. Suivant ce qui a été dit dans une section précédente, cette cause ne peut être aucune qualité, ou idée ou combinaison d'idées. Il faut donc que ce soit une substance; mais on a montré qu'il n'y a pas de substance corporelle, ou matérielle; il reste donc que la cause des idées soit une substance incorporelle active, un Esprit {Spirit).
27. — Un Esprit est un être actif, simple, sans division : en tant qu'il perçoit les idées, on l'appelle l'entendement, et, en tant qu'il les produit, ou opère sur elles, la volonté. D'après cela, il ne peut y avoir d'idée formée d'une âme, ou esprit, car toutes les idées possibles étant passives et inertes (v. sect. 25), elles ne sauraient représenter en nous, par le moyen de la ressemblance et des images, ce qui agit. Un peu d'attention rendra évident à quiconque qu'il est absolument impossible d'avoir une idée qui porte la ressemblance de ce principe actif de mouvement et de changement des idées. Telle est la nature de l'esprit, ou de ce qui agit, qu'il ne peut être perçu par lui-même, mais seulement par les effets qu'il produit. Si quelqu'un doute de la vérité de ce qui est avancé ici, qu'il réfléchisse seulement, et qu'il essaie, s'il le peut, de se former l'idée d'un pouvoir ou être actif quelconque. Qu'il se demande s'il a des idées des deux principaux pouvoirs, désignés par les noms de volonté et d'entendement; s'il les a distinctes l'une de l'autre, aussi bien que d'une troisième idée : l'idée de Substance ou Être en général, avec une notion relative de sa propriété de supporter les susdits pouvoirs, d'en être le sujet.
Car c'est cela qu'on entend par le nom d'âme ou esprit. Quelques-uns tiennent qu'il en est ainsi; mais, autant que je puis voir, les mots volonté, entendement, esprit (mind), âme, esprit (spirit), ne se rapportent pas à différentes idées, et, à vrai dire, ne se rapportent à aucune idée, mais à quelque chose de très différent des idées, et qui, en qualité d'agent, ne peut ressembler à aucune, ni être représenté par aucune. [En même temps, il faut avouer cependant que nous avons une notion de l'âme, de l'esprit (spirit), et des opérations de l'esprit (mind), telles que vouloir, aimer, haïr, puisque nous connaissons ou comprenons la signification de ces mots ]
28. — Je constate que je puis exciter à mon gré des idées dans mon esprit, changer et varier la scène aussi souvent que je le trouve bon. Il ne faut que vouloir, aussitôt telle ou telle idée s'élève dans ma fantaisie; et le même pouvoir fait qu'elle s'efface et cède la place à une autre. Ce faire et défaire des idées est la très propre désignation de l'esprit actif (mind active). Tout cela est certain, l'expérience en est le fondement; mais quand nous parlons d'agents non pensants, ou d'une excitation des idées sans qu'aucune volition intervienne, nous ne faisons que nous amuser avec des mots.
29. — Mais quelque pouvoir que j'exerce sur mes propres pensées, je reconnais que les idées perçues actuellement par mes sens ne sont pas aussi dépendantes de ma volonté. Quand j'ouvre les yeux en plein jour, il n'est pas en mon pouvoir de voir ou de ne pas voir, non plus que de déterminer les différents objets qui se présenteront à ma vue; et il en est de même de l'ouïe et des autres sens : les idées dont ils reçoivent l'impression ne sont pas des créatures de ma volonté. Il y a donc quelque autre Volonté ou Esprit qui les produit.
30. — Les idées des sens sont plus fortes, vives et distinctes que celles de l'imagination. Elles ont aussi une fermeté, un ordre, une cohérence, et ne sont point excitées au hasard, comme c'est souvent le cas pour celles qui sont des effets des volontés humaines. Elles se produisent, au contraire, en une série ou chaîne régulière, dont l'admirable agencement prouve assez la sagesse et la bienveillance de leur Auteur. Or les règles fixées ou méthodes établies, moyennant lesquelles l'Esprit (the Mind) dont nous dépendons excite en nous les idées des sens, se nomment les lois de la nature. Celles-là, nous les apprenons par l'expérience, qui nous enseigne que telles et telles idées sont accompagnées de telles et telles autres idées, dans le cours ordinaire des choses.
31. — Nous tirons de là une sorte de prévision qui nous permet de régler nos actions pour l'utilité de la vie. Autrement nous serions perpétuellement en danger, ne sachant comment agir pour nous procurer le moindre plaisir, ou pour éloigner la moindre douleur. Que les aliments nourrissent, que le sommeil restaure les forces, et que le feu nous brûle; que de semer au temps des semailles est le moyen de recueillir au temps de la moisson, et en général que tels et tels moyens mènent à telles et telles fins, nous ne découvrons rien de tout cela à l'aide d'une connexion nécessaire de nos idées, mais uniquement par l'observation des lois établies de la nature. Au défaut de ces lois nous serions entièrement jetés dans l'incertitude et la confusion, et l'homme fait ne serait pas plus en état de se diriger que l'enfant qui vient de naître.
32. — Et cependant cette œuvre uniforme et si bien liée, dans laquelle se déploient avec tant d'évidence la bonté et la sagesse de l'Esprit qui gouverne et de qui la Volonté constitue les lois de la nature, il s'en faut tellement qu'elle dirige vers Lui nos pensées, que, tout au contraire, elle semble les faire dévier vers les causes secondes. Car, quand nous percevons certaines idées sensibles, constamment suivies par d'autres idées, et que nous reconnaissons que l'opération n'est point de nous, nous nous hâtons d'attribuer le pouvoir et l'action aux idées elles-mêmes, et de les prendre pour causes les unes des autres; celui de toutes les choses est la plus absurde et la plus inintelligible. Si, par exemple, nous avons observé que, percevant à l'aide de la vue une certaine figure lumineuse ronde, nous percevons en même temps, à l'aide du toucher, l'idée ou sensation appelée chaleur, nous concluons de là que le soleil est la cause de la chaleur. Et de même en observant que le mouvement et le choc des corps sont accompagnés d'un son, nous sommes portés à penser que ce dernier est l'effet des autres qui le précédent.
33. — Les idées imprimées sur les sens par l'Auteur de la nature s'appellent des choses réelles; et celles qui sont excitées dans l'imagination, et qui sont moins régulières, moins vives, moins constantes, s'appellent plus proprement idées ou images des choses dont elles sont des représentations et des copies. Mais nos sensations, pour vives et distinctes qu'elles soient, ne laissent pas d'être des idées, c'est-à-dire d'exister dans l'esprit et d'y être perçues aussi véritablement que les idées que nous formons nous-mêmes. On accorde que les idées des sens ont plus de réalité, c'est-à-dire qu'elles sont plus fortes, plus cohérentes et ordonnées que les créatures de l'esprit (mind) ; mais ce n'est point une raison pour qu'elles existent hors de l'esprit (mind). Elles sont aussi moins dépendantes de l'esprit (spirit) ou substance pensante qui les perçoit, attendu qu'elles sont excitées par la volonté d'un autre et plus puissant esprit {spirit). Cependant ce sont toujours des idées, et certainement une idée, qu'elle soit faible ou qu'elle soit forte, ne peut exister autrement qu'en un esprit {mind) qui la perçoit...."
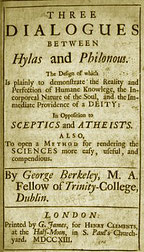
"Three Dialogues between Hylas and Philonous in opposition to Sceptics and Atheists" (Trois dialogues entre Hylas et Philonous, contre les sceptiques et les athées, 1713)
Berkeley expose ici l'ensemble de sa doctrine et répondre aux difficultés que l'on avait trouvées dans son Traité des principes de la connaissance humaine. Peu d'œuvres ont une plus grande
efficacité didactique, tant Berkeley est préoccupé des destinées de la religion et de la morale dont il voit la restauration liée au spiritualisme. Hylas est matérialiste ; Philonous est spiritualiste, et ce dernier représente l'auteur lui-même.
Contre l'affirmation spiritualiste de Philonous, Hylas oppose une série d`objections qui, toutes, partent du principe que les objets formant la réalité du monde existent en soi. Cependant
Hylas doit rapidement concéder que le monde est "sensible", précisément dans la perception, et que la chaleur, la saveur, l'odeur, le son, la couleur, parce qu'étant des sensations, ne peuvent être unis à la substance matérielle, laquelle est par définition "insensible" (ceci est la thèse de Locke). S`il est bien évident que ces "qualités secondaires" n`existent pas en dehors de l'intelligence, on pourrait avec raison défendre - pense Hylas - l'indépendance des "qualités primaires" (extension, forme, solidité, poids, mouvement, repos), en tant que propriétés réelles et objectives des choses. Mais comment cela est-il possible, puisque ces "qualités premières" ne peuvent même pas dans la réflexion abstraite, être séparées des "qualités secondaires"?
Hylas va donc accuser Philonous de «transformer toute chose en idées». «Vous vous méprenez, répond celui-ci, je ne suis pas en train de transformer les choses en idées, mais plutôt les idées en choses; puisque ces objets immédiats de la perception, qui ne sont, d'après vous, que les apparences des choses, je les considère, moi, comme étant les choses réelles elles-mêmes» (Dial., III). En appelant les choses des idées, Berkeley ne porte nulle atteinte à leur réalité; et s'il préfère la seconde dénomination à la première, c'est parce que «le terme de chose, par opposition à celui d'idée, est généralement pris pour désigner ce qui existerait hors de l'esprit». L'immatérialisme ne fait évanouir rien de réel, «Je ne supprime pas les substances... Je rejette seulement le sens philosophique (qui n'est en réalité qu'un non-sens) du mot substance». Mais ce n'est pas tout : non seulement l'existence des corps n'est en rien compromise, mais leur nature nous reste, ou plutôt nous devient connaissable. Qu'en saurions-nous, de cette nature, si les choses réelles étaient hors de nous, inattingibles, si notre esprit n'en possédait que des copies, dont la ressemblance restât à jamais invérifiable? Et voilà par où le «matérialisme» se révèle profondément sceptique : mettre hors de l'esprit, mettre derrière les qualités sensibles une matière impossible à concevoir, dont nul ne peut dire ce qu'elle cache, n'est-ce pas enlever tout fondement à la connaissance ?
De l'immatérialisme, au contraire, découlent immédiatement, suivant les tenues mêmes du titre complet des Dialogues, la réalité et la perfection de la connaissance humaine. Les choses sont ce que nous percevons qu'elles sont : non plus les apparences illusoires d'on ne sait quelle «substance» inaccessible à la pensée. Nos sens, quoi qu'on dise, ne nous trompent pas. «Je suis pour la réalité plus que tous les autres philosophes. Ils ont mille doutes et ne sont certains que d'une chose, c'est que nous pouvons être trompés. J'affirme directement le contraire».
En particulier, les choses, tout en n'étant que des idées, sont là où nous percevons qu'elles sont : « Le cheval est dans l'écurie, les livres dans le cabinet d'étude, comme auparavant». Pourquoi en serait-il autrement? L'étendue n'est qu'une idée : cela ne l'empêche pas d'être réelle. Les choses n'existent que dans l'esprit : cela ne les empêche pas d'être à leur place, c'est-à-dire précisément à celle où l'esprit les perçoit...
LES QUALITÉS DITES PREMIÈRES N'EXISTENT PAS PLUS QUE LES AUTRES EN DEHORS DE L'ESPRIT
Hylas. — Je reconnais franchement, Philonous, qu'il ne sert à rien de résister plus longtemps. Couleurs, sons, saveurs, en un mot tout ce qu'on a appelé les qualités secondes, n'ont certainement aucune existence en dehors de l'esprit. Mais, par cet aveu, il ne faut pas supposer que j'abandonne quoi que ce soit de la réalité de la matière et des objets extérieurs; car je vois bien des philosophes qui ne maintiennent que cela, et qui cependant sont aussi éloignés qu'on peut l'être de nier la matière. Pour mieux comprendre ce que je dis, il vous faut savoir que les qualités sensibles ont été divisées par les philosophes en premières et secondes. Les unes sont : l'étendue, la figure, la solidité, le poids, le mouvement et le repos. Et pour celles-là, ils soutiennent qu'elles existent réellement dans les corps. Les autres sont celles que nous avons énumérées plus haut, en un mot, toutes celles des qualités sensibles qui ne sont pas comprises dans les qualités premières; et ces philosophes affirment qu'elles ne sont que des sensations ou des idées, n'existant nulle part ailleurs que dans l'esprit. Mais vous saviez déjà tout ceci, je n'en doute pas. Pour ma part, depuis longtemps déjà j'étais informé qu'une telle opinion avait cours parmi les philosophes, mais je n'avais jamais été tout à fait convaincu de sa vérité, jusqu'à maintenant.
Philonous. — Vous êtes donc encore d'avis que l'étendue et les figures diverses sont inhérentes à des substances extérieures privées de pensée?
Hylas. — Sans doute.
Philonous. — Mais si les mêmes arguments que l'on a mis en avant contre les qualités secondes valaient encore contre celles-ci?
Hylas. — Eh bien, je serais alors réduit à croire qu'elles aussi n'existent que dans l'esprit.
Philonous. — D'après votre opinion, c'est précisément la figure et l'étendue que vous percevez par les sens qui existent dans l'objet extérieur ou substance matérielle?
Hylas. — Précisément les mêmes.
Philonous. — Tous les autres animaux ont-ils d'aussi bonnes raisons pour penser de même de la figure et de l'étendue qu'ils voient et qu'ils touchent?
Hylas. — Sans aucun doute, pour peu qu'ils pensent.
Philonous. — Dites-moi, Hylas : croyez-vous que les sens soient donnés à tous les animaux pour leur préservation et leur bien-être dans la vie? ou que ce n'est qu'aux hommes qu'ils sont donnés pour cette fin?
Hylas. — Je ne mets pas en question qu'ils ne soient destinés au même usage chez tous les autres animaux.
Philonous. — S'il en est ainsi, n'est-il pas nécessaire que leurs sens leur permettent de percevoir leurs propres membres et les corps qui pourraient leur être nuisibles?
Hylas. — Certainement.
Philonous. — Il faut alors supposer qu'une mite voit ses propres pattes et les choses de grandeur égale ou même moindre, comme des corps de dimension assez considérable ; bien qu'au même moment ces mêmes choses vous apparaissent, à vous, comme à pehie discernables, ou, au plus, connue autant de points visibles.
Hylas. — Je ne puis nier cela.
Philonous. — Et à des êtres plus petits que la mite, ces corps sembleront encore plus grands ?
Hylas. — Certes.
Philonous. — Ainsi ce que, vous, vous distinguez à peine, apparaîtra à un autre animal extrêmement petit comme quelque montagne énorme?
Hylas. — Tout cela, je l'accorde.
Philonous. — Une seule et même chose peut-elle être au même moment et en elle-même de dimensions différentes?
Hylas. — Ce serait absurde à penser.
Philonous. — Mais, de ce que vous aviez posé en principe, il suit que l'étendue perçue par vous et celle que perçoit la mite elle-même, et aussi celles que perçoivent des animaux plus petits encore, sont chacune à la fois l'étendue véritable des pattes de la mite; ce qui revient à dire qu'en vertu de vos propres principes, vous êtes tombé dans une absurdité.
Hylas. — Oui, ce point semble offrir quelque difficulté.
Philonous. — Autre chose : n'avez-vous pas admis qu'aucune propriété réelle, inhérente à un objet, ne peut être modifiée sans quelque modification dans la chose même ?
Hylas. — Je l'ai admis.
Philonous. — Mais, selon qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne d'un objet, son étendue visible varie, jusqu'à être, à une certaine distance, dix ou cent fois plus grande qu'à une autre. Ne suit-il pas de là qu'elle aussi n'est pas réellement inhérente à l'objet?
Hylas. — J'avoue que je ne sais plus que penser.
Philonous. — Votre jugement sera bientôt fixé si vous osez penser aussi librement de cette qualité que vous avez fait des autres. N'avez-vous pas admis comme un argument sérieux, que ni la chaleur ni le froid n'existaient dans l'eau, parce qu'elle semblait chaude à une main et froide à l'autre?
Hylas. — En effet.
Philonous. — Et n'est-ce pas raisonner tout de même que de conclure qu'il n'existe dans un objet ni étendue ni figure, s'il semble à un œil petit, uni et rond, taudis qu'au même moment il apparait à l'autre connue grand, inégal et anguleux?
Hylas. — Exactement de même. Mais ce cas se produit-il jamais?
Philonous. . — Vous pouvez, quand vous voudrez, faire l'expérience, en regardant avec un des yeux nu, et avec l'autre à travers un microscope.
Hylas. — Je ne sais comment défendre ce point, et pourtant j'ai bien de la répugnance à abandonner l'étendue : je vois de si étranges conséquences découler d'une telle concession ! .
Philonous. — Etranges, dites- vous? Mais, après les concessions déjà faites, j'espère que l'étrangeté d'une chose n'est pas pour vous la faire rejeter. — [Et, d'autre part, ne semblerait-il pas très étrange aussi qu'un raisonnement général qui s'applique à toutes les autres qualités sensibles ne s'appliquât pas aussi à l'étendue? S'il est accordé qu'aucune idée, ni rien d'analogue à une idée, ne peut exister dans une substance privée de perception, ne s'ensuit-il pas forcément que ni la figure, ni aucun mode de l'étendue que nous puissions ou percevoir ou imaginer ou dont nous soyons à même d'avoir quelque idée, ne peut être réellement inhérent à la matière? — pour ne pas parler de la difficulté particulière qu'il y aurait à concevoir qu'une substance matérielle, distincte de l'étendue et antérieure à elle, fût le substratum de l'étendue. Prenez telle qualité sensible que vous voudrez, figure, ou son, ou couleur, il semble également impossible qu'elle puisse subsister en ce qui ne la perçoit pas.]
Hylas. — J'abandonne ce point pour le moment, tout en me réservant le droit d'y revenir, au cas où je découvrirais plus tard quelque faux pas dans ma marche jusqu'ici.
Philonous. — C'est un droit qui ne vous peut être dénié. Puisque nous en avons fini avec les figures et l'étendue, nous arrivons au mouvement. Un mouvement réel dans un objet extérieur peut-il être au même moment et tout ensemble très rapide et très lent?
Hylas. — Il ne peut l'être.
Philonous. — La rapidité du mouvement d'un corps n'est-elle pas en proportion directe du temps qu'il met à parcourir un espace donné? Ainsi un corps qui parcourt un mille en une heure se meut trois fois plus vite que s'il parcourait un mille en trois heures.
Hylas. — Parfaitement.
Philonous. — Et le temps n'est-il pas mesuré par la succession des idées dans nos esprits?
Hylas. — C'est vrai.
Philonous. — Et n'est-il pas possible que les idées se succèdent une ou deux fois plus vite dans votre esprit qu'elles ne font, dans le mien ou dans celui d'un être intelligent d'une autre espèce que nous?
Hylas. — Je le reconnais.
Philonous. — Par conséquent, pour une autre personne, le même corps peut sembler accomplir son mouvement dans un certain espace en moitié moins de temps qu'il ne vous paraît le faire à vous. Et le même raisonnement s'appliquera à toute autre relation : ce qui revient à dire, en se conformant à vos principes (puisque les mouvements perçus existent tous réellement dans l'objet) , qu'il est possible qu'un seul et même corps se meuve réellement dans le même chemin tout à la fois très vite et très lentement. Comment cela se concilie-t-il, soit avec le sens commun, soit avec ce que vous venez de reconnaître ?
Hylas. — Je ne sais que dire à cela.
Philonous. — Passons à la solidité : de deux choses l'une, ou, par ce mot, vous n'entendez pas une qualité sensible, et alors elle ne rentre pas dans le sujet de nos recherches; ou, si vous la regardez comme telle, elle doit se ramener à la dureté ou à la résistance. Or, l'une comme l'autre de ces deux qualités est nettement relative à nos sens; car il est évident que ce qui paraît dur à un animal peut sembler mou à un autre, s'il a plus de force et des membres plus vigoureux. Il n'est pas moins clair que la résistance que nous sentons n'est pas dans l'objet.
Hylas. — Je reconnais que la sensation même de résistance, qui est tout ce qu'on perçoit immédiatement, n est pas dans le corps, mais ce qui y est, c'est la cause de cette sensation.
Philonous. — Oui, mais les causes de nos sensations ne sont pas des choses immédiatement perçues, et par suite ne sont pas sensibles. Ce point, je pense, a été déjà suffisamment établi.
Hylas. — Je le reconnais; mais vous me pardonnerez si j'ai l'air un peu embarrassé; je ne sais comment me défaire de mes vieilles opinions.
Philonous. — Pour vous tirer de peine, considérez seulement que si l'on a une fois accordé que l'étendue n'a aucune existence en dehors de l'esprit, il faut nécessairement admettre la même chose pour le mouvement, la solidité et le poids, puisque toutes ces qualités supposent évidemment l'étendue. Il est donc superflu de discuter en particulier pour chacune d'elles. En refusant à l'étendue toute existence réelle, vous la leur avez refusée à toutes du même coup.
Hylas. — Je m'étonne, Philonous, que, si vous dites vrai, les philosophes qui refusent aux qualités secondes toute existence réelle, l'attribuent pourtant aux qualités premières. S'il n'y a entre elles aucune différence, comment peut-on expliquer cela ?
Philonous. — Ce n'est pas mon affaire d'expliquer toutes les opinions des philosophes. Mais, entre autres raisons qui peuvent être assignées à ce fait, il semble que l'une consiste probablement en ce que le plaisir et la douleur sont plutôt associés aux premières qu'aux secondes. La chaleur et le froid, les saveurs et les odeurs, ont quelque chose de plus vif dans l'agrément ou la peine qu'ils nous procurent, que les idées d'étendue, de figure et de mouvement dans la manière dont elles nous affectent. Et, comme il est trop visiblement absurde de prétendre que la douleur ou le plaisir puissent exister dans une substance dénuée de perception, les hommes ont cessé de croire à l'existence externe des qualités secondes plus facilement qu'à celle des premières. Vous serez convaincu qu'il y a vraiment quelque chose de cela, si vous vous rappelez la différence que vous faisiez entre un degré plus intense et un degré moindre de chaleur, en attribuant à l'un une existence réelle que vous refusiez à l'autre. Mais, au fond, cette distinction n'a pas de raison d'être; car, à coup sûr, une sensation indifférente est aussi véritablement une sensation que telle autre, qui nous procure plus de plaisir ou de peine; et par conséquent l'on ne peut pas supposer que les unes plus que les autres existent en un sujet dénué de pensée.
Hylas.— Il me revient justement à l'esprit, Philonous, que j'ai entendu parler quelque part d'une distinction entre l'étendu absolue et l'étendue sensible . Aussi, bien qu'il ait été reconnu que le grand et le petit consistent purement et simplement dans le rapport que d'autres êtres étendus soutiennent avec les parties de notre propre corps, et ne peuvent par suite être réellement inhérents aux substances elles-mêmes, — rien ne nous oblige pour cela à soutenir la même théorie en ce qui regarde l'étendue absolue, qui est quelque chose d'abstrait des idées de grand et de petit, de telle ou telle grandeur ou figure particulière. De même aussi pour le mouvement; la rapidité ou la lenteur sont tout à fait relatives à la succession des idées dans notre propre esprit : mais il ne s'ensuit pas, parce que ces modifications du mouvement n'existent pas en dehors de l'esprit, que le mouvement absolu, qui est une abstraction de ces modes particuliers, ne puisse pas exister ainsi.
Philonous. — Qu'est-ce qui distingue, je vous prie, un certain mouvement d'un autre ou une certaine portion de l'étendue d'une autre? N'est-ce pas quelque chose de sensible, comme un certain degré de rapidité ou de lenteur, qui est particulier à chaque mouvement, une certaine grandeur ou figure, particulière à chaque étendue?
Hylas. — Je pense que oui.
Philonous. — Mais ces qualités, dépouillées de toute propriété sensible, n'ont plus aucune différence spécifique ou numérique, comme dit l'Ecole.
Hylas. — En effet.
PhiIonous. — C'est-à-dire qu'elles sont l'étendue en général et le mouvement en général.
Hylas. — Soit.
Philonous. — Mais c'est une maxime universellement admise que tout ce qui existe est particulier. Comment donc le mouvement en général ou l'étendue en général peuvent- ils exister en une substance corporelle ?
Hylas. — Je demande du temps pour résoudre cette difficulté.
PhiIonous. — Je crois qu'elle peut l'être très vite. Car vous pouvez me dire sans doute si vous êtes en état de vous former telle ou telle idée. Or, je veux bien réduire à ceci notre discussion : si vous pouvez vous former par la pensée, et de façon distincte, une idée abstraite du mouvement ou de l'étendue, dépouillés de tous leurs modes sensibles, tels que rapidité ou lenteur, grandeur ou petitesse, forme ronde ou carrée, et autres semblables que l'on a reconnus n'exister que dans l'esprit, je vous céderai sur le point que vous contestez, Mais, de votre côté, si vous ne pouvez y réussir, il sera déraisonnable de persister plus longtemps à maintenir une chose dont vous n'avez aucune notion.
Hylas. — J 'avoue franchement que je ne puis me former cette idée.
Philonous. — Pouvez- vous même séparer les idées d'étendue et de mouvement des idées de toutes ces autres qualités que ceux qui les distinguent nomment secondes?
Hylas. — Quoi ! n'est-il pas très facile de considérer l'étendue et le mouvement en soi, abstraction faite de toutes les autres qualités sensibles? Comment font donc, je vous prie, les mathématiciens, qui en traitent?
Philonous. — Je reconnais, Hylas, qu'il n'y a rien de difficile à former des propositions et des raisonnements généraux sur ces qualités sans en mentionner aucune autre, et, en ce sens, de les considérer ou d'en traiter abstraitement. Mais suit-il de ce que je peux prononcer le mot mouvement en lui-même, que je puisse m'en former dans mon esprit une idée qui soit exclusive de l'idée de corps? Ou, parce qu'on peut établir des théorèmes sur l'étendue et la figure, sans aucune mention du grand ou du petit ou de tout autre mode ou qualité sensible, en résulte-t-il donc qu'une telle idée abstraite d'étendue, sans aucune dimension ou figure particulière, sans aucune qualité sensible, puisse être distinctement conçue et saisie par l'esprit? Les mathématiciens traitent de la quantité sans considérer quelles autres qualités sensibles l'accompagnent, parce que cela est tout à fait indifférent à leurs démonstrations. Mais, quand ils ne font plus attention aux mots et contemplent les idées en elles-mêmes, je suis sûr que vous vous convaincrez qu'ils n'ont pas d'idée pure et abstraite de l'étendue.
Hylas. — Mais que faites- vous du pur intellect? N 'est-ce pas le propre de cette faculté que de former des idées abstraites?
Philonous. — Puisque je ne puis pas former d'idées abstraites du tout, il est clair que je ne puis pas en former par le secours du pur intellect, quelle que soit la faculté que vous entendiez par ces mots. De plus, sans rechercher la nature du pur intellect et de ses objets spirituels, vertu, raison, divinité et autres semblables, ce qui paraît bien manifeste, c'est que les choses sensibles ne peuvent qu'être perçues par les sens ou représentées par l'imagination. La figure et l'étendue, qui sont originellement perçues par les sens, n'appartiennent donc pas au pur intellect; mais, pour vous satisfaire davantage, voyez si vous pouvez vous former l'idée de quelque figure, abstraction faite de toutes ses particularités de dimension, ou même de toutes les autres qualités sensibles.
Hylas. — Laissez-moi réfléchir un peu. — Je ne crois pas le pouvoir.
Philonous. — Et pouvez-vous penser que ce qui implique contradiction dans sa conception même puisse exister réellement dans la nature?
Hylas. — En aucune façon.
Philonous. — Puis donc qu'il est impossible à l'esprit de disjoindre même les idées d'étendue et de mouvement de toutes les autres qualités sensibles, ne s'ensuit-il pas que, là où l'une de ces idées existe, l'autre y existe nécessairement aussi?
Hylas. — C'est ce qu'il me semble.
Philonous. — Par conséquent, ces mêmes arguments que vous admettiez connue concluants contre les qualités secondes, le sont aussi, sans qu'on les force nullement, contre les qualités premières. De plus, si vous voulez vous en remettre à vos sens, n'est-il pas clair que toutes les qualités sensibles coexistent, ou qu'elles leur apparaissent comme occupant le même lieu? Les sens nous représentent- ils jamais un mouvement ou une figure comme dépouillés de toutes les autres qualités visibles et tangibles?
Hylas. — Vous n'avez pas besoin d'insister davantage. Je suis disposé à avouer, s'il n'y a pas quelque erreur ou quelque faute cachée dans nos démarches jusqu'ici, qu'il faut refuser également à toutes les qualités sensibles une existence en dehors de l'esprit.
{Dialogues d'Hylas et de Philonous. premier dialogue : Œuvres choisies de Berkeley, traduites par Beaulavon et Parodi. Paris. Alcan, 1895.)

Hylas est finalement disposé à accepter la thèse de Philonous, mais prévoit que pratiquement elle déconcertera les êtres humains, qui sont bien loin de ramener l' "existence" d'un objet au fait de l' "existence perçue" par une intelligence éternelle. En réponse, Philonous triomphera en énumérant toutes les difficultés qui vont à l'encontre du matérialisme.
«Mes efforts tendent seulement, dit Berkeley à la fin des Dialogues, à unifier et à mettre dans un meilleur jour cette vérité qui a été jusqu'ici partagée entre la foule et les philosophes, celle-là étant d'avis que les choses qu'on perçoit immédiatement sont les choses réelles, et ceux-ci, que les choses immédiatement perçues sont des idées qui n'existent que dans l'intelligence. Ce sont ces deux propositions qui, réunies, constituent en fait la substance de tout ce que j'avance ici (Dial, III). »
Ainsi la critique de la matière aboutit à la ruine du scepticisme : la philosophie la plus audacieuse retrouve et consolide les croyances communes. Mais ce n'est pas tout, l'immatérialisme ne condamne pas seulement le scepticisme, mais encore l'athéisme et l'irréligion. La "nature incorporelle de l'âme" et l' "immédiate Providence d'une Divinité"...
PREUVE IMMATÉRIALISTE DE L 'EXISTENCE DE DIEU
Philonous. — Eh bien donc, êtes- vous à la fin convaincu qu'aucune des choses sensible n'a d'existence réelle et que vous êtes en vérité un franc sceptique?
Hylas. — C'est trop évident pour qu'on le nie.
Philonous. — Regardez ! Les champs ne sont-ils pas couverts d'une délicieuse verdure? N'y a-t-il pas dans les forêts et dans les bosquets, dans les ruisseaux et dans les sources limpides, quelque chose qui charme, qui enchante, qui transporte l'âme? Et à la vue de l'immense et profond océan, ou de quelque énorme montagne dont la cime se perd dans les nuages, ou de quelque vieille et sombre forêt, notre esprit ne se remplit-il pas d'une douce horreur? Même dans les rochers et les déserts, n'y a-t-il pas comme une sauvagerie qui plaît? Quel plaisir sincère on éprouve à contempler les beautés naturelles de la terre ! Pour prolonger et renouveler notre amour pour elles, le voile de la nuit ne nous cache-t-il pas et ne nous découvre-t-il pas tour à tour la face de la terre; et ne change-t-elle pas de parure avec les saisons ? Avec quelle harmonie sont disposés les éléments ! Combien sont variées et combien utiles les moindres productions de la nature ! Quelle délicatesse, quelle beauté, quelle prévoyance dans le corps de l'animal et du végétal ! Avec quel art exquis toutes choses s'adaptent aussi bien à leurs fins particulières qu'à la constitution des parties opposées de l'univers !
Et tandis qu'elles s'aident ainsi mutuellement et se soutiennent, ne rehaussent-elles pas encore l'une l'autre leur beauté, et n'augmentent-elles pas l'une par l'autre leur éclat? Élevez maintenant vos pensées de cette boule, qui est la terre, à ces lampes glorieuses qui ornent la haute voûte du ciel.
Le mouvement et la position des planètes, ne sont-ce pas des choses admirables d'ordre et d'harmonie? Ces globes, nommés à tort errants, les a-t-on jamais vus courir au hasard, dans leurs voyages répétés à travers le vide où nul sentier n'est tracé? Ne mesurent-ils pas autour du soleil des espaces proportionnés au temps? Si fixes et immuables sont les lois par lesquelles l'invisible Auteur de la nature anime l'univers ? Que brillante et radieuse est la lumière des étoiles fixes ! Que magnifique et riche est cette profusion négligente qui semble les avoir semées tout au travers de l'immense voûte azurée ! Et pourtant, si vous prenez le télescope, toute une nouvelle armée d'étoiles, qui échappait à l'œil nu, vient frapper votre regard. D'ici elles semblent serrées et petites, mais à les voir de plus près, ce sont des orbes immense des lumière à des distances diverses, plongés au loin dans l'abîme de l'espace.
Maintenant, vous devez appeler l'imagination à votre aide. Les sens faibles et bornés ne peuvent découvrir ces innombrables mondes qui gravitent autour d'autres feux; et, dans ces mondes, l'énergie d'une intelligence toute parfaite se déploie en des formes infinies. Mais ni les sens ni l'imagination n'ont assez de force pour embrasser l'étendue sans bornes, avec toute sa parure scintillante. L'esprit a beau, en se travaillant, déployer et tendre toutes ses forces jusqu'à leur extrême portée, toujours hors de ses prises il reste comme un incommensurable excédent. Et pourtant tous ces vastes corps qui composent cette formidable machine, si distants et si lointains qu'ils soient, sont enchaînés par quelque secret mécanisme, par quelque art et quelque vertu divine, dans une mutuelle dépendance, et s'accordent dans une correspondance mutuelle les uns avec les autres, et même avec cette terre, qui s'était presque évanouie de ma pensée, perdue dans cette foule de mondes.
Le système entier de l'univers n'est-il pas immense, admirable, glorieux, au delà de toute expression et au delà de toute pensée? Quel traitement ne méritent donc pas ces philosophes, qui voudraient priver ces scènes si nobles et si délicieuses de toute réalité? Comment se peut-il que l'on accueille des principes qui nous amènent à regarder toute cette beauté visible de la création comme une splendeur fausse et imaginaire? Pour tout dire, pouvez- vous espérer que ce scepticisme que vous professez, n'apparaisse pas comme l'extravagance la plus absurde à tous les hommes de bons sens?
Hylas. — Les autres peuvent penser là-dessus comme il leur plaira; mais pour vous, vous n'avez rien à me reprocher. Ce qui me console, c'est que vous êtes sceptique tout autant que moi.
Philonous. — Ici, Hylas, je dois vous demander la permission de me séparer de vous.
Hylas. — Quoi ! Avez-vous ainsi, d'un bout à l'autre, accordé les prémisses pour nier maintenant la conclusion, et me laisser soutenir tout seul ces paradoxes où vous m'avez engagé? Cela sûrement n'est pas bien.
Philonous. — Je nie que je sois d'accord avec vous sur les opinions qui mènent au scepticisme. Vous disiez en effet que la réalité des choses sensibles consistait dans une existence absolue, extérieure à l'intelligence des esprits, ou distincte de la perception qu'on en a.
Et, en approfondissant cette notion de réalité, vous êtes obligé de dénier aux choses sensibles toute existence réelle; c'est-à-dire, d'après votre propre définition, que vous vous déclarez vous-même sceptique. Mais moi, je ne dis ni ne pense que la réalité des choses sensibles doive être définie de cette façon.
Pour moi il est évident, par suite de raisons que vous avez admises, que les choses sensibles ne peuvent exister autre part que dans une intelligence ou un esprit. D'où je conclus, non pas qu'elles n'ont aucune existence réelle, mais que, — puisqu'elles ne dépendent pas de ma pensée , et qu'elles ont une existence distincte de la percept ion que j'en ai, — il doit y avoir quelque autre intelligence en qui elles existent. Aussi sûrement donc que l'univers sensible existe réellement, aussi sûrement il y a un Esprit infini et omniprésent qui le contient et qui le soutient.
Hylas. — Quoi ! mais vous ne dites pas autre chose que ce que je prétends avec tous les Chrétiens, bien plus, avec tous ceux qui croient qu'il y a un Dieu, et que c'est lui qui connaît et qui contient toutes choses.
Philonous. — Oui, mais c'est ici que réside la différence. D'ordinaire on croit que toutes les choses sont connues ou perçues par Dieu, parce qu'on croit à l'existence d'un Dieu; tandis que moi, tout au contraire je conclus immédiatement et nécessairement l'existence d'un Dieu de ce que toutes les choses sensibles doivent être perçues par Lui.
Hylas. — Mais, du moment que nous croyons a la même chose, qu'importe la manière dont nous arrivons à cette croyance ?
Philonous. — Mais nous ne nous accordons pas non plus dans une même opinion. Car, bien que les philosophes reconnaissent que tous les êtres corporels sont perçus par Dieu, ils leur attribuent pourtant une existence permanente absolue et distincte de la perception qu'en a une intelligence quelconque, ce que je ne fais pas.
De plus, n'est-il pas différent de dire : «Il y a un Dieu, donc Il perçoit toutes choses», ou de dire : «Les choses sensible s existent réellement; et, si elles existent réellement, elles sont nécessairement perçues par une intelligence infinie; donc il existe une intelligence infinie, ou Dieu»? Ce qui vous fournit une démonstration immédiate et directe, tirée du plus évident des principes, de l'existence d'un Dieu. Théologiens et philosophes ont établi au-dessus de toute discussion, d'après la beauté et l'utilité des diverses parties de la création, qu'elle était l'œuvre de Dieu.
Mais, sans recourir à l'astronomie et à la philosophie naturelle, sans aucune contemplation de l'arrangement, de l'ordre et de la convenance des choses, montrer qu'une intelligence infinie doit être nécessairement inférée de la simple existence du monde sensible, c'est un avantage qui appartient seulement à ceux qui ont fait cette simple réflexion : que le monde sensible est ce que nous percevons par nos différents sens; et que rien n'est perçu par les sens que les idées : et qu'aucune idée ou archétype d'une idée ne peut exister autrement que dans une intelligence. Vous pouvez dès lors, sans fouiller laborieusement les sciences, sans aucun artifice de raisonnement ou aucune lenteur rebutante de discussion, arrêter et combattre le plus vigoureux avocat de l'athéisme; tous ces misérables recours, que l'on trouvait dans une éternelle succession de causes et d'effets dépourvus de pensée, ou bien dans un concours fortuit d'atomes, toutes ces monstrueuses imaginations de Vanini, de Hobbes et de Spinoza, en un mot, le système entier de l'athéisme, n'est-il pas renversé de fond en comble, par cette réflexion unique, qu'il y a une contradiction interne à supposer que la totalité ou une partie quelconque, même la plus grossière et la plus informe, de l'univers visible, puisse exister en dehors d'une intelligence?
Qu'un de ces fauteurs d'impiété considère en lui-même ses propres pensées, et qu'il fasse effort pour concevoir seulement comment un rocher, un désert, un chaos, ou un confus assemblage d'atomes, comment une chose quelconque, sensible ou imaginable, peut exister indépendamment d'une intelligence, et il ne lui en faudra pas davantage pour se convaincre de sa folie. Quoi de plus avantageux que d'amener la discussion sur un tel terrain, et de s'en remettre à son adversaire lui-même, pour qu'il voie s'il peut concevoir, même par la pensée, ce qu'il pose comme vrai en fait, et s'il peut de bonne foi le faire passer d'une existence notionnelle à une existence réelle?"

Dieu - Les choses corporelles ne sont que des idées, n'existent qu'en des esprits. Mais de quels esprits s'agit-il? Berkeley n'a jamais songé à identifier les choses réelles avec la perception qu'en a tel ou tel sujet individuel : il est manifeste que les choses sensibles «ne dépendent pas de ma pensée, et qu'elles ont une existence distincte de la perception que j'en ai». D'une part, il ne dépend pas de nous d'avoir telle perception plutôt que telle autre; d'autre part, il serait absurde de supposer que les choses cessent d'exister quand nous ne les percevons pas.
Mais alors, puisque leur existence ne consiste que dans le fait d'être perçues, «il doit y avoir quelque autre intelligence en qui elles existent. Aussi sûrement donc que l'univers sensible existe réellement, aussi sûrement il y a un Esprit infini et omniprésent qui le contient et qui le soutient.»
Preuve aussi simple qu'originale : «d'ordinaire on croit que toutes les choses sont connues ou perçues par Dieu, parce qu'on croit à l'existence d'un Dieu ; tandis que moi, tout au contraire, je conclus immédiatement et nécessairement l'existence d'un Dieu de ce que toutes les choses sensibles doivent être perçues par lui (Dialogues, II). «L'existence de Dieu, en d'autres termes, est l'aboutissement inévitable de l'idéalisme, si l'on ne veut pas voir s'abîmer le monde matériel; sous peine de n'être qu'un pur nihilisme ou un solipsisme absurde (hypothèses auxquelles Berkeley ne s'arrête même pas), l'immatérialisme mène droit à l'affirmation théiste. Ma perception, pourrait-on dire encore, ne se suffit pas à elle-même : elle implique Dieu; sans Dieu toute sa réalité s'effondrerait. L'univers a besoin de Dieu pour exister , parce qu'il ne peut exister que dans une pensée, et que ma pensée individu elle, ni celle d'aucun esprit fini, ne saurait être évidemment celle dont il s'agit. Cette conception n'est pas sans analogie avec la fameuse théorie de Malebranche, d'après laquelle «nous voyons toutes choses en Dieu» : Berkeley fait lui-même la comparaison en insistant sur les différences essentielles qui le séparent du philosophe français. «Il bâtit sur les idées les plus abstraites et les plus générales, ce que je désavoue absolument. Il affirme un univers extérieur et absolu, ce que je nie. Il soutient que nous sommes trompés par nos sens et que nous ne connaissons pas la nature réelle ni les formes et les figures véritables des êtres étendus : toutes choses dont je soutiens exactement le contraire» (Dialogues).
C'est ainsi pour Berkeley un formidable coup porté au «matérialisme» qui contient en germe, non seulement, la négation sceptique de l'existence des corps et de la réalité de la connaissance, mais encore l'athéisme et l'irréligion. La Matière du réalisme, ce bloc impénétrable à la pensée, recélait d'effrayantes possibilités : si elle disparaît, tout le système de l'athéisme, «tous ces misérables recours que l'on trouvait dans une éternelle succession de causes et d'effets dépourvus de pensée, ou bien dans un concours fortuit d'atomes, toutes ces monstrueuses imaginations de Vanini, de Hobbes et de Spinoza», disparaissent du même coup.
Et loin que le système de Berkeley soit en contradiction avec la Bible, c'est au contraire sur l'hypothèse matérialiste que reposent toutes les objections qu'on a faites au dogme de la création : car il est si difficile de concevoir la Matière comme tirée du néant, que beaucoup de philosophes anciens et modernes l'ont regardée comme coéternelle à Dieu...
Mais comment l'Esprit infini produit-il des idées dans les esprits finis ? Comment Dieu nous fait-il avoir perception? En d'autres termes, comment s'établit la communication entre l'intelligence suprême et toutes les autres? Berkeley n'approfondit pas cette redoutable question. Il cherchera plus tard dans la "Siris", à expliquer à l'aide d'un intermédiaire l'action de Dieu sur le monde; mais, outre que cette conception s'accorde mal avec la philosophie du "Traité" et des "Dialogues", qui écarte expressément l'idée d'un tel intermédiaire, le problème auquel elle répond n'est pas celui que nous venons de poser.
Quoi que il en soit relativement au mode de cette communication entre l'Esprit divin et les esprits finis (et tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il s'agit d'une communication immédiate et sui generis), le Dieu de Berkeley grâce à ce pouvoir producteur d'idées, résout victorieusement bien des difficultés. Non seulement il est l'origine et le fondement de toute perception, mais encore c'est par lui que s'explique, sous quelque aspect qu'on le considère, l'ordre des perceptions, qui n'est autre que l'ordre même des choses.
"Hylas. — Aucune idée ne peut donc être analogue à la nature de Dieu, ni la représenter?
Philonous. — C'est impossible.
Hylas. — Si donc nous n'avons aucune idée de l'intelligence de Dieu, comment pouvez-vous concevoir comme possible que les choses existent dans son intelligence? Ou bien, si vous pouvez concevoir l'intelligence de Dieu sans en avoir aucune idée, pourquoi ne serais-je pas autorisé à concevoir l'existence de la Matière, malgré que je n'en aie aucune idée?
Philonous. — Pour votre première question, je reconnais que je n'ai pas proprement d'idée ni de Dieu, ni d'aucun autre esprit; car, étant actifs, ils ne peuvent être représentés par des choses parfaitement inertes, comme sont nos idées. Je sais néanmoins que moi, je suis un esprit, c'est-à-dire une substance pensante, j'existe, aussi certainement que je sais que mes idées existent. Bien plus, je sais ce que je veux dire par ces mots je et moi ; et je sais cela immédiatement ou intuitivement, quoique je ne le perçoive pas comme je perçois un triangle, une couleur ou un son. L'intelligence, l'esprit ou l'âme est cette chose indivisible et inétendue qui pense, agit et perçoit. Je dis indivisible, parce qu'elle est inétendue; et inétendue, parce que les choses étendues figurées et mobiles, sont des idées ; et que ce qui perçoit des idées, ce qui pense et ce qui veut, n'est manifestement lui-même ni une idée, ni semblable à une idée. Les idées sont choses inactives et perçues; et les esprits sont une sorte d'êtres tout à fait différents. Je ne dis donc pas que mon âme soit une idée, ni semblable à une idée.
Pourtant, en prenant le mot idée dans un sens large, on peut dire que mon âme me fournit une idée, c'est-à-dire une image ou ressemblance de Dieu, — quoique, à la vérité, extrêmement inadéquate. Car toute la notion que j'ai de Dieu est obtenue en réfléchissant sur ma propre âme, en exaltant ses puissances et en écartant ses imperfections. Aussi, quoique ce ne soit pas une idée inactive, j'ai pourtant en moi-même une sorte d'image active et pensante de la Divinité. Et, quoique je ne Le perçoive pas par les sens, pourtant j'ai quelque notion de Lui, ou encore je Le connais par réflexion et raisonnement.
De ma propre intelligence et de mes propres idées, j'ai une connaissance immédiate; et, par leur intermédiaire, je saisis médiatement la possibilité de l'existence d'autres esprits et d'autres idées. Bien plus, de ma propre existence, et de la dépendance que je découvre en moi-même et en mes idées, je conclus nécessairement, par un acte de raison, l'existence d'un Dieu, et de toutes les choses créées dans l'intelligence de Dieu. Voilà pour votre première question. Pour la seconde, je suppose qu'à présent vous pouvez y répondre de vous- même. Car, vous ne percevez pas la Matière objectivement, comme vous faites pour une existence inactive ou une idée ; vous ne la connaissez pas, comme vous vous connaissez vous-même, par un acte de réflexion ; vous ne la concevez pas médiatement par analogie avec l'une ni avec l'autre; et vous ne la formez pas non plus en raisonnant d'après ce que vous connaissez immédiatement. Tout cela rend le cas de la Matière profondément différent de celui de la Divinité...."
Tout d'abord, comment comprendre l'accord entre les perceptions simultanées de plusieurs esprits ? Si les choses ne sont que des idées dans des intelligences, comment se fait-il que plusieurs personnes, au même moment, dans les mêmes circonstances, perçoivent «la même chose»? Cela serait inintelligible, si les idées-choses n'existaient que dans l'esprit du sujet individuel qui les perçoit : mais Berkeley n'a jamais dit cela; et si elles existent en Dieu, il n'y a plus rien d'étonnant à ce que celui-ci suscite en plusieurs esprits des perceptions qui se correspondent. C'est en Dieu que se trouve le principe d'unité que le «matérialisme» réalise grossièrement dans la substance.
De même, d'où vient, pour un même esprit, l'accord entre plusieurs perceptions à différents moments du temps? D'où vient que les choses ne cessent pas d'exister quand je ne les perçois pas, si bien que je les retrouve régulièrement à la même place quand j'y reviens moi-même ? La réponse est identique ; et elle semble à Berkeley si fortement s'imposer qu'elle lui sert, nous l'avons vu, à prouver la nécessité, et par conséquent l'existence même, de Dieu.
Ce n'est pas tout. On sait que, pour Berkeley, les différentes classes de données sensorielles sont radicalement hétérogènes, de sorte qu'à proprement parler, un ensemble d'idées visuelles, par exemple, et un ensemble d'idées tactiles ne sauraient constituer un seul objet. D'où vient donc que ces ensembles se présentent si constamment liés, que nous les rapportons couramment à des objets uniques? Cette «connexion régulière» des idées tactiles et visuelles avait permis à Berkeley d'expliquer la formation des perceptions de distance, de grandeur et de position ; il avait même indiqué, dès ce moment, qu'une telle connexion requérait pour cause l'action d'une Providence.
Il développe à nouveau cette idée dans le quatrième dialogue de l' "Alciphron". L'existence de Dieu, dit-il en substance, est tout aussi certaine que celle du libre-penseur qui la nie; car nous ne jugeons de l'existence d'un esprit (excepté le nôtre) que par un certain nombre de signes sensibles qui nous la font supposer : or, ces signes ne sont pas moins manifestes dans un cas que dans l'autre. L'ordre et l'harmonie du monde témoignent de l'existence de Dieu : Berkeley ne renonce nullement à la classique preuve des causes finales. Mais il ne s'en tient pas à la forme banale de cette preuve : Dieu, dit-il, nous parle un véritable langage, au sens le plus propre du mot. Les signes qui composent ce langage ne sont autres que nos sensations visuelles : elles méritent bien ce nom, puisque la connexion qui les unit aux objets tangibles est à la fois constante et purement extrinsèque, tout comme le rapport du mot à ce qu'il exprime. Les choses sont arrangées de telle sorte que nos sensations visuelles, grâce à la perception acquise de distance, nous avertissent de telles ou telles sensations tactiles, avec lesquelles elles n'ont par elles-mêmes aucune relation : cette régularité, si utile à l'être humain, ne peut venir que d'un Dieu qui la concerte à notre profit.
Berkeley part du fait de la perception, et montre que ce fait suppose Dieu. Seulement, dans les Dialogues, Dieu apparaît comme nécessaire pour fonder la perception elle-même; dans l'Alciphron, il sert à fonder la connexion régulière des perceptions hétérogènes. De même que l'idéalisme donnait un nouveau sens à la preuve a contingentia, de même la théorie de la vision renouvelle, en la précisant, celle des causes finales. L'univers que nous percevons ne se comprend pas sans Dieu : il exige Dieu, d'abord par sa seule existence, puis par l'ordre qui s'y manifeste, et dont la liaison des données tactiles et visuelles n'est qu'un cas particulièrement démonstratif.
Et plus encore, avant Hume, Berkeley proclame l'absence de tout lien intrinsèque entre la cause et l'effet : n'importe quel effet pourrait succéder à n'importe quelle cause. C'est même trop dire que d'appeler la loi un fait constant : celle de la gravitation, par exemple, n'a rien d'universel : «dans certain cas, un principe tout à fait contraire semble ressortir de lui-même, comme dans la croissance verticale des plantes et dans l'élasticité de l'air. Il n'y a rien de nécessaire ou d'essentiel dans cette question. Tout y dépend de la volonté de l'esprit qui gouverne...»
Bref, la nature n'est régulière que parce que Dieu le veut ainsi; et s'il le veut, s'il s'assujettit, en principe, à l'uniformité dans la production des idées c'est par pure bonté pour les êtres humains, afin qu'ils puissent tirer de l'expérience des prévisions pratiquement utiles. Il n'y a des lois que pour que nous puissions les connaître et nous en servir, la science tout entière n'ayant d'autre but que de fournir une base à notre action, des instruments à nos besoins. Pour se résumer, la notion de loi naturelle, en son sens plein, fait entièrement défaut à Berkeley : sa philosophie de la nature est un contingentisme absolu, à fondement théologique. Il n'y a pas de loi, parce que la volonté de Dieu en tient lieu.
Une formule saisissante du Commonplace Book marque bien le sens de cette doctrine, qui est l'antithèse du fatalisme: «Je ne crois pas que les choses arrivent par nécessité : il n'existe pas deux idées dont la connexion soit nécessaire. Tout n'est que résultat de la liberté; c'est-à-dire : tout est volontaire (Cpl. B., p. 58, § 492)». La volonté libre est au fond de tout. Nous rejoignons ainsi la conclusion de la partie précédente : «L'Esprit, la chose active, ce qui est l'âme et Dieu, c'est la Volonté seule».

"Alciphron, or the Minute Philosopher" (1732)
Pendant son séjour en Amérique, Berkeley a composé Alciphron, un ouvrage d'apologétique chrétienne dirigé contre les "libres penseurs" qu'il considérait comme des ennemis de l'anglicanisme établi. Alciphron est également une œuvre philosophique importante et une source cruciale des vues de Berkeley sur le langage. S'il n'apporte aucune contribution complémentaire à la pensée du philosophe, "Alciphron" est considéré comme son chef d'oeuvre littéraire...
Sept dialogues au cours desquels Alciphron et Lysie les soutiennent les arguments des libres penseurs du temps, mais de "petits philosophes" qui minimisent les choses de la plus grande valeur, les pensées, les finalités et les espérances que poursuivent les êtres humains. Ils ramènent au bon sens toutes les connaissances, les notions et les théories de l'intellect, pour en fin de compter dégrader notre nature et nous assigner une portion du temps, au lieu de l'immortalité. La critique de l'hédonisme, du sensualisme et de l'athéisme ainsi que la défense des convictions morales et religieuses de Berkeley sont confiées à Euphranor et à Criton. Le but que doit viser tout homme dans ses actions est le bien-être de toute l'humanité, que les "petits philosophes" identifient avec le progrès de la richesse; en effet ils considèrent le vice, recherche effrénée du plaisir, comme le moyen le plus propre à encourager l'augmentation de cette richesse. Ce que l'on nomme vertus n`est pour eux que des préjugés, et l'on donne une preuve de sa liberté de penser en s`en libérant.
Mais leurs théories ne résistent pas à un raisonnement démonstratif : la nature de l`homme étant distincte de celle de l'animal parce qu`il a reçu le privilège de la raison qui, à la fois, lui procure les plaisirs intellectuels et, dans la vie active, l'incline aux bonnes moeurs, on doit rechercher les raisons du bien-être propre de l'homme. c'est pourquoi la prospérité sociale ne peut s'obtenir par le vice, mais peut seulement s'atteindre à travers la vertu.
Pour que l'homme soit persuadé de la nécessité de rechercher celle-ci, il ne suffit pas toutefois de dire que l'humanité est "naturellement portée" vers elle; l'idée que la morale peut se fonder sur un simple "goût", ou tendance de la nature, pourrait être facilement contredire par une opinion opposée. La moralité ne peut que s'appuyer sur un principe qui dépasse la simple nature humaine : la foi en Dieu. Le système moral suppose une Providence. La perspective d'une vie future dans laquelle il y aurait des récompenses pour les bons et des châtiments pour les méchants donne au principe de la moralité une base beaucoup plus solide et concrète que la simple proposition de la vertu portant en elle-même sa propre récompense.
Les "petits philosophes" prétendent détruire la base des convictions morales et religieuses, en proclamant que la liberté de pensée est la négation de toute foi religieuse. Mais la connaissance de nous-mêmes, comme êtres pensants, et la découverte de l'existence, hors de nous-mêmes, d'autres individus pensants prouvent l'existence d'une pensée absolue. Le langage même n'est pas une invention de l'être humain, il n'est pas dérivé des impressions des sens, mais il a une origine divine.
"Euphranor.— ...Mais que diriez- vous si je vous prouvais que Dieu parle réellement aux hommes? En cas que je vous démontre ce point, serez- vous content?
Alciphron. — Je ne suis point de ceux qui admettent des inspirations ou un langage intérieur. Des gens raisonnables n'ajoutent guère de foi à ces sortes de choses. Vous n'aurez rien fait, si vous ne me démontrez clairement que Dieu parle aux hommes par des signes extérieurs et sensibles, de la même manière que les hommes se font entendre les uns aux autres.
Euphranor.— Vous serez donc content, si je vous fais voir au doigt et à l'œil que Dieu parle aux hommes par le moyen de quelques signes extérieurs, sensibles et arbitraires, qui n'ont aucune ressemblance, ni aucune connexion nécessaire, avec les choses qu'ils signifient; si je vous fais voir, que, par d'innombrables combinaisons de ces signes, nous découvrons une infinie variété d'objets; que nous sommes instruits de leur nature; que nous sommes avertis de ce que nous devons éviter ou poursuivre; comme aussi de quelle manière nous devons nous conduire à l'égard des choses éloignées de nous, tant à l'égard du temps que du lieu : encore une fois, serez-vous content alors?
Alciphron. — C'est précisément ce que je souhaite de vous; car c'est en cela que la force, l'usage et la nature du langage consistent.
Euphranor. — Jetez les yeux, Alciphron, sur le château qui est au haut de cette colline.
Alciphron. — Je l'ai fait.
Euphranor. — N'est-il pas à une grande distance de vous ?
Alciphron. — Oui.
Euphranor. — La distance n'est-elle pas mesurée par une ligne qui va directement de l'œil à l'objet?
Alciphron. — Sans contredit.
Euphranor. — Et une ligne, dans cette situation, peut- elle peindre plus qu'un seul point dans le fond de l'œil?
Alciphron. — Pas davantage.
Euphranor. — Par conséquent, la représentation d'une longue et d'une courte distance est précisément de la même grandeur, ou plutôt d'aucune grandeur du tout, l'âme n'apercevant dans ces différents cas qu'un seul point.
Alciphron. — Cela me paraît vrai.
Euphranor. — Ne faut-il donc pas qu'elle soit aperçue par le moyen de quelqu'autre chose?
Alciphron. — Certainement.
Euphranor. — Pour découvrir quelle chose ce peut être, examinons quel changement il peut y avoir dans la représentation du même objet, placé à différentes distances de l'œil. Or, l'expérience m'apprend que, à mesure qu'on éloigne davantage un objet de l'œil en ligne directe, cet objet paraît plus petit ; et ce changement de figure, étant proportionnel et universel, me paraît être le moyen par lequel nous apercevons les différents degrés de distance.
Alciphron. — Je n'ai rien à opposer à tout cela.
Euphranor. — Mais la petitesse, dans la nature de la chose, ne paraît pas avoir de liaison nécessaire avec le plus ou le moins de distance.
Alciphron. — Soit.
Euphranor. — Ne suit-il pas de là que la petitesse de l'objet ne peut nous instruire de son éloignement que par le moyen de l'expérience
Alciphron. — J'y consens.
Euphranor. — C'est-à-dire que nous apercevons la distance, non pas immédiatement, mais par le secours d'un signe, qui n'y a ni ressemblance ni rapport nécessaire, et dont la liaison avec la distance est précisément de la même nature que celle des mots avec les choses.
Alciphron. — Je vous arrête là, Euphranor. Les maîtres en optique ne parlent-ils pas d'un angle fait par les deux rayons visuels, angle qui fait apercevoir l'objet, et qui le représente plus grand ou plus petit, selon qu'il est lui-même plus ou moins ouvert?
Euphranor. — L'âme aperçoit donc la distance des choses par le moyen de la géométrie?
Alciphron. — Oui.
Euphranor. — Ne semble-t-il pas suivre de là que personne ne saurait voir, à moins que d'avoir appris la géométrie, et que d'avoir quelque idée de lignes et d'angles?
Alciphron. — Il y a une sorte de géométrie naturelle, qui s'apprend sans étude.
Euphranor. — Je vous prie de me dire, Alciphron, s'il n'est pas nécessaire que je connaisse la liaison que les prémisses ont entre elles, et que celles-ci à leur tour ont avec la conséquence; et, en général, pour connaître une chose par le moyen d'une autre, ne dois-je pas connaître premièrement cette autre chose? Avant que j'aperçoive votre pensée par vos mots, ne dois-je pas avoir la perception des mots mêmes? Et la connaissance des prémisses n'est-elle pas requise avant que je puisse inférer la conséquence?
Alciphron. — Tout cela est vrai.
Euphranor. — Quiconque donc conclut qu'un objet est moins éloigné de ce que l'angle est plus ouvert, ou infère de la diminution de l'angle que l'objet est à une plus grande distance, doit commencer par apercevoir ces angles. Que s'il ne les aperçoit pas, il ne lui est pas possible d'en tirer la moindre conséquence. Cela est-il ainsi, ou non?
Alciphron. — Vous avez raison.
Euphranor. — Demandez au premier homme que vous rencontrerez, s'il a quelque perception ou quelque connaissance de ces angles visuels? Ou bien s'il y songe jamais, ou s'il en tire quelque conséquence, par géométrie naturelle ou artificielle ? Quelle croyez-vous que sera sa réponse?
Alciphron. — Pour dire le vrai, je crois que sa réponse sera, qu'il est sur tous ces sujets dans la plus profonde ignorance.
Euphranor. — Par conséquent, il n'est pas possible que les hommes jugent de la distance par les angles; ni, par la même raison, il ne saurait y avoir la moindre force dans l'argument que vous en tirez, pour démontrer que la distance est aperçue par le moyen de quelque chose qui a une connexion nécessaire avec elle.
Alciphron. — J'en demeure d'accord.
Euphranor. — Pour moi, je trouve qu'un homme peut savoir s'il aperçoit une chose ou non, et si cette perception lui vient immédiatement ou médiatement et, en cas qu'elle lui vienne immédiatement, si c'est par le moyen de quelque chose qui y ressemble ou non, et qui a avec la perception une liaison arbitraire ou nécessaire.
Alciphron. — Cela me paraît ainsi.
Euphranor. — Et n'est-il pas certain que la distance est uniquement aperçue par l'expérience, en cas qu'on ne l'aperçoive pas immédiatement par elle-même, ni par le moyen d'aucune image, ni enfin par quelques angles, qui aient une connexion nécessaire avec elle?
Alciphron. — Oui.
Euphranor. — Ne semble- t-il pas suivre de ce que vous m'avez accordé, qu'un homme, qui n'aurait pas la moindre expérience sur ce sujet en question, ne croirait pas que les choses qu'il voit fussent à la moindre distance de lui ?
Alciphron. — Comment cela?
Euphranor. — La petitesse de l'objet aperçu, ou quelque autre idée ou sensation, qui n'ont aucune ressemblance ni aucune liaison nécessaire avec la distance, ne sauraient non plus faire connaître différents degrés de distance, ou la distance en elle-même, à notre âme, qui n'a encore aucune expérience par rapport à la connexion arbitraire dont nous venons de parler, que des mots peuvent exciter des idées dans l'âme d'un homme qui ignore la langue dont ces mots sont empruntés.
Alciphron. — Je ne vous conteste aucun de ces articles.
Euphranor. — Ne s'ensuit-il pas de là qu'un homme, qui serait né aveugle, et qui recouvrerait la vue, croirait, dans le temps que les objets frapperaient pour la première fois ses regards, croirait, dis-je, que les choses qu'il aperçoit ne sont à aucune distance de lui, mais dans son œil, ou, pour mieux dire, dans son âme ?
Alciphron. — J'avoue que cela me paraît ainsi; et cependant, d'un autre côté, j'ai peine à croire que, si la supposition que vous venez de faire avait lieu à mon égard, je m'imaginasse que les objets qui sont à présent à une si grande distance, fussent au-dedans de moi.
Euphranor. — Il semble donc que vous croyez que les objets visibles sont à une certaine distance de vous?
Alciphron. — Sans contredit. Quelqu'un peut-il révoquer en doute que le château que voilà est à une grande distance?
Euphranor. — De grâce, Alciphron, pouvez-vous discerner les portes, les fenêtres et les créneaux du château dont vous parlez ?
Alciphron. — Non. Dans la distance où je suis, je vois seulement une petite tour ronde.
Euphranor. — Mais moi, qui y ai été, je sais que ce n'est point une petite tour ronde, mais un grand bâtiment carré, avec des créneaux et des tourelles, que vous ne paraissez pas apercevoir.
Alciphron. — Que prétendez- vous conclure de là?
Euphranor. — J'en conclus que le véritable objet que votre vue aperçoit n'est point ce château éloigné de vous de quelques milles.
Alciphron. — Pourquoi?
Euphranor. — A cause qu'un petit objet rond est une chose, et qu'un grand objet carré en est une autre. Qu'en dites- vous ?
Alciphron. — Je ne puis le nier.
Euphranor. — La figure visible n'est-elle pas le propre objet de la vue?
Alciphron. — Certainement.
— Que pensez-vous, dit Euphranor en tournant ses regards vers le ciel, de la figure visible de Vénus ? N'est- ce pas un objet plat et rond, de la grandeur d'une pièce de six sous ?
Alciphron. — Et puis?
Euphranor. — Que pensez- vous de la planète même?
Ne croyez-vous pas que c'est un grand corps opaque, parsemé de montagnes et de vallées ?
Alciphrox. — Je le crois.
Euphranor. — Comment pouvez- vous donc conclure que l'objet propre de votre vue existe à quelque distance de vous?
Alciphrox. — J 'avoue que je m'y trouve embarrassé.
Euphranor. — Voulez- vous une autre preuve de la même vérité? Jetez les yeux sur cette nuée de couleur cramoisie. Croyez-vous que, si vous étiez proche de l'endroit où elle est, vous aperçussiez quelque chose de pareil à ce que vous voyez à présent ?
Alciphrox. — Nullement: j'apercevrais seulement une espèce de brouillard.
Euphranor. — N'est-il pas évident, par conséquent, que ni le château, ni la planète, ni la nuée, que vous voyez d'ici, ne sont pas les objets réels, que vous supposez exister à une certaine distance de vous?
Alciphrox. — Que dois- je donc penser? Ne voyons- nous rien du tout, ou le spectacle de l'univers n'est-il pour nous qu'une scène d'illusion?
Euphranor. — Tout bien examiné, il semble que les objets propres de la vue sont la lumière et les couleurs; lesquelles, étant infiniment diversifiées et combinées, forment un langage destiné à nous informer des distances, des figures, des situations, de dimensions, et de plusieurs autres qualités des objets qui tombent sous nos sens; non par un rapport de ressemblance, ni par une connexion nécessaire, mais par l'institution arbitraire de la Providence, précisément comme les mots excitent en nous l'idée des choses qu'ils signifient.
Alciphrox. — Comment ! Peut-on dire que nous n'apercevions point la vue des arbres, des maisons, des hommes, des rivières, et une infinité d'autres choses?
Euphranor. — La faculté de voir nous procure sans doute la perception de tous ces objets. Mais s'ensuit-il de là qu'ils soient les objets propres et immédiats de la vue, davantage que toutes les choses qui sont signifiées par le moyen de certains mots, sont les objets immédiats et propres de l'ouïe?
Alciphrox. — Selon vous, donc, la lumière, les ombres et les couleurs, diversement combinées, répondent aux différentes articulations du son dans le langage ; et, par ce moyen, notre âme aperçoit les objets, précisément de même qu'elle en a une autre sorte de perception par le moyen de certains sons : c'est-à-dire nullement à cause de quelque ressemblance, ou d'une liaison nécessaire, mais uniquement par expérience et par habitude.
Euphranor. — Je serais très fâché que vous ajoutassiez plus de foi à ce que je dis, que la nature des choses ne vous y oblige, ou que vous vous rendissiez à quelque autre motif qu'à la force de la vérité ; car je ne crois pas que les esprits les plus forts veuillent s'exempter de l'obligation de se rendre à l'évidence.
Alciphrox. — Vous m'avez conduit pas à pas dans un labyrinthe, dont j'avoue que j'aide la peine à sortir. Cependant j'espère de m'en tirer de manière ou d'autre.
Ici Alciphrox, après avoir fait une courte pause, continua de la manière suivante :
11 . — Vos principes, Euphranor, vont trop loin, puisqu'on en peut conclure qu'un homme, qui serait né aveugle, et qui recouvrerait la vue, non seulement n'apercevrait pas d'abord à distance des objets, mais ne connaîtrait pas même les choses qu'il verrait, et ne distinguerait pas, par exemple, un homme d'un arbre : supposition qui me paraît de la dernière absurdité.
Euphraxor. — J'avoue, en conséquence des principes que vous et moi avons admis, qu'un pareil homme ne connaîtrait aucun des objets dont il a eu auparavant la perception par l'attouchement, parce qu'il n'entend pas encore la signification des différentes combinaisons de la lumière et des couleurs; tout comme un Chinois ne se formerait point d'idée des mêmes objets, à l'ouïe de certains sons qui les exprimeraient, mais dont la signification lui serait inconnue. Dans l'un et dans l'autre cas, il faut du temps, de l'expérience, et des actes répétés, pour acquérir la connaissance de la connexion qu'il y a entre les signes et les choses signifiées ; c'est-à-dire pour entendre le langage, soit des yeux, soit des oreilles. Et je ne trouve rien d'absurde en tout cela.
Alciphrox. — Je ne vois donc, à parler exactement, cette pierre, que dans le même sens que je puis être dit l'entendre, lorsqu'on prononce le mot de pierre en ma présence ?
Euphraxor. — Précisément de même.
Alciphron. — Comment se fait-il donc que chacun dit qu'il voit, par exemple, une maison ou un rocher, lorsque ces objets sont devant ses yeux ; mais que personne ne dit qu'il entend un rocher ou une maison, mais seulement les mots ou les sons, par lesquels ces choses sont signifiées, mais point entendues ? Outre cela, si la vision est simplement un langage adressé aux yeux, on peut demander quand les hommes ont appris ce langage. Pour acquérir la connaissance d'un aussi grand nombre de signes qu'il faut pour former un langage, il est nécessaire de prendre bien de la peine. Mais où est l'homme qui peut dire que le langage de la vision lui a coûté la moindre peine ou la moindre partie de son temps?
Euphraxor. — Cela ne vous paraîtra pas si étrange, si vous considérez que notre mémoire ne saurait nous rappeler le temps dans lequel nous avons commencé à apprendre ce langage. Si nous avons parlé cette langue dés le premier jour de notre naissance; si l'Auteur de la nature parle constamment aux yeux de tous les hommes, même dès leur plus tendre enfance, dans tous les instants où leurs yeux sont ouverts à la lumière, seuls ou en compagnie; je ne suis nullement étonné que les hommes ne se soient jamais aperçus qu'ils aient appris un langage, dont les premières leçons leur ont été données de bonne heure, et sur lequel ils ont reçu dans la suite des instructions tant de fois réitérées. De plus, si nous faisons attention que ce langage est le même par tout le monde, et non pas, comme les autres langages, différent dans différents pays, il y a moyen de concevoir pourquoi les hommes tombent dans l'erreur en s'imaginant qu'il y a une ressemblance ou une connexion nécessaire entre les objets propres de la vue et les choses signifiées par ces objets, ou pourquoi ils n'en font qu'un seul et même objet. Par là il est aisé de concevoir pourquoi, dans le langage en question, la plupart des hommes confondent les signes avec les choses signifiées, quoique la même chose ne leur arrive pas à l'égard des langages particuliers formés par les différentes nations.
12. — Il est bon aussi de remarquer que, les signes n'étant pas de grande valeur en eux-mêmes, et n'étant considérés que par leur destination à signifier les choses dont ils sont les signes, il arrive que l'âme passe souvent par-dessus, et fixe immédiatement son attention sur les choses signifiées. C'est ainsi, par exemple, que, lorsque nous lisons, nous ne faisons presque aucune attention aux caractères, et ne considérons que le sens. C'est ce qui fait que les hommes disent quelquefois qu'ils voient des mots, des idées et des choses, en lisant un livre : au lieu qu'à parler exactement, ils voient .seulement les caractères, qui leur rappellent le souvenir des mots, des idées et des choses. Et, par parité de raison, ne pouvons-nous pas supposer que les hommes, passant par-dessus les objets propres et immédiats de la vue, comme étant peu importants, s'attachent uniquement aux choses signifiées, et en parlent comme s'ils les voyaient?
Alciphron. — Pour vous dire librement ma pensée, cette dissertation commence à m 'ennuyer, et roule sur un sujet trop sec et trop petit pour mériter mon attention.
— Je croyais, dit Criton, que les petits philosophes aimaient à examiner les choses avec précision et en détail.
Alciphron. — Cela est vrai : mais, dans un siècle aussi poli que le nôtre, qui voudrait n'être simplement que philosophe? Il y a une certaine exactitude scolastique, qui s'accorde mal avec les manières aisées d'un homme du monde. Mais, pour ne point chicaner là-dessus, je me contenterai d'en appeler à votre conscience, et de vous demander si vous croyez réellement que Dieu lui-même parle chaque jour, et en chaque endroit, aux yeux de tous les hommes?
Euphraxor. — C'est véritablement mon sentiment; et ce serait le vôtre, si vous vouliez être d'accord avec vous- même, et vous en tenir à la définition que vous avez donnée du langage. Puisque vous ne sauriez nier que le grand Auteur et Directeur de la nature s'explique constamment aux yeux des hommes par le ministère sensible de quelques signes arbitraires, qui n'ont aucune ressemblance, ni aucune connexion, avec les choses signifiées; et cela d'une manière si merveilleuse, que, par le moyen de ces signes, il leur fait apercevoir une infinie variété d'objets, différents en nature, en temps et en lieu, et les instruit comment ils doivent se conduire à l'égard des choses éloignées et futures, aussi bien qu'à l'égard de celles qui sont présentes, et à une distance peu considérable; en conséquence, dis-je, de vos sentiments et de vos aveux, vous avez autant raison de penser que l'Agent universel, ou Dieu, parle à vos yeux, que de croire que quelque personne particulière parle à vos oreilles.
Alciphron. — Je ne saurais m 'empêcher de croire qu'il y a quelque sophisme dans tout ce raisonnement, quoique je ne puisse pouvoir démêler en quoi il consiste. Voyons un peu. Les signes ne sont-ils pas arbitraires dans le langage?
Euphraxor. — Oui.
Alciphron. — Et, par conséquent, ils n'expriment pas toujours des choses dont l'existence est réelle. Au lieu que ce langage naturel, comme vous l'appelez, ou ces signes visibles, indiquent toujours les choses avec la même uniformité, et ont une connexion régulière et constante avec des objets réels : d'où il paraît que cette connexion est nécessaire, et que, par conséquent, suivant notre définition, ce ne saurait être un langage. Que répondez-vous à cette objection ?
Euphraxor. — Vous pouvez y trouver une réponse vous-même, pourvu que vous vous regardiez dans un miroir, ou que vous jetiez les yeux sur un tableau.
Alciphron. — Vous avez raison, et je vois que je me suis trompé. Ainsi, tout ce qui me reste à dire sur cette opinion, c'est que je la trouve si étrange et si opposée à ma manière de penser, que je ne l'admettrai de ma vie...."
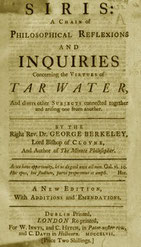
La «Siris» (1744)
En 1734, Berkeley est nommé évêque de Cloyne, ce qui lui permet de retourner en Irlande. C'est là que Berkeley écrit sa dernière œuvre philosophique, la plus étrange et la plus vendue de son vivant (6 éditions en 6 mois). Siris (1744) a un triple objectif : établir les vertus de l'eau de goudron (un liquide préparé en laissant reposer du goudron de pin dans de l'eau) comme panacée médicale, fournir un contexte scientifique soutenant l'efficacité de l'eau de goudron, et conduire l'esprit du lecteur, par étapes graduelles, vers la contemplation de Dieu.
"Je commence cet ouvrage par assurer mes lecteurs, que rien dans ma situation présente n'aurait pu m'engager à l'entreprendre, si je n'étais fermement persuadé du fruit que le public en doit recueillir. Si la partie spéculative de l'écrit qu'on va lire fournit de l'exercice et de la nourriture à l'esprit, j'ose dire que l'autre partie tend si sûrement à procurer le bien du corps, que tous les deux ne peuvent manquer d'y trouver leur compte. D'un luth désaccordé, c'est en vain qu'on prétendrait tirer quelque harmonie; de même, dans l'état présent, les opérations de notre âme dépendent à tel point de la bonne disposition de ce corps qui lui sert d'instrument, que tout ce qui contribue d'une manière sensible à conserver ou rétablir la santé de celui-ci, mérite bien l'attention de celle-là. Voilà par quels motifs je me suis déterminé à publier les vertus salutaires de l'eau de goudron.
J'ai cru que ce que chacun de nous doit, en qualité d'homme, au genre humain dont il est membre, m'en faisait une obligation indispensable. Mais l'enchaînure naturelle des effets avec leurs causes a fait que mes pensées sur ce sujet peu relevé, quoiqu'utile, m'ont conduit à d'autres recherches ultérieures, et celles-ci à d'autres encore plus éloignées, et peut-être un peu abstraites, mais qui, comme je l'espère, ne seront pas sans utilité et sans agrément.."
Le dernier ouvrage philosophique de Berkeley fait l'objet d'une question contestée : dans quelle mesure la doctrine de la Siris diffère-t-elle de celle des "Dialogues" et du "Traité''! Avons-nous affaire à deux philosophies distinctes et contradictoires? Ou doit-on, au contraire, reconnaître à la pensée de Berkeley une unité fondamentale, et ne voir d'une période à l'autre que des différences de ton et de point de vue ? On ne peut nier la réalité des changements apportés par la Siris...
On a pu dire que la belle lucidité des Dialogues fait place à des nuages mystiques. Le philosophe semble avoir perdu l'assurance juvénile que lui inspirait naguère la découverte de son principe : il ne croit plus que nous puissions saisir, des vérités les plus hautes, autre chose qu'un reflet. En outre, plusieurs thèses, entièrement étrangères aux précédents ouvrages, font dans la Siris leur apparition, la théorie de l'éther, «esprit vital du monde»; l'idée d'une connaissance supra-sensible et supra-empirique et d'un objet lui appartenant en propre; celle enfin de la trinité des hypostases, des innovations qui s'inspirent de la philosophie ancienne tirées des abondantes lectures de Berkeley. La première philosophie envisageait surtout les idées en tant que perçues, et dans leur rapport avec l'entendement humain; la seconde, en tant que produites, et dans leur rapport avec la volonté divine. Les idées que produit la Volonté divine cachent son essence plutôt encore qu'elles ne l'expriment : Berkeley se propose d'atteindre cette volonté même, (qui est par nature inexprimable). Ainsi s'expliquent l'obscurité, le mysticisme de ses spéculations..

POUR NE PAS CONCLURE, en synthèse, quelle est donc en fin de compte l'intuition propre de Berkeley, quelles sont les images médiatrices qui nous la livrent, quelle est l'idée inspiratrice qui lui fut présente dès le principe et qui parcourt toute son œuvre...
Dès 1708, Berkeley écrivait dans son Cahier de notes (C. B. 97, 4-91) : "La source de la folie de ceux qui nient l'existence du mouvement et des autres choses perçues effectivement par les sens vient de ce qu'ils ignorent la nature de l'existence et en quoi elle consiste. La découverte de la nature, du sens, de l'importance de l'exister, voilà sur quoi j'insiste principalement. Cela met une grande différence entre les sceptiques et moi. Je crois que c'est tout à fait nouveau. Je suis sûr que, pour moi, c'est nouveau."
De fait, il y a deux manières, et deux manières seulement d'exister. "Exister, c'est être perçu, ou percevoir", écrit Berkeley, et il ajoute en marge cette note, qui explique le texte : "ou vouloir, c'est-à-dire agir". Il est impossible que rien existe en dehors de ce qui pense et de ce qui est pensé (C. B. 39, 437), des esprits et des idées (Pr. 2, 89, 142).
De la première sorte, l'existence in se, seule primitive, seule première et fondamentale, est toute existence consciente. De la deuxième sorte, l'existence in alio, dérivée, entièrement différente de la première, et n'impliquant nulle communauté entre les deux natures, est l'existence des choses sensibles, dont tout l'être consiste dans le fait d'être perçu (esse est percipi) et ne peut en être abstrait, car ce n'est rien dire d'intelligible que de parler d'une existence absolue des objets sensibles en eux-mêmes ou sans l'esprit (Pr. 24).
Par là on échappe au doute, car on ne saurait se tromper en matière de simple perception (C. B. 306, 693), et il est bien certain que les corps continuent d'exister, les arbres dans le parc, le cheval dans l'écurie, les livres dans la salle de travail, même quand je ne les perçois pas actuellement, car, si j'ouvre les yeux et regarde de ce côté, je les verrai (C._B. 786, 293) : ils existent donc, que nous pensions à eux ou non, comme un ensemble de forces capables de produire des pensées (773, 282), et comme nous n'en sommes pas les causes, comme ils sont indépendants de notre volonté, il faut donc qu'il y ait quelque autre cause de ces faits, c'est-à-dire un Être qui veut ces perceptions en nous (104, 499), un Pouvoir parfait simple, unique,
éternel, qui est l'Esprit actif, la seule cause de toutes les choses naturelles, Dieu (35, 433). Voilà ce qu'est la réalité.
Berkeley ne nie en aucune manière, il affirme et garantit au contraire l'existence réelle des choses que nous percevons comme des données immédiates; et, de ce qu'elles ne dépendent pas de ma pensée, de ce qu'elles ont une existence distincte de la perception que j'en ai, il infère, et infère nécessairement, - puisque le monde sensible est ce que nous percevons par nos sens, que rien n'est perçu par les sens que les idées, et qu'aucune idée ou aucun archétype d'une idée ne peut exister autrement que dans une intelligence, - l'existence d'une Intelligence en qui elles existent, en qui elles subsistent, et qui à chaque instant affecte mon esprit des impressions sensibles qu'il reçoit. Et, d'après la variété, l'ordre et la manière de ces impressions, je conclus que leur auteur est sage, puissant et bon au-delà de tout ce qu'on peut comprendre.
"Remarquez-le bien", ajoute Berkeley, par la bouche de Philonous, répondant à l'objection de ceux qui l'accusent de verser dans les visions enthousiastes de Malebranche, "je ne dis pas : je vois les choses en percevant ce qui les représente dans la substance intelligible de Dieu. Cela, je ne le comprends pas. Mais je dis : Les choses perçues par moi sont connues par l'entendement, et produites par la volonté, d'un Esprit infini."
Tout ce que nie Berkeley, c°est que les choses sensibles, aussi bien que l'étendue, le temps, le mouvement, les nombres et les ordres d'infinis (C. B. 4-98. Pr. 110-134), aient une existence absolue, extérieure à toutes les intelligences et distincte dc la perception qu'en a Dieu (35 D.); c'est qu'il existe une substance matérielle, inerte et inanimée, qui en soit cause et cause de pensée (29 D.). Un monde vidé de pensée, dépourvu d'intelligence, c'est-à-dire un je ne sais quoi, nec quid, nec quantum, nec quale, quel spectacle étonnant (C. B. 516, 22-23), ou plutôt quelle notion inintelligible. Qu'il y ait une réalité, qu'il y ait des choses, qu'il y ait une rerum natura, voilà, dit Berkeley, ce qui est indubitable d'après mes Principes (C. B. 799, 305). Mais,
si nous sommes bien pénétrés de ces principes, d'ailleurs conformes à l'expérience et au sens commun, nous verrons que la Nature, conçue comme un être distinct de Dieu, aussi bien que des lois de la nature et des choses perçues par les sens, n'est qu'un pur son dénué de toute signification intelligible, une vaine chimère introduite par des païens dépourvus de toute juste notion sur l'omniprésence et l'infinie perfection de Dieu, et que des chrétiens ne sauraient admettre (Pr. 150); que la cause de tous les phénomènes de la nature est Dieu seul (C. B. 35, 433), sans qu'il puisse y avoir partage entre Dieu et la Nature ou les causes secondes, occasions ou instruments (C. B. 91, 485. 2° D.).
Du même coup, Berkeley sape à la base l'idée que les "philosophes" se font de la Nature, "comme si la Nature était autre chose que l'ordre établi par la libre volonté de Dieu" (C. B. 404, 794), et comme si les causes physiques pouvaient rien faire (464, 856), étant inertes par nature (Siris 247).
Mais il y a plus. Une fois écarté tout ce qui s'interpose entre l'homme et Dieu, une fois ôté le voile qui fait de la pellicule un écran, rien n'empêchera plus l'esprit d'apercevoir Dieu au travers, par transparence; ou, pour transposer en une image auditive l'image visuelle dont nous nous sommes servi (Alciphron, IV, 6-9), la Nature entière, et ce qu'on appelle à tort du nom de Matière, nous apparaîtra comme un langage que Dieu parle aux hommes, à l'aide de signes arbitraires, extérieurs et sensibles qui n'ont ni ressemblance ni connexion nécessaire avec les choses qu'ils représentent et suggèrent, pas plus que n'en ont les mots avec ce qu'ils désignent, ou les signes de la vue avec les objets du toucher, tels que la distance. De ces signes, Dieu se sert pour nous manifester les effets de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté, et pour nous diriger dans la vie.
Ainsi nous voyons ou nous entendons Dieu de la même manière que nous connaissons les êtres spirituels distincts de nous, à savoir les hommes, mais avec cette différence qu'un esprit humain particulier est désigné par un assemblage fini et restreint d'idées qui nous amène à penser qu'il y a là un principe distinct de pensée et de mouvement, semblable à nous, qui l'accompagne et qu'il représente, au lieu que, partout où nous portons notre vue, en tous temps, en tous lieux,
nous percevons des signes et gages manifestes de la Divinité : tout ce que nous voyons, entendons, sentons, tout ce que nous percevons par nos sens, bref tout ce qui compose la puissante trame du monde (Pr. 6), étant un signe ou un effet de la puissance de Dieu, c'est-à-dire d'un Esprit qui est intimement présent à nos intelligences, qui produit en elles toute la variété d'idées et de sensations qui nous affectent sans cesse, de qui nous dépendons entièrement et absolument, bref en qui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes (Pr. 147-14-9) : le Créateur qui a le pouvoir de produire toutes choses par un simple fiat ou acte de sa volonté (Pr. 152).
Ainsi, tout nous découvre Dieu, ou nous le cache, selon qu'on voit au travers de ces signes ce qu'ils signifient, ou que, au contraire, on s'arrête à eux.
Sans doute, l'expression qu'il en a donnée est allée se développant en même temps que se développait son esprit au contact de l'expérience ct des choses, des sciences et des hommes; mais dès son enfance il avait une inexplicable propension à penser de cette manière (C. B. 899), et tous les éléments de sa doctrine se trouvent, au moins en germe, dans le premier de ses écrits, ce cahier de notes, le Commonplace Book, qu”il rédigea en 1707-08, alors que âgé de vingt-deux ans à peine, il était maître ès arts et junior fellow au Trinity College de Dublin. Dès cette époque il conçoit et présente "toute l'œuvre orientée vers la pratique et la morale, comme cela ressort, premièrement, de ce que je rends manifeste la proximité et l'omniprésence de Dieu, deuxièmement, de ce que je supprime tout travail scientifique inutile" (C. B. 901), à savoir celui qui naît des abus du langage et de la doctrine des idées générales abstraites.
Car après tout, écrit-il à la fin de son Traité des Principes de la connaissance humaine, où l'on recherche les principales causes d'erreur et de difficulté dans les sciences, et les fondements du scepticisme, de l'athéisme et de l'irréligion (1710), "ce qui mérite la première place dans nos études, c'est la considération de DIEU et de notre devoir : et comme le principal objet et dessein de mes travaux a été de les promouvoir, je les tiendrai pour entièrement inutiles et inefficaces si je ne puis, par ce que j'ai dit, inspirer à mes lecteurs un pieux sentiment de la présence de Dieu, et, en montrant, comme je l'ai fait, la pauvreté et la vanité des spéculations stériles auxquelles s'adonnent les savants, les mieux disposer à révérer et embrasser les vérités salutaires de l'Évangile, dont la connaissance et la pratique constitue la plus haute perfection de la nature. humaine".
Cette inspiration religieuse, ce sens profond de la présence de Dieu reconnaissable en toutes choses et d'abord dans nos esprits, ce sentiment vif de la réalité du monde spirituel, de l'Esprit qui opère tout en tous, en qui et par qui tout existe, qui assure l'ordre et l'enchaînement des choses, la correspondance, le commerce et la communion entre les esprits, enfin cet ardent et impétueux désir de saisir la réalité existante à sa source, en dénonçant et en écartant tous les sujets de confusion, de controverse et d'erreur, en ramenant au sens commun et à l'expérience immédiate les êtres humains qu'on dirait aveugles par un excès de lumière (Pr. 149), en leur apprenant à voir partout les signes et les effets de la puissance divine, à entendre en tout le langage que leur tient l'Auteur de la nature : voilà ce qui fait l'unité de sa vie comme de sa doctrine.
Ainsi qu'il le notait sur un feuillet séparé de son journal en 1708, "Mes spéculations ont le même effet que les visites en pays étranger; à la fin, je reviens au point d'où j'étais parti, mais le cœur à l'aise et jouissant de la vie avec une satisfaction nouvelle", la satisfaction de celui qui, à défaut de cette intuition parfaite des choses divines, privilège des âmes pures jouissant de la pure lumière, s'est efforcé, ainsi qu'il le dit dans les dernières lignes de sa Siris, de faire le meilleur usage possible des lueurs imparfaites de ces Idées divines qui passent à sa portée...
