- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Jonathan Swift (1667-1645), "Gulliver'sTravels" (1726, 1735) - John Arbuthnot (1667-1735) - John Gay (1685-1732), "Beggar's Opera" (1728) - Thomas Parnell (1679-1718) - Alexander Pope (1688-1744), "The Dunciad" - - ...
Last update 10/10/2021
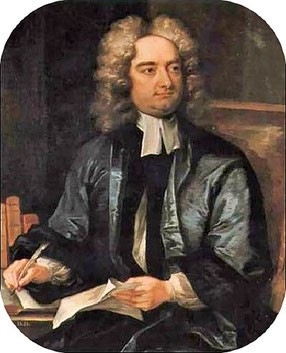
En Angleterre, autour de Guillaume III (1689-1702), autour de la reine Anne (1702-1707), autour de George Ier (1714-1727), se livrait la grande bataille des whigs et des tories, bataille ardente, fiévreuse, longtemps incertaine ; pendant cette période d'émotions sans cesse renouvelées, où l'Angleterre se demandait chaque jour si la Révolution de 1688 allait rester un acte définitif ou si l'on allait la rayer de son histoire en revenant à la succession des Stuarts, les esprits furent dans un état de surexcitation et d'agitation extraordinaires; aucun Anglais ne resta indifférent. Pas une question n'était soulevée, pas un fait ne se produisait sans faire naître immédiatement des raisonnements passionnés pour et contre. La fureur des discussions était telle, que le développement des journaux n'y suffisait pas ; les brochures politiques combattaient à côté d'eux, et surgissaient si nombreuses que Swift déclarait qu'un homme aurait passé toutes ses journées du matin jusqu'au soir pour les lire.
A de certains moments ministres et Parlement, impatientés par le bruit incessant de ces publications essayèrent de les faire taire, le ministère tory mit un lourd impôt général sur les journaux et les brochures, la Chambre des communes expulsa Steele de son sein à cause d'un écrit intitulé "la Crise" (1714) et de deux numéros de son journal "The Englishman", la Chambre des Lords offrit une récompense à qui lui dénoncerait l'auteur d'une brochure anonyme de Swift, "L'Esprit public des Whigs" (1714), par ordre des Communes, le livre de Defoe, "The Shortest Way with the Dissenters" (1702), fut brûlé par le bourreau. Mais journaux et brochures continuèrent à pulluler, et les brochures particulièrement furent achetées avec un empressement tout à fait inconnu jusque-là. En quatre ans le "The True-born Englishman" de Defoe (1701) eut neuf éditions sur bon papier, et douze éditions de contrebande à bon marché, qui se vendirent dans les rues de Londres au nombre de 80 000 exemplaires. En 1706, le fameux sermon du docteur Henry Sacheverell (1674-1724), qui amena la chute du ministère whig de la reine Amie et le triomphe momentané des tories à la fin de son règne, eut en quelques jours une vente de 40 000 exemplaires. Jamais encore on n'avait vu des acheteurs si nombreux répondre avec une pareille constance à la production des écrivains. Dans la suite des modèles fournis par Richard Steel et Joseph Addison, The Tatler (1709), qui faisait écho aux discussions politiques et littéraires tenues dans les cafés londoniens, The Spectator (1711), augmentation notable du nombre de lecteurs, mais aussi des titres et de la qualité des textes ....
(Portrait de Jonathan Swift par Charles Jervas, 1718)
Les écrivains anglais ont très souvent été mêlés aux luttes politiques de cette Angleterre du XVIIIe siècle, en y prenant une part avec une ardeur plus ou moins active. Ce premier tiers du siècle, correspondant globalement au règne de la reine Anne, 1702-1707, révèle une extraordinaire effervescence "intellectuelle" : en une décennie, l'écrivain, plus essayeur que grand romancier ou grand dramaturge, acquiert une importance sociale et politique, une autonomie critique, le nombre des beaux-esprits ne cesse de s'accroître, une opinion publique se constitue. Puis vint, sous la plume sans concession des "satiristes" un certain reflux, moquant les excès de ce nouvel esprit brassant avec vanité une intellectualité sans consistance, la nouvelle structure politique, la monarchie constitutionnelle, l'évolution économique, sociale et financière britannique se chargeant de liquider cette première période...
Depuis la Révolution de 1688, en Angleterre, le souverain ne tenait plus en effet de sa naissance seule son autorité absolue et indiscutable, mais d'une "opinion publique", le parti Jacobite était là, par exemple, guettant avec passion le moment où un désaccord se produirait entre le monarque et ses soutiens: le Bill of Rights anglais de 1689 avait ouvert la voie à une monarchie constitutionnelle. Dès lors, on vit le roi choisir des ministres ayant l'oreille du Parlement, de leur côté, les ministres chercher des appuis pour leurs idées et leur administration : on ne put désormais négliger d'attirer à soi les écrivains, qui avaient si bien montré de quel poids leur plume pouvait être dans la balance politique, et dont le développement de la presse grandissait chaque jour l'importance.
C'est alors qu'en Angleterre, la littérature, ou du moins ce qu'on s'en représentait, sembla mener à la fortune et aux dignités, et les exemples abondent en ce premier tiers du XVIIIe siècle, on est poète, écrivain, dramaturge, qu'importe l'importance de l'oeuvre, elle ouvre la voie à quelque titre politique ou de fonction : Nicholas Rowe (1674-1718) fut poète-lauréat, mais aussi arpenteur de la douane dans le port de Londres et greffier du conseil du prince de Galles, Eustace Budgell (1686-1737) fut en Irlande premier secrétaire des Lords Juges, attaché au Conseil du royaume, membre du Parlement et contrôleur du revenu, George Granville (1666-1735) fut membre de la Chambre des communes, chevalier du comté de Cornwall, ministre de la guerre, élevé à la pairie avec le titre de Lord Lansdowne, William Congreve (1670-1729) fut, dès après sa première comédie, vingt quatre ans à peine accomplis , nommé commissaire des autorisations de voitures publiques et de débits de vin, eut de plus un emploi au Trésor et un à la Douane, et à l'avènement de la maison de Hanovre fut nommé secrétaire de la Jamaïque; Daniel Defoe (1660-1731) eut un emploi auprès des commissaires de l'impôt sur le verre et fut chargé de diverses missions politiques, et si Swift n'avait pas écrit le Conte du Tonneau et qualifié de façon irrévérencieuse les cheveux rouges de la duchesse de Somerset, aurait nommé Doyen de l'église de Saint-Patrick...
Ecrire ne fut plus un métier, mais une carrière, une carrière qui conduisait aux honneurs et à la richesse, l'écrivain ne forme plus une classe à part, il pénètre dans la haute société, non plus en protégé, mais sur un pied d'égalité avec les plus grands, "ce qui encourage le plus les gens de lettres en Angleterre, écrira Voltaire dans ses Lettres philosophiques, c'est la considération où ils sont..." L'intimité de Gongreve avec la fille de Marlborough est restée célèbre. Addison épousa la comtesse douairière de Warwick. Dans le fameux Kitcat club (1705), on vit siéger, à côté de nobles politiques comme les comtes de Dorset et de Sunderland, comme les ducs de Somerset et de Newcastle, comme Marlborough, de simples écrivains comme Vanbrugh, Gongreve, Addison, Locke, Garth, Steele, Maynwaring, Stepney, Walsh. Dans le Scriblerus Club (1714), Swift, Arbuthnot, Gay, côtoyaient familièrement Harley et Bolingbroke. Partout les auteurs se trouvèrent introduits et reçus, sans avoir comme autrefois à s'amoindrir et à s'humilier..
Et il s'ensuivit que la littérature fit des recrues plus nombreuses que jamais. Elle ne fut plus seulement l'amusement des riches désœuvrés, le refuge des déclassés de la fortune, ou le rêve des jeunes gens enthousiastes. Du jour où elle offrit à ses adeptes, non pas une gloire douteuse, mais la fortune presque assurée, du jour où l'on put être écrivain, non seulement sans déchoir, mais encore avec de grandes chances de s'élever, écrire devint l'objectif de quiconque se sentit en état de manier une plume. Aucun homme de talent, ou supposé tel, ne put plus hésiter à entrer en lice.
Certes, si d'autres époques des lettres anglaises peuvent citer des noms plus importants que celle-ci, aucune ne peut montrer un tel nombre de talents dans tous les genres. Mais de fil en aiguille, l'humaine nature aidant, élevés aux yeux des autres par la place qu'on leur faisait dans la société, les écrivains purent acquérir, certes, et se tenir à des opinions personnelles, mais contractèrent une présomption croissante vite dénoncée par un Swift ou un Addison...

Joseph Addison affirmera que sa génération surpassait les anciens dans "Doggerel, Humour, Burlesque, and all the trivial Arts of Ridicule". Nous rencontrons, dit-il, " plus de raillerie chez les Modernes, mais plus de bon sens chez les Anciens" (We meet with more Raillery among the Moderns, but more Good Sense among the Ancients). A la même époque, toute la France, nous dit-on, fourmiller de gens qui ont de l’Esprit, mais qui n’ont que de l’Esprit. En Angleterre, la génération précédente avait été celle de la "dignité", la dignité de la cour de Louis XIV, introduite en Angleterre à la Restauration, lorsque, "in ev'ry taste of foreign courts improv'd" (dans tous les goûts des cours étrangères), la Grande-Bretagne devint "to soft refinements less a foe" (moins ennemie des doux raffinements doux) ; une dignité symbolisée par la perruque flottante avec ses boucles luxuriantes, et exprimée par Dryden, lorsqu'en 1700 il parla de Chaucer comme d'un "a rough diamond", qui "must first be polished e'er he shines" (être poli avant de briller).
Mais cette dignité était tant devenue pompeuse et oppressante que bien des jeunes esprits se révoltèrent, un Gay a écrit "Trivia" (1716), mais il n'était pas un satiriste. Au contraire de Swift, essentiellement un pamphlétaire, un satiriste qui, tout au long de son oeuvre et de sa vie se dégage peu à peu des contingences historiques, pour atteindre à la profondeur douloureuse et à la grandeur d`un témoignage intime à l'encontre de notre humanité. Conscient de ses contradictions intimes, Swift se voulait homme libre et combattit, dans la société qui l`entourait, les hommes et les faits dans lesquels il retrouvait une incohérence à laquelle, toute sa vie, il s`efforça d'échapper. Mais, rejetant toute métaphysique, insatisfait et pourtant rivé à sa condition, il ne parvint qu'à exprimer une amertume cinglante, une allégresse désenchantée, une lucidité désespérée, annonçant, diront certains, l'ironie et le tragique d'un Nietzsche...

En 1711, "The Spectator" se substitua au "Tatler", créé par Richard Steele, qui dura deux ans et auquel collabora Joseph Addison. Avec un tirage d'environ 3 000 exemplaires, The Spectator connut un grand succès, Addison estima que chaque numéro était lu par 60 000 Londoniens, soit le dixième de la population de la capitale à cette époque. Un des motifs assignés à la disparition du "Tatler" était le manque de matière : vint "The Spectator", une simple demi-feuille que l'on promettait quotidien et truffé d'esprit et d'humour, on y trouvait l'image d'une vertu aussi riante qu'aimable et tournant le vice en ridicule. Les auteurs ne se souciaient guère d'être dans le ton de l'époque, "Polite and Gallant", et toute une nouvelle façon de penser vint ainsi à gagner nombre d'esprit, le simple bon sens...
"... Bickerstaff ventur'd to tell theTown, that they were a parcel of Fops, Fools and vain Cocquets ; but in such a manner, as even pleased them, and made them more than half enclin'd to believe that he spoke Truth.
Instead of complying with the false Sentiments, or Vicious tasts of the Age, either in Morality, Criticism, or Good Breeding, he has boldly assur'd them, that they were altogether in the wrong, and commanded them, with an Authority, which perfectly well became him, to surrender themselves to his Arguments, for Vertue and good Sense.
'Tis incredible to conceive the effect his Writings have had on the Town; How many Thousand follies they have either quite banish'd, or given a very great check to ; how much Countenance they have added to Vertue and Religion; how many People they have render'd happy, by shewing them it was their own fault if they were not so; and lastly, how intirely they have convinc'd our Fops and Young Fellows of the value and advantagcs of Learning.
He has indeed rescued it out of the hands of Pedants and Fools, and discover'd the true method of making it amiable and lovely to all mankind : In the dress he gives it, 'tis a most welcome guest at Tea-Tables and Assemblies, and is relish'd and caressed by the Merchants on the Change;...
Lastly, His Writings have set all our Wits and Men of Letters upon a new way of Thinking, of which they had little or no Notion before ; and tho' we cannot yet say that any of them have come up to the Beauties of the Original, I think we may venture to affirm, that every one of them Writes and Thinks much more justly than they did some time since...
You may remember I told you before that one Cause assign'd for the laying down the "Tatler" was want of Matter; and, indeed this was the prevailing Opinion in Town, when we were Surpris'd all at once by a Paper called "The Spectator", which was promised to be continued every day, and was writ in so excellent a Stile, with so nice a Judgment, and such a noble profusion of Wit and Humour, that it was not difficult to determine it could come from no other hands but Ihose which had penn'd the Lucubrations...
Mean while, "The Spectator"... is in every one's Hand, and a constant Topic for our Morning Conversation at Tea-Tables and Coffee-Houses. We had at first, indeed, no manner of Notion how a "Diurnal Paper" could be continu'd in the Spirit and Stile of our present "Spectators"; but to our no small Surprise, we find them still rising upon us, and can only wonder from whence so Prodigious a Run of Wit and Learning can procced; since some of our best Judges seem to think that they have hitherto, in generai, out-shone even the Esquires first "Tatlers". Most People Fancy, from their frequency, that they must be compos'd by a Society ; I, with all, Assign the first Places to Mr. Steele and His Friend..."
(Gay (?), The Présent State of Wit, signé J. G.).
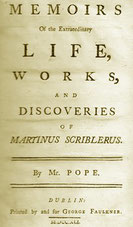
1713-1714, "The Memoirs of Martin Scriblerus"..
Le Scriblerus Club, club littéraire britannique du XVIIIe siècle et point culminant de la satire du siècle et d'influence sur Henry Fielding et Laurence Sterne, eut pour membres fondateurs Alexander Pope, Jonathan Swift, John Gay, Thomas Parnell et John Arbuthnot. Aux "temps heureux" de l'ascension des whigs et de la commercialisation croissante de la littérature et de l'érudition, ces cinq écrivains ont non seulement, via leurs célèbres réunions de mars-avril 1714 qui se poursuivirent en correspondances assidues, participaient activement à l'élaboration de chefs d'oeuvre de l'époque, tels que "Gulliver's Travels" (1726), "The Beggar's Opera" (1728) et "The Dunciad " (1729), mais encore plus directement collaboré aux fameuses "Mémoires de Martinus Scriblerus" ("The Memoirs of Martin Scriblerus") dès 1713 : une oeuvre qui a donné lieu à bien des rencontres fréquentes et animées lorsqu'ils étaient tous à Londres. Le nom Martin était tiré du personnage comique de John Dryden, Sir Martin Mar-all, dont le nom était devenu synonyme d'erreur absurde (Scriblerus était une référence au scribler, terme contemporain de mépris pour un écrivain sans talent). Leur but était de ridiculiser l'érudition prétentieuse et le jargon savant à travers la personne d'un pirate littéraire fictif, Martinus Scriblerus, de ridiculiser tous les faux goûts en matière d'apprentissage, sous la forme d'un homme assez doué qui s'était plongé dans tous les arts et toutes les sciences, mais sans discernement, représentatif de cette tranche d'époque. Des cinq, seuls Pope et Swift ont vécu pour voir la publication des Mémoires (1741), bien que diverses pièces mineures écrites en collaboration ou individuellement aient paru auparavant sous le nom de Scriblerus. Swift en écrivit un abrégé, "Memoirs of the Lif of Scriblerus, a jeu d'esprit". Bien que l'on attribue à Pope l'origine du personnage de Scriblerus, la plupart des idées étaient celles d'Arbuthnot, et il était le plus assidu des collaborateurs. La stimulation que les membres ont tirée les uns des autres a eu des effets d'une grande portée.
Nombre d'oeuvres jaillirent de ce creuset littéraire si prompt à bousculer ces quelques 9000 beaux-esprits et libres-penseurs qui s'installent dans le paysage littéraire du royaume. "The Beggar's Opera" de Gay est né d'une suggestion faite par Swift au Scriblerus Club, et l'empreinte du Scriblerus sur les "Voyages de Gulliver" de Swift, en particulier le livre III, qui décrit le voyage à Laputa, est indéniable. D'autres conservateurs éminents, tels que Robert Harley, premier comte d'Oxford, et Henry St. John, premier vicomte de Bolingbroke, étaient membres du club.
Jonathan Swift (1667-1745) avait déjà créé des personnages satiriques avant la création du Scriblerus Club (notamment dans A Tale of a Tub, 1704) et continuera à le faire longtemps après sa disparition (par exemple, M. B. Drapier, auteur supposé de The Drapier's Letters, 1724, et Simon Wagstaff, projecteur de Polite Conversation, 1738).
Le poète et ecclésiastique Thomas Parnell (1679-1718), protégé de Swift et, comme lui, un ancien whig, venu d'Irlande en Angleterre après la mort de sa femme, contribua avec enthousiasme aux collaborations scribles, travaillant particulièrement étroitement avec Pope. Son ouvrage intitulé "Homer's Battle of the Frogs and Mice, with the Remarks of Zoilus, to which is Prefix'd, the Life of the said Zoilus" (1717) rassemble plusieurs éléments typiquement scribleriens, des vers héroïques factices, des commentaires savants factices et la défense de l'œuvre d'un confrère (dans ce cas, l'Homère de Pope).

Le médecin royal John Arbuthnot (1667-1735), écossais, des médecins attitrés de la reine Anne Stuart jusqu’à la mort de cette dernière et proche de Swift et d'Oxford, était une figure centrale du groupe, apportant une inventivité rapide dans des domaines allant de la politique à l'érudition classique, en passant par les sujets scientifiques et médicaux, et guide spirituel reconnu des Memoirs of Martinus Scriblerus. Il publia cinq pamphlets, dont le premier paraît en 1712, réunis en un seul volume en 1727 sous le titre "Law is a Bottom-less Pit... " (La loi est un puits sans fond...), des satires publiées à nouveau par Swift et Pope sous le titre "The History of John Bull" (Le Procès sans fin), une œuvre qui trace pour la première fois le portrait du personnage de John Bull, un symbole de la Grande-Bretagne.

John Gay (1685-1732), qui collaborait avec Pope depuis 1711 environ, était déjà rompu à la farce et à la parodie à l'époque des réunions documentées du club. Il soutient Pope contre Ambrose Philips dans" The Shepherd's Week" (1714) ; et une fois rentré de Hanovre, il produit la farce satirique et tragique "The What d'ye Call It" (1715), la farce "Georgic Trivia" (1716) et la farce satirique "Three Hours after Marriage" (1717), avec Pope et Arbuthnot. Son chef-d'œuvre, "The Beggar's Opera" (1728),

C'est Alexander Pope (1688-1744) qui fut le membre le plus actif du Scriblerus Club, ayant survécu le plus longtemps, il a le plus contribué à façonner l'image du club pour la postérité.
"The bliss of man - could pride that blessing find - Is not to act or think beyond mankind ; No pow'rs of body or of soul to share, But what his nature and his state can bear" (Le bonheur de l'homme, si l'orgueil ne s'abusait point, n'est pas de penser ou d'agir au delà de l'homme; d'avoir des facultés de corps & d'esprit au delà de ce qui convient à sa nature & à son état).
Le plus grand poète classique anglais, poète des salons, de la ville et de la vie sociale, a dû toujours vivre en marge de la société et en dehors de Londres. Il était en effet catholique et en tant que tel exclu de la vie de la capitale. Pope est une personnalité très discutée ; certains voient en lui un infirme hypocrite et méchant, d'autres insistent sur ses amitiés durables, son stoïcisme devant la douleur et les épreuves de la vie. Comme son ami Swift, il aime plus les hommes que l'humanité, mais ses lettres révèlent un homme plus indigné par la sottise vaniteuse de certains que par l'humaine condition. Une lecture attentive fera reconnaître en lui un sentimentaliste, disciple de Shaftesbury. Sa position catholique explique un certain scepticisme narquois, doublé de tolérance. Si la rébellion contre la société et contre les formules littéraires consacrées constitue l'essence même du romantisme, Pope est bien le représentant parfait du classicisme anglais. C'est le poète horatien par excellence, en accord total avec les règles sociales et les idées esthétiques de son époque ; accord qui apparaît dans tous les aspects de cette œuvre très riche et très diverse.
La poésie de Pope, très intellectualisée, est un régal pour l'esprit ; poésie d'équilibre et de sérénité, elle est animée par une imagination disciplinée mais ardente et vive. Artiste complet et conscient, subtil et viril à la fois, Pope est un modèle de délicatesse et d'honnêteté intellectuelle. Nul n'a eu plus que lui conscience de la dignité élevée du poète, et de son rôle dans la cité, nul non plus que lui n'eut le désir d'atteindre la parfaite union des idées claires et lucides avec une forme poétique obéissant à des règles sévères mais sachant aussi admettre librement et hardiment variations et arabesques.
Né à Londres, fils de commerçants fortunés, il vit une enfance chétive près de Windsor ; petit, bossu, il est atteint du mal de Pott. Appliqué, studieux, grand travailleur, à seize ans il écrit des Pastorales qui le lancent dans le monde littéraire. Encouragé par le spirituel Wycherly et l'exigeant Walsh, il fait déjà preuve d'invention et de rigueur. Son "Essay on Criticism" (1711) le fait pénétrer dans le cercle de Joseph Addison, le fondateur avec Richard Steele du magazine The Spectator en 1711, et de ceux qui fréquentent le célèbre café Will's.
Sa vie ne sera dès lors qu'une suite de succès entrecoupée de violentes querelles avec ses confrères rivaux. Après "The Rape of the Lock" (1712-1714, La Boucle de cheveux volée), poème héroï-comique sur la vie des salons, il se met à la grande œuvre de sa vie, la traduction d'Homère. L'Iliade paraît de 1715 à 1721, L'Odyssée de 1725 à 1726. Tory, à cause de son catholicisme, il s'éloigne du whig Addison après avoir malmené certains de ses amis, auteurs, comme lui, de «pastorales». Il se rapproche de Swift.
Le Scribblerus Club est fondé, publiant de nombreux pamphlets satiriques collectifs (1712-1726) dirigés contre les ennemis politiques et littéraires du clan. Pope fut donc soutenu pendant sa traduction d'Homère contre les éditeurs rivaux, les confrères jaloux comme Dennis, et même les critiques trop honnêtes, comme Theobald, éditeur de Shakespeare et héros de sa première grande satire, "The Dunciad" (1728-1743). C'est une épopée héroï-comique, dirigée d'abord contre Theobald, puis contre Colley Cibber, whig et « poète-lauréat ». Après cela, Pope met en vers les doctrines de Bolingbroke et de Shaftesbury, c'est l' "Essay on Man et Moral Essay" (1733-1734). Puis il se tourne vers les Epîtres et les Satires à la manière d'Horace, de Swift et de Donne (1733-1758). Il passe la fin de sa vie à mettre au point sa correspondance tout en feignant de s'indigner de la voir publiée contre son gré. Il meurt à Twickenham...
1711-1712 - The Spectator - Deux éditions, quotidienne et en volume, chacune de ces deux éditions comprenait près de 10 000 exemplaires, et avant que le Spectateur eût cessé de paraître comme journal, on avait déjà vendu plus de 9000 exemplaires des quatre premiers volumes. Le Spectateur était encore tenu d'être court et d'offrir la lecture à petites doses. Mais insensiblement, et sans qu'ils en aient conscience, l'esprit des lecteurs, à lire les témoignages de l'époque, semblait se fortifier, leur goût se former, leur intelligence s'éclairer. Les œuvres les plus solides de la littérature anglaise étaient rééditées et lues : on se reprend à lire Milton et Shakspeare. Bientôt les Magazines vont succéder aux journaux d'essais, mais sans les supprimer; les uns et les autres vivront de longues années côte à côte.
Enfin le roman, non plus le roman romanesque, mais le roman de mœurs, va naître en 1719 avec "Robinson Crusoe" et se développer Defoe, Richardson, Fielding et Smollett. Une certaine culture générale ainsi s'est répandue, et ce à travers toutes les classes de la société. Il n'est plus question de groupes divers de lecteurs, de Puritains et de Cavaliers, de la Cour et de la Cité, de la capitale et de la province : les lecteurs sont maintenant toute l'Angleterre....
En un mot, les écrivains ont désormais en face d'eux un public, c'est-à-dire des lecteurs assez nombreux pour qu'ils puissent déjà compter sur eux, et assez éclairés pour que tous les genres de composition aient chance d'être par eux accueillis et achetés. Mais qu'en est-il des écrivains eux-mêmes ? Swift ne songea jamais à sa gloire littéraire, il ne mit son nom dans aucun de ses ouvrages et n'utilisa en fin de compte son talent que pour tenter d'arracher un évêché qu'il n'obtint jamais. Voltaire face à Congreve qu'il rencontre note cette opposition entre l'écrivain gentilhomme et l'homme de lettres. Steele se vit enlever la direction du théâtre de Drury Lane et avait déjà, avec Addison, été dépossédé de ses places à l'arrivée au pouvoir de Harley et de Bolingbroke, en 1710 l'un des premiers rédacteurs du journal Examiner, lancé par les tories pour contrer la presse du parti whig, où écrivait aussi le poète et diplomate Matthew Prior (1664-1721). Un Bolingbroke qui perdit tout à la mort de la reine Anne (1714) et fut même proscrit par le Parlement et dépouillé de tous ses biens et se réfugia en France. Gay, qui avait mis ses espérances dans le parti tory, perdit ses fonctions de secrétaire et toute chance de promotion sérieuse quand de même la reine Anne mourut. Prior, à l'avènement de George Ier, fut accusé de trahison, emprisonné, et ne retint plus de ses riches appointements que son mince traitement de fellow de Cambridge, tandis que Swift, demandait en vain à la politique de le faire évêque.
Puis vint au pouvoir Robert Walpole, en 1721, dominant sans aucun scrupules la vie politique anglaise jusqu'en 1742, et avec lui cessa d'un coup la protection de l'écrivain accordée par les hommes d'Etat.. George Ier (1714-1727), étranger dans son propre royaume, ne savait pas un mot d'anglais, - Walpole communiquait avec lui en un espèce de latin de cuisine -, et George II (1727-1760) ne dissimulait pas son mépris pour la "beinture" et la boésie". Les auteurs se retrouvèrent ainsi soudainement déchus de leur grandeur et de leur prospérité. La seule ressource qui leur restât était de se mettre à la tâche et d'écrire pour les éditeurs, mais la profession d'éditeur était encore à ses débuts, peu développée, ne disposant que de maigres capitaux. Et pour surcroît de malheur, le nombre des auteurs s'était tellement accru que ce fut une véritable foule déçue et besogneuse qui se disputa les travaux de librairie, en assiégeant d'offres de services revues et magazines, Smollett (Humphrey Clinker) et Fielding mettront en scène quelques-uns de ses personnages. Samuel Johnson, à ses débuts dans la littérature, passe ses nuits à errer dans les rues de Londres, faute de logement. Et le peintre Hogarth représentera dans un tableau célèbre un poète installé dans un misérable taudis (The Distressed Poet), travaillant dans sa robe de chambre, pendant que sa femme raccommode son unique culotte, et interrompu par la réclamation d'un créancier ....
Dans "Humphrey Clinker", Tobias Smollett mettra en scène en 1771 une collection d'auteurs qui semblent bien être représentés d'après nature : le philosophe de la bande, qui a été chassé de l'Université pour athéisme, et poursuivi pour avoir blasphémé le dimanche dans un cabaret, entreprend de combattre les ouvrages métaphysiques de Bolingbroke; un Ecossais enseigne la prononciation anglaise; un Piémontais écrit une satire sur les poètes anglais; un cockney, atteint d'hypochondrie, et qui confond le maïs avec le riz, compose un traité d'agriculture pratique. Un Irlandais publie une brochure en faveur d'un ministre, dans l'espérance d'en recevoir quelque témoignage de gratitude; déçu dans cette espérance, il fait passer sa brochure comme étant l'œuvre du ministre lui-même, et en écrit une réfutation en règle. Un autre, qui n'a jamais bougé hors des limites privilégiées où les débiteurs de ce temps étaient à l'abri des recors, compose un récit de ses voyages en Europe et en Asie...

Alexander Pope (1688-1744) est sans doute l'un des seuls auteurs qui parviendra à s'imposer dans ce nouveau contexte (cf. Alexander Pope, vers 1727, par Michael Dahl). Dès ses premiers succès littéraires, il avait été accueilli dans la société la plus distinguée de Londres, et il avait vite compté parmi ses amis, non seulement des littérateurs comme Walsh, Congreve, Granville, Garth, Swift, Steele, Addison, Gay, Arbulhnot, Parnell, mais des hommes d'État comme Harley, Bolingbroke, Halifax, Somers, Craggs. Ses amis littérateurs, aussi bien que ses amis hommes d'Etat, étaient tous rangés sous des bannières politiques. A quel parti Pope s'alliait-il? Etait-il whig? Etait-il tory '? Comme catholique, les tories le considéraient d'avance comme un des leurs, et à la fin de son poème sur la Forêt de Windsor, il y avait à l'éloge de la paix des vers qui étaient faits pour leur plaire. Mais il avait écrit pour le Caton d'Addison un prologue que les whigs avaient applaudi avec enthousiasme; et le Spectateur et le Guardian, dirigés par deux whigs, avaient accueilli ses vers et sa prose.
Puis fut publié en 1713 la traduction de l'Iliade, une œuvre considérable, depuis longtemps annoncée, et à laquelle toute l'Angleterre lettrée s'intéressait. Et pour la première fois, Pope rompit de façon éclatante la longue tradition des dédicaces politiques en s'adressant à un de ses confrères, William Congreve. "Les whigs disent que Bolingbroke est le héros de votre préface, lui écrivit Jervas. Songez à introduire Walpole dans la prochaine, pour maintenir en équilibre la balance du pouvoir". Et c'est encore Pope qui écrivit à Swift en 1726 :
"Sûrement, sans flatterie, vous êtes maintenant au-dessus de tous les partis, et il est grand temps que vous soyez, après avoir vingt ou trente ans observé le monde,
Nullius addictus jurare in verba magistri.
Je ne doute pas que beaucoup de gens ne soient disposés à être dans votre intimité pour que vous soyez dans leurs intérêts; mais que le ciel préserve un honnête homme ou un homme d'esprit d'être d'aucun parti, si ce n'est de celui de son pays. Ils ont assez de coquins pour écrire pour leurs passions et pour leurs desseins : écrivons pour l'honneur et pour la postérité."
Et Pope, au-delà d'une certaine ambiguïté et de nombre d'accusation dont il fut l'objet, tint hors de toute portée et loua à long bail une maison aux environs de Londres, à Twickenham, sur les bords de la Tamise, s'y installa, vivant chez lui en propriétaire, embellissant son jardin, travaillant à son aise, recevant ses amis, soignant pieusement sa vieille mère, et s'écriant avec fierté : «Grâce à Homère, je vis et je suis heureux, sans rien devoir à aucun prince ni à aucun grand seigneur au monde» (1729)...
Vingt ans plus tard; dans 'The Rambler", périodique fondé par Samuel Johnson et qui paraissait tous les mardis et samedis de 1750 à 1752, celui-ci écrivit avec solennité : "Les sciences, après mille indignités, se retirèrent du palais du patronage; et, ayant longtemps erré par le monde dans la douleur et la détresse, furent enfin conduites à la chaumière de l'indépendance, fille de la force d'âme, où elles apprirent de la prudence et de la parcimonie à se suffire à elles-mêmes dans la dignité et le calme.."
1725, date décisive dans l'évolution des lettres et de la pensée anglaises...
En 1726 parurent les Voyages de Gulliver. À première lecture, on est émerveillé par l'ingéniosité, l'allégresse et la transparence du propos soutenu par des images quasi mystiques de Swift : un Gulliver enchaîné par la foule des nains sur la plage de Liliput, transformé en poupée par la jeune géante de Brobdingnag, surpris par les vêtements géométriques des savants fous de Laputa, fuyant le désir des ignobles femelles Yahoos auprès de son maître cheval. La seconde lecture inquiète : il n'y a place que pour l'indignation et la honte. Ainsi la conclusion du discours sur l'Angleterre exprimant les opinions du roi philosophe, du bon géant qui règne à Brobdingnag. «Il ne me paraît pas même, par tout ce que vous m'avez dit, qu'une seule vertu soit requise pour parvenir à aucun rang ou à aucune charge parmi vous. Je vois que les hommes ne sont point ennoblis par leur vertu, que les prêtres n'y sont point avancés par leur piété ou leur science, les soldats par leur conduite ou leur valeur, les juges par leur intégrité, les sénateurs par l'amour de leur patrie, ni les hommes d'état par leur sagesse... par les réponses que je vous ai obligé de faire à mes objections, je juge que la plupart de vos compatriotes sont la plus pernicieuse race d'insectes que la nature ait jamais souffert de ramper sur la surface de la terre » (Voyage à Brobdingnag chap. iv, fin).
Quelques mois auparavant, Swift, l'auteur de ce voyage imaginaire, écrivait à Pope, le 29 septembre 1725 : « Quand vous penserez à la société, donnez-lui encore un coup de garcette pour me faire plaisir. J'ai toujours détesté toutes les nations, les professions et les communautés et mon affection se reporte toute sur des personnes isolées. » Il y a là une exagération évidente, mais elle diffère peu de celle qui fait le fond de la philosophie de Bernard Mandeville, quand il soutient vers la même époque que le vice est inséparable de l'état social et que les excès des particuliers contribuent à la prospérité générale. Dans son quatrième voyage, Gulliver pleure de se voir refuser l'adoption par les Houyhnhnms, ces chevaux dotés de raison qui n'ont que mépris pour les Yahoos, ces bêtes brutes à forme humaine. Le désir de transparence et de rationalité débouche sur la haine des miroirs et de soi : l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Gay porte un jugement non moins sévère sur la dégradation des mœurs. Dans son Opéra des Gueux (1728), il fait un éloge ironique de la racaille et la suite qu'il écrivit sous le titre de Polly, et que le Gouvernement crut devoir interdire, contient d'amères railleries à l'adresse de ses concitoyens. Si la littérature est le miroir fidèle d'une époque, le tableau qu'elle présente ici paraît plutôt sombre.
Et la réalité rejoint la fiction. C'est en 1731 que mourut le colonel Francis Chartres (Works, Pope, moral essays ep.III, v20), qui réunit en sa personne tous les vices imaginables et n'en parvint pas moins à la fortune par l'usure et des spéculations malhonnêtes. Sans rechercher des exemples célèbres et aussi éclatants, il est facile d'en trouver d'aussi réels dans l'entourage même de nos écrivains. George Bubb Dodington, pour citer l'un de ses Mécènes, est le type accompli du parlementaire véreux qui trafique de ses votes avec une sérénité et une inconscience parfaites. Ses mœurs étaient plutôt respectables, suivant les idées du jour, puisqu'il reconnut sa liaison avec Miss Belian, si même il n'épousa pas la dame. C'est sa carrière politique qui est surtout édifiante. Il fait d'abord la cour à Robert Walpole et le quitte pour le Prince de Galles. Il s'attache ensuite au duc d'Argyll pour revenir au prince en 1739. Puis il se laisse gagner par le ministre Pelbam afin d'obtenir un poste lucratif. En 1749 un nouveau revirement le ramène auprès de l'héritier du trône dont la mort renverse ses projets. Il cherche alors fortune en 1755 sous le patronage du duc de Newcastle, tout en s'attachant à demeurer en bons termes avec la princesse douairière de Galles. L'influence de Pitt lui enlève sa parcelle de pouvoir et il reste sans place jusqu'à l'avènement de George III. A ce moment il se met en faveur auprès de Lord Bute et conquiert la pairie en 1761 pour mourir le 28 juillet comme Lord Melcombe.
Ecrivain exilé, qui fut bâtonné et embastillé en France, Voltaire acquiert entre 1726 et 1729, en Angleterre, le sens de l'œuvre philosophique, essai ou pamphlet, et découvre l'efficacité sociale de l'humour. Il va en effet s'initier tour à tour aux libertés parlementaires auprès de Bolingbroke, lord Peterborough, Walpole, aux bienfaits du commerce et de l'industrie auprès du négociant Falkener, étudier les sectes religieuses et fréquenter des libres penseurs, s'entretenir avec Swift, l'auteur de Gulliver, qui publie un journal satirique, avec les poètes Pope, Gay, Young, avec les philosophes Berkeley et Clarke. Il va admirer Locke et Newton et applaudir les drames de Shakespeare. Voir ses différentes Lettres Anglaises publiées en 1734 qui livrent à la littérature française une expérience capitale...


Jonathan Swift (1667-1645)
"La vie de vie de Swift est, écrit Walter Scott, un sujet plein d'intérêt et d'instruction pour tous ceux qui aiment à méditer sur les vicissitudes dont se compose la destinée des hommes célèbres par leurs talents et par leur renommée. Dénué de toutes ressources à sa naissance , élevé par la froide et insouciante charité de deux oncles , privé des honneurs universitaires, réduit pendant plusieurs années au patronage impuissant de sir William Temple, les premières pages de l'histoire de Swift offrent le tableau du génie humilié et trompé dans ses espérances. Malgré tous ces désavantages, il parvint à être le conseil d'un ministère britannique, le plus habile défenseur de son système d'administration, et l'intime ami de tous les hommes remarquables par leur noblesse ou leurs talents sous le règne classique de la reine Anne.
Les événements de ses dernières années présentent un contraste non moins frappant. Enveloppé dans la disgrâce de ses patrons , il fut persécuté , s'exila de l'Angleterre , vécut séparé de ses amis, et puis tout a coup acquit un degré de popularité qui le rendit l'idole de l'Irlande, et l 'effroi de ceux qui, gouvernaient ce royaume.
Sa vie privée n'est pas moins extraordinaire. Il aima deux des plus belles et des plus intéressantes femmes du temps ,et il en fut tendrement aimé; mais il était dans sa destinée de ne jamais former avec aucune d'elles une union heureuse et paisible, et il les vit successivement descendre au tombeau avec la conviction que leur maladie mortelle avait pour cause la douleur de leur espérances déçues, et une affection mal récompensée.
Les talents de Swift, source de sa renommée et de son orgueil, dont l'éclat avait si longtemps ébloui et charmé le monde, furent obscurcis par la maladie, pervertis par les passions à mesure qu'il approcha du terme de sa vie, et avant qu'il l'eût atteint, ils étaient bien au-dessous de ceux des hommes les plus ordinaires.
La vie de Swift est donc une leçon importante pour les hommes célèbres; elle leur enseignera que , si le génie ne doit pas se laisser accabler parle malheur , la renommée, quelque grande qu'elle soit, ne doit pas encourager la présomption. En lisant l'histoire de cet homme illustre , ceux que le sort a privés des brillantes qualités dont il était doué , ou qui ont manqué l'occasion de les développer , se convaincront que le bonheur ne dépend ni d'une influence politique ni d'une grande gloire.
Jonathan Swift, docteur en théologie, et doyen de Saint-Patrick de Dublin , descendait d'une branche cadette de la famille des Swift, du comté d'York, qui était établie dans cette province depuis bien des années. Le grand-père du doyen, le révérend Thomas Swift , était vicaire de Goodrich, dans le comté de Hereford, et avait une petite propriété dans les environs. Au commencement des guerres civiles, il se distingua par son zèle et par son activité pour la cause de Charles Ier. Ses exploits et ses malheurs à cette époque, sont consignés dans un mémoire même du doyen...." (Mémoires politiques et littéraires sur la vie et les ouvrages de Jonathan Swift, by Scott, Walter, 1828).
Bien qu'on ait longtemps montré à Dublin la maison où naquit Swift, bien qu'il ait passé la plus grande partie de sa vie en Irlande et y soit devenu populaire, Swift n'avait rien d'Irlandais. Son grand-père, vicaire de l'Église anglicane, dans le comté d'Hereford et tout dévoué à la cause royale pendant les guerres civiles, avait eu quatorze enfants. L'aîné de ses dix fils, Godwin, nommé procureur-général en Irlande, y avait attiré quatre de ses frères. L'un deux, Jonathan, s'était marié dans le comté de Leicester. Il amena sa femme à Dublin, et après deux ans de mariage, y mourut au mois d'avril de l'année 1667. Le 30 novembre de la même année, sa veuve, déjà mère d'une fille, mit au monde Jonathan Swift. Orphelin de père, élevé dans la misère, humilié par la charité de son oncle Godwin, à l’âge de six ans , on l’envoya à l’école de Kilkenny. A quatorze ans il entrait à l'université de Dublin et ne parla jamais qu'avec ressentiment de ces longues années de collège et des épreuves qu'y subit son orgueil. Rien ne relevait sa situation parmi ses condisciples. Il alla jusqu'à haïr les exercices du collège et particulièrement ceux auxquels ses maîtres attachaient le plus d'importance. Il garda contre la logique et surtout contre les commentateurs d'Aristote, une rancune qui a laissé dans ses écrits des traces nombreuses et impérissables.
Dans l'Ile des sorciers, Gulliver obtient de son hôte l'évocation et l'entretien des morts les plus illustres : "Je demandai, dit-il, que l'on fît apparaître Homère et Aristote à la tête de tous leurs commentateurs; mais ceux-ci étaient si nombreux qu'il y en eut plusieurs centaines qui furent obligés d'attendre dans les antichambres et dans les cours du palais. Au premier coup d'œil, je distinguai ces deux grands hommes, non seulement de la foule, mais l'un de l'autre. Homère était plus grand et de meilleure mine qu'Aristote ; il se tenait très-droit pour son âge, et ses yeux étaient les plus vifs et les plus perçants que j'eusse jamais vus. Aristote se courbait beaucoup et s'appuyait sur un bâton. Son visage était maigre, ses cheveux lisses et rares, sa voix creuse. Je m'aperçus bientôt qu'ils étaient l'un et l'autre parfaitement étrangers au reste delà compagnie, et n'en avaient jamais entendu parler. Un spectre, que je ne nommerai pas, me dit à l'oreille que ces commentateurs se tenaient toujours le plus loin qu'ils pouvaient de leurs auteurs dans le monde souterrain, parce qu'ils se sentaient honteux et coupables d'avoir si indignement défiguré la pensée de ces grands écrivains aux yeux de la postérité. Je présentai à Homère Didyme et Eusthathius, et je l'induisis à les traiter mieux qu'ils ne le méritaient peut-être, car il reconnut bientôt qu'ils manquaient du génie nécessaire pour pénétrer un poète. Mais Aristote perdit patience quand je lui rendis compte des travaux de Scot et de Ramus, en lui présentant ces deux savants, et il leur demanda si tout le reste de leur espèce était composé d'aussi grands sots qu'eux-mêmes."
Après avoir échoué une première fois à son examen Bachelor-of-arts , il fut reçu le 18 février 1686, et pendant toute la durée de son séjour à l'Université, fut en état de révolte contre la discipline, frappé sans cesse de punitions. Il passa encore trois années au collège, de plus en plus inquiet de l'avenir, à mesure qu'il approchait du monde, appauvri, s'il était possible, par la mort de son oncle Godwin, secouru par un autre oncle, William. En 1688, il quitta le collège et l'Irlande, et vint à Leicester où la pauvreté de sa mère l'aigrit un peu plus davantage. Mais elle l'encouragea à chercher fortune du côté du célèbre sir William Temple, qui avait épousé une de ses parentes.
William Temple (1628-1699), d'origine irlandaise, homme de lettres, poète et penseur politique, fut l'un des plus éminents serviteurs de la Couronne anglaise à l'époque de la Restauration. Il avait été diplomate habile entre 1665 et 1678, qui, via à une série de missions sur le continent européen, avait été chargé de contrecarrer certains des plus ambitieux desseins de Louis XIV et avait été ainsi en 1668, l'artisan de la Triple-Alliance rassemblant les Provinces-Unies, la Suède et l'Angleterre. Homme politique, il avait tenté, entre 1679 et 1681, de réaliser l'impossible réconciliation des whigs et des tories et a persuadé Charles II de créer, en vain, un Conseil privé de trente membres, que le roi aurait nécessairement dû consulter avant toute décision et avec lequel il aurait en fait gouverné. Homme de lettres, il se rangeait dans le camp des admirateurs du passé (Upon Ancient and Modern Learning, 1692) et avait produit après 1681, des œuvres historiques et littéraires réputées. A l'avènement de Guillaume , que William Temple avait connu en Hollande pendant les négociations de la paix de Nimègue, le vit offrir au nouveau souverain ses conseils celui-ci fit de fréquentes visites à Moor-Park, où Temple vieillissant s'abandonnait aux lettres et ne voulant se sentir ni trop loin, ni trop près de Londres. Il accueillit Swift avec bonté, le fit son secrétaire, et n'eut pas de peine à reconnaître sous cette éducation incomplète une vive et forte intelligence. Swift y acquit une formation des plus profitables, sans cesser de souffrir de sa dépendance.
En 1692. Swift se faire recevoir à Oxford Master of Arts, mais, revenu à Moor-Park, il trouve un sir Temple beaucoup plus disposé à user de ses services qu'à participer à son élévation sociale. Il prend alors le parti de le quitter et d'entrer dans l'Église, reçoit les ordres à Dublin au mois d'octobre 1694, et au mois de janvier 1695, fut nommé à la prébende de Kilroot dans le diocèse de Connor. Mais Swift ne put supporter plus d'une année la médiocrité de cette vie, et surtout cet isolement, qui lui fit toujours considérer l'Irlande comme une terre d'exil. Manquait à sir Temple autant que sir Temple lui manquait, c'est à Moor-Park, en 1696, qu'il résigna son bénéfice de Kilroot. Il ne quitta plus Temple, qui mourut le 27 janvier 1699, laissant a Swift le soin de publier une édition complète de ses œuvres. Swift publia l'édition, la dédia au roi, ne reçut aucune réponse de Guillaume, et se décida à lui adresser un mémoire dont il attendit inutilement l'effet.
Oublié du roi, sans ressources, il accepta la place de secrétaire et d'aumônier de lord Berkeley, nommé à de hautes fonctions en Irlande. Après de nouvelles déceptions et quelques démêlés avec ce nouveau maître, il obtint par son entremise le bénéfice de Laracor, dans le diocèse de Meath.

Le nom de Swift est inextricablement lié à deux femmes, la passionnée Esther Vanhomrigh ("Vanessa") et la délicate Esther Johnson ("Stella"). En 1700, Swift s'établit et jouit pour la première fois d'une certaine aisance et de la liberté. Ce fut alors qu'il attira près de lui Esther Johnson (1681-1728), l'infortunée Stella, qu'il avait connu enfant et orpheline à Moor Park: "Je l'ai connue dès l'âge de six ans, et j'ai participé à son éducation en lui indiquant les livres qu'elle devait lire, et en l'instruisant perpétuellement des principes de l'honneur et de la vertu, dont elle ne s'est jamais écartée dans aucune action ni à aucun moment de sa vie. De son enfance jusqu'à l'âge de quinze ans environ, elle fut malade, mais elle acquit ensuite une santé parfaite et fut alors considérée comme l'une des plus belles, gracieuses et agréables jeunes femmes de Londres, un peu trop grosse seulement. Ses cheveux étaient plus noirs que ceux d'un corbeau, et tous les traits de son visage étaient parfaits."
Mais pour cela, Swift devait rompre avec Esther Vanhomrigh, Vanessa, rencontrée en 1707 et qui avait 22 ans de moins que lui : sa mort en 1723 inspirera à Swift, "Cadenus and Vanessa", la plus longue de ses poésies et une justification de sa conduite. Rompre avec Stella et épouser Miss Vanhomrigh, était au-dessus de ses forces; il voyait aussi la ruine de sa réputation. Dans ce poème de Cadenus et Vanessa, il exhorte Vanessa à une sorte d'amour platonique, lui offrant, dit-il, «un perpétuel délice d'esprit, appuyé sur la vertu, plus durable que les séductions de l'amour, et qui échauffe sans brûler»...
En 1714, la mère de Miss Vanhomrigh mourut; elle accourut en Irlande avec sa sœur, et le supplice de Swift commença. Il n'eut jamais le courage de lui enlever tout espoir, et la désespéra lentement par une froideur inexplicable pour elle, par les brusques changements de son humeur.
Pendant ce temps s'établissait entre Stella et Swift une autre intimité douloureuse qui ternit la renommée de l'écrivain et qui est le mystère de sa vie. Il ne consentit à épouser Stella qu'en 1716, la voyant s'éteindre dans sa douleur, sentant une rivale sans la connaître, et encore ce fut un mariage secret, un secret qui devint une torture pour Stella : c'est à elle, indirectement, que Swift adresse les lettres du Journal à Stella, publié en 1766-1768 et véritable journal intime de cette période de l'auteur de Gulliver. Retirée à Cellbridge, près de Dublin, elle écrivait en 1720: "Dix mortelles semaines se sont écoulées depuis que je vous ai vu, et pas une lettre.... Vous voulez à force de rigueur me détacher de vous.... Je vous conjure par Dieu même, de me dire ce qui a pu causer l'extrême changement que je trouve en vous. » Certes, Swift l'encourageait dans ses lettres à vivre au jour le jour, et à ne rien désirer au-delà du présent. «Les sages de tous les temps (5 juillet 1721) ont pensé que la meilleure méthode est de prendre les minutes comme elles volent, et défaire un plaisir de toute action innocente.... Écrivez- moi gaîment, sans plaintes et sans prières ; autrement Gadenus le saura et vous punira.»
Mais à la fin de 1722, Vanessa, livrée de son côté au sentiment de son abandon, se décida à chercher le véritable secret de la conduite de Swift et écrivit à Stella qui lui répondit qu'elle était la femme de Swift, et elle envoya à ce dernier la lettre de Vanessa, en quittant Dublin. Aussitôt Swift partit avec cette lettre pour Cellbridge, entra chez Vanessa, jeta cette lettre sur la table, et sortit sans lui dire un seul mot. Il ne la revit plus. Trois semaines plus tard, elle mourait, révoquant le testament qu'elle avait fait en faveur de Swift, et léguant une partie de sa fortune au docteur Berkeley. Swift alla errer deux mois dans le sud de l'Irlande..
Mais ces amours n'occupaient dans l'âme de Swift que la seconde place : la pauvreté et l'obscurité lui étaient insupportables, et il se voyait sur le point d'en sortir. La politique était alors le grand chemin de cette puissance, on n'y arrivait que par l'entremise de l'un des deux partis, qui influaient tour à tour sur les destinées de la nation, et sur la fortune des ambitieux. Swift pouvait choisir entre eux et rien ne lui interdisaient de changer par la suite...

Anne Stuart (1665-1714), reine de Grande-Bretagne (1702-1714), succède à Guillaume..
Au commencement de l'année, 1701, qui fut la dernière et la plus agitée du règne de Guillaume, Swift vint à Londres : les ministres whigs, Halifax, Orford, Somers, et l'ami de Guillaume, Bentinck, comte de Portland, venaient d'être mis en accusation par la Chambre des Communes, pour avoir signé le traité de partage de la monarchie Espagnole, que le testament de Charles II venait de donner tout entière à la France. Les accusés devaient être sauvés par une opinion publique, plus disposée à seconder Guillaume contre la politique ambitieuse de la France qu'à poursuivre ses amis. Le discours sur les dissensions d'Athènes et de Rome (A Dscourse of the contests and dissensions in Athens and Rome), où Swift défendait sous les noms de Miltiades, d'Aristide, de Thémistocle, de Phocion. les illustres accusés, et instruisait le Parlement, par l'exemple des républiques antiques, du péril que fait courir aux États la rupture de l'équilibre entre les pouvoirs publics et l'aveugle acharnement des factions, s'accordait avec le sentiment général aussi bien qu'avec les intérêts du parti Whig : « Ce n'est pas l'ambition des particuliers qui causa cette grande lutte ; les guerres civiles donnent en effet plus de prise et plus de feu à l'ambition particulière, qui devient l'instrument destiné à trancher ces grandes querelles et qui est assurée de recueillir le butin. Mais un homme sensé, qui voit des bandes de vautours planer sur deux armées près d'en venir aux mains, ne fait pas retomber sur eux le sang versé dans la bataille, bien que les cadavres soient leur partage. » Sans cette altération des principes de la constitution, ajoute Swift : « Un misérable comme Antoine, un enfant comme Octave, auraient-ils osé rêver qu'ils donneraient des lois à un tel empire et à un tel peuple! » Considérant l'état de son pays, il en marque le danger dans les accroissements du pouvoir de la Chambre des Communes ; il la requiert de se limiter, elle aussi, par une Magna Charta comme dut le faire la royauté, lorsque l'équilibre des pouvoirs commença de s'établir.
Le succès de cet écrit introduisit l'auteur dans la société d'Addison, de Steele, d'Arbuthnot, de Pope et des hommes d'Etat qu'il avait défendus. La mort de Guillaume et l'avènement d'Anne Stuart, en 1702, concoururent avec le mouvement de l'opinion à favoriser le succès des Whigs.
Fille de Jacques II, fidèle à l'Église établie, qui redoutait les Whigs, Anne eût incliné vers les Tories, si l'influence de lady Malborough (sa belle et intelligente ami d'enfance Sarah Jennings Churchill) et ses hésitations n'eussent imposé à la reine le choix d'une partie de ses ministres. Les vives rivalités entre whigs et tories marqueront son cout règne (1702-1714), intensifiées par l'incertitude qui prévaut autour de sa succession. Cette administration mélangée ne pouvait être défavorable à Swift, qui se déclarait Whig en politique et Tory en affaires religieuses; qui, d'une part, se disait dévoué à la succession protestante et aux libertés nationales, et qui, de l'autre, défendait les intérêts de la High-Church contre la Low-Church, alliée des Whigs. Swift espérait ainsi parvenir à l'épiscopat par ses relations politiques avec les Whigs, et par les sympathies particulières que son dévouement à la Haute-Église devait lui ménager du côté de la reine et des évêques.

"The Tale of a Tub" (Le Conte du Tonneau)
Ecrite entre 1696 et 1702, publiée en 1704, avec "The battle of the books", une satire en faveur de la Haute-Église contre les Dissidents protestants, un texte qui fustigeait la bêtise de ses contemporains, mais qui déplut à la reine Anne et l'obligea à s'exiler. "La Satyre est une espèce de Miroir, ou l'on voit les visages de tout le monde , sans y découvrir ses propres traits, c'est -là la raison principale de la réception favorable qu'elle rencontre dans le monde , & du peu de chagrin qu'elle y donne à ceux-là même qui en sont les objets. Si ce que je donne ici au public n'a pas le même heureux sort , contre la règle générale , je m'en mettrai fort peu en peine. J'ai appris par une longue expérience , qu'il n'y a pas de grands inconvenients à craindre de la part de certains génies , tels que ceux que j'attaque ici. La colère & la fureur, quoiqu'elles ajoutent de nouvelles forces au corps , ne font qu'affaiblir l’Esprit & rendre tous ses efforts vains & inutiles..."
Le prodigieux succès de "Tale of a Tub" eut sur la vie de Swift une influence décisive. Il devint un "infidel" que l'Église établie prit en horreur, il semble ne pas en avoir pris conscience : membre et membre ambitieux de l'Eglise anglicane, Swift, qui haïssait les idées générales trop commodément plaqués sur les réalités, n'instruisait, en toute liberté, la religion plus en politique qu'en chrétien. Plus tard, Voltaire en jugea de même. C'est le Conte du Tonneau qui lui fit dire : « Que j'aime la hardiesse anglaise ! »
(Préface) ".. C'est dans cette vue que je donne au public le Traité suivant qui pourra servir, par interim , déjouer à notre bande inquiète de Beaux-Esprîts , en attendant qu'on mette la derniere main à notre grand, ouvrage, sur lequel il est bon de donner ici en passant quelques lumières au Lecteur Bénévole. Notre intention est d'ériger un grand Collège capable de contenir neuf mil-mille sept cens & quarante quatre personnes, ce qui par un calcul modeste monte à peu près au nombre courant des Beaux-Génies de notre Ile. Ils doivent être partagez dans differentes classes selon leur différent tour d'esprit". La finalité est de donner de l'emploi aux 9744 Beaux Esprits et petits-Maîtres afin de Ies détourner d'attaquer la Religion & le Gouvernement...
Le titre dérive de l'habitude qu'avaient les marins, lorsqu'ils rencontraient une baleine, de lui lancer un tonneau vide pour détourner ses attaques du navire. Il s'agit ici de détourner les attaques dirigées par le Léviathan de Hobbes notamment à l'encontre des aspects les plus faibles de la religion. A la préface succède l'histoire d'un père qui laisse à chacun de ses trois enfants, Peter, Martin et Jack (qui représentent respectivement l'Eglise romaine, l'Eg1ise anglicane et les dissidents), un manteau, en leur ordonnant qu'ils ne le modifient à aucune condition. Les fils vont peu à peu désobéir à l'injonction paternelle : Peter trouve des excuses pour garnir le vêtement d`ornements, Martin (allusion évidente à Martin Luther) pour en éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, et Jack (c'est-à-dire Calvin) pour le réduire en lambeaux dans sa manie de tout purifier. Enfin Martin et Jack se disputent avec le tyrannique Peter, puis entre eux, et se séparent. La satire de Swift, spécialement violente contre Peter, n'épargne cependant pas Martin, représentant de l'Eglise à laquelle appartenait l'écrivain.
Le récit est interrompu de digressions destinées à parodier les écrivains érudits et les polémistes. Cette œuvre, l'une des plus pénétrantes écrites par Swift, fournira de nombreuses idées aux sceptiques pendant tout le XVIIIe siècle. Ce qui retiendra le lecteur moderne, ce n'est pas l'histoire des trois frères, qui se rapporte à des questions qui manquent maintenant d'actualité, mais les digressions...
On y évoque les "machines oratoires", la Chaire, l'Echelle, le Théâtre ambulant, tout autant que le tonneau, pour s'élever au-dessus du peuple et haranguer les foules, on évoque les ouvrages des auteurs de Grubstreet, et le nouveau goût moderne pour la digression, nouvelle figure de style dédiée à la fabrication des livres...
"J'avouë que si nous étions dans le même cas on se trouvoient les Grecs & les Romains du tems que le savoir étoit encore au berceau , & qu'il falloit le nourrir & l'emmaillotter par le moïen de l'invention , il seroit aisé de faire des volumes entiers sans s'écarter du sujet que par de petites courses nécessaires pour avancer le dessein principal. Mais il en a été des Sciences, comme d'une nombreuse armée campée dans un Païs fertile; pendant quelque tems elle subsiste par les productions mêmes du terroir , mais dans la suite elle est forcée d'aller en fourage à plusieurs lieues de là, parmi les amis ou les ennemis, tout comme elle peut; les terres voisines cependant sont entierement foulées , & ravagées; elles deviennent nues, & seches , & ne produisent plus rien que des nuages de poussiere.
L'Etat de la République des Lettres étant ainsi changée par une révolution totale , les sages modernes qui en font parfaitement instruits, ont découvert une méthode plus courte & plus prudente de devenir savans & beaux esprits ; la lecture & la méditation y entrent pour rien ; & il n'y a plus que deux manières parfaites de le servir d'un livre comme il faut: la premiere est la même dont plusieurs gens usent à l'égard des grands Seigneurs; ils apprennent par coeur leurs titres , & ensuite ils se ventent d'en être les amis intimes; la seconde qui est la mieux choisie, & la plus profonde , consiste à s'atacher à la table des matières , par laquelle un livre est dirigé comme un Vaisseau par le Gouvernail.
Pour entrer dans le Palais des Sciences par la grande porte , il faut du tems & des soins ; c'est pourquoi les personnes expeditives & ennemies du Cérémoniel se contentent d'y entrer par la porte de derrière. N'ont-elles pas raison; les Sciences ressemblent à des troupes en marche qu'on ne bat jamais plus plus facilement qu'en tombant sur l'arriere-garde. C'est par la même méthode que les Médecins jugent de la Constitution de tout un corps en consultant ce qui en découle par en bas; c'est ainsi que les Enfans attrapent les moineaux, en leur mettant un peu de sel sur la queue. C'est ainsi que pour se conduire sagement, il faut selon la maxime d'un Philosophe prendre toujours garde sur la fin. On se met en possession des Sciences comme Hercule trouva ses tauraux en les remenant vers leurs traces & non pas en les suivant, enfin le savoir doit être effilé comme un vieux bas, en commençant par le pied...
D'ailleurs toute l'année des Sciences a été rangée depuis peu par l'effort le plus pénible de la discipline militaire, dans un ordre si ferré , qu'on peut la passer en revue en moins de rien. Nous sommes redevables de ce bonheur aux Systêmes & aux abrégez , que les Pères modernes du savoir ont dressez à la sueur de leur corps pour la commodité de leurs chers Enfans. Le travail n'est autre chose que la semence de la paresse, & c'est le bonheur particulier de notre âge de jouïr paisiblement du fruit produit par cette bienheureuse semence.
Or la méthode de parvenir à un savoir profond & sublime , étant devenue, si régulière, & si Systematique, il faut de necessité que le nombre des Auteurs augmente à proportion & que leur habileté parvienne à une certaine hauteur, qui rend absolument nécessaire leur Commerce mutuel. De plus on a calculé qu'il ne reste plus dans la nature une quantité suffisante de sujets nouveaux, pour fournir à l'étendue d'un seul volume ; je puis asseurer le Lecteur que j'en ai vu une demonstration dans les formes , fondée sur les principes incontestable de l'Arithmétique.
Ce que je viens d'avancer pourroit bien être combattu par certains Philosophes qui soutiennent l'infinité de la matière, & qui , pour cette raison, prétendent qu'aucune espece ne sauroit être entierement épuisée; pour voir la futilité de cette objection, examinons la branche la plus noble de l'esprit &de l'invention moderne, si bien cultivée dans cet heureux siècle, qu'elle a porté des fruits plus beaux & plus nombreux qu'aucune de ses Compagnes. Je sais qu'on trouve quelques échantillons de cette sorte d'esprit parmi les anciens, mais ils n'ont jamais été ramassez que je sache dans quelque recueil pour l'usage des Modernes, & par consequent nous pouvons soutenir à notre honneur & gloire, que nous en sommes les Inventeurs & que nous l'avons portée jusqu'au plus haut degré de perfection.
La sorte d'esprit dont je parle ici, est ce talent merveilleux d'inventer des comparaisons & des allusions fort agréables, surprenantes, & applicables, sur toutes les matières qui concernent la propagation du genre humain, sujet dont la politesse éloigne absolument la propriété des termes...."
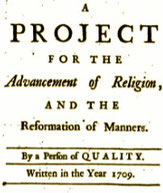
"Essai dans le Goût le plus moderne sur les Facultez de l'Ame en forme de lettre" : "Les Philosophes disent que l’Homme est un Microcosme , ou petit Monde en miniature, qui représente le grand dans toutes ses parties. Je suis encore persuadé, que le Corps naturel peut parfaitement bien être comparé au Corps Politique. Et si cette Comparaison est juste, comment est-il possible que les Epicuriens disent la vérité, en soutenant que l’Univers a été formé par le concours fortuit d’Atomes? Je serai prêt à embrasser leur opinion , quand je verrai les Lettres de l’Alphabet, jettées à tout hazard, former un Traité de Philosophie aussi sçavant qu’ingenieux..."
En 1705, Swift prend contact avec les chefs politiques whigs et, participant activement à la vie politique, devient leur porte-parole ; il publie alors, entre autres récits : "Argument sur l'abolition du christianisme" (Argument to prove that the abolishing of Christianity...), pamphlet contre les libres-penseurs, - "Un des plus grands Avantages qu’on attache à l’Extirpation du Chriltianisme, c’est que par-là on élargiroit beaucoup les bornes de la liberté de conscience , ce grand boulevard de la Nation & de la Religion Protestante , auquel les Fraudes pieuses font de fréquentes brèches, malgré la bonne intention de nos Législateurs..."-, et "Projet pour l'avancement de la religion et la réforme des mœurs" (Project for the Advancement of Religion, 1708), dans lequel il professe une égale répulsion envers les sectes et les hérésies, puritaines, papistes ou autres. ...
"Projet pour l'avancement de la religion..."
"...On me permettra de dire ici, sans avoir le moindre dessein de choquer le Clergé , que , par une prévention aussi commune que pernicieuse , les Ecclésiastiques eux-mêmes détruisent les Services qu’ils pourroient rendre à la Religion & à la Vertu : ils affectent de n’avoir aucun Commerce, sinon les uns avec les autres , & de ne se point mêler avec les Laïques ; ils ont leurs Sociétés particulières, leurs Caffez particuliers où ils paroissent toujours pour ainsi dire en troupe . Un Ministre tout seul ose à peine se montrer dans une Compagnie de gens polis : & s’il s’y trouve par malheur, il est taciturne, la défiance est peinte sur son visage , il est dans des appréhensions continuelles d’être turlupiné, & d’être en butte à des railleries offensantes.
Cette conduite du Clergé me paroît aussi sensée, que le seroit celle des Médecins , s’ils mettoient tout leur tems à visiter leurs Apoticaires, ou à se visiter les uns les autres , sans se mettre en peine de leurs malades. A mon avis, le Commerce avec les Laïques, est l’affaire principale des Gens d’Eglise, & je ne crois pas qu’ils puissent trouver un moyen plus efficace de sauver les âmes , que de se rendre propres à plaire dans la Conversation des gens du monde : leur érudition pourroit y contribuer beaucoup, s’ils s’appliquoient à la polir, & à la débarasser de la Rudesse & de la Pédanterie. Il est ordinaire à présent que ceux qu’on appelle bons-vivans , qui ne vont jamais à l’Eglife, & qui ne s’amusent point à parcourir les Livres de dévotion, forment leur idée de tout le Clergé, sur quelques pauvres Miniftres vagabonds qui se crottent dans les rués, ou qui semblent se dérober de quelque Maison de Qualité, où ils font l’Office de Chapelain pour dix Shellings par mois. Cette idée n’est pas rectifiée par la vûë d’autres Ecclésiaftiques, qui ont des talens plus rélevez & une figure plus revenante.
Que certains Raisonneurs pensent ce qu’ils trouvent à propos, il est certain qu’il faut porter la masse générale des hommes à aimer & à estimer les Gens d’Eglise, si l’on veut leur inspirer de la tendresse pour la Religion. On fait d’ordinaire fort peu de cas d’un Remede , quelque excellent qu’il puisse être, s’il est donné par un Médecin, qu’on hait, ou qu’on méprise....
"... Pour reformer les Vices de la Ville, qui ont une si grande influence sur tout le Royaume , il feroit fort utile de faire une Loi , pour ordonner à tous les Cabaretiers de renvoyer leur chalands chez eux , & de fermer leur porte à minuit; & pour défendre à toute femme, quelle qu’elle pût être , de mettre jamais le pied dans un Cabaret , sous quelque prétexte que ce fût. On comprend facilement , qu’une pareille Loi préviendroit un très-grand nombre d’Inconveniens, comme Querelles, Débauchés, Vols, Maladies infâmes , & un grand nombre d’autres maux qu’il est inutile de mentionner. Il feroit bon même d’enjoindre aux Maîtres de ces maisons, sous des peines sévères , de ne donner à chaque Compagnie qu’une certaine quantité de boisson , & de leur refuser tout ce qui pourroit les jetter dans des excès.
Je crois qu’il y a à peine dans toute la Chrétienté une seule Nation , où toutes sortes de Fraudes sont pratiquées dans un aussi haut degré que chez nous. L’Homme de Robe, le Négociant & l’Artisan,ont trouvé chacun dans sa vocation tant de moyens de tromper , & tant d’artifices subtils , qu’ils passent la portée de la prudence humaine, incapable de se précautionner contre tant de pièges. Nos Législateurs ne pourroient jamais rendre un plus important service au Public, qu’en appliquant un remede efficace à ce mal , qui , dans plusieurs cas , mérite des châtimens plus rigoureux que certains crimes que nos Loix punissent par la mort du coupable. Le Marchand de Vin mêle du Poison à ses liqueurs frelatées, & tue par-là plus de sujets qu’une maladie contagieuse. L’Avocat vous persuade d’entrer dans un Procès , dans lequel il prévoit votre ruine & celle de toute votre Famille. Le Banquier prend tout votre capital , & il vous en promet des rentes considerables, résolu de faire banqueroute le jour après. Tous ces Scélérats méritent infiniment mieux la Potence, que ce Malheureux qu’on y attache pour avoir volé un Cheval.
On ne sçauroit gueres se justifier devant Dieu & devant les Hommes , de ce qu'on né fait point quelque Loi sévère contre la Liberté excessive de la Presse. Du moins devroit-on prévenir l’Impression de ces Ouvrages qui, sous prétexte de la Liberté de Penser , renversent tous les Articles de la Religion , qui ont toujours passé pour incontestables parmi tous ceux qui se sont fait une gloire de porter le nom de Chrétiens. Par conséquent ces Dogmes ne doivent point être regardez comme des Matières de Controverse, ou comme des Sujets de simple Spéculation. Les Dogmes de la 'Trinité , de la Divinité de J. Christ, l' Immortalité de l'Ame, et même la Vérité de toute la Révélation , sont tous les jours combattus , et niez ouvertement , dans des Livres faits exprès dans ce dessein: quoiqu’il n’y ait point de Secte parmi nous , qui admette les principes qu’on pose dans ces dangereux Ouvrages, ou qui les croye nécessaires à son Systême.
Je n'aurois jamais fait , si je voulois entrer ici dans le détail de tous les Inconveniens , où le Pouvoir Législatif seul est en état de remédier. Peut-être ceux dans lequel ce pouvoir réside , feront peu de cas de quelques Propositions qui ne fortent pas de leur propre Corps. Ce pendant , quoique persuadé de la foiblesse de mes lumières, je suis sur que les pensées sinceres d’un homme éclairé & intégre , qui n’a en vûë que le bien de fa Patrie, peuvent aller plus au fait, que les Délibérations d’une Assemblée nombreuse, où la faction & l’intérêt ne prévalent souvent que trop. Un seul guide montrera mieux le chemin , que cinq-cens qui ont des idées différentes, ou qui marchent à tâtons en se fermant les yeux.
Dans la défiance où je fuis touchant la réception qu’on fera à mes Propositions, je ne ferai encore qu’une seule Remarque , qui mérite, ce me semble , toute l’attention du Parlement.
N’est-ce pas une honte pour notre Pais , & un sujet de scandale pour toutes les Nations Chrétiennes, que dans plusieurs Villes où le nombre des Habitans augmente tous les jours , on ait si peu soin de bâtir de nouvelles Eglises, qu’il est impossible à la cinquième partie du Peuple d’assister au Service Divin? Dans notre Capitale même, un seul Ministre, assisté de deux chétifs Vicaires , est souvent chargé du soin de plus de vingt- mille Ames..."
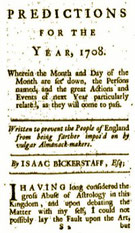
En 1709 paraissent les "Predictions for the Ensuing Year by Isaac Bickerstaff", ou "Prédictions pour l'année 1708, dans lesquelles les mois et le jour du mois sont indiqués, les personnes nommées et les grands événements de l 'année prochaine relatés en détail, tels qu'ils doivent advenir ; écrites pour empêcher le peuple d 'Angleterre d'être dorénavant la dupe des faiseurs d'Almanachs vulgaires. Par Isaac Bickerstaff esq".
Dans cette parodie, Swift dénonçait et raillait les imposteurs avec leurs propres armes, le ton pompeux l'assurance et la fausse logique des faiseurs d'almanachs, si nombreux à l`époque, qui se traitaient à l'envi de charlatans et proclamaient détenir seuls la vérité. Bickerstalf en arrive même à prédire la mort de Partridge, son confrère, un personnage authentique, de son état savetier à Londres, et qui avait pour rival et ennemi juré John Gadbury, tailleur de son métier, habitant Oxford.
".. Une Personne , dit-on, peut-être disposée, par la force d’une Planete dominante, à la Volupté, à la Colere, ou à l’Avarice , & vaincre par sa Raison ces mauvaises Influences , comme fit autrefois Socrate. Les Astres inclinent, mais ne forcent point, la volonté des hommes; & par consequent on a beau suivre les Régles les plus certaines de l’Astrologie , il est impossible d’être parfaitement sûr que les Evenemens répondront juste aux Prédictions. J’avoue que cette Objection est très-solide par rapport à tel ou à tel individu humain ; mais comme les grandes révolutions dépendent d’ordinaire des dispositions d’un grand nombre de personnes , il est impossible de croire qu’elles s’accorderont toutes à s’opposer à leurs penchans , & à les détourner d’un dessein général qui est conforme à leurs inclinations. D’ailleurs, l’influence des Etoiles s’étend à un grand nombre d’Evenemens qui sont indépendans de la Raison , comme les Maladies , la Mort , & en un mot tout ce qu’on appelle dans le monde Accidens.
J’ai commencé mes Prédictions par le tems que le Soleil entre dans le Belier, ce que je prens pour le véritable commencement de l’Année naturelle; & je les ai poussées un peu plus loin que le tems auquel il entre dans le ligne de la Balance : c’est-là précisement la Saison des grandes Affaires. Je n’ai pas encore arrangé ce qui regarde le reste de l’Année; parce que j’en ai été détourné par plusieurs occupations qui n’ont rien de commun avec le Public. D’ailleurs , j’ai déjà insinué que ce n’est ici qu’un Echantillon d’un grand nombre de Pronostics que je prépare pour les Années suivantes , si l’on veut bien me le permettre , & m’encourager à l’exécution d’un si grand dessein.
Ma première Prédiction n’est qu’une Bagatelle , & je ne la donne ici que pour faire voir l’Ignorance des prétendus Astrologues dans les choses qui les regardent directement eux-mêmes. Elle a pour objet Partrige , le Faiseur d’Almanacs. J’ai fait son Horoscope selon ma méthode particulière; & je trouve qu’il mourra infailliblement d’une Fièvre chaude le 29 de MARS environ à onze heures de nuit. Je le prie d’y songer, & de mettre ordre à ses affaires.
Le Mois d’AVRIL sera remarquable par la mort de plusieurs personnes du premier rang. Le Cardinal de Noailles mourra le 4 ; & le 11 . Le Prince des Asturies , Fils du Roi Philippe. Le 14, un des premiers Pairs de ce Royaume mourra à sa maison de Campagne. Le 19. l’ Angleterre perdra un vieux Laïque distingué par sa grande Erudition; & le 25. on verra mourir un fameux Banquier demeurant dans la Rue du Lombard..."

1709, publication trois fois par semaine du journal Tatler (le Babillard) - Il sort sous première version du 12 avril 1709 au 2 janvier 1712 (sera remplacé par The Spectator de Steele et Addison), avec Richard Steele sous le nom de plume d’«Isaac Bickerstaff», personnage fictif créé un an plus tôt par l'écrivain Jonathan Swift, autre collaborateur du journal.
Dès 1711, juste au moment où le Spectateur venait de succéder au Babillard, voici ce qu'écrivait un témoin qu'on suppose être le fabuliste Gay...
"La disparition du Babillard a semblé être déplorée comme une calamité publique. Tout le monde regrettait d'avoir perdu un agréable amusement, et les cafés commencèrent à comprendre que les élucubrations du seigneur Bickerstaff leur avaient procuré plus de clients que tous leurs autres journaux mis ensemble.
Il faut vraiment avouer que jamais homme n'abandonna la plume au milieu de tentations plus fortes de s'en servir encore ; sa réputation était plus haut, je crois, que n'a jamais été celle d'aucun auteur vivant... Chacun le lisait avec plaisir et bon vouloir, et les tories, en considération de ses autres bonnes qualités, lui avaient presque pardonné son imprudence inconcevable à se déclarer contre eux. Enfin il était grandement improbable, s'il abandonnait un personnage dont les opinions étaient si fortement imprimées dans tous les esprits, qu'il put jamais, avec quelque talent qu'il écrivit sous une forme nouvelle, retrouver le même accueil.
Pour vous donner mon opinion personnelle sur les écrits de cet auteur, je ferai d'abord remarquer qu'il y a cette admirable différence entre lui et le reste de nos auteurs polis et galants, que ceux-ci se sont efforcés de plaire à leurs contemporains en les flattant, et en encourageant leurs vices à la mode et leurs idées fausses. On aurait ri, il y a quelque temps, d'entendre déclarer qu'on pouvait dire quelque chose de spirituel à l'éloge du mariage, et que la religion et la vertu étaient en quoi que ce soit nécessaires à un homme élégant. Bickerstaff a eu le courage de dire à notre beau monde qu'il était une collection de fats, de sots et de vaines coquettes; mais il l'a dit de manière à lui faire même plaisir, et à le rendre plus qu'à moitié enclin à croire qu'il lui disait vrai.
Au lieu de s'accommoder aux fausses idées et aux goûts vicieux du siècle en fait de morale, de littérature ou de savoir-vivre, il a hardiment assuré aux gens qu'ils avaient tout à fait tort, et leur a ordonné, avec une autorité qui lui seyait parfaitement bien, de se rendre à ses arguments en faveur de la vertu et du bon sens.
Il est impossible de s'imaginer l'effet que ses écrits ont eu sur la ville; combien de milliers de folies ils ont ou entièrement supprimées ou sérieusement tenues en échec; en quelle faveur ils ont mis la vertu et la religion; combien de gens ils ont rendus heureux en leur montrant que c'était leur propre faute s'ils ne l'étaient pas; et enfin com- bien ils ont entièrement convaincu nos fats et nos jeunes cervelles de la valeur et des avantages du savoir.
A vrai dire, Bickerstaff a tiré le savoir des mains des pédants et des sots, et a découvert le moyen de le rendre aimable et séduisant à tout le genre humain. Dans le costume où il le présente, c'est un convive très bien accueilli aux tables à thé et aux réunions du monde, et il est apprécié et choyé par les négociants qui fréquentent la Bourse.
Enfin ses écrits ont inspiré à tous nos beaux esprits et à tous nos auteurs une nouvelle manière de penser dont ils avaient auparavant fort peu ou pas du tout l'idée; et bien que nous ne puissions pas dire qu'aucun d'eux s'est élevé jusqu'aux beautés de l'original, je pense qu'on peut sans témérité affirmer que chacun d'eux écrit et pense beaucoup mieux qu'il ne faisait il y a quelque temps ..."

"Meditation Upon a Broomstick" (1704-1710), ou "Méditation sur un manche à balai, dans le style et à la manière des méditations de l'honorable Robert Boyle". Une brève mais célèbre "méditation" parodique dont on connaît le contexte. Chapelain de la maison de lord Berkeley, Swift, tenu de lire à l'épouse de ce dernier les méditations de M. Boyle, qu'il prisait fort peu, y inséra une de sa composition et la débita du même ton solennel que les précédentes; sur quoi son auditrice de s`extasier sur cet étonnant M. Boyle, qui savait tirer de si belles réflexions morales d`un aussi méprisable sujet.
« Mais un balai, direz-vous peut-être, est l'emblème d`un arbre qui se tient sur la tête ; et je vous prie, qu`est-ce qu`un homme, si ce n'est une créature sens dessus dessous, ses facultés
animales perpétuellement montées sur ses facultés raisonnables, sa tête où devraient être
ses talons..."
"Contemplez ce Balai jette ignominieusement dans un coin. Je l’ai vû autrefois dans un état florissant. Il occupoit une place honorable dans une grande forêt. Il étoit plein de suc , couvert d’une verdure riante, & de rameaux épais. En vain l’industrie de l’homme veut combattre la nature , en attachant à ce tronc desséché l’ornement étranger de quelque branches flétries. Ce n’est tout au plus qu’un arbre renversé qui porte ses branches vers la terre & sa racine en
l’air. Il est manié à présent par les servantes les plus maussades , condamné à servir d’instrument à leurs viles occupations, & par le sort le plus capricieux , il est destiné à se salir, dans le tems qu’il nettoye toute autre chose. Usé à la fin dans ce triste service, il est jetté dans la rue , ou bien il est mis en pièces pour allumer le feu. Quand je l’examine, je soupire, & je ne sçaurois m’empêcher de me dire à moi- même: certainement , l'Homme mortel n'est qu'un Balai.
La nature envoye l’homme dans le monde vif & robuste , sa tête est ornée de ses propres cheveux , branches naturelles des végétaux raisonnables , jusqu’à ce que la hache de l'intemperance coupe ces rameaux si gais & si rians, & le laisse un tronc desséché. Alors il a recours à l’Art, il se charge le front d’un vil amas de cheveux étrangers , tous couverts de poudre; il en paroît fier , comme d’une dépouille glorieuse. Si ce Balai que nous voyons-là , vouloit se donner des airs sur ce faisceau de branches qui ne sont pas de son cru , & qui sont tout couvertes de poussiere, quoiqu’elles servent peut-être à donner de de la propreté à la chambre de la plus belle Dame, sa vanité ne nous paroîtroit-elle pas ridicule & méprisable au suprême degré ? Nous sommes des juges également aveugles de notre propre mérite, & des defauts d’autrui.
Mais , dira-t-on , un Balai est l’emblème d’un Arbre appuyé sur sa tête. Eh ! je vous prie , qu’est-ce que l’homme, qu’une créature toujours tournée sens dessus dessous ? Ses facultez animales ont toûjours le dessus sur sa raison; sa tête est placée ou devroient être ses pieds , elle se vautre toûjours dans la terre. Avec tous ces defauts , il veut être le Reformateur général des erreurs & des vices, il fouille continuellement dans tous les égoûts de la nature , il met en lumière des vilainies cachées , il excite une épaisse poussiere où l’on n’en voyoit point auparavant, & en même tems il se plonge dans les ordures dont il veut débarasser les autres. Ses derniers jours sont consumez dans l’esclavage des femmes , & d’ordinaire de celles qui le méritent le moins, jusqu’à ce qu’usé jusqu’au bout , comme son Frere le Balai , il soit chassé de la maison , à moins qu’il n’ait de quoi allumer un feu , auprès duquel les autres s’échauffent."
1710, Swift, des Whigs aux Tories...
Il fut dès lors impossible aux Whigs, qui désiraient se l'attacher ("les Whigs s accrochent à moi comme des gens qui se noient"), d'obtenir pour lui une situation lucrative et honorable. Il fut question tour à tour du secrétariat de l'ambassade de Vienne , de l'évêché de Virginie, d'une prébende de Westminster, tout échoua, et en 1709 Swift retourna en Irlande, aigri contre ses amis politiques et très-disposé à tenter la fortune du côté de leurs adversaires. Ce qu'il fit, mais les mêmes déceptions l'attendaient dans ce nouveau camp, moins libre encore que le premier dans son action sur l'Église. Une guerre sans ménagement suivit la rupture de Swift. Les Tories avaient fondé contre une feuille Whig que rédigeaient l'évêque Burnet, Addison, Steele et quelques autres, l' "Examiner", qui fut abandonné à Swift du mois de novembre 1710 au mois de juin 1711 : il y défendit énergiquement le ministère, y déchira les Whigs avec violence, dénonçant la célèbre avidité de Malborough, l'impiété de lord Wharton, la vénalité de Walpole, avec une ironie mordante intempérante, les doctrines des Whigs étaient dénoncées, les maximes des Tories revêtues d'une tolérante sagesse : «Nous les accusons de vouloir détruire l'Eglise établie, et introduire, à sa place, le fanatisme et la liberté de penser; d'être ennemis de la monarchie, de vouloir miner la présente forme du gouvernement pour élever une république ou quelque autre établissement de leur goût sur ses ruines. D'un autre côté, leurs clameurs contre nous peuvent se résumer dans ces trois mots redoutables : le papisme, le pouvoir absolu, le prétendant».
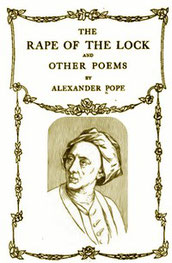
1712-1714, "The Rape of the Lock" (La Boucle de cheveux volée), d'Alexander Pope fait émerger une nouvelle tradition poétique, une structure formelle complexe, un thème relativement superficiel, et une parodie des poèmes héroiques antérieurs. "La Boucle de cheveux enlevée" décrit des évènements sans importance liés au vol d'une boucle de cheveux. Lord Peter a pris une boucle de cheveux à miss Arabella Fermor, ce qui entraîne une querelle entre les deux familles. Pope tente de les réconcilier en écrivant son poème sur le modèle du célèbre "Lutrin" de Nicolas Boileau, en plus frivole : le boudoir d'une élégante, une barque chargée de nymphes et de galants voguant sur un fleuve bordée de riches villas, un salon où l'on cause et joue en buvant du café. C'est à ce moment que la boucle est dérobée de la chevelure de Bélinde, provoquant une guerre dentelle qui se termine par la montée au ciel de la fameuse boucle qui devient une nouvelle étoile, on y a vu toute la vie frivole et éphémère d'une époque...
Not with more glories, in th' etherial plain,
The sun first rises o'er the purpled main,
Than, issuing forth, the rival of his beams
Launch'd on the bosom of the silver Thames.
Fair nymphs, and well-dress'd youths around her shone,
But ev'ry eye was fix'd on her alone.
On her white breast a sparkling cross she wore,
Which Jews might kiss, and infidels adore.
Her lively looks a sprightly mind disclose,
Quick as her eyes, and as unfix'd as those:
Favours to none, to all she smiles extends;
Oft she rejects, but never once offends.
Bright as the sun, her eyes the gazers strike,
And, like the sun, they shine on all alike.
Yet graceful ease, and sweetness void of pride,
Might hide her faults, if belles had faults to hide:
If to her share some female errors fall,
Look on her face, and you'll forget 'em all.
This nymph, to the destruction of mankind,
Nourish'd two locks, which graceful hung behind
In equal curls, and well conspir'd to deck
With shining ringlets the smooth iv'ry neck.
Love in these labyrinths his slaves detains,
And mighty hearts are held in slender chains.
With hairy springes we the birds betray,
Slight lines of hair surprise the finney prey,
Fair tresses man's imperial race ensnare,
And beauty draws us with a single hair.
Th' advent'rous baron the bright locks admir'd;
He saw, he wish'd, and to the prize aspir'd.
Resolv'd to win, he meditates the way,
By force to ravish, or by fraud betray;
For when success a lover's toil attends,
Few ask, if fraud or force attain'd his ends.
For this, ere Phoebus rose, he had implor'd
Propitious Heav'n, and ev'ry pow'r ador'd,
But chiefly love—to love an altar built,
Of twelve vast French romances, neatly gilt.
There lay three garters, half a pair of gloves;
And all the trophies of his former loves;
With tender billet-doux he lights the pyre,
And breathes three am'rous sighs to raise the fire.
Then prostrate falls, and begs with ardent eyes
Soon to obtain, and long possess the prize:
The pow'rs gave ear, and granted half his pray'r,
The rest, the winds dispers'd in empty air.
(...)
Chant II
Le Soleil sortant de l'onde, n'eut jamais tant d'éclat que Belinde , lorsqu'elle sortlt de son palais, pour se rendre sur la Tamise. Elle étoit accompagnée des Femmes les plus belles et des Jeunes hommes les mieux faits, tous superbement parés.
Belinde seule attire les regards & les cœurs : on voit sur sa gorge d'albâtre une croix étincelante , qu'un Juif auroit baisée , & qu'un Infidèle auroit adorée ; la vivacité de son esprit paroît dans ses yeux , qui s'arrêtent aussi peu que ses pensées ; elle distribue également les charmes de son sourire , mais elle n'accorde de grâce à aucun : elle reprime les desirs sans offenser les amans : éblouissante comme d'Astre du jour, elle répand , comme lui , de tous côtés une lumiére égale : elle plaît sans songer à plaire : son air est noble sans orgueil , sans hauteur elle imprime le respect : elle sçait cacher habilement les petits défauts , si on peut dire que les Belles ayent quelque chose à cacher. Ces petits défauts même sont sur le compte de son sexe. Mais on la voit & on les oublie.
Elle portoit d'ordinaire, pour le suplice des coeurs deux Boucles de cheveux , qu'elle nouoit galamment, & qui retombant en ondes égales sur le plus beau cou du monde , en relevoient la blancheur. Ces Boucles charmantes étoient une chaîne précieuse , dont l'Amour se servoit pour attacher ses captifs. Les oiseaux & les poissons se prennent aux filets : les beaux cheveux prennent les cœurs.
Un Baron audacieux, frapé de l'éclat de ceux de Belinde, les desire et forme le projet d'en faire la conquête. Uniquement attentif au succès, il veut employer pour y parvenir & la force & la ruse. Le choix de l'une ou de l'autre importe peu aux amans , pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent.
Dans ce dessein, il invoque le Ciel avant que le jour paroisse , il adore les Puissances Célestes, & s'adressant sur-tout à l'Amour, il lui érige un autel composé de douze gros volumes de Romans François : il déploye trois jartiéres , un gant, avec d'autres pareils trophées de ses premiéres amourettes. Ses lettres , ses billets doux allument le feu ; trois soupirs qu'il pousse , excitent la flamme ; il se prosterne , il prie avec de yeux ardens que ce trésor pusse être bien-ô & toujours en sa puissance. L'Amour, l'entend, mais il n'exauce que la moitié de ses vœux ; les vents dissipent le reste dans les airs.
Cependant le vaisseau galamment équipé , où Belinde étoit entrée , s'avance sur la Tamise. Une délicieuse harmonie de voix & d'instrumens se perd dans les airs & glisse sur les eaux : les Zéphirs badinent sur l'onde calme; Belinde rit, & la joye règne autour d'elle.
Les sentimens d'Ariel étoient bien différens, le malheur dont elle est menacée par les astres, le rend triste & rêveur. Il convoque les habitans de l'air, & à ses ordres le leger escadron accourt; ils se placent à l'instant sur les cordages du vaisseau, & agitent l'air par ce mouvement subit & rapide: on croit entendre le souffle aimable des Zéphirs....

1712, apparition de John Bull, personnage satirique créé par John Arbuthnot (1667-1735), ami de Jonathan Swift et d'Alexander Pope, dans le pamphlet "Law is a Bottomless Pit". La même année, Arbuthnot publie un récit politique en quatre parties intitulé "The History of John Bull", un traitement satirique de la guerre de Succession d'Espagne qui voit John Bull intenter un procès à diverses figures censées représenter les rois de France (Louis Baboon) et d'Espagne (Lord Strutt). William Hogarth et d'autres écrivains britanniques ont fait de Bull "un archétype héroïque de l'Anglais né libre". Par la suite, la figure de Bull a été diffusée à l'étranger par des illustrateurs et des écrivains tels que le caricaturiste américain Thomas Nast et l'écrivain irlandais George Bernard Shaw.
How John Bull was so mightily pleased with his success, that he was going to leave off his trade, and turn lawyer.
It is wisely observed by a great philosopher, that habit is a second nature ; this was verified in the case of John Bull, who, from an honest and plain tradesman, had got such a haimt about the courts of justice, and such a jargon of law words, that he concluded himself as able a lawyer as any that pleaded at the bar, or sat on the bench. He was overheard one day talking to himself after this manner : "How capriciously does fate or chance dispose of mankind? how seldom is that business allotted to a man, for which he is fitted by nature? It is plain I was intended for a man of law ; how did my guardians mistake my genius in placing me, like a mean slave, behind a counter? Bless me! what immense estates these fellows rise by the law ! Besides, it is the profession of a gentleman. What a pleasure is it to be victorious in a cause, to swagger at the bar I What a fool am I to drudge any more in this wooUen trade I for a lawyer I was bom, and a lawyer I will be ; one is never too old to learn". All this while John had conned over such a catalogue of hard words, as were enough to conjure up the devil ; these he used to babble indifferently in all companies, eepeciaUyat coffee-houses; so that his neighbour tradesmen began to shun his company as a man that was cracked.
Instead of the affairs at Blackwell-hall, and price of broad cloth, wool and baizes, he talks of nothing but actions upon the case, returns, capias, alias capias, demurrers, venire facias, replevins, supersedeases, certioraris, writs of error, actions of trover and conversion, trespasses, precipes and dedimus.
This was matter of jest to the learned in law ; however, Hocus, and the rest of the tribe, encouraged John in his fancy, assuring him that he had a great genius for law ; that they questioned not but in time he might raise money enough by it to reimburse him all his charges ; that, if he studied, he would undoubtedly arrive to the dignity of a lord chief justice : as for the advice of honest friends and neighbours, John despised it ; he looked upon them as fellows of a low genius, poor groveling mechanics ; John reckoned it more honour to have got one favourable verdict, than to have sold a bale of broad-cloth. As for Nic Frog, to say the truth, he was more prudent ; for, though he followed his lawsuit closely, he neglected not his ordinary business, but was both in court and in his shop at the proper hours.
(chap. VII) Comment John Bull était si heureux de son succès, qu'il abandonna son métier et se mit à travailler. - "Un grand philosophe a judicieusement observé que l'habitude est une seconde nature ; cela s'est vérifié dans le cas de John Bull, qui, d'honnête et simple commerçant, avait acquis une telle connaissance des cours de justice, et un tel jargon juridique, qu'il se considérait comme un avocat aussi compétent que n'importe quel autre plaideur ou juge. On l'entendit un jour se parler à lui-même de cette manière : " Combien capricieusement le sort ou le hasard dispose-t-il de l'humanité ? Combien rarement une affaire est-elle attribuée à un homme, pour laquelle il est fait par nature ? Il est clair que j'étais destiné à un homme de loi ; comment mes tuteurs se sont-ils trompés sur mon génie en me plaçant, comme un méchant esclave, derrière un comptoir ? Bénissez-moi ! vers quels immenses domaines ces ces gars-là s'élèvent par la loi! Et puis, c'est la profession d'un gentleman. Quel plaisir d'être victorieux dans une cause, de se pavaner au barreau ! Quel imbécile je suis de me traîner encore dans ce métier de sorcier ! car j'ai été avocat et je le serai encore ; on n'est jamais trop vieux pour apprendre ! Pendant tout ce temps, John avait accumulé un tel catalogue de mots durs, qu'il suffisait de conjurer le diable ; ces mots, il les balbutiait indifféremment dans toutes les compagnies, dans les cafés, de sorte que ses voisins commerçants commencèrent à fuir sa compagnie comme un homme fêlé. Au lieu des affaires de Blackwell-hall et du prix des étoffes larges, de la laine et des baizes, il ne parle que des actions en cause, des retours, des "capias", des "alias capias", des "demurrers", des "venire facias", des "replevins", des "supersedeases", des "certioraris", des "writs of error", des "actions of trover and conversion", "trespasses", "precipes" et "dedimus". C'était un sujet de plaisanterie pour les érudits en droit ; cependant, Hocus, et le reste de la tribu, encourageaient John dans sa fantaisie, l'assurant qu'il avait un grand génie pour le droit ; qu'ils ne doutaient pas qu'avec le temps il pourrait gagner assez d'argent par ce moyen pour lui rembourser toutes ses charges ; que, s'il étudiait, il arriverait sans aucun doute à la dignité de lord chef de justice : quant aux conseils des amis et des voisins honnêtes, John les méprisait ; il les considérait comme des gens de peu de génie, de pauvres mécaniciens rampants ; John estimait qu'il était plus honorable d'avoir obtenu un verdict favorable que d'avoir vendu un ballot de toile. Quant à Nic Frog, pour dire la vérité, il était plus prudent ; car, bien qu'il suivît de près son procès, il ne négligeait pas ses affaires ordinaires, et était à la fois au tribunal et dans sa boutique aux heures convenables..."

1713, Le "Windsor-Forest" - Alexander Pope évoque un endroit familier où il passa son enfance, la ville de Binfield, dans la forêt de Windsor, pour célébrer une paix retrouvée : la signature du traité d'Utrecht en 1713 met fin à la longue et particulièrement coûteuse guerre de succession d'Espagne, une guerre qui avait vu s'opposer avec âpreté les Whigs et les Tories. S'annonçait une nouvelle ère d'harmonie politique et de prospérité économique.
Thy forests, Windsor! and thy green retreats,
At once the Monarch's and the Muse's seats,
Invite my lays. Be present, sylvan maids!
Unlock your springs, and open all your shades.
Granville commands; your aid O Muses bring!
What Muse for Granville can refuse to sing?
The groves of Eden, vanish'd now so long,
Live in description, and look green in song:
These, were my breast inspir'd with equal flame,
Like them in beauty, should be like in fame.
Here hills and vales, the woodland and the plain,
Here earth and water, seem to strive again;
Not Chaos like together crush'd and bruis'd,
But as the world, harmoniously confus'd:
Where order in variety we see,
And where, tho' all things differ, all agree.
Here waving groves a checquer'd scene display,
And part admit, and part exclude the day;
As some coy nymph her lover's warm address
Nor quite indulges, nor can quite repress.
There, interspers'd in lawns and opening glades,
Thin trees arise that shun each other's shades.
Here in full light the russet plains extend;
There wrapt in clouds the blueish hills ascend.
Ev'n the wild heath displays her purple dyes,
And 'midst the desart fruitful fields arise,
That crown'd with tufted trees and springing corn,
Like verdant isles the sable waste adorn.
Let India boast her plants, nor envy we
The weeping amber or the balmy tree,
While by our oaks the precious loads are born,
And realms commanded which those trees adorn.
Not proud Olympus yields a nobler sight,
Tho' Gods assembled grace his tow'ring height,
Than what more humble mountains offer here,
Where, in their blessings, all those Gods appear.
See Pan with flocks, with fruits Pomona crown'd,
Here blushing Flora paints th' enamel'd ground,
Here Ceres' gifts in waving prospect stand,
And nodding tempt the joyful reaper's hand;
Rich Industry sits smiling on the plains,
And peace and plenty tell, a Stuart reigns.
Not thus the land appear'd in ages past,
A dreary desart and a gloomy waste,
To savage beasts and savage laws a prey,
And kings more furious and severe than they;
Who claim'd the skies, dispeopled air and floods,
The lonely lords of empty wilds and woods:
Cities laid waste, they storm'd the dens and caves,
(For wiser brutes were backward to be slaves):
What could be free, when lawless beasts obey'd,
And ev'n the elements a Tyrant sway'd?...

1714 - Le Scriblerus Club réunit Alexander Pope, Jonathan Swift, John Gay, Thomas Parnell et John Arbuthnot, à la fois plus sélect et plus exclusivement tory dans ses perspectives politiques...
Swift, ayant quitté les whigs, voulait un groupe qui garantisse l'intimité entre les écrivains clés et le ministère tory, tandis que Pope cherchait une alternative à son association de plus en plus gênante avec le cercle whig de Joseph Addison. Les seules réunions complètes des cinq écrivains que l'on peut maintenant documenter ont eu lieu en mars et avril 1714. Le logement d'Arbuthnot au palais de St James était probablement un lieu de prédilection. Le club n'a jamais atteint une solidité institutionnelle comparable à celle du Kit-Cat Club whig contemporain ou, plus tard, du club littéraire de Johnson, et les réunions ont très vite cessé. En avril 1714, Pope s'était retiré à la campagne avec Parnell pour travailler sur sa traduction de l'Iliade d'Homère, et en mai, Swift avait quitté Londres, désespéré par le désarroi des dirigeants tories, pour retourner en Irlande en août. En juin 1714, alors qu'une réunion des membres restants est tentée, Gay est nommé à une ambassade à Hanovre, qui ne prendra fin que trop tôt avec la mort de la reine Anne le 1er août. Arbuthnot et Pope ne parvinrent pas à raviver l'enthousiasme de Swift pour Scriblerus...
1713-1714, Fin des ambitions politiques de Swift...
En 1714, à la mort de la reine Anne, le parti Whig revient au pouvoir avec la maison de Hanovre, l'ancien ministère fut accusé de trahison, Ormond et Bolingbroke prirent la fuite, et lord Oxford attendit son procès à la tour de Londres. Mais la carrière politique de Swift était terminée et ses tentatives pour obtenir un évêché échouèrent.
Swift est alors nommé doyen de Saint-Patrick à Dublin (1713), et retrouve sa terre d'exil.
Il publie successivement "L'Esprit public des whigs" (1714), la "Proposition pour l'usage universel des produits d'Irlande" (1720), "brûler tout ce qui vient d'Angleterre sauf le charbon", "A Letter of Advice to a Young Poet" (1721), de la vanité des ambitions et des milieux littéraires. La perte de toute influence politique, la nécessité de renoncer à toute ambition, l'éloignement offensant que lui montrait la population protestante, animée contre les Tories et contre les Stuarts, rendirent très-pénibles les premiers moments de sa chute. Il y réfléchit amèrement dans un court Essai sur la destinée des gens d'église ( An Essay on the fates of clergymen). ..
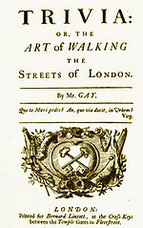
1713 - John Gay (1685-1732), intendant de la duchesse de Monmouth, puis placé par chez lord Clarendon, qui l'emmena au Hanovre, publie ses premiers poèmes, "Rural Sports" (1713), où il imite "Windsor Forest" (1713) de Pope, un poème héroï-comique "The Fan", que l'on rapproche de l'épopée satirique de Pope, "The Rape of the Lock", puis en 1714, , "The Shepherd's Week", six poèmes pastoraux parodiques, destinés à se moquer des pastorales d'Ambrose Philips (1675-1749), poète que Pope détestait.
Après quoi, ce fut "Trivia, or the Art of Walking the Streets of London" (1716), poème satirique, réaliste et plein d'humour, où Gay décrit avec minutie les mille spectacles offerts par les rues de Londres à l'époque géorgienne. Mieux que Boileau avec ses Embarras de Paris, nous dit-on, et moins grave qu'un Samuel Johnson dans son beau poème sur Londres, "the fountain of intelligence and pleasure" : "No Sir, when a man is tired of London, hie is tired of life; for there is in London all that life can afford". Gay n'était pas, comme Swift l'a dit un jour, "as arrant a cockney as any hosier in Cheapside" (un cockney aussi arrogant que n'importe quel bonnetier de Cheapside). Bien qu'il ait été apprenti chez un marchand de soie londonien, il est né et a fait ses études à Barnstaple et, malgré Swift, il pouvait "distinguish rye from barley, and an oak from a crab-tree".
Gay considérait Londres, non pas comme "the great scene of ambition, instruction, and amusement; comparatively speaking, a heaven upon earth" (Boswell), mais très concrètement comme un homme qui se lève à quatre heures du matin, prend le bateau pour Londres, et va errrer dans la pendant les vingt heures suivantes, ouvert à tout ce qu'il rencontrait, en hiver, au printemps, sous la pluie, le large pavé de Cheapside, Thames Street, qui s'étend du fossé de Fleet à la Tour, avec ses murs entourés de douves, malodorants à cause de la graisse bouillante des marchands de suif, du poisson rassis sur les étals des poissonniers, des piles de fromages du Cheshire, le beau Pall Mall, avec ses carrosses dorés, ses boutiques parfumées, ses fenêtres gaies de rubans brillants ; ou flamboyant le soir, tandis que les valets de pied attendent de raccompagner leurs maîtresses chez elles, Drury Lane, hanté par les "fair recluses", Burlington House, célèbre pour ses peintures et la résidence de Haendel, les marchés aux viandes de Newgate, Leaden- hall, et St. James, le marché aux fruits de Covent Garden, Moorfields, célèbre pour ses livres d'occasion... Et dans l'esprit de Garth's Dispensary et de Pope's Rape of the Lock, le projet burlesque de Gray consiste à rapporter le quotidien des rues de Londres d'exemples similaires tirés de la poésie classique latine et de la mythologie. Le poète, se frayant un chemin à travers la foule à la recherche d'un ami perdu, est Énée cherchant Creusa parmi les ruines de Troie, ou Nisus retournant à la recherche d'Euryale...
Book I, OF THE IMPLEMENTS FOR WALKING THE STREETS
AND SIGNS OF THE WEATHER
Through winter streets to steer your course aright;
How to walk clean by day, and safe by night;
How jostling crowds, with prudence, to decline;
When to assert the wall, and when resign;
I sing: thou, Trivia! goddess, aid my song,
Through spacious streets conduct thy bard along;
By thee transported, I securely stray
Where winding alleys lead the doubtful way,
The silent court and op'ning square explore,
And long perplexing lanes untrod before.
To pave thy realm, and smooth the broken ways,
Earth from her womb a flinty tribute pays:
For thee the sturdy pav'or thumps the ground,
Whilst ev'ry stroke his lab'ring lungs resound;
For thee the scavenger bids kennels glide
Within their bounds, and heaps of dirt subside.
My youthful bosom burns with thirst of fame,
From the great theme to build a glorious name;
To tread in paths to ancient bards unknown,
And bind my temples with a civic crown:
But more, my country's love demands the lays—
My country's be the profit, mine the praise.
When the black youth at chosen stands rejoice,
And "Clean your shoes" resounds from ev'ry voice;
When late their miry sides stage-coaches show,
And their stiff horses through the town move slow;
When all the Mall in leafy ruin lies,
And damsels first renew their oyster cries;
Then let the prudent walker shoes provide,
Not of the Spanish or Morocco hide;—
The wooden heel may raise the dancer's bound,
And with the scallop'd top his step be crown'd;—
Let firm well-hammer'd soles protect thy feet
Through freezing snows, and rains, and soaking sleet.
Should the big last extend the shoe too wide,
Each stone will wrench th' unwary step aside;
The sudden turn may stretch the swelling vein,
Thy cracking joint unhinge, or ancle sprain:
And when too short the modish shoes are worn,
You'll judge the seasons by your shooting corn.
Nor should it prove thy less important care,
To choose a proper coat for winter's wear.
Now in thy trunk thy D'Oily habit fold—
The silken drugget ill can fence the cold;
The freeze's spongy nap is soak'd with rain,
And show’rs soon drench the camblet's cockled grain:
True Witney broad-cloth, with its shag unshorn,
Unpierc'd is in the lasting tempest worn:
Be this the horseman's fence; for who would wear
Amid the town the spoils of Russia's bear?
BOOK II.
OF WALKING THE STREETS BY DAY.
Thus far the muse has trac'd, in useful lays,
The proper implements for wint'ry ways;
Has taught the walker with judicious eyes
To read the various warnings of the skies:
Now venture, muse! from home, to range the town,
And for the public safety risk thy own.
For ease and for dispatch the morning's best;
No tides of passengers the street molest.—
You'll see a draggled damsel here and there,
From Billingsgate her fishy traffick bear:
On doors the sallow milkmaid chalks her gains;
Ah! how unlike the milkmaid of the plains!
Before proud gates attending asses bray,
Or arrogate with solemn pace the way;—
These grave physicians, with their milky cheer,
The lovesick maid and dwindling beau repair.
Here rows of drummers stand in martial file,
And with their vellum thunder shake the pile,
To greet the new-made bride. Are sounds like these
The proper prelude to a state of peace?
Now Industry awakes her busy sons:
Full-charg'd with news the breathless hawker runs;
Shops open, coaches roll, carts shake the ground,
And all the streets with passing cries resound.
If cloth'd in black you tread the busy town,
Or if distinguish'd by the rev'rend gown,
Three trades avoid.—Oft in the mingling press
The barber's apron soils the sable dress:
Shun the perfumer's touch with cautious eye;
Nor let the baker's step advance too nigh.
Ye walkers! too, that youthful colours wear,
Three sullying trades avoid with equal care.—
The little chimney-sweeper skulks along,
And marks with sooty stains the heedless throng:
When "Small-coal" murmurs in the hoarser throat,
From smutty dangers guard thy threaten'd coat:
The dustman's cart offends thy clothes and eyes,
When through the street a cloud of ashes flies.
But whether black or lighter dyes are worn,
The chandler's basket, on his shoulder borne,
With tallow spots thy coat: resign the way,
To shun the surly butcher's greasy tray;—
Butchers! whose hands are died with blood's foul stain,
And always foremost in the hangman's train.
Let due civilities be strictly paid.
The wall surrender to the hooded maid;
Nor let thy sturdy elbow's hasty rage
Jostle the feeble steps of trembling age:
And when the porter bends beneath his load,
And pants for breath, clear thou the crowded road:
But, above all, the groping blind direct,
And from the pressing throng the lame protect.

"The Dunciad" (1728-1743), Alexander Pope...
Poème publié d'abord anonymement en trois livres en 1728, puis en quatre livres en 1743, dans sa forme définitive, rédigé en grande partie en pentamètre iambique. Le poème est considéré comme un chef-d'œuvre de la dérision héroïque. Après que Pope eut édité les œuvres de William Shakespeare pour les adapter aux goûts du XVIIIe siècle, l'érudit Lewis Theobald l'attaqua dans "Shakespeare Restored" (1726). Pope répondit en 1728 par la première version de son Dunciad, dans lequel Theobald apparaît comme Tibbald, fils préféré de la déesse de l'ennui (Dulness), un héros approprié pour ce que Pope considérait comme le règne du pédantisme. Un an plus tard, Pope publia "The Dunciad Variorum", dans lequel il développa le poème et ajouta de fausses notes de bas de page, des appendices, des errata et des préfaces, comme si la Dunciad elle-même était tombée entre les mains d'un pédant sans art. Pope n'a pas officiellement reconnu être l'auteur du Dunciad avant 1735, date à laquelle il l'a inclus dans un volume de ses œuvres collectives. En 1742, Pope publia The New Dunciad, conçu comme le quatrième livre du Dunciad ; dans ce livre, l'empire de la déesse de l'ennui est devenu universel. La même année, le poète lauréat Colley Cibber a attaqué Pope dans la presse ; Pope a répondu en révisant le Dunciad de manière à remplacer Théobald par Cibber comme héros douteux de l'œuvre. Le résultat, The Dunciad in Four Books (1743), rassemble, sous une forme révisée, les livres et l'appareil critique des versions précédentes.
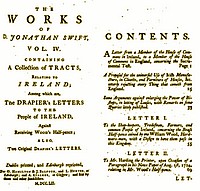
1724-1725, Swift, "Drapier's letters"
- La prospérité dont l’Irlande avait joui sous les princes de la maison de Stuart avait été interrompue par une guerre civile , dont l’issue avait forcé l’élite de sa noblesse et de ses militaires â s’exiler. La population catholique de ce royaume n’excitait que méfiance et était frappée par là d’une entière incapacité. Le parlement d’Angleterre s’était arrogé le pouvoir de faire des lois pour l’Irlande ; et il l’exerçait de manière à enchaîner, autant que possible , le commerce de ce royaume , à le subordonner au commerce de l’Angleterre et a le tenir dans sa dépendance. Les statuts de la dixième et onzième année du règne de Guillaume III prohibaient l’exportation des marchandises de laine, excepté en Angleterre et dans la principauté de Galles. Les manufactures d’Irlande se trouvèrent par la privées d’un revenu évalué a un million sterling. Pas une voix ne s’éleva dans la Chambre des Communes contre ces mesures tyranniques.
En 1720, devant l'état déplorable de l'Irlande, Swift écrit un court pamphlet exhortant l'Irlande à ne consommer que ses produits manufacturiers, à l'exclusion de ceux de l'Angleterre ("A proposal for the universal use of Irish manufacture"). L'état des Irlandais «était devenu pire que celui des paysans de France, des serfs d'Allemagne et de Pologne», «Quiconque voyage dans ce pays et y considère l'aspect de la nature, l'aspect, l'extérieur et les habitations des hommes, ne se croira pas dans une contrée où la loi, la religion, où la plus vulgaire humanité soient respectées».
Ses "Drapier's letters", sept pamphlets écrits entre 1724 et 1725, sous le pseudonyme MB, Drapier, pour fuir toutes représailles («To the Shop-keepers, Tradesmen, Farmers, and Common-People of Ireland»), tentent de soulever l'opinion publique contre l'imposition d'une monnaie de cuivre frappée en privé par un certain William Wood,et dénonçant une Irlande constitutionnellement et financièrement dépendante de la Grande-Bretagne.
La quatrième lettre du drapier, "To the Whole People of Ireland, A Word or Two to the Ireland, A Short Defence of the Ireland" (1724) élevait le débat jusqu'aux proportions d'une lutte entre l'Irlande et l'Angleterre, limitait le pouvoir royal et prêtait à Wood l'odieuse vanterie de réduire les Irlandais à « manger leurs sabots» (That we must either take those halfpence or eat our brogues) et absolvait Walpole de toute complicité, par ce paragraphe à double entente : «Je démontre au- delà de toute contradiction que M. Walpole est contre le projet Wood et ami de l'Irlande par cet unique et invincible argument. L'opinion universelle est que c'est un homme sage, un ministre habile, cherchant le véritable intérêt du roi dans toutes ses actions, au-dessus de toute corruption par son intégrité, et de toute tentation par sa fortune».
Exclu de la Chambre des communes le 17 juin 1711, pour concussion notoire dans l'administration de la guerre, rentré en 1713 dans la vie publique , devenu le chef du gouvernement de George Ier , diffamant ceux qu'il ne pouvait pas acheter en les faisant passer pour vendus, Walpole supporta impatiemment le cynique éloge de Swift. On ne put mettre en accusation l'imprimeur de ces lettres, le gouvernement résilia son accord avec Wood, Swift venait de faire reculer de 15 années l'émission d'une monnaie de cuivre en Irlande, et était apparu de nouveau sur la scène, plus important et plus redouté que jamais.
En 1726, il alla jouir de son triomphe à Londres et eut avec Walpole une entrevue qui fit croire à un marché entre l'homme d'Etat et l'écrivain qui venait de prouver ce que valait son influence. Malgré la bienveillance affectée de sir Walpole et l'éloge compromettant qu'il faisait de Swift dans le monde, celui-ci ne devenant pas évêque et ne pouvant même réussir à échanger son doyenné de Saint- Patrick contre une position équivalente en Angleterre, donna peu de prise à cette accusation.
En même temps, Swift noua des relations étroites et entretint de grandes espérances du côté du futur roi d'Angleterre. Le prince de Galles, sa femme Caroline, sa favorite Miss Howard, attirèrent Swift dans leur petite cour et lui firent un accueil qui semblait devoir réparer toutes les déceptions antérieures du doyen de Saint-Patrick.
Mais au milieu de ces succès et de ces familiarités royales, Swift fut rappelé en Irlande, Stella se mourrait et espérait toujours apparaître publiquement comme sa femme. En 1728, Stella mourut. Les récits qui nous sont laissés de sa mort sont tous deux aussi déchirants et aussi accablants l'un que l'autre pour la mémoire de Swift...

1726 - "Gulliver's Travels", or Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships.".....
Swift revint en Irlande au mois d'août 1726, et y fut reçu avec plus d'acclamations et d'honneurs que n'en eût obtenu le souverain. Au commencement du mois de novembre, Gulliver s'imposait à Londres. «Il y a environ dix jours, écrivait Gay à Swift, lé 17 novembre 1726, fut publié ici un livre sur les voyages d'un certain Gulliver, qui depuis fait l'entretien de toute la ville ; toute l'édition fut vendue en une semaine , et rien n'est plus divertissant que d'entendre les opinions différentes de tout le monde sur ce livre, que tout le monde cependant s'accorde à goûter au dernier point. On dit généralement que vous en êtes l'auteur, mais le libraire déclare qu'il ne sait pas de quelle main il l'a reçu. Du haut en bas de la société, tout le monde le lit , du cabinet des ministres jusqu'à la chambre de la nourrice. Vous voyez qu'on ne vous fait pas injure en vous l'attribuant. S'il est de vous, vous avez désobligé deux ou trois de vos meilleurs amis, en ne leur donnant pas le moindre soupçon. Peut-être que, pendant tout ce temps, je vous parle d'un livre que vous n'avez jamais vu , et qui n'a pas encore touché l'Irlande. S'il en est ainsi, je crois que ce que j'en ai dit suffît pour vous donner l'envie de le lire et que vous me prierez de vous l'envoyer... » Et Pope félicitait Swift sans détour, «Je prédis, écrivait-il, que ce livre fera désormais l'admiration de tous les hommes».
Swift, lui-même, avait le sentiment de la grandeur de son œuvre, lorsqu'au mois d'août 1727, répondant à une lettre où l'abbé Desfontaines s'excusait d'avoir altéré Gulliver pour le rapprocher du goût de la France, il écrivait au timide traducteur : «Si les livres du sieur Gulliver ne sont calculés que pour les îles britanniques, ce voyageur doit passer pour un très-pitoyable écrivain. Les mêmes vices et les mêmes folies règnent partout; du moins dans tous les pays civilisés d'Europe ; et l'auteur qui n'écrit que pour une ville , une province , un royaume ou même un siècle , mérite si peu d'être traduit qu'il ne mérite pas d'être lu. Les partisans de ce Gulliver, qui ne laissent pas que d'être en fort grand nombre chez nous, soutiennent que son livre durera autant que notre langue , parce qu'il ne tire pas son mérite de certaines modes ou manières de penser et de dire , mais d'une suite d'observations sur les imperfections, les folies et les vices de l'homme »
C'est en effet à l'être humain qu'en veut Gulliver et à tout ce que l'on voit de plus excellent en lui-même et dans le monde où il domine. La politique , rabaissée dans le voyage de Lilliput aux débats d'une fourmilière, disparaît devant la calme sagesse des habitants de Brobdingnag et de ce roi philosophe qui , prenant dans sa main et caressant doucement le panégyriste éloquent des institutions et des mœurs de l'Angleterre , lui dit , sans émotion , que d'après ses propres peintures, «la plupart de ses compatriotes sont la plus pernicieuse vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper sur la surface de la terre». Laputa est le théâtre décourageant et ridicule de nos sciences, de nos inventions, de nos efforts pour rendre le séjour de la terre plus supportable, et abaisse les plus nobles occupations de l'esprit humain. Mais l'île de Houyhnhnms est l'abîme où l'humanité s'engloutit tout entière ; les arts, les lois, les mœurs, la religion, la raison même, tout succombe ; la beauté s'avilit, l'amour fait horreur, et après cette universelle dégradation de tout ce qui peut occuper, charmer, élever l'homme sur la terre, on n'est plus surpris de voir le voyageur qui est rejeté parmi le genre humain, au sortir d'une telle épreuve, se voiler la face et refuser de voir des hommes...

Gulliver's Travels - I - A VOYAGE TO LILLIPUT..
Les Voyages de Gulliver se compose de quatre parties ou voyages (Édition illustrée par Grandville).
Dans la première partie , Gulliver, chirurgien embarqué sur un navire marchand, raconte comment il fit naufrage et aborda à l`île de Lilliput, dont les habitants mesuraient environ six pouces. Profitant du sommeil et de l'épuisement de Gulliver, les Lilliputiens le garrottent à l`aide de mille petits liens et le transportent à l'intérieur des terres, jusqu`à leur capitale où Gulliver, enchaîné par mesure de précaution, émerveille la population par sa taille et divertit grandement l'empereur et sa cour....
"Après avoir attendu trois ans , et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j’acceptai une offre avantageuse qui me fut faite par le capitaine Guillaume Prichard , prêt à monter l’Antilope , et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol, le 4 mai 1699, et notre voyage fut d’abord très heureux. Il est inutile d’ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers ; c’est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une violente tempête qui nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van-Diemen. Nous nous trouvions alors par trente degrés deux minutes de latitude méridionale. Douze de nos hommes étaient morts d’excès de fatigue et de mauvaise nourriture ; les autres étaient dans un état d’épuisement absolu. Le 5 novembre , commencement de l’été dans ces pays-là , le ciel étant très sombre, les matelots aperçurent un rocher qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d’un demi-câble ; mais le vent était si fort que nous fûmes poussés directement contre l’écueil , et brisés aussitôt. Six hommes de l’équipage (j’étais du nombre) , s’étant jetés dans la chaloupe , trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du rocher. Nous allâmes à la rame environ trois
lieues; mais à la fin la lassitude ne nous permit plus de ramer. Entièrement épuisés, nous nous abandonnâmes au gré des flots ; et environ une demi-heure après nous fûmes renversés par un coup de vent du nord.
Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, non plus que de ceux qui se sauvèrent sur le rocher ou qui restèrent dans le vaisseau ; mais je crois qu’ils périrent tous : pour moi, je nageai à l’aventure, et fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes , mais sans toucher le fond. Enfin , étant près de m'abandonner, je trouvai pied dans l’eau ; et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible , je marchai une demi-lieue dans la mer avant de prendre terre ; dans ce moment-là je supposai qu’il pouvait être environ huit heures et demie du soir. Je fis près d’un quart de lieue sans découvrir aucune maison , ni aucun vestige d’habitants ; ou du moins j’étais trop exténué pour les apercevoir. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d’eau-de-vie que j’avais bue en abandonnant le vaisseau, tout cela m’entraîna à dormir. Je me couchai sur l’herbe , qui était très fine et très douce ; bientôt je fus enseveli dans le plus profond sommeil que j’eusse jamais goûté , et qui dura environ neuf heures , car je ne m’éveillai qu’au jour. J’essayai alors de me lever; mais ce fut en vain. Comme je m’étais couché sur le dos , je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre de l’un et de l’autre côté , et mes cheveux , qui étaient longs et épais , attachés de la même manière. Je trouvai même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps depuis mes aisselles jusqu’à mes cuisses.
Je ne pouvais regarder que le ciel ; le soleil commençait à être fort chaud, et sa grande clarté fatiguait mes yeux. J’entendis un bruit confus autour de moi ; mais dans la posture où j’étais je ne pouvais, je le répète, rien voir que le ciel. Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche , et cet objet , avançant doucement sur ma poitrine , monter presque jusqu’à mon menton. Dirigeant, comme je le pus, ma vue de ce côté, j’aperçus une créature humaine, haute tout au plus de six pouces , tenant à la main un arc et une flèche , et portant un carquois sur le dos ! J’en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce qui la suivaient.
Dans ma surprise, je jetai de tels cris, que tous ces petits êtres se retirèrent saisis de peur ; et il y en eut même quelques-uns, comme je l’ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes qu’ils firent en se précipitant à terre. Néanmoins ils revinrent bien- tôt ; et un d’eux , qui eut la hardiesse de s’avancer assez pour voir entièrement mon visage , levant les mains et les yeux en signe d’étonnement, s’écria d’une voix aigre, mais distincte : hekinah degul. Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots ; mais je n’en compris pas alors le sens.
(I attempted to rise, but was not able to stir : for as I happened to lie on my back, I found my arms and legs were strongly fastened on each side to the ground ; and my hair, which was long and thick, tied down in the same manner. I likewise felt several slender ligatures across my body, from my arm-pits to my thighs. I could only look upwards, the sun began to grow hot, and the light offended my eyes. I heard a confused noise about me, but in the posture I lay, could see nothing except the sky. In a little time I felt something alive moving on my left leg, which advancing gently forward over my breast, came almost up to my chin ; when bending my eyes downwards as much as I could, I perceived it to be a human creature not six inches high, with a bow and arrow in his hands, and a quiver at his back. In the mean time, I felt at least forty more of the same kind (as I conjectured) following the first. I was in the utmost astonishment, and roared so loud, that they all ran back in a fright; and some of them, as I was after- wards told, were hurt with the falls they got by leaping from my sides upon the ground. However, they soon returned, and one of them, who ventured so far as to get a full sight of my face, lifting up his hands and eyes by way of admiration, cried out in a shrill, but distinct voice, Hekinah degul: the others repeated the same words several times, but then I knew not what they meant.)
J’étais pendant ce temps-là, comme le lecteur peut le penser, dans une position fort gênante. Enfin, par mes efforts pour me mettre en liberté, j’eus le bonheur de rompre les cordons ou fils , et d’arracher les che- villes qui attachaient mon bras droit à la terre; car en le haussant un peu, j’avais découvert ce qui me tenait captif. En même temps , par une secousse violente qui me causa une douleur extrême , je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit , en sorte que je me trouvai en état de tourner un peu la tête. Alors ces insectes humains prirent la fuite avant que je pusse les toucher, et poussèrent des cris très aigus. Ce bruit cessant, j’entendis un d’eux s’écrier : tolgo phonac; et aussitôt je me sentis percé à la main gauche de plus de cent flèches qui me piquaient comme autant d’aiguilles. Ils en firent ensuite une autre décharge en l’air, comme nous tirons des bombes en Europe; plusieurs, je crois, me tombaient sur le corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d’autres s’abattaient sur mon visage, que je tâchai de couvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée , je m’efforçai encore de me dégager; mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première, et quelques-uns tachaient de me percer de leurs lances ; mais par bonheur je portais une veste de peau de buffle qu’ils ne pouvaient traverser. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos, et de rester comme j’étais jusqu’à la nuit ; qu’alors , dégageant mon bras gauche , je pourrais me mettre tout-à-fait en liberté ; et à l’égard des habitants , c’était avec raison que je me croyais d’une force égale aux plus puissantes armées qu’ils pourraient mettre sur pied pour m’attaquer, s’ils étaient tous de la même taille que ceux que j’avais vus. Mais la fortune me réservait un autre sort.
Quand ces gens eurent remarqué que j’étais tranquille, ils cessèrent de me décocher des flèches; mais une rumeur croissante m’apprit que leur nombre s’augmentait considérablement ; et environ à deux toises de moi , vis- à-vis de mon oreille droite, j’entendis, pendant plus d’une heure , comme un bruit de gens qui travaillaient. Enfin , tournant un peu ma tête de ce côté-là , autant que les chevilles et les cordons me le permettaient , je vis un échafaud élevé de terre d’un pied et demi , où quatre de ces petits hommes pouvaient se placer, et deux ou trois échelles pour y monter ; d’où un d’entre eux , qui me semblait être une personne de condition , me fit une harangue assez longue, dont je ne compris pas un mot. Avant que de commencer, il s écria trois fois : langro dehul san. (Ces mots furent répétés par la suite, et me furent expliqués , ainsi que les précédents. ) Aussitôt cinquante hommes s’avancèrent, et coupèrent les cordons qui attachaient le côté gauche de ma tête; ce qui me donna la liberté de la tourner à droite , et d’observer la figure et l’action de celui qui devait parler. Il me parut être d'un âge moyen, et d’une taille plus grande que les trois autres qui l’accompagnaient , dont l’un , qui avait l’air d’un page et était à peu près haut comme mon doigt , tenait la queue de sa robe , et les deux autres étaient debout de chaque côté pour le soutenir. Ils remplissait convenablement son rôle d’orateur, et je crus voir se succéder la menace et la promesse dans son dis- cours , qui contenait aussi des mouvements de compassion et de sensibilité. Je fis la réponse en peu de mots , mais du ton le plus soumis , levant la main gauche et les yeux vers le soleil, comme pour le prendre à témoin que je mourais de faim, n’ayant rien mangé depuis longtemps.
Mon appétit était en effet si pressant, que je ne pus m’empêcher de faire voir mon impatience (peut-être d’une façon un peu incivile) en portant souvent mon doigt à ma bouche, pour faire connaître que j’avais besoin de nourriture. L'hurgo ( c’est ainsi que parmi eux on appelle un grand seigneur, comme je l’ai su depuis) me comprit fort bien. Il descendit de l’échafaud, et fit appliquer à mes côtés plusieurs échelles, sur lesquelles montèrent bientôt une centaine d’hommes , qui se mirent en marche vers ma bouche , chargés de paniers pleins de viandes , réunis et envoyés par les ordres de leur souverain dès qu’il avait eu connaissance de mon arrivée. J’observai qu’il y avait de la chair de différents animaux; mais je ne pus les distinguer par le goût. Il y avait des gigots , des épaules et des éclanches taillées comme du mouton , et fort bien accommodées , mais plus petites que les ailes d’une alouette ; j’en avalais deux ou trois d’une bouchée avec trois pains gros comme des balles de fusil. Ils me fournirent tout cela , témoignant de grandes marques d'étonnement et d’admiration à la vue de ma taille et de mon prodigieux appétit.
Je fis un autre signe pour leur indiquer qu’il me manquait à boire; ils conjecturèrent, par la façon dont je mangeais, qu’une petite quantité de boisson ne me suffirait pas ; et , comme ils étaient ingénieux , ils levèrent avec beaucoup d’adresse un des plus grands tonneaux de vin qu’ils eussent , le roulèrent vers ma main , et le défoncèrent. Je le bus d’un seul coup , ce qui ne me fut pas très-difficile, car il ne contenait pas plus d’une demi- pinte ; ce vin avait un peu le goût du bourgogne , mais il était plus agréable. On m’en apporta un autre muid, que je bus de même, et je fis signe qu’on m’en amenât encore d’autres ; mais on n’en avait plus à me donner.
Après m’avoir vu faire toutes ces merveilles , ils poussèrent des cris de joie , et se mirent à danser sur ma poitrine, répétant plusieurs fois, comme ils avaient fait d’abord ; hekinah degul. Ils m’indiquèrent par signes que je pouvais jeter à terre les deux muids ; mais ils avertirent d’abord les assistants de s’éloigner, en criant : borach mevolah; et quand ils virent les deux muids en l’air, ce fut un houra général.
J’avoue que je fus plusieurs fois tenté, pendant qu’ils allaient et venaient sur mon corps , de saisir quarante ou cinquante des premiers qui se trouveraient à ma portée , et de les lancer à terre ; mais le souvenir de ce que j’avais déjà souffert, qui peut-être n'était pas le pis qu’ils pouvaient m’infliger, et la promesse que je leur avais faite tacitement de ne point exercer ma force contre eux , me firent éloigner ces pensées de mon esprit. D’ailleurs je me regardais comme lié par les lois de l’hospitalité envers un peuple qui venait de me traiter avec tant de magnificence. Cependant je ne pouvais me lasser d’admirer la hardiesse de ces petits êtres qui s’aventuraient à monter et à se promener sur mon corps , tandis qu’une de mes mains était libre.
Lorsqu’ils virent que je ne demandais plus à manger, ils conduisirent devant moi une personne d’un rang supérieur qui m’était envoyée par Sa Majesté. Son Excellence monta sur le bas de ma jambe , et s’avança jusqu’à mon visage avec une douzaine de gens de sa suite. Il me présenta ses lettres de créance revêtues du sceau royal , les plaça tout près de mes yeux , et fit un discours d’environ dix minutes , d’un ton calme , mais résolu , montrant de temps en temps le côté de l’horizon qui s’étendait en face de nous. C’était la direction dans laquelle était située la capitale , à une demi-lieue à peu près; et le roi avait arrêté dans son conseil que j’y serais transporté. Je répondis en peu de mots , qui ne furent pas entendus , et je recourus aux signes ; passant la main qu’on avait laissée libre par dessus les têtes de l’envoyé et de son monde, je l’appliquai sur mon autre main et sur ma tête. Le seigneur comprit que je désirais être détaché ; mais il me fit entendre que je devais être transporté dans l’état où j’étais. Toutefois il m’assura par d’autres signes que l’on me donnerait tout ce qui me serait nécessaire. Le désir d’essayer de briser mes liens me revint fortement; mais lorsque je sentis la pointe de leurs flèches sur mes mains , déjà couvertes d’ampoules , et sur mon visage , plusieurs de ces petits dards étant restés dans ma chair, et le nombre de mes ennemis augmentant de moment en moment , je montrai l’intention de me soumettre à tout ce qu’ils voudraient faire de moi. Alors l'hurgo ( le seigneur ) et sa suite se retirèrent avec beaucoup de marques de civilité et de satisfaction.
Bientôt après j’entendis une acclamation universelle , avec de fréquentes répétitions de ces mots : peplum selan ; et j’aperçus à ma gauche un grand nombre de gens relâchant les cordons à un tel point que je me trouvai en état de me tourner à droite, et d’uriner, fonction dont je m’acquittai abondamment au grand étonnement du peuple, lequel, devinant ce que j’allais faire, s’ouvrit impétueusement à droite et à gauche pour éviter le déluge. Quelque temps auparavant on m’avait frotté charitablement le visage et les mains d’une espèce d’onguent d’une odeur agréable, qui en très-peu de temps me guérit de la piqûre des flèches. Ces circonstances, jointes aux rafraîchissements que j’avais reçus, et à la nourriture solide que j’avais prise, me disposèrent à dormir; et mon sommeil fut d’environ huit heures , ainsi que je m’en assurai plus tard , les médecins, par ordre de l’empereur, ayant mêlé au vin une potion soporifique...."
"... Ces peuples excèlent dans les mathématiques et la mécanique, sciences particulièrement encouragées par leur souverain. Ce prince possède de très ingénieuses machines de transport, capables de porter des vaisseaux de guerre (quelquefois longs de neuf pieds) des forêts où ils ont été construits jusqu’à la côte. Cinq cents ingénieurs ou charpentiers furent chargés de préparer une de ces machines de la dimension convenable pour me transporter. C’était un chariot de sept pieds de long sur quatre de large, posé sur vingt-deux roues et élevé d’un demi- pied. Le bruit que j’avais entendu venait de l’approche de cette machine, qui fut placée parallèlement à mon corps. La principale difficulté était de me hisser dans la voiture ; à cet effet on planta quatre-vingts poteaux ; de fortes cordes de la grosseur de bon fil d’emballage furent attachées à des bandes que l’on avait passées autour de mon corps, de mes bras, de mes jambes et de mon cou. Alors neuf cents hommes robustes tirèrent les cordes par des poulies fixées aux poteaux, et Je fus ainsi élevé, jeté sur la machine, et solidement attaché. Tout cela me fut raconté; car, pendant le temps de l’opération, je dormais du plus profond sommeil. Quinze cents chevaux vigoureux me traînèrent jusqu’à la capitale, à un demi -mille de distance..."

Remis en liberté pour sa bonne conduite, Gulliver, qui a appris la langue du pays, s'initie aux mœurs, lois et coutumes des Lilliputiens. Il apprend ainsi que l`empire est divise depuis longtemps par des luttes intestines opposant les porteurs de talons hauts aux porteurs de talons bas. En outre, les Lilliputiens sont depuis des années en guerre avec l`empereur Blefuscu, dont la domination s`étend sur une île voisine : cette guerre a eu pour origine la controverse des Petits-boutiens et des Grands-boutiens sur la question capitale de savoir par quel bout il faut casser les œufs; les Gros-boutiens exilés avaient trouvé refuge auprès de Blefuscu, lequel s'apprête justement à envahir Lilliput. L'intervention de Gulliver, lequel s'en va capturer la flotte de Blefuscu, en tirant les navires derrière lui comme autant de jouets, sauve l`empire ; Blefuscu fait demander la paix.
On comble Gulliver d`honneurs et de titres. Mais les courtisans, jaloux, veulent sa perte : l' "homme-montagne" ayant éteint un incendie qui menaçait de détruire le palais impérial en l'arrosant d`urine, on l'accuse d'un crime de lèse-majesté. Averti à temps, répugnant à user de sa force, il s`enfuit dans le royaume de Blefuscu. Enfin la mer ayant rejeté au rivage une chaloupe abandonnée, Gulliver s`embarque, est recueilli par un navire anglais et regagne sa patrie.
"..Quinze jours après que j’eus obtenu ma liberté, Reldresal, secrétaire d’État pour le département des affaires particulières, se rendit chez moi, suivi d’un seul domestique. Il ordonna que son carrosse l’attendit à quelque distance, et me pria de lui donner une heure d’attention. Je lui offris de me coucher, afin qu’il pût être de niveau à mon oreille; mais il aima mieux que je le tinsse dans ma main pendant la conversation.
Il commença par me faire des compliments sur ma liberté, et me dit qu’il pouvait se flatter d’y avoir un peu contribué. Puis il ajouta que, sans l’intérêt que la cour y avait mis, je ne l’eusse pas sitôt obtenue; «car, dit-il, quelque florissant que notre État paraisse aux étrangers, nous avons deux grands fléaux à combattre : une faction puissante au dedans , et au dehors l’invasion dont nous sommes menacés par un ennemi formidable. A l’égard du premier, il faut que vous sachiez que, depuis plus de soixante et dix lunes, il y a eu deux partis opposés dans cet empire, sous les noms de "tramecksan" et "slamecksan", termes empruntés des hauts et bas talons de leurs souliers , par lesquels ils se distinguent.
On prétend, il est vrai, que les talons hauts sont les plus conformes à notre ancienne constitution: mais, quoi qu’il en soit, Sa Majesté a résolu de ne se servir que des talons bas dans l’administration du gouvernement et dans toutes les charges qui sont à la disposition de la couronne. Vous pouvez même remarquer que les talons de Sa Majesté impériale sont plus bas au moins d’un drurr que ceux d’aucun de sa cour. (Le drurr est environ la quatorzième partie d’un pouce).
(As to the first, you are to understand, that for above seventy moons past there have been two struggling parties in this empire, under the names of Tramecksan and Slamechan from the high and low heels of their shoes, by which they distinguish themselves. It is alleged, indeed, that the high heels are most agreeable to our ancient constitution ; but, however this be, his majesty has determined to make use only of low heels in the administration of the government, and all offices in the gift of the crown, as you cannot but observe ; and particularly that his majesty's imperial heels are lower at least by a drurr than any of his court : drurr is a measure about the fourteenth part of an inch.
The animosities between these two parties run so high, that they will neither eat, nor drink, nor talk with each other. We compute the Tramecksafiy or high heels, to exceed us in number } but the power is wholly on our side. We apprehend his imperial highness, the heir to the crown, to have some tendency towards the high heels ; at least we can plainly discover that one of his heels is higher than the other, which gives him a hobble in his gait.
Now, in the midst of these intestine cfisquiets, we are threatened with an invasion from the island of Blefuscu, which is the other great empire of the universe, almost as large and powerful as this of his majesty....)
La haine des deux partis, continua-t-il , est à un tel degré, qu’ils ne mangent ni ne boivent ensemble, et qu’ils ne se parlent point. Nous comptons que les tramecksans ou hauts talons nous surpassent en nombre; mais l’autorité est entre nos mains. Hélas! nous craignons beaucoup que Son Altesse impériale, l’héritier présomptif de la couronne, n’ait quelque penchant pour les hauts talons; au moins nous pouvons facilement voir qu’un de ses talons est plus haut que l’autre, ce qui le fait un peu clocher dans sa démarche. Or, au milieu de ces dissensions intestines, nous sommes menacés d’une invasion de la part de l’île de Blefuscu , qui est l’autre grand empire de l’univers , presque aussi vaste et aussi puissant que celui-ci, car, à parler franchement, nos philosophes doutent fort de l’existence, dans notre monde, de ces États desquels vous nous avez entretenus, et qui seraient habités par des créatures humaines aussi grosses et aussi grandes que vous ; ils sont plus disposés à croire que vous êtes tombé de la lune ou d’une des étoiles, parce qu’il est certain qu’une centaine de mortels de votre grosseur consommerait dans peu de temps tous les fruits et tous les bestiaux des États de Sa Majesté. D’ailleurs, nos historiens, depuis six mille lunes, ne font mention d’aucunes autres régions que des deux grands empires de Lilliput et de Blefuscu. Ces deux formidables puissances ont, comme j’allais vous le dire, été engagées pendant trente-six lunes dans une guerre très-opiniâtre dont voici le sujet.
Tout le monde convient que la manière primitive de casser les œufs avant de les manger , est de les casser au gros bout; mais l’aïeul de Sa Majesté régnante, pendant qu’il était enfant, voulant casser un œuf à l’ancienne manière, eut le malheur de se couper le doigt; sur quoi l’empereur son père ordonna à tous ses sujets, sous de graves peines, de casser leurs œufs par le petit bout. Le peuple fut si irrité de cette loi, que nos historiens racontent qu’il y eut à cette occasion six révoltes, dans lesquelles un empereur perdit la vie, et l’autre la couronne. Ces dissensions intestines furent toujours fomentées par les souverains de Blefuscu ; et quand les soulèvements étaient réprimés, les coupables se réfugiaient dans cet empire. On suppose que onze mille hommes ont, à différentes époques, subi la mort plutôt que de se soumettre à la loi de casser leurs œufs par le petit bout. Plusieurs centaines de gros volumes ont été écrits et publiés sur cette matière ; mais les livres des gros-boutiens ont été défendus depuis longtemps, et tout leur parti a été déclaré par les lois incapable de posséder des charges. Pendant la suite continuelle de ces troubles, les empereurs de Blefuscu ont souvent fait des remontrances par leurs ambassadeurs, nous accusant de faire un crime en violant un précepte fondamental de notre grand prophète Lustrogg, dans le cinquante-quatrième chapitre du Blundecral (qui est leur Alcoran).
Cependant il s’agissait simplement d’une interprétation différente du texte dont voici les mots : "Que tous les fidèles casseront leurs œufs au bout le plus commode". On doit, à mon avis, laisser décider à la conscience de chacun quel est le bout le plus commode; ou au moins c’est à l’autorité du souverain magistrat d’en décider. Or, les gros-boutiens exilés ont trouvé tant de crédit à la cour de l’empereur de Blefuscu , et tant de secours et d’appui dans notre pays même, qu’une guerre très-sanglante a régné entre les deux empires pendant trente-six lunes à ce sujet, avec différents succès. Dans cette guerre nous avons perdu quarante vaisseaux de ligne et un bien plus grand nombre de petits vaisseaux, avec trente mille de nos meilleurs matelots et soldats: l’on compte que la perte de l’ennemi n’est pas moins considérable. Quoi qu’il en soit, il arme à présent une flotte très-redoutable, et se prépare à faire une descente sur nos côtes. Or, Sa Majesté impériale, menant sa confiance en votre valeur, et ayant une haute idée de vos forces , m’a commandé de vous donner ce détail au sujet de ses affaires, afin de savoir quelles sont vos dispositions à son égard. »
Je répondis au secrétaire que je le priais d’assurer l’empereur de mes très-humbles respects, et de lui faire savoir que j’étais prêt à sacrifier ma vie pour défendre sa personne sacrée et son empire contre toutes les entreprises et invasions de ses ennemis. Il me quitta, fort satisfait de ma réponse..."

Le plan de la satire varie dans ses différentes parties. Le voyage à Lilliput est une allusion à la cour et à la politique de l’Angleterre : sir Robert Walpole est peint dans le personnage du premier ministre Flimnap. La chute du grand-trésorier de Lilliput, qui tombe de la corde sur laquelle il dansait, et qui se casse la jambe en touchant un des coussins du roi , fait allusion à la démission de Walpole en 1717, qui ne fut pas acceptée par les sollicitations de la duchesse de Kendal en sa faveur. Le ridicule jeté sur les ordres de chevalerie par le tableau des nobles Lilliputiens qui sautent par dessus un bâton pour obtenir un fil bleu , rouge, ou vert , est un trait lancé contre Walpole, qui, pour multiplier les honneurs et les récompenses, rétablit l’ordre du Bain , comme un premier degré à celui de la Jarretière.
".. Dans le choix qu’on fait des sujets pour remplir les emplois, on a plus d’égard à la probité qu’au grand génie. Comme le gouvernement est nécessaire au genre humain, on croit que la Providence n’eut jamais dessein de faire de l’administration des affaires publiques une science difficile et mystérieuse qui ne pût être possédée que par un petit nombre d’esprits rares et sublimes, tels qu’il en naît au plus deux ou trois dans un siècle; mais on juge que la vérité, la justice, la tempérance et les autres vertus, sont à la portée de tout le monde, et que la pratique de ces vertus, accompagnée d’un peu d’expérience et de bonne intention, rend tout homme de bon sens propre au service de son pays. On est persuadé que le défaut des vertus morales est loin de pouvoir être suppléé par les talents supérieurs de l’esprit; ceux-ci rendraient les personnes qui les posséderaient et n’auraient ni bonnes mœurs ni bonne foi, plus dangereuses dans les emplois que ne pourrait l’être un ministre ignorant et borné, mais intègre. On pense que les erreurs d’un honnête homme ne peuvent être aussi funestes au bien public, que les pratiques ténébreuses d’un ministre dont les inclinations seraient corrompues, dont les vues seraient criminelles, et qui trouverait dans les ressources de son esprit de quoi faire le mal impunément.
Celui qui ne croit pas à une Providence divine parmi les Lilliputiens est déclaré incapable de posséder aucun emploi public. Comme les rois se prétendent à juste titre les députés de la Providence, les Lilliputiens jugent qu’il n’y a rien de plus absurde et de plus inconséquent que la conduite d’un prince qui se sert de gens sans religion, qui nient cette autorité suprême dont il se dit le dépositaire, et dont en effet il emprunte la sienne.
Je dois faire observer que je parle ici des lois fondamentales des Lilliputiens, et non des institutions modernes introduites par la corruption inhérente à l’espèce humaine, telle, par exemple, que cette honteuse manière d’obtenir les grandes charges en dansant sur la corde, et les marques de distinction en sautant par-dessus un bâton. Cet indigne usage fut établi par le père de l’empereur régnant.
L’ingratitude, est, parmi ces peuples, un crime capital, comme nous apprenons dans l’histoire qu’elle l’a été autrefois aux yeux de quelques nations vertueuses. Un homme capable de nuire même à son bienfaiteur est nécessairement l’ennemi de tous les autres hommes; par conséquent, il est indigne de vivre. Ainsi raisonnent les Lilliputiens..."
"In choosing persons for all employments, they have more regard to good morals than to great abilities ; for, since government is necessary to mankind, they believe that the common size of human understanding is fitted to some station or other ; and that Providence never intended to make the management of public affairs a mystery to be comprehended only by a few persons of sublime genius, of which there seldom are three born in an age ; but they suppose truth, justice, temperance, and the like, to be in every man's power ; the practice of which virtues, assisted by experience and a good intention, would qualify any man for the service of his country, except where a course of study is required. But they thought the want of moral virtues was so far from being supplied by superior endowments of the mind, that employments could never be put into such dangerous hands as those of persons so qualified ; and at least, that the mistakes committed by ignorance, in a virtuous disposition, would never be of such fatal consequence to the public weal, as the practices of a man whose inclinations led him to be corrupt, and who had great abilities to manage, to multiply, and defend his corruptions.
In like manner, the disbelief of a Divine Providence renders a man incapable of holding any public station ; for, since kings avow themselves to be the deputies of Providence, the Lilliputians think nothing can be more absurd than for a prince to employ such men as disown the authority under which he acts.
In relating these and the following laws, I would only be understood to mean the original institutions, and not the most scandalous corruptions, into which these people are fallen by the degenerate nature of man. For, as to that infamous practice of acquiring great employments by dancing on the ropes, or badges of favour and distinction by leaping over sticks and creeping under them, the reader is to observe that they were first introduced by the grandfather of the emperor now rdgning, and grew to the present height by the gradual increase of party and faction..."
Walpole ne le pardonna pas à Swift : aussi s’opposa-t-il constamment à tout projet qui aurait pu amener le doyen en Angleterre. Les factions des torys et des whigs sont désignées par les factions des talons hauts et des talons plats; les petit-boutiens et les gros-boutiens sont les papistes et les protestants. Le prince de Galles, qui traitait également bien les torys et les whigs, rit de bon cœur de la condescendance de l’héritier présomptif , qui portait un talon haut et un talon plat. Blefuscu, où l’ingratitude de la cour lilliputienne force Gulliver à chercher un asile, pour n'avoir pas les yeux crevés, est la France, où l’ingratitude de la cour d’Angleterre força le duc d’Ormond et lord Bolingbroke de se réfugier. Les personnes qui connaissent l’histoire secrète du règne de George Ier saisiront facilement les autres allusions.
Le scandale que cause Gulliver par sa manière d’éteindre l’incendie du palais impérial fait allusion à la disgrâce de la reine Anne , que l’auteur encourut pour avoir composé le Conte du Tonneau, dont on se ressouvint pour lui en faire un crime, tandis que l’on avait oublié le service que cet ouvrage avait rendu au haut clergé. Nous devons aussi remarquer que la constitution et le système d’éducation publique de l’empire de Lilliput sont proposés comme des modèles, et que la corruption qui régnait à la cour ne datait que des trois derniers règnes. C’était l’opinion de Swift sur la constitution d’Angleterre.

Gulliver's Travels - II - A VOYAGE TO BROBDINGNAG
Dans le "Voyage à Lilliput", Swift, se prévalant d'une simple différence de proportions, atteint à la fois au merveilleux et à la satire. Vus par le petit bout de la lorgnette, guerres civiles et comportements humains apparaissent d`autant plus dérisoires qu`ils sont alimentés par des ambitions et une rhétorique démesurées. Bénéficiant de par sa taille d`un sentiment de sereine et solitaire supériorité, Gulliver se comporte en juge amusé ; mais que le rapport des proportions vienne à s'inverser, et c`est lui qui va se trouver dans la situation d`un jouet, menacé constamment de ridicule, d`angoisse et de mort par les choses jugées jusque-là des plus insignifiantes et inoffensives. En effet, au cours d`un second voyage, Gulliver, accompagné de quelques marins, aborde une côte inconnue qui se révèlera être le pays de Brobdingnag, habité par des géants.
Abandonné à terre par ses compagnons terrorisés à la vue d'un des habitants, le pauvre Gulliver va se cacher dans la forêt que forment pour lui les tiges d`un champ de blé. Un paysan le découvre et l'apporte au fermier. Et le héros, réduit à une taille minuscule, prend bien vite la mesure de son impuissance lui qui, à Lilliput, n'avait de règles que celles de son bon plaisir, tenait dans sa paume le secrétaire des Affaires intérieures de l`empire et condescendait à servir l'empereur, multiplie maintenant courbettes et civilités devant le paysan et sa famille, voit en chaque insecte un horrible monstre et se trouve bien aise de s'attirer la curiosité affectueuse d`une petite fille de neuf ans, qui le couche dans un berceau de poupée ou l`installe sur une étagère pour lui éviter d'être dévoré par les rats. Conduit à la Cour, où il devient vite un objet d`amusement et s'attire l`hostilité du bouffon attitré, il éveille cependant chez le roi un vif intérêt à son égard.
".. Mon maître descendit de cheval à une auberge où il avait coutume d’aller; et, après avoir tenu conseil avec l’hôte, et fait quelques préparatifs nécessaires, il loua le glultrud , ou crieur public, pour annoncer à toute la ville qu’on ferait voir à l’enseigne de l’Aigle verte un petit animal étranger moins gros qu’un splack-nock , et qui ressemblait , dans toutes les parties de son corps, à une créature humaine, prononçait plusieurs mots, et faisait une infinité de tours d’adresse.
Je fus posé sur une table dans la salle la plus grande de l’auberge, qui avait près de trois cents pieds en carré. Ma petite maîtresse se tenait debout sur un tabouret bien près de la table, pour prendre soin de moi et m’indiquer ce qu’il fallait faire. Mon maître, pour éviter la foule et le désordre, ne voulut pas permettre que plus de trente personnes entrassent à la fois pour me voir. Je marchai çà et là sur la table, suivant les ordres de la jeune fille : elle me fit plusieurs questions qu’elle savait être à ma portée, et proportionnées à la connaissance que j’avais de la langue; je répondis le mieux et le plus haut que je pus. Je me retournai plusieurs fois vers toute la compagnie, et fis mille révérences. Je pris un dé plein de vin , que Glumdalclitch m’avait donné pour me servir de gobelet , et je bus à la santé des spectateurs. Je tirai mon sabre, et fis le moulinet à la façon des maîtres d’armes en Angleterre. Ma bonne me donna un bout de paille, avec lequel je fis l’exercice comme avec une pique, ayant appris cela dans ma jeunesse. Je fus montré ce jour-là douze fois, et fus obligé de répéter toujours les mêmes choses, jusqu’à ce que je fusse presque mort de lassitude, d’ennui et de chagrin.
Ceux qui m’avaient vu firent de tous côtés des récits si merveilleux sur le rapport de ma taille avec la leur, sur mes exercices prodigieux, que le peuple voulait ensuite enfoncer les portes pour entrer. Mon maître, ayant en vue ses propres intérêts , ne voulut permettre à personne de me toucher, excepté à ma petite maîtresse, et , pour me mettre plus à couvert de tout accident, on avait rangé des bancs autour de la table à la distance convenable pour que je ne fusse à portée d’aucun spectateur. Cependant un petit écolier malin me jeta une noisette à la tête , et il s’en fallut peu qu’il ne m’attrapât : elle fut lancée avec tant de force, que, s’il n’eût pas manqué son coup, elle m’aurait infailliblement fait sauter la cervelle , car elle était presque aussi grosse qu’un melon ; mais j’eus la satisfaction de voir le méchant espiègle chassé de la salle.
Mon maître fit afficher qu’il me ferait voir encore le jour du marché suivant. Cependant il me fit faire une voiture plus commode, vu que j’avais été si fatigué de mon premier voyage et du spectacle que j’avais donné pendant huit heures de suite, que je ne pouvais plus me tenir debout, et que j’avais presque perdu la voix.
Pour m’achever, lorsque je fus de retour, tous les gentilshommes du voisinage, ayant entendu parler de moi, se rendirent à la maison de mon maître. Il y en avait un jour plus de trente, avec leurs femmes et leurs enfants ; car ce pays est aussi peuplé que l’Angleterre. Et mon maître demandait toujours le prix d’une chambrée complète, même pour une seule famille, lorsqu’il me montrait à la maison. Ainsi je n’avais pas beaucoup de repos , sinon les mercredis (qui sont leur jour de sabbat), quoique je ne fusse point porté à la ville. Supputant le profit que je pouvais lui rapporter, mon maître résolut de me faire voir dans les villes du royaume les plus considérables.
S’étant donc fourni de toutes les choses nécessaires à un long voyage, après avoir réglé ses affaires domestiques et dit adieu à sa femme, le 17 août 1703, c’est-à-dire environ deux mois après mon arrivée, nous partîmes pour nous rendre à la capitale, située vers le milieu de cet empire, à près de quinze cents lieues de notre demeure..."

"... Sa Majesté, prince très-sérieux et d’un visage austère, ne remarquant pas bien ma figure à la première vue, demanda froidement à la reine depuis quand elle avait le goût des splack nocks ( car il m’avait pris pour cet insecte) ; mais la reine, qui avait infiniment d’esprit, me mit doucement debout sur l’écritoire du roi, et m’ordonna de dire moi même à Sa Majesté ce que j’étais. Je le fis en très-peu de mots ; et Glumdalclitch , qui était restée à la porte du cabinet, ne pouvant souffrir que je fusse longtemps hors de sa présence, entra, et dit à Sa Majesté comment j’avais été trouvé dans un champ.
Le roi ôtait aussi savant qu’aucun de ses sujets, surtout dans les mathématiques et les sciences naturelles. Cependant, quand il vit de près ma figure et ma démarche, avant que je pusse commencer à parler, il s’imagina que je pourrais être une machine artificielle, la mécanique étant poussée à un haut degré de perfection en son pays; mais quand il eut entendu ma voix, et qu'il eut trouvé du raisonnement dans les petits sons que je rendais, il ne put cacher son étonnement et son admiration.
Il n’était nullement satisfait de la relation que je lui avais donnée de mon arrivée en ce royaume, et il supposait que c’était un conte inventé par le père de Glumdalclitch , et que l’on m’avait fait apprendre par cœur. Dans cette pensée, il m’adressa d’autres questions, et je répondis à toutes avec justesse, mais avec un léger accent étranger et quelques locutions rustiques que j’avais apprises chez le fermier, et qui étaient assez déplacées à la cour.
Il envoya chercher trois savants qui étaient alors de quartier à la cour et dans leur semaine de service, selon la coutume de ce pays. Ces messieurs, après avoir examiné ma figure avec beaucoup d’attention, furent d’avis différents sur mon sujet. Ils convenaient tous cependant que je ne pouvais pas être produit suivant les lois ordinaires de la nature, parce que j’étais dépourvu de la faculté naturelle de conserver ma vie, soit par l’agilité, soit par la faculté de grimper sur un arbre , soit par le pouvoir de creuser la terre, et d’y faire des trous pour m’y cacher comme les lapins. Mes dents, qu’ils considérèrent longtemps, les firent conjecturer que j’étais un animal carnassier.
Un de ces philosophes avança que j’étais un embryon, un pur avorton; mais cet avis fut rejeté par les deux autres, qui observèrent que mes membres étaient parfaits et achevés dans leur espèce, et que j’avais vécu plusieurs années ; ce qui parut évident par ma barbe, dont les poils étaient visibles au microscope. On ne voulut pas admettre que je fusse un nain, parce que ma petitesse était hors de comparaison ; le nain favori de la reine, le plus petit qu’on eût jamais vu dans ce royaume , avait près de trente pieds de haut. Après un grand débat, on conclut unanimement que je n’étais qu’un relplum scalcath, qui veut dire littéralement jeu de nature ; décision très-conforme à la philosophie moderne de l’Europe, dont les professeurs, dédaignant le vieux subterfuge des causes occultes, à la faveur duquel les sectateurs d’Aristote tâchent démasquer leur ignorance, ont inventé cette solution merveilleuse de toutes les difficultés de la physique, au très-grand avantage du savoir humain.
Après cette conclusion décisive, je pris la liberté de dire quelques mots : je m’adressai au roi, et protestai à Sa Majesté que je venais d’un pays où mon espèce était répandue en plusieurs millions d’individus des deux sexes, où les animaux, les arbres et les maisons étaient proportionnés à ma petitesse, et où, par conséquent, je pouvais être tout aussi bien en état de me défendre et de trouver ma nourriture, qu’aucun des sujets de Sa Majesté pouvait le faire en ses États. Cette réponse fit sourire dédaigneusement les philosophes, qui répliquèrent que le laboureur m’avait bien instruit, et que je savais ma leçon. Le roi , qui avait plus de pénétration que ses savants, les congédia et envoya chercher le laboureur, qui, par bonheur, n’était pas encore sorti de la ville. L’ayant donc d’abord examiné en particulier, et puis l’ayant confronté avec moi et avec la jeune fille, Sa Majesté commença à croire que ce que je lui avais dit pouvait être vrai. Il pria la reine de donner ordre qu’on prît un soin particulier de moi , et fut d’avis qu’il me fallait laisser sous la conduite de Glumdalclitch, ayant remarqué que nous avions une grande affection l’un pour l’autre..."

Chap.V, un bref passage un peu plus licencieux, comme l'époque les aimait, passage souvent omis dans nombre de traductions : "..The maids of honour often invited Glumdalclitch to their appartments, and desired she would bring me along with her, on purpose to have the pleasure ot seeing and touching me..." Les filles d’honneur invitaient souvent ma gouvernante à venir dans leur appartement et à m’apporter avec elle, afin de pouvoir m’examiner et me toucher. Souvent elles me mettaient entièrement nu et me couchaient dans leur sein, ce qui m’était très-désagréable à cause de la forte senteur de leur peau. Je ne dis point cela dans l'intention de donner une idée désavantageuse de la personne de ces dames, que je respecte comme je le dois ; mais c’est que ma petitesse comparative rendait mon odorat très-fin ; et sans doute ces belles dames étaient aussi irréprochables sous ce rapport que les femmes du même rang en Angleterre. A ce propos, je me rappelle qu'un de mes amis intimes à Lilliput prit la liberté, pendant une journée très-chaude où j’avais pris plus d'exercice qu’à l’ordinaire, de se plaindre de l’odeur que mon corps émettait, bien que je sois moins sujet qu’aucun de mon sexe à cet inconvénient. Mais je suppose que ses facultés odorantes étaient quant à moi ce qu’étaient les miennes à l’égard de cette nation de géants. Je ne puis cependant m’empêcher de rendre justice sur ce point à la reine, ma maîtresse, et à Glumdalclitch, ma gouvernante; l’une et l’autre avaient la peau aussi douce que celle d’une dame anglaise.
Une chose me déplaisait beaucoup dans ces visites du matin aux filles d'honneur, c’est qu’elles en usaient avec moi sans cérémonie, me regardant comme un être sans conséquence. Elles se déshabillaient et ôtaient même leur chemise pendant que j’étais sur leur toilette, obligé, malgré moi, de les voir toutes nues. Je dis malgré moi, car cette vue me causait, au lieu de plaisir, de l'horreur et du dégoût. Leur peau était inégale et de toutes sortes de couleurs, avec des signes çà et là aussi larges que des assiettes; leurs cheveux étaient gros comme de petites cordes, pour ne rien dire du reste. Ce n’est pas tout : elles ne se faisaient pas le moindre scrupule de satisfaire en ma présence certain petit besoin, dans un vase de la contenance de trois tonneaux. La plus jolie de ces dames, une fille de seize ans, d’une gaieté un peu folie, s’amusait parfois à me mettre à cheval sur le bord de son corsage, et me faisait mille autres tours que le lecteur me dispensera de citer. Enfin, elle m’ennuya si fort, que je priai Glumdalclitch de ne me laisser jamais seul avec elle..."

Amené à observer les mœurs et les lois du pays, Gulliver ne laisse pas de les trouver un peu simplistes, bien qu'elles permettent au royaume de vivre en paix. Aussi a-t-il à cœur de brosser au monarque un séduisant tableau des coutumes, conditions politiques et institutions de l'Angleterre, après quoi son illustre interlocuteur résume ainsi ses impressions : "D'après ce que vous venez de me dire... il m`apparaît que la majorité de vos compatriotes sont la plus pernicieuse vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper sur la surface de la terre"...
".. Tous les mercredis, jours de repos dans ce pays, le roi, la reine et la famille royale dînent ensemble dans les appartements de Sa Majesté, laquelle, m’ayant pris en grande amitié, faisait placer en ces occasions ma petite chaise et ma table à sa gauche et devant une salière. Ce prince prenait plaisir à causer avec moi et à me faire des questions touchant les mœurs, la religion, les lois , le gouvernement et la littérature de l’Europe , et je lui en rendais compte le mieux que je pouvais. Son esprit était si pénétrant et son jugement si solide, qu’il faisait des réflexions et des observations très-sages sur tout ce que je lui disais.
Mais j’avoue qu’ayant parlé un peu trop en détail de ma chère patrie, de notre commerce étendu, de nos schismes religieux, de nos sectes politiques, le roi, influencé par les préjugés de son éducation, me prit d’une main, me frappa de l’autre bien doucement, et me demanda en éclatant de rire si j’étais un wigh ou un tory; puis, se tournant vers son premier ministre, qui se tenait derrière lui, ayant à la main un bâton blanc presque aussi haut que le grand mât du Souverain Royal : « Hélas! dit il, que la grandeur humaine est peu de chose, puisque de vils insectes peuvent ainsi l’imiter! et j’ose dire qu'ils ont chez eux des rangs et des distinctions, de petits lambeaux dont ils se parent, des trous, des cages, des boîtes, qu’ils appellent des palais et des hôtels, des équipages , des livrées, des titres, des charges, des occupations , des passions comme nous. Chez eux on aime, on hait, on trompe, on trahit comme ici. » C’est ainsi que Sa Majesté philosophait à l’occasion de ce que je lui avais dit de l’Angleterre ; et moi j’étais confondu et indigné de voir ma patrie, la maltresse des arts, la souveraine des mers, le fléau de la France , l’arbitre de l’Europe , la gloire de l’univers, traitée avec tant de mépris.
("But I confess that, after I had, been a little too copious in talking of my own beloved country, of our trade, and wars by sea and land, of our schisms in religion, and parties in the state, the prejudices of his education prevailed so far, that he could not forbear taking me up in his right hand, and stroking me gently with the other, after a hearty fit of laughing, asked, me “Whether I was a Whig or Tory!" Then turning to his first minister, who waited behind him with a white staff, near as tall as the mainmast of the Royal Sovereign, he observed, “How contemptible a thing was human grandeur, which could be mimicked by such diminutive insects as I ! and yet," says he, "I dare engage, these creatures have their titles and distinctions of honour ; they contrive little nests and burrows, that they call houses and cities ; they make a figure in dress and equipage ; they love, they fight, they dispute, they cheat, they betray!" And thus he coutinued on, while my colour came and went several times, with indignation, to hear our noble country, the mistress of arts and .arms, the scourge of France, the arbitress of Europe, the scat of virtue, piety, honour, and truth, the pride and envy of the world, so contemptuously treated.
But as I was not in a condition to resent injuries, so, upon, mature thoughts, I began to doubt whether I was injured or no....")
Mais ma situation ne me permettait pas de ressentir une injure; et je doutais même, en y réfléchissant mieux, que j’eusse été offensé. Je me rappelai qu’après avoir passé plusieurs mois parmi ce peuple, mes yeux s’étaient accoutumés aux proportions relatives des choses, et leurs dimensions si différentes des nôtres ne me causaient plus l’horreur qu’elles m’avaient inspirée au premier abord. Il est même certain que si j’avais vu tout à coup une compagnie de dames et de seigneurs anglais dans leurs brillantes parures des jours de naissance royale, jouant tous les rôles en courtisans bien stylés, saluant, babillant et se pavanant , j’aurais été tenté de rire de leur mine, comme le roi et ses grands venaient de rire de moi. Le fait est que je ne pouvais m’empêcher de sourire quand la reine me prenait dans sa main et se plaçait devant une glace. Nos deux figures formaient le contraste le plus ridicule, et je croyais réellement avoir diminué de grandeur.
II n’y avait rien qui m’offensât et me chagrinât plus que le nain de la reine, qui , étant de la taille la plus petite qu’on eût jamais vue dans ce pays , devint d’une insolence extrême à la vue d’un homme beaucoup plus petit que lui. Il me regardait d’un air fier et dédaigneux, et se moquait sans cesse de ma figure quand il passait à côté de moi , tandis que j’étais posé sur une table, causant avec les seigneurs et les dames de la cour; et il ne manquait jamais de lancer quelque quolibet sur mon exiguïté. Je ne m’en vengeai qu’en l’appelant frère (car je crois en vérité qu’il n’avait pas plus de trente pieds), en le défiant de lutter avec moi, et en lui adressant de ces petites plaisanteries que les pages de cour se font mutuellement. Un jour, pendant le dîner, le malicieux avorton fut si piqué de quelque chose que je lui avais dit, qu’il grimpa sur le dos de la chaise de la reine, me saisit par le milieu du corps, m’enleva, me laissa tomber dans une assiette de lait, et s’enfuit. J’en eus par-dessus les oreilles; et si je n’avais été un nageur excellent, j’aurais été infailliblement noyé. Glumdalclitch , dans ce moment, était par hasard à l’autre extrémité de la chambre. La reine fut si consternée de cet accident, qu’elle manqua de présence d’esprit pour m’assister; mais ma petite bonne vint à mon secours, et me tira du plat très-adroitement, non sans que j’eusse bu plusieurs pintes de lait. On me mit au lit. Cependant je n’eus aucun mal..."
Plus loin, Gulliver a l'occasion de reprendre son dialogue avec le roi et lui décrire avec plus d'emphase le gouvernement de l'Angleterre, la constitution du parlement, "divisé en deux corps législatifs, le premier, nommé chambre des pairs, compose de nobles possesseurs et seigneurs des plus belles terres du royaume. Je parlai de l’extrême soin qu’on prenait de leur éducation par rapport aux sciences et aux armes, pour les rendre capables d’être conseillers-nés du royaume, d’avoir part dans l’administration du gouvernement, d’être membres de la plus haute cour de justice, dont il n’y avait point d’appel , et d’être les défenseurs zélés de leur prince et de leur patrie, par leur valeur, leur conduite et leur fidélité ; je dis que ces seigneurs étaient l’ornement et la sûreté du royaume, et les dignes successeurs de leurs ancêtres, dont les honneurs avaient été la récompense d’une vertu insigne. J’ajoutai que de saints personnages siégeaient avec ces nobles sous le titre d’évêques, et que leur charge particulière était de veiller sur la religion et sur ceux qui la prêchent au peuple; et qu’on choisissait dans le clergé les hommes les plus exemplaires et les plus savants pour les revêtir de cette dignité éminente.
Je dis que l’autre partie du parlement était une assemblée respectable, nommée la chambre des communes, composée de nobles ou de gentilshommes choisis librement , et députés par le peuple même, seulement à cause de leurs lumières, de leurs talents et de leur amour pour la patrie, afin de représenter la sagesse de toute la nation. J'ajoutai que ces deux corps formaient la plus auguste assemblée de l’Europe, et que cette assemblée, de concert avec le prince, faisait les lois et décidait de toutes les affaires d’État.
Ensuite je décrivis nos cours de justice , où étaient assis de vénérables interprètes de la loi, qui décidaient sur les différentes contestations des particuliers, qui punissaient le crime et protégeaient l’innocence. Je ne manquai pas de parler de la sage et économique administration de nos finances, et de m’étendre sur la valeur et les exploits de nos guerriers de mer et de terre. Je supputai le nombre de mes concitoyens, en comptant combien il y avait de millions d’hommes de différentes religions et de différents partis politiques parmi nous. Je n’omis ni nos jeux, ni nos spectacles, ni aucune autre particularité que je crusse pouvoir faire honneur à mon pays, et je finis par un petit récit historique des dernières révolutions d’Angleterre depuis environ cent ans..." Le roi l'interroge alors plus précisément et donne l'occasion au satiriste de dénoncer quelques singularités de son temps. "Ce qui l’étonna fort, ce fut d’apprendre que nous entretenions une armée dans le sein de la paix et au milieu d’un peuple libre. Il dit que, si nous étions gouvernés de notre propre consentement, il ne pouvait s’imaginer de qui nous avions peur, et contre qui nous avions à nous battre.. (..) .. Il rit beaucoup de ma bizarre arithmétique (comme il lui plut de l'appeler ), lorsque j’avais supputé le nombre de notre peuple, en calculant celui de nos différentes sectes religieuses et politiques. Il ne concevait pas que l’on pût empêcher les gens d’avoir des opinions contraires à la sûreté de l’État , ni que l’on pût permettre de professer ouvertement de telles opinions : la première chose étant une tyrannie, la seconde une faiblesse; car si l’on ne peut empêcher un homme d’avoir des substances vénéneuses dans sa maison, on doit lui défendre de les débiter... (..) .. Il était extrêmement étonné du récit que je lui avait fait de notre histoire du dernier siècle; ce n’était, selon lui , qu’un enchaînement horrible de conjurations, de rébellions, de meurtres, de massacres, de révolutions, d’exils, et des plus terribles effets que l’avarice, l’esprit de faction, l’hypocrisie, la perfidie, la cruauté, la rage, la folie, la haine, l’envie, la malice et l’ambition pouvaient produire.
Sa Majesté , dans une autre audience , prit la peine de récapituler la substance de tout ce que j’avais dit , compara les questions qu’elle m’avait faites avec les réponses que j’avais données; puis, me prenant dans ses mains et me flattant doucement, s’exprima dans ces mots que je n’oublierai jamais, non plus que la manière dont il les prononça :
"Mon petit ami Grildrig, vous avez fait un panégyrique admirable de votre pays : vous avez fort bien prouvé que l’ignorance, la paresse et le vice peuvent être quelquefois les seules qualités d’un homme d’État; que les lois sont éclaircies, interprétées et appliquées le mieux du monde par des gens dont les intérêts et la capacité les portent à les corrompre, à les embrouiller et à les éluder. La forme de votre gouvernement dans son origine a peut-être été supportable, mais le vice l’a tout a fait défigurée. Il ne me paraît pas même, par tout ce que vous m’avez dit, qu’une seule vertu soit requise pour parvenir à aucun rang ou à aucune charge parmi vous. Je vois que les hommes n’y sont point anoblis pour leur vertu , que les prêtres n’y sont point avancés pour leur piété ou leur science, les soldats pour leur conduite ou leur valeur, les juges pour leur intégrité, les sénateurs pour l’amour de leur patrie; ni les hommes d’Etat pour leur sagesse. Pour vous, continua le roi, qui avez passé la plus grande partie de votre vie dans les voyages, je veux croire que vous n’êtes pas infecté des vices de votre pays; mais, par tout ce que vous m’avez raconté d’abord et par les réponses que je vous ai obligé de faire à mes objections, je juge que la plupart de vos compatriotes sont la plus pernicieuse vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper sur la surface de la terre."
("His majesty, in another audience, was at the pains to recapitulate the sum of all I had spoken ; compared the questions he made with the answers I had given : then taking me into his hands, and stroking me gently, delivered himself in these words, which I shall never forget, nor the manner he spoke them in : "My little friend Grildrig, you have made a most admirable panegyric upon your country ; you have clearly proved, that ignorance, idleness, and vice, are the proper ingredients for qualifying a legislator ; that laws are best explained, interpreted, and applied, by those whose interest and abilities lie in perverting, confounding, and eluding them. I observe among you some lines of an institution, which, in its original, might have been tolerable, but these half erased, and the rest wholly blurred and blotted by corruptions. It does not appear, from all you have said, how any one perfection is required, toward the procurement of any one station among you ; much less, that men are ennobled on account of their virtue ; that priests are advanced for their piety or Iearning: soldiers, for their conduct or valour ; judges, for their integrity ; senators, for the love of their country ; or counsellors, for their wisdom. As for yourself, continued the king, who have spent the greatest part of your life in travelling, I am well disposed to hope you may hitherto have escaped many vices of your country. But by what I have gathered from your own relation, and the answers I have with much pains wringed and extorted from you, I cannot but conclude the bulk of your natives to be the most pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth..")
Gulliver, offensé dans sa dignité d`avoir à tenir le rôle de bête curieuse, éprouve ainsi une profonde nostalgie envers son pays. Et qui plus, se rend compte de l'incroyable limitation de l'esprit de ces gouvernants allant jusqu'à rejeter l'offre qu'il leur fait de découvrir et utiliser la poudre à canons qui leur assurerait une domination absolue sur le monde : "Le roi fut saisi d’horreur à la description que je lui fis de ces terribles machines, et à la proposition dont je l’accompagnai. Il était confondu de voir un insecte impuissant et rampant ( ce sont ses propres termes) parler avec tant de légèreté des scènes de sang et de désolation produites par ces inventions destructives, il fallait, disait-il, que ce, fût un mauvais génie, ennemi de Dieu et de ses ouvrages, qui en eût été l’auteur. Il protesta que, quoique rien ne lui fit plus de plaisir que les nouvelles découvertes, soit dans la nature, soit dans les arts, il aimerait mieux perdre sa couronne que de faire usage d’un si funeste secret, dont il me défendit, sous peine de la vie, de faire part à aucun de ses sujets.
Étrange effet des vues et des principes bornés d’un prince orné de toutes les qualités qui peuvent gagner la vénération, l’amour et l’estime des peuples. Ce prince sage, éclairé, plein de talents admirables , et presque adoré de sa nation, sottement gêné par un scrupule bizarre, dont nous n’avons jamais eu l’idée en Europe, laisse échapper l’occasion qu’on lui met entre les mains de se rendre le maître absolu de la vie, de la liberté et des biens de tous ses sujets!
Je ne dis pas cela dans l'intention de rabaisser les vertus et les lumières de ce prince, auquel je n’ignore pas néanmoins que ce récit fera tort dans l’esprit d’un lecteur anglais ; mais je suis convaincu que ce défaut ne venait que d’ignorance, ces peuples n’ayant pas encore réduit la politique en art, comme l’ont fait les Européens dont l’esprit est plus subtil. Car il me souvient que , dans un entretien que j’eus un jour avec le roi , je lui dis par hasard qu’il y avait parmi nous un grand nombre de volumes écrits sur l’art de gouverner, et Sa Majesté en conçut, contre mon attente, une opinion très-basse de notre esprit , et ajouta qu’il méprisait et détestait tout mystère, tout raffinement et toute intrigue dans les procédés d’un prince ou d’un ministre d’Etat.
Il ne pouvait comprendre ce que je voulais dire par les secrets du cabinet. Pour lui, il renfermait la science de gouverner dans des bornes très-étroites, la réduisant au sens commun, à la raison, à la douceur, à la prompte décision des affaires civiles et criminelles, et à d’autres semblables pratiques à la portée de tout le monde, et qui ne méritent pas qu’on en parle. Enfin il avança ce paradoxe étrange, que si quelqu’un pouvait faire croître deux épis ou deux brins d’herbe sur un morceau de terre où auparavant il n’y en avait qu’un , il mériterait beaucoup du genre humain, et rendrait un service plus essentiel à son pays que toute la race de nos sublimes politiques.
Les connaissances de ce peuple sont fort peu de chose, et ne consistent que dans la morale , l’histoire, la poésie et les mathématiques ; mais il faut avouer qu’ils excellent dans ces quatre genres...."
(".. He confined the knowledge of governing within very narrow bounds, to common sense and reason, to justice and lenity, to the speedy determination of civil and criminal causes ; with some other obvious topics, which are not worth considering. And he gave it for his opinion, That whoever could make two ears of corn, or two blades of grass, to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential service to his country, than the whole race of politicians put together...")
L'inattention d'un page et le caprice d`un aigle géant, qui emporte la "boîte" servant de logis à Gulliver avant de la laisser choir au milieu de la mer, permettront finalement à l`aventureux Lemuel Gulliver de se faire recueillir, une fois de plus, par un navire anglais et de retrouver sa famille...
Mais telle est la force de l`habítude que Gulliver, frappé par les petites dimensions de toutes choses, se croit de nouveau parmi les habitants de Lilliput, se jette aux pieds de sa femme en pensant l`embrasser ou s`efforce en vain d`élever sa fille à la hauteur de ses yeux pour la mieux voir, passant ainsi, pendant un certain temps, pour avoir l'esprit dérangé.
D`où il semble permis de tirer cette conclusion qu`après être passé de la pratique des Anciens à celle des Modernes, de l'intimité du bas-peuple à celle des Grands, du complexe de supériorité au complexe d'infériorité, il faut à l`homme une raison bien solide pour déjouer illusions et mensonges, afin de trouver sa propre mesure, de la conserver et de l`accorder à celle de ses semblables...
Dans le "Voyage à Brobdingnag", nous dit Walter Scot, la satire est d’une application plus générale, et il est difficile d’y rien trouver qui se rapporte aux événements politiques et aux ministres du temps. C’est l’opinion que se formeraient des actions et des sentiments de l’homme, des êtres d’un caractère froid, réfléchi, philosophique, et doués d’une force immense. Le monarque de ces fils d’Anack est la personnification d’un roi patriote, indifférent â ce qui est curieux , froid pour ce qui est beau , et ne prenant intérêt qu’a ce qui concerne l’utilité générale et le bien public. Les intrigues et les scandales d’une cour européenne sont , aux yeux d’un tel prince , aussi odieux dans leurs résultats que méprisables dans leurs motifs. Le contraste de Gulliver arrivant de Lilliput, où il était un géant, chez une race d’hommes parmi lesquels il n’est plus qu’un pygmée, est d’un heureux effet. Les mêmes idées reviennent nécessairement; mais, comme elles changent de face dans le rôle que joue le narrateur, c’est plutôt un développement qu’une répétition.

Gulliver's Travels - III - A VOYAGE TO LAPUTA, BALNIBARBI, LUGGNAGG, GLUBBDOBDRIB, AND JAPAN
Le fond de comédie sur lequel se déroule le "Voyage à Lilliput" s`éclaire d`un jour plus
dramatique avec le "Voyage à Brobdingnag" où à chaque pas, l'acteur-spectateur Gulliver
risque sa vie. Mais ce crescendo va s`accuser jusqu'au sarcasme et la féerie se muer en
hallucinations dans les deux dernières parties du roman.
La satire en effet redouble d`âpreté dans le récit que fait Gulliver de son voyage à l`île volante de Laputa et au continent voisin dont la capitale de son royaume terre-ferme a pour nom Logado. Là, métaphysique, spéculations scientifiques, créations artistiques et industrielles nous apparaissent comme des élucubrations de l`esprit humain; historiens, philosophes et savants y prennent figure d'hurluberlus : l'un d'eux cherche depuis huit ans à obtenir des rayons de soleil à partir de citrouilles; un autre fabrique de la poudre à canon avec de la glace ; enfin, les sages de Laputa, perdus dans leurs spéculations, se conduisent en idiots dans la vie pratique....
Abandonné dans un petit canot par des pirates qui se sont emparés de son vaisseau, Gulliver accoste dans une île... "Je passai toute la nuit dans la caverne où j’avais mis mes provisions, et ces mêmes herbes sèches destinées à faire du feu me servirent de lit. Je dormis peu, car l’inquiétude de mon esprit l’emporta sur la lassitude de mon corps. Je considérais qu’il était impossible de ne pas mourir dans un lieu si misérable, et qu’il me faudrait bientôt faire une triste fin. Je me trouvai si abattu de ces réflexions, que je n’eus pas le courage de me lever; et, avant que j’eusse assez de force pour sortir de ma caverne, le jour était déjà fort grand ; le temps était beau, et le soleil si ardent, que j’étais obligé de lui tourner le visage. Mais voici tout à coup que le temps s’obscurcit, d’une manière pourtant très-différente de ce qui arrive par l’interposition d’un nuage. Je me tournai vers le soleil, et je vis entre lui et moi un grand corps opaque et mobile, qui semblait avancer vers l’île. Ce corps suspendu, qui me paraissait à deux milles de hauteur, me cacha le soleil environ six ou sept minutes; mais je ne remarquai point que l’air fût plus froid , ou le ciel plus obscur que si je m’étais trouvé sous l’ombre d’une montagne. Quand ce corps approcha davantage de l'endroit où j'étais, il me parut être d'une substance solide, applati au fond, uni et réfléchissant hrillamment la mer sur laquelle il planait. Je m’arrêtai sur une hauteur à deux cents pas environ du rivage, et je vis ce même corps s’abaisser presque en ligne parallèle avec moi à un mille de distance. Je pris alors mon télescope, et je découvris un grand nombre de personnes qui allaient et venaient sur les flancs un peu inclinés de cette masse flottante; mais je ne pus discerner ce qu’elles faisaient.
L’amour naturel de la vie fit naître en moi quelque sentiment de joie, et j’espérai que cette aventure me donnerait le moyen de sortir de l’état fâcheux où j’étais ; mais le lecteur aura peine à se figurer mon étonnement lorsque je vis une île en l'air, habitée par des hommes qui avaient l’art et le pouvoir de la hausser, de l’abaisser, et de la faire marcher à leur gré ; cependant , n’étant pas alors en humeur de philosopher sur un aussi étrange phénomène, je me contentai d’observer de quel côté l'île tournerait; car elle me parut alors arrêtée.
Mais bientôt après elle avança de mon côté, et j’y pus découvrir plusieurs grandes galeries et des escaliers d’intervalle en intervalle pour communiquer des unes aux autres. Sur la galerie la plus basse, je vis plusieurs hommes qui pêchaient des oiseaux à la ligne , et d’autres qui regardaient. Je leur fis signe avec mon bonnet (car depuis longtemps mon chapeau était usé) et avec mon mouchoir; et, lorsque je fus plus près d’eux, je criai de toutes mes forces ; et , ayant alors regardé fort attentivement, je vis une foule de monde amassée sur le bord qui était vis-à-vis de moi. Je compris par leurs gestes qu’ils me voyaient, quoiqu'ils ne m’eussent pas répondu.
J'aperçus alors cinq ou six hommes montant avec empressement au sommet de l'île, et je m’imaginai qu'ils avaient été envoyés à quelques personnes d’autorité pour en recevoir des ordres sur ce qu’on devait faire en cette occasion. La foule des insulaires augmenta, et en moins d'une demi-lieure l'île s’approcha tellement, qu’il n’y avait plus que cent pas de distance entre elle et moi. Ce fut alors que je me mis en diverses postures humbles et suppliantes, et que je parlai du ton le plus touchant; mais je ne reçus point de réponse. Ceux qui se trouvaient le plus près de moi me semblaient , à en juger parleurs habits, des personnes de distinction. Ils se consultaient ensemble en regardant souvent de mon côté. A la fin, un d'eux s’adressa à moi dans un langage clair, poli et très-doux, dont le son approchait de l’italien: ce fut aussi en italien que je répondis, m’imaginant que l’accent de cette langue serait plus agréable à leurs oreilles que tout autre langage. Bien que nous ne nous entendissions point les uns les autres, ma détresse fut comprise; et l'on me fit signe de descendre du rocher, et d’aller vers le rivage, ce que je fis; et alors l’île volante s’étant abaissée à un degré convenable, on me jeta de la galerie d’en bas une chaîne avec un petit siège qui y était attaché..."
(II) A mon arrivée, je me vis entouré d'une foule de gens parmi lesquels ceux qui approchaient le plus près de moi paraissaient les plus considérables. Ils me regardaient tous avec admiration, et je les regardais de même, n’ayant encore jamais yu une race de mortels si singulière dans sa figure, dans ses habits et dans ses manières ; ils avaient la tête penchée les uns à droite, les autres à gauche, et un œil tourné en dedans, et l'autre vers le ciel. Leurs habits étaient bigarrés de figures du soleil, de la lune, des étoiles, et entremêlés de celles de divers instruments, violons, flûtes, harpes, trompettes, guitares, clavecins et plusieurs autres inconnus en Europe. Je vis autour de quelques personnes des hommes vêtus en domestiques, portant chacun une vessie attachée comme un fléau au bout d’un petit bâton, et dans laquelle il y avait, comme je l’appris ensuite, une certaine quantité de pois secs ou de petits caillous : ils frappaient de temps en temps avec ces vessies , tantôt la bouche , tantôt les oreilles de ceux dont ils étaient proches, et je n’en pus d’abord deviner la raison. Il parait que ce peuple est tellement adonné aux méditations profondes, qu’il en résulte un état de distraction habituel, en sorte que personne ne pourrait ni parler ni écouter les discours des autres sans le secours de quelque impression extérieure produite sur les organes de la parole et de l’audition. C’est pourquoi ceux qui en avaient le moyen avaient toujours un domestique frappeur, ou "climenole" dans la langue du pays, qui leur servait de moniteur, et sans lequel ils ne sortaient jamais..."
".. nous entrâmes dans le palais et fûmes admis en présence du roi. Sa Majesté était sur un trône environné de personnes de la première distinction. Devant le trône était une grande table couverte de globes, de sphères et d'instruments de mathématiques de toute espèce. Le roi ne prit point garde à moi lorsque j’entrai, quoique la foule qui m’accompagnait fît un très-grand bruit : il était alors appliqué à résoudre un problème, et nous attendîmes au moins une heure entière avant que Sa Majesté eût fini son opération. Il avait auprès de lui deux pages qui tenaient des frappoirs à la main, et l’un d’eux, lorsque Sa Majesté eut cessé de travailler, le frappa doucement et respectueusement à la bouche, et l’autre à l’oreille droite. Le roi parut alors comme se réveiller en sursaut ; et , jetant les yeux sur moi et sur tout le monde qui m’entourait, il se rappela ce qu’on lui avait dit de mon arrivée peu de temps auparavant : il dit quelques mots, et aussitôt un jeune homme armé d’une vessie s’approcha de moi, et m’en donna un léger coup sur l’oreille droite; mais je tâchai de faire entendre par signes que je n avais nul besoin d’un pareil instrument, ce qui donna au roi et à toute la cour une très-pauvre idée de mon intelligence. Le roi me fit diverses questions, et je lui parlai dans tous les idiomes qui m’étaient connus; et lorsqu’on se fut enfin aperçu que je ne pouvais ni entendre ni être entendu, l’on me conduisit , par l’ordre du roi , dans un appartement de son palais, ce prince étant distingué au-dessus de tous ses prédécesseurs par son hospitalité envers les étrangers...." Les mathématiques dominent leurs pensées, "toutes leurs idées s’exprimaient en lignes et en figures", mais privilégiant l'abstrait et ignorant toute pratique, ce qui n'est pas sans conséquence, désastreuse, sur leur façon de vivre..
"Leurs maisons étaient fort mal bâties : les murs n’étaient pas droits, les pièces n’avaient pas un seul angle régulier. Ce défaut provenait du mépris de ce peuple pour la géométrie pratique, regardée en ce pays comme une chose vulgaire et mécanique. Je n’ai jamais vu de peuple si sot, si niais, si maladroit dans tout ce qui regarde les actions communes de la vie.
Les instructions que l'on donne aux ouvriers étant d'une nature abstraite, ils ne peuvent les comprendre, et il en résulte des erreurs perpétuelles. Ce sont, outre cela, les plus mauvais raisonneurs du monde, toujours prêts à contredire, si ce n’est lorsqu’ils pensent juste, ce qui leur arrive rarement; et bien qu’ils soient assez habiles à se servir de la plume, du crayon ou du compas , ils conçoivent lentement et imparfaitement tout ce qui ne tient pas aux mathématiques et à la musique. Ils sont totalement étrangers à l’imagination , à l'invention ; aucun mot de leur langue n’exprime ces facultés ; et leur intelligence est bornée aux deux sciences ci-dessus mentionnées.
Beaucoup d’entre eux, principalement ceux qui s’appliquent à l’astronomie , donnent dans l’astrologie judiciaire, quoiqu’ils n’osent l’avouer publiquement. Mais ce que je trouvai de plus surprenant, ce qui me parut même inexplicable, ce fut l’inclination qu’ils avaient pour la politique, et leur curiosité pour les nouvelles ; ils parlaient incessamment d’affaires d’état , et portaient des jugements sur ces matières, défendant avec acharnement et pied à pied une opinion de parti.
J’ai souvent remarqué la même disposition dans nos mathématiciens d’Europe, sans avoir jamais pu trouver la moindre analogie entre les mathématiques et la politique: à moins que l’on ne suppose que, comme le plus petit cercle a autant de degrés que le plus grand , celui qui sait raisonner sur un cercle tracé sur le papier peut également raisonner sur la sphère du monde; mais j’attribuerais plutôt cette manie à un penchant commun à tous les hommes, celui de se mêler de ce qui les regarde le moins , et de ce qu’ils ont le moins de moyens d’étudier.
Ce peuple paraît toujours inquiet et alarmé, et ce qui n’a jamais troublé le repos des autres hommes est le sujet continuel de leurs craintes et de leurs frayeurs ; ainsi ils appréhendent l’altération des corps célestes. Par exemple, ils pensent que la terre, approchant toujours du soleil, sera à la fin dévorée par cet astre. Ils croient que la face du soleil se couvrira peu à peu d’une croûte formée de ses émanations, et qu’elle cessera d’éclairer le monde. Ils prétendent qu’ayant échappé à un coup de queue de la dernière comète, lequel nous aurait anéantis , nous n’échapperons pas à la prochaine, qui, selon leur calcul, paraîtra dans trente et un ans.."
"Ils sont ainsi continuellement alarmés en pensant à ces dangers et à d’autres non moins menaçants , et ces craintes les empêchent de dormir tranquilles et de goûter aucune sorte de plaisir. Quand ils se rencontrent le matin , ils se demandent d’abord les uns aux autres des nouvelles du soleil, comment il se porte , et en quel état il s’est couché et levé.
Les femmes de cette île sont très-vives ; elles méprisent leurs maris, et ont beaucoup de goût pour les étrangers, dont il y a toujours un nombre considérable à la suite de la cour, soit pour les affaires des villes et des corporations , soit pour des motifs privés. Ils sont peu estimés , parce qu’ils n’ont point les connaissances particulièrement appréciées par les Laputiens; mais c’est parmi eux que les dames de qualité prennent leurs galants. Ce qu’il y a de fâcheux , c’est qu’ils ont trop de sécurité dans leurs intrigues; car les maris sont si absorbés dans les spéculations géométriques, qu’on caresse leurs femmes en leur présence sans qu’ils s’en aperçoivent , pourvu qu’ils aient une plume à la main et que le moniteur avec sa vessie ne soit pas à leur côté.
Les femmes et les filles sont très-fâchées de se voir confinées dans cette île, quoique ce soit l’endroit le plus délicieux de la terre, et qu’elles y vivent dans la richesse et dans la magnificence. Elles peuvent aller où elles veulent dans l’île, et faire tout ce qui leur plaît , mais elles meurent d’envie de courir le monde, et de goûter les plaisirs de la capitale, où il leur est défendu d’aller sans la permission du roi , qu’il ne leur est pas aisé d’obtenir, parce que les maris ont souvent éprouvé qu’il leur était difficile de les faire revenir à Laputa..."

Arbuthnot, qui était un savant, n’approuvait point le Voyage à Laputa, dans lequel il voyait probablement un ridicule jeté sur la Société royale. Il est certain qu’on y trouve quelques allusions aux philosophes les plus estimés du temps. On prétend même qu’il y a un trait dirigé contre sir Isaac Newton. L’ardent patriote n’avait pas oublié l'opinion du philosophe en faveur de la monnaie de cuivre de Wood. On suppose que le tailleur qui , après avoir calculé la taille de Gulliver avec un demi-cercle, et pris sa mesure par une ligure mathématique , lui rapporte des habits très mal faits et qui ne vont point a sa taille , fait allusion à une erreur de l’imprimeur qui , en ajoutant un chiffre à un calcul astronomique de Newton sur la distance qui sépare le soleil de la terre, l’avait augmenté à un degré incalculable.
Mais, quoique Swift ait traité peut-être avec irrévérence le plus grand philosophe du temps, et que, dans plusieurs de ses écrits, il paraisse faire peu de cas des mathématiques, la satire de Gulliver est plutôt dirigée contre l’abus de la Science que contre la science elle-même. — Les faiseurs de projets de l’académie de Laputa sont représentés comme des hommes qui , ayant une légère teinture des mathématiques, prétendent perfectionner leurs plans de mécanique par pure fantaisie ou par un travers d’esprit. Du temps de Swift il y avait beaucoup de gens de cette espèce qui abusaient de la crédulité des ignorants , les ruinaient, et parleur maladresse retardaient les progrès delà science. En livrant au ridicule tous ces faiseurs de projets, les uns dupes de leurs demi-connaissances , les autres véritables imposteurs, Swift, qui les avait en aversion, depuis qu’ils avaient causé la ruine de son oncle Godwin , a emprunté plusieurs traits, et peut-être l’idée générale de Rabelais, livre V, chapitre XXIII , où Pantagruel observe les occupations des courtisans de Quinte-Essence, reine d’Entéléchie.
Swift s’est encore moqué des professeurs de sciences spéculatives, occupés de l’étude de ce que l’on appelait alors magie physique et mathématique ; étude qui, ne reposant sur aucun principe solide, n’était ni indiquée ni constatée par l’expérience, mais flottait entre la science et la mysticité; — telles sont l'alchimie, et la composition de figures de bronze parlantes, d’oiseaux de bois volants, de poudres sympathiques, de baumes que l’on n’appliquait pas à la blessure, mais à l’arme qui l’avait faite, de fioles d’essence avec lesquelles on pouvait fumer des arpents de terre, avec d’autres merveilles semblables, dont la vertu était prônée par des imposteurs qui trouvaient malheureusement des dupes. La machine du bon professeur de Lagado, pour hâter les progrès des sciences spéculatives et pour composer des livres sur tous les sujets, sans le secours du génie et du savoir, était un ridicule jeté sur l’art inventé par Raymond Lulle , et perfectionné par ses sages commentateurs, ou sur le procédé mécanique, par lequel, selon Cornélius Agrippa, un des disciples de bulle, «tout homme pouvait disserter sur quelque matière que ce fût, et avec un certain nombre de grands mots , noms et verbes , prolonger une thèse avec beaucoup d’éclat et de subtilité, en soutenant les deux côtés de la question».
Le lecteur pouvait se croire transporté au sein de la grande académie de Lagado, quand il lisait le bref et grand Art de l'invention et de la démonstration, qui consiste à ajuster le sujet qu’on doit traiter à une machine composée de divers cercles fixes et mobiles. Le cercle principal était fixe, et on y lisait les noms des substances et de toutes les choses qui pouvaient fournir un sujet, disposés on ordre général, comme DlEU, ANGE , TERRE , CIEL , HOMME , ANIMAL , etc., etc. Dans ce cercle fixe était placé un autre cercle mobile, sur lequel étaient écrits ce que les logiciens appellent accidents , comme QUANTITÉ, QUALITÉ, RELATION, etc., etc. Dans d’autres cercles figuraient les attributs absolus et relatifs, etc., etc., avec les formules des questions. En tournant les cercles de manière à faire porter les divers attributs sur la question proposée, il en résultait une espèce de logique mécanique, que Swift avait incontestablement en vue quand il décrivit la fameuse machine à composer des livres.
L'auteur quitte l'île de Lapula, et est conduit à Balnibarbi, le domaine continental du roi de Laputa, Lagado en est la capitale. Il y visite l'académie, y rencontre les "savants abstraits" et les plus singulières absurdités en matière d'invention.
Passant de Laputa à l'île de Glubdubdrib, repaire de devins et autres nécromants, Gulliver ne résiste pas au plaisir d'évoquer les ombres des grands hommes de l'Antiquité, et parvient à confronter Scot et Ramus, puis Descartes et Gassendi à Aristote. ll apprend ainsi que l'humanité a été trompée par des écrivains menteurs et corrompus : ils ont attribué à des lâches les plus grands exploits guerriers, à des sots les plus sages décisions, à des flatteurs la sincérité, à des traîtres les vertus romaines. à des athées la plus profonde dévotion, la chasteté à des sodomites et la franchise à des espions...
(VIII) "..Mes découvertes sur l’histoire moderne furent les plus mortifiantes. Je reconnus que les historiens ont transformé des guerriers imbéciles et lâches en grands capitaines, des insensés et de petits génies en grands politiques , des flatteurs et des courtisans en gens de bien, des athées en hommes pleins de religion, d’infamés débauchés en gens chastes, et des délateurs de profession en hommes vrais et sincères. Je sus de quelle manière des personnes très-innocentes avaient été condamnées à la mort ou au bannissement par l’intrigue des favoris qui avaient corrompu les juges, et combien de lâches coquins avaient été élevés aux emplois les plus honorables, les plus lucratifs, les plus importants pour l’état. Je vis quelle part immense les prostituées et leurs proxénètes ont eue dans les grands évènements , et combien les cours , les conseils , les sénats, ont été influencés par des femmes galantes, des débauchés, des parasites et des bouffons. Oh! que je conçus alors une basse idée de l’humanité! Que la sagesse et la probité des hommes me parurent peu de chose, en voyant la source de toutes les révolutions, le motif honteux des entreprises les plus éclatantes, les ressorts, ou plutôt les accidents imprévus, et les bagatelles qui les avaient fait réussir!
("I was chiefly disgusted with modern history ; for having strictly examined all the persons of greatest name in the courts of princes, for an hundred years past, I found how the world had been misled by prostitute writers, to ascribe the greatest exploits in war, to cowards ; the wisest counsel, to fools ; sincerity, to flatterers ; Roman virtue, to betrayers of their country; piety to atheists ; chastity to sodomites ; truth to informers : how many innocent and excellent persons had been condemned to death or banishment, by the practising of great ministers upon the corruption of judges, and the malice of factions; how many villains had been exalted to the highest places of trust, power, dignity, and profit ; how great a share in the motions and events of courts, counsels, and senates, might be challenged by bawds, whores, pimps, parasites, and buffoons. How low an opinion I had of human wisdom and integrity, when I was truly informed of the springs and motives of great enterprises and revolutions in the world, and of the contemptible accidents to which they owed their success!")

"Here I discovered the roguery and ignorance of those who pretend to write anecdotes or secret history" - Je découvris l’ignorance et la mauvaise foi de nos historiens, qui prétendent écrire des anecdotes ou mémoires secrets, et ont fait mourir par le poison tant de rois, conté les entretiens secrets de tel ou tel prince avec son ministre , et auraient , si on les en croyait, crocheté les cabinets des souverains, des ministres et des ambassadeurs, et pénétré le fond même de leurs pensées, sur quoi ils ont eu le malheur de se tromper presque constamment.
Ce fut là que j’appris les causes secrètes de quelques évènements qui ont étonné le monde ; je vis comment une coquette avait gouverné le boudoir, le boudoir le conseil, le conseil le sénat. Un général d'armée m'avoua qu’il avait une fois remporté une victoire par sa poltronnerie et par son imprudence; et un amiral me dit qu’il avait battu malgré lui une flotte ennemie, lorsqu’il avait envie de laisser battre la sienne. Il y eut trois rois qui me dirent que, sous leur règne, ils n’avaient jamais récompensé ni élevé aucun homme de mérite, si ce n’est une fois que leur ministre les trompa, et se trompa lui-même sur cet article ; qu’en cela ils étaient persuadés d’avoir eu raison, et ils affirmaient qu’ils agiraient de même s’ils revenaient au monde; car les trônes ne peuvent se soutenir que par la corruption , le caractère positif, confiant, inflexible, que la vertu donne à un homme étant la chose la plus incommode dans les affaires publiques.
J’eus la curiosité de m’informer par quel moyen un grand nombre de personnes étaient parvenues à une très-haute fortune. Je me bornai à ces derniers temps, sans néanmoins toucher au temps présent, de peur d’offenser même les étrangers ( car il n’est pas nécessaire que j’avertisse que tout ce que j’ai dit jusqu’ici ne regarde point mon cher pays). Un grand nombre de personnes furent appelées , et le plus léger examen me fit découvrir tant d’infamie, que je ne puis y penser sans tristesse. Le parjure, l’oppression, la subornation, la séduction, la fraude, les viles complaisances, et d’autres turpitudes, étaient les moyens les plus excusables qui avaient amené leur élévation. Mais plusieurs confessèrent qu’ils devaient leur grandeur aux plus horribles débauches, à l’inceste, à la prostitution de leurs femmes et de leurs filles, que d’autres avaient trahi leur patrie et leur souverain, que d’autres avaient employé le poison, enfin que le plus grand nombre avaient perverti les lois pour perdre l’innocence. Après ces découvertes, je crois qu’on me pardonnera d’avoir désormais un peu moins d’estime et de vénération pour la grandeur, que j’honore et respecte naturellement, comme tous les inférieurs sont tenus d’honorer et de respecter ceux que la nature ou la fortune ont placés dans un rang supérieur.
J’avais lu dans quelques livres que des sujets avaient rendu de grands services à leur prince et à leur patrie : j’eus envie de les voir; mais on me dit qu’on avait oublié leurs noms, et qu’on se souvenait seulement de quelques-uns , dont les historiens avaient fait mention en les faisant passer pour des traîtres et des fripons..."
Retour de l’auteur à Maldonada. Il fait alors voile pour le royaume de Lugguagg. A son arrivée il est arrêté, ensuite conduit à la cour, une cour où, lorsqu'il s'y présenta, on le "fit coucher et ramper sur le ventre , et balayer le plancher avec ma langue à mesure que j’avançais vers le trône du roi; mais parce que j’étais étranger, on avait eu l’honnêteté de nettoyer le plancher de manière que la poussière ne put m’incommoder". "Il y a même en cette cour un autre usage que je ne puis approuver. Lorsque le roi veut faire mourir quelque seigneur ou quelque courtisan d’une manière qui ne le déshonore point, il fait jeter sur le plancher une certaine poudre brune empoisonnée, qui ne manque point de le dépêcher au bout de vingt-quatre heures; mais, pour rendre justice à la grande bonté de ce prince , et au soin qu’il a de ménager la vie de ses sujets, étant sous ce rapport un modèle à présenter aux souverains de l’Europe , il faut dire qu’après de semblables exécutions il a coutume d’ordonner très-expressément de bien balayer le plancher; en sorte que si ses domestiques l’oubliaient, ils courraient risque de tomber dans sa disgrâce.."
Gulliver se rend ensuite chez les Struldbrug, qui sont aflligés d`immortalité et se considèrent comme les plus malheureux des hommes, condamnés qu'ils sont à vivre et, partant, à s`ennuyer pour l'éternité...
"Lorsqu’un struldbrugg s’est marié à une struldbrugge , le mariage, selon les lois de l’État, est dissous dès que le plus jeune des deux est parvenu à l’âge de quatre-vingts ans. Il est juste , en effet , que de malheureux humains, condamnés malgré eux, et sans l’avoir mérité, à vivre éternellement, ne soient pas encore, pour surcroît de disgrâce, obligés de vivre avec une femme éternelle. Aussitôt qu’ils atteignent cet âge fatal, ils sont regardés comme morts civilement. Leurs héritiers s'emparent de leurs biens; et ils sont réduits à une simple pension alimentaire. Les pauvres sont entretenus aux dépens du public. Passé cette période , ils sont incapables d’occuper aucun emploi de confiance, d’exercer aucun métier lucratif; ils ne peu- vent acheter, ni vendre, ni passer des baux, et leur témoignage n’est point reçu en justice.
Parvenus à quatre-vingt-dix ans, leurs dents et leurs cheveux tombent; ils perdent le goût des aliments, et ils boivent et mangent sans aucun plaisir. Les maladies et infirmités auxquelles ils étaient sujets continuent sans augmenter ni diminuer. En parlant ils oublient le nom des choses les plus communes et ceux de leurs amis les plus intimes. Il leur est pour cette raison impossible de s’amuser à lire, puisque leur mémoire ne leur permet pas de retenir les premiers mots d’une phrase jusqu’à ce qu’ils arrivent aux derniers; et cette infirmité les prive de la seule distraction qu’ils pourraient avoir. D’ailleurs, comme la langue de ce pays est sujette à de fréquents changements, les struldbruggs nés dans un siècle ont beaucoup de peine à entendre le langage des hommes nés dans un autre..."
Au chapitre XI, l’auteur part de l’île de Luggnagg pour se rendre au Japon, où il s’embarque sur un vaisseau hollandais : il arrive à Amsterdam , et de là passe en Angleterre...

Gulliver's Travels - IV - A VOYAGE TO THE COUNTRY OF THE HOUYHNHNMS
L’auteur entreprend un voyage en qualité de capitaine de vaisseau, mais son équipage se révolte, l’enferme, l’enchaîne, puis l'abandonne sur un rivage inconnu. C'est ainsi que Gulliver relate son quatrième et dernier "Voyage au pays des Houyhnhnm", les bons et vertueux chevaux, qui cultivent l'amitié et la bienveillance et qui tiennent l'espèce humaine sous leur dépendance : cette dernière est représentée par les Yahoo, êtres répugnants et dégénérés portant les marques de la pire bestialité.
Confié à un maître cheval, un Houyhnhnm, Gulliver apprend leur langue, parle de lui et de ce qui le distingue des Yahoo. Puis, à la demande de son maître, lui dresse un état de l'Angleterre, de sa constitution, et des causes ordinaires des guerres entre les princes d'Europe. Swift construit ainsi tout au long de son récit, des tranches de vie du fonctionnement économique, politique et social de cet équivalent lointain du monde "yahoo" ..
"C’est, continuai-je, en fournissant aux riches toutes les choses dont ils ont besoin que la grande masse de notre peuple subsiste. Par exemple, lorsque je suis chez moi, et que je suis habillé comme je dois l’être, je porte sur mon corps l’ouvrage de cent ouvriers. Un millier de mains ont contribué à bâtir et à meubler ma maison , et il en a fallu encore cinq ou six fois plus pour la parure de ma femme" - "Je lui dis que nous mangions mille choses différentes qui souvent opéraient en sens inverse l'une de l’autre ; que parfois nous mangions sans avoir faim, que nous buvions sans avoir soif, que nous passions les nuits à avaler des liqueurs brûlantes sans manger un seul morceau; ce qui enflammait nos entrailles, ruinait notre estomac , précipitait ou arrêtait notre digestion ; que certaines femelles prostituées avaient un venin qui engendrait la corruption dans les os , et qu’elles communiquaient ce mal à leurs amants; que cette maladie funeste, ainsi que plusieurs autres, naissait quelquefois avec nous et nous était transmise avec le sang; enfin que je ne finirais point si je voulais lui exposer toutes les maladies auxquelles nous étions sujets; qu’il y eu avait au moins cinq ou six cents par rapport à chaque membre , et que chaque partie , soit interne , soit externe, en avait une infinité qui lui étaient propres. Pour guérir tous ces maux , ajoutai-je , nous avons une sorte de gens que l'on élève pour guérir ou pour prétendre guérir les malades", et qu'outre les maladies réelles, "nous sommes sujets à des maladies imaginaires pour lesquelles les médecins ont inventé des remèdes imaginaires".
Gulliver/Swit en vient à parler du gouvernement et détailler une constitution que le monde entier admire...
".. Je répondis qu’un premier ou principal ministre d’état était un individu totalement exempt de joie et de chagrin, d’amour et de haine, de pitié et de colère, du moins qu’il ne manifestait aucune passion, sauf le désir ardent d’acquérir des richesses , du pouvoir et des titres ; qu’il employait ses paroles à toute espèce d’usage, hors à celui d’exprimer ses pensées; qu'il ne disait jamais la vérité, sinon avec l’intention de la faire prendre pour un mensonge ; que ceux desquels il disait le plus de mal en arrière étaient sûrs d’être en bon chemin pour leur avancement; et que lorsqu’il louait quelqu’un, soit en face, soit indirectement, on pouvait juger que c’était un homme perdu; une promesse d’un ministre , surtout si elle était affirmée par serment , était, dis-je, l’augure le plus défavorable, et toute personne sage se retirait après cela et abandonnait ses espérances.
Il est trois méthodes par lesquelles on peut s’élever au rang de premier ministre : la première est de pouvoir disposer avec prudence d'une femme, d’une fille, ou d’une sœur; la seconde est de trahir ou de détruire sourdement son prédécesseur; la troisième est de montrer un zèle furieux dans les assemblées publiques contre la corruption de la cour.
Mais un prince avisé doit employer de préférence ceux qui pratiquent Ja dernière de ces méthodes, parce que ces fanatiques d’opposition deviennent toujours les ministres les plus servilement dévoués aux volontés et aux passions de leur maître. Une fois en possession de leur place, les ministres s’y maintiennent en s’assurant la majorité d’un sénat ou grand conseil législatif par la distribution des emplois dont ils disposent, eux les ministres; enfin par un expédient appelé acte d’indemnité (dont j’expliquai la signification), ils se mettent à l’abri de toute responsabilité, et se retirent des affaires chargés des dépouilles de la nation.
Le palais d’un premier ministre est une école où se forment des sujets pour sa profession ; les pages , les laquais, le portier, en imitant le maître, deviennent dans leur sphère autant de ministres, et apprennent à exceller en trois principales branches de l’art, savoir : l’insolence, le mensonge et la vénalité. En conséquence, ils ont chacun une cour subalterne composée de personnes du premier rang ; et quelquefois , à force d’adresse et d’impudence, ils parviennent par différents degrés à succéder à leur maître. Celui-ci est ordinairement gouverné, soit par une maîtresse surannée, soit par un laquais favori, qui sont les canaux par lesquels les faveurs se répandent, et qui peuvent être nommés les gouvernants du royaume en dernier ressort.."
Gulliver note au passage que "le lecteur s'étonnera peut- être que j’aie pu me résoudre à représenter mon espèce sous un jour aussi fidèle devant une race de mortels déjà prévenus défavorablement à l’égard du genre humain , par la complète ressemblance de ce genre avec les yahous du pays. Mais j’avoue que les nombreuses vertus de ces excellents quadrupèdes, placées dans un contact immédiat avec les corruptions humaines, avaient si bien éclairci ma vue et agrandi la sphère de mon intelligence, que je commençai à juger différemment des actions et des passions des hommes , et à penser que l'honneur de mon espèce ne valait pas la peine d’être ménagé.." Et son maître de conclure que "nous étions des animaux qui, par un accident inconcevable pour lui, avions été doués d’une légère parcelle de raison , de laquelle nous n’avions fait usage que pour aggraver nos défauts et en acquérir de nouveaux que la nature ne nous avait point donnés; tandis que nous avions perdu le peu de capacités qu’elle nous avait accordées; que nous avions été merveilleusement habiles à multiplier nos besoins primitifs ; et qu’il paraissait que nous passions notre vie en vains efforts pour les satisfaire par nos inventions". Quant à moi, il était évident que je n’avais ni la force ni l’agilité d’un yahou commun...
La violence satirique de cette dernière partie donne tout son sens aux Voyages de Gulliver et en fait une œuvre sombre et puissante, d'un pessimisme douloureux, dénué pourtant de la moindre résignation. Comme pour Rabelais, et non sans intention peut-être, on a cru bon de donner de ce chef-d'œuvre des éditions incomplètes et "expurgées ", en le ramenant ainsi à une simple fantaisie humoristique, au point d`en faire un classique de la littérature enfantine. Sous les dehors du conte philosophique, de la relation de voyages et du roman d`aventure, Swift prend figure de témoignage personnel et s'inscrit dans le courant d`idées soutenues par les amis de Swift, tels que John Arbuthnot (1667-1735), Alexander Pope (1688-1744) et John Gay (1685-1732).

Le Voyage chez les Houyhnhnms est une diatribe sévère contre la nature humaine ; elle n’a pu être inspirée que par l’indignation qui , comme Swift le reconnaît dans son épitaphe , avait si Iongtemps rongé son cœur. Vivant dans un pays où l’espèce humaine était divisée en petits tyrans et en esclaves opprimés , idolâtre de la liberté et de l’indépendance qu’il voyait chaque jour foulées aux pieds , l’énergie de ses sentiments n’étant plus contenue lui fit prendre en horreur une race capable de commettre et de souffrir de telles iniquités. Ne perdons pas de vue, ajoute Walter Scot, sa santé déclinant tous les jours ; son bonheur domestique détruit par la perte d’une femme qu’il avait aimée, et par le spectacle affligeant du danger qui menaçait les jours d’une autre femme qui lui était si chère; ses propres jours flétris dès leur automne; la certitude de les finir dans un pays qu’il avait en aversion , et de ne pouvoir habiter celui où il avait conçu de si flatteuses espérances, et laissé tous ses amis. Cette réunion de circonstances peut faire pardonner une misanthropie générale, qui ne ferma jamais le cœur de Swift à la bienfaisance. Ces considérations ne se bornent pas à la personne de l’auteur; elles sont aussi une sorte d’apologie pour l’ouvrage. Malgré la haine qui l’a dicté , le caractère des Yahous offre une leçon morale. Ce n’est pas l’homme éclairé par la religion, ou n’ayant même que les lumières naturelles , que Swift a voulu peindre ; c’est l’homme dégradé par l’asservissement volontaire de ses facultés intellectuelles et de ses instincts , tel qu’on le trouve malheureusement dans les dernières classes de la société , quand il est abandonné à l’ignorance et aux vices qu’elles produisent.
Gulliver entendait rester jusqu'à la fin de ses jours chez les Houyhnhnms...
"... Je jouissais d’une parfaite santé de corps et d’une tranquillité d’esprit non moins complète. Je ne craignais ni la trahison ou l’inconstance d’un ami, ni les outrages d’un ennemi ouvert ou caché. Je n’avais nulle occasion de corrompre, de flatter, de ramper pour obtenir la faveur d’un grand ou de son favori. Je n’avais pas besoin de me défendre de la fraude ou de la tyrannie; il n’y avait là ni médecins pour détruire mon corps, ni gens de loi pour vider ma bourse, ni espions pour guetter mes paroles, mes actions, ou forger contre moi des accusations pour gagner ses honoraires; là, point de critiques, de mystificateurs, de charlatans, de filous, de voleurs, de tapageurs, de procureurs, de vils agents de débauche, de bouffons, de joueurs, de politiques, de beaux esprits, de vaporeux , d’ennuyeux bavards, de souteneurs de thèses, de ravisseurs , d’assassins , de virtuoses ; point de meneurs ni de valets de partis; point de provocateurs au vice par l’exemple ou l’encouragement; point de prisons, de gibets, de haches, de piloris; point de marchands ni d’artisans fripons; point de vanité, d’orgueil ou d’affectation; point de fats, de fanfarons, d’ivrognes, de prostituées, de maladies honteuses; point de femmes querelleuses, malhonnêtes, dépensières ; point de pédants stupides et arrogants; point de compagnons importuns, exigeants, disputeurs, bruyants, hurlants, vides d’esprit , à prétention , et accoutumés à mêler leur conversation de jurements; point de faquins sortis de la poussière , grâce à leurs vices ; point de nobles jetés dans la boue à cause de leurs vertus; point de grands seigneurs, de juges, de violons, ni de maîtres à danser.
J’avais l’honneur de m’entretenir souvent avec les Houyhnhnms qui venaient au logis; et mon maître avait la bonté de souffrir que j’entrasse toujours dans la salle pour profiter de leur conversation. La compagnie et mon maître voulaient bien condescendre à me questionner et à entendre mes réponses.
J’accompagnais aussi mon maître dans ses visites; mais je gardais toujours le silence, à moins qu’on ne m’interrogeât; et c’était à mon grand regret que je prenais la parole, parce que cela me faisait perdre l'occasion de m'instruire, car j’avais bien plus à gagner à rester humble auditeur en de telles conversations où l'on ne disait que ce qui était utile, en s’exprimant dans les termes les plus brefs et les plus significatifs. On observait, comme je l’ai déjà dit, la plus grande décence, mais sans le moindre mélange de cérémonie. Personne ne parlait sans éprouver du plaisir et sans en donner aux autres. Il n’y avait là ni interruption , ni lourdeur, ni âpreté , ni contradiction , ni emportement..." Et "Quand je pensais à ma famille, à mes amis, à mes compatriotes, à la race humaine en général , je les considérais comme de véritables yahous; et ils n’étaient réellement peut-être qu’un peu plus civilisés et doués de la faculté de parler, mais n’usant de la raison que pour perfectionner et multiplier leurs vices ; tandis que leurs semblables dans le pays des Houyhnhnms avaient seulement les vices qu’ils tenaient de la nature. S’il m’arrivait de voir ma figure dans un lac ou une fontaine , je détournais les yeux , j’avais horreur de moi-même; la vue d’un yahou commun me semblait moins intolérable que celle de ma personne..."
Mais le voici dans l'obligation de quitter cette terre, il reste un Yahoo qui ne peut être que traité comme tel par un Houyhnhnm...
"Je commençai ce voyage désespéré le 15 février 1715, à neuf heures du matin". Gulliver atteint la Nouvelle-Hollande, espère s'y établir, mais est blessé par une flèche, et regagne, non sans appréhension, l'Angleterre à bord d'un bâtiment portugais, "j’avais en effet oublié la faculté de mentir commune chez les yahous dans tous les pays où ils dominent.."
"Il me serait plus facile de me réconcilier avec l’espèce humaine en général , si elle se contentait d’avoir les vices et les folies auxquels la nature l’a rendue sujette. Je ne suis point choqué à la vue d’un homme de loi, d’un voleur de mouchoirs de poche, d’un colonel, d’un bouffon, d’un lord, d’un joueur, d’un politique, d’un souteneur de filles, d’un médecin, d’un suborneur, d’un faux témoin, d’un procureur, d’un traître et de tant d’autres états qui sont dans l’ordre des choses. Mais quand je vois un monde de difformités et de maladies du corps et de l’esprit toutes engendrées par l’orgueil, la patience m’échappe ; il m’est impossible de concevoir comment un pareil vice et un pareil animal peuvent aller ensemble. Les sages et vertueux Houyhnhnms, qui abondent en toutes les excellences faites pour orner une créature raisonnable, n’ont pas de nom dans leur langue pour ce vice; ils n’ont en effet aucun terme pour exprimer ce qui est mal, hors ceux qui désignent les détestables qualités de leurs yahous, parmi lesquelles ils n’ont point reconnu l’orgueil, sans doute faute d’avoir bien entendu l’espèce humaine telle qu’elle est dans les pays où elle domine. Cependant moi, grâce à mon expérience, j’ai pleinement discerné les germes de l’orgueil chez l’yahou sauvage...."

Ainsi, Swift sait donner aux évènements les plus invraisemblables un air de vérité par le caractère et le style du narrateur.
Le caractère du voyageur imaginaire est exactement celui d'un William Dampier (1651-1715, qui a minutieusement décrit populations, faunes et flores en parcourant les mers en deux voyages autour du monde), ou de tout autre navigateur opiniâtre de ce temps-là , doué de courage et de sens commun , parcourant des mers éloignées, avec ses préjugés anglais qu’il rapporte tous à Portsmouth ou à Plymouth, et racontant gravement et simplement à son retour ce qu’il a vu et ce qu’on lui a dit dans les pays étrangers. Ce caractère est tellement anglais que les étrangers peuvent difficilement l’apprécier et les traductions en rendre compte. Les observations de Gulliver ne sont jamais plus fines ou plus profondes que celles d’un capitaine de navire marchand, ou d’un chirurgien de la Cité de Londres , qui a fait un voyage de long cours....
Pour ne pas prolonger ces réflexions, conclura Walter Scott de sa présentation des Voyages de Gulliver (1838), j’engage seulement le lecteur à remarquer avec quel art infini les actions humaines sont partagées entre ces deux races d’êtres imaginaires , pour rendre la satire plus piquante. A Lilliput, les intrigues et les tracasseries politiques , qui sont la principale occupation des courtisans en Europe , transportées dans une cour de petites créatures de six pouces de haut , deviennent un objet de ridicule ; tandis que la légèreté des femmes et les folies des cours européennes, que l’auteur prête aux dames de la cour de Brobdingnag, deviennent des monstruosités dégoûtantes chez une nation d’une stature effrayante. Par ces moyens et par mille autres dans lesquels on retrouve la touche d’un grand maître, et dont on sent l’effet sans pouvoir en saisir la cause que par une longue analyse , le génie de Swift a fait d’un conte de féerie un roman auquel on n’en peut comparer aucun autre pour l’art du récit et le véritable esprit de la satire.
La réputation des Voyages de Gulliver se répandit bientôt en Europe. Voltaire, qui se trouvait alors en Angleterre, les vanta a ses amis de France et leur recommanda de les faire traduire. L’abbé Desfontaines entreprit de faire cette traduction. Ses doutes, ses craintes, ses apologies, sont consignés dans une introduction curieuse , bien propre à donner une idée de l’esprit et des opinions d’un homme de lettres de cette époque en France.
Ce traducteur convient qu’il sent qu’il blesse toutes les règles; et tout en demandant grâce pour les fictions extravagantes qu’il a essayé d’habiller à la française , il avoue qu’à certains passages la plume lui tombait des mains d’horreur et d’étonnement, en voyant toutes les bienséances aussi audacieusement violées par le satirique anglais. Il tremble que quelques- uns des traits lancés par Swift ne soient appliqués à la cour de Versailles, et il proteste avec beaucoup de circonlocutions, qu’il n’est question que des tories et des whigs du factieux royaume d’Angleterre. Il termine en assurant ses lecteurs que non seulement il a changé beaucoup d’incidents, afin de les accommoder au goût de ses compatriotes, mais qu’il a supprimé tous les détails nautiques , et beaucoup d’autres particularités minutieuses, si détestables dans l’original. Malgré cette affectation de goût et de délicatesse , la traduction est passable. Il est vrai que l’abbé Desfontaines s’est indemnisé, en publiant une continuation des Voyages , dans un style fort différent de celui de l’original...
Swift revint en Angleterre en 1727. Toujours désireux de s'y établir et d'échanger son doyenné, il avait cependant rompu ouvertement avec Walpole, qui, traité froidement par le prince de Galles , semblait disgracié d'avance à l'avènement du nouveau souverain. Aussi , lorsque la mort de George Ier (11 juin 1727) fut annoncée à Londres , les amis de Swift l'exhortèrent à y attendre les bienfaits du règne qui commençait. Il avait été question d'une union des Whigs et des Tories contre Walpole; le prince y semblait disposé, et c'est ce que Swift avait indiqué en donnant à l'héritier du trône de Lilliput un talon haut et un bas talon. Mais Walpole fut plus puissant sous George II que sous George Ier. Le roi d'Angleterre, sa femme , sa maîtresse , oublièrent parfaitement le bon accueil que Swift avait reçu du prince de Galles, et ce fut la dernière déception du doyen de saint Patrick. Il avait écrit à Pope en 1726 : "Aller en Angleterre, serait une chose excellente , si elle n'était toujours accompagnée de cette vilaine circonstance qu'il faut retourner en Irlande."
Il retourna dans cette terre d'exil, en 1727, pour n'en plus sortir...
Swift publie, en 1727, la même année que Les Voyages de Gulliver, une "Short view of the state of Ireland", et probablement vers la même époque décide, de concert avec Pope, de mettre par écrit ses pensées quotidiennes. sans souci de forme ou d`ordre, ce qui nous valut ces "Pensées sur divers sujets moraux et divertissants", dans le goût des aphorismes chers aux moralistes et hommes d`esprit du XVIIIe siècle, mais avec une observation plus réaliste et pénétrante, un ton original, et moderne.
".. Quand nous refléchissons sur les Evenemens passez, les Guerres , les Emeutes , les Négociations, nous nous étonnons de ce que les hommes se sont donné tant de mouvemens pour des choses si passageres : si nous considérons le tems présent, nous voyons précisément la même humeur intrigante, qui s’occupe sur les mêmes Evenemens, & nous ne nous en étonnons point dut tout.
L’Homme sage tire des conjectures & des conclusions de l’examen de toutes les circonstances des choses, mais le moindre incident qu’il n'est pas possible de prévoir, est capable de donner aux affaires des tours si peu attendus , & traîne après lui des révolutions si surprenantes, que le sage est souvent aussi peu en état de juger des évènements, que l'homme du monde le plus Ignorant & le moins expérimenté..."

"Beggar's Opera" (1728) ...
Le titre de gloire plus éclatant de John Gay fut l'Opéra du gueux (Beggar's Opera), après avoir donné "Trois Heures après le mariage" (Three Hours after Marriage), une farce écrite en 1717 en collaboration avec Pope et John Arbuthnot. The Beggar's Opera devint l'Opéra de quat' sous (Die Dreigroschenoper, 1928) de Berthold Brecht, changeant le bandit en bourgeois, et remplaçant les airs du XVIIIe siècle par les dissonances de Kurt Weill. La comédie de Gay est à la fois, avec ses quelque soixante-dix chansons, une parodie amusée de l'opéra italien (qui devenait envahissant) et une satire politique enjouée qui donne au bandit de grand chemin, Macheath, des allures de grand seigneur, aimé et trahi par les femmes, mais surtout trahi par le fripon Peachum, maître receleur et son complice, et qui trafique avec une justice corrompue. L'action se joue entre l'obsédante prison de Newgate et l'antre du chef receleur, les frasques amoureuses de Macheath tissant un lien d'opérette entre les deux lieux scéniques. Beggar's Opera eut un énorme succès...
"A Modest Proposal" (1729) - En 1729, Swift publie "The Journal of a Modern Lady" et lance, surtout, un pamphlet virulent et célèbre, "Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge de leurs parents ou à leur pays et pour les rendre utiles au public", "A Modest Proposal for preventing the Children of Poor People in Ireland from being a Burden to their Parents or Country; and for making them Beneficial to the Public". Un écrit magistral et féroce dirigé non seulement dirigé contre les Anglais, mais aussi contre l`hypocrisie morale, les profiteurs de la misère et leurs crimes indirects. Swift, indigné par les conditions misérables faites au bas peuple irlandais, n`y propose rien moins, sur le ton le plus sérieux et le plus docte, que de manger les enfants des pauvres, énumérant les avantages économiques d'une telle mesure, réfutant d`avance les objections, s`attardant même aux détails de cette future institution d'intérêt public et aux diverses façons d`accommoder cette nourriture :
"J'accorde que cet aliment sera un peu cher, et par conséquent il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir de plus en plus droit aux enfants." Cette courte pièce est jugée comme la plus puissante de toute son œuvre. Jamais la satire n`avait atteint' à de tels accents, à des revendications aussi nettement sociales : "J'invite les hommes politiques à qui mon ouverture déplaira, et qui auront peut-être la hardiesse de tenter une réponse, à demander d'abord aux parents de ces mortels, si, à l`heure qu'il est, ils ne regarderaient pas comme un grand bonheur d'avoir été vendus pour être mangés à l`âge d`un an, de la façon que je prescris, et d`avoir évité par là toute la série d`infortunes par lesquelles ils sont passés, et l`oppression des propriétaires, et le manque des moyens les plus ordinaires de subsistance, ainsi que d'un toit et d'un habit pour les préserver des intempéries du temps. et la perspective inévitable de léguer un tel sort, ou des misères encore plus grandes, à leur postérité jusqu`à la consommation des siècles."
En 1733, Swift publie Sur la poésie (On Poetry) et en 1736 paraissent ses Ouvrages poétiques (The Poetical Works of Swift), il y révèle sa maîtrise de la langue et utilise l`ensemble des modes de composition poétique de l'ère élisabéthaine à son époque, empruntant aux ballades et chansons populaires tout autant qu`aux plus grands poètes et dramaturges. On retrouve dans ses poèmes les mêmes caractères que dans ses ouvrages en prose, son humour, son réalisme impitoyable, ne reculant même pas devant la scatologie. sa verve.
En 1738 paraît "La Conversation polie", "Complete Collection of Gentle and Ingenious Conversation according to the Most Políte Mode and Method now used at Court, and in the Best Companies of England", pamphlet dirigé contre le beau monde et ses snobismes. véritable prélude aux romans de moeurs. Sous le pseudonyme de Simon Wagstaff, Swift y tourne en ridicule la bêtise, la grossièreté et l'esprit forcé de la conversation du monde élégant, en trois dialogues dans lesquels figurent en tant qu'interlocuteurs lord Sparkish, miss Notable, lady Smart, Tom Neverout, etc. Dans ces personnages, Swift incarne les manies, le ridicule, la pauvreté intellectuelle des gens du monde de son temps...
1745, la mort de Swift ..- Quelques éclairs traversèrent encore cette intelligence qui , bientôt, allait complètement s'obscurcir.
La famille royale et Walpole furent impitoyablement raillés dans sa "Rhapsodie sur la poésie (On poetry, a Rhapsody), qui eut été poursuivie, si les jurisconsultes ne l'eussent jugée inattaquable. La verve de Swift s'épanche encore dans cette brillante satire, écrite sur sa propre mort (Verses on the Death of Doctor Swift by HimseIf) : il y met en scène, avec vivacité, ses amis, ses ennemis, les indifférents parlant sur sa mort. Jusqu'au bout, enfin , il s'indigna des atteintes portées par le Parlement d'Irlande aux intérêts de l'Eglise, et une série de pièces satiriques atteste son inutile ressentiment.
Vers 1736, il se sentit, avec désespoir, survivre à sa raison ; il ne la recouvra plus qu'à de rares intervalles. II se brouillait et se réconciliait sans cesse avec ceux qui l'entouraient, et perdait par degrés, avec le commerce du monde, les consolations qui se tirent de la mémoire et de la pensée. En 1741 , passé aux tories, Swift publie "Pensées libres sur l 'état présent des affaires" (Some free Thoughts on the Present State of Affairs), reprochant à Oxford de ne pas éliminer complètement les whigs de l'armée et de l`administration. Puis sombre alors dans l`apathie et perd peu à peu la raison. Cette longue agonie , dont ses meilleurs amis souhaitaient la fin, se prolongea jusqu'au 19 octobre 1745. Il fut enterré dans la cathédrale de Saint-Patrick..
En 1744, on publiera encore les Sermons. Le Sermon sur la difficulté de se connaitre et les Instructions aux domestiques (Directions to Servants) furent publiés, posthumes, en 1745. L'Histoire des quatre dernières années de la reine Anne (The History of the four last years of the queen), treize ans plus tard en 1758, une œuvre surprenante et originale. le souvenir d`une personnalité d`exception. dont l'ambiguïté avait éveillé l'intérêt de ses contemporains. On y perçoit un cri de révolte de l`auteur contre son temps et sa propre condition...
