- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Marivaux (1688-1763), "La Double inconstance" (1723), "L'Île des esclaves" (1725), "Le Jeu de l'amour et du hasard" (1730) - Antoine Watteau (1684-1721) - Claudine Guérin de Tencin (1682-1749) - Charles Pinot Duclos (1704-1772) - Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692-1754) - ......
Last update 10/10/2021

"En vérité, l'amour ne nous trompe point; dès qu'il se montre, il nous dit ce qu'il est et de quoi il sera question; l'âme, avec lui, sent la présence d'un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur." - Depuis Molière, la comédie n'avait pas connu de véritable innovation. C'est Marivaux qui lui apporte un nouveau souffle, en créant, à côté de la comédie de moeurs et de caractères, celle de l'analyse sentimentale. Il va mettre en scène la naissance et le développement du sentiment amoureux en concentrant l'action sur le rôle joué par le langage (le "marivaudage"), une langue élégante et délicate qui épouse ainsi toutes les nuances de l'évolution des coeurs, et permet à l'intrigue de se nouer. Marivaux disait vivre en spectateur, ne vivre que pour voir et entendre, voir et entendre une vie sociale et sentimentale, celle des Salons où se donnent tout à la fois le bon usage de la langue, la manière de dire le monde, et de se dire soi-même. Ce que Marivaux ne se lasse pas d'observer et de décrire, ce sont principalement les ruses de la vanité féminine et la fatuité masculine, leurs combats sournois et leurs pacifications trompeuses. Vanité et coquetterie sont érigées en sources de nos passions. Le sentiment amoureux naît de l'amour-propre blessé ou caressé.
Mais plus encore, Marivaux reste le peintre de l'amour naissant, des premiers instants de cet amour méfiant, tout en feintes et en réticences. Il est alors incomparable pour fixer d'un mot rapide l'ombre de doute ou d'espérance qui passe, fugitive, sur un cœur, pour marquer d'un trait net, précis, les plus faibles oscillations du désir. On ne trouvera ici ni d'intrigues élaborées ni de situations fortes, mais un canevas de sentiments minutieusement élaborés. « Le dialogue, disait-il, y est partout l'expression simple des mouvements du cœur... Et c'est peut-être, ajoutait-il, conscient de sa nouveauté, parce que ce ton est naturel qu'il a paru singulier. » Dorante et Silvia, Araminte et Lélio parlent une langue travaillée, nuancée, parfois subtile, ; mais leur langage nous semble aujourd'hui dans un rapport exact avec leurs sentiments.
Pourtant le succès de Marivaux au XVIIIe siècle ne fut pas décisif, ni le public des Comédiens Français ni celui du Théâtre-Italien ne lui firent un accueil délirant. On lui reprocha sa "préciosité", son "abus fatigant de l'esprit". Il s'est de plus toujours tenu à l'écart des philosophes, à distance de Molière et mal aimé par Voltaire qui le jugeait trop subtil et trop raffiné. Il faudra attendre Musset et le XIXe pour redécouvrir Marivaux.
Mais déjà se jouait entre 1730 et 1736, une palette de sentiments amoureux d'une étrange singularité, "Le Jeu de l’amour et du hasard" (1730), des comédies amoureuses qui étudient les surprises des sens, "l'Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut" (1731), où le personnage principal tente de se construire au travers d'une passion exclusive et dévorante, "Les Egarements du cœur et de l’esprit" (1736) qui préfigure le personnage de Valmont dans "les Liaisons dangereuses" un demi-siècle plus tard...
Le contexte dans lequel s'enracine ce nouveau sentiment amoureux? La Régence (1715-1723). Les personnages de Marivaux semblent ne consentir à aimer, à être aimés que s'ils sont bien certains de ne courir aucun risque de douleur ou d'humiliation. Nous verrons Lucidor tourmenter sans pitié la tendre Angélique, parce qu'il craint de n'être pas aimé seulement pour lui-même, et Silvia pousser à bout Dorante qui souffre, parce qu'elle souhaite connaître jusqu'où peut aller sa passion. Les amants de Marivaux ont respiré l'air de la Régence, la subtilité, la recherche de sentiments où ils se complaisent, la curiosité trop attentive qu'ils portent sur eux-mêmes, tout un raffinement extrême mais encore qu'intellectuel. On a pu ainsi se demander, troublé, si tant de délicatesses d'esprit n'étaient pas au fond qu'une plus élégante dépravation du cœur....
En février 1723, Louis XV ayant atteint sa treizième année fut proclamé majeur. Le duc d'Orléans mourut subitement en décembre; l'évêque de Fréjus, Fleury, précepteur du jeune roi, devint bientôt ministre d'État (1726), fut nommé cardinal, et garda jusqu'à sa mort, en 1743, la confiance entière de Louis XV. Ce vieillard - il avait soixante-dix ans en 1723 - pratiqua une politique d'apaisement et d'équilibre dans tous les domaines : alors que l'Autriche et l'Espagne venaient de conclure contre la France et l'Angleterre un traité d'alliance, le cardinal s'efforça, avec le ministre anglais Walpole, de calmer les esprits et se rapprocha de l'Espagne (1729). Chauvelin, secrétaire d'État aux Affaires étrangères depuis 1727, profita de l'affaire de la succession de Pologne pour pousser Louis XV à soutenir la candidature de son beau-père Stanislas Leczinski contre l'électeur de Saxe, parent et allié de l'empereur d'Autriche. Fleury tira parti des premiers succès pour conclure un traité qui établissait en Italie les Bourbons de Naples et faisait espérer l'annexion ultérieure de la Lorraine à la France. Mais la situation s'assombrit dans les dernières années du ministère Fleury : la rivalité commerciale provoque en 1739 la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre et en 1740 s'ouvre la crise de la succession d'Autriche; la France s'unit à la Prusse et à l'Espagne contre Marie-Thérèse, mais la souveraine réussit à dissocier la coalition et à repousser en 1743 le maréchal de Belle-Isle.
Bien secondé aux Finances par l'excellent contrôleur général Orry, Fleury administre avec soin et avec économie le trésor, et l'année 1739 voit un budget en équilibre. Le développement économique favorisé par une reprise générale en Europe fut encouragé : le commerce maritime et les ports de Bordeaux, de Nantes, de Marseille connurent une grande prospérité. Au point de vue religieux, le cardinal, tout en maintenant l'interdiction contre les jansénistes contenue dans la bulle Unígenítus, s'efforça de calmer l'agitation latente. Dans la délicate affaire des "Convulsionnaires" du cimetière Saint-Médard dont les désordres prenaient des proportions inquiétantes, il sut mêler habilement les mesures de police et les négociations secrètes, et finit par rétablir le calme. Après la mort de Fleury, en 1743, Louis XV décide de ne plus avoir de Premier ministre et de s'occuper lui-même de l'État. Une autre époque se dessine...
Quant à Marivaux, depuis 1744, il est pratiquement tombé dans l'oubli, vingt longues années de silence jusqu'à sa mort en 1763. Et en 1761, un certain Jean-Jacques Rousseau publiait La Nouvelle Héloïse...
Envers du décor : la liberté individuelle reste toujours un vain mot et les cruautés persistantes qui frappent les plus fragiles socialement et qu'ont dénoncé les sarcasmes d'un Voltaire ou les larmes d'un Rousseau ne s'effriteront que très progressivement, la question préparatoire ne sera abolie qu'en 1780, la question préalable en 1788...
Envers du décor, l'élégance des manières et des costumes que le théâtre de Marivaux a si bien illustrée. L'amour devient "maître et seigneur" et se dote d'un "esprit", 1730-1740. Mais c'est un sentiment tout en extérieur, l'imagination en est absente, le tour d'esprit reste raisonneur, ce que l'on exprime, c'est finesse du ton, une élégance aisée des manières. Les Dorante et les Silvia de Marivaux, ses comtesses et ses marquis, et jusqu'à Dubois et jusqu'à Lisette, tous ses personnages ont ce je ne sais quoi de vif et de souple, de naturel et de raffiné, d'audacieux et de léger qui fut la marque de la société française pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Mais cet esprit, chez ces amoureux, chez ces amoureuses, défend le cœur avec avec les ruses multipliées d'un stratège qui couvre une place menacée....
Globalement, le XVIIIe siècle semble effectivement s'adoucir, et les "âmes sensibles" se rassembleront à l'appel de Rousseau dans les années 1760 et de nombreuses sociétés humanitaires seront créées. En réaction contre les horreurs de la Traite des noirs et de l'esclavage, la Société des Amis des Noirs fut fondée à Paris en 1788, peu après celle de Londres. La charité publique et privée fut particulièrement active au cours du tragique hiver de 1788-1789. Les survivants de cette époque brillante n'eurent guère besoin de transformer leurs souvenirs pour y retrouver cette "douceur de vivre" que Voltaire avait évoquée dès 1736 dans "le Mondaín", et qu'il oppose avec impertinence à tout ascétisme religieux.
"Regrettera qui veut le bon vieux temps
Et l'âge d 'or, et le règne d 'Astrée,
Et les beaux jours de Saturne et de Rhée,
Et le jardin de nos premiers parents,
Moi je rends grâce à la. nature sage
Qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge
Tant décrié par nos tristes frondeurs :
Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs
J'aime le luxe et même la mollesse,
Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,
La propreté, les goûts, les ornements,
Tout honnête homme a de tels sentiments.
Il est bien doux pour mon cœur très immonde
De voir ici l'abondance à la ronde,
Mère des arts et des heureux travaux,
Nous apporter, de sa source féconde
Et des besoins et des plaisirs nouveaux.
L'or de la terre et les trésors de l'onde,
Leurs habitants et les peuples de l'air,
Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde.
Oh! le bon temps que ce siècle de fer!"

Le tout début du XVIIIe siècle vit naître une forme inattendue de comédie, la comédie qui fait pleurer. Elle doit son existence au développement d'une sensibilité qui n'a pas encore trouvé ses formules expressives. Elle est dans ce mouvement de réaction contre l'intellectualisme excessif et de progrès de la classe bourgeoise, qui s'est élevée de plus en plus face à une aristocratie déclinante. Cette comédie d'un genre sérieux s'appelle, en vers, la "comédie larmoyante", en prose, le "drame bourgeois". L'inventeur de la comédie larmoyante est Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692-1754), qui, après avoir fait en 1719 une critique anonyme des Fables de La Motte, et après avoir publié en 1732 son Épître à Clio dans laquelle il plaide la cause des anciens et attaque les théories antipoétiques du même La Motte, aborda en 1733 le théâtre, où il donna successivement : "La Fausse antipathie" (1733); "Le Préjugé à la mode" (1735), sa pièce la plus connue; "L'École des amis" (1737); "Mélanide" (1741); "L'École des mères" (1744); "La Gouvernante" (1747); "L'Ecole de la jeunesse" (1749) ; "L'Homme de fortune" (1751), "Le Retour imprévu" (1756). La comédie dite larmoyante est aussi représentée par Baculard D'Arnaud (1718-1805). Et c'est Diderot qui va formuler la théorie du drame bourgeois, avec ses trois pièces, "Le Fils naturel ou Les épreuves de la vertu" (comédie en cinq actes et en prose, composée en 1757 et jouée en 1771), "Le Père de famille" (comédie en cinq actes et en prose, composée en 1758 et jouée en 1761), "Est-il bon ? Est-il méchant?" (pièce en quatre actes et en prose, écrite en 1781 et publiée en 1831). Mais le drame bourgeois, tel que le rêvait Diderot, a surtout été réalisé par Michel Sedaine (1719-1797) dans les deux pièces qu'il donna à la Comédie Française, "Le Philosophe sans le savoir" (1765) et "La Gageure imprévue" (comédie en un acte, 1768). Sébastien Mercier (1740-1814) reprendra en les exagérant les idées de Diderot dans son Traité du théâtre ou Nouvel essai sur l'art dramatique (1773).

Il y a donc le Marivaux qui, physiquement, fréquente les salons de Mme de Lambert et de Mme de Tencin, et parfois insupporte ses contemporains : Grimm, qui toujours le traita en ennemi, lui reprochait "d'entendre finesse à tout", ce qui rend, ajoutait-il, son commerce «épineux et insupportable», «il fallait, dit un autre, le louer et le caresser continuellement comme une jolie
femme". Il y a celui qui qui fréquente un cercle ami restreint, tout en restant extrêmement réservé, entre Fontenelle, Montesquieu, Mairan, Lamotte, le président Hénault, l'abbé de Choisy,et un Helvétius lui reprochant encore et toujours, une "délicatesse d'amour-propre" qui ne laissait pas d'être parfois incommode. Inévitable, disent ses biographes, compte tenu de la sagacité perçante de son esprit et de la finesse extrême de sa sensibilité. Marivaux souffrit vivement par son amour-propre et ne sut pas toujours dissimuler ses blessures. Nous le verrons pourtant, comportement rare à une époque de cabales littéraires continues, se tenir à distance, ainsi d'un Voltaire qui ne l'épargna guère. Pensionné par le roi, mais qui ne l'était pas, Marivaux se tint toute sa vie éloigné de la cour, c'est un de ses traits de caractère, et lorsqu'il apprit qu'il devait sa pension à l'influence de Mme de Pompadour, son chagrin d'avoir été longtemps à son insu protégé par elle fut si vif qu'il hâta sa fin. C'est qu'il avait besoin, selon le mot de d'Alembert,
qui est, dans sa concision, un bien rare éloge, « d'aimer et d'estimer ses bienfaiteurs ». Cette hauteur d'âme le préserva de toute ambition...
Marivaux, le salon de Mme de Tencin, ... - Paris remplace Versailles, la société mondaine est le miroir lumineux de cette vie brillante : les salons ont repris l'importance qu'ils avaient au début du XVIIe siècle : salons de Mme de Lambert, de Mme de Tencin, de Mme Geoffrin, de la marquise du Deffand, où se rencontrent les grands seigneurs, les écrivains, les financiers, les artistes, les savants. Jean-François Marmontel (1723-1799), dans le sixième livre de ses Mémoires, nous parle du salon de Mme Geoffrin. Parmi les habitués de ce salon, nous ne retiendrons que d'Alembert et Marivaux qui apparaissent ici pris sur le vif dans toute la vérité de leur comportement quotidien.
"Assez riche pour faire de sa maison le rendez-vous des lettres et des arts, et voyant que c'était pour elle un moyen de se donner dans sa vieillesse une amusante société et une existence honorable, Mme Geoffrin avait fondé chez elle deux dîners : l'un (le lundi) pour les artistes, l'autre (le mercredi) pour les gens de lettres; et une chose assez remarquable, c'est que, sans aucune teinture ni des arts ni des lettres, cette femme qui, de sa vie, n'avait rien lu ni rien appris qu'à la volée, se trouvant au milieu de l'une ou de l'autre société, ne leur était point étrangère. Elle y était même à son aise; mais elle avait le bon esprit de ne parler jamais que de ce qu'elle savait très bien, et de céder, sur tout le reste, la parole à des gens instruits, toujours poliment attentive, sans même paraître ennuyée de ce qu'elle n'entendait pas, mais plus adroite encore à présider, à surveiller, à tenir sous sa main ces deux sociétés naturellement libres, à marquer des limites à cette liberté et à l'y ramener par un mot, par un geste, comme par un fil invisible, lorsqu'elle voulait s 'échapper...
De cette société, l'homme le plus gai, le plus animé, le plus amusant dans sa gaieté, c'était d'Alembert. Après avoir passé sa matinée à chiffrer de l'algèbre et à résoudre des problèmes de dynamique ou d'astronomie, il sortait de chez sa vitrière comme un écolier échappé du collège, ne demandant qu 'à se réjouir; et, par le tour vif et plaisant que prenait alors cet esprit si lumineux, si profond, si solide, il faisait oublier en lui le philosophe et le savant, pour n'y plus voir que l'homme aimable...
Marivaux aurait bien voulu avoir aussi cette humeur enjouée; mais il avait dans la tête une affaire qui le préoccupait sans cesse et lui donnait l'air soucieux. Comme il avait acquis par ses ouvrages la réputation d'esprit subtil et raffiné, il se croyait obligé d'avoir toujours de cet esprit-là et il était continuellement à l'affût des idées susceptibles d'opposition ou d'analyse, pour les faire jouer ensemble ou pour les mettre à l'alambic...
L'abbé Morellet, avec plus d'ordre et de clarté dans un très riche ,magasin de connaissances de toute espèce, était pour la conversation une source d'idées saines, pures, profondes, qui, sans jamais tarir, ne débordait jamais. Il se montrait à nos dîners avec une âme ouverte, un esprit juste et ferme, et dans le cœur autant de droiture que dans l'esprit...
Saint-Lambert, avec une politesse délicate, quoique un peu froide, avait dans la conversation le tour d'esprit élégant et fin qu'on remarque dans ses ouvrages. Sans être naturellement gai, il s'animait de la gaieté des autres; et, dans un entretien philosophique ou littéraire, personne ne causait avec une raison plus saine ni avec un goût plus exquis...
Helvétius, préoccupé de son ambition de célébrité littéraire, nous arrivait la tête encore fumante de son travail de la matinée. Pour faire un livre distingué dans son siècle, son premier soin avait été de chercher ou quelque vérité nouvelle à mettre au jour ou quelque pensée hardie et neuve à produire et à soutenir. Or, comme depuis deux mille ans les vérités nouvelles et fécondes sont infiniment rares, il avait pris pour thèse le paradoxe qu'il a développé dans son livre "De l'Esprit"...
A propos des grâces, parlons d'une personne qui en avait tous les dons dans l'esprit et dans le langage, et qui était la seule femme que Mme Geoffrin eût admise à son dîner des gens de lettres; c'était l'amie de d'Alembert, Mlle de Lespinasse; étonnant composé de bienséance, de raison, de sagesse, avec la tête la plus vive, l'âme la plus ardente, l'imagination la plus inflammable qui ait existé depuis Sapho...
Soit qu'il fût entré dans le plan de Mme Geoffrin d'attirer chez elle les plus considérables des étrangers qui venaient à Paris et de rendre, par-là, sa maison célèbre dans toute l'Europe, soit que ce fût la suite et l'effet naturel de l'agrément et de l'éclat que donnait à cette maison la société des gens de lettres, il n'arrivait d'aucun pays ni prince, ni ministre, ni hommes ou femmes de nom qui, en allant voir Mme Geoffrin, n'eussent l'ambition d'être invités à l'un de nos dîners et ne se fissent un grand plaisir de nous voir réunis à table..." (Marmontel, Mémoires, livre VI).
Les salons eurent en effet sur la littérature du XVIIIe siècle une influence, qui, regrettable à certains égards, fut dans l'ensemble plutôt heureuse. Ils eurent parfois le tort de dégénérer en coteries et contribueront alors à surfaire la renommée de quelques écrivains médiocres. C'est ainsi que le jugement plus équitable et clairvoyant de la postérité a dû remettre à leur véritable place - place très secondaire - des auteurs trop encensés au XVIIIe siècle dans les salons : Marmontel, Saint-Lambert, Delille, Duclos, Chamfort, Rivarol...
En revanche les salons poussèrent les écrivains de valeur à donner leur mesure et les aidèrent à émerger de l'obscurité. Ils obligèrent aussi les philosophes du XVIIIe siècle à parler toujours avec clarté des problèmes difficiles, avec agrément des questions les plus austères, et furent des foyers de diffusion pour leurs idées. Peut-être auraient-ils fini par nuire à la profondeur de la pensée philosophique, si les écrivains y avaient trop constamment vécu; mais les plus grands d'entre eux composèrent leurs œuvres dans la solitude et se contentèrent de venir de temps en temps demander à la conversation vive et spirituelle des salons le stimulant nécessaire à leur activité intellectuelle.
Dans une lettre (1731) à M. Lefebvre (jeune littérateur, qui mourut cette année même) Voltaire, décrivant la vie de l`homme de lettres, en vient à parler de l'esprit de coterie qui règne dans les salons...
"...ll y a dans Paris un grand nombre de petites sociétés où préside toujours quelque femme qui, dans le déclin de sa beauté, fait briller l'aurore de son esprit. Un ou deux hommes de lettres sont les premiers ministres de ce petit royaume. Si vous négligez d'être au rang des courtisans, vous êtes dans celui des ennemis, et on vous écrase. Cependant, malgré votre mérite, vous vieillissez dans l'opprobre et dans la misère. Les places destinées aux gens de lettres sont données à l'intrigue non au talent..
Que le hasard vous amène dans une compagnie où il se trouvera quelqu'un de ces auteurs réprouvés du public ou de ces demi-savants qui n'ont pas même assez de mérite pour être de médiocres auteurs mais qui aura quelque place où qui sera intrus dans quelque corps: vous sentirez, par la supériorité qu'il affectera sur vous, que vous êtes justement dans le dernier degré du genre humain... (Voltaire)
Dans un de ses romans, "Les Confessions du comte de ** (1742), Duclos, après avoir fait une peinture satirique du salon de Mme de Tencin (sous le nom à peine déguisé de Mm de Tonins), conclut ainsi :
"Le dépit de me voir auteur malgré moi, la nécessité d'admirer tout ce qui émanait de notre société et surtout de Madame de Tonins, me dégoutèrent bientôt et d'elle et du bel esprit. Ce fut alors que je commençai à connaître véritablement Madame de Tonins et sa petite cour. Je m'aperçus que chaque société, et surtout celles de bel esprit, croient composer le public; et que j'avais pris pour une approbation générale le sentiment de quelques personnes que les airs imposants et la confiance de Madame de Tonins avaient prévenues et séduites. Le public, loin d'y applaudir, s'en moquait hautement. Le droit usurpé de juger sans appel les hommes et les ouvrages, notre mépris affecté pour ceux qui réduisaient notre société à sa juste valeur, étaient autant d'objets qui excitaient la plaisanterie et la satire publiques. D'ailleurs, notre société n'était pas moins ennuyeuse que ridicule : j'étais étourdi et excédé de n'entendre parler d'autre chose que de comédies, opéras, acteurs et actrices. On a dit que le dictionnaire de l'opéra ne renfermait pas plus de six cents mots : celui des gens du monde est encore plus borné. Tous ces beaux d'esprit ne servent qu'à dégoûter le génie, rétrécir l'esprit, encourager les médiocres, donner de l'orgueil aux sots, et révolter le public." (Duclos, Les Confessions du comte de **, 1e partie.)
Dans ses "Considérations sur les mœurs" (1751), Duclos a montré les avantages des salons du XVIIIe siècle, dont il avait, neuf ans plus tôt, dénoncé surtout les inconvénients...
"Autrefois les gens de lettres, livrés à l'étude et séparés du monde, en travaillant pour les contemporains, ne songeaient qu'à la postérité. Leurs mœurs, pleines de candeur et de rudesse, n'avaient guère de rapport avec celles de la société; et les gens du monde, moins instruits qu'aujourd'hui, admiraient les ouvrages, ou plutôt le nom des auteurs, et ne se croyaient pas trop capables de vivre avec eux. Il entrait même dans cet éloignement plus de considération que de répugnance. Le goût des lettres, des sciences et des arts a gagné insensiblement, et il est venu au point que ceux qui ne l'ont pas l'affectent. On a donc recherché ceux qui les cultivent, et ils ont été attirés dans le monde à proportion de l'agrément qu'on a trouvé leur commerce. On a gagné de part et d'autre à cette liaison. Les gens du monde ont cultivé leur esprit, formé leur goût et acquis de nouveaux plaisirs. Les gens de lettres n'en ont pas retiré moins d'avantages. Ils ont trouvé de la considération; ils ont perfectionné leur goût, poli leur esprit, adouci leurs moeurs et acquis sur plusieurs articles des lumières qu'ils n'auraient pas puisées dans les livres". (Duclos, Considérations sur les mœurs, chap.XI)
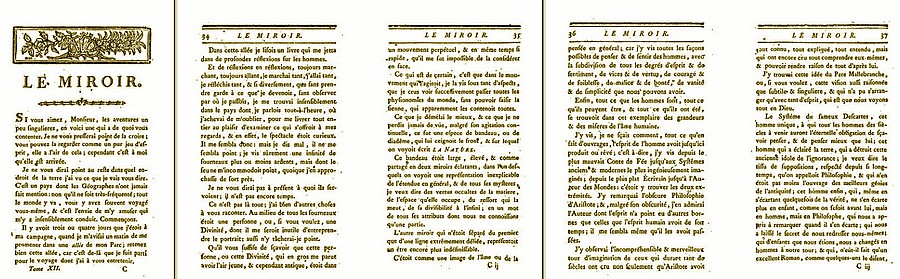
A trois reprises, Marivaux fonde des «feuilles» ou journaux, Spectateur français, Cabinet du philosophe, Indigent philosophe, qui tombent rapidement, faute de lecteurs. Le public est celui des Cafés littéraires qui, en même temps que les salons connaissent une faveur nouvelle, c'est l'époque de multiplication des cafés à Paris. Et c'est dans ces « cafés littéraires » que se montaient ordinairement les cabales destinées à faire tomber les pièces de certains auteurs et Marivaux, fort de ses trente-deux pièces de théâtre, sept ou huit romans et une incroyable quantité de «mélanges», fut de ceux contre qui se dressèrent ces cénacles qui y siégeaient. Il fut ainsi plusieurs fois obligé de faire représenter ses pièces sans les signer ou en les signant d'un pseudonyme, afin de dérouter les meneurs de cabales...
C'est qu'on discute dans ces cafés aussi passionnément que dans les clubs, les académies et les loges maçonniques, où se façonne peu à peu une opinion publique de plus en plus puissante. Le rayonnement de la France est à son apogée; ses artistes et ses écrivains sont accueillis avec faveur dans l'Europe entière, et la bonne société de tous les pays parle français : c'est en français qu'en mars 1721, Jean-Sébastien Bach dédie ses Six concerts avec plusieurs instruments au Margrave de Brandebourg...
La première maison de café s'ouvrit en France à Marseille en 1654 et en 1669 cette boisson fut mise à la mode à Paris par Soliman-Aga, ambassadeur ottoman auprès de Louis XIV. Montesquieu, dans ses Lettres persanes (XXXVI), traçait en 1713 ce petit tableau des cafés de Paris : "Le café est très en usage à Paris : il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles; dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y est entré."
Trois cafés littéraires, situés dans le quartier du Pont-Neuf, furent surtout célèbres au XVIIIe siècle. Le café Procope, fondé en 1689 par le Sicilien Francesco Procopio dei Coltelli, 13, rue des Fossés-Saint-Germain (rue actuelle de l'Ancienne-Comédie). Là se réunissaient Boindin, l'abbé Terrasson, Fréret, Fontenelle, Duclos, Dumarsais, Piron, Voltaire, Diderot, Marmontel, La Chaussée... Le café Gradot, sur le Quai de l'École, dont les principaux habitués étaient La Motte, Saurin et Maupertuis. Le café de la veuve Laurent, à l'angle de la rue Dauphine et de la rue Christine, fréquenté par J.-B. Rousseau, La Motte, Saurin, La Faye, Maupertuis, Crébillon...
"Les cafés surtout prennent avec une vivacité prodigieuse; mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un café? C'est, en deux mots, le secret de rassembler chez soi un très grand nombre de gens sans dépense, sans cérémonie et sans gêne; bien entendu qu'on n'admet que les gens de sa société; or, voici comment on s'y prend. Le jour indiqué pour tenir café, on place dans la salle destinée à cet usage plusieurs petites tables de deux, de trois ou de quatre places au plus; les unes sont garnies de cartes, jetons, échecs, damiers, trictracs, etc. ; les autres de bière, vin, orgeat et limonade. La maîtresse de la maison qui tient le café est vêtue à l'anglaise : robe simple, courte, tablier de mousseline, fichu pointu et petit chapeau; elle a devant elle une table longue en forme de comptoir, sur laquelle on trouve des oranges, des biscuits, des brochures, et tous les papiers publics. La tablette de cheminée est garnie de liqueurs ; les valets sont tous en vestes blanches et en bonnets blancs; on les appelle garçons, ainsi que dans les cafés publics; on n'en admet aucun d'étranger; la maîtresse de la maison ne se lève pour personne; chacun se place oú il veut et à la table qu'il lui plaît... Mais ce n'est pas tout; il y a tout plein d'accessoires charmants à tout, cela : on y joue des pantomimes, on y danse, on y chante, on y représente des proverbes..." (Mme d'Epinay)

Marivaux et le "marivaudage"...
Marivaux a composé trente-deux pièces et donne à la comédie une forme nouvelle dans première moitié du XVIIIe, Beaumarchais fera de même dans la seconde. La grande originalité de Marivaux consiste à avoir pris l'amour comme thème exclusif de ses pièces, à l'avoir peint pour lui-même, et non pas seulement, ainsi que le faisait Molière, pour fournir une intrigue à la comédie ou pour aider à la manifestation des caractères. Aussi a-t-on pu avec raison rapprocher Marivaux de Racine. Mais nous ne sommes plus à la même époque et le temps de cet amour est différent. Racine a peint l'amour-passion et Marivaux l'amour-tendresse ; Racine a peint l'amour lorsqu'il est arrivé à l'état de crise et Marivaux à l'heure où il s'éveille dans un cœur encore jeune. Marivaux a d'ailleurs, comme Racine, fait des pièces extrêmement simples, et, comme lui encore, excellé dans la peinture des caractères féminins. Ce qui est bien à lui, en revanche, c'est le langage qu'il prête a ses personnages, cette manière très spéciale de s'exprimer que du vivant même de Marivaux on avait nommé le "marivaudage", et qui consiste à dire des choses aimables de façon spirituelle, loin du style direct de Molière..
Ainsi des confidences d'une jeune fille de qualité à sa suivante...
" Lucile. − Je te dis que mon parti est pris, et je veux que tu la portes. Est-ce que tu crois que je me pique d'être plus indifférente qu'une autre ? Non, je ne me vante point de cela, et j'aurais tort de le faire, car j'ai l'âme tendre, quoique naturellement vertueuse : et voilà pourquoi le mariage serait une très mauvaise condition pour moi. Une âme tendre est douce, elle a des sentiments, elle en demande ; elle a besoin d'être aimée, parce qu'elle aime ; et une âme de cette espèce-là entre les mains d'un mari n'a jamais son nécessaire.
Lisette. − Oh ! dame, ce nécessaire-là est d'une grande dépense, et le coeur d'un mari s'épuise.
Lucile. − Je les connais un peu, ces messieurs-là ; je remarque que les hommes ne sont bons qu'en qualité d'amants, c'est la plus jolie chose du monde que leur coeur, quand l'espérance les tient en haleine ; soumis, respectueux et galants, pour le peu que vous soyez aimable avec eux, votre amour-propre est enchanté ; il est servi délicieusement ; on le rassasie de plaisirs, folie, fierté, dédain, caprices, impertinences, tout nous réussit, tout est raison, tout est loi ; on règne, on tyrannise, et nos idolâtres sont toujours à nos genoux. Mais les épousez-vous, la déesse s'humanise-t-elle, leur idolâtrie finit où nos bontés commencent. Dès qu'ils sont heureux, les ingrats ne méritent plus de l'être..."
Ainsi du marivaudage entre un laquais et une servante...
"Lépine. − Remarquons d'abondance que la Comtesse se plaît avec mon maître, qu'elle a l'âme joyeuse en le voyant. Vous me direz que nos gens sont étranges personnes, et je vous l'accorde. Le Marquis, homme tout simple, peu hasardeux dans le discours, n'osera jamais aventurer la déclaration ; et des déclarations, la Comtesse les épouvante ; femme qui néglige les compliments, qui vous parle entre l'aigre et le doux, et dont l'entretien a je ne sais quoi de sec, de froid, de purement raisonnable. Le moyen que l'amour puisse être mis en avant avec cette femme. Il ne sera jamais à propos de lui dire : "Je vous aime", à moins qu'on ne le lui dise à propos de rien. Cette matière, avec elle, ne peut tomber que des nues. On dit qu'elle traite l'amour de bagatelle d'enfant ; moi, je prétends qu'elle a pris goût à cette enfance. Dans cette conjoncture, j'opine que nous encouragions ces deux personnages. Qu'en sera-t-il ? qu'ils s'aimeront bonnement, en toute simplesse, et qu'ils s'épouseront de même. Qu'en sera-t-il ? Qu'en me voyant votre camarade, vous me rendrez votre mari par la douce habitude de me voir. Eh donc ! parlez, êtes-vous d'accord ?
Lisette. − Non.
Lépine. − Mademoiselle, est−ce mon amour qui vous déplaît ?
Lisette. − Oui.
Lépine. − En peu de mots vous dites beaucoup ; mais considérez l'occurrence. Je vous prédis que nos maîtres se marieront ; que la commodité vous tente."

On a souvent écrit que Marivaux (1688-1763) avait prêté une âme aux figurines que met en scène Antoine Watteau (1684-1721), le peintre des « fêtes galantes », le représentant du mouvement rocaille, l'artiste qui aime tant représenter le théâtre dans ses tableaux (La Comédie italienne. Vers 1720. Huile sur toile. National Gallery of Art, Washington D.C). Quatre ans les séparent, et tous deux sont experts à découvrir toutes les malices ingénues et toutes les naïvetés rusées que peut receler un cœur de femme, les tableaux de ce peintre tant mélancolique qu'amusé illustrent nombre de ses dialogues...



Cf. "Comédiens de la Comédie-Française", The Hermitage, St. Petersburg, 1712; "La Comédie Française", 1716, Staatliche Museen, Berlin; "La Comédie Italienne", 1716, Staatliche Museen, Berlin; "Une Proposition embarassante", 1716, The Hermitage, St. Petersburg; "L'Embarquement pour Cythera", 1718-20, Schloss Charlottenburg, Berlin; "La gamme d'amour", 1717, National Gallery, London; "Les Charmes de la Vie", 1718, Wallace Collection, London; "La Boudeuse", 1718, The Hermitage, St. Petersburg; "La Finette", 1717, Musée du Louvre; "Acteurs de la Comédie Française, 1720, Metropolitan Museum of Art, New York; "L'Enseigne de Gersaint", 1720, Schloss Charlottenburg, Berlin...

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux,
né à Paris en 1688, vécut à Riom et à Limoges, et c'est à Riom, où son père, un financier intègre, est directeur de la Monnaie, qu'il étudie au Collège de l'Oratoire. Il est inscrit dès 1710 à la Faculté de droit de Paris, mais semble prendre plus d'intérêt à la littérature qu'au droit et est reçu dans les salons à la mode de Mme de Lambert, Mme de Tencin, Mme Geoffrin, fréquente La Motte, Fontenelle, Helvétius, et commence tôt à écrire des romans, des parodies des anciens et des articles pour le Nouveau Mercure. Vers 1712, sa production n'est guère reluisante, Pharsamon, les Effets surprenants de la sympathie, la Voiture embourbée, l'Iliade travestie, imite La Bruyère avec ses Réflexions sur la populace, le Bourgeois, le Peuple. Il fait à trente-quatre ans, un mariage d'inclination, qui lui donna deux années d'un bonheur paisible, brutalement interrompu par la mort de sa femme, Mlle Colombe Bologne. Entre temps il aura englouti la fortune de celle-ci dans la banqueroute de Law. En 1720, Marivaux cherche encore sa voie et donne aux Comédiens italiens une comédie, "Arlequin poli par l'amour", et aux Comédiens-Français une tragédie, "Annibal", la première est un succès, la seconde un échec. Après avoir décroché enfin sa licence de droit, Marivaux fonde un journal sur le modèle du Spectator anglais, le Spectateur français (qui paraît de 1721 à 1734), fourmillant de choses vues, de réflexions, dans lequel comme son devancier anglais, le dramaturge romancier tente de "faire sortir la philosophie des cabinets d'étude et des bibliothèques". Il entend "penser en homme" plus qu'en auteur, et au passage s'amuser avec lui-même. "Je préférerais, écrit-il, toutes les idées fortuites que le hasard nous donne à celle que la recherche la plus ingénieuse pourrait nous fournir dans le travail". Avec nonchalance et ironie, dénonçant les petites façons des belles au miroir ou démaquant les ruses du "négligé" féminin, cette "abjuration simulée de coquetterie", le "chef d'oeuvre de l'envie de plaire", Marivaux devient l'intime des Comédiens italiens où brillent Silvia, Flaminia, Lélio et Thomassin, il leur écrit sur mesure, entre 1722 et 1740, dans le langage «de la conversation», des comédies d'un ton nouveau, dont la dramaturgie se fonde sur les «mouvements» de la sensibilité : la Surprise de l'amour (1722), la Double Inconstance (1723), le Prince travesti (1724) et la Fausse Suivante, le Jeu de l'amour et du hasard (1730), le Triomphe de l'amour et l'École des mères, l'Heureux Stratagème (1733), la Mère confidente (1735), les Fausses Confidences (1737), la Joie imprévue, les Sincères et l'Épreuve (1740).
Un Marivaux oublié, celui qui, exemple rare chez les auteurs de ce XVIIIe siècle, aborde autant d'idées et de thèmes relatifs aux évolutions des moeurs, l'union libre, l'émancipation des femmes, dans L'Ile des Esclaves, L'Héritier de village, La Nouvelle Colonie ou la ligue des femmes, L'Ile de la raison ou les petits hommes.
On oublie de même que chez Molière, chez Regnard et chez leurs successeurs du Palais-Royal, les rôles de femmes sont rares, peu étoffés et presque toujours burlesques. Elles s'appellent Clarice, Angélique, Constance, Lucile; quelquefois même, Hermiane, Garise, Églé, Dina, des jeunes filles sous des demi-masques à la Watteau nées vraisemblablement vers le temps où le roi Louis XIV finissait tant bien que mal son règne. Elles ont été admises à la vie mondaine dans un temps où le roi Louis XV était jeune et le royaume particulièrement heureux, pour certains. C'est ainsi que dans les comédies de Marivaux, les femmes occuperont le premier plan....
Il écrit aussi deux romans importants : "la Vie de Maríanne", publiée de 1731 à 1741 et "le Paysan parvenu", publié en 1735 et 1736, où il étudie avec beaucoup de vérité les mœurs contemporaines à travers des personnages vivants et concrets. En 1742, il avait été élu à l'Académie grâce au soutien sans réserve de Mme de Tencin. Ses dernières années seront bien sombre, soutenu par une autre femme, après la disparition de Mme de Tencin, Mlle de Saint-Jean, Gabrielle-Angélique Anquetin de la Chapelle Saint-Jean qui éprouvait pour l'auteur une tendre admiration. Il mourra, un peu oublié, en 1763...

1720 - "Arlequin poli par l'amour"
Comédien un acte représentée pour la première fois par les comédiens italiens, le 16 juillet 1720. C'est à cette même année que Marivaux, en collaboration avec le chevalier de Saint-Jorry, écrira une première comédie dont le texte est aujourd'hui perdu, "L'Amour et la Vérité", deux irréconciliables thèmes qu'il tentera par la suite constamment d'articuler.
SCÈNE PREMIÈRE - LA FÉE, TRIVELIN.
TRIVELIN, à la fée, qui soupire.
Vous soupirez, madame ; et, malheureusement pour vous, vous risquez de soupirer longtemps, si votre raison n'y met ordre. Me permettez-vous de le vous dire ici mon sentiment ?
LA FÉE.
Parle.
TRIVELIN.
Le jeune homme que vous avez enlevé à ses parents est un beau brun, bien fait ; c'est la figure la plus charmante du monde. Il dormait dans un bois quand vous le vîtes, et c'était assurément voir l'Amour endormi. Je ne suis donc point surpris du penchant subit qui vous a prise pour lui.
LA FÉE.
Est-il rien de plus naturel que d'aimer ce qui est aimable ?
TRIVELIN.
Oh ! sans doute ; cependant, avant cette aventure, vous aimiez assez le grand enchanteur Merlin.
LA FÉE.
Eh bien ! l'un me fait oublier l'autre; cela est encore fort naturel.
TRIVELIN.
C'est la pure nature ; mais il reste une petite observation à faire ; c'est que vous enlevez le
jeune homme endormi, quand peu de jours après vous allez épouser le même Merlin qui en a votre parole. Oh ! cela devient sérieux ; et, entre nous, c'est prendre la nature un peu trop à la lettre. Cependant, passe encore; le pis qu'il en pouvait arriver, c'était d'être infidèle ; cela serait très vilain dans un homme; mais dans une femme, cela est plus supportable. Quand une femme est fidèle, on l'admire ; mais il y a des femmes modestes qui n'ont pas la vanité de vouloir être admirées. Vous êtes de celles-là ; moins de gloire, et plus de plaisir ; à la bonne heure !
LA FÉE.
De la gloire à la place où je suis ! Je serais une grande dupe de me gêner pour si peu de chose.
TRIVELIN.
C'est bien dit ; poursuivons. Vous portez le jeune homme endormi dans votre palais, et vous
voilà à guetter le moment de son réveil ; vous êtes en habit de conquête et dans un attirail
digne du mépris généreux que vous avez pour la gloire. Vous vous attendiez de la part du beau garçon à la surprise la plus amoureuse ; il s'éveille et vous salue du regard le plus imbécile que jamais nigaud ait porté. Vous vous approchez ; il bâille deux ou trois fois de toutes ses forces, s'allonge, se retourne et se rendort. Voilà l'histoire curieuse d'un réveil qui promettait une scène si intéressante. Vous sortez en soupirant de dépit, et peut-être chassée par un ronflement de basse-taille, aussi nourri qu'il en soit. Une heure se passe ; il se réveille encore, et, ne voyant personne auprès de lui, il crie : Hé ! A ce cri galant, vous rentrez ; l'Amour se frottait les yeux. Que voulez-vous, beau jeune homme ? lui dites-vous. Je veux goûter, moi, répondit-il. .Mais n'êtes-vous point surpris de me voir ? ajoutez-vous. Eh ! mais, oui, repart-il. Depuis quinze jours qu'il est ici, sa conversation a toujours été de la même force. Cependant vous l'aimez ; et, qui pis est, vous laissez penser à Merlin que lui, Merlin, va vous épouser; et votre dessein, m'avez-vous dit, est, s'il est possible, d'épouser le jeune homme. Franchement, si vous les prenez tous deux, suivant toutes les règles, le second mari doit gâter le premier.
LA FÉE.
Je vais te répondre en deux mots. La figure du jeune homme en question m'enchante ; j'ignorais qu'il eût si peu d'esprit quand je l'ai enlevé. Pour moi sa bêtise ne me rebute point ; j'aime, avec les grâces qu'il a déjà, celles que lui prêtera l'esprit quand il en aura. Quelle volupté de voir un homme aussi charmant me dire, à mes pieds : Je vous aime ! Il est déjà le plus beau brun du monde ; mais sa bouche, ses yeux, tous ses traits seront adorables, quand un peu d'amour les aura retouchés ; mes soins réussiront peut-être à lui en inspirer. Souvent il me regarde, et tous les jours je crois être au moment où il peut me sentir et se sentir lui-même. Si cela lui arrive, sur-le-champ j'en fais mon mari. Cette qualité le mettra alors à l'abri des fureurs de Merlin ; mais, avant cela, je n'ose mécontenter cet enchanteur, aussi puissant que moi, et avec qui je différerai le plus longtemps que je pourrai.
TRIVELIN.
Mais si le jeune homme n'est jamais ni plus amoureux ni plus spirituel, si l'éducation que vous tâchez de lui donner ne réussit pas, vous épouserez donc Merlin ?
LA FÉE.
Non; car, en l'épousant même je ne pourrais me déterminer à perdre l'autre de vue ; et si jamais il venait à m'aimer, toute mariée que je serais, je veux bien te l'avouer, je ne me fierais pas à moi.
TRIVELIN.
Oh ! je m'en serais bien douté sans que vous me l'eussiez dit. Femme tentée et femme vaincue, c'est tout un. Mais je vois notre bel imbécile qui vient avec son maître à danser...

1723 - "La Surprise de l’amour"
" Le Baron. − Songez-vous à tous les millions de femmes qu'il y a dans le monde, au couchant, au levant, au septentrion, au midi, Européennes, Asiatiques, Africaines, Américaines, blanches, noires, basanées, de toutes les couleurs ? Nos propres expériences, et les relations de nos voyageurs, nous apprennent que partout la femme est amie de l'homme, que la nature l'a pourvue de bonne volonté pour lui ; la nature n'a manqué que Madame, le soleil n'éclaire qu'elle chez qui notre espèce n'ait point rencontré grâce, et cette seule exception de la loi générale se rencontre avec un personnage unique, je te le dis en ami ; avec - un homme qui nous a donné l'exemple d'un fanatisme tout neuf ; qui seul de tous les hommes n'a pu s'accoutumer aux coquettes qui fourmillent sur la terre, et qui sont aussi anciennes que le monde ; enfin qui s'est condamné à venir ici languir de chagrin de ne plus voir de femmes, en expiation du crime qu'il a fait quand il en a vu. Oh ! je ne sache point d'aventure qui aille de pair avec la vôtre...." (Acte I, scène VIII)
Le succès de cette comédie en trois actes, sa première véritable comédie, fut tel que Marivaux en écrira deux suites, la Seconde Surprise de l'amour (1727), puis Les Serments indiscrets (1732). "Il s'agit de deux personnes qui s'aiment pendant toute la pièce, mais qui n'en savent rien eux-mêmes, et qui n'ouvrent les yeux qu'à la dernière scène". Lélio, meurtri par une infidèle, s`est réfugié à la campagne, résolu à ne plus voir de femmes. Son valet Arlequin, abandonné également par une maîtresse volage, partage sa retraite, sinon la fermeté de son ressentiment. Jacqueline, servante de Lélio, et Pierre. jardinier de la comtesse qui habite la propriété voisine, voudraient se marier. mais craignent que l'humeur de Lélio ne s'oppose à leur projet; aussi mettent-ils leur espoir dans l'appui que la comtesse leur a promis. La visite que la comtesse fait à Lélio, accompagnée de Colombine, sa suivante, est fort froidement accueillie; et Lélio lui en découvre la raison. Mais la comtesse n'a pas moins mauvaise opinion des hommes que Lélio des femmes et de leur perfidie. Leur entrevue, toute en provocations et pointes, n'a rien d`un duo d`amoureux; mais elle ne trompe pas leur ami le baron, ni peut-être Colombine à qui il ne déplairait pas de "travailler à la conversion d`Arlequin". Et c'est Arlequin qui le premier cède, mais pour que Colombine l'épouse, il faut "hâter l'amour de nos maîtres"...
(Acte I, Scène II) - Lélio, Arlequin, tous deux d'un air triste. Lélio, dégoûté de l'amour, s'est retiré à la campagne pour y vivre « en ermite, en philosophe ». Il se promène dans une allée en devisant avec son valet Arlequin.
Lélio. − Le temps est sombre aujourd'hui.
Arlequin. − Ma foi oui, il est aussi mélancolique que nous.
Lélio. − Oh, on n'est pas toujours dans la même disposition, l'esprit aussi bien que le temps est sujet à des nuages.
Arlequin. − Pour moi, quand mon esprit va bien, je ne m'embarrasse guère du brouillard.
Lélio. − Tout le monde en est assez de même.
Arlequin. − Mais je trouve toujours le temps vilain, quand je suis triste.
Lélio. − C'est que tu as quelque chose qui te chagrine.
Arlequin. − Non.
Lélio. − Tu n'as donc point de tristesse ?
Arlequin.− Si fait.
Lélio. − Dis donc pourquoi ?
Arlequin. − Pourquoi ? En vérité je n'en sais rien ; c'est peut−être que je suis triste de ce que je ne suis pas gai.
Lélio. − Va, tu ne sais ce que tu dis.
Arlequin. − Avec cela, il me semble que je ne me porte pas bien.
Lélio. − Ah, si tu es malade, c'est une autre affaire.
Arlequin. − Je ne suis pas malade, non plus.
Lélio. − Es-tu fou ? Si tu n'es pas malade, comment trouves-tu donc que tu ne te portes pas bien ?
Arlequin. − Tenez, Monsieur, je bois à merveille, je mange de même, je dors comme une marmotte, voilà ma santé.
Lélio. − C'est une santé de crocheteur, un honnête homme serait heureux de l'avoir.
Arlequin. − Cependant je me sens pesant et lourd, j'ai une fainéantise dans les membres, je bâille sans sujet, je n'ai du courage qu'à mes repas, tout me déplaît ; je ne vis pas, je traîne ; quand le jour est venu, je voudrais qu'il fût nuit ; quand il est nuit, je voudrais qu'il fût jour : voilà ma maladie ; voilà comment je me porte bien et mal.
Lélio. − Je t'entends, c'est un peu d'ennui qui t'a pris ; cela se passera. As-tu sur toi ce livre qu'on m'a envoyé de Paris... ? Réponds donc !
Arlequin. − Monsieur, avec votre permission, que je passe de l'autre côté.
Lélio. − Que veux-tu donc ? Qu'est-ce que cette cérémonie ?
Arlequin. − C'est pour ne pas voir sur cet arbre deux petits oiseaux qui sont amoureux ; cela me tracasse, j'ai juré de ne plus faire l'amour ; mais quand je le vois faire, j'ai presque envie de manquer de parole à mon serment : cela me raccommode avec ces pestes de femmes, et puis c'est le diable de me refâcher contre elles.
Lélio. − Eh, mon cher Arlequin, me crois-tu plus exempt que toi de ces petites inquiétudes-là ? Je me ressouviens qu'il y a des femmes au monde, qu'elles sont aimables, et ce ressouvenir-là ne va pas sans quelques émotions de coeur ; mais ce sont ces émotions-là qui me rendent inébranlable dans la résolution de ne plus voir de femmes.
Arlequin. − Pardi, cela me fait tout le contraire, à moi ; quand ces émotions-là me prennent, c'est alors que ma résolution branle. Enseignez-moi donc à en faire mon profit comme vous.
Lélio. − Oui-da, mon ami : je t'aime ; tu as du bon sens, quoique un peu grossier. L'infidélité de ta maîtresse t'a rebuté de l'amour, la trahison de la mienne m'en a rebuté de même ; tu m'as suivi avec courage dans ma retraite, et tu m'es devenu cher par la conformité de ton génie avec le mien, et par la ressemblance de nos aventures.
Arlequin. − Et moi, Monsieur, je vous assure que je vous aime cent fois plus aussi que de coutume, à cause que vous avez la bonté de m'aimer tant. Je ne veux plus voir de femmes, non plus que vous, cela n'a point de conscience ; j'ai pensé crever de l'infidélité de Margot : les passe-temps de la campagne, votre conversation et la bonne nourriture m'ont un peu remis. Je n'aime plus cette Margot, seulement quelquefois son petit nez me trotte encore dans la tête ; mais quand je ne songe point à elle, je n'y gagne rien ; car je pense à toutes
les femmes en gros, et alors les émotions de coeur que vous dites viennent me tourmenter : je cours, je saute, je chante, je danse, je n'ai point d'autre secret pour me chasser cela ; mais ce secret-là n'est que de l'onguent miton-mitaine : je suis dans un grand danger ; et puisque vous m'aimez tant, ayez la charité de me dire comment je ferai pour devenir fort, quand je suis faible.
Lélio. − Ce pauvre garçon me fait pitié. Ah ! sexe trompeur, tourmente ceux qui t'approchent, mais laisse en repos ceux qui te fuient !
Arlequin. − Cela est tout raisonnable, pourquoi faire du mal à ceux qui ne te font rien ?
Lélio. − Quand quelqu'un me vante une femme aimable et l'amour qu'il a pour elle, je crois voir un frénétique qui me fait l'éloge d'une vipère, qui me dit qu'elle est charmante, et qu'il a le bonheur d'en être mordu.
Arlequin. − Fi donc, cela fait mourir.
Lélio. − Eh, mon cher enfant, la vipère n'ôte que la vie. Femmes, vous nous ravissez notre raison, notre liberté, notre repos ; vous nous ravissez à nous-mêmes, et vous nous laissez vivre. Ne voilà-t-il pas des hommes en bel état après ? Des pauvres fous, des hommes troublés, ivres de douleur ou de joie, toujours en convulsion, des esclaves. Et à qui appartiennent ces esclaves ? à des femmes ! Et qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Pour la définir il faudrait la connaître : nous pouvons aujourd'hui en commencer la définition, mais je soutiens qu'on n'en verra le bout qu'à la fin du monde.
Arlequin. − En vérité, c'est pourtant un joli petit animal que cette femme, un joli petit chat, c'est dommage qu'il ait tant de griffes.
Lélio. − Tu as raison, c'est dommage ; car enfin, est-il dans l'univers de figure plus charmante ? Que de grâces, et que de variété dans ces grâces !
Arlequin. − C'est une créature à manger.
Lélio. − Voyez ces ajustements, jupes étroites, jupes en lanterne, coiffure en clocher, coiffure sur le nez, capuchon sur la tête, et toutes les modes les plus extravagantes : mettez-les sur une femme, dès qu'elles auront touché sa figure enchanteresse, c'est l'Amour et les Grâces qui l'ont habillée, c'est de l'esprit qui lui vient jusques au bout des doigts. Cela n'est−il pas bien singulier ?
Arlequin. − Oh, cela est vrai ; il n'y a mardi ! pas de livre qui ait tant d'esprit qu'une femme, quand elle est en corset et en petites pantoufles.
Lélio. − Quel aimable désordre d'idées dans la tête ! que de vivacité ! quelles expressions ! que de naïveté ! L'homme a le bon sens en partage, mais ma foi l'esprit n'appartient qu'à la femme. A l'égard de son coeur, ah ! si les plaisirs qu'il nous donne étaient durables, ce serait un séjour délicieux que la terre. Nous autres hommes, la plupart, nous sommes jolis en amour : nous nous répandons en petits sentiments doucereux ; nous avons la marotte d'être délicats, parce que cela donne un air plus tendre ; nous faisons l'amour règlement, tout comme on fait une charge ; nous nous faisons des méthodes de tendresse ; nous allons chez une femme, pourquoi ? Pour l'aimer, parce que c'est le devoir de notre emploi. Quelle pitoyable façon de faire ! Une femme ne veut être ni tendre ni délicate, ni fâchée ni bien aise ; elle est tout cela sans le savoir, et cela est charmant. Regardez-la quand elle aime, et qu'elle ne veut pas le dire, morbleu, nos tendresses les plus babillardes approchent-elles de l'amour qui passe à travers son silence ?
Arlequin. − Ah ! Monsieur, je m'en souviens, Margot avait si bonne grâce à faire comme cela la nigaude !
Lélio. − Sans l'aiguillon de la jalousie et du plaisir, notre coeur à nous autres est un vrai paralytique : nous restons là comme des eaux dormantes, qui attendent qu'on les remue pour se remuer. Le coeur d'une femme se donne sa secousse à lui-même ; il part sur un mot qu'on dit, sur un mot qu'on ne dit pas, sur une contenance. Elle a beau vous avoir dit qu'elle aime ; le répète-t-elle, vous l'apprenez toujours, vous ne le saviez pas encore : ici par une impatience, par une froideur, par une imprudence, par une distraction, en baissant les yeux, en les relevant, en sortant de sa place, en y restant ; enfin c'est de la jalousie, du calme, de l'inquiétude, de la joie, du babil et du silence de toutes couleurs. Et le moyen de ne pas s'enivrer du plaisir que cela donne ? Le moyen de se voir adorer sans que la tête vous tourne ? Pour moi, j'étais tout aussi sot que les autres amants ; je me croyais un petit prodige, mon mérite m'étonnait : ah ! qu'il est mortifiant d'en rabattre ! C'est aujourd'hui ma bêtise qui m'étonne ; l'homme prodigieux a disparu, et je n'ai trouvé qu'une dupe à la place.
Arlequin. − Eh bien, Monsieur, queussi, queumi, voilà mon histoire ; j'étais tout aussi sot que vous : vous faites pourtant un portrait qui fait venir l'envie de l'original.
Lélio. − Butor que tu es ! Ne t'ai-je pas dit que la femme était aimable, qu'elle avait le coeur tendre, et beaucoup d'esprit ?
Arlequin. − Oui, est-ce que tout cela n'est pas bien joli ?
Lélio. − Non, tout cela est affreux.
Arlequin. − Bon, bon, c'est que vous voulez m'attraper peut-être.
Lélio. − Non, ce sont là les instruments de notre supplice. Dis-moi, mon pauvre garçon, si tu trouvais sur ton chemin de l'argent d'abord, un peu plus loin de l'or, un peu plus loin des perles, et que cela te conduisît à la caverne d'un monstre, d'un tigre, si tu veux, est-ce que tu ne haïrais pas cet argent, cet or et ces perles ?
Arlequin. − Je ne suis pas si dégoûté, je trouverais cela fort bon ; il n'y aurait que le vilain tigre dont je ne voudrais pas, mais je prendrais vitement quelques milliers d'écus dans mes poches, je laisserais là le reste, et je décamperais bravement après.
Lélio. − Oui, mais tu ne saurais point qu'il y a un tigre au bout, et tu n'auras pas plutôt ramassé un écu, que tu ne pourras t'empêcher de vouloir le reste.
Arlequin. − Fi, par la morbleu, c'est bien dommage : voilà un sot trésor, de se trouver sur ce chemin−là. Pardi, qu'il aille au diable, et l'animal avec.
Lélio. − Mon enfant, cet argent que tu trouves d'abord sur ton chemin, c'est la beauté, ce sont les agréments d'une femme qui t'arrêtent ; cet or que tu rencontres encore, ce sont les espérances qu'elle te donne ; enfin ces perles, c'est son coeur qu'elle t'abandonne avec tous ses transports.
Arlequin. − Ahi ! ahi ! gare l'animal.
Lélio. − Le tigre enfin paraît après les perles, et ce tigre, c'est un caractère perfide retranché dans l'âme de ta maîtresse ; il se montre, il t'arrache son coeur, il déchire le tien ; adieu tes plaisirs, il te laisse aussi misérable que tu croyais être heureux.
Arlequin. − Ah, c'est justement la bête que Margot a lâchée sur moi, pour avoir aimé son argent, son or et ses perles.
Lélio. − Les aimeras−tu encore ?
Arlequin. − Hélas, Monsieur, je ne songeais pas à ce diable qui m'attendait au bout. Quand on n'a pas étudié, on ne voit pas plus loin que son nez.
Lélio. − Quand tu seras tenté de revoir des femmes, souviens-toi toujours du tigre, et regarde tes émotions de coeur comme une envie fatale d'aller sur sa route, et de te perdre.
Arlequin. − Oh, voilà qui est fait ; je renonce à toutes les femmes, et à tous les trésors du monde, et je m'en vais boire un petit coup pour me fortifier dans cette bonne pensée.
(Acte I, scène VII) - La Comtesse, Lélio, Colombine - La comtesse, voisine de Lélio et comme lui d'humeur sauvage, fait profession de mépriser les hommes. A Lélio qui s'étonne d cette sévérité et semble en chercher la raison dans quelque secrète rancune, elle riposte :
Lélio. − Madame, puis-je vous rendre quelque service ?
La Comtesse. − Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise ; mais il y a le neveu de mon fermier qui cherche en mariage une jeune paysanne de chez vous. Ils ont peur que vous ne consentiez pas à ce mariage : ils m'ont priée de vous engager à les aider de quelque libéralité, comme de mon côté j'ai dessein de le faire. Voilà, Monsieur, tout ce que j'avais à vous dire quand vous vous êtes retiré.
Lélio. − Madame, j'aurai tous les égards que mérite votre recommandation, et je vous prie de m'excuser si j'ai fui ; mais je vous avoue que vous êtes d'un sexe avec qui j'ai cru devoir rompre pour toute ma vie : cela vous paraîtra bien bizarre ; je ne chercherai point à me justifier ; car il me reste un peu de politesse, et je craindrais d'entamer une matière qui me met toujours de mauvaise humeur ; et si je parlais, il pourrait, malgré moi, m'échapper des traits d'une incivilité qui vous déplairait, et que mon respect vous épargne.
Colombine. − Mort de ma vie, Madame, est-ce que ce discours-là ne vous remue pas la bile ? Allez, Monsieur, tous les renégats font mauvaise fin : vous viendrez quelque jour crier miséricorde et ramper aux pieds de vos maîtres, et ils vous écraseront comme un serpent. Il faut bien que justice se fasse.
Lélio. − Si Madame n'était pas présente, je vous dirais franchement que je ne vous crains ni ne vous aime.
La Comtesse. − Ne vous gênez point, Monsieur. Tout ce que nous disons ici ne s'adresse point à vous ; regardons−nous comme hors d'intérêt. Et sur ce pied−là, peut-on vous demander ce qui vous fâche si fort contre les femmes ?
Lélio. − Ah ! Madame, dispensez-moi de vous le dire ; c'est un récit que j'accompagne ordinairement de réflexions où votre sexe ne trouve pas son compte.
La Comtesse. − Je vous devine, c'est une infidélité qui vous a donné tant de colère.
Lélio. − Oui, Madame, c'est une infidélité ; mais affreuse, mais détestable.
La Comtesse. − N'allons point si vite. Votre maîtresse cessa-t-elle de vous aimer pour en aimer un autre ?
Lélio. − En doutez-vous, Madame ? La simple infidélité serait insipide et ne tenterait pas une femme sans l'assaisonnement de la perfidie.
La Comtesse. − Quoi ! vous eûtes un successeur ? Elle en aima un autre ?
Lélio. − Oui, Madame. Comment, cela vous étonne ? Voilà pourtant les femmes, et ces actions doivent vous mettre en pays de connaissance.
Colombine. − Le petit blasphémateur !
La Comtesse. − Oui, votre maîtresse est une indigne, et l'on ne saurait trop la mépriser Colombine. − D'accord, qu'il la méprise, il n'y a pas à tortiller : c'est une coquine celle-là.
La Comtesse. − J'ai cru d'abord, moi, qu'elle n'avait fait que se dégoûter de vous, et de l'amour, et je lui pardonnais en faveur de cela la sottise qu'elle avait eue de vous aimer. Quand je dis vous, je parle des hommes en général.
Colombine. − Prenez, prenez toujours cela en attendant mieux.
Lélio. − Comment, Madame, ce n'est donc rien, à votre compte, que de cesser sans raison d'avoir de la tendresse pour un homme ?
La Comtesse. − C'est beaucoup, au contraire ; cesser d'avoir de l'amour pour un homme, c'est à mon compte connaître sa faute, s'en repentir, en avoir honte, sentir la misère de l'idole qu'on adorait, et rentrer dans le respect qu'une femme se doit à elle-même. J'ai bien vu que nous ne nous entendions point : si votre maîtresse n'avait fait que renoncer à son attachement ridicule, eh ! il n'y aurait rien de plus louable ; mais ne faire que changer d'objet, ne guérir d'une folie que par une extravagance, eh fi ! Je suis de votre sentiment, cette femme-là est tout à fait méprisable. Amant pour amant, il valait autant que vous déshonorassiez sa raison qu'un autre.
Lélio. − Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette chute-là.
Colombine. − Ah, ah, ah, il faudrait bien des conversations comme celle-là pour en faire une raisonnable. Courage, Monsieur, vous voilà tout déferré : décochez-lui-moi quelque trait bien hétéroclite, qui sente bien l'original. Eh ! vous avez fait des merveilles d'abord.
Lélio. − C'est assurément mettre les hommes bien bas, que de les juger indignes de la tendresse d'une femme : l'idée est neuve.
Colombine. − Elle ne fera pas fortune chez vous.
Lélio. − On voit bien que vous êtes fâchée, Madame.
La Comtesse. − Moi, Monsieur ! Je n'ai point à me plaindre des hommes ; je ne les hais point non plus. Hélas, la pauvre espèce ! elle est, pour qui l'examine, encore plus comique que haïssable.
Colombine. − Oui-da, je crois que nous trouverons plus de ressource à nous en divertir, qu'à nous fâcher contre elle.
Lélio. − Mais, qu'a-t-elle donc de si comique ?
La Comtesse. − Ce qu'elle a de comique ? Mais y songez-vous, Monsieur ? Vous êtes bien curieux d'être humilié dans vos confrères. Si je parlais, vous seriez tout étonné de vous trouver de cent piques au-dessous de nous. Vous demandez ce que votre espèce a de comique, qui, pour se mettre à son aise, a eu besoin de se réserver un privilège d'indiscrétion, d'impertinence et de fatuité ; qui suffoquerait si elle n'était babillarde, si sa misérable vanité n'avait pas ses coudées franches ; s'il ne lui était pas permis de déshonorer un sexe qu'elle ose mépriser pour les mêmes choses dont l'indigne qu'elle est fait sa gloire. Oh ! l'admirable engeance qui a trouvé la raison et la vertu des fardeaux trop pesants pour elle, et qui nous a chargées du soin de les porter : ne voilà-t-il pas de beaux titres de supériorité sur nous ? et de pareilles gens ne sont-ils pas risibles ! Fiez-vous à moi, Monsieur, vous ne connaissez pas votre misère, j'oserai vous le dire : vous voilà bien irrité contre les femmes ; je suis peut-être, moi, la moins aimable de toutes. Tout hérissé de rancune que vous croyez être, moyennant deux ou trois coups d'oeil flatteurs qu'il m'en coûterait, grâce à la tournure grotesque de l'esprit de l'homme, vous m'allez donner la comédie.
Lélio. − Oh ! je vous défie de me faire payer ce tribut de folie-là.
Colombine. − Ma foi, Madame, cette expérience-là vous porterait malheur.
Lélio. − Ah, ah, cela est plaisant ! Madame, peu de femmes sont aussi aimables que vous, vous l'êtes tout autant que je suis sûr que vous croyez l'être ; mais s'il n'y a que la comédie dont vous parlez qui puisse vous réjouir, en ma conscience, vous ne rirez de votre vie.
Colombine. − En ma conscience, vous me la donnez tous les deux, la comédie. Cependant, si j'étais à la place de Madame, le défi me piquerait, et je ne voudrais pas en avoir le démenti.
La Comtesse. − Non, la partie ne me pique point, je la tiens gagnée. Mais comme à la campagne il faut voir quelqu'un, soyons amis pendant que nous y resterons ; je vous promets sûreté : nous nous divertirons, vous à médire des femmes, et moi à mépriser les hommes.
Lélio. − Volontiers.
Colombine. − Le joli commerce ! on n'a qu'à vous en croire ; les hommes tireront à l'orient, les femmes à l'occident ; cela fera de belles productions, et nos petits-neveux auront bon air. Eh morbleu ! pourquoi prêcher la fin du monde ? Cela coupe la gorge à tout : soyons raisonnables ; condamnez les amants déloyaux, les conteurs de sornettes, à être jetés dans la rivière une pierre au col ; à merveille. Enfermez les coquettes entre quatre murailles, fort bien. Mais les amants fidèles, dressez-leur de belles et bonnes statues pour encourager le public. Vous riez ! Adieu, pauvres brebis égarées ; pour moi, je vais travailler à la conversion d'Arlequin. A votre égard, que le ciel vous assiste, mais il serait curieux de vous voir chanter la palinodie, je vous y attends.
La Comtesse. − La folle ! Je vous quitte, Monsieur ; j'ai quelque ordre à donner : n'oubliez pas, de grâce, ma recommandation pour ces paysans
(Acte II, scène VII) - Lélio, la Comtesse - La comtesse, pour plus de sûreté, a résolu de ne plus parler à Lélio, et vient de le lui marquer dans un billet. Se promenant dans le parc, Lélio l'aperçoit qui paraît chercher quelque chose à terre.
Lélio, d'un air agité. − Oui, Madame, je reviens, j'ai quelque chose à vous dire ; et puisque vous voilà, ce sera un billet d'épargné et pour vous et pour moi.
La Comtesse. − A la bonne heure, de quoi s'agit−il ?
Lélio. − C'est que le neveu de votre fermier ne doit plus compter sur Jacqueline. Madame, cela doit vous faire plaisir ; car cela finit le peu de commerce forcé que nous avons ensemble.
La Comtesse. − Le commerce forcé ? Vous êtes bien difficile, Monsieur, et vos expressions sont bien naïves ! Mais passons. Pourquoi donc, s'il vous plaît, Jacqueline ne veut−elle pas de ce jeune homme ? Que signifie ce caprice−là ?
Lélio. − Ce que signifie un caprice ? Je vous le demande, Madame ; cela n'est point à mon usage, et vous le définiriez mieux que moi.
La Comtesse. − Vous pourriez cependant me rendre un bon compte de celui−ci, si vous vouliez : il est de votre ouvrage apparemment ; je me mêlais de leur mariage, cela vous fatiguait, vous avez tout arrêté. Je vous suis obligée de vos égards.
Lélio. − Moi, Madame !
La Comtesse. − Oui, Monsieur, il n'était pas nécessaire de vous y prendre de cette façon-là ; cependant je ne trouve point mauvais que le peu d'intérêt que j'avais à vous voir fût à charge : je ne condamne point dans les autres ce qui est en moi ; et sans le hasard qui nous rejoint ici, vous ne m'auriez vue de votre vie, si j'avais pu.
Lélio. − Eh, je n'en doute pas, Madame, je n'en doute pas.
La Comtesse. − Non, Monsieur, de votre vie ; et pourquoi en douteriez-vous ? En vérité, je ne vous comprends pas ! Vous avez rompu avec les femmes, moi avec les hommes : vous n'avez pas changé de sentiments, n'est-il pas vrai ? d'où vient donc que j'en changerais ? Sur quoi en changerais-je ? Y songez-vous ? Oh ! mettez-vous dans l'esprit que mon opiniâtreté vaut bien la vôtre, et que je n'en démordrai point.
Lélio. − Eh Madame, vous m'en avez accablé, de preuves d'opiniâtreté ; ne m'en donnez plus, voilà qui est fini. Je ne songe à rien, je vous assure.
La Comtesse. − Qu'appelez-vous, Monsieur, vous ne songez à rien ? mais du ton dont vous le dites, il semble que vous vous imaginez m'annoncer une mauvaise nouvelle ? Eh bien, Monsieur, vous ne m'aimerez jamais, cela est-il si triste ? Oh ! je le vois bien, je vous ai écrit qu'il ne fallait plus nous voir, et je veux mourir si vous n'avez pris cela pour quelque agitation de coeur ; assurément vous me soupçonnez de penchant pour vous. Vous m'assurez que vous n'en aurez jamais pour moi : vous croyez me mortifier, vous le croyez, monsieur Lélio, vous le croyez, vous dis-je, ne vous en défendez point. J'espérais que vous me divertiriez en m'aimant : vous avez pris un autre tour, je ne perds point au change, et je vous trouve très divertissant comme vous êtes.
Lélio, d'un air riant et piqué. − Ma foi, Madame, nous ne nous ennuierons donc point ensemble ; si je vous réjouis, vous n'êtes point ingrate : Vous espériez que je vous divertirais, mais vous ne m'aviez pas dit que je serais diverti. Quoi qu'il en soit, brisons là-dessus ; la comédie ne me plaît pas longtemps, et je ne veux être ni acteur ni spectateur.
La Comtesse, d'un ton badin. − Ecoutez, Monsieur, vous m'avouerez qu'un homme à votre place, qui se croit aimé, surtout quand il n'aime pas, se met en prise ?
Lélio. − Je ne pense point que vous m'aimez, Madame ; vous me traitez mal, mais vous y trouvez du goût. N'usez point de prétexte, je vous ai déplu d'abord ; moi spécialement, je l'ai remarqué : et si je vous aimais, de tous les hommes qui pourraient vous aimer, je serais peut−être le plus humilié, le plus raillé, et le plus à plaindre.
La Comtesse. − D'où vous vient cette idée-là ? Vous vous trompez, je serais fâchée que vous m'aimassiez, parce que j'ai résolu de ne point aimer : Mais quelque chose que j'aie dit, je croirais du moins devoir vous estimer.
Lélio. − J'ai bien de la peine à le croire.
La Comtesse. − Vous êtes injuste, je ne suis pas sans discernement : Mais à quoi bon faire cette supposition, que si vous m'aimiez je vous traiterais plus mal qu'un autre ? La supposition est inutile, puisque vous n'avez point envie de faire l'essai de mes manières ; que vous importe ce qui en arriverait ? Cela vous doit être indifférent ; vous ne m'aimez pas ? car enfin, si je le pensais...
Lélio. − Eh ! je vous prie, point de menace, Madame : vous m'avez tantôt offert votre amitié, je ne vous demande que cela, je n'ai besoin que de cela : Ainsi vous n'avez rien à craindre.
La Comtesse, d'un air froid. − Puisque vous n'avez besoin que de cela, Monsieur, j'en suis ravie ; je vous l'accorde, j'en serai moins gênée avec vous.
Lélio. − Moins gênée ? Ma foi, Madame, il ne faut pas que vous la soyez du tout ; et tout bien pesé, je crois que nous ferons mieux de suivre les termes de votre billet.
La Comtesse. − Oh, de tout mon coeur : allons, Monsieur, ne nous voyons plus. Je fais présent de cent pistoles au neveu de mon fermier ; vous me ferez savoir ce que vous voulez donner à la fille, et je verrai si je souscrirai à ce mariage, dont notre rupture va lever l'obstacle que vous y avez mis. Soyons-nous inconnus l'un à l'autre ; j'oublie que je vous ai vu ; je ne vous reconnaîtrai pas demain.
Lélio. − Et moi, Madame, je vous reconnaîtrai toute ma vie ; je ne vous oublierai point : vos façons avec moi vous ont gravé pour jamais dans ma mémoire.
La Comtesse. − Vous m'y donnerez la place qu'il vous plaira, je n'ai rien à me reprocher ; mes façons ont été celles d'une femme raisonnable.
Lélio. − Morbleu, Madame, vous êtes une dame raisonnable, à la bonne heure. Mais accordez donc cette lettre avec vos premières honnêtetés et avec vos offres d'amitié ; cela est inconcevable, aujourd'hui votre ami, demain rien. Pour moi, Madame, je ne vous ressemble pas, et j'ai le coeur aussi jaloux en amitié qu'en amour : ainsi nous ne nous convenons point.
La Comtesse. − Adieu, Monsieur, vous parlez d'un air bien dégagé et presque offensant, si j'étais vaine : Cependant, et si j'en crois Colombine, je vaux quelque chose, à vos yeux mêmes.
Lélio. − Un moment ; vous êtes de toutes les dames que j'ai vues celle qui vaut le mieux ; je sens même que j'ai du plaisir à vous rendre cette justice-là. Colombine vous en a dit davantage ; c'est une visionnaire, non seulement sur mon chapitre, mais encore sur le vôtre, Madame, je vous en avertis. Ainsi n'en croyez jamais au rapport de vos domestiques.
La Comtesse. − Comment ! Que dites-vous, Monsieur ? Colombine vous aurait fait entendre... Ah l'impertinente ! je la vois qui passe. Colombine, venez ici.

1723 - "La Double Inconstance"
Comédie en trois actes représentée à Paris, le 6 avril 1723, qui ne porte plus sur quelque amour naissant mais sur la fin d'un tendre sentiment et l'apparition d'une nouvelle passion, le moteur de ce changement n'est que vanité et attrait de la nouveauté. Le prince s'est épris d'une jeune paysanne Silvia, l'a fait enlever et conduire en son château. Il voudrait l'épouser, mais elle aime Arlequin. Le prince fait venir Arlequin à sa cour; il veut le rendre infidèle et, par là, ruiner l'amour que lui garde Silvia. La bonne table, les honneurs rendus par les courtisans et la grâce de Flaminia, fille d'un domestique du prince, atténuent la peine d'Arlequin. Silvia apprend par ailleurs que les dames de la Cour se moquent d'elle pour sa beauté rustique et décide de les confondre. Elle jette ainsi son dévolu sur officier qui l'assure en retour de son amour tendre et respectueux. Tandis qu'Arlequin se laisse gagner par les charmes de Flaminia, Silvia se désole de faire souffrir l'officier, qui est en réalité le prince lui-même. Le dénouement est celui qu'on attend : quand le prince se sera fait connaître à Silvia, la comédie se terminera par deux mariages...
Acte I, Scène II, Le Prince, Flaminia, Trivelin
Le Prince, à Trivelin. − Eh bien, as−tu quelque espérance à me donner ? Que dit−elle ?
Trivelin. − Ce qu'elle dit, seigneur, ma foi, ce n'est pas la peine de le répéter, il n'y a rien encore qui mérite votre curiosité.
Le Prince. − N'importe, dis toujours.
Trivelin. − Eh non, seigneur, ce sont de petites bagatelles dont le récit vous ennuierait, tendresse pour Arlequin, impatience de le rejoindre, nulle envie de vous connaître, désir violent de ne vous point voir, et force haine pour nous ; voilà l'abrégé de ses dispositions, vous voyez bien que cela n'est point réjouissant ; et franchement, si j'osais dire ma pensée, le meilleur serait de la remettre où on l'a prise. (Le Prince rêve tristement.)
Flaminia. − J'ai déjà dit la même chose au Prince, mais cela est inutile. Ainsi continuons, et ne songeons qu'à détruire l'amour de Silvia pour Arlequin.
Trivelin. − Mon sentiment à moi est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fille−là ; refuser ce qu'elle refuse, cela n'est point naturel, ce n'est point là une femme, voyez−vous, c'est quelque créature d'une espèce à nous inconnue. Avec une femme, nous irions notre train ; celle−ci nous arrête, cela nous avertit d'un prodige, n'allons pas plus loin.
Le Prince. − Et c'est ce prodige qui augmente encore l'amour que j'ai conçu pour elle.
Flaminia, en riant. − Eh, seigneur, ne l'écoutez pas avec son prodige, cela est bon dans un conte de fée. Je connais mon sexe, il n'a rien de prodigieux que sa coquetterie. Du côté de l'ambition, Silvia n'est point en prise, mais elle a un coeur, et par conséquent de la vanité ; avec cela, je saurai bien la ranger à son devoir de femme. Est−on allé chercher Arlequin ?
Trivelin. − Oui ; je l'attends.
Le Prince, d'un air inquiet. − Je vous avoue, Flaminia, que nous risquons beaucoup à lui montrer son amant, sa tendresse pour lui n'en deviendra que plus forte.
Trivelin. − Oui ; mais si elle ne le voit, l'esprit lui tournera, j'en ai sa parole.
Flaminia. − Seigneur, je vous ai déjà dit qu'Arlequin nous était nécessaire.
Le Prince. − Oui, qu'on l'arrête autant qu'on pourra ; vous pouvez lui promettre que je le comblerai de biens et de faveurs, s'il veut en épouser une autre que sa maîtresse.
Trivelin. − Il n'y a qu'à réduire ce drôle−là, s'il ne veut pas.
Le Prince. − Non, la loi qui veut que j'épouse une de mes sujettes me défend d'user de violence contre qui que ce soit.
Flaminia. − Vous avez raison ; soyez tranquille, j'espère que tout se fera à l'amiable. Silvia vous connaît déjà sans savoir que vous êtes le Prince, n'est−il pas vrai ?
Le Prince. − Je vous ai dit qu'un jour à la chasse, écarté de ma troupe, je la rencontrai près de sa maison ; j'avais soif, elle alla me chercher à boire : je fus enchanté de sa beauté et de sa simplicité, et je lui en fis l'aveu. Je l'ai vue cinq ou six fois de la même manière, comme simple officier du palais : mais quoiqu'elle m'ait traité avec beaucoup de douceur, je n'ai pu la faire renoncer à Arlequin, qui m'a surpris deux fois avec elle.
Flaminia. − Il faudra mettre à profit l'ignorance où elle est de votre rang ; on l'a déjà prévenue que vous ne la verriez pas sitôt ; je me charge du reste, pourvu que vous vouliez bien agir comme je voudrai.
Le Prince, en s'en allant. − J'y consens. Si vous m'acquérez le coeur de Silvia, il n'est rien que vous ne deviez attendre de ma reconnaissance.
Flaminia. − Toi, Trivelin, va−t'en dire à ma soeur qu'elle tarde trop à venir.
Trivelin. − Il n'est pas besoin, la voilà qui entre ; adieu, je vais au−devant d'Arlequin.
Acte I, Scène III, Lisette, Flaminia
Lisette. − Je viens recevoir tes ordres, que me veux−tu ?
Flaminia. − Approche un peu que je te regarde.
Lisette. − Tiens, vois à ton aise.
Flaminia, après l'avoir regardée. − Oui−dà, tu es jolie aujourd'hui.
Lisette, en riant. − Je le sais bien ; mais qu'est−ce que cela fait ?
Flaminia. − Ote cette mouche galante que tu as là.
Lisette, refusant. − Je ne saurais, mon miroir me l'a recommandée.
Flaminia. − Il le faut, te dis−je.
Lisette, en tirant sa boîte à miroir, et ôtant la mouche. − Quel meurtre ! Pourquoi persécutes−tu ma mouche ?
Flaminia. − J'ai mes raisons pour cela. Or ça, Lisette, tu es grande et bien faite.
Lisette. − C'est le sentiment de bien des gens.
Flaminia. − Tu aimes à plaire ?
Lisette. − C'est mon faible.
Flaminia. − Saurais−tu avec une adresse naïve et modeste inspirer un tendre penchant à quelqu'un, en lui témoignant d'en avoir pour lui, et le tout pour une bonne fin ?
Lisette. − Mais j'en reviens à ma mouche, elle me paraît nécessaire à l'expédition que tu me proposes.
Flaminia. − N'oublieras−tu jamais ta mouche ? non, elle n'est pas nécessaire : il s'agit ici d'un homme simple, d'un villageois sans expérience, qui s'imagine que nous autres femmes d'ici sommes obligées d'être aussi modestes que les femmes de son village ; oh ! la modestie de ces femmes−là n'est pas faite comme la nôtre ; nous avons des dispenses qui le scandaliseraient ; ainsi ne regrette plus tes mouches, et mets−en la valeur dans tes manières ; c'est de ces manières dont je te parle ; je te demande si tu sauras les avoir comme il faut ? Voyons, que lui diras-tu ?
Lisette. − Mais, je lui dirai... Que lui dirais-tu, toi ?
Flaminia. − Ecoute−moi, point d'air coquet d'abord. Par exemple, on voit dans ta petite contenance un dessein de plaire, oh ! il faut en effacer cela ; tu mets je ne sais quoi d'étourdi et de vif dans ton geste, quelquefois c'est du nonchalant, du tendre, du mignard ; tes yeux veulent être fripons, veulent attendrir, veulent frapper, font mille singeries ; ta tête est légère ; ton menton porte au vent ; tu cours après un air jeune, galant et dissipé ; parles−tu aux gens, leur réponds−tu ? tu prends de certains tons, tu te sers d'un certain langage, et le tout finement relevé de saillies folles ; oh ! toutes ces petites impertinences−là sont très jolies dans une fille du monde, il est décidé que ce sont des grâces, le coeur des hommes s'est tourné comme cela, voilà qui est fini : mais ici il faut, s'il te plaît, faire main basse sur tous ces agréments-là ; le petit homme en question ne les approuverait point, il n'a pas le goût si fort, lui. Tiens, c'est tout comme un homme qui n'aurait jamais bu que de belle eau bien claire, le vin ou l'eau-de-vie ne lui plairaient pas.
Lisette, étonnée. − Mais de la façon dont tu arranges mes agréments, je ne les trouve pas si jolis que tu dis.
Flaminia, d'un air naïf. − Bon ! c'est que je les examine, moi, voilà pourquoi ils deviennent ridicules : mais tu es en sûreté de la part des hommes.
Lisette. − Que mettrai-je donc à la place de ces impertinences que j'ai ?
Flaminia. − Rien : tu laisseras aller tes regards comme ils iraient si ta coquetterie les laissait en repos ; ta tête comme elle se tiendrait, si tu ne songeais pas à lui donner des airs évaporés ; et ta contenance tout comme elle est quand personne ne te regarde. Pour essayer, donne−moi quelque échantillon de ton savoir−faire ; regarde−moi d'un air ingénu.
Lisette, se tournant. − Tiens, ce regard−là est−il bon ?
Flaminia. − Hum ! il a encore besoin de quelque correction.
Lisette. − Oh dame, veux−tu que je te dise ? Tu n'es qu'une femme, est−ce que cela anime ? Laissons cela, car tu m'emporterais la fleur de mon rôle. C'est pour Arlequin, n'est−ce−pas ?
Flaminia. − Pour lui−même.
Lisette. − Mais le pauvre garçon, si je ne l'aime pas, je le tromperai ; je suis fille d'honneur, et je m'en fais un scrupule.
Flaminia. − S'il vient à t'aimer, tu l'épouseras, et cela te fera ta fortune ; as−tu encore des scrupules ? Tu n'es, non plus que moi, que la fille d'un domestique du Prince, et tu deviendras grande dame.
Lisette. − Oh ! voilà ma conscience en repos, et en ce cas−là, si je l'épouse, il n'est pas nécessaire que je l'aime. Adieu, tu n'as qu'à m'avertir quand il sera temps de commencer.
Flaminia. − Je me retire aussi ; car voilà Arlequin qu'on amène.

1725 - "L’île des esclaves"
Dans l'Ile des Esclaves, Marivaux aborde la question des rapports entre maîtres et serviteurs sur le mode mi-satirique, mi-sentimental. L'antagonisme des classes sociales disparaît-il dès que les êtres humains introduisent dans leurs rapports l'amour du prochain? En débarquant dans cette île, les maîtres deviennent valets et les valets maîtres. Ainsi Iphicrate et son laquais Arlequin, Euphrosine et sa soubrette Cléanthis échangent leur condition, leurs vêtements et jusqu'à leur nom. Et entre autres humiliations que les anciens maîtres ont à subir, ils doivent s'entendre dire leurs vérités par leurs ci-devant serviteurs. Le gouverneur de l'île, Trivelin, explique ce rite à Cléanthis et Euphrosine (scène III).
Scène III - Trivelin, Cléanthis ; esclave, Euphrosine, sa maîtresse.
Trivelin. − Ah ça ! ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie, dites−moi aussi votre nom.
Cléanthis, saluant. − Je m'appelle Cléanthis, et elle, Euphrosine.
Trivelin. − Cléanthis ? passe pour cela.
Cléanthis. − J'ai aussi des surnoms ; vous plaît−il de les savoir ?
Trivelin. − Oui−da. Et quels sont−ils ?
Cléanthis. − J'en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et caetera.
Euphrosine, en soupirant. − Impertinente que vous êtes !
Cléanthis. − Tenez, tenez, en voilà encore un que j'oubliais.
Trivelin. − Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément.
Euphrosine. − Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l'étrange aventure où je me trouve ?
Cléanthis. − Oh ! dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n'y avait rien de si commode ; on n'avait affaire qu'à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? Faites cela, je le veux ; taisez−vous, sotte ! Voilà qui était fini. Mais à présent il faut parler raison ; c'est un langage étranger pour Madame ; elle l'apprendra avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l'avancer.
Trivelin, à Cléanthis. − Modérez−vous, Euphrosine. (A Euphrosine.) Et vous, Cléanthis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir : je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous.
Cléanthis. − Hum ! Elle me trompera bien si elle amende.
Trivelin. − Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice.
Cléanthis. − Oh ! tenez, tout cela est trop savant pour moi, je n'y comprends rien ; j'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait ; ce qui viendra ; nous le prendrons.
Trivelin. − Doucement, point de vengeance
Cléanthis. − Mais, notre bon ami, au bout du compte, vous parlez de son sexe ; elle a le défaut d'être faible, je lui en offre autant ; je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ses mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle ; car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons, qui est−ce qui décidera ? Ne suis−je pas la maîtresse une fois ? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune ; et puis, moi, je lui pardonnerai, quand je pourrai, ce qu'elle m'a fait : qu'elle attende !
Euphrosine, à Trivelin. − Quels discours ! Faut−il que vous m'exposiez à les entendre ?
Cléanthis. − Souffrez−les, Madame, c'est le fruit de vos oeuvres.
Trivelin. − Allons, Euphrosine, modérez−vous.
Cléanthis. − Que voulez−vous que je vous dise ? quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer, que de la contenter un peu, voyez−vous ; quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte ; mais il me faut cela.
Trivelin, à part, à Euphrosine. − Il faut que ceci ait son cours ; mais consolez−vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. (A Cléanthis.) J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y exhorte en ami. Venons maintenant à l'examen de son caractère : il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait, qui se doit faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons.
Cléanthis. − Oh que cela est bien inventé ! Allons, me voilà prête ; interrogez−moi, je suis dans mon fort.
Euphrosine, doucement. − Je vous prie, Monsieur, que je me retire, et que je n'entende point ce qu'elle va dire.
Trivelin. − Hélas ! ma chère Dame, cela n'est fait que pour vous ; il faut que vous soyez présente.
Cléanthis. − Restez, restez ; un peu de honte est bientôt passée.
Trivelin. − Vaine minaudière et coquette, voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde−t−il ?
Cléanthis. − Vaine minaudière et coquette, si cela la regarde ? Eh voilà ma chère maîtresse ; cela lui ressemble comme son visage.
Euphrosine. − N'en voilà−t−il pas assez, Monsieur ?
Trivelin. − Ah ! je vous félicite du petit embarras que cela vous donne ; vous sentez, c'est bon signe, et j'en augure bien pour l'avenir : mais ce ne sont encore là que les grands traits ; détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez−vous les défauts dont nous parlons ?
Cléanthis. − En quoi ? partout, à toute heure, en tous lieux ; je vous ai dit de m'interroger ; mais par où commencer ? je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces, que cela me brouille. Madame se tait, Madame parle ; elle regarde, elle est triste, elle est gaie : silence, discours, regards, tristesse et joie, c'est tout un, il n'y a que la couleur de différente ; c'est vanité muette, contente ou fâchée ; c'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse ; c'est Madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou tous les deux à la fois : voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela.
Euphrosine. − Je n'y saurais tenir.
Trivelin. − Attendez donc, ce n'est qu'un début.
Cléanthis. − Madame se lève ; a-t-elle bien dormi, le sommeil l'a-t-il rendu belle, se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux ? vite sur les armes ; la journée sera glorieuse. Qu'on m'habille ! Madame verra du monde aujourd'hui ; elle ira aux spectacles, aux promenades, aux assemblées ; son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour, il fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener hardiment, il est en état, il n'y a rien à craindre.
Trivelin, à Euphrosine. − Elle développe assez bien cela.
Cléanthis. − Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé ? Ah qu'on m'apporte un miroir ; comme me voilà faite ! que je suis mal bâtie ! Cependant on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit ; des yeux battus, un teint fatigué ; voilà qui est fini, il faut envelopper ce visage−là, nous n'aurons que du négligé, Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même le jour, si elle peut ; du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant il vient compagnie, on entre : que va-t-on penser du visage de Madame ? on croira qu'elle enlaidit : donnera-t-elle ce plaisir−là à ses bonnes amies ? Non, il y a remède à tout : vous allez voir. Comment vous portez-vous, Madame ? Très mal, Madame ; j'ai perdu le sommeil ; il y a huit jours que je n'ai fermé l'oeil ; je n'ose pas me montrer, je fais peur. Et cela veut dire : Messieurs, figurez−vous que ce n'est point moi, au moins ; ne me regardez pas, remettez à me voir ; ne me jugez pas aujourd'hui ; attendez que j'aie dormi. J'entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration ! ... Oh ! ce sont de pauvres gens pour nous.
Trivelin, à Euphrosine. − Courage, Madame ; profitez de cette peinture−là, car elle me paraît fidèle.
Euphrosine. − Je ne sais où j'en suis.
Cléanthis. − Vous en êtes aux deux tiers ; et j'achèverai, pourvu que cela ne vous ennuie pas.
Trivelin. − Achevez, achevez ; Madame soutiendra bien le reste.
Cléanthis. − Vous souvenez−vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait ? j'étais dans la chambre ; vous vous entreteniez bas ; mais j'ai l'oreille fine : vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien ; vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Cette femme−là est aimable, disiez−vous ; elle a les yeux petits, mais très doux ; et là−dessus vous ouvriez les vôtres, vous vous donniez des tons, des gestes de tête, de petites contorsions, des vivacités. Je riais. Vous réussîtes pourtant, le cavalier s'y prit ; il vous offrit son coeur. A moi ? lui dîtes−vous. Oui, Madame, à vous−même, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez, dites−vous, en ôtant vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle ; il la vit ; il la prit, il la baisa ; cela anima sa déclaration ; et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien ! y suis−je ?
Trivelin, à Euphrosine. − En vérité, elle a raison.
Cléanthis. − Ecoutez, écoutez, voici le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre, et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle, et je dis : Oh ! pour cela il faut l'avouer, Madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bontés, pendant huit jours, ce petit mot−là ne me valut−il pas ! J'essayai en pareille occasion de dire que Madame était une femme très raisonnable : oh ! je n'eus rien, cela ne prit point ; et c'était bien fait, car je la flattais.
Euphrosine. − Monsieur, je ne resterai point, ou l'on me fera rester par force ; je ne puis en souffrir davantage.
Trivelin. − En voila donc assez pour à présent.
Cléanthis. − J'allais parler des vapeurs de mignardise auxquelles Madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour je mis à son insu des fleurs dans la ruelle de son lit pour voir ce qu'il en serait. J'attendais une vapeur, elle est encore à venir. Le lendemain, en compagnie, une rose parut ; crac ! la vapeur arrive.
Trivelin. − Cela suffit, Euphrosine ; promenez−vous un moment à quelques pas de nous, parce que j'ai quelque chose à lui dire ; elle ira vous rejoindre ensuite.
Cléanthis, s'en allant. − Recommandez−lui d'être docile au moins. Adieu, notre bon ami ; je vous ai diverti, j'en suis bien aise. Une autre fois je vous dirai comme quoi Madame s'abstient souvent de mettre de beaux habits, pour en mettre un négligé qui lui marque tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là ; on dirait qu'une femme qui le met ne se soucie pas de paraître, mais à d'autre ! on s'y ramasse dans un corset appétissant, on y montre sa bonne façon naturelle ; on y dit aux gens : Regardez mes grâces, elles sont à moi, celles−là ; et d'un autre côté on veut leur dire aussi : Voyez comme je m'habille, quelle simplicité ! il n'y a point de coquetterie dans mon fait.
Trivelin. − Mais je vous ai prié de nous laisser.
Cléanthis. − Je sors, et tantôt nous reprendrons le discours, qui sera fort divertissant ; car vous verrez aussi comme quoi Madame entre dans une loge au spectacle, avec quelle emphase, avec quel air imposant, quoique d'un air distrait et sans y penser ; car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil−là. Vous verrez comme dans la loge on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté, et qu'on ne connaît pas. Bonjour, notre bon ami, je vais à notre auberge.
Chacun reprendra son habit et sa position après bien des révélations, Trivelin scelle la réconciliation des serviteurs et des maîtres, aux premiers, "nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leurs duretés", leur dit-il, quant à ces derniers, "« Vous avez été leurs maîtres, et vous en avez mal agi ; ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent , faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous"...

1730 - "Le Jeu de l’amour et du hasard"
M. Orgon veut marier sa fille avec le fils d'un de ses plus vieux amis. Le jeune homme, Dorante, pour pouvoir mieux observer sa fiancée, a échangé ses habits avec ceux de son valet. Mais la jeune fille, Silvia, a eu la même idée que lui, et a pris le costume de sa soubrette. Dans la scène que voici, nous assistons au premier entretien de Dorante, déguisé en valet sous le nom de Bourguignon, et de Silvia, déguisée en suivante sous le nom de Lisette..
Acte I, scène 7, Silvia, Dorante - Silvia obtient de son père, Orgon, la permission de se déguiser pour observer Dorante, qu'on lui destine, sans être connue de lui. Elle échangera son costume contre celui de sa suivante Lisette. Dorante, de son côté, a eu la même pensée, et il emprunte les vêtements de son domestique. Ainsi Dorante et Silvia, déguisés en valet et soubrette, vont se trouver aux prises, ignorant ce qu'ils sont réellement, tandis que Pasquin, sous les habits de son maître, courtisera Lisette, croyant s'adresser à Silvia. Mario, frère de Silvia, est au fait du déguisement de sa sœur. Il vient d'assister, ainsi qu'Orgon, à la première entrevue des deux jeunes gens et s'est égayé aux dépens de Silvia.
SILVIA (à part)
Ils se donnent la comédie, n'importe, mettons tout à profit ; Ce garçon n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qui l'aura. Il va m'en conter ; laissons-le dire, pourvu qu'il m'instruise.
DORANTE (à part).
Cette fille-ci m'étonne; il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur: lions connaissance avec elle... (Haut). Puisque nous sommes dans le style amical, et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi.
SILVIA.
Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me conter des douceurs; n'est-il pas vrai?
DORANTE
Ma foi! je n'étais pas venu dans ce dessein-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grandes liaisons avec les soubrettes: je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc! tu me soumets; je suis presque timide; ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi; j'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête; et, quand je te tutoie, il me semble que je joue; enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse?
SILVIA
Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant, est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vue.
DORANTE
Ma foi! je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres.
SILVIA
Le trait est joli assurément; mais, je te le répète encore, je ne suis point faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne.
DORANTE
C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas?
SILVIA.
Non, Bourguignon; laissons-là l'amour, et soyons bons amis.
DORIANTE
Rien que cela! Ton petit traité n'est composé que de deux clauses impossibles.
SILVIA (à part). ,
Quel homme pour un valet! (Haut). ,ll faut pourtant qu'il s'exécute; on m'a prédit que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition, et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autres.
DORANTE
Parbleu! cela est plaisant; ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi; j'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition.
SILVIA.
Ne t'écarte donc pas de ton projet.
DORANTE.
Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons: tu as l'air bien distingué, et l'on est quelquefois fille de condition sans le savoir...
SILVIA (à part).
Mais, en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en aie... (Haut.) Dis-moi, qui es-tu, toi qui me parles ainsi?
DORANTE.
Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches.
SILVIA.
Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne, et je voudrais pouvoir y contribuer: la fortune a tort avec toi.
DORANTE.
Ma foi! l'amour a plus tort qu'elle; j'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde.
SILVIA (à part)
Nous voilà, grâce au ciel, en conversation réglée? (Haut.) Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens; mais, je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense?
DORANTE
Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi.
SILVIA
Ah! je me fâcherai; tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-là ton amour. ,
DORANTE
Quitte donc ta figure.
SILVIA (à part)
A la fin, je crois qu'il m'amuse... (Haut.) Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir? Faudra-t-il que je te quitte? (A part.) Je devrais déjà l'avoir fait. .
DORANTE
Attends, Lisette; je voulais moi-même te parler d'autre chose; mais je ne sais plus ce que c'est.
SILVIA
J'avais, de mon côté, quelque chose à te dire; mais tu m'as fait perdre mes idées aussi, à moi.
DORANTE.
Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait.
SILVIA
Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu.
DORANTE.
Eh non! te dis-je, Lisette; il ne s'agit ici que de mon maître.
SILVIA
Eh bien, soit; je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion ; il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sers.
DORANTE
Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple?
SILVIA
Veux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire?
DORANTE
Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'y résiste point; et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par, tout ce qu'il y a de plus aimable au monde.
SILVIA
Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter; car, assurément, cela est singulier.
DORANTE.
Tu as raison, notre aventure est unique.
SILVIA (à part).
Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie, je ne pars point; me voilà encore et je réponds! En vérité, cela passe la raillerie! (Haut.) Adieu...
DORANTE.
Achevons donc ce que nous voulions dire.
SILVIA.
Adieu, te dis-je, plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse
de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine ; en attendant, tu vois cet appartement, c'est le vôtre.
DORANTE.
Tiens, voici mon maître.
Silvia, déguisée en soubrette, éprouve donc une vive attirance pour Arlequin, qui par bonheur n'est autre que Dorante, le fiancé qu'on lui destine; elle ignore qu'il s'est travesti en valet (II, 7). Marivaux analyse avec une extrême délicatesse les émotions de l'amour naissant, l'agacement de la jeune fille qui ne veut pas admettre la réalité de ses sentiments, puis les excuses qu'elle se donne naïvement à elle-même, dans le monologue de la scène 8, acte II.
(Acte II, scène 7)
Silvia
Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d 'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là.
Lisette
Pardi! Madame, je ne puis pas jouer deux rôles à la fois : il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que j'ordonne.
Silvia
Fort bien; mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point.
Lisette
Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup.
Silvia
Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de la voir deux fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot; dans cette conjoncture, c'est à vous à me tirer tout doucement d 'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser.
Lisette
Je ne saurais, Madame.
Silvia
Vous ne sauriez? Et qu'est-ce qui vous en empêche?
Lisette
M. Orgon me l'a défendu.
Silvia
Il vous l'a défendu! Mais je ne reconnais point mon père à. ce procédé-là!
Lisette
Positivement défendu.
Silvia
Eh bien! je vous charge de lui dire mes dégoûts, et de l'assurer qu'ils sont invincibles; je ne saurais me persuader qu'après cela il veuille pousser les choses plus loin.
Lisette
Mais, Madame, le futur, qu'a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant?
Silvia
Il me déplaît, vous dis-je, et votre peu de zèle aussi.
Lisette
Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande.
Silvia
Je le hais assez, sans prendre du temps pour le haïr davantage.
Lísette
Son valet, qui fait l'important, ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte?
Silvia
Hum! la sotte! son valet a bien affaire ici!
Lísette
C'est que je me méfie de lui, car il est raisonneur.
Silvia
Finissez vos portraits, on n 'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu, et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage.
Lísette
Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit.
Silvia
Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? A qui en avez-vous? D'où vous vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin, vous m'obligez à le justifier; il n'est pas question de le brouiller avec son maître ni d'en faire un fourbe pour me faire une imbécile, moi, qui écoute ses histoires.
Lisette
Oh! Madame, dès que vous le défendez sur ce ton-là, et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire.
Silvia.
Dès que je le défends sur ce ton-là? Qu'est-ce que c'est que le ton dont vous dites cela. vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit?
Lisette
Je dis, Madame, que je ne vous ai jamais vue comme vous êtes, et que je ne conçois rien à
votre aigreur. Eh bien! si ce valet n'a rien dit, à la bonne heure; il ne faut pas vous emporter pour le justifier; je vous crois, voilà qui est fini; je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi.
Silvia
Voyez-vous le mauvais esprit! comme elle tourne les choses. Je me sens dans une indignation... qui... va jusqu'aux larmes.
Lisette
En quoi donc, Madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis?
Silvia
Moi, j'y entends finesse! moi! je vous querelle pour lui! j'ai bonne opinion de lui! Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion, juste ciel! bonne opinion! Que faut-il que je réponde à cela! Qu'est-ce que cela veut dire? A qui parlez-vous? Qui est-ce qui est à l'abri
de ce qui arrive? Où en sommes-nous?
Lísette
Je n'en sais rien, mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez.
Silvia
Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable; laissez-moi, je prendrai d'autres mesures.
Acte II, Scène 8
Silvia, seule
Je frissonne encore de ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne nous traitent-ils pas dans leur esprit! Comme ces gens-là vous dégradent! Je ne saurais m'en remettre; je n'oserais songer aux termes dont elle s'est servie, ils me font toujours peur. Il s'agit d'un valet. Ah! l'étrange chose! Écartons l'idée dont cette insolente est venue me noircir l'imagination. Voici Bourguignon, voilà cet objet en question pour lequel je m'emporte; mais ce n'est pas sa faute, le pauvre garçon; et je ne dois pas m'en prendre à lui.
Acte III, Scène 8 - Le marivaudage, l'art de tout dire en ne disant rien, ici Silvia utilise sincérité et coquetterie, a engagé son coeur plus qu'elle ne veut l'avouer, et Dorante souffre..
Dorante, à part. − Qu'elle est digne d'être aimée ! Pourquoi faut−il que Mario m'ait prévenu ?
Silvia. − Où étiez−vous donc, Monsieur ? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à Monsieur Orgon.
Dorante. − Je ne me suis pourtant pas éloigné, mais de quoi s'agit−il ?
Silvia, à part. − Quelle froideur ! (Haut.) J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite, j'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait du moins reculer le mariage, il ne m'a pas seulement écoutée ; je vous avertis même qu'on parle d'envoyer chez le notaire, et qu'il est temps de vous déclarer.
Dorante. − C'est mon intention ; je vais partir incognito, et je laisserai un billet qui instruira Monsieur Orgon de tout.
Silvia, à part. − Partir ! ce n'est pas là mon compte.
Dorante. − N'approuvez−vous pas mon idée ?
Silvia. − Mais... pas trop.
Dorante. − Je ne vois pourtant rien de mieux dans la situation où je suis, à moins que de parler moi−même, et je ne saurais m'y résoudre ; j'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire : je n'ai plus que faire ici.
Silvia. − Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver, ni les combattre ; et ce n'est pas à moi à vous les demander.
Dorante. − Il vous est aisé de les soupçonner, Lisette.
Silvia. − Mais je pense, par exemple, que vous avez du dégoût pour la fille de Monsieur Orgon.
Dorante. − Ne voyez−vous que cela ?
Silvia. − Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer ; mais je ne suis pas folle, et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter.
Dorante. − Ni le courage d'en parler ; car vous n'auriez rien d'obligeant à me dire : adieu Lisette.
Silvia. − Prenez garde, je crois que vous ne m'entendez pas, je suis obligée de vous le dire.
Dorante. − A merveille ! et l'explication ne me serait pas favorable, gardez−moi le secret jusqu'à mon départ.
Silvia. − Quoi, sérieusement, vous partez ?
Dorante. − Vous avez bien peur que je ne change d'avis.
Silvia. − Que vous êtes aimable d'être si bien au fait !
Dorante. − Cela est bien naïf : Adieu.
Il s'en va.
Silvia, à part. − S'il part, je ne l'aime plus, je ne l'épouserai jamais... (Elle le regarde aller.) Il s'arrête pourtant, il rêve, il regarde si je tourne la tête, je ne saurais le rappeler, moi... Il serait pourtant singulier qu'il partît, après tout ce que j'ai fait ? ... Ah, voilà qui est fini, il s'en va, je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais : mon frère est un maladroit, il s'y est mal pris, les gens indifférents gâtent tout. Ne suis−je pas bien avancée ? Quel dénouement ! Dorante reparaît pourtant ; il me semble qu'il revient, je me dédis donc, je l'aime encore... Feignons de sortir, afin qu'il m'arrête : il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose.
Dorante, l'arrêtant. − Restez, je vous prie, j'ai encore quelque chose à vous dire.
Silvia. − A moi, Monsieur ?
Dorante. − J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincue que je n'ai pas tort de le faire.
Silvia. − Eh, Monsieur, de quelle conséquence est−il de vous justifier auprès de moi ? Ce n'est pas la peine, je ne suis qu'une suivante, et vous me le faites bien sentir.
Dorante. − Moi, Lisette ! est−ce à vous à vous plaindre, vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire ?
Silvia. − Hum, si je voulais, je vous répondrais bien là−dessus.
Dorante. − Répondez donc, je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis−je ! Mario vous aime.
Silvia. − Cela est vrai.
Dorante. − Vous êtes sensible à son amour, je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt que je m'en allasse ; ainsi, vous ne sauriez m'aimer.
Silvia. − Je suis sensible à son amour ! qui est−ce qui vous l'a dit ? Je ne saurais vous aimer ! qu'en savez−vous ? Vous décidez bien vite.
Dorante. − Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez−moi de ce qui en est, je vous en conjure.
Silvia. − Instruire un homme qui part !
Dorante. − Je ne partirai point.
Silvia. − Laissez−moi, tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence, et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments ?
Dorante. − Ce qu'ils m'importent, Lisette ? peux−tu douter encore que je ne t'adore ?
Silvia. − Non, et vous me le répétez si souvent que je vous crois ; mais pourquoi m'en persuadez−vous, que voulez−vous que je fasse de cette pensée−là, Monsieur ? Je vais vous parler à coeur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous ; que de ressources n'avez−vous pas pour vous en défaire ! La distance qu'il y a de vous à moi, mille objets que vous allez trouvez sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement ; vous en rirez peut−être au sortir d'ici, et vous aurez raison. Mais moi, Monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappée, quel secours aurai−je contre l'impression qu'il m'aura faite ? Qui est−ce qui me dédommagera de votre perte ? Qui voulez−vous que mon coeur mette à votre place ? Savez−vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus ? Jugez donc de l'état où je resterais, ayez la générosité de me cacher votre amour : moi qui vous parle, je me ferais un scrupule de vous dire que je vous aime, dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison, et vous voyez bien aussi que je vous les cache.
Dorante. − Ah ! ma chère Lisette, que viens−je d'entendre : tes paroles ont un feu qui me pénètre, je t'adore, je te respecte ; il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tînt encore contre toi, et mon coeur et ma main t'appartiennent.
Silvia. − En vérité, ne mériteriez−vous pas que je les prisse, ne faut−il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font, et croyez−vous que cela puisse durer ?
Dorante. − Vous m'aimez donc ?
Silvia. − Non, non ; mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous.
Dorante. − Vos menaces ne me font point de peur.
Silvia. − Et Mario, vous n'y songez donc plus ?
Dorante. − Non, Lisette ; Mario ne m'alarme plus, vous ne l'aimez point, vous ne pouvez plus me tromper, vous avez le coeur vrai, vous êtes sensible à ma tendresse : je ne saurais en douter au transport qui m'a pris, j'en suis sûr, et vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude−là.
Silvia. − Oh, je n'y tâcherai point, gardez−là, nous verrons ce que vous en ferez.
Dorante. − Ne consentez−vous pas d'être à moi ?
Silvia. − Quoi, vous m'épouserez malgré ce que vous êtes, malgré la colère d'un père, malgré votre fortune ?
Dorante. − Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vue, ma fortune nous suffit à tous deux, et le mérite vaut bien la naissance : ne disputons point, car je ne changerai jamais.
Silvia. − Il ne changera jamais ! Savez−vous bien que vous me charmez, Dorante ?
Dorante. − Ne gênez donc plus votre tendresse, et laissez−la répondre...
Silvia. − Enfin, j'en suis venue à bout ; vous... vous ne changerez jamais ?
Dorante. − Non, ma chère Lisette.
Silvia. − Que d'amour !

Voltaire vs Marivaux - Le Spectateur français et le Cabinet du philosophe sont des bréviaires de marivaudage, on y retrouve toute une collection d'observations synthétisées en maximes sur l'amour et ses effets, la jalousie, le dépit, la coquetteries, les caprices, les froideurs, les brouilles, les raccommodements. Les analyses subtiles du coeur auxquelles s'adonnaient Marivaux irritèrent quelques uns de ces célèbres contemporains. Le 8 juin 1732, Voltaire écrivait à M. de Fourmont : «Nous allons avoir cet été une comédie en prose du sieur Marivaux, sous le titre les Serments indiscrets. Vous comptez bien qu'il y aura beaucoup de métaphysique et peu de naturel». Dans son Temple du Goût, discutable satire. Voltaire réédita ce mot de «comédie métaphysique» : «Cet homme, disait-il, passe sa vie à peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. » Et Marivaux de répliquer dans Le Spectateur français : "S'il venait en France, dit-il, une génération d'hommes qui eût encore plus de finesse d'esprit qu'on n'en a jamais eu en France et ailleurs, il faudrait de nouveaux mots, de, nouveaux signes pour exprimer les nouvelles idées dont cette génération serait capable. Les mots que nous avons ne suffiraient pas, quand même les idées qu'ils exprimeraient auraient quelque ressemblance avec les nouvelles idées qu'on aurait acquises; il s'agirait quelquefois d'un degré de plus de fureur, de passion, d'amour, ou de méchanceté, qu'on apercevrait dans l'homme; et ce degré de plus, aperçu tout nouvellement, demanderait un signe, un mot propre, pour fixer l'idée qu'on aurait acquise". Ainsi, "vous accusez un auteur d'avoir un style précieux. Qu'est-ce que cela signifie.' Que voulez-vous dire avec votre style? Je vois d'ici un jeune homme d'esprit, qui compose, et qui, de peur de mériter le même reproche, ne va faire que des phrases. Il craindra de penser finement; car, s'il pensait ainsi, il serait obligé d'employer des mots qu'il soupçonne devoir vous paraître précieux.... Son style peut-être bien n'est accusé d'être mauvais, précieux, guindé, recherché, que parce que les pensées qu'il exprime sont extrêmement fines, et ont dû se former d'une liaison d'idées singulières, lesquelles idées ont dû à leur tour être exprimées par le rapprochement de mots et de signes qu'on a rarement vus aller ensemble."
En 1735, les Lettres philosophiques de Voltaire furent condamnées par un arrêt du Parlement. Un libraire, voulant achalander sa boutique, crut faire une bonne opération commerciale en demandant à Marivaux, en échange d'une somme de cinq cents livres, une réfutation de ces Lettres philosophiques. Voltaire s'était réfugié au château de Cirey, en Lorraine, chez la marquise du Châtelet, et flaira le danger. Par une de ces volte-face dont il était coutumier lorsque son intérêt personnel était en jeu, il écrivit, en février 1736, à un certain M. Berger, homme d'affaires et collectionneur, une lettre, qui n'était pas destinée, évidemment, à rester dans les poches du destinataire, et où Marivaux fut alors traité de la plus obligeante façon : "A l'égard de M. de Marivaux, je serais très fâché de compter parmi mes ennemis un homme de son caractère et dont j'estime l'esprit et la probité. II y a surtout dans ses ouvrages un caractère de philosophie, d'humanité et d'indépendance, dans lequel j'ai trouvé avec plaisir mes propres sentiments. Il est vrai que je lui souhaite quelquefois un style moins recherché et des sujets plus nobles, mais je suis bien loin de l'avoir voulu désigner en parlant des comédies métaphysiques. Je n'entends par ce terme que ces comédies où l'on introduit des personnages qui ne sont point dans la nature, des personnages allégoriques, propres tout au plus pour le poème épique, mais très déplacés sur la scène, où tout doit être peint d'après nature. Ce n'est pas, ce me semble, le défaut de M. de Marivaux. Je lui reprocherais au contraire de trop détailler les passions, et de manquer quelquefois le chemin du cœur en prenant des routes un peu détournées. J'aime d'autant plus son esprit, que je le prierais de ne le point prodiguer. Il ne faut pas qu'un personnage de comédie songe à être spirituel, il faut qu'il soit plaisant malgré lui, et sans croire l'être; c'est la différence qui doit être entre la comédie et le simple dialogue...."

1732 - "L'École des mères ou l’Illustre Aventurier"
Une comédie romanesque en un acte créée pour la première fois le 26 juillet 1732 par les Comédiens italiens à l’Hôtel de Bourgogne. Les fruits d'une éducation trop sévère, Madame Argante veut accoutumer sa fille à l’obéissance passive...
Acte I, Scène V - Angélique, Madame Argante
Madame Argante. − Venez, Angélique, j'ai à vous parler.
Angélique, modestement. − Que souhaitez-vous, ma mère ?
Madame Argante. − Vous voyez, ma fille, ce que je fais aujourd'hui pour vous ; ne tenez-vous pas compte à ma tendresse du mariage avantageux que je vous procure ?
Angélique, faisant la révérence. − Je ferai tout ce qu'il vous plaira, ma mère.
Madame Argante. − Je vous demande si vous me savez gré du parti que je vous donne ? Ne trouvez-vous pas qu'il est heureux pour vous d'épouser un homme comme Monsieur Damis, dont la fortune, dont le caractère sûr et plein de raison, vous assurent une vie douce et paisible, telle qu'il convient à vos moeurs et aux sentiments que je vous ai toujours inspirés ? Allons, répondez, ma fille !
Angélique. − Vous me l'ordonnez donc ?
Madame Argante. − Oui, sans doute. Voyez, n'êtes-vous pas satisfaite de votre sort ?
Angélique. − Mais...
Madame Argante. − Quoi ! mais ! je veux qu'on me réponde raisonnablement ; je m'attends à votre reconnaissance, et non pas à des mais.
Angélique, saluant. − Je n'en dirai plus, ma mère.
Madame Argante. − Je vous dispense des révérences ; dites-moi ce que vous pensez.
Angélique. − Ce que je pense ?
Madame Argante. − Oui : comment regardez-vous le mariage en question ?
Angélique. − Mais...
Madame Argante. − Toujours des mais !
Angélique. − Je vous demande pardon ; je n'y songeais pas, ma mère.
Madame Argante. − Eh bien, songez-y donc, et souvenez-vous qu'ils me déplaisent. Je vous demande quelles sont les dispositions de votre coeur dans cette conjoncture-ci. Ce n'est pas que je doute que vous soyez contente, mais je voudrais vous l'entendre dire vous-même.
Angélique. − Les dispositions de mon coeur ! Je tremble de ne pas répondre à votre fantaisie.
Madame Argante. − Et pourquoi ne répondriez-vous pas à ma fantaisie ?
Angélique. − C'est que ce que je dirais vous fâcherait peut-être.
Madame Argante. − Parlez bien, et je ne me fâcherai point. Est-ce que vous n'êtes point de mon sentiment? Etes−vous plus sage que moi?
Angélique. − C'est que je n'ai point de dispositions dans le coeur.
Madame Argante. − Et qu'y avez-vous donc, Mademoiselle ?
Angélique. − Rien du tout.
Madame Argante. − Rien ! qu'est-ce que rien ? Ce mariage ne vous plaît donc pas ?
Angélique. − Non.
Madame Argante, en colère. − Comment ! il vous déplaît ?
Angélique. − Non, ma mère.
Madame Argante. − Eh ! parlez donc ! car je commence à vous entendre : c'est-à-dire, ma fille, que vous n'avez point de volonté ?
Angélique. − J'en aurai pourtant une, si vous le voulez.
Madame Argante. − Il n'est pas nécessaire ; vous faites encore mieux d'être comme vous êtes ; de vous laisser conduire, et de vous en fier entièrement à moi. Oui, vous avez raison, ma fille ; et ces dispositions d'indifférence sont les meilleures. Aussi voyez-vous que vous en êtes récompensée ; je ne vous donne pas un jeune extravagant qui vous négligerait peut−être au bout de quinze jours, qui dissiperait son bien et le vôtre, pour courir après mille passions libertines ; je vous marie à un homme sage, à un homme dont le coeur est sûr, et qui saura tout le prix de la vertueuse innocence du vôtre.
Angélique. − Pour innocente, je le suis.
Madame Argante. − Oui, grâces à mes soins, je vous vois telle que j'ai toujours souhaité que vous fussiez ; comme il vous est familier de remplir vos devoirs, les vertus dont vous allez avoir besoin ne vous coûteront rien ; et voici les plus essentielles ; c'est, d'abord, de n'aimer que votre mari.
Angélique. − Et si j'ai des amis, qu'en ferai-je ?
Madame Argante. − Vous n'en devez point avoir d'autres que ceux de Monsieur Damis, aux volontés de qui vous vous conformerez toujours, ma fille ; nous sommes sur ce pied−là dans le mariage.
Angélique. − Ses volontés ? Et que deviendront les miennes ?
Madame Argante. − Je sais que cet article a quelque chose d'un peu mortifiant ; mais il faut s'y rendre, ma fille. C'est une espèce de loi qu'on nous a imposée ; et qui dans le fond nous fait honneur, car entre deux personnes qui vivent ensemble, c'est toujours la plus raisonnable qu'on charge d'être la plus docile, et cette docilité-là vous sera facile ; car vous n'avez jamais eu de volonté avec moi, vous ne connaissez que l'obéissance.
Angélique. − Oui, mais mon mari ne sera pas ma mère.
Madame Argante. − Vous lui devez encore plus qu'à moi, Angélique, et je suis sûre qu'on n'aura rien à vous reprocher là-dessus. Je vous laisse, songez à tout ce que je vous ai dit ; et surtout gardez ce goût de retraite, de solitude, de modestie, de pudeur qui me charme en vous ; ne plaisez qu'à votre mari, et restez dans cette simplicité qui ne vous laisse ignorer que le mal. Adieu, ma fille.

1732 - "Les Serments indiscrets"
Comédie en cinq actes créée le 8 juin 1732 par les Comédiens français ordinaires du roi, où il ne s'agit plus d’amants qui s’aiment sans s’en douter, et qui ne reconnaissent leur amour qu’au moment où ils se l’avouent, mais de personnages qui savent fort bien qu’ils s’aiment mais ne veulent pas en convenir. La belle Lucile ne vit que pour le désir de plaire, survient Damis, il est beau, bien fait, mais Lucile ne le connaît pas, et il ne connaît point Lucile, et pourtant on veut les marier. Damis n'entre pas dans ce projet et Lucile n'aime pas les accordailles "où le cœur ne se marie pas" : "... Allons, monsieur.... Nous n'avons à nous craindre, ni l'un ni l'autre; vous ne vous souciez point de moi, je ne me soucie point de vous. Nous voilà fort à notre aise; ainsi convenons de nos faits; mettez-moi l'esprit en repos; comment nous y prendrons-nous? J'ai une sœur qui peut plaire ; affectez plus de goût pour elle que pour moi; peut-être cela sera-t-il plus aisé et vous continuerez toujours. Ce moyen-là vous convient-il ? Vaut-il mieux nous plaindre d'un éloignement réciproque ? Ce sera comme vous voudrez; vous savez mon secret; vous êtes un honnête homme; expédions...." A ce franc parler, Damis ressent plus qu'un intérêt qui va grandissant mais auquel il sait qu'il ne peut s'abandonner : "« Eh ! madame, c'en est fait; et vous n'avez rien à craindre. Je ne suis point de caractère à persécuter les dispositions où je vous vois; elles excluent notre mariage; et quand ma vie en dépendrait, quand mon cœur vous regretterait, ce qui ne serait pas difficile à croire, je vous sacrifierais mon cœur et ma vie, et vous les sacrifierais sans vous le dire; c'est à quoi je m'engage, non par des serments qui ne signifieraient rien, et que je fais pourtant, comme vous, si vous les exigez; mais parce que votre cœur, parce que la raison, mon honneur et ma probité, dont vous l'exigez, le veulent; et comme il faudra nous voir, et que je ne saurais partir ni vous quitter sur-le-champ, si, pendant le temps que nous nous verrons, il m'allait par hasard échapper quelque discours qui pût vous alarmer, je vous conjure d'avance de n'y rien voir contre ma parole et de ne l'attribuer qu'à l'impossibilité qu'il y aurait de n'être pas galant avec ce qui vous ressemble...."
Mais Lucile a une sœur cadette, Phénice, discrète et d'une grande douceur. Quand Orgon, le père des deux jeunes filles, se révèle déçu par le peu de goût que Damis montre pour Lucile, son regard se porte sur Phénice, qui feint de se prêter à cette volte-face. Et Damis va jouer ainsi un rôle fort éloigné de ses sentiments. Ainsi, les deux amants, sans le vouloir et tout en le voulant, semble s'éloigner l'un de l'autre. Heureusement, la petite sœur arrangera tout, bien qu'il semble impossible qu'une femme à qui l'on répète qu'on l'aime, ne finisse point par aimer....
Acte I, Scène II - Lucile, Lisette
Lucile. − Ah ! te voilà, Lisette, approche ; je viens d'apprendre que Damis est arrivé hier de Paris, qu'il est actuellement chez son père ; et voici une lettre qu'il faut que tu lui rendes, en vertu de laquelle j'espère que je ne l'épouserai point.
Lisette. − Quoi ! cette idée-là vous dure encore ? Non, Madame, je ne ferai point votre message ; Damis est l'époux qu'on vous destine ; vous y avez consenti ; tout le monde est d'accord : entre une épouse et vous, il n'y a plus qu'une syllabe de différence, et je ne rendrai point votre lettre ; vous avez promis de vous marier.
Lucile. − Oui, par complaisance pour mon père, il est vrai ; mais y songe-t-il ? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage comme celui-là ? Ne faudrait-il pas être folle, pour épouser un homme dont le caractère m'est tout à fait inconnu ? D'ailleurs ne sais-tu pas mes sentiments ? Je ne veux point être mariée sitôt et ne le serai peut-être jamais.
Lisette. − Vous ? Avec ces yeux-là ? Je vous en défie, Madame.
Lucile. − Quel raisonnement ! Est-ce que des yeux décident de quelque chose ?
Lisette. − Sans difficulté ; les vôtres vous condamnent à vivre en compagnie, par exemple.
Examinez-vous : vous ne savez pas les difficultés de l'état austère que vous embrassez ; il faut avoir le coeur bien frugal pour le soutenir ; c'est une espèce de solitaire qu'une fille, et votre physionomie n'annonce point de vocation pour cette vie-là.
Lucile. − Oh ! ma physionomie ne sait ce qu'elle dit ; je me sens un fonds de délicatesse et de goût qui serait toujours choqué dans le mariage, et je n'y serais pas heureuse.
Lisette. − Bagatelle ! Il ne faut que deux ou trois mois de commerce avec un mari pour expédier votre délicatesse ; allez, déchirez votre lettre.
Lucile. − Je te dis que mon parti est pris, et je veux que tu la portes. Est-ce que tu crois que je me pique d'être plus indifférente qu'une autre ? Non, je ne me vante point de cela, et j'aurais tort de le faire, car j'ai l'âme tendre, quoique naturellement vertueuse : et voilà pourquoi le mariage serait une très mauvaise condition pour moi. Une âme tendre est douce, elle a des sentiments, elle en demande ; elle a besoin d'être aimée, parce qu'elle aime ; et une âme de cette espèce-là entre les mains d'un mari n'a jamais son nécessaire.
Lisette. − Oh ! dame, ce nécessaire-là est d'une grande dépense, et le coeur d'un mari s'épuise.
Lucile. − Je les connais un peu, ces messieurs-là ; je remarque que les hommes ne sont bons qu'en qualité d'amants, c'est la plus jolie chose du monde que leur coeur, quand l'espérance les tient en haleine ; soumis, respectueux et galants, pour le peu que vous soyez aimable avec eux, votre amour-propre est enchanté ; il est servi délicieusement ; on le rassasie de plaisirs, folie, fierté, dédain, caprices, impertinences, tout nous réussit, tout est raison, tout est loi ; on règne, on tyrannise, et nos idolâtres sont toujours à nos genoux. Mais les épousez-vous, la déesse s'humanise-t-elle, leur idolâtrie finit où nos bontés commencent. Dès qu'ils sont heureux, les ingrats ne méritent plus de l'être.
Lisette. − Les voilà.
Lucile. − Oh ! pour moi, j'y mettrai bon ordre, et le personnage de déesse ne m'ennuiera pas, messieurs, je vous assure. Comment donc ! Toute jeune, et tout aimable que je suis, je n'en aurais pas pour six mois aux yeux d'un mari, et mon visage serait mis au rebut ! De dix−huit ans qu'il a, il sauterait tout d'un coup à cinquante ? Non pas, s'il vous plaît ; ce serait un meurtre ; il ne vieillira qu'avec le temps, et n'enlaidira qu'à force de durer ; je veux qu'il n'appartienne qu'à moi, que personne n'ait que voir à ce que j'en ferai, qu'il ne relève que de moi seule. Si j'étais mariée, ce ne serait plus mon visage ; il serait à mon mari, qui le laisserait là, à qui il ne plairait pas, et qui lui défendrait de plaire à d'autres ; j'aimerais autant n'en point avoir. Non, non, Lisette, je n'ai point envie d'être coquette ; mais il y a des moments où le coeur vous en dit, et où l'on est bien aise d'avoir les yeux libres, ainsi, plus de discussion ; va porter ma lettre à Damis, et se range qui voudra sous le joug du mariage !
Lisette. − Ah ! Madame, que vous me charmez ! que vous êtes une déesse raisonnable ! Allons ! je ne vous dis plus mot ; ne vous mariez point ; ma divinité subalterne vous approuve et fera de même. Mais de cette lettre que je vais porter, en espérez-vous beaucoup ?
Lucile. − Je marque mes dispositions à Damis ; je le prie de les servir ; je lui indique les moyens qu'il faut prendre pour dissuader son père et le mien de nous marier ; et si Damis est aussi galant homme qu'on le dit, je compte l'affaire rompue.
Acte I, Scène VI - Lucile, sortant promptement du cabinet, Damis, Lisette
Lucile. − Et moi du mien, Monsieur, je vous le promets, car je puis hardiment me montrer après ce que vous venez de dire ; allons, Monsieur, le plus fort est fait, nous n'avons à nous craindre ni l'un ni l'autre : vous ne vous souciez point de moi, je ne me soucie point de vous ; car je m'explique sur le même ton, et nous voilà fort à notre aise ; ainsi convenons de nos faits ; mettez-moi l'esprit en repos ; comment nous y prendrons-nous ? J'ai une soeur qui peut plaire ; affectez plus de goût pour elle que pour moi ; peut-être cela vous sera-t-il aisé. Je m'en plaindrai, vous vous excuserez et vous continuerez toujours. Ce moyen-là vous convient-il ? Vaut-il mieux nous plaindre d'un éloignement réciproque ? Ce sera comme vous voudrez ; vous savez mon secret ; vous êtes un honnête homme ; expédions.
Lisette. − Nous ne barguignons pas, comme vous voyez ; nous allons rondement ; faites-vous de même ?
Lucile. − Qu'est−ce que c'est que cette saillie-là qui me compromet ? ... Faites-vous de même ? ... Voulez-vous divertir Monsieur à mes dépens ?
Damis. − Je trouve sa question raisonnable, Madame.
Lucile. − Et moi, Monsieur, je la déclare impertinente ; mais c'est une étourdie qui parle.
Damis. − Votre apparition me déconcerte, je l'avoue ; je me suis expliqué d'une manière si libre, en parlant de personnes aimables, et surtout de vous, Madame !
Lucile. − De moi, Monsieur ? vous m'étonnez ; je ne sache pas que vous ayez rien à vous reprocher. Quoi donc ! serait-ce d'avoir promis que je ne vous paraîtrais pas redoutable ? Eh ! tant mieux ; c'est m'avoir fait votre cour que cela. Comment donc ! est-ce que vous croyez ma vanité attaquée ? Non, Monsieur, elle ne l'est point : supposez que j'en aie, que vous me trouviez redoutable ou non, qu'est-ce que cela dit ? Le goût d'un homme seul ne décide rien là-dessus ; et de quelque façon qu'il se tourne, on n'en vaut ni plus ni moins ; les agréments n'y perdent ni n'y gagnent ; cela ne signifie rien ; ainsi, Monsieur, point d'excuse ; au reste, pourtant, si vous en voulez faire, si votre politesse a quelque remords qui la gêne, qu'à cela ne tienne, vous êtes bien le maître.
Damis. − Je ne doute pas, Madame, que tout ce que je pourrais vous dire ne vous soit indifférent ; mais n'importe, j'ai mal parlé, et je me condamne très sérieusement.
Lucile, riant. − Eh bien ! soit ; allons, Monsieur, vous vous condamnez, j'y consens. Votre prétendue future vaut mieux que tout ce que vous avez vu jusqu'ici ; il n'y a pas de comparaison, je l'emporte ; n'est−il pas vrai que cela va là ? Car je me ferai sans façon, moi, tous les compliments qu'il vous plaira, ce n'est pas la peine de me les plaindre, ils ne sont pas rares, et l'on en donne à qui en veut.
Damis. − Il ne s'agit pas de compliments, Madame ; vous êtes bien au-dessus de cela, et il serait difficile de vous en faire.
Lucile. − Celui−là est très fin, par exemple, et vous aviez raison de ne le vouloir pas perdre ; mais restons−en là, je vous prie ; car à la fin, tant de politesses me supposeraient un amour−propre ridicule, et ce serait une étrange chose qu'il fallût me demander pardon de ce qu'on ne m'aime point. En vérité, l'idée serait comique. Ce serait en m'aimant qu'on m'embarrasserait : mais grâce au ciel, il n'en est rien ; heureusement mes yeux se trouvent pacifiques ; ils applaudissent à votre indifférence ; ils se la promettaient, c'est une obligation que je vous ai, et la seule de votre part qui pouvait m'épargner une ingratitude ; vous m'entendez ; vous avez eu quelque peur des dispositions que je pouvais avoir ; mais soyez tranquille. Je me sauve, Monsieur, je vous échappe ; j'ai vu le péril, et il n'y paraît pas.
Damis. − Ah ! Madame, oubliez un discours que je n'ai tenu tantôt qu'en plaisantant ; je suis de tous les hommes celui à qui il est le moins permis d'être vain, et vous de toutes les dames celle avec qui il serait le plus impossible de l'être ; vous êtes d'une figure qui ne permet ce sentiment-là à personne ; et si je l'avais, je serais trop méprisable.
Lisette. − Ma foi, si vous le prenez sur ce ton-là, tous deux, vous ne tenez rien ; je n'aime point ce verbiage-là ; ces yeux pacifiques, ces apostrophes galantes à la figure de Madame, et puis des vanités, des excuses, où cela va-t-il ? Ce n'est pas là votre chemin ; prenez garde que le diable ne vous écarte ; tenez, vous ne voulez point vous épouser : abrégeons, et tout à l'heure entre mes mains cimentez vos résolutions d'une nouvelle promesse de ne vous appartenir jamais ; allons, Madame, commencez pour le bon exemple, et pour l'honneur de votre sexe.
Lucile. − La belle idée qu'il vous vient là ! le bel expédient, que je commence ! comme si tout ne dépendait pas de Monsieur, et que ce ne fût pas à lui à garantir ma résolution par la sienne ! Est-ce que, s'il voulait m'épouser, il n'en viendrait pas à bout par le moyen de mon père, à qui il faudrait obéir ? C'est donc sa résolution qui importe, et non pas la mienne que je ferais en pure perte.
Lisette. − Elle a raison, Monsieur ; c'est votre parole qui règle tout ; partez.
Damis. − Moi, commencer ! cela ne me siérait point, ce serait violer les devoirs d'un galant homme, et je ne perdrai point le respect, s'il vous plaît.
Lisette. − Vous l'épouserez par respect ; car ce n'est que du galimatias que toutes ces raisons-là ; j'en reviens à vous, Madame.
Lucile. − Et moi, je m'en tiens à ce que j'ai dit : Car il n'y a point de réplique. Mais que Monsieur s'explique, qu'on sache ses intentions sur la difficulté qu'il fait : est-ce respect ? est-ce égard ? est-ce badinage ? est-ce tout ce qu'il vous plaira ? Qu'il se détermine : il faut parler naturellement dans la vie.
Lisette. − Monsieur vous dit qu'il est trop poli pour être naturel.
Damis. − Il est vrai que je n'ose m'expliquer.
Lisette. − Il vous attend.
Lucile, brusquement. − Eh bien ! terminons donc, s'il n'y a que cela qui vous arrête, Monsieur ; voici mes sentiments : je ne veux point être mariée, et je n'en eus jamais moins d'envie que dans cette occasion-ci ; ce discours est net et sous-entend tout ce que la bienséance veut que je vous épargne. Vous passez pour un homme d'honneur, Monsieur ; on fait l'éloge de votre caractère, et c'est aux soins que vous vous donnerez pour me tirer de cette affaire−ci, c'est aux services que vous me rendrez là-dessus que je reconnaîtrai la vérité de tout ce qu'on m'a dit de vous. Ajouterai-je encore une chose ? Je puis avoir le coeur prévenu, je pense qu'en voilà assez, Monsieur, et que ce que je dis là vaut bien un serment de ne vous épouser jamais ; serment que je fais pourtant, si vous le trouvez nécessaire. Cela suffit-il ?
Damis. − Eh ! Madame, c'en est fait, et vous n'avez rien à craindre. Je ne suis point de caractère à persécuter les dispositions où je vous vois ; elles excluent notre mariage ; et quand ma vie en dépendrait, quand mon coeur vous regretterait, ce qui ne serait pas difficile à croire, je vous sacrifierais et mon coeur et ma vie, et vous les sacrifierais sans vous le dire ; c'est à quoi je m'engage, non par des serments qui ne signifieraient rien, et que je fais pourtant comme vous si vous les exigez, vous, mais parce que votre coeur, parce que la
raison, mon honneur et ma probité dont vous l'exigez, le veulent ; et comme il faudra nous voir, et que je ne saurais partir ni vous quitter sur-le-champ, si, pendant le temps que nous nous verrons, il m'allait par hasard échapper quelque discours qui pût vous alarmer, je vous conjure d'avance de n'y rien voir contre ma parole, et de ne l'attribuer qu'à l'impossibilité qu'il y aurait de n'être pas galant avec ce qui vous ressemble. Cela dit, je ne vous demande plus qu'une grâce ; c'est de m'aider à vous débarrasser de moi, et de vouloir bien que je
n'essuie point tout seul les reproches de nos parents : il est juste que nous les partagions, vous les méritez encore plus que moi. Vous craignez plus l'époux que le mariage, et moi je ne craignais que le dernier. Adieu, Madame ; il me tarde de vous montrer que je suis du moins digne de quelque estime.
Il se retire.
Lisette. − Mais vous vous en allez sans prendre de mesures.
Damis. − Madame m'a dit qu'elle avait une soeur à qui je puis feindre de m'attacher ; c'est déjà un moyen d'indiqué.
Lucile, triste. − Et d'ailleurs nous aurons le temps de nous revoir. Suivez Monsieur, Lisette, puisqu'il s'en va, et voyez si personne ne regarde !
Damis, à part, en sortant. − Je suis au désespoir
Damis est, à l'égard du mariage, dans les mêmes sentiments que Lucile. Il le déclare à Lisette et l'assure en même temps de son indifférence anticipée pour Lucile qu'il ne connaît pas encore. Lucile, cachée dans un cabinet, a tout entendu. Elle se montre et, après une vive escarmouche avec Damis, elle fait le serment de ne l'épouser jamais. Damis, à son tour, jure de ne lui laisser jamais deviner s'il l'aime.
Acte III, scène VII - Lucile, Lisette, Damis, Frontin
Lucile. − J'ai à vous parler pour un moment, Damis ; notre entretien sera court ; je n'ai qu'une question à vous faire ; vous, qu'un mot à me répondre ; et puis je vous fuis, je vous laisse.
Damis. − Vous n'y serez point obligée, Madame, et j'aurai soin de me retirer le premier. (A part.) Eh bien, Lisette ?
Lucile. − Le premier ou le dernier ; je vous donne la préférence : Etes-vous si pressé ? Retirez-vous tout à l'heure : Lisette vous rendra ce que j'ai à vous dire.
Damis, se retirant. − Je prends donc ce parti comme celui qui vous convient le mieux, Madame.
Il feint de s'en aller.
Lucile. − Qu'il s'en aille ; l'arrêtera qui voudra.
Lisette. − Eh ! mais vous n'y pensez pas ; revenez donc, Monsieur ; est-ce que la guerre est déclarée entre vous deux ?
Damis. − Madame débute par m'annoncer qu'elle n'a qu'un mot à me dire, et puis qu'elle me fuit ; n'est-ce pas m'insinuer qu'elle a de la peine à me voir ?
Lucile. − Si vous saviez l'envie que j'ai de vous laisser là !
Damis. − Je n'en doute pas, Madame ; mais ce n'est pas à présent qu'il faut me fuir ; c'était dès le premier instant que vous m'avez vu, et que je vous déplaisais, qu'il fallait le faire.
Lucile. − Vous fuir dès le premier instant ! Pourquoi donc, Monsieur ? Cela serait bien sauvage ; on ne fuit point ici à la vue d'un homme.
Lisette. − Mais quel est le travers qui vous prend à tous deux ? Faut-il que des personnes qui se veulent du bien se parlent comme si elles ne pouvaient se souffrir ? Et vous, Monsieur, qui aimez ma maîtresse ; car vous l'aimez, je gage. (Ces mots-là se disent en faisant signe à Damis.)
Lucile. − Que vous êtes sotte ! Allez, visionnaire, allez perdre vos gageures ailleurs. A qui en veut-elle ?
Lisette. − Oui, Madame, je sors ; mais avant que de partir, il faut que je parle. Vous me demandez à qui j'en veux. A vous deux, Madame, à vous deux. Oui, je voudrais de tout mon coeur ôter à Monsieur qui se tait, et dont le silence m'agite le sang, je voudrais lui ôter le scrupule du ridicule engagement qu'il a pris avec vous, que je me repens de vous avoir laissé prendre, et dont vous souffrez autant l'un que l'autre. Pour vous, Madame, je ne sais pas comment vous l'entendez ; mais si jamais un homme avait fait serment de ne me pas
dire : Je vous aime, oh ! je ferais serment qu'il en aurait le démenti ; il saurait le respect qui me serait dû, je n'y épargnerais rien de tout ce qu'il y a de plus dangereux, de plus fripon, de plus assassin dans l'honnête coquetterie des mines, du langage et du coup d'oeil. Voilà à quoi je mettrais ma gloire, et non pas à me tenir douloureusement sur mon quant-à-moi, comme vous faites, et à me dire : Voyons ce qu'il dit, voyons ce qu'il ne dit pas ; qu'il parle, qu'il commence ; c'est à lui, ce n'est pas à moi ; mon sexe, ma fierté, les bienséances, et mille autres façons inutiles avec Monsieur qui tremble, et qui a la bonté d'avoir peur que son
amour ne vous alarme et ne vous fâche. De l'amour nous fâcher ! De quel pays venez-vous donc ? Eh ! mort de ma vie, Monsieur, fâchez hardiment ; faites-nous cet honneur-là ; courage, attaquez-nous ; cette cérémonie-là fera votre fortune, et vous vous entendrez : car jusqu'ici on ne voit goutte à vos discours à tous deux ; il y a du oui, du non, du pour, du contre ; on fuit, on revient, on se rappelle, on n'y comprend rien. Adieu, j'ai tout dit ; vous voilà débrouillés, profitez-en. Allons, Frontin.
Acte III - Scène VIII - Damis, Lucile
Lucile. − Juste ciel ! quelle impertinente ! Où a-t-elle pris tout ce qu'elle nous dit là ? D'où lui viennent surtout de pareilles idées sur votre compte ? Au reste, elle ne me ménage pas plus que vous.
Damis. − Je ne m'en plains point, Madame.
Lucile. − Vous m'excuserez, je me mets à votre place ; il n'est point agréable de s'entendre dire de certaines choses en face.
Damis. − Quoi, Madame ! est-ce l'idée qu'elle a que je vous aime, que vous trouvez si désagréable pour moi ?
Lucile. − Mais désagréable ; je ne dis pas que son erreur vous fasse injure ; mon humilité ne va pas jusque-là. Mais à propos de quoi cette folle-là vient-elle vous pousser là-dessus ?
Damis. − A propos de la difficulté qu'elle s'imagine qu'il y a à ne vous pas aimer, cela est tout simple ; et si j'en voulais à tous ceux qui me soupçonneraient d'amour pour vous, j'aurais querelle avec tout le monde.
Lucile. − Vous n'en auriez pas avec moi.
Damis. − Oh ! vraiment, je le sais bien. Si vous me soupçonniez, vous ne seriez pas là ; vous fuiriez, vous déserteriez.
Lucile. − Qu'est-ce que c'est que déserter, Monsieur ? Vous avez là des expressions bien gracieuses, et qui font un joli portrait de mon caractère ; j'aime assez l'esprit hétéroclite que cela me donne. Non, Monsieur, je ne déserterais point ; je ne croirais pas tout perdu ; j'aurais assez de tête pour soutenir cet accident-là, ce me semble, alors comme alors, on prend son parti, Monsieur, on prend son parti.
Damis. − Il est vrai qu'on peut ou haïr ou mépriser les gens de près comme de loin.
Lucile. − Il n'est pas question de ce qu'on peut. J'ignore ce qu'on fait dans une situation où je ne suis pas ; et je crois que vous ne me donnerez jamais la peine de vous haïr.
Damis. − J'aurai pourtant un plaisir ; c'est que vous ne saurez point si je suis digne de haine à cet égard-là ; je dirai toujours : peut-être.
Lucile. − Ce mot-là me déplaît, Monsieur, je vous l'ai déjà dit.
Damis. − Je ne m'en servirai plus, Madame, et si j'avais la liste des mots qui vous choquent, j'aurais grand soin de les éviter.
Lucile. − La liste est encore amusante. Eh bien ! je vais vous dire où elle est, moi ; vous la trouverez dans la règle des égards qu'on doit aux dames ; vous y verrez qu'il n'est pas bien de vous divertir avec un peut-être, qui ne fera pas fortune chez moi, qui ne m'intriguera pas ; car je sais à quoi m'en tenir : c'est en badinant que vous le dites ; mais c'est un badinage qui ne vous sied pas ; ce n'est pas là le langage des hommes ; on n'a pas mis leur modestie sur ce pied-là. Parlons d'autre chose ; je ne suis pas venue ici sans motif ; écoutez-moi : vous savez, sans doute, qu'on veut vous donner ma soeur ?
Damis. − On me l'a dit, Madame.
Lucile. − On croit que vous l'aimez ; mais moi, qui ai réfléchi sur l'origine des empressements que vous avez marqués pour elle, je crains qu'on ne s'abuse, et je viens vous demander ce qui en est.
Damis. − Eh que vous importe, Madame !
Lucile. − Ce qu'il m'importe ? Voilà bien la question d'un homme qui n'a ni frère ni soeur, et qui ne sait pas combien ils sont chers ! C'est que je m'intéresse à elle, Monsieur ; c'est que, si vous ne l'aimez pas, ce serait manquer de caractère, ce me semble, ce serait même blesser les lois de cette probité à qui vous tenez tant, que de l'épouser avec un coeur qui s'éloignerait d'elle.
Damis. − Pourquoi donc, Madame, avez-vous inspiré qu'on me la donne ? Car j'ai tout lieu de soupçonner que vous en êtes cause, puisque c'est vous qui m'avez d'abord proposé de l'aimer ; au reste, Madame, ne vous inquiétez point d'elle, j'aurai soin de son sort plus sincèrement que vous ; elle le mérite bien.
Lucile. − Qu'elle le mérite ou non, ce n'est pas son éloge que je vous demande, ni à vos imaginations que je viens répondre ; parlez, Damis, l'aimez-vous ? Car s'il n'en est rien, ou ne l'épousez pas, ou trouvez bon que j'avertisse mon père qui s'y trompe, et qui serait au désespoir de s'y être trompé.
Damis. − Et moi, Madame, si vous lui dites que je ne l'aime point ; si vous exécutez un dessein qui ne tend qu'à me faire sortir d'ici avec la haine et le courroux de tout le monde ; si vous l'exécutez, trouvez bon qu'en revanche je retire toutes mes paroles avec vous, et que je dise à Monsieur Orgon que je suis prêt de vous épouser quand on le voudra, dès aujourd'hui, s'il le faut.
Lucile. − Oui-da, Monsieur, le prenez-vous sur ce ton menaçant ? Oh ! je sais le moyen de vous en faire prendre un autre. Allez votre chemin, Monsieur ; poursuivez ; je ne vous retiens pas. Allez pour vous venger, violer des promesses dont l'oubli ne serait tout au plus pardonnable qu'à quiconque aurait de l'amour. Courez vous punir vous-même, vous ne manquerez pas votre coup ; car je vous déclare que je vous y aiderai, moi. Ah ! vous m'épouserez, dites-vous, vous m'épouserez ! Et moi aussi, Monsieur, et moi aussi.
Je serai bien aussi vindicative que vous, et nous verrons qui se dédira de nous deux ; assurément le compliment est admirable ! c'est une jolie petite partie à proposer.
Damis. − Eh bien ! cessez donc de me persécuter, Madame. J'ai le coeur incapable de vous nuire ; mais laissez-moi me tirer de l'état où je suis ; contentez-vous de m'avoir déjà procuré ce qui m'arrive ; on ne m'offrirait pas aujourd'hui votre soeur, si, pour vous obliger, je n'avais pas paru m'attacher à elle, ou si vous n'aviez pas dit que je l'aimais. Souvenez-vous que j'ai servi vos dégoûts pour moi avec un honneur, une fidélité surprenante, avec une fidélité que je ne vous devais point, que tout autre, à ma place, n'aurait jamais eu, et ce procédé si louable, si généreux, mérite bien que vous laissiez en repos un homme qui peut avoir porté la vertu jusqu'à se sacrifier pour vous ; je ne veux pas dire que je vous aime ; non, Lucile, rassurez-vous ; mais enfin vous ne savez pas ce qui en est, vous en pourriez douter ; vous êtes assez aimable pour cela, soit dit sans vous louer ; je puis vous épouser, vous ne le voulez pas, et je vous quitte. En vérité, Madame, tant d'ardeur à me faire du mal récompense mal un service que tout le monde, hors vous, aurait soupçonné d'être difficile à rendre. Adieu, Madame.
Il s'en va
Lucile. − Mais attendez donc, attendez, donnez-moi le temps de me justifier ; ne tient-il qu'à s'en aller, quand on a chargé les gens de noirceurs pareilles ?
Damis. − J'en dirais trop si je restais.
Lucile. − Oh ! vous ferez comme vous pourrez ; mais il faut m'entendre.
Damis. − Après ce que vous m'avez dit, je n'ai plus rien à savoir qui m'intéresse.
Lucile. − Ni moi plus rien à vous répondre ; il n'y a qu'une chose qui m'étonne, et dont je ne devine pas la raison, c'est que vous osiez vous en prendre à moi d'un mariage que je vois qui vous plaît. Le motif de cette hypocrisie-là me paraît aussi ridicule qu'inconcevable. A moins que ce ne soit ma soeur qui vous y engage, pour me cacher l'accord de vos coeurs et la part qu'elle a à un engagement que j'ai refusé, dont je ne voudrais jamais, et que je la trouve bien à plaindre de ne pas refuser elle-même.
Elle sort.
Scène IX - Frontin, Damis, consterné.
Frontin. − Eh bien ! Monsieur, à quoi en êtes-vous ?
Damis. − Au plus malheureux jour de ma vie, laisse-moi.
Il sort.
Acte V, Scène II - Lucile, Lisette - Un orgueil qui se débat...
Lucile. − Eh bien ! Lisette, avez-vous vu mon père ?
Lisette. − Oui, Madame, et autant qu'il m'a paru, je l'ai laissé très inquiet de vos dispositions ; pour de réponse, Monsieur Ergaste qui est venu le joindre ne lui a pas donné le temps de m'en faire. Il m'a seulement dit qu'il vous parlerait.
Lucile. − Fort bien : cependant les préparatifs du mariage se font toujours.
Lisette. − Vous verrez ce qu'il vous dira.
Lucile. − Je verrai ! la belle ressource ! Pouvez-vous être de ce sang-froid-là, dans les circonstances où je me trouve ?
Lisette. − Moi ! de sang-froid, Madame ? Je suis peut-être plus fâchée que vous.
Lucile. − Ecoutez, vous auriez raison de l'être : je vous dois l'injure que j'essuie, et j'ai fait une triste épreuve de l'imprudence de vos conseils. Vous n'êtes point méchante ; mais, croyez-moi, ne vous attachez jamais à personne ; car vous n'êtes bonne qu'à nuire.
Lisette. − Comment donc ! est-ce que vous croyez que je vous porte malheur ?
Lucile. − Hé pourquoi non ? Est-ce que tout n'est pas plein de gens qui vous ressemblent ? Vous n'avez qu'à voir ce qui m'arrive avec vous.
Lisette. − Mais vous n'y songez pas, Madame.
Lucile. − Oh ! Lisette, vous en direz tout ce qu'il vous plaira, mais voilà des fatalités qui me passent et qui ne m'appartiennent point du tout.
Lisette. − Et de là vous concluez que c'est moi qui vous les procure ? Mais, Madame, ne soyez donc point injuste. N'est-ce pas vous qui avez renvoyé Damis ?
Lucile. − Oui, mais qui est-ce qui en est cause ? Depuis que nous sommes ensemble, avez-vous cessé de me parler des douceurs de je ne sais quelle liberté qui n'est que chimère ? Qui est−ce qui m'a conseillé de ne me marier jamais ?
Lisette. − L'envie de faire de vos yeux ce qu'il vous plairait, sans en rendre compte à personne.
Lucile. − Les serments que j'ai faits, qui est-ce qui les a imaginés ?
Lisette. − Que vous importent-ils ? Ils ne tombent que sur un homme que vous n'aimez point.
Lucile. − Eh pourquoi donc vous êtes-vous efforcée de me persuader que je l'aimais ? D'où vient me l'avoir répété si souvent que j'en ai presque douté moi-même ?
Lisette. − C'est que je me trompais.
Lucile. − Vous vous trompiez. Je l'aimais ce matin, je ne l'aime pas ce soir. Si je n'en ai pas d'autre garant que vos connaissances, je n'ai qu'à m'y fier, me voilà bien instruite. Cependant, dans la confusion d'idées que tout cela me donne à moi, il arrive, en vérité, que je me perds de vue. Non, je ne suis pas sûre de mon état ; cela n'est-il pas désagréable ?
Lisette. − Rassurez-vous, Madame ; encore une fois vous ne l'aimez point.
Lucile. − Vous verrez qu'elle en saura plus que moi. Eh ! que sais-je si je ne l'aurais pas aimé, si vous m'aviez laissée telle que j'étais, si vos conseils, vos préjugés, vos fausses maximes ne m'avaient pas infecté l'esprit ? Est-ce moi qui ai décidé de mon sort ? Chacun a sa façon de penser et de sentir, et apparemment que j'en ai une ; mais je ne dirai pas ce que c'est, je ne connais que la vôtre. Ce n'est ni ma raison ni mon coeur qui m'ont conduit, c'est vous. Aussi n'ai-je jamais pensé que des impertinences. Et voilà ce que c'est : on croit se déterminer, on croit agir, on croit suivre ses sentiments, ses lumières, et point du tout ; il se trouve qu'on n'a qu'un esprit d'emprunt, et qu'on ne vit que de la folie de ceux qui s'emparent de votre confiance.
Lisette. − Je ne sais où j'en suis !
Lucile. − Dites-moi ce que c'était, à mon âge, que l'idée de rester fille ? Qui est-ce qui ne se marie pas ? Qui est-ce qui va s'entêter de la haine d'un état respectable, et que tout le monde prend ? La condition la plus naturelle d'une fille est d'être mariée. Je n'ai pu y renoncer qu'en risquant de désobéir à mon père. Je dépends de lui. D'ailleurs, la vie est pleine d'embarras : un mari les partage. On ne saurait avoir trop de secours. C'est un véritable ami qu'on acquiert. Il n'y avait rien de mieux que Damis, c'est un honnête homme. J'entrevois qu'il m'aurait plu. Cela allait tout de suite. Mais malheureusement vous êtes au monde ; et la destination de votre vie est d'être le fléau de la mienne. Le hasard vous place chez moi, et tout est renversé. Je résiste à mon père, je fais des serments ; j'extravague ; et ma soeur en profite !
Lisette. − Je vous disais tout à l'heure que vous n'aimiez pas Damis ; à présent je suis tentée de croire que vous l'aimez.
Lucile. − Eh ! le moyen de s'en être empêchée avec vous ? Eh bien ! oui, je l'aime, Mademoiselle ; êtes-vous contente ? Oui, et je suis charmée de l'aimer pour vous mettre dans votre tort, et vous faire taire.
Lisette. − Eh ! mort de ma vie, que ne le disiez-vous plus tôt ? Vous nous auriez épargné bien de la peine à tous, et à Damis qui vous aime, et à Frontin et moi qui nous aimons aussi et qui nous désespérions ; mais laissez-moi faire, il n'y a encore rien de gâté.
Lucile. − Oui, je l'aime, il n'est que trop vrai, et il ne me manquait plus que le malheur de n'avoir pu le cacher ; mais s'il vous en échappe un mot, vous pouvez renoncer à moi pour la vie.
Lisette. − Quoi ! vous ne voulez pas ? ...
Lucile. − Non, je vous le défends.
Lisette. − Mais, Madame, ce serait dommage, il vous adore.
Lucile. − Qu'il me le dise lui-même, et je le croirai. Quoi qu'il en soit, il m'a plu.
Lisette. − Il le mérite bien, Madame.

1733 - "L’Heureux Stratagème"
Comédie en trois actes créée pour la première fois le 6 juin 1733 par les Comédiens italiens. La Comtesse délaisse Dorante qui ne demande qu'à être aimé et préfère séduire un Chevalier gascon pour lequel elle n'a au fond que du mépris, afin de le soutirer à la Marquise, une Marquise qui va élaborer stratagème pour faire de Dorante son soupirant...
Acte I, scène IV - Une apologie de l'infidélité, distinguer un homme, ce n'est pas encore l'aimer...
Lisette, La Comtesse.
La Comtesse. − Je te cherchais, Lisette. Avec qui étais-tu là ? il me semble avoir vu sortir quelqu'un d'avec toi.
Lisette. − C'est Dorante qui me quitte, Madame.
La Comtesse. − C'est lui dont je voulais te parler : que dit-il, Lisette ?
Lisette. − Mais il dit qu'il n'a pas lieu d'être content, et je crois qu'il dit assez juste : qu'en pensez-vous, Madame ?
La Comtesse. − Il m'aime donc toujours ?
Lisette. − Comment ? s'il vous aime ! Vous savez bien qu'il n'a point changé. Est-ce que vous ne l'aimez plus ?
La Comtesse. − Qu'appelez-vous plus ? Est-ce que je l'aimais ? Dans le fond, je le distinguais, voilà tout ; et distinguer un homme, ce n'est pas encore l'aimer, Lisette ; cela peut y conduire, mais cela n'y est pas.
Lisette. − Je vous ai pourtant entendu dire que c'était le plus aimable homme du monde.
La Comtesse. − Cela se peut bien.
Lisette. − Je vous ai vue l'attendre avec empressement.
La Comtesse. − C'est que je suis impatiente.
Lisette. − Etre fâchée quand il ne venait pas.
La Comtesse. − Tout cela est vrai ; nous y voilà : je le distinguais, vous dis-je, et je le distingue encore ; mais rien ne m'engage avec lui ; et comme il te parle quelquefois, et que tu crois qu'il m'aime, je venais te dire qu'il faut que tu le disposes adroitement à se tranquilliser sur mon chapitre.
Lisette. − Et le tout en faveur de Monsieur le chevalier Damis, qui n'a vaillant qu'un accent gascon qui vous amuse ? Que vous avez le coeur inconstant ! Avec autant de raison que vous en avez, comment pouvez-vous être infidèle ? car on dira que vous l'êtes.
La Comtesse. − Eh bien ! infidèle soit, puisque tu veux que je le sois ; crois-tu me faire peur avec ce grand mot-là ? Infidèle ! ne dirait-on pas que ce soit une grande injure ? Il y a comme cela des mots dont on épouvante les esprits faibles, qu'on a mis en crédit, faute de réflexion, et qui ne sont pourtant rien.
Lisette. − Ah ! Madame, que dites-vous là ? Comme vous êtes aguerrie là-dessus ! Je ne vous croyais pas si désespérée : un coeur qui trahit sa foi, qui manque à sa parole !
La Comtesse. − Eh bien ! ce coeur qui manque à sa parole, quand il en donne mille, il fait sa charge ; quand il en trahit mille, il la fait encore : il va comme ses mouvements le mènent, et ne saurait aller autrement. Qu'est-ce que c'est que l'étalage que tu me fais là ? Bien loin que l'infidélité soit un crime, c'est que je soutiens qu'il ne faut pas un moment hésiter d'en faire une, quand on en est tentée, à moins que de vouloir tromper les gens, ce qu'il faut éviter, à quelque prix que ce soit.
Lisette. − Mais, mais... de la manière dont vous tournez cette affaire-là, je crois, de bonne foi, que vous avez raison. Oui, je comprends que l'infidélité est quelquefois de devoir, je ne m'en serais jamais doutée !
La Comtesse. − Tu vois pourtant que cela est clair.
Lisette. − Si clair, que je m'examine à présent, pour savoir si je ne serai pas moi-même obligée d'en faire une.
La Comtesse. − Dorante est en vérité plaisant ; n'oserais-je, à cause qu'il m'aime, distraire un regard de mes yeux ? N'appartiendra-t-il qu'à lui de me trouver jeune et aimable ? Faut-il que j'aie cent ans pour tous les autres, que j'enterre tout ce que je vaux ? que je me dévoue à la plus triste stérilité de plaisir qu'il soit possible ?
Lisette. − C'est apparemment ce qu'il prétend.
La Comtesse. − Sans doute ; avec ces Messieurs-là, voilà comment il faudrait vivre ; si vous les en croyez, il n'y a plus pour vous qu'un seul homme, qui compose tout votre univers ; tous les autres sont rayés, c'est autant de mort pour vous, quoique votre amour-propre n'y trouve point son compte, et qu'il les regrette quelquefois : mais qu'il pâtisse ; la sotte fidélité lui a fait sa part, elle lui laisse un captif pour sa gloire ; qu'il s'en amuse comme il pourra, et qu'il prenne patience. Quel abus, Lisette, quel abus ! Va, va, parle à Dorante, et laisse là tes scrupules. Les hommes, quand ils ont envie de nous quitter, y font-ils tant de façons ? N'avons-nous pas tous les jours de belles preuves de leur constance ? Ont-ils là-dessus des privilèges que nous n'ayons pas ? Tu te moques de moi ; le Chevalier m'aime, il ne me déplaît pas : je ne ferai pas la moindre violence à mon penchant.
Lisette. − Allons, allons, Madame, à présent que je suis instruite, les amants délaissés n'ont qu'à chercher qui les plaigne ; me voilà bien guérie de la compassion que j'avais pour eux.
La Comtesse. − Ce n'est pas que je n'estime Dorante ; mais souvent, ce qu'on estime ennuie. Le voici qui revient. Je me sauve de ses plaintes qui m'attendent ; saisis ce moment pour m'en débarrasser...

1735 - "La Mère confidente"
Comédie en trois actes créée pour la première fois le 9 mai 1735 par les Comédiens italiens à l’Hôtel de Bourgogne, "une pièce à part dans le théâtre de Marivaux", écrira Sainte-Beuve, qui voit une jeune fille débordante de passion naissante, Angélique, sous les yeux d'une mère, Mme Argante, qui l'adore plus que tout mais songe à quelque riche parti pour sa fille. Elle rencontre dans un parc, par hasard, Dorante, jeune gentilhomme fort honnête mais sans le sou, et tout naturellement avec le concours de la suivante Lisette, qui aime les manèges secrets et les beaux sentiments. Dorante veut épouser Angélique au moment où il avait résolu d'épouser une riche veuve très opulente. Mme Argante a de son côté dénicher, dans une gentilhommière des environs, un hobereau, du nom d'Ergaste, un jeune homme d'une quarantaine d'années, riche et sérieux. Angélique n'éprouvera pour celui-ci qu'estime et donc indifférence. Mme Argante quant à elle s'inquiète pour sa fille qui semble la proie de quelque passion secrète. Elle confesse Angélique, apprend son secret, lui rétorque "Mais c'est un roman que tout cela!", à quoi la jeune fille de répondre, "Moi, je n'en lis jamais de roman, et puis notre aventure est toute des plus simples". Mme Argante devenue confidente entraîne sa fille à renoncer au jeune homme, repousse avec violence le malheureux Dorante, accable de reproches sa suivante. Réapparaît Ergaste, et l'adroit Dorante voit que l'instant est venu de recourir à ces moyens romanesques dont les jeunes filles aiment à entendre parler et parle d'enlèvement. Angélique, délicieusement scandalisée, entreprend de convaincre sa mère...
Acte I, Scène VIII - Madame Argante, Angélique - Un pacte de confiance, Pour sa figure, je la lui passe, c'est à quoi je ne regarde guère...
Madame Argante. − Je vous demandais à Lubin, ma fille.
Angélique. − Avez-vous à me parler, Madame ?
Madame Argante. − Oui ; vous connaissez Ergaste, Angélique, vous l'avez vu souvent à Paris, il vous demande en mariage.
Angélique. − Lui, ma mère, Ergaste, cet homme si sombre si sérieux, il n'est pas fait pour être un mari, ce me semble.
Madame Argante. − Il n'y a rien à redire à sa figure.
Angélique. − Pour sa figure, je la lui passe, c'est à quoi je ne regarde guère.
Madame Argante. − Il est froid.
Angélique. − Dites glacé, taciturne, mélancolique, rêveur et triste.
Madame Argante. − Vous le verrez bientôt, il doit venir ici, et s'il ne vous accommode pas, vous ne l'épouserez pas malgré vous, ma chère enfant, vous savez bien comme nous vivons ensemble.
Angélique. − Ah ! ma mère, je ne crains point de violence de votre part, ce n'est pas là ce qui m'inquiète.
Madame Argante. − Es-tu bien persuadée que je t'aime ?
Angélique. − Il n'y a point de jour qui ne m'en donne des preuves.
Madame Argante. − Et toi, ma fille, m'aimes-tu autant ?
Angélique. − Je me flatte que vous n'en doutez pas, assurément.
Madame Argante. − Non, mais pour m'en rendre encore plus sûre, il faut que tu m'accordes une grâce.
Angélique. − Une grâce, ma mère ! Voilà un mot qui ne me convient point, ordonnez, et je vous obéirai.
Madame Argante. − Oh ! si tu le prends sur ce ton-là, tu ne m'aimes pas tant que je croyais. Je n'ai point d'ordre à vous donner, ma fille ; je suis votre amie, et vous êtes la mienne, et si vous me traitez autrement, je n'ai plus rien à vous dire.
Angélique. − Allons, ma mère, je me rends, vous me charmez, j'en pleure de tendresse, voyons, quelle est cette grâce que vous me demandez ? Je vous l'accorde d'avance.
Madame Argante. − Viens donc que je t'embrasse : te voici dans un âge raisonnable, mais où tu auras besoin de mes conseils et de mon expérience ; te rappelles-tu l'entretien que nous eûmes l'autre jour ; et cette douceur que nous nous figurions toutes deux à vivre ensemble dans la plus intime confiance, sans avoir de secrets l'une pour l'autre ; t'en souviens-tu ? Nous fûmes interrompues, mais cette idée-là te réjouit beaucoup, exécutons-la, parle-moi à coeur ouvert ; fais-moi ta confidente.
Angélique. − Vous, la confidente de votre fille ?
Madame Argante. − Oh ! votre fille ; et qui te parle d'elle ? Ce n'est point ta mère qui veut être ta confidente, c'est ton amie, encore une fois.
Angélique, riant. − D'accord, mais mon amie redira tout à ma mère, l'un est inséparable de l'autre.
Madame Argante. − Eh bien ! je les sépare, moi, je t'en fais serment ; oui, mets-toi dans l'esprit que ce que tu me confieras sur ce pied-là, c'est comme si ta mère ne l'entendait pas ; eh ! mais cela se doit, il y aurait même de la mauvaise foi à faire autrement.
Angélique. − Il est difficile d'espérer ce que vous dites là.
Madame Argante. − Ah ! que tu m'affliges ; je ne mérite pas ta résistance.
Angélique. − Eh bien ! soit, vous l'exigez de trop bonne grâce, j'y consens, je vous dirai tout.
Madame Argante. − Si tu veux, ne m'appelle pas ta mère, donne-moi un autre nom.
Angélique. − Oh ! ce n'est pas la peine, ce nom-là m'est cher, quand je le changerais, il n'en serait ni plus ni moins, ce ne serait qu'une finesse inutile, laissez-le-moi, il ne m'effraye plus.
Madame Argante. − Comme tu voudras, ma chère Angélique. Ah çà ! je suis donc ta confidente, n'as-tu rien à me confier dès à présent ?
Angélique. − Non, que je sache, mais ce sera pour l'avenir.
Madame Argante. − Comment va ton coeur ? Personne ne l'a-t-il attaqué jusqu'ici ?
Angélique. − Pas encore.
Madame Argante. − Hum ! Tu ne te fies pas à moi, j'ai peur que ce ne soit encore à ta mère à qui tu réponds.
Angélique. − C'est que vous commencez par une furieuse question.
Madame Argante. − La question convient à ton âge.
Angélique. − Ah !
Madame Argante. − Tu soupires ?
Angélique. − Il est vrai.
Madame Argante. − Que t'est-il arrivé ? Je t'offre de la consolation et des conseils, parle.
Angélique. − Vous ne me le pardonnerez pas.
Madame Argante. − Tu rêves encore, avec tes pardons, tu me prends pour ta mère.
Angélique. − Il est assez permis de s'y tromper, mais c'est du moins pour la plus digne de l'être, pour la plus tendre et la plus chérie de sa fille qu'il y ait au monde.
Madame Argante. − Ces sentiments-là sont dignes de toi, et je les dirai ; mais il ne s'agit pas d'elle, elle est absente : revenons, qu'est-ce qui te chagrine ?
Angélique. − Vous m'avez demandé si on avait attaqué mon coeur ? Que trop, puisque j'aime !
Madame Argante, d'un air sérieux. − Vous aimez ?
Angélique, riant. − Eh bien ! ne voilà-t-il pas cette mère qui est absente ? C'est pourtant elle qui me répond ; mais rassurez-vous, car je badine.
Madame Argante. − Non, tu ne badines point, tu me dis la vérité, et il n'y a rien là qui me surprenne ; de mon côté, je n'ai répondu sérieusement que parce que tu me parlais de même ; ainsi point d'inquiétude, tu me confies donc que tu aimes.
Angélique. − Je suis presque tentée de m'en dédire.
Madame Argante. − Ah ! ma chère Angélique, tu ne me rends pas tendresse pour tendresse.
Angélique. − Vous m'excuserez, c'est l'air que vous avez pris qui m'a alarmée ; mais je n'ai plus peur ; oui, j'aime, c'est un penchant qui m'a surpris.
Madame Argante. − Tu n'es pas la première, cela peut arriver à tout le monde : et quel homme est-ce ? est-il à Paris ?
Angélique. − Non, je ne le connais que d'ici ?
Madame Argante, riant. − D'ici, ma chère ? Conte-moi donc cette histoire-là, je la trouve plus plaisante que sérieuse, ce ne peut être qu'une aventure de campagne, une rencontre ?
Angélique. − Justement.
Madame Argante. − Quelque jeune homme galant, qui t'a salué, et qui a su adroitement engager une conversation ?
Angélique. − C'est cela même.
Madame Argante. − Sa hardiesse m'étonne, car tu es d'une figure qui devait lui en imposer : ne trouves-tu pas qu'il a un peu manqué de respect ?
Angélique. − Non, le hasard a tout fait, et c'est Lisette qui en est cause, quoique fort innocemment ; elle tenait un livre, elle le laissa tomber, il le ramassa, et on se parla, cela est tout naturel.
Madame Argante, riant. − Va, ma chère enfant, tu es folle de t'imaginer que tu aimes cet homme-là, c'est Lisette qui te le fait accroire, tu es si fort au-dessus de pareille chose ! tu en riras toi-même au premier jour.
Angélique. − Non, je n'en crois rien, je ne m'y attends pas, en vérité.
Madame Argante. − Bagatelle, te dis-je, c'est qu'il y a là dedans un air de roman qui te gagne.
Angélique. − Moi, je n'en lis jamais, et puis notre aventure est toute des plus simples.
Madame Argante. − Tu verras ; te dis-je ; tu es raisonnable, et c'est assez ; mais l'as-tu vu souvent ?
Angélique. − Dix ou douze fois.
Madame Argante. − Le verras-tu encore ?
Angélique. − Franchement, j'aurais bien de la peine à m'en empêcher.
Madame Argante. − Je t'offre, si tu le veux, de reprendre ma qualité de mère pour te le défendre.
Angélique. − Non vraiment, ne reprenez rien, je vous prie, ceci doit être un secret pour vous en cette qualité-là, et je compte que vous ne savez rien, au moins, vous me l'avez promis.
Madame Argante. − Oh ! je te tiendrai parole, mais puisque cela est si sérieux, peu s'en faut que je ne verse des larmes sur le danger où je te vois, de perdre l'estime qu'on a pour toi dans le monde.
Angélique. − Comment donc ? l'estime qu'on a pour moi ! Vous me faites trembler. Est-ce que vous me croyez capable de manquer de sagesse ?
Madame Argante. − Hélas ! ma fille, vois ce que tu as fait, te serais-tu crue capable de tromper ta mère, de voir à son insu un jeune étourdi, de courir les risques de son indiscrétion et de sa vanité, de t'exposer à tout ce qu'il voudra dire, et de te livrer à l'indécence de tant d'entrevues secrètes, ménagées par une misérable suivante sans coeur, qui ne s'embarrasse guère des conséquences, pourvu qu'elle y trouve son intérêt, comme elle l'y trouve sans doute ? qui t'aurait dit, il y a un mois, que tu t'égarerais jusque-là, l'aurais-tu cru ?
Angélique, triste. − Je pourrais bien avoir tort, voilà des réflexions que je n'ai jamais faites.
Madame Argante. − Eh ! ma chère enfant, qui est-ce qui te les ferait faire ? Ce n'est pas un domestique payé pour te trahir, non plus qu'un amant qui met tout son bonheur à te séduire ; tu ne consultes que tes ennemis ; ton coeur même est de leur parti, tu n'as pour tout secours que ta vertu qui ne doit pas être contente, et qu'une véritable amie comme moi, dont tu te défies : que ne risques-tu pas ?
Angélique. − Ah ! ma chère mère, ma chère amie, vous avez raison, vous m'ouvrez les yeux, vous me couvrez de confusion ; Lisette m'a trahie, et je romps avec le jeune homme ; que je vous suis obligée de vos conseils !
Lubin, à Madame Argante. − Madame, il vient d'arriver un homme qui demande à vous parler.
Madame Argante, à Angélique. − En qualité de simple confidente, je te laisse libre ; je te conseille pourtant de me suivre, car le jeune homme est peut-être ici.
Angélique. − Permettez-moi de rêver un instant, et ne vous embarrassez point ; s'il y est, et qu'il ose paraître, je le congédierai, je vous assure.
Madame Argante. − Soit, mais songe à ce que je t'ai dit.
Elle sort.
Acte III, Scène XI - Madame Argante, Angélique, Dorante
Madame Argante. − Eh bien ! Monsieur, ma nièce m'a tout conté, rassurez-vous : il me paraît que vous êtes inquiet.
Dorante. − J'avoue, Madame, que votre présence m'a d'abord un peu troublé.
Angélique, à part. − Comment le trouvez-vous, ma mère ?
Madame Argante, à part le premier mot. − Doucement. Je ne viens ici que pour écouter vos raisons sur l'enlèvement dont vous parlez à ma nièce.
Dorante. − Un enlèvement est effrayant, Madame, mais le désespoir de perdre ce qu'on aime rend bien des choses pardonnables.
Angélique. − Il n'a pas trop insisté, je suis obligée de le dire.
Dorante. − Il est certain qu'on ne consentira pas à nous unir. Ma naissance est égale à celle d'Angélique, mais la différence de nos fortunes ne me laisse rien à espérer de sa mère.
Madame Argante. − Prenez garde, Monsieur ; votre désespoir de la perdre pourrait être suspect d'intérêt ; et quand vous dites que non, faut-il vous en croire sur votre parole ?
Dorante. − Ah ! Madame, qu'on retienne tout son bien, qu'on me mette hors d'état de l'avoir jamais ; le ciel me punisse si j'y songe !
Angélique. − Il m'a toujours parlé de même.
Madame Argante. − Ne nous interrompez point, ma nièce. (A Dorante.) L'amour seul vous fait agir, soit ; mais vous êtes, m'a-t-on dit, un honnête homme, et un honnête homme aime autrement qu'un autre ; le plus violent amour ne lui conseille jamais rien qui puisse tourner à la honte de sa maîtresse, vous voyez, reconnaissez-vous ce que je dis là, vous qui voulez engager Angélique à une démarche aussi déshonorante ?
Angélique, à part. − Ceci commence mal.
Madame Argante. − Pouvez-vous être content de votre coeur ; et supposons qu'elle vous aime, le méritez-vous ? Je ne viens point ici pour me fâcher, et vous avez la liberté de me répondre, mais n'est-elle pas bien à plaindre d'aimer un homme aussi peu jaloux de sa gloire, aussi peu touché des intérêts de sa vertu, qui ne se sert de sa tendresse que pour égarer sa raison, que pour lui fermer les yeux sur tout ce qu'elle se doit à elle-même, que pour l'étourdir sur l'affront irréparable qu'elle va se faire ? Appelez-vous cela de l'amour,
et la puniriez-vous plus cruellement du sien, si vous étiez son ennemi mortel ?
Dorante. − Madame, permettez-moi de vous le dire, je ne vois rien dans mon coeur qui ressemble à ce que je viens d'entendre. Un amour infini, un respect qui m'est peut-être encore plus cher et plus précieux que cet amour même, voilà tout ce que je sens pour Angélique ; je suis d'ailleurs incapable de manquer d'honneur, mais il y a des réflexions austères qu'on n'est point en état de faire quand on aime, un enlèvement n'est pas un crime, c'est une irrégularité que le mariage efface ; nous nous serions donné notre foi mutuelle, et Angélique, en me suivant, n'aurait fui qu'avec son époux.
Angélique, à part. − Elle ne se payera pas de ces raisons-là.
Madame Argante. − Son époux, Monsieur, suffit-il d'en prendre le nom pour l'être ? Et de quel poids, s'il vous plaît, serait cette foi mutuelle dont vous parlez ? Vous vous croiriez donc mariés, parce que, dans l'étourderie d'un transport amoureux, il vous aurait plu de vous dire : Nous le somme ? Les passions seraient bien à leur aise, si leur emportement rendait tout légitime.
Angélique. − Juste ciel !
Madame Argante. − Songez-vous que de pareils engagements déshonorent une fille ! que sa réputation en demeure ternie, qu'elle en perd l'estime publique, que son époux peut réfléchir un jour qu'elle a manqué de vertu, que la faiblesse honteuse où elle est tombée doit la flétrir à ses yeux mêmes, et la lui rendre méprisable ?
Angélique, vivement. − Ah ! Dorante, que vous étiez coupable ! Madame, je me livre à vous, à vos conseils, conduisez-moi, ordonnez, que faut-il que je devienne, vous êtes la maîtresse, je fais moins cas de la vie que des lumières que vous venez de me donner ; et vous, Dorante, tout ce que je puis à présent pour vous, c'est de vous pardonner une proposition qui doit vous paraître affreuse.
Dorante. − N'en doutez pas, chère Angélique ; oui, je me rends, je la désavoue ; ce n'est pas la crainte de voir diminuer mon estime pour vous qui me frappe, je suis sûr que cela n'est pas possible ; c'est l'horreur de penser que les autres ne vous estimeraient plus, qui m'effraye ; oui, je le comprends, le danger est sûr, Madame vient de m'éclairer à mon tour : je vous perdrais, et qu'est-ce que c'est que mon amour et ses intérêts, auprès d'un malheur aussi terrible ?
Madame Argante. − Et d'un malheur qui aurait entraîné la mort d'Angélique, parce que sa mère n'aurait pu le supporter.
Angélique. − Hélas ! jugez combien je dois l'aimer, cette mère, rien ne nous a gênés dans nos entrevues ; eh bien ! Dorante, apprenez qu'elle les savait toutes, que je l'ai instruite de votre amour, du mien, de vos desseins, de mes irrésolutions.
Dorante. − Qu'entends-je ?
Angélique. − Oui, je l'avais instruite, ses bontés, ses tendresses m'y avaient obligée, elle a été ma confidente, mon amie, elle n'a jamais gardé que le droit de me conseiller, elle ne s'est reposée de ma conduite que sur ma tendresse pour elle, et m'a laissée la maîtresse de tout, il n'a tenu qu'à moi de vous suivre, d'être une ingrate envers elle, de l'affliger impunément, parce qu'elle avait promis que je serais libre.
Dorante. − Quel respectable portrait me faites-vous d'elle ! Tout amant que je suis, vous me mettez dans ses intérêts même, je me range de son parti, et me regarderais comme le plus indigne des hommes, si j'avais pu détruire une aussi belle, aussi vertueuse union que la vôtre.
Angélique, à part. − Ah ! ma mère, lui dirai-je qui vous êtes ?
Dorante. − Oui, belle Angélique, vous avez raison. Abandonnez-vous toujours à ces mêmes bontés qui m'étonnent, et que j'admire ; continuez de les mériter, je vous y exhorte, que mon amour y perde ou non, vous le devez, je serais au désespoir, si je l'avais emporté sur elle.
Madame Argante, après avoir rêvé quelque temps. − Ma fille, je vous permets d'aimer Dorante.
Dorante. − Vous, Madame, la mère d'Angélique !
Angélique. − C'est elle−même ; en connaissez-vous qui lui ressemble ?
Dorante. − Je suis si pénétré de respect...
Madame Argante. − Arrêtez, voici Monsieur Ergaste.....

1739 - "Les Sincères"
Divertissement en un acte et en prose représentée pour la première fois par les Comédiens italiens le 13 janvier 1739 à l’ Hôtel de Bourgogne, et qui met en présence deux couples, un maître et sa maîtresse, et un valet et une soubrette et révèle l'observateur des moeurs de son temps et le fin moraliste que fut Marivaux. La Marquise et Ergaste se découvrent une commune sincérité et, épris l’un de l’autre, font le projet de se marier en dépit des promesses antérieures qui les attachaient l’une à Dorante, l’autre à Araminte. Mais les rusés serviteurs agiront de telle sorte que leur amour se brise avec leur orgueil et qu'ils s’en retourneront à leurs anciens soupirants....
(Scène IV - La Marquise, Ergaste - Sincères au dépens du prochain...)
La Marquise. − Ah ! vous voici, Ergaste ? je n'en puis plus ! j'ai le coeur affadi des douceurs de Dorante que je quitte ; je me mourais déjà des sots discours de cinq ou six personnes d'avec qui je sortais, et qui me sont venues voir ; vous êtes bien heureux de ne vous y être pas trouvé. La sotte chose que l'humanité ! qu'elle est ridicule ! que de vanité ! que de duperies ! que de petitesse ! et tout cela, faute de sincérité de part et d'autre. Si les hommes voulaient se parler franchement, si l'on n'était point applaudi quand on s'en fait accroire, insensiblement l'amour-propre se rebuterait d'être impertinent, et chacun n'oserait plus s'évaluer que ce qu'il vaut. Mais depuis que je vis, je n'ai encore vu qu'un homme vrai ; et en fait de femmes, je n'en connais point de cette espèce.
Ergaste. − Et moi, j'en connais une ; devinez-vous qui c'est ?
La Marquise. − Non, je n'y suis point.
Ergaste. − Eh, parbleu ! c'est vous, Marquise ; où voulez-vous que je la prenne ailleurs ?
La Marquise. − Eh bien, vous êtes l'homme dont je vous parle ; aussi m'avez-vous prévenue d'une estime pour vous, d'une estime...
Ergaste. − Quand je dis vous, Marquise, c'est sans faire réflexion que vous êtes là ; je vous le dis comme je le dirais à un autre. Je vous le raconte.
La Marquise. − Comme de mon côté je vous cite sans vous voir ; c'est un étranger à qui je parle.
Ergaste. − Oui, vous m'avez surpris ; je ne m'attendais pas à un caractère comme le vôtre. Quoi ! dire inflexiblement la vérité ! la dire à vos amis même ! quoi ! voir qu'il ne vous échappe jamais un mot à votre avantage !
La Marquise. − Eh mais ! vous qui parlez, faites-vous autre chose que de vous critiquer sans cesse ?
Ergaste. − Revenons à vos originaux ; quelle sorte de gens était-ce ?
La Marquise. − Ah ! les sottes gens ! L'un était un jeune homme de vingt-huit à trente ans, un fat toujours agité du plaisir de se sentir fait comme il est ; il ne saurait s'accoutumer à lui ; aussi sa petite âme n'a-t-elle qu'une fonction, c'est de promener son corps comme la merveille de nos jours ; c'est d'aller toujours disant : Voyez mon enveloppe, voilà l'attrait de tous les coeurs, voilà la terreur des maris et des amants, voilà l'écueil de toutes les sagesses.
Ergaste, riant. − Ah ! la risible créature !
La Marquise. − Imaginez-vous qu'il n'a précisément qu'un objet dans la pensée, c'est de se montrer ; quand il rit, quand il s'étonne, quand il vous approuve, c'est qu'il se montre. Se tait-il ? Change-t-il de contenance ? Se tient-il sérieux ? ce n'est rien de tout cela qu'il veut faire, c'est qu'il se montre ; c'est qu'il vous dit : Regardez-moi. Remarquez mes gestes et mes attitudes ; voyez mes grâces dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis ; voyez mon air fin, mon air leste, mon air cavalier, mon air dissipé ; en voulez-vous du vif, du fripon, de l'agréablement étourdi ? en voilà. Il dirait volontiers à tous les amants : N'est-il pas vrai que ma figure vous chicane ? à leurs maîtresses : Où en serait votre fidélité, si je voulais ? à l'indifférente : Vous n'y tenez point, je vous réveille, n'est-ce pas ? à la prude : Vous me lorgnez en dessous ? à la vertueuse : Vous résistez à la tentation de me regarder ? à la jeune fille : Avouez que votre coeur est ému ! Il n'y a pas jusqu'à la personne âgée qui, à ce qu'il croit, dit en elle-même en le voyant : Quel dommage que je ne suis plus jeune !
Ergaste, riant. − Ah ! ah ! ah ! je voudrais bien que le personnage vous entendît.
La Marquise. − Il sentirait que je n'exagère pas d'un mot. Il a parlé d'un mariage qui a pensé se conclure pour lui ; mais que trois ou quatre femmes jalouses, désespérées et méchantes, ont trouvé sourdement le secret de faire manquer : cependant il ne sait pas encore ce qui arrivera ; il n'y a que les parents de la fille qui se soient dédits, mais elle n'est pas de leur avis. Il sait de bonne part qu'elle est triste, qu'elle est changée ; il est même question de pleurs : elle ne l'a pourtant vu que deux fois ; et ce que je vous dis là, je vous le rends un
peu plus clairement qu'il ne l'a conté. Un fat se doute toujours un peu qu'il l'est ; et comme il a peur qu'on ne s'en doute aussi, il biaise, il est fat le plus modestement qu'il lui est possible ; et c'est justement cette modestie-là qui rend sa fatuité sensible.
Ergaste, riant. − Vous avez raison.
La Marquise. − A côté de lui était une nouvelle mariée, d'environ trente ans, de ces visages d'un blanc fade, et qui font une physionomie longue et sotte ; et cette nouvelle épousée, telle que je vous la dépeins, avec ce visage qui, à dix ans, était antique, prenait des airs enfantins dans la conversation ; vous eussiez dit d'une petite fille qui vient de sortir de dessous l'aile de père et de mère ; figurez-vous qu'elle est toute étonnée de la nouveauté de son état ; elle n'a point de contenance assurée ; ses innocents appas sont encore tout confus
de son aventure ; elle n'est pas encore bien sûre qu'il soit honnête d'avoir un mari ; elle baisse les yeux quand on la regarde ; elle ne croit pas qu'il lui soit permis de parler si on ne l'interroge ; elle me faisait toujours une inclination de tête en me répondant, comme si elle m'avait remerciée de la bonté que j'avais de faire comparaison avec une personne de son âge ; elle me traitait comme une mère, moi, qui suis plus jeune qu'elle, ah, ah, ah !
Ergaste. − Ah ! ah ! ah ! il est vrai que, si elle a trente ans, elle est à peu près votre aînée de deux.
La Marquise. − De près de trois, s'il vous plaît.
Ergaste, riant. − Est-ce là tout ?
La Marquise. − Non ; car il faut que je me venge de tout l'ennui que m'ont donné ces originaux. Vis-à-vis de la petite fille de trente ans, était une assez grosse et grande femme de cinquante à cinquante-cinq ans, qui nous étalait glorieusement son embonpoint, et qui prend l'épaisseur de ses charmes pour de la beauté ; elle est veuve, fort riche, et il y avait auprès d'elle un jeune homme, un cadet qui n'a rien, et qui s'épuise en platitudes pour lui faire sa cour. On a parlé du dernier bal de l'Opéra. J'y étais, a-t-elle dit, et j'y trompai mes
meilleurs amis, ils ne me reconnurent point. Vous ! Madame, a-t-il repris, vous n'êtes pas reconnaissable ? Ah ! je vous en défie, je vous reconnus du premier coup d'oeil à votre air de tête. Eh ! comment cela, Monsieur ? Oui, Madame, à je ne sais quoi de noble et d'aisé qui ne pouvait appartenir qu'à vous ; et puis vous ôtâtes un gant ; et comme, grâce au ciel, nous avons une main qui ne ressemble guère à d'autres, en la voyant je vous nommai. Et cette main sans pair, si vous l'aviez vue, Monsieur, est assez blanche, mais large, ne vous déplaise, mais charnue, mais boursouflée, mais courte, et tient au bras le mieux nourri que j'aie vu de ma vie. Je vous en parle savamment ; car la grosse dame au grand air de tête prit longtemps du tabac pour exposer cette main unique, qui a de l'étoffe pour quatre, et qui finit par des doigts d'une grosseur, d'une brièveté, à la différence de ceux de la petite fille de trente ans qui sont comme des filets.
Ergaste, riant. − Un peu de variété ne gâte rien.
La Marquise. − Notre cercle finissait par un petit homme qu'on trouvait si plaisant, si sémillant, qui ne dit rien et qui parle toujours ; c'est-à-dire qu'il a l'action vive, l'esprit froid et la parole éternelle : il était auprès d'un homme grave qui décide par monosyllabes, et dont la compagnie paraissait faire grand cas ; mais à vous dire vrai, je soupçonne que tout son esprit est dans sa perruque : elle est ample et respectable, et je le crois fort borné quand il ne l'a pas ; les grandes perruques m'ont si souvent trompée que je n'y crois plus.
Ergaste, riant. − Il est constant qu'il est de certaines têtes sur lesquelles elles en imposent.
La Marquise. − Grâce au ciel, la visite a été courte, je n'aurais pu la soutenir longtemps, et je viens respirer avec vous. Quelle différence de vous à tout le monde ! Mais dites sérieusement, vous êtes donc un peu content de moi ?
Ergaste. − Plus que je ne puis dire.
La Marquise. − Prenez garde, car je vous crois à la lettre ; vous répondez de ma raison là-dessus, je vous l'abandonne.
Ergaste. − Prenez garde aussi de m'estimer trop.
La Marquise. − Vous, Ergaste ? vous êtes un homme admirable : vous me diriez que je suis parfaite que je n'en appellerais pas : je ne parle pas de la figure, entendez-vous ?
Ergaste. − Oh ! de celle-là, vous vous en passeriez bien, vous l'avez de trop.
La Marquise. − Je l'ai de trop ? Avec quelle simplicité il s'exprime ! vous me charmez, Ergaste, vous me charmez... A propos, vous envoyez à Paris ; dites à votre homme qu'il vienne chercher une lettre que je vais achever.
Ergaste. − Il n'y a qu'à le dire à Frontin que je vois. Frontin !
(Scène XI - Dorante, la Marquise, après s'être regardés, et avoir gardé un grand silence.)
La Marquise. − Eh bien ! Dorante, me promènerai-je avec un muet ?
Dorante. − Dans la triste situation où me met votre indifférence pour moi, je n'ai rien à dire, et je ne sais que soupirer.
La Marquise, tristement. − Une triste situation et des soupirs ! que tout cela est triste ! que vous êtes à plaindre ! mais soupirez-vous quand je n'y suis point, Dorante ? j'ai dans l'esprit que vous me gardez vos langueurs.
Dorante. − Eh ! Madame, n'abusez point du pouvoir de votre beauté : ne vous suffit-il pas de me préférer un rival ? pouvez-vous encore avoir la cruauté de railler un homme qui vous adore ?
La Marquise. − Qui m'adore ! l'expression est grande et magnifique assurément : mais je lui trouve un défaut ; c'est qu'elle me glace, et vous ne la prononcez jamais que je ne sois tentée d'être aussi muette qu'une idole.
Dorante. − Vous me désespérez, fut-il jamais d'homme plus maltraité que je le suis ? fut-il de passion plus méprisée ?
La Marquise. − Passion ! j'ai vu ce mot-là dans Cyrus ou dans Cléopâtre. Eh ! Dorante, vous n'êtes pas indigne qu'on vous aime ; vous avez de tout, de l'honneur, de la naissance, de la fortune, et même des agréments ; je dirai même que vous m'auriez peut-être plu ; mais je n'ai jamais pu me fier à votre amour ; je n'y ai point de foi, vous l'exagérez trop ; il révolte la simplicité de caractère que vous me connaissez. M'aimez-vous beaucoup ? ne m'aimez-vous guère ? faites-vous semblant de m'aimer ? c'est ce que je ne saurais décider. Eh ! le moyen d'en juger mieux, à travers toutes les emphases ou toutes les impostures galantes dont vous l'enveloppez ? Je ne sais plus que soupirer, dites-vous. Y a-t-il rien de si plat ? Un homme qui aime une femme raisonnable ne dit point : Je soupire ; ce mot n'est pas assez sérieux pour lui, pas assez vrai ; il dit : Je vous aime ; je voudrais bien que vous m'aimassiez ; je suis bien mortifié que vous ne m'aimiez pas : voilà tout, et il n'y a que cela dans votre coeur non plus. Vous n'y verrez, ni que vous m'adorez, car c'est parler en poète ; ni que vous êtes désespéré, car il faudrait vous enfermer ; ni que je suis cruelle, car je vis doucement avec tout le monde ; ni peut-être que je suis belle, quoique à tout prendre il se pourrait que je la fusse ; et je demanderai à Ergaste ce qui en est ; je compterai sur ce qu'il me dira ; il est sincère : c'est par là que je l'estime ; et vous me rebutez par le contraire.
Dorante, vivement. − Vous me poussez à bout ; mon coeur en est plus croyable qu'un misanthrope qui voudra peut-être passer pour sincère à vos dépens, et aux dépens de la sincérité même. A mon égard, je n'exagère point : je dis que je vous adore, et cela est vrai ; ce que je sens pour vous ne s'exprime que par ce mot-là. J'appelle aussi mon amour une passion, parce que c'en est une ; je dis que votre raillerie me désespère, et je ne dis rien de trop ; je ne saurais rendre autrement la douleur que j'en ai ; et s'il ne faut pas m'enfermer, c'est que je ne suis qu'affligé, et non pas insensé. Il est encore vrai que je soupire, et que je meurs d'être méprisé : oui, je m'en meurs, oui, vos railleries sont cruelles, elles me pénètrent le coeur, et je le dirai toujours. Adieu, Madame ; voici Ergaste, cet homme si sincère, et je me retire. Jouissez à loisir de la froide et orgueilleuse tranquillité avec laquelle il vous aime.
La Marquise, le voyant s'en aller. − Il en faut convenir, ces dernières fictions-ci sont assez pathétiques.
(Scène XII - La Marquise, Ergaste)
Ergaste. − Je suis charmé de vous trouver seule, Marquise ; je ne m'y attendais pas. Je viens d'écrire à mon frère à Paris ; savez-vous ce que je lui mande ? ce que je ne vous ai pas encore dit à vous-même.
La Marquise. − Quoi donc ?
Ergaste. − Que je vous aime.
La Marquise, riant. − Je le savais, je m'en étais aperçue.
Ergaste. − Ce n'est pas là tout ; je lui marque encore une chose.
La Marquise. − Qui est ? ...
Ergaste. − Que je croyais ne vous pas déplaire.
La Marquise. − Toutes vos nouvelles sont donc vraies ?
Ergaste. − Je vous reconnais à cette réponse franche.
La Marquise. − Si c'était le contraire, je vous le dirais tout aussi uniment.
Ergaste. − A ma première lettre, si vous voulez, je manderai tout net que je vous épouserai bientôt.
La Marquise. − Eh mais ! apparemment.
Ergaste. − Et comme on peut se marier à la campagne, je pourrai même mander que c'en est fait.
La Marquise, riant. − Attendez ; laissez-moi respirer : en vérité, vous allez si vite que je me suis crue mariée.
Ergaste. − C'est que ce sont de ces choses qui vont tout de suite, quand on s'aime.
La Marquise. − Sans difficulté ; mais, dites-moi, Ergaste, vous êtes homme vrai : qu'est-ce que c'est que votre amour ? car je veux être véritablement aimée.
Ergaste. − Vous avez raison ; aussi vous aimé-je de tout mon coeur.
La Marquise. − Je vous crois. N'avez-vous jamais rien aimé plus que moi ?
Ergaste. − Non, d'homme d'honneur : passe pour autant une fois en ma vie. Oui, je pense bien avoir aimé autant ; pour plus, je n'en ai pas l'idée ; je crois même que cela ne serait pas possible.
La Marquise. − Oh ! très possible, je vous en réponds ; rien n'empêche que vous n'aimiez encore davantage : je n'ai qu'à être plus aimable et cela ira plus loin ; passons. Laquelle de nous deux vaut le mieux, de celle que vous aimiez ou de moi ?
Ergaste. − Mais ce sont des grâces différentes ; elle en avait infiniment.
La Marquise. − C'est-à-dire un peu plus que moi.
Ergaste. − Ma foi, je serais fort embarrassé de décider là-dessus.
La Marquise. − Et moi, non, je prononce. Votre incertitude décide ; comptez aussi que vous l'aimiez plus que moi.
Ergaste. − Je n'en crois rien.
La Marquise, riant. − Vous rêvez ; n'aime-t-on pas toujours les gens à proportion de ce qu'ils sont aimables ? et dès qu'elle l'était plus que je ne la suis, qu'elle avait plus de grâces, il a bien fallu que vous l'aimassiez davantage ? votre coeur n'a guère de mémoire.
Ergaste. − Elle avait plus de grâces ! mais c'est ce qui est indécis, et si indécis, que je penche à croire que vous en avez bien autant.
La Marquise. − Oui ! penchez-vous, vraiment ? cela est considérable ; mais savez-vous à quoi je penche, moi ?
Ergaste. − Non.
La Marquise. − A laisser là cette égalité si équivoque, elle ne me tente point ; j'aime autant la perdre que de la gagner, en vérité.
Ergaste. − Je n'en doute pas ; je sais votre indifférence là-dessus, d'autant plus que si cette égalité n'y est point, ce serait de si peu de chose !
La Marquise, vivement. − Encore ! Eh ! je vous dis que je n'en veux point, que j'y renonce. A quoi sert d'éplucher ce qu'elle a de plus, ce que j'ai de moins ? Ne vous travaillez plus à nous évaluer ; mettez-vous l'esprit en repos ; je lui cède, j'en ferai un astre, si vous voulez.
Ergaste, riant. − Ah ! ah ! ah ! votre badinage me charme ; il en sera donc ce qu'il vous plaira ; l'essentiel est que je vous aime autant que je l'aimais.
La Marquise. − Vous me faites bien de la grâce ; quand vous en rabattriez, je ne m'en plaindrais pas. Continuons, vos naïvetés m'amusent, elles sont de si bon goût ! Vous avez paru, ce me semble, avoir quelque inclination pour Araminte ?
Ergaste. − Oui, je me suis senti quelque envie de l'aimer ; mais la difficulté de pénétrer ses dispositions m'a rebuté. On risque toujours de se méprendre avec elle, et de croire qu'elle est sensible quand elle n'est qu'honnête ; et cela ne me convient point.
La Marquise, ironiquement. − Je fais grand cas d'elle ; comment la trouvez-vous ? à qui de nous deux, amour à part, donneriez-vous la préférence ? ne me trompez point.
Ergaste. − Oh ! jamais, et voici ce que j'en pense : Araminte a de la beauté, on peut dire que c'est une belle femme.
La Marquise. − Fort bien. Et quant à moi, à cet égard-là, je n'ai qu'à me cacher, n'est-ce pas ?
Ergaste. − Pour vous, Marquise, vous plaisez plus qu'elle.
La Marquise, à part, en riant. − J'ai tort, je passe l'étendue de mes droits. Ah ! le sot homme ! qu'il est plat ! Ah ! ah ! ah !
Ergaste. − Mais de quoi riez-vous donc ?
La Marquise. − Franchement, c'est que vous êtes un mauvais connaisseur, et qu'à dire vrai, nous ne sommes belles ni l'une ni l'autre.
Ergaste. − Il me semble cependant qu'une certaine régularité de traits...
La Marquise. − Visions, vous dis-je ; pas plus belles l'une que l'autre. De la régularité dans les traits d'Araminte ! de la régularité ! vous me faites pitié ! et si je vous disais qu'il y a mille gens qui trouvent quelque chose de baroque dans son air ?
Ergaste. − Du baroque à Araminte !
La Marquise. − Oui, Monsieur, du baroque ; mais on s'y accoutume, et voilà tout ; et quand je vous accorde que nous n'avons pas plus de beauté l'une que l'autre, c'est que je ne me soucie guère de me faire tort ; mais croyez que tout le monde la trouvera encore plus éloignée d'être belle que moi, tout effroyable que vous me faites.
Ergaste. − Moi, je vous fais effroyable ?
La Marquise. − Mais il faut bien, dès que je suis au-dessous d'elle.
Ergaste. − J'ai dit que votre partage était de plaire plus qu'elle.
La Marquise. − Soit, je plais davantage, mais je commence par faire peur.
Ergaste. − Je puis m'être trompé, cela m'arrive souvent ; je réponds de la sincérité de mes sentiments, mais je n'en garantis pas la justesse.
La Marquise. − A la bonne heure ; mais quand on a le goût faux, c'est une triste qualité que d'être sincère.
Ergaste. − Le plus grand défaut de ma sincérité, c'est qu'elle est trop forte.
La Marquise. − Je ne vous écoute pas, vous voyez de travers ; ainsi changeons de discours, et laissons là Araminte. Ce n'est pas la peine de vous demander ce que vous pensiez de la différence de nos esprits, vous ne savez pas juger.
Ergaste. − Quant à vos esprits, le vôtre me paraît bien vif, bien sensible, bien délicat.
La Marquise. − Vous biaisez ici, c'est vain et emporté que vous voulez dire.

1731-1741 - "La Vie de Marianne"
Célèbre pour ses comédies, Marivaux fut aussi un romancier de talent. Avec "Pharsamon ou les Folies amoureuses" (composé en 1712, publié en 1737) et "Les Aventures de*** ou les Effets surprenants de la Sympathie" (1713-1714), il parodie le roman précieux non sans se laisser prendre lui-même aux attraits du genre. "La Voiture embourbée" (1714) marque une évolution vers plus de réalisme. C'est avec "La Vie de Marianne", dont la publication s'échelonne de 1731 à 1741, et avec "Le Paysan parvenu" (1735-1736) que Marivaux affirme un talent original de romancier, romans psychologiques et romans de moeurs. Mais les deux romans sont inachevés, ne contiennent point, ou très peu, de marivaudage, sont écrits d'un style courant et assez simple, parfois tirant en longueur, mais remplis de peintures de mœurs qui sentent le vrai, et de portraits tout en relief. ....
Roman d'analyse et roman de moeurs. Marianne est une jeune fille dont on ne connaît rien quant à son origine si ce n'est que jeune fille élevée dans le raffinement aristocratique, elle va se retrouver plongée dans un milieu populaire où tout lui sera étranger. Elle va ainsi connaître de nombreuses aventures et des fortunes diverses au long d'infinies digressions psychologiques, mais on reconnaît, malgré les longueurs, une extraordinaire habileté de l'auteur qui sait donner vie à son héroïne. L`histoire débute avec l`attaque d'un carrosse par des brigands ; tous les occupants de la voiture sont tués, à l'exception de Marianne, âgée alors de deux ans, et d'un chanoine qui s`enfuit. La petite fille est recueillie par un curé et soignée par la sœur de celui-ci. Ces braves gens l`élèvent et, quand elle est devenue une jeune fille, l'emmènent à Paris. Là, orpheline de quinze ans, elle se retrouve seule, désemparée et sans argent, à la mort de ses protecteurs. Un religieux la présente à M. de Climal, homme charitable et pieux, en apparence du moins, mais en fait personnage libertin, hypocrite, qui est resté un classique et qu'on peut placer, sans complaisance et sans crainte, non loin de Tartuffe.
"C'était un homme de cinquante à soixante ans, encore assez bien fait, fort riche, d'un visage doux et sérieux, où l'on voyait un air de mortification qui empêchait qu'on ne remarquât tout son embonpoint. Il nous reçut bonnement et sans façon, et sans autre compliment que d'embrasser d'abord le religieux; il jeta un coup d'œil sur moi et puis nous fit asseoir. Le cœur me battait; j'étais honteuse, embarrassée; je n'osais lever les yeux ; mon petit amour-propre était étonné, et ne savait où il en était. "Voyons, de quoi s'agit-il ? dit alors notre homme pour entamer la conversation, et en prenant la main du religieux, qu'il serra avec componction dans la sienne. Là-dessus le religieux lui conta mon histoire. "Voilà, répondit-il, une aventure bien particulière, et une situation bien triste? "Vous pensiez juste, mon père, quand vous m'avez écrit qu'on ne pouvait faire une meilleure action que de rendre service à mademoiselle. Je le crois de même , elle a plus besoin de secours qu'un autre par mille raisons, et je vous suis obligé de vous être adressé à moi pour cela ; je bénis le moment où vous avez été inspiré de m'avertir, car je suis pénétré de ce que je viens d'entendre ; allons, examinons un peu de quelle façon nous nous y prendrons. Quel âge avez-vous, ma chère enfant? ajouta-t-il, en me parlant avec une charité cordiale. A cette question je me mis à soupirer sans pouvoir répondre. Ne vous affligez pas, me dit-il, prenez courage, je ne demande qu'à vous être utile ; et d'ailleurs Dieu est le maître, il faut le louer de tout ce qu'il fait : dites-moi donc, quel âge avez-vous à peu près? Quinze ans et demi, repris-je, et peut-être plus. Effectivement, dit-il en se retournant du côté du père, à la voir on lui en donnerait davantage; mais sur sa physionomie, j'augure bien de son cœur et du caractère de son esprit : on est même porté à croire qu'elle a de la naissance: en vérité son malheur est bien grand! que les desseins de Dieu sont impénétrables ! Mais revenons au plus pressé, ajouta-t-il, après s'être ainsi prosterné en esprit devant les desseins de Dieu : comme vous n'avez nulle fortune dans ce monde, il faut voir à quoi vous vous destinez : la demoiselle qui est morte n'avait-elle rien résolu pour vous ? Elle avait, lui dis-je, intention de me mettre chez une marchande. Fort bien, reprit-il, j'approuve ses vues; sont-elles de votre goût ? Parlez franchement, il y a plusieurs choses qui peuvent vous convenir : j'ai, par exemple, une belle-sœur qui est une personne très raisonnable, fort à son aise, et qui vient de perdre une demoiselle qui était à son service, qu'elle aimait beaucoup, et à qui elle aurait fait du bien dans la suite ; si vous vouliez tenir sa place, je suis persuadé qu'elle vous prendrait avec plaisir. Cette proposition me fit rougir. Hélas ! monsieur, lui dis-je, quoique je n'aie rien, et que je ne sache à qui je suis, il me semble que j'aimerais mieux mourir que d'être chez quelqu'un en qualité de domestique ; et si j'avais mon père et ma mère, il y a toute apparence que j'en aurais moi-même, au lieu d'en servir à personne.
Je lui répondis cela d'une manière fort triste ; après quoi versant quelques larmes : puisque je suis obligée de travailler pour vivre, ajoutai-je en sanglotant, je préfère le plus petit métier qu'il y ait, et le plus pénible, pourvu que je sois libre, à l'état dont vous me parlez, quand j'y devrais faire ma fortune.
Eh! mon enfant, me dit-il, tranquillisez-vous ; je vous loue de penser comme cela, c'est une marque que vous avez du cœur, et cette fierté-là est permise; il ne faut pas la pousser trop loin, elle ne serait plus raisonnable : quelque conjecture avantageuse qu'on puisse faire de votre naissance, cela ne vous donne aucun état, et vous devez vous régler là-dessus: mais enfin nous suivrons les vues de cette amie que vous avez perdue ; il en coûtera davantage, c'est une pension qu'il faudra payer ; mais n'importe, dès aujourd'hui vous serez placée : je vais vous mener chez ma marchande de linge, et vous y serez la bienvenue : êtes-vous contente? Oui, monsieur, lui dis-je, et jamais je n'oublierai vos bontés...."
Marianne est donc placée chez une lingère, Mme Dutour...
"Cette marchande, il faut que je vous la nomme pour la facilité de l'histoire. Elle s'appelait Mme Dutour; c'était une veuve qui, je pense, n'avait pas plus de trente ans ; une grosse réjouie qui, à vue d'œil, paraissait la meilleure femme du monde ; aussi l'était-elle. Son domestique était composé d'un petit garçon de six ou sept ans, qui était son fils, d'une servante, et d'une nommée Mlle Toinon, sa fille de boutique. Quand je serais tombée des nues, je n'aurais pas été plus étourdie que je l'étais ; les personnes qui ont du sentiment sont bien plus abattues que d'autres dans de certaines occasions, parce que tout ce qui leur arrive les pénètre ; il y a une tristesse stupide qui les prend, et qui me prit : Mme Dutour fit de son mieux pour me tirer de cet état-là.
"Allons, Mademoiselle Marianne, me disait-elle (car elle avait demandé mon nom), vous êtes avec de bonnes gens, ne vous chagrinez point, j'aime qu'on soit gaie ; qu'avez-vous qui vous fâche ? Est-ce que vous vous déplaisez ici ? Moi, dès que je vous ai vue, j'ai pris de l'amitié pour vous ; tenez, voilà Toinon, qui est une bonne enfant, faites connaissance ensemble." Et c'était en soupant qu'elle me tenait ce discours, à quoi je ne répondais que par une inclinaison de tête et avec une physionomie dont la douceur remerciait sans que je parlasse ; quelquefois je m'encourageais jusqu'à dire : « Vous avez bien de la bonté" ; mais, en vérité, j'étais déplacée, et je n'étais pas faite pour être là. Je sentais, dans la franchise de cette femme-là, quelque chose de grossier qui me rebutait.
Je n'avais pourtant vécu encore qu'avec mon curé et sa sœur, et ce n'étaient pas des gens du monde, il s'en fallait bien ; mais je ne leur avais vu que des manières simples et non pas grossières : leurs discours étaient unis et sensés ; d'honnêtes gens, vivant médiocrement, pouvaient parler comme ils parlaient, et je n'aurais rien imaginé de mieux, si je n'avais jamais vu autre chose : au lieu qu'avec ces gens-ci je n'étais pas contente, je leur trouvais un jargon, un ton brusque qui blessait ma délicatesse. Je me disais déjà que dans le monde il fallait qu'il y eût quelque chose qui valait mieux que cela ; je soupirais après, j'étais triste d'être privée de ce mieux que je ne connaissais pas. Dites-moi d'où cela venait. Où est-ce que j 'avais pris mes délicatesses ? Étaient-elles dans mon sang? cela se pourrait bien. Venaient-elles du séjour que j'avais fait à Paris ? cela se pourrait encore. Il y a des âmes perçantes à qui il n'en faut pas beaucoup montrer pour les instruire, et qui sur le peu qu'elles voient soupçonnent tout d'un coup tout ce qu'elles pourraient voir.
La mienne avait le sentiment bien subtil, je vous assure, surtout dans les choses de sa vocation, comme était le monde. Je ne connaissais personne à Paris, je n'en avais vu que les rues, mais dans ces rues, il y avait des personnes de toute espèce ; il y avait des carrosses, et dans ces carrosses un monde qui m'était très nouveau, mais point étranger. Et sans doute il y avait en moi un goût naturel, qui n'attendait que ces objets-là pour s'y prendre ; de sorte que, quand je les voyais, c'était comme si j'avais rencontré ce que je cherchais.
Vous jugez bien qu'avec ces dispositions, Mme Dutour ne me convenait point, non plus que Mlle Toinon, qui était une grande fille qui se redressait toujours, et qui maniait sa toile avec tout le jugement et toute la décence possibles ; elle y était tout entière, et son esprit ne passait pas son aune. Pour moi, j'étais si gauche à ce métier-là, que je l'impatientais à tout moment. Il fallait voir de quel air elle me reprenait, avec quelle fierté de savoir elle corrigeait ma maladresse : et ce qui est plaisant, c'est que l'effet ordinaire de ces corrections, c'était de me rendre encore plus maladroite, parce que j'en devenais plus dégoûtée."
M. de Climal entreprend donc progressivement de conquérir Marianne....
"Monsieur de Climal (c'était ainsi que s'appelait celui qui m'avait mise chez madame Dutour) revint trois ou quatre jours après m'avoir laissée là. J'étais alors dans notre chambre avec mademoiselle Toinon, qui me montrait ses belles bardes, et qui sortit, par savoir-vivre, dès qu'il fut entré. Eh bien, mademoiselle, comment vous trouvez-vous ici? me dit-il. Mais, monsieur, répondis-je, j'espère que je m'y ferai. J'aurais, répondit-il, grande envie que vous fussiez contente ; car je vous aime de tout mon cœur, vous m'avez plu tout d'un coup, et je vous en donnerai toutes les preuves que je pourrai. Pauvre enfant ! que j'aurai de plaisir à vous rendre service ! Mais je veux que vous ayez de l'amitié pour moi. Il faudrait que je fusse bien ingrate pour en manquer, lui répondis-je. Non, non, reprit-il, ce ne sera point par ingratitude que vous ne m'aimerez point ; c'est que vous n'aurez pas avec moi une certaine liberté que je veux que vous ayez. Je sais trop le respect que je vous dois, lui dis-je. Il n'est pas sûr que vous m'en deviez, dit-il, puisque nous ne savons pas qui vous êtes : mais, Marianne, ajouta-t-il en me prenant la main, qu'il serrait imperceptiblement, ne seriez-vous pas un peu plus familière avec un ami qui vous voudrait autant de bien que je vous en veux?
Voilà ce que je demande : vous lui diriez vos sentiments, vos goûts ; vous aimeriez à le voir. Pourquoi ne feriez-vous pas de même avec moi ? Oh ! j'y veux mettre ordre absolument, ou nous aurons querelle ensemble. A propos, j'oubliais à vous donner de l'argent. Et en disant cela, il me mit quelques louis d'or dans la main. Je les refusai d'abord, et lui dis qu'il me restait quelque argent de la défunte ; mais, malgré cela, il me força de les prendre. Je les pris donc avec honte, car cela m'humiliait ; mais je n'avais point de fierté à écouter là-dessus avec un homme qui s'était chargé de moi, pauvre orpheline, et qui paraissait vouloir me tenir lieu de père.
Je fis une révérence assez sérieuse en recevant ce qu'il me donnait. Eh ! me dit-il, ma chère Marianne, laissons là les révérences, et montrez-moi que vous êtes contente. Combien m'allez-vous saluer de fois pour un habit que je vais vous acheter? voyons. Je ne fis pas, ce me semble, une grande attention à l'habit qu'il me promettait ; mais il dit cela d'un air si bon et si badin, qu'il me gagna le cœur, je vous l'avoue: mes répugnances me quittèrent, un vif sentiment de reconnaissance en prit la place, et je me jetai sur son bras que j'embrassai de fort bonne grâce, et presque en pleurant de sensibilité.
Il fut charmé de mon mouvement, et me prit la main, qu'il baisa d'une manière fort tendre ; façon de faire qui, au milieu de mon petit transport, me parut encore singulière, mais toujours de cette singularité qui m'étonnait sans rien m'apprendre, et que je penchais à regarder comme des expressions un peu extraordinaires de son bon cœur. Quoi qu'il en soit, la conversation, de ma part, devint dès ce moment-là plus aisée, mon aisance me donna des grâces qu'il ne me connaissait pas encore ; il s'arrêtait de temps en temps à me considérer avec une tendresse dont je remarquais toujours l'excès, sans y entendre plus de finesse.
Il n'y avait pas moyen non plus qu'alors j'en pénétrasse davantage ; mon imagination avait fait son plan sur cet homme-là, et quoique je le visse enchanté de moi, rien n'empêchait que ma jeunesse, ma situation, mon esprit et mes grâces ne lui eussent donné pour moi une affection très innocente : on peut se prendre d'une tendre amitié pour les personnes de mon âge dont on veut avoir soin: on se plaît à leur voir du mérite, parce que nos bienfaits nous en feront plus d'honneur; enfin on aime ordinairement à voir l'objet de sa générosité ; et tous les motifs de simple tendresse qu'un bienfaiteur peut avoir dans ce cas-là, une fille de plus de quinze ans et demi, quoiqu'elle n'ait rien vu, les sent et les devine confusément: elle n'en est non plus surprise que de voir l'amour de son père et de sa mère pour elle; et voilà comment j'étais : je l'aurais plutôt pris pour un original dans ses façons, que pour ce qu'il était; il avait beau reprendre ma main, l'approcher de sa bouche en badinant, je n'admirais là-dedans que la rapidité de son inclination pour moi, et cela me touchait plus que tous ses bienfaits; car à l'âge où j'étais, quand on n'a point encore souffert, on ne sait point trop l'avantage qu'il y a d'être dépourvue de tout.
Peut-être devrais-je passer tout ce que je vous dis là , mais je vais comme je puis, je n'ai garde de songer que je vous fais un livre : cela me jetterait dans un travail d'esprit dont je ne sortirais pas ; je m'imagine que je vous parle, et tout passe dans la conversation: continuons-la donc.
Dans ce temps on se coiffait en cheveux, et jamais créature ne les a eus plus beaux que moi ; cinquante ans que j'ai n'en ont fait que diminuer la quantité, sans en avoir changé la couleur, qui est encore du plus clair châtain. Monsieur de Climal les regardait, les touchait avec passion mais cette passion, je la regardais comme un pur badinage. Marianne, me disait-il quelquefois, vous n'êtes point si à plaindre: de si beaux cheveux et ce visage-là ne vous laisseront manquer de rien. Ils ne me rendront ni mon père ni ma mère, lui répondis-je. Ils vous feront aimer de tout le monde, me dit-il ; et pour moi, je ne leur refuserai jamais rien. Oh ! pour cela, lui dis-je, je compte sur vous et sur votre bon cœur. Sur mon bon cœur reprit-il en riant- eh! vous parlez donc de cœur, chère enfant et si je vous demandais le vôtre, me le donneriez-vous ? Hélas ! vous le méritez bien, lui dis-je naïvement.
A peine lui ai-je répondu cela, que je vis dans ses yeux quelque chose de si ardent, que ce fut un coup de lumière pour moi; sur-le-champ, je me dis en moi-même: il se pourrait bien faire que cet homme-là m'aimât comme un amant aime une maîtresse; car enfin, j'en avais vu des amants dans mon village, j'avais entendu parler d'amour, j'avais même déjà lu quelques romans à la dérobée , et tout cela, joint aux leçons que la nature nous donne, m'avait du moins fait sentir qu'un amant était bien différent d'un ami ; et sur cette différence, que j'avais comprise à ma manière, tout d'un coup les regards de M. de Climal me parurent d'une espèce suspecte.
Cependant je ne regardai pas l'idée qui m'en vint sur-le-champ comme une chose encore bien sûre; mais je devais bientôt en avoir le cœur net ; et je commençai toujours, en attendant, par être un peu plus forte et plus à mon aise avec lui. Mes soupçons me défirent presque tout à fait de cette timidité qu'il m'avait tant reprochée ; je crus que s'il était vrai qu'il m'aimât, il n'y avait plus tant de façon à faire avec lui, et que c'était lui qui était dans l'embarras et non pas moi. Ce raisonnement coula de source : au reste Il paraît fin, et ne l'est pas ; il n'y a rien de si simple on ne s aperçoit pas seulement qu'on le fait.
Il est vrai que ceux contre qui on raisonne comme cela n'ont pas grand retour à espérer de vous ; cela supposé qu'en fait d'amour on ne se soucie guère d'eux : aussi de ce côté-là M. de Climal m'était-il parfaitement indifférent et même de cette indifférence qui va devenir haine si on la tourmente: peut-être eût-il été ma première inclination si nous avions commencé autrement ensemble ; mais je ne l'avais connu que sur le pied d'un homme pieux, qui entreprenait d avoir soin de moi par charité; et je ne sache point de manière de connaître les gens qui éloigne tant de les aimer de ce qu'on appelle amour: il n'y a plus de sentiments tendres à demander à une personne qui n'a fait connaissance avec vous que dans ce goût-là. L'humiliation qu'elle a soufferte vous a fermé son cœur de ce côté-là; ce cœur en garde une rancune que lui-même il ne sait pas qu'il a, tant que vous ne lui demandez que des sentiments qui vous sont justement dus; mais lui demandez-vous d'une certaine tendresse, oh ! c'est une autre affaire : son amour-propre vous reconnaît alors ; vous vous êtes brouillé avec lui sans retour là-dessus, il ne vous pardonnera jamais : et c est ainsi que j étais avec M. de Climal.
Il est vrai que, si les hommes savaient obliger, je crois qu'ils feraient tout ce qu'ils voudraient de ceux qui leur auraient obligation : car est-il rien de si doux que le sentiment de reconnaissance, quand notre amour-propre n'y répugne point? On en tirerait des trésors de tendresse ; au lieu qu'avec les hommes, on a besoin de deux vertus, l'une pour vous empêcher d'être indignée du bien qu'ils vous font, l'autre pour vous en imposer la reconnaissance...."
M. de Climal promet donc à Marianne sa protection si elle veut bien l`aimer, et lui offre un bel habit, mais le voici se démasquant de plus en plus ...
"... l'homme amoureux se montrait, je lui voyais déjà la moitié du visage ; mais j'avais conclu qu'il fallait que je le visse tout entier pour le reconnaître, sinon il était arrêté que je ne verrais rien. Les bardes n'étaient pas encore en lieu de sûreté ; et, si je m'étais scandalisée trop tôt, j'aurais peut-être tout perdu. Les passions de l'espèce de celle de M, de Climal sont naturellement lâches quand on les désespère, elles ne se piquent pas de faire une retraite bien honorable, et c'est un vilain amant qu'un homme qui vous désire plus qu'il ne vous aime : non pas que l'amant le plus délicat ne désire à sa manière, mais du moins c'est que chez lui les sentiments du cœur se mêlent avec les sens ; tout cela se fond ensemble : ce qui fait un amour tendre, et non pas vicieux, quoique à la vérité capable du vice ; car tous les jours, en fait d'amour, on fait très délicatement des choses fort grossières : mais il ne s'agit point de cela. Je feignis donc de ne rien comprendre aux petits discours que me tenait M. de Climal pendant que nous retournions chez madame Dutour. J'ai peur de vous aimer trop, Marianne, me disait-il ; et, si cela était, que feriez-vous ? Je ne pourrais en être que plus reconnaissante, s'il était possible, lui répondis-je. Cependant, Marianne, je me défie de votre cœur, quand il connaîtra toute la tendresse du mien, ajouta-t-il ; car vous ne la savez pas. Comment, lui dis-je, vous croyez que je ne vois pas votre amitié? Eh ! ne changez point mes termes, reprit-il, je ne dis pas mon amitié, je parle de ma tendresse. Quoi ! dis-je, n'est-ce pas la même chose ? Non, Marianne, me répondit-il en me regardant d'une manière à m'en prouver la différence ; non, chère fille, ce n'est pas la même chose ; et je voudrais bien que l'une vous parût plus douce que l'autre.
Là-dessus je ne pus m'empêcher de baisser les yeux, quoique j'y résistasse ; mais mon embarras fut plus fort que moi. Vous ne me dites mot; est-ce que vous m'entendez, me dit-il en me serrant la main? C'est, lui dis-je, que je suis honteuse de ne savoir que répondre à tant de bonté. Heureusement pour moi, la conversation finit là, car nous étions arrivés ; tout ce qu'il put faire, ce fut de me redire à l'oreille : Allez, friponne, allez rendre votre cœur plus traitable et moins sourd ; je vous laisse le mien pour vous y aider. Ce discours était assez net, et il était difficile de parler plus français : je fis semblant d'être distraite pour me dispenser d'y répondre ; mais un baiser qu'il m'appuyait sur l'oreille en me parlant, s'attirait mon attention malgré que j'en eusse, et il n'y avait pas moyen d'être sourde à cela ; aussi ne le fus-je pas. Monsieur, ne vous ai-je pas fait mal, m'écriai-je d'un air naturel, en feignant de prendre le baiser qu'il m'avait donné pour le choc de sa tête avec la mienne. Dans le temps que je disais cela, je descendais de carrosse, et je crois qu'il fut la dupe de ma petite finesse..."
Marianne, en jeune coquette, ne peut résister aux attraits de la belle toilette...
"Au bout de quatre jours on m'apporta mon habit et du linge: c'était un jour de fête, et je venais de me lever quand cela vint. A cet aspect, Toinon et moi nous perdîmes d'abord toutes deux la parole, moi d'émotion, de joie, elle de la triste comparaison qu'elle flt de ce que j'allais être à ce qu'elle serait: elle aurait bien troqué son père et sa mère contre le plaisir d'être orpheline au même prix que moi: elle ouvrait sur mon petit attirail de grands yeux stupéfaits et jaloux, et d'une jalousie si humiliée que cela me fit pitié dans ma joie; mais il n'y avait point de remède à sa peine, et j'essayai mon habit le plus modestement qu'il me tut possible, devant un petit miroir ingrat qui ne me rendait que la moitié de ma figure; et ce que j'en voyais me paraissait bien piquant.
Je me mis donc vite à me coiffer et à m'habiller pour jouir de ma parure : il me prenait des palpitations en songeant combien j'allais être jolie: la main m'en tremblait à chaque épingle que j'attachais; je me hâtais d'achever sans rien précipiter pourtant; je ne voulais rien laisser d'imparfait: mais j'eus bientôt fini, car la perfection que je connaissais était bien bornée; je commençais avec des dispositions admirables, et c'était tout.
Vraiment, quand j'ai connu le monde, j'y faisais bien d'autres façons: les hommes parlent de science et de philosophie : voilà quelque chose de beau en comparaison de la science de bien placer un ruban, ou de décider de quelle couleur on le mettra! Si on savait ce qui se passe dans la tête d'une coquette en pareil cas, combien son âme est déliée et pénétrante, si on voyait la flnesse des jugements qu'elle fait sur les goûts qu'elle essaie, et puis qu'elle rebute, et puis qu'elle hésite de choisir, et qu'elle choisit enfin par pure lassitude: car souvent elle n'est pas contente, et son idée va toujours plus loin que son exécution; si on savait ce que je dis là, cela ferait peur, cela humilierait les plus forts esprits, et Aristote ne paraîtrait plus qu'un petit garçon. C'est moi qui le dis, qui le sais à merveille, et qu'en fait de parure, quand on a trouvé ce qui est bien, ce n'est pas grand'chose, et qu'il faut trouver le mieux pour aller au delà du mieux; et que, pour attraper ce dernier mieux, il faut lire dans le cœur des hommes, et savoir préférer ce qui le gagne le plus à ce qui ne fait que le gagner beaucoup: et cela est immense!"
Cependant, M. de Climal devient de plus en plus pressant et Mme Dutour, en femme qui connaît la vie, conseille à Marianne de se laisser faire la cour et d'accepter les cadeaux du vieillard...
Marivaux se fait femme au travers de son héroïne et débute la seconde partie de son roman sur le seuil d'une église où se pressent du beau monde et des femmes extrêmement parées : "nous avons deux sortes d'esprit, nous autres femmes. Nous avons d'abord le nôtre, qui est celui que nous recevons de la nature, celui qui nous sert à raisonner, suivant le degré qu'il a, qui devient ce qu'il peut, et qui ne sait rien qu'avec le temps. Et puis nous en avons encore un autre, qui est à part du nôtre, et qui peut se trouver dans les femmes les plus sottes. C'est l'esprit que la vanité de plaire nous donne, et qu'on appelle, autrement dit, la coquetterie." Et voici Marianne regardée à son tour, parée par les soins de son protecteur. Elle se sent alors femme parmi les femmes et connaît pour la première fois l'attirance d'un regard.
Marianne, en sortant de l'église, a fait un faux pas et s'est blessée. Un jeune seigneur, Valville, l'a fait transporter chez lui, et, après qu'elle a reçu quelques soins, Marianne prie qu'on la ramène en fiacre chez Mme Dutour. Elle vient d'y arriver. "A peine fus-je assise que je tirai de l'argent pour payer le cocher; mais Mme Dutour, en femme d'expérience, crut devoir me conduire là-dessus et me trouva trop jeune pour m'abandonner ce petit détail. Laissez-moi faire, me dit-elle, je vais le payer; où vous a-t-il prise? Auprès de la paroisse, lui dis-je. Eh! c'est tout près d'ici, répliqua-t-elle en comptant quelque monnaie. Tenez, voilà ce qu'il vous faut." La discussion dégénère entre le cocher et Mme Dutour à tel point que l'on crie, que l'on gesticule, et Marivaux au passage nous dresse un portait saisissant du peuple de Paris, un peuple attiré par le brouhaha, qui accourt et se rassemble, non pour s'amuser mais pour voir, "jouir bien sérieusement de ce qu'il verra. En un mot, alors il n'est ni polisson ni méchant ; et c'est en quoi j'ai dit qu'il était moins canaille ; il est seulement curieux, d'une curiosité sotte et brutale, qui ne veut ni bien ni mal à personne, qui n'entend point d'autre finesse que de venir se repaître de ce qui arrivera. Ce sont des émotions d'âme que ce peuple demande ; les plus fortes sont les meilleures; il cherche à vous plaindre si on vous outrage, à s'attendrir pour vous si on vous blesse, à frémir pour votre vie si on la menace : voilà ses délices : et si votre ennemi n'avait pas assez de place pour vous battre, il lui en ferait lui-même, sans en être plus malintentionné, et lui dirait volontiers : Tenez, faites à votre aise, et ne nous retranchez rien du plaisir que nous avons à frémir pour ce malheureux. Ce ne sont pourtant pas les choses cruelles qu'il aime, il en a peur au contraire, mais il aime l'effroi qu'elles lui donnent: cela remue son âme qui ne sait jamais rien, qui n'a jamais rien vu, qui est toujours toute neuve. Tel est le peuple de Paris, à ce que j'ai remarqué dans l'occasion..."
(Deuxième partie) Entretemps, Marianne, troublée par Valville, voit naître en elle un nouveau sentiment : "Je n'ai de ma vie été si agitée. Je ne saurais vous définir ce que je sentais. C'était un mélange de trouble, de plaisir et de peur ; oui, de peur, car une jeune fille qui en est là-dessus à son apprentissage, ne sait point où tout cela la mène; ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possèdent ; et la nouveauté de cet état l'alarme. Il est vrai qu'elle y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir fait comme un danger, sa pudeur même en est effrayée ; il y a quelque chose qui la menace, qui l'étourdit, et qui prend déjà sur elle. On se demanderait volontiers dans ces instants-là : que vais-je devenir? Car, en vérité, l'amour ne nous trompe point : dès qu'il se montre, il nous dit ce qu'il est, et de quoi il sera question ; l'âme, avec lui, sent la présence d'un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas, et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur...."
Dans cette troisième partie, la jeune fille, innocente, qui ne voyait pas jusque-là de mal dans la conduite de M. de Climal, s'aperçoit enfin où il veut en venir, ils s'en expliquent tous deux, "pour être dévot il n'en est pas moins homme". Alors qu'il était aux pieds de Marianne, Valville est survenu et a donné des marques d'indignation et de mépris. Marianne, désespérée, s'est enfuie de chez Mme Dutour. Elle entre dans une église, attenante à un couvent.
Son beau visage noyé de larmes et son air noble attirent l`attention de Mme de Míran qui, apitoyée par son histoire, décide de se charger d'elle. Le personnage de Mme de Miran inspira un célèbre portrait littéraire de Casanova, celui d'une beauté atypique de l'époque d'une grande interprète des comédies de Marivaux, Zanetta Rosa Benozzi Balletti (1701-1758), dite Silvia Balletti. Révélée par "La Surprise de l'amour", c'est pour elle que Marivaux écrira les oeuvres qu'il destine au Théâtre-Italien...
"Ma bienfaitrice, que je ne vous ai pas encore nommée, s'appelait madame de Miran ; elle pouvait avoir cinquante ans. Quoiqu'elle eût été belle femme, elle avait quelque chose de si bon et de si raisonnable dans la physionomie, que cela avait dû nuire à ses charmes, et les empêcher d'être aussi piquants qu'ils auraient dû l'être. Quand on a l'air si bon, on en paraît moins belle ; un air de franchise et de bonté si dominant est tout à fait contraire à la coquetterie ; il ne fait songer qu'au bon caractère d'une femme, et non pas à ses grâces ; il rend la belle personne plus estimable, mais son visage plus indifférent ; de sorte qu'on est plus content d'être avec elle que de la regarder. Et voilà, je pense, comme on avait été avec madame de Miran ; on ne prenait pas garde qu'elle était belle femme, mais seulement la meilleure femme du monde. Aussi, m'a-t-on dit, n'avait-elle guère fait d'amants, mais beaucoup d'amis, et même d'amies ; ce que je n'ai point de peine à croire, vu cette innocence d'intention qu'on voyait en elle, vu cette mine simple, consolante et paisible qui devait rassurer l'amour-propre de ses compagnes, et la faisait plus ressembler à une confidente qu'à une rivale. Les femmes ont le jugement sûr là-dessus. Leur propre envie de plaire leur apprend tout ce que vaut un visage de femme, quel qu'il soit, beau ou laid, il n'importe : ce qu'il a de mérite, fût-il imperceptible, elles l'y découvrent, et ne s'y fient pas : mais il y a des beautés entre elles qu'elles ne craignent point ; elles sentent fort bien que ce sont des beautés sans conséquence ; et apparemment que c'était ainsi qu'elles avaient jugé de madame de Miran..."
Portrait de Mme Dorsin, une amie de Mme de Miran qui, elle aussi, a pris Marianne en amitié, Marivaux retrouve ainsi ses sensations premières lorsque arrivant à Paris, il devint l'hôte des salons les plus recherches, celui de Mme de Lambert d'abord plus tard celui de Mme de Tencin..
"Nous arrivâmes alors, et nous entrâmes chez Mme Dorsin; il y avait trois ou quatre personnes avec elle. « Ah ! la voilà donc enfin ; vous me l'amenez, dit-elle à Mme de Miran en me voyant. Venez, mademoiselle, venez que je vous embrasse, et allons nous mettre à table : on n'attendait que vous. » Nous dînâmes. Quelque novice et quelque ignorante que je fusse en cette occasion-ci, comme l'avait dit Mme de Miran, j'étais née pour avoir du goût, et je sentis bien avec quelles gens je dînais. Ce ne fut point à force de leur trouver de l'esprit que j'appris à les distinguer; pourtant il est certain qu'ils en avaient plus que d'autres, et que je leur entendais dire d'excellentes choses; mais ils les disaient avec si peu d'effort, ils y cherchaient si peu de façon, c'était d'un ton de conversation si aisé et si uni, qu'il ne tenait qu'à moi de croire qu'ils disaient les choses les plus communes. Ce n'était point eux qui y mettaient de la finesse, c'était de la finesse qui s'y rencontrait; ils ne sentaient pas qu'ils parlaient mieux qu'on ne parle ordinairement; c'étaient seulement de meilleurs esprits que d'autres, et qui par là tenaient de meilleurs discours qu'on n'a coutume d'en tenir ailleurs, sans qu'ils eussent besoin d'y tâcher, et je dirais volontiers sans qu'il y eût de leur faute; car on accuse quelquefois les gens d'esprit de vouloir briller; oh! il n'était pas question de cela ici; et, comme je l'ai déjà dit, si je n'avais pas eu un peu de goût naturel, un peu de sentiment, j'aurais pu m'y méprendre, et je ne me serais aperçue de rien.
Mais, à la fin, ce ton de conversation si excellent, si exquis, quoique si simple, me frappa. Ils ne disaient rien que de juste et que de convenable, rien qui ne fût d'un commerce doux, facile et gai; j'avais compris le monde tout autrement que je ne le voyais là (et je n'avais pas tant de tort) : je me l'étais figuré pleins de petites règles frivoles et de petites finesses polies, plein de bagatelles graves et importantes, difficiles à apprendre, et qu'il fallait savoir sous peine d'être ridicule, toutes ridicules qu'elles sont elles-mêmes. Et point du tout; il n'y avait rien ici qui ressemblât à ce que j'avais pensé, rien qui dût embarrasser mon esprit ni ma figure, rien qui me fît craindre de parler, rien au contraire qui n'encourageât ma petite raison à oser se familiariser avec la leur; j'y sentis même une chose qui m'était fort commode, c'est que leur bon esprit suppléait aux tournures obscures et maladroites du mien. Ce que je ne disais qu'imparfaitement, ils achevaient de le penser et de l'exprimer pour moi, sans qu'ils y prissent garde; et puis ils m'en donnaient tout l'honneur.
Enfin ils me mettaient à mon aise; et moi qui m'imaginais qu'il y avait tant de mystères dans l'a politesse des gens du monde, et qui l'avais regardée comme une science qui m'était totalement inconnue et dont je n'avais nul principe, j'étais bien surprise de voir qu'il n'y avait rien de si particulier dans la leur, rien qui me fût si étranger; mais seulement quelque chose de liant, d'obligeant et d'aimable. Il me semblait que cette politesse était celle que toute âme honnête, que tout esprit bien fait trouve qu'il a en lui, dès qu'on la lui montre.
Mais nous voici chez Mme Dorsin, aussi bien qu'aux dernières pages de cette partie de ma vie ; c'est ici où j'ai dit que je ferais le portrait de cette dame : j'ai dit aussi, ce me semble, qu'il serait long, et c'est de quoi je ne réponds plus. Peut être sera-t-il court, car je suis
lasse. Tous ces portraits me coûtent : voyons celui-ci pourtant.
Mme Dorsin était beaucoup plus jeune que ma bienfaitrice : il n'y a guère de physionomie comme la sienne; et jamais aucun visage de femme n'a tant mérité que le sien qu'on se servît de ce terme de physionomie pour le définir et pour exprimer tout ce qu'on en pensait en bien. Ce que je dis là signifie un mélange avantageux de mille choses dont je ne tenterai pas le détail. Cependant voici en gros ce que j'en puis expliquer. Mme Dorsin était belle, encore n'est-ce pas là dire ce qu'elle était; ce n'aurait pas été la première idée qu'on eût eue d'elle en la voyant; on avait quelque chose de plus pressé à sentir : voici un moyen de me faire entendre. Personnifions la beauté, et supposons qu'elle s'ennuie d'être si sérieusement belle, qu'elle veuille essayer du seul plaisir de plaire, qu'elle tempère sa beauté sans la perdre, et qu'elle se déguise en grâces; c'est à Mme Dorsin qu'elle voudra ressembler; et voilà le portrait que vous devez vous faire de cette dame. Ce n'est pas là tout; je ne parle ici que du visage, tel que vous l'auriez pu voir dans un tableau de Mme Dorsin.
Ajoutez à présent une âme qui passe à tout moment sur cette physionomie; qui va y peindre tout ce qu'elle sent; qui y répand l'air de tout ce qu'elle est; qui la rend aussi spirituelle, aussi délicate, aussi vive, aussi fière, aussi sérieuse, aussi badine qu'elle l'est tour à tour elle-même; et jugez par là des accidents de force, de grâce, de finesse, et de l'infinité des expressions rapides qu'on voyait sur ce visage.
Parlons maintenant de cette âme, puisque nous y sommes. Quand quelqu'un a peu d'esprit et de sentiment, on dit d'ordinaire qu'il a les organes épais; et un de mes amis, à qui je demandai ce que cela signifiait, me dit gravement et en termes savants : « C'est que
notre âme est plus ou moins bornée, plus ou moins embarrassée, suivant la conformation des organes auxquels elle est unie ». Et s'il m'a dit vrai, il fallait que la nature eût donné à Mme Dorsin des organes bien favorables; car jamais âme ne fut plus agile que la sienne et ne souffrit moins de diminution dans sa faculté de penser.
La plupart des femmes qui ont beaucoup d'esprit ont une certaine façon d'en avoir qu'elles n'ont pas naturellement, mais qu'elles se donnent. Celle-ci s'exprime nonchalamment et d'un air distrait, afin qu'on croie qu'elle n'a presque pas besoin de prendre la peine de penser, et que tout ce qu'elle dit lui échappe. C'est d'un air froid, sérieux et décisif, que celle-là parle, et c'est pour avoir aussi un caractère d'esprit particulier..."
Mme de Míran fait entrer Marianne comme pensionnaire dans un couvent et la considère comme sa fille. Par une très heureuse coïncidence, Mme de Míran est la mère de Valville. Celui-ci a recherché et retrouvé la jeune fille ; mais peut-il épouser une inconnue sans fortune ? Devant l'amour désespéré de son fils et le désintéressement de Marianne, Mme de Miran en arrive, après de longues hésitations, à consentir au mariage.
Mais le roman ne fait que commencer car Marivaux va accumuler à plaisir les péripéties les plus diverses, les contretemps les plus imprévisibles. La famille et les relations doivent en effet d'abord être convaincues d`accepter cette mésalliance. Puis Valville, son mariage une fois assuré, devient infidèle et s'éprend d'une autre pensionnaire du couvent. Au début de la neuvième partie, Marianne laisse la parole à une autre narratrice, la religieuse Tervire qui raconte, dans une tonalité devenue plus sombre en 1741, son existence diflîcile et sa vocation forcée. Marivaux ne reviendra pas par la suite sur l`histoire de Marianne, qui va ainsi restée en suspens....

Crébillon fils vs Marivaux - En 1732, peu de temps après que Marivaux eut commencé de publier son célèbre roman "La Vie de Marianne", Crébillon fils, l'auteur du "Sofa" résolut de taquiner un auteur qui osait raconter autre chose que des aventures d'alcôve. Il écrivit ainsi un conte quelque peu farfelu, "l'Ecumoire ou Tanzaï et Néadarné, histoire japonaise", dans lequel il s'adonnait à des allusions bien visibles à la bulle Unigenitus, au cardinal de Rohan, à la duchesse du Maine, et à de très méchantes pointes à l'égard de Marivaux. La conséquence fut pour lui d'être emprisonné quelques temps à Vincennes. Marivaux crut devoir riposter en insérant, dans l'histoire de son "Paysan parvenu", quelques allusions directes aux calembredaines dont Crébillon s'était fait une sorte de spécialité.

1734-1735 - "Le Paysan parvenu"
Etude d'ambition humaine souvent rapprochée de l'Ingénu de Voltaire, du Gil Blas de Lesage, et de Joseph Andrews ainsi qu'au Tom Jones de Fielding. C'est justement en 1735 que Lesage publia le XXIIe livre de Gil Blas. Sous l'ancien régime, un laquais pouvait arriver à tout. Jacob est né quelque part en Champagne, dans une ferme, et l'on sait que Marivaux a cultivé l'imprécision et que les descriptions semblent rapidement le désintéressaient. Jeune paysan champenois venu à Paris, d'abord valet chez un seigneur, il perd bientôt sa place. C est alors que, se promenant dans Paris, il rencontre, au coin du Pont-Neuf, Mlle Habert la cadette, tout près de se trouver mal; il lui offre ses services et la reconduit chez elle. Le voici engagé comme domestique par une Mademoiselle Habert, une dévote d'une cinquantaine d'années qui vit avec sa soeur aînée et une servante, Catherine.
Mais qu'est-ce qu'un intérieur de dévotes?
"Nous entrâmes dans une maison où tout me parut bien étoffé, et dont l'arrangement ainsi que les meubles étaient dans le goût des habits de nos dévotes. Netteté, simplicité et propreté, c'est ce qu'on y voyait. On eût dit que chaque chambre était un oratoire; l'envie d'y faire oraison prenait en y entrant; tout y était modeste et luisant, tout y invitait l'âme à y goûter la douceur d'un saint recueillement. L'autre sœur était dans son cabinet, qui, les deux mains sur les bras d'un fauteuil, s'y reposait de la fatigue d'un déjeuner qu'elle venait de faire, et en attendait la digestion en paix. Les débris du déjeuner étaient là sur une petite table; il avait été composé d'une demi-bouteille de vin de Bourgogne presque toute bue, de deux œufs frais, et d'un petit pain au lait. Je crois que ce détail n'ennuiera point; il entre dans le portrait de la personne dont je parle.
« Eh ! mon Dieu, ma sœur, vous avez été bien long temps à revenir; j'étais en peine de vous, dit celle qui était dans le fauteuil à celle qui entrait. Est-ce là le domestique qu'on devait nous donner?
— Non, ma sœur, reprit l'autre; c'est un honnête jeune homme que j'ai rencontré sur le pont Neuf, et sans lui je ne serais pas ici, car je viens de me trouver très mal; il s'en est aperçu en passant, et s'est offert pour m'aider à revenir à la maison.
— En vérité, ma sœur, reprit l'autre, vous vous faites toujours des scrupules que je ne saurais approuver. Pourquoi sortir le matin pour aller loin, sans prendre quelque nourriture? Et cela parce que vous n'aviez pas entendu la messe. Dieu exige-t-il qu'on devienne malade? Ne peut-on le servir sans se tuer? Le servirez-vous mieux quand vous aurez perdu la santé et que vous vous serez mise hors d'état d'aller à l'église? Ne faut-il pas que notre piété soit prudente? N'est-on pas obligé de ménager sa vie pour louer Dieu, qui nous l'a donnée, le plus longtemps qu'il sera possible? Vous êtes trop outrée, ma sœur, et vous devez demander conseil là-dessus.
— Enfin, ma chère sœur, reprit l'autre, c'est une chose faite. J'ai cru que j'aurais assez de force; j'avais effectivement envie de manger un morceau en partant; mais il était bien matin, et d'ailleurs j'ai craint que ce ne fût une délicatesse, et si on ne hasardait rien, on n'aurait
pas grand mérite; mais cela ne m'arrivera plus, car il est vrai que je m'incommoderais. Je crois pourtant que Dieu a béni mon petit voyage, puisqu'il a permis que j'aie rencontré ce garçon que vous voyez; l'autre est placé; il n'y a que trois mois que celui-ci est à Paris; il m'a fait son histoire; je lui trouve de très bonnes mœurs, et c est assurément la Providence qui nous l'adresse. Il veut être sage, et notre condition lui convient; que dites-vous de lui?
— Il prévient assez, répondit l'autre; mais nous parlerons de cela quand vous aurez mangé; appelez Catherine, ma sœur, afin qu'elle vous apporte ce qu'il vous faut: pour vous, mon garçon, allez dans la cuisine; vous y déjeunerez aussi. »
A cet ordre, je fis la révérence; et Catherine, qu'on avait appelée, monta. On la chargea du soin de me rafraîchir. Catherine était grande, maigre, mise blanchement, et portant sur sa mine l'air d'une dévotion revêche, en colère, et ardente; ce qui lui venait apparemment de la
chaleur que son cerveau contractait auprès du feu de sa cuisine et de ses fourneaux, sans compter que le cerveau d'une dévote, et d'une dévote cuisinière, est naturellement sec et brûlé.
Je n'en dirais pas autant de celui d'une pieuse; car il y a bien de la différence entre la véritable piété et ce qu'on appelle communément dévotion. Les dévots fâchent le monde, et les gens pieux l'édifient; les premiers n'ont que les lèvres de dévotes, c'est le cœur qui l'est dans les autres; les dévots vont à l'église simplement pour y aller, pour avoir le plaisir de s'y trouver, et les pieux pour y prier Dieu; ces derniers ont de l'humilité, les dévots n'en veulent que dans les autres. Les uns sont de vrais serviteurs de Dieu, les autres n'en ont que la contenance. Faire oraison pour se dire : « Je la fais » ; porter à l'église des livres de dévotion pour les manier, les ouvrir et les lire; se retirer dans un coin, s'y tapir, pour y jouir superbement d'une posture de méditatifs; s'exciter à des transports pieux, afin de croire qu'on a une âme bien distinguée si on en attrape; en sentir en effet quelques-uns que l'ardente vanité d'en avoir fait naître, et que le diable, qui ne les laisse manquer de rien pour les tromper, leur donne ; revenir de là tout gonflé de respect pour soi-même, et d'une orgueilleuse pitié pour les âmes ordinaires ; s'imaginer ensuite qu'on a acquis le droit de se délasser de ses saints exercices par mille petites mollesses qui soutiennent une santé délicate : tels sont ceux que j'appelle des dévots, de la dévotion desquels le malin esprit a tout le profit, comme on le voit bien. A l'égard des personnes véritablement pieuses, elles sont aimables pour les méchants mêmes, qui s'en accommodent bien mieux que de leurs pareils; car le plus grand ennemi du méchant, c'est celui qui lui ressemble. Voilà, je pense, de quoi mettre mes pensées sur les dévots à l'abri de toute censure.
Revenons à Catherine, à l'occasion de qui j'ai dit cela. Catherine donc avait un trousseau de clefs à sa ceinture, comme une tourière de couvent. « Apportez des œufs frais à ma sœur, qui est à jeun à l'heure qu'il est, lui dit Mlle Habert, sœur aînée de celle avec qui j'étais
venu, et menez ce garçon dans votre cuisine pour lui faire boire un coup. — Un coup! répondit Catherine, d'un ton brusque et pourtant de bonne humeur; il en boira bien deux à raison de sa taille. — Et tous les deux à votre santé, madame Catherine, lui dis-je.
— Bon, reprit-elle; tant que je me porterai bien, ils ne me feront pas mal. Allons, venez; vous m'aiderez à faire cuire mes œufs.
— Eh! non, Catherine, ce n'est pas la peine, dit Mlle Habert la cadette; donnez-moi le pot de confitures, ce sera assez.
— Mais, ma sœur, cela ne nourrit point, dit l'aînée.
— Les œufs me gonfleraient », dit la cadette; et puis ma sœur par-ci, ma sœur par-là. Catherine, d'un geste sans appel, décida pour les œufs en s'en allant, à cause, dit-elle, qu'un déjeuner n'était pas un dessert.
Pour moi, je la suivis dans sa cuisine, où elle me mit aux mains, avec un reste de ragoût de la veille et des volailles froides, une bouteille de vin presque pleine, et du pain à discrétion.
Ah ! le bon pain Je n'en ai jamais mangé de meilleur, de plus blanc, de plus ragoûtant; il faut bien des attentions pour faire un pain comme celui-là ; il n'y avait qu'une main dévote qui pût l'avoir pétri; aussi était-il de la façon de Catherine. L'excellent repas que je fis! La vue seule de la cuisine donnait envie de manger; tout y faisait entrer en goût.
« Mangez, me dit Catherine en se mettant après ses œufs frais; Dieu veut qu'on vive.
— Voilà de quoi faire sa volonté, lui dis-je, et par-dessus le marché j'ai grande faim. — Tant mieux, reprit-elle; mais dites-moi, êtes-vous retenu? Restez-vous avec nous? — Je l'espère ainsi, répondis-je, et je serais bien fâché que cela ne fût pas; car je m imagine qu'il fait bon sous votre direction, madame Catherine. Vous avez l'air-si avenant, si raisonnable! — Eh! eh! reprit-elle, je fais du mieux que je peux; que le ciel nous assiste! Chacun a ses fautes, et je n 'en chôme pas ; et le pis est, c'est que la vie se passe, et plus l'on va, plus on se crotte; car le diable est toujours après nous, l'Église le dit; mais on bataille. Au
surplus, je suis bien aise que nos demoiselles vous prennent; car vous me paraissez de bonne amitié. Hélas! tenez, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à défunt Baptiste, que j'ai pensé épouser; c'était bien le meilleur enfant, et il était beau mais garçon comme vous; ce n'est pas là ce que j'y regardais, quoique cela fasse toujours plaisir. Dieu nous l'a ôté, il est le maître, il n'y a point à le contrôler; mais vous avez toute son apparence, vous parlez tout comme lui; mon Dieu! qu'il m 'aimait! Je suis bien changée depuis, sans ce que je
changerai encore; je m'appelle toujours Catherine; mais ce n'est plus de même.
— Ma foi! lui dis-je, si Baptiste n'était pas mort, il vous aimerait encore; car moi qui lui ressemble, je n'en ferais pas à deux fois. — Bon! bon! me dit-elle en riant, je suis encore un bel objet! Mangez, mon fils, mangez; vous direz mieux quand vous m'aurez regardée de plus
près. Je ne vaux plus rien qu'à faire mon salut, et c'est bien de la besogne; Dieu veuille que je l'achève! »
En disant ces mots, elle tira ses œufs, que je voulus porter en haut. « Non, non, me dit-elle; déjeunez en repos, afin que cela vous profite; je vais voir un peu ce qu'on pense de vous là-haut; je crois que vous êtes notre fait, et j'en dirai mon avis; nos demoiselles ordinairement sont dix ans à savoir ce qu'elles veulent, et c'est moi qui ai la peine de vouloir pour elles. Mais ne vous embarrassez pas, j'aurai soin de tout; je me plais à servir mon prochain, et c'est ce qu'on nous recommande au prône.
— Je vous rends mille grâces, madame Catherine, lui dis-je, et surtout souvenez-vous que je suis un prochain qui ressemble à Baptiste. — Mais mangez donc, me dit-elle; c'est le moyen de lui ressembler longtemps en ce monde; j'aime un prochain qui dure, moi.
— Et je vous assure que votre prochain aime à durer », lui dis-je en la saluant d'un rouge-bord que je bus à sa santé.
Ce fut là le premier essai que je fis du commerce de Mme Catherine, des discours de laquelle j'ai retranché une centaine de Dieu soit béni! et que le ciel nous assiste! qui servaient tantôt de refrain, tantôt de véhicule à ses discours. Apparemment cela faisait partie de sa dévotion verbale; mais peu m'importait, ce qui est sûr, c'est que je ne déplus point à la bonne dame, non plus qu'à ses maîtresses, surtout à Mlle Habert la cadette, comme on le verra dans la suite.
J'achevai de déjeuner en attendant la réponse que m'apporterait Catherine. Elle descendit bientôt, et me dit : "Allons, notre ami, il ne vous manque plus que votre bonnet de nuit, attendu que votre gîte est ici. — Le bonnet de nuit, nous l'aurons bientôt, lui dis-je; pour mes pantoufles, je les porte actuellement. — Fort bien, mon gaillard, me dit-elle; allez donc quérir vos hardes afin de revenir dîner; pendant que vous déjeuniez, vos gages couraient; c'est moi qui l'ai conclu. — Courent-ils en bon nombre? repris-je. — Oui, oui, me dit-elle en riant; je t'entends bien, et ils vont un train fort honnête. — Je m'en fie bien à vous, répondis-je; je ne veux pas seulement y regarder; et je vais gager que je suis mieux que je ne mérite, grâce à vos bons soins. — Ah! le bon apôtre; me dit-elle, toute réjouie de la franchise
que je mettais dans mes louanges; c'est Baptiste tout revenu; il me semble que je l'entends.
Alerte, alerte, j'ai mon dîner à faire; ne m'amuse pas, laisse-moi travailler et cours chercher ton équipage; es-tu revenu? — Autant vaut, lui dis-je en sortant; j'aurai bientôt fait; il ne faut point de mulets pour amener mon bagage. »
Et cela dit, je me rendis à mon auberge. Je fis pourtant en chemin quelques réflexions pour savoir si je devais entrer dans cette maison. « Mais, me disais-je, je ne cours aucun risque; il n'y aura qu'à déloger si je ne suis pas content. En attendant, le déjeuner m'est de bon augure; il me semble que la dévotion de ces gens-ci ne compte pas ses morceaux et n'est pas entêtée d'abstinence. D'ailleurs toute la maison me fait bonne mine; on n'y hait pas les gros garçons de mon âge; je suis déjà dans la faveur de la cuisinière; voilà déjà mes quatre repas assurés, et le cœur me dit que tout ira bien ; courage ! »
Je me trouvai à la porte de mon auberge en raisonnant ainsi; je n'y devais rien que le bonsoir à mon hôtesse, et puis je n'avais qu'à décamper avec mon paquet. Je fus de retour à la maison au moment qu'on allait se mettre à table. Malepeste! le succulent petit dîner! Voilà ce qu'on appelle du potage, sans parler d'un petit plat de rôt d'une finesse, d'une cuisson si parfaite!... Il fallait avoir l'âme bien à l'épreuve du plaisir que peuvent donner les bons morceaux, pour ne pas donner dans le péché de friandise en mangeant de ce rôt-là, et puis de ce ragoût; car il y en avait un d'une délicatesse d'assaisonnement que je n'ai jamais rencontrée nulle part. Si l'on mangeait au ciel, je ne voudrais pas y être mieux servi; Mahomet, de ce repas-là, aurait pu faire une des joies de son paradis. Nos dames ne mangeaient point de bouilli; il ne faisait que paraître sur la table, et puis on l'ôtait pour le donner aux pauvres. Catherine, à son tour, s'en passait, disait-elle, par charité pour eux; et je consentis sur-le-champ à devenir aussi charitable qu'elle. Rien n'est tel que le bon exemple.
Je sus, depuis, que mon devancier n'avait pas eu comme moi part à l'aumône, parce qu'il était trop libertin pour mériter de la faire et pour être réduit au rôt et au ragoût.
Je ne sais pas au reste comment nos deux sœurs faisaient en mangeant; mais assurément c'était jouer des gobelets que de manger ainsi. Jamais elles n'avaient d'appétit, du moins on ne voyait point celui qu'elles avaient; il escamotait les morceaux; ils disparaissaient, sans qu'il parût presque y toucher. On voyait ces dames se servir négligemment de leurs fourchettes; à peine avaient-elles la force d'ouvrir la bouche; elles jetaient des regards indifférents sur ce bon vivre. « Je n'ai point de goût aujourd'hui... — Ni moi non plus... — Je trouve tout fade... — Et moi tout trop salé. » Ces discours-là me jetaient de la poudre aux yeux; de manière que je croyais voir les créatures les plus dégoûtées du monde; et cependant le résultat de toutes leurs façons était que les plats se trouvaient si considérablement diminués quand on desservait, que je ne savais d'abord comment ajuster tout cela.
Mais je vis à la fin de quoi j'avais été dupe; c'était de ces airs de dégoût que marquaient nos maîtresses et qui m'avaient caché la sourde activité de leurs dents. Le plus plaisant, c'est qu'elles s'imaginaient elles-mêmes être de très petites, de très sobres mangeuses. Et comme il n'était pas décent que des dévotes fussent gourmandes; qu'il faut se nourrir pour vivre, et non pas vivre pour manger; que, malgré cette maxime raisonnable et chrétienne, leur appétit glouton ne voulait rien perdre, elles avaient trouvé le secret de la gloutonnerie; et c'était par le moyen de ces apparences de dédain pour les viandes, c'était par l'indolence avec laquelle elles y touchaient, qu'elles se persuadaient être sobres, en se conservant le plaisir de ne pas l'être ; c'était à la faveur de cette singerie que leur dévotion laissait
innocemment le champ libre à l'intempérance. Il faut avouer que le diable est bien fin, mais aussi que nous sommes bien sots. Le dessert fut à l'avenant du repas : confitures sèches et liquides; et sur le tout de petites liqueurs, pour aider la digestion et pour ravigoter ce goût si mortifié.
Après quoi, Mlle Habert l'aînée disait à la cadette: « Allons, ma sœur, remercions Dieu.
— Cela est bien juste », répondait l'autre avec une plénitude de reconnaissance qu'alors elle aurait assurément eu tort de disputer à Dieu. «Cela est bien juste », disait-elle donc; et puis les deux sœurs, se levant de leurs sièges avec un recueillement qui était de la meilleure foi du monde et qu'elles croyaient aussi méritoire que légitime, joignaient posément les mains pour faire une prière commune, où elles se répondaient par versets l'une à l'autre avec des tons que le sentiment de leur bien-être rendait extrêmement pathétiques. Ensuite on ôtait le couvert; elles se laissaient aller dans un fauteuil, dont la mollesse et la profondeur invitaient au repos; et là on s'entretenait de quelques réflexions qu'on avait faites d'après de saintes lectures, ou bien d'un sermon du jour ou de la veille, dont elles trouvaient le sujet admirablement convenable pour monsieur ou pour madame une telle. Ce sermon-là n'était fait que pour eux; l'avarice, l'amour du monde, l'orgueil et d'autres imperfections y avaient été si bien débattus !
« Mais, disait l'une, comment peut-on assister à la sainte parole de Dieu, et n'en pas revenir avec dessein de se corriger? Ma sœur, comprenez-vous quelque chose à cela? Mme une telle, qui pendant le carême est venue assidûment au sermon, comment l'entend-elle? Je lui vois toujours le même air de coquetterie; et à propos de coquetterie, mon Dieu! que je fus scandalisée l'autre jour de la manière indécente dont Mlle *** était vêtue! Peut-on venir à l'église en cet état-là? Je vous dirai qu'elle me donna une distraction dont je demande
pardon à Dieu, et qui m'empêcha de dire mes prières. En vérité, cela est effroyable!
- Vous avez raison, ma sœur, répondait l'autre; mais quand je vois de pareilles choses, je baisse les yeux; et la colère que j'en ai fait que je refuse de les voir, et que je loue Dieu de la grâce qu'il m'a faite de m'avoir du moins préservée de ces péchés-là, en le priant de tout
mon cœur de vouloir bien éclairer de sa grâce les personnes qui les commettent. »
(Première Partie).
L'épisode du directeur de conscience.
"Je faisais ma révérence à Mlle Habert pour descendre dans ma cuisine, quand un ecclésiastique entra dans la chambre. C'était le directeur ordinaire de ces dames; je dis ordinaire, parce qu'elles étaient amies de plusieurs autres ecclésiastiques qui leur rendaient visite et avec qui, par surcroît, elles s'entretenaient aussi des affaires de leur conscience. Pour celui-ci, il en avait la direction en chef ; c'était l'arbitre de leur conduite.
Encore une fois, que tout ce que je dis là ne scandalise personne et n'induise pas à penser que je raille indirectement l'usage où l'on est de donner sa conscience à gouverner à ce qu'on appelle des directeurs et de les consulter sur toutes ses actions. Cet usage est sans doute louable et saint en lui-même; c'est bien fait de le suivre, quand on le suit comme il faut, et ce n'est pas de cela que je badine; mais il y a des minuties dont les directeurs ne devraient pas se mêler aussi sérieusement qu'ils le font, et je ris de ceux qui portent leur direction jusque-là.
Ce directeur-ci était un assez petit homme, mais bien fait dans sa taille un peu ronde ; il avait le teint frais, d'une fraîcheur reposée ; l'œil vif, mais de cette vivacité qui n'a rien d'étourdi ni d'ardent. N'avez-vous jamais vu de ces visages qui annoncent dans ceux qui les ont je ne sais quoi d'accommodant, d'indulgent et de consolant pour les autres, et qui sont comme les garants d'une âme remplie de douceur et de charité? C'était là positivement la mine de notre directeur. Du reste, imaginez-vous de courts cheveux dont l'un ne passe l'autre, qui siéent on ne peut mieux et qui se relèvent en demi-boucles autour des joues par un tour qu'ils prennent naturellement et qui ne doit rien au soin de celui qui les porte; joignez à cela des lèvres assez vermeilles, avec de belles dents qui ne sont belles et blanches à leur tour
que parce qu'elles se trouvent heureusement ainsi sans qu'on y touche. Tels étaient les agréments, soi-disant innocents, de cet ecclésiastique, qui dans ses habits n'avait pas oublié que la religion même veut qu'on observe sur soi une propreté modeste, afin de ne choquer les yeux de personne. Il excédait seulement un peu cette propreté de devoir; mais il est bien difficile d'en trouver le point juste; de sorte que notre ecclésiastique, contre son intention sans doute, avait été jusqu'à l'ajustement.
Mlle Habert l'aînée, qui s'était assoupie, devina plus son arrivée qu'elle ne l'entendit; car il ne fit pas grand bruit en entrant; mais une dévote en pareil cas a l'ouïe bien subtile. Celle-ci se réveilla sur-le-champ en souriant de la bonne fortune qui lui venait en dormant; j'entends une bonne fortune toute spirituelle.
Cet ecclésiastique, pour qui j'étais un visage nouveau, me regarda avec assez d'attention.
« Est-ce là votre domestique, mesdames? leur dit-il. — Oui, monsieur; c'est un garçon que nous avons d'aujourd'hui, répondit l'aînée ; et c'est un service qu'il a rendu à ma sœur qui en est cause. » Là-dessus elle se mit à lui conter ce qui m'était arrivé avec sa cadette, et moi je jugeai à propos de sortir pendant l'histoire. Quand je fus au milieu de l'escalier, songeant aux regards que ce directeur avait jetés sur moi, il me prit envie de savoir ce qu'il en dirait. Catherine m'attendait pourtant dans sa cuisine; mais n'importe, je remontai doucement l'escalier. J'avais fermé la porte de la chambre, et j'en approchai mon oreille le plus près qu'il me fut possible.
Mon aventure avec Mlle Habert la cadette fut bientôt racontée; de temps en temps je regardais à travers la serrure; et de la manière dont le directeur était placé, je voyais son visage en plein, aussi bien que celui de la sœur cadette.
Je remarquai qu'il écoutait le récit qu'on lui faisait d'un maintien froid, pensif, et tirant sur l'austère. Ce n'était plus cette physionomie si douce, si indulgente qu'il avait, quand il était entré dans la chambre; il ne faisait pas encore la mine ; mais je devinais qu'il allait la faire, et que mon aventure allait devenir un cas de conscience.
Quand il eut tout entendu, il baissa les yeux en homme qui va porter un jugement de conséquence, et donner le résultat d'une réflexion profonde. Et puis : «Vous avez été bien vite, mesdames», dit-il en les regardant toutes deux avec des yeux qui rendaient le cas grave et important, et qui disposaient mes maîtresses à le voir presque traiter de crime.
A ces premiers mots qui ne me surprirent point, car je ne m'attendais pas à mieux, la sœur cadette rougit, prit un air embarrassé, mais à travers lequel on voyait du mécontentement.
« Vous avez été bien vite, reprit-il encore une fois. — Eh! quel mal peut-il y avoir là dedans, reprit cette cadette d'un ton à demi timide et révolté, si c'est un honnête garçon, comme il y a lieu de le penser? Il a besoin de condition, je le trouve en chemin, il me rend un service, il me reconduit ici; il nous manque un domestique et nous le prenons; quelle offense peut-il y avoir là contre Dieu? J'ai cru faire au contraire, une action de charité et de reconnaissance.
— Nous le savons bien, ma sœur, répondit l'aînée ; mais n'importe; puisque monsieur, qui est plus éclairé que nous, n'approuve pas ce que nous avons fait, il faut se rendre. A vous dire la vérité, tantôt, quand vous m'avez parlé de garder ce jeune homme, il me semble
que j'y ai senti quelque répugnance; j'ai eu un pressentiment que ce ne serait pas l'avis de monsieur, et Dieu sait que j'ai remis le tout à sa décision. »
Ce discours ne persuadait pas la cadette, qui n'y répondait que par des mines qui disaient toujours : « Je n'y vois point de mal. »
Le directeur avait laissé parler l'aînée sans l'interrompre, et semblait même un peu piqué de l'obstination de l'autre. Prenant pourtant un air tranquille et bénin : « Ma chère demoiselle, écoutez-moi, dit-il à cette cadette. Vous savez avec quelle affection particulière je vous
donne mes conseils à toutes deux. » Ces dernières paroles, à toutes deux, furent partagées
de façon que la cadette en avait pour le moins les trois quarts et demi pour elle, et ce ne fut même que par réflexion subite qu'il en donna le reste à l'aînée ; car, dans son premier mouvement, l'homme saint n'avait point du tout songé à elle. — « Vraiment, dit l'aînée, qui sentit cette inégalité de partage, et l'oubli qu'on avait d'abord fait d'elle; vraiment, monsieur, nous savons bien que vous nous considérez toutes deux l'une autant que l'autre, et que votre piété n'admet point de préférence, comme cela est juste.»
Le ton de ce discours fut un peu aigre, quoique prononcé en riant, de peur qu'on n'y vit de la jalousie. — « Hélas! ma soeur, reprit la cadette un peu vivement, je ne l'entends pas autrement non plus; et quand même monsieur serait plus attaché à vous qu'à moi, je n'y trouverais rien à redire; il vous rendrait justice; il connaît le fond de votre âme et les grâces que Dieu vous fait, et vous êtes assurément bien plus digne de son attention que moi.
— Mes chères sœurs, leur répondit là-dessus cet ecclésiastique qui voyait que ce petit débat venait par sa faute, ne vous troublez point; vous m'êtes égales devant Dieu parce que vous l'aimez également toutes deux; et si mes soins avaient à se fixer plus sur l'une que sur l'autre, ce serait en faveur de celle que je verrais marcher le plus lentement dans la voie de son salut; sa faiblesse m'y attacherait davantage, parce qu'elle aurait-plus besoin de secours; mais, grâce au ciel, vous marchez toutes deux du même pas; aucune de vous ne reste en arrière, et ce n'est pas cela dont il s 'agit. Nous parlons du jeune homme que vous avez retenu (cette jeunesse lui tenait au cœur); vous n'y voyez point de mal, j'en suis persuadé; mais daignez m'entendre.»
Là il fit une petite pause comme pour se recueillir. Et puis continuant : « Dieu, par sa bonté, ajouta-t-il, permet souvent que ceux qui nous conduisent aient des lumières qu'il nous refuse; et c'est afin de nous montrer qu'il ne faut pas nous en croire, et que nous nous égarerions si nous n'étions pas dociles. « De quelle conséquence est-il, me dites-vous, d'avoir retenu ce garçon qui paraît sage? D'une très sérieuse conséquence. « Premièrement, c'est avoir agi contre la prudence humaine; car enfin, vous ne le connaissez que de
l'avoir rencontré dans la rue. Sa physionomie vous paraît bonne, et je le veux; chacun a ses yeux là-dessus, et les miens ne lui sont pas tout à fait aussi favorables; mais je vous passe cet article. Eh bien! depuis quand, sur la seule physionomie, fie-t-on son bien et sa vie à des inconnus? Quand je dis son bien et sa vie, je n'exagère pas à votre égard. Vous n'êtes que trois filles toutes seules dans une maison; que ne risquezvous pas, si cette physionomie vous trompe, si vous avez affaire à un aventurier, comme cela peut arriver?
Qui vous a répondu de ses mœurs, de sa religion, de son caractère? Un fripon ne peut-il pas avoir la mine d'un honnête homme? A. Dieu ne plaise que je le soupçonne de l'être, un fripon; la charité veut qu'on pense à son avantage; mais la charité ne doit pas aller jusqu'à l'imprudence, et c'en est une que de s 'y fier comme vous faites.
— Ah ! ma sœur, ce que monsieur dit est sensé ! s'écria l'aînée à cet endroit. Effectivement ce garçon a d'abord quelque chose qui prévient; mais monsieur a raison pourtant, à présent que j'y songe; il a un je ne sais quoi dans le regard, qui a pensé m 'arrêter, moi qui vous parle.
— Encore un mot, ajouta l'ecclésiastique en l 'interrompant; vous approuvez ce que j'ai dit, et ce n'est pourtant rien en comparaison de ce que j 'ai à vous dire. « Ce garçon est dans la première jeunesse, il a l'air hardi et dissipé ; vous n'êtes pas encore dans un âge à l'abri de la censure ; ne craignez-vous point les mauvaises pensées qui peuvent venir là-dessus à ceux qui le verront chez vous? Ne savez-vous pas que les hommes se scandalisent aisément, et que c'est un malheur terrible que d'induire son prochain au moindre scandale? Ce n'est point moi qui vous le dis, c est l Évangile. D'ailleurs, mes chères sœurs (car il faut tout dire), nous-mêmes ne sommes-nous pas faibles? Que faisons-nous dans la vie, que combattre incessamment contre nous, que tomber, que nous relever? Je dis dans les moindres petites choses ; et cela ne doit-il pas nous faire trembler? Ah! croyez-moi, n allons point, dans l'affaire de notre salut, chercher de nouvelles difficultés à vaincre; ne nous exposons point à de nouveaux sujets de faiblesse. Cet homme-ci est trop jeune; vous vivriez avec lui, vous le verriez presque à tout moment; la racine du péché est toujours en nous, et je me défie déjà (je suis obligé de vous le dire en conscience), je me défie déjà de la bonne opinion que vous avez de lui, de cette affection obstinée que vous avez déjà prise pour lui; elle est innocente, le sera-t-elle toujours? Encore une fois, je m'en défie. J'ai vu Mlle Habert, ajouta-t-il en regardant la sœur cadette, n'être pas contente des sentiments que j'ai d'abord marqués là-dessus; d'où vient cet entêtement dans son sens, cet éloignement pour mes idées, elle que je n'ai jamais vue résister un instant aux conseils que ma conscience m'a dictés pour la sûreté de la sienne? Je n'aime point cette disposition d'esprit-là, elle m'est suspecte; on dirait que c'est un piège que le démon lui tend; et, dans cette occurrence, je suis obligé de vous exhorter à renvoyer ce jeune homme, dont la mine, au surplus, ne me revient point autant qu'à vous; et je me charge de vous donner un domestique de ma main. C'est un peu d'embarras pour moi, mais Dieu m'inspire de le prendre; et je vous conjure, en son nom, de vous laisser conduire. Me le promettez-vous?
— Pour moi, monsieur, dit l'aînée avec un entier abandon à ses volontés, je vous réponds que vous êtes le maître, et vous verrez quelle est ma soumission; car, dès cet instant, je m'engage à n'exiger aucun service du jeune homme en question et je ne doute pas que ma
sœur ne m'imite.
— En vérité, reprit la cadette avec un visage presque enflammé de colère, je ne sais comment prendre tout ce que j'entends. Voilà déjà ma sœur liguée contre moi ! la voilà charmée du tort imaginaire qu'on me donne! et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est de cette façon-là à mon égard, puisqu'il faut le dire, et que la façon dont on me parle m'y force. Elle ne doute pas, dit-elle, que je ne me conforme à sa conduite; eh je n'ai jamais fait autre chose depuis que nous vivons ensemble ; il a toujours fallu plier sous elle pour avoir la paix. Dieu sait, sans reproche, combien de fois je lui ai sacrifié ma volonté, qui n'avait pourtant point d'autre défaut que de n'être pas la sienne! et franchement, je commence à me lasser de cette sujétion que je ne lui dois point. Oui, ma sœur; vous ferez de ce que je vous dis l'usage qu'il vous plaira; mais vous avez l'humeur haute, et c'est cette humeur-là dont il serait à propos que monsieur s'alarmât pour vous, et non pas de l'action que j'ai faite en amenant ici un pauvre garçon à qui j'ai peut-être obligation de la vie, et qu'on veut que j'en récompense en le chassant, après que nous lui avons toutes deux donné parole de le garder. Monsieur m'objecte qu'il n'a point de répondant; mais ce jeune homme m'a dit qu'il en trouverait, si nous en voulions : ainsi cette objection tombe. Quant à moi, à qui il a rendu un si grand service, je ne lui dirai point de s'en aller, ma sœur : je ne saurais.
— Eh! ma sœur, reprit l'aînée, je me charge, si vous me le permettez, de le congédier pour vous, sans que vous vous en mêliez ; avec promesse, de ma part, de réparer mes hauteurs passées par une condescendance entière pour vos avis, quoique vous ne soyez que ma
cadette. Si vous aviez eu la charité de m'avertir de mes défauts, je m'en serais peut-être corrigée avec l'aide de Dieu, et des prières de monsieur, qui ne m'a pourtant jamais reprise de cette hauteur dont vous parlez; mais comme vous avez plus d'esprit qu'une autre, plus de pénétration, vous ne sauriez vous être trompée, et je suis bien heureuse que vous aperceviez en moi ce qui est échappé à la prudence de monsieur même.
— Je ne suis pas venu ici, dit alors l'ecclésiastique en se levant d'un air dépité, pour semer la zizanie entre vous, mademoiselle; et, dès que je laisse subsister les défauts de mademoiselle votre sœur, que je ne suis pas assez éclairé pour les voir, que d'ailleurs mes avis sur votre conduite ne vous paraissent pas justes, je conclus que je vous suis inutile, et qu'il faut que je me retire.
— Comment! monsieur, vous retirer! s'écria l'aînée; ah ! monsieur, mon salut m'est encore plus cher que ma sœur, et je sens bien qu'il n'y a qu'avec un aussi saint homme que vous que je le puis faire. Vous retirer, mon Dieu! non, monsieur; c'est d'avec ma sœur qu'il faut-que je me retire. Nous pouvons vivre séparément l'une de l'autre; elle n'a que faire de moi, ni moi d'elle ; qu'elle reste, je lui cède cette maison-ci, et je vais de ce pas m'en chercher une autre où j'espère de votre piété que vous voudrez bien me continuer les visites que vous nous rendiez ici. Eh! juste ciel! où en sommes-nous?»
L'ecclésiastique ne répondit rien à ce dévot et tendre emportement qu'on marquait en sa faveur. Ne conserver que l'aînée, c'était perdre beaucoup. Il me sembla qu'il était extrêmement embarrassé; et comme la scène menaçait de devenir bruyante par les larmes que l'aînée commençait à répandre et par les éclats de voix dont elle remplissait la chambre, je quittai mon poste et descendis vite dans la cuisine, où il y avait près d'un quart d'heure que Catherine m'attendait pour le dîner.
Je n'ai que faire, je pense, d'expliquer pourquoi le directeur opinait sans quartier pour ma sortie. Il leur avait dit dans son sermon qu'il était indécent que je demeurasse avec elles; mais je crois qu'il aurait passé là-dessus, qu'il n'y aurait pas même songé, sans un autre motif
que voici : c'est qu'il voyait la sœur cadette obstinée à me garder; cela pouvait signifier qu'elle avait du goût pour moi ; ce goût pour moi aurait pu la dégoûter d'être dévote, et puis d'être soumise; adieu l'autorité du directeur, et on aime à gouverner les gens. Il y a bien de la douceur à les voir obéissants et attachés; à être leur roi, pour ainsi dire, et un roi souvent d'autant plus chéri, qu'il est inflexible et rigoureux." (Seconde Partie.)
A la suite de cette discussion, Mlle Habert, la cadette, veut se séparer de sa sœur, et vivre seule. Accompagnée de Jacob, elle se met en quête d'un logement et trouve son bonheur chez Mme d'Alain. Elle fait passer, dans un premier temps, le beau Jacob pour son cousin qu'elle présente du nom de M. de La Vallée. La voici rapidement résolue à l'épouser secrètement et se confie à la logeuse pour qu'elle fasse venir un prêtre complaisant. Mais le prêtre se révèle être le fameux directeur de conscience évoqué précédemment et bien-entendu le projet de mariage échouera....
L'aventure se poursuit. Après avoir séduit une jeune chambrière dont il dissipa les économies, Jacob trouva donc sur son chemin une vieille fille de cinquante ans, fort dévote, fort riche, à laquelle il plut par sa jeunesse et par sa verdeur. Il ne craignit pas de se marier avec elle pour avoir de l'argent. « Bah! songeait-il avec philosophie, la vif se passe, et plus on va plus on se crotte. » Lorsqu'on est résigné à se crotter par monts et par vaux, on peut en effet aller très loin. Jacob ne se contente pas d'épouser un sac d'écus. Il profite de cette aubaine pour se divertir. La disproportion d'âge entre deux époux excuse l'infidélité. Jacob suivant cette maxime fait la cour à une dame. Mais il est trompé par cette dame , et cette expérience lui enlève les derniers vestiges de la confiance qu'il accordait au genre humain. Guéri des amourettes, notre héros se pousse dans les antichambres et dans les cabinets des ministres. Sa fortune est désormais établie. Le voilà contrôleur général des fermes en Champagne, fermier-général et seigneur de ce même village d'où il était sorti en sabots. Et le roman s'achève par des peintures édifiantes. Jacob, n'ayant plus rien à désirer, devient respectable....

1737 – "Les Fausses confidences"
Comédie en trois actes et la dernière des grandes pièces de Marivaux, représentée pour la première fois à Paris par les Comédiens italiens le 16 mars 1737. On y côtoie les réticences du cœur et de la raison, les souffrances nées de situations ambiguës et des silences forcés, avec pour tirer les ficelles de la comédie les ruses d'un valet. Dorante est un jeune bourgeois de belle mine. mais sans fortune. Amoureux fou d'Araminte. veuve fort riche, il se fait engager comme son intendant sur la recommandation de son oncle et avec l'appui de la suivante Marton, la grande sacrifiée de la comédie, à qui il se trouve fiancé à son entrée dans la maison par un quiproquo qu`il accepte. Il retrouve chez Araminte un de ses anciens valets, Dubois. qui se charge de mener l'intrigue en sa faveur. Dubois instruit Araminte qu'elle est aimée de son intendant, mais qu`elle ne doit pas s'attendre à un aveu, car celui-ci la respecte infiniment; puis il répand la nouvelle de cette passion grâce à des "confidences" forgées et des situations embarrassantes toutes construites. Araminte lutte contre ses sentiments naissants, refusant de s`avouer l'attirance qu'elle éprouve pour le jeune homme. Elle se heurte à son entourage, à sa mère qui voudrait la voir épouser un comte. Souhaitant que Dorante s'exprime enfin, elle le contraint dans une scène cruelle (scène XIII) pour tous deux à écrire de sa part un billet au comte dans lequel elle accepte sa main. Dorante souffre, mais ne se dévoile pas...
Scène XIII, Dorante, Araminte, Dubois
Dubois, sortant, et en passant auprès de Dorante, et rapidement. − Il m'est impossible de l'instruire ; mais qu'il se découvre ou non, les choses ne peuvent aller que bien.
Dorante. − Je viens, Madame, vous demander votre protection. Je suis dans le chagrin et dans l'inquiétude : j'ai tout quitté pour avoir l'honneur d'être à vous, je vous suis plus attaché que je ne puis le dire ; on ne saurait vous servir avec plus de fidélité ni de désintéressement ; et cependant je ne suis pas sûr de rester. Tout le monde ici m'en veut, me persécute et conspire pour me faire sortir. J'en suis consterné ; je tremble que vous ne cédiez à leur inimitié pour moi, et j'en serais dans la dernière affliction.
Araminte, d'un ton doux. − Tranquillisez−vous ; vous ne dépendez point de ceux qui vous en veulent ; ils ne vous ont encore fait aucun tort dans mon esprit, et tous leurs petits complots n'aboutiront à rien ; je suis la maîtresse.
Dorante, d'un air bien inquiet. − Je n'ai que votre appui, Madame.
Araminte. − Il ne vous manquera pas ; mais je vous conseille une chose : ne leur paraissez pas si alarmé, vous leur feriez douter de votre capacité, et il leur semblerait que vous m'auriez beaucoup d'obligation de ce que je vous garde.
Dorante. − Ils ne se tromperaient pas, Madame ; c'est une bonté qui me pénètre de reconnaissance.
Araminte. − A la bonne heure ; mais il n'est pas nécessaire qu'ils le croient. Je vous sais bon gré de votre attachement et de votre fidélité ; mais dissimulez−en une partie, c'est peut-être ce qui les indispose contre vous. Vous leur avez refusé de m'en faire accroire sur le chapitre du procès ; conformez-vous à ce qu'ils exigent ; regagnez-les par là, je vous le permets : l'événement leur persuadera que vous les avez bien servis ; car toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le Comte.
Dorante, d'un ton ému. − Déterminée, Madame !
Araminte. − Oui, tout à fait résolue. Le Comte croira que vous y avez contribué ; je le lui dirai même, et je vous garantis que vous resterez ici ; je vous le promets. (A part.) Il change de couleur.
Dorante. − Quelle différence pour moi, Madame !
Araminte, d'un air délibéré. − Il n'y en aura aucune, ne vous embarrassez pas, et écrivez le billet que je vais vous dicter ; il y a tout ce qu'il faut sur cette table.
Dorante. − Et pour qui, Madame ?
Araminte. − Pour le Comte, qui est sorti d'ici extrêmement inquiet, et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. (Dorante reste rêveur, et par distraction ne va point à la table.) Eh ! vous n'allez pas à la table ? A quoi rêvez−vous ?
Dorante, toujours distrait. − Oui, Madame.
Araminte, à part, pendant qu'il se place. − Il ne sait ce qu'il fait ; voyons si cela continuera.
Dorante, à part, cherchant du papier. − Ah ! Dubois m'a trompé !
Araminte, poursuivant. − Etes−vous prêt à écrire ?
Dorante. − Madame, je ne trouve point de papier.
Araminte, allant elle−même. − Vous n'en trouvez point ! En voilà devant vous.
Dorante. − Il est vrai.
Araminte. − Ecrivez. Hâtez−vous de venir, Monsieur ; votre mariage est sûr... Avez−vous écrit ?
Dorante. − Comment, Madame ?
Araminte. − Vous ne m'écoutez donc pas ? Votre mariage est sûr ; Madame veut que je vous l'écrive, et vous attend pour vous le dire. (A part.) Il souffre, mais il ne dit mot ; est-ce qu'il ne parlera pas ? N'attribuez point cette résolution à la crainte que Madame pourrait avoir des suites d'un procès douteux.
Dorante. − Je vous ai assuré que vous le gagneriez, Madame : douteux, il ne l'est point.
Araminte. − N'importe, achevez. Non, Monsieur, je suis chargé de sa part de vous assurer que la seule justice qu'elle rend à votre mérite la détermine.
Dorante, à part. − Ciel ! je suis perdu. (Haut.) Mais, Madame, vous n'aviez aucune inclination pour lui.
Araminte. − Achevez, vous dis−je... Qu'elle rend à votre mérite la détermine... Je crois que la main vous tremble ! vous paraissez changé. Qu'est−ce que cela signifie ? Vous trouvez-vous mal ?
Dorante. − Je ne me trouve pas bien, Madame.
Araminte. − Quoi ! si subitement ! cela est singulier. Pliez la lettre et mettez : A Monsieur le comte Dorimont. Vous direz à Dubois qu'il la lui porte. (A part.) Le coeur me bat ! (A Dorante.) Voilà qui est écrit tout de travers ! Cette adresse-là n'est presque pas lisible. (A part.) Il n'y a pas encore là de quoi le convaincre.
Dorante, à part. − Ne serait-ce point aussi pour m'éprouver ? Dubois ne m'a averti de rien.
Scène XIV - Araminte, Dorante, Marton
Marton. − Je suis bien aise, Madame, de trouver Monsieur ici ; il vous confirmera tout de suite ce que j'ai à vous dire. Vous avez offert en différentes occasions de me marier, Madame ; et jusqu'ici je ne me suis point trouvée disposée à profiter de vos bontés. Aujourd'hui Monsieur me recherche ; il vient même de refuser un parti infiniment plus riche, et le tout pour moi ; du moins me l'a−t−il laissé croire, et il est à propos qu'il
s'explique ; mais comme je ne veux dépendre que de vous, c'est de vous aussi, Madame, qu'il faut qu'il m'obtienne : ainsi, Monsieur, vous n'avez qu'à parler à Madame. Si elle m'accorde à vous, vous n'aurez point de peine à m'obtenir de moi−même.
Scène XV - Dorante, Araminte
Araminte, à part, émue. − Cette folle ! (Haut.) Je suis charmée de ce qu'elle vient de m'apprendre. Vous avez fait là un très bon choix : c'est une fille aimable et d'un excellent caractère.
Dorante, d'un air abattu. − Hélas ! Madame, je ne songe point à elle.
Araminte. − Vous ne songez point à elle ! Elle dit que vous l'aimez, que vous l'aviez vue avant de venir ici.
Dorante, tristement. − C'est une erreur où Monsieur Remy l'a jetée sans me consulter ; et je n'ai point osé dire le contraire, dans la crainte de m'en faire une ennemie auprès de vous. Il en est de même de ce riche parti qu'elle croit que je refuse à cause d'elle ; et je n'ai nulle part à tout cela. Je suis hors d'état de donner mon coeur à personne : je l'ai perdu pour jamais, et la plus brillante de toutes les fortunes ne me tenterait pas.
Araminte. − Vous avez tort. Il fallait désabuser Marton.
Dorante. − Elle vous aurait peut−être empêchée de me recevoir, et mon indifférence lui en dit assez.
Araminte. − Mais dans la situation où vous êtes, quel intérêt aviez-vous d'entrer dans ma maison, et de la préférer à une autre ?
Dorante. − Je trouve plus de douceur à être chez vous, Madame.
Araminte. − Il y a quelque chose d'incompréhensible en tout ceci ! Voyez-vous souvent la personne que vous aimez ?
Dorante, toujours abattu. − Pas souvent à mon gré, Madame ; et je la verrais à tout instant, que je ne croirais pas la voir assez.
Araminte, à part. − Il a des expressions d'une tendresse ! (Haut.) Est-elle fille ? A-t-elle été mariée ?
Dorante. − Madame, elle est veuve.
Araminte. − Et ne devez−vous pas l'épouser ? Elle vous aime, sans doute ?
Dorante. − Hélas ! Madame, elle ne sait pas seulement que je l'adore. Excusez l'emportement du terme dont je me sers. Je ne saurais presque parler d'elle qu'avec transport !
Araminte. − Je ne vous interroge que par étonnement. Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous, et vous lui sacrifiez votre fortune ? Voilà de l'incroyable. Comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire ? On essaie de se faire aimer, ce me semble : cela est naturel et pardonnable.
Dorante. − Me préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance ! Etre aimé, moi ! non, Madame. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence ; et je mourrai du moins sans avoir eu le malheur de lui déplaire.
Araminte. − Je n'imagine point de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante : je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus de toute comparaison ?
Dorante. − Dispensez-moi de la louer, Madame : je m'égarerais en la peignant. On ne connaît rien de si beau ni de si aimable qu'elle ! et jamais elle ne me parle ou ne me regarde, que mon amour n'en augmente.
Araminte baisse les yeux et continue. − Mais votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez ? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous ?
Dorante. − Le plaisir de la voir quelquefois, et d'être avec elle, est tout ce que je me propose.
Araminte. − Avec elle ! Oubliez-vous que vous êtes ici ?
Dorante. − Je veux dire avec son portrait, quand je ne la vois point.
Araminte. − Son portrait ! Est-ce que vous l'avez fait faire ?
Dorante. − Non, Madame ; mais j'ai, par amusement, appris à peindre, et je l'ai peinte moi-même. Je me serais privé de son portrait, si je n'avais pu l'avoir que par le secours d'un autre.
Araminte, à part. − Il faut le pousser à bout. (Haut.) Montrez-moi ce portrait.
Dorante. − Daignez m'en dispenser, Madame ; quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé.
Araminte. − Il m'en est tombé un par hasard entre les mains : on l'a trouvé ici. (Montrant la boîte.) Voyez si ce ne serait point celui dont il s'agit.
Dorante. − Cela ne se peut pas.
Araminte, ouvrant la boîte. − Il est vrai que la chose serait assez extraordinaire : examinez.
Dorante. − Ah ! Madame, songez que j'aurais perdu mille fois la vie, avant d'avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrai-je expier ? ... (Il se jette à ses genoux.)
Araminte. − Dorante, je ne me fâcherai point. Votre égarement me fait pitié. Revenez-en, je vous le pardonne.
Marton paraît et s'enfuit. − Ah ! (Dorante se lève vite.)
Araminte. − Ah ciel ! c'est Marton ! Elle vous a vu.
Dorante, feignant d'être déconcerté. − Non, Madame, non : je ne crois pas. Elle n'est point entrée.
Araminte. − Elle vous a vu, vous dis-je : laissez-moi, allez-vous-en : vous m'êtes insupportable.
Rendez−moi ma lettre. (Quand il est parti.) Voilà pourtant ce que c'est que de l'avoir gardé !
Dubois s'arrange pour faire lire devant l'assemblée une lettre inventée où Dorante proclame qu'il préfère s`embarquer plutôt que continuer à souffrir. Tiraillée entre un parti qui lui parle en faveur du jeune homme. et vers lequel penche son propre cœur. et les adversaires de Dorante qui le traitent avec dureté et condescendance, Araminte cède finalement à l'amour. Dorante lui révèle alors les "fausses confidences" dont elle a été victime en les justifiant par la vérité de sa passion....

1740 - "L'Epreuve"
Comédie en un acte représentée à Paris le 19 novembre 1740 par les comédiens ordinaires du roi, l'une des plus jouées de toutes les pièces de Marivaux. Lucidor, séduisant et riche, vient visiter un château qu'il s'est acheté et tombe malade. Il est soigné par Angélique, la fille de la concierge. Elle se montre si attentionnée et si confuse qu'il finit par se rendre
compte qu`il est aimé d'elle. Il s`attendrit d`autant plus que lui-même est épris au point de vouloir l`épouser. Pour s`assurer des sentiments d`Angélique, Lucidor prétend vouloir la marier avec un de ses amis. qui est en fait son valet Frontin déguisé. et encourage un riche fermier. maître Blaise, à lui faire également sa cour. Un cruel quíproquo entretenu par Lucidor fait croire à la jeune fille qu`il s'est proposé lui-même. Elle résiste à la souffrance de sa déception, aux instances de sa mère, aux importunités du fermier, jusqu'à ce que Lucidor, enfin convaincu, mette fin à cette terrible épreuve, qui révèle autant son inquiétude que la pureté d`âme et de cœur de la jeune fille....
(Scène VIII - Lucidor, Angélique)
Lucidor la regardant attentivement.
Angélique, en riant. − A quoi songez-vous donc en me considérant si fort ?
Lucidor. − Je songe que vous embellissez tous les jours.
Angélique. − Ce n'était pas de même quand vous étiez malade. A propos, je sais que vous aimez les fleurs, et je pensais à vous aussi en cueillant ce petit bouquet ; tenez, Monsieur, prenez-le.
Lucidor. − Je ne le prendrai que pour vous le rendre, j'aurai plus de plaisir à vous le voir.
Angélique prend. − Et moi, à cette heure que je l'ai reçu, je l'aime mieux qu'auparavant.
Lucidor. − Vous ne répondez jamais rien que d'obligeant.
Angélique. − Ah ! cela est si aisé avec de certaines personnes ; mais que me voulez-vous donc ?
Lucidor. − Vous donner des témoignages de l'extrême amitié que j'ai pour vous, à condition qu'avant tout, vous m'instruirez de l'état de votre coeur.
Angélique. − Hélas ! le compte en sera bientôt fait ! Je ne vous en dirai rien de nouveau ; ôtez notre amitié que vous savez bien, il n'y a rien dans mon coeur, que je sache, je n'y vois qu'elle.
Lucidor. − Vos façons de parler me font tant de plaisir, que j'en oublie presque ce que j'ai à vous dire.
Angélique. − Comment faire ? Vous oublierez donc toujours, à moins que je ne me taise ; je ne connais point d'autre secret.
Lucidor. − Je n'aime point ce secret-là ; mais poursuivons : il n'y a encore environ que sept semaines que je suis ici.
Angélique. − Y a-t-il tant que cela ? Que le temps passe vite ! Après ?
Lucidor. − Et je vois quelquefois bien des jeunes gens du pays qui vous font la cour ; lequel de tous distinguez−vous parmi eux ? Confiez-moi ce qui en est comme au meilleur ami que vous ayez.
Angélique. − Je ne sais pas, Monsieur, pourquoi vous pensez que j'en distingue, des jeunes gens qui me font la cour ; est−ce que je les remarque ? est-ce que je les vois ? Ils perdent donc bien leur temps.
Lucidor. − Je vous crois, Angélique.
Angélique. − Je ne me souciais d'aucun quand vous êtes venu ici, et je ne m'en soucie pas davantage depuis que vous y êtes, assurément.
Lucidor. − Etes-vous aussi indifférente pour maître Blaise, ce jeune fermier qui veut vous demander en mariage, à ce qu'il m'a dit ?
Angélique. − Il me demandera en ce qu'il lui plaira, mais, en un mot, tous ces gens-là me déplaisent depuis le premier jusqu'au dernier, principalement lui, qui me reprochait, l'autre jour, que nous nous parlions trop souvent tous deux, comme s'il n'était pas bien naturel de se plaire plus en votre compagnie qu'en la sienne ; que cela est sot !
Lucidor. − Si vous ne haïssez pas de me parler, je vous le rends bien, ma chère Angélique : quand je ne vous vois pas, vous me manquez, et je vous cherche.
Angélique. − Vous ne cherchez pas longtemps, car je reviens bien vite, et ne sors guère.
Lucidor. − Quand vous êtes revenue, je suis content.
Angélique. − Et moi, je ne suis pas mélancolique.
Lucidor. − Il est vrai, je vois avec joie que votre amitié répond à la mienne.
Angélique. − Oui, mais malheureusement vous n'êtes pas de notre village, et vous retournerez peut-être bientôt à votre Paris, que je n'aime guère. Si j'étais à votre place, il me viendrait plutôt chercher que je n'irais le voir.
Lucidor. − Eh ! qu'importe que j'y retourne ou non, puisqu'il ne tiendra qu'à vous que nous y soyons tous deux ?
Angélique. − Tous deux, Monsieur Lucidor ! Eh mais ! contez-moi donc comme quoi.
Lucidor. − C'est que je vous destine un mari qui y demeure.
Angélique. − Est-il possible ? Ah çà, ne me trompez pas, au moins, tout le coeur me bat ; loge-t-il avec vous ?
Lucidor. − Oui, Angélique ; nous sommes dans la même maison.
Angélique. − Ce n'est pas assez, je n'ose encore être bien aise en toute confiance. Quel homme est-ce ?
Lucidor. − Un homme très riche.
Angélique. − Ce n'est pas là le principal ; après.
Lucidor. − Il est de mon âge et de ma taille.
Angélique. − Bon ; c'est ce que je voulais savoir.
Lucidor. − Nos caractères se ressemblent, il pense comme moi.
Angélique. − Toujours de mieux en mieux, que je l'aimerai !
Lucidor. − C'est un homme tout aussi uni, tout aussi sans façon que je le suis.
Angélique. − Je n'en veux point d'autre.
Lucidor. − Qui n'a ni ambition, ni gloire, et qui n'exigera de celle qu'il épousera que son coeur.
Angélique, riant. − Il l'aura, Monsieur Lucidor, il l'aura, il l'a déjà ; je l'aime autant que vous, ni plus ni moins.
Lucidor. − Vous aurez le sien, Angélique, je vous en assure, je le connais ; c'est tout comme s'il vous le disait lui-même.
Angélique. − Eh ! sans doute, et moi je réponds aussi comme s'il était là.
Lucidor. − Ah ! que de l'humeur dont il est, vous allez le rendre heureux !
Angélique. − Ah ! je vous promets bien qu'il ne sera pas heureux tout seul.
Lucidor. − Adieu, ma chère Angélique ; il me tarde d'entretenir votre mère et d'avoir son consentement. Le plaisir que me fait ce mariage ne me permet pas de différer davantage ; mais avant que je vous quitte, acceptez de moi ce petit présent de noce que j'ai droit de vous offrir, suivant l'usage, et en qualité d'ami ; ce sont de petits bijoux que j'ai fait venir de Paris.
Angélique. − Et moi je les prends, parce qu'ils y retourneront avec vous, et que nous y serons ensemble ; mais il ne fallait point de bijoux, c'est votre amitié qui est le véritable.
Lucidor. − Adieu, belle Angélique ; votre mari ne tardera pas à paraître.
Angélique. − Courez donc, afin qu'il vienne plus vite.
(Scène IX - Angélique, Lisette)
Lisette. − Eh bien ! Mademoiselle, êtes-vous instruite ? A qui vous marie-t-on ?
Angélique. − A lui, ma chère Lisette, à lui-même, et je l'attends.
Lisette. − A lui, dites-vous ? Et quel est donc cet homme qui s'appelle lui par excellence ? Est−ce qu'il est ici ?
Angélique. − Eh ! tu as dû le rencontrer ; il va trouver ma mère.
Lisette. − Je n'ai vu que Monsieur Lucidor, et ce n'est pas lui qui vous épouse.
Angélique. − Eh ! si fait, voilà vingt fois que je te le répète ; si tu savais comme nous nous sommes parlé, comme nous nous entendions bien sans qu'il ait dit : C'est moi ! , mais cela était si clair, si clair, si agréable, si tendre ! ...
Lisette. − Je ne l'aurais jamais imaginé, mais le voici encore.
(Scène X - Lucidor, Frontin, Lisette, Angélique)
Lucidor. − Je reviens, belle Angélique ; en allant chez votre mère, j'ai trouvé Monsieur qui arrivait, et j'ai cru qu'il n'y avait rien de plus pressé que de vous l'amener ; c'est lui, c'est ce mari pour qui vous êtes si favorablement prévenue, et qui, par le rapport de nos caractères, est en effet un autre moi-même ; il m'a apporté aussi le portrait d'une jeune et jolie personne qu'on veut me faire épouser à Paris. (Il le lui présente.) Jetez les yeux dessus : comment le trouvez-vous ?
Angélique, d'un air mourant, le repousse. − Je ne m'y connais pas.
Lucidor. − Adieu, je vous laisse ensemble, et je cours chez Madame Argante. (Il s'approche d'elle.) Etes-vous contente ?
Angélique, sans lui répondre, tire la boîte aux bijoux et la lui rend sans le regarder : elle la met dans sa main ; et il s'arrête comme surpris et sans la lui remettre, après quoi il sort.
(Scène XI - Angélique, Frontin, Lisette)
Angélique reste immobile ; Lisette tourne autour de Frontin avec surprise, et Frontin paraît embarrassé.
Frontin. − Mademoiselle, l'étonnante immobilité où je vous vois intimide extrêmement mon inclination naissante ; vous me découragez tout à fait, et je sens que je perds la parole.
Lisette. − Mademoiselle est immobile, vous muet, et moi stupéfaite ; j'ouvre les yeux, je regarde, et je n'y comprends rien.
Angélique, tristement. − Lisette, qui est-ce qui l'aurait cru ?
Lisette. − Je ne le crois pas, moi qui le vois.
Frontin. − Si la charmante Angélique daignait seulement jeter un regard sur moi, je crois que je ne lui ferais point de peur, et peut-être y reviendrait-elle : on s'accoutume aisément à me voir, j'en ai l'expérience, essayez-en.
Angélique, sans le regarder. − Je ne saurais ; ce sera pour une autre fois. Lisette, tenez compagnie à Monsieur, je lui demande pardon, je ne me sens pas bien ; j'étouffe, et je vais me retirer dans ma chambre....

"Machine matrimoniale" et "théâtre inconnu" - La critique littéraire aime ses jeux de langage. On a pu appelé le théâtre marivaudien une «machine matrimoniale», pour son caractère attendu du dénouement matrimonial, mais l’essentiel de la dramaturgie tourne autour d’une interrogation sur les jeux de l’être et du paraître, les pièges de la sincérité et ceux du mensonge : c’est à proprement parler l’essence du marivaudage que de jouer ainsi sur les faux-semblants. La cruauté (cruauté le plus souvent ordinaire, inhérente aux règles sociales) n’est pourtant pas absente de cet univers de comédie : dans le Prince travesti, la princesse, amoureuse de Lélio, charge Hortense de plaider la cause de son amour, alors qu’Hortense elle-même aime Lélio. Les ruses du langage, de l’amour et de l’amour-propre, les subtiles dissertations sentimentales des personnages de Marivaux sont la matière même de l’intrigue. Par l’emploi éminemment théâtral qu’il fait des thèmes du déguisement et du masque, Marivaux se place dans le droit fil de la tradition italienne de la commedia dell’arte et de la tradition espagnole du romanesque baroque, à ceci près que le masque joue dans son théâtre le rôle de révélateur et qu’il est préoccupé, à travers le jeu même, par la recherche de la vérité.
On a aussi souligné la singularité de l'oeuvre de Marivaux en évoquant un «théâtre inconnu». On a pu distinguer deux sortes de pièces bien différentes chez notre auteur. Des comédies dont l'amour n'est plus l'unique matière et qui tirent leur intérêt principal d'une peinture de mœurs (l'École des Mères, le Petit-Maître corrigé) ou d'une idée de moraliste (le Préjugé vaincu,-la Mère confidente). Ensuite une dizaine de pièces, d'un genre tout à fait singulier, dont Marivaux semble bien être l'inventeur et où il n'a guère été imité, le genre de la comédie philosophique (l'Ile des Esclaves, l'Ile de la Raison, la Nouvelle Colonie). Parmi ces pièces, quelques-unes, dans un cadre d'une mythologie toute fantaisiste, font mouvoir des personnages à demi-allégoriques (la Réunion des Amours, le Triomphe de Plutus), d'autres, où l'imagination de Marivaux se joue plus librement encore, qui sont de pures féeries (Félicie). Mais ce sont autant de pièces faites plus pour être lues que jouées, et c'est là toute la singularité de notre auteur. Et quand nous passons de son théâtre à ses romans, c'est bien un autre monde qui s'ouvre à nous, mais persiste encore et toujours cette incroyable don de percevoir et de démêler les dessous, les détours, les demi-teintes du sentiment. Reste que le théâtre l'obligeait à être court, il s'est parfois dans ses romans laissé emporter par son goût passionné de l'analyse sentimentale...
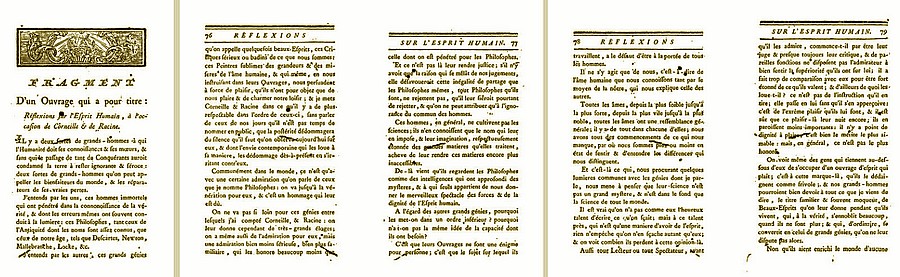

Marivaux, "Réflexions"
"En général il peut y avoir un degré d'ignorance meurtrière parmi les hommes en fait de morale. Il y a un degré de connaissance qui leur nuit peut-être encore davantage. Il y a une médiocrité de connaissance dont ils se trouveraient mieux, et qui est le point où il faudrait qu'ils fussent. Dans ce degré médiocre, ils en sauraient assez pour savoir se rendre suffisamment heureux; mais ils n'en sauraient pas assez pour savoir échapper aux reproches d'être méchants.
Plus les hommes, par la finesse de leur esprit, connaissent d'iniquités de cœur, et plus ils commettent de crimes.
En vain cette même finesse , leur apprend-elle de nouvelles vertus, ils s'en tiennent à les savoir, et ne les exercent pas; mais, pour des crimes, malheur à toute société d'hommes dans laquelle il y a assez d'esprit et d'expérience pour savoir en combien de façons fines, secrètes et impunies, on peut manquer d'honneur, de justice et de vertu. Il faudrait donc, pour le bonheur des hommes, qu'ils ne fussent ni trop ignorants ni trop avancés. Trop d'ignorance leur donne des mœurs barbares; le trop d'expérience leur en donne d'habilement scélérates. La médiocrité de connaissances leur en donnerait de plus douces..."
Sainte-Beuve est de ceux, rares, qui ont su découvrir en Marivaux plus qu'un écrivain léger, un théoricien et un philosophe, son amitié avec un Fontenelle est révélatrice d'un esprit qui s'efforçait de méditer sur de bien vastes sujets tout en menant par ailleurs cette finesse des analyses psychologiques qui feront la renommée de Marivaux bien longtemps après sa mort.
On lit dans "Le Miroir" : "La force de nos passions, de nos folies, et la médiocrité de nos connaissances, les progrès qu'elles ont faits, devraient nous faire soupçonner que cette nature est encore bien jeune en nous. Quoi qu`il en soit, nous ne savons pas l'âge qu'elle a ; peut-être n'en a-t-elle point? ... De même qu'on n'a pas encore trouvé toutes les formes dont la matière est susceptible, l'âme humaine n'a pas encore montré tout ce qu'elle peut être; toutes les façons de penser et de sentir ne sont pas épuisées."
Dans "Réflexions sur les Romains", Marivaux pose la question suivante : "A quoi pouvait aboutir un pareil gouvernement où le citoyen n'était ni sujet, ni libre, où il n'y avait que de lâches esclaves, qui affectaient une liberté qu'ils n'avaient plus, et un maître hypocrite qui affectait d'observer une égalité dont il ne laissait que la chimère..."
Dans "Réflexions sur les hommes", il lançait l'avertissement suivant, deux siècles avant Paul Valéry :« A quoi bon faire des livres pour instruire les hommes; les passions n'ont jamais lu; il n'y a point d'expériences pour elles, elles se lassent quelquefois mais elles ne se corrigent guère; et voilà pourquoi tant d'événements se répètent..."
