- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) - Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) - d'Holbach (1723-1789) - Louis-Jacques Goussier (1722-1799) - Charles Marie de La Condamine (1701-1774) - Denis Diderot (1713-1784) - ........
Last update 10/10/2021

Le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, - 17 volumes de textes et 11 volumes de planches composés par plus de 150 auteurs sous la direction de Diderot et de D''Alembert, et publiés de 1751 à 1772 -, succède à "L'Esprit des Lois" de Montesquieu (1748) et aux trois premiers volumes de l' "Histoire naturelle" de Buffon (1749).... On a dit, et il est à peine exagéré de dire, que l'Encyclopédie fut la grande affaire du XVIIIe siècle, "Ce siècle est le siècle des dictionnaires", avouait en 1729 un rédacteur des Mémoires de Trévoux, et Grimm, dans une lettre de septembre 1758, écrit, "c'est la mode depuis quelque temps de mettre tout en dictionnaire." Mode qui se rattache au goût d'une époque soucieuse avant tout de diffuser les "Lumières" et de mettre la science à la portée de tout le monde, mais "à peu de frais", observe encore le mémorialiste de Trévoux (août 1715), car on aime à savoir, mais on veut apprendre sans peine et en peu de temps. C'est en fait une constante de l'humaine nature en société, de nos jours rien n'a véritablement changé, "apprendre à peu de frais...".
De cette mode nouvelle, de ce "goût dominant du siècle", ainsi que le proclament le Prospectus de Diderot (novembre 1750) et le Discours préliminaire de d'Alembert (juillet 1751), les philosophes s'emparèrent avec d'autant plus d'empressement qu'en se proposant d'y satisfaire ils y trouvaient l'occasion de "secouer le joug de l'autorité et de l'exemple pour s'en tenir aux lois de la raison", et donner une production calquée enfin sur les fameuses "vérités de la nature" : car "tel est l'effet du progrès de la raison". Plus de Sommes théologiques à la manière de saint Thomas, ni de Méditations, comme celles de Descartes, sur la philosophie première, l'existence de Dieu et l'immortalité de nos âmes, mais une Cyclopaedia comme celle d'Ephraïm Chambers, entreprise maçonnique destinée à "réunir les lumières de toutes les nations dans un seul ouvrage", ou un "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres" qui les ordonneront résolument selon leurs rapports, non à Dieu, mais à l'être humain, dont la primauté s'affirme. Fidèles au principe énoncé par Pope et, après lui, par Lessing, que le propre sujet d'étude pour l'homme c'est l'homme, d'Alembert déclare dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie : "Tout s'y rapporte à nos besoins", et, plus clairement encore, Diderot dans l'article Encyclopédie : "Pourquoi n'introduirions-nous pas l'homme dans notre ouvrage comme il est placé dans l'univers? Pourquoi n'en ferions-nous pas un centre commun" ?".

"Derrière l'Encyclopédie, il y a un homme et il y a des idées", des hommes qui s'ouvrent au monde, des penseurs qui nous disent que c'est à ce monde extérieur qu'ils doivent toutes leurs idées, le sensualisme anglais est passé par là. Et "L'homme, c'est Diderot. Nulle plus curieuse figure, nulle plus riche personnalité en ce siècle qui, Rousseau mis à part et quelques très grands musiciens, n'en compte guère. Nul homme dont il soit plus difficile, et, par suite, plus tentant, de définir le caractère, que cet homme à qui s'applique mieux qu'à tout autre le portrait tracé par Bacon de ceux qui se délectent du vertige de leurs pensées et tiendraient pour servitude d'être contraints par une foi fixe ou par des axiomes constants. Il appartient à cette famille "ennemie de toute lisière" dont il parle à Sophie Volland (27 janvier 1766), et, comme ce Neveu de Rameau qui lui ressemble par tant de traits, il dirait volontiers de lui-même : "Me faire autre que je ne suis? Il faut que Rameau soit ce qu'il est." De fait, ainsi qu'il l'écrit à propos "du grand sophiste" J.-J. Rousseau, "dans l'édifice moral tout est lié" (4 juin 1759). Que chacun reste fidèle à son caractère, même si ce caractère, comme c'est le cas, est fait de contrastes : car, dans ses expressions les plus contradictoires, dans les cent physionomies diverses qu'il peut revêtir en un jour, se manifeste l'unité complexe d'un être singulier qui ne vise pas à être une espèce, qui se contente d'être lui, c'est-à-dire un homme tel que nul n'est plus dissemblable de lui que lui-même, dont l'inconstance apparente recouvre un naturel stable et défini, fait d'un certain mélange ou d'une certaine balance d'affections et de penchants, et qui aime à se donner, en lui et hors de lui, le spectacle de cette sorte de pantomime universelle qui est le grand branle de la terre. Ainsi se poursuit ce soliloque, recommandé par son maître Shaftesbury, qui est comme un dialogue perpétuel, jamais achevé, - car les interlocuteurs n'arrivent jamais à se convaincre, - entre lui et moi: dialogue où le sujet se dédouble, et prend sa mesure dans ce miroir où il apprend à se connaître en connaissant la duplicité qui est son être même, l'être de l'homme, de chaque homme. "Duplicité de l'homme ", disait déjà Pascal (Pensées, 315) : mais duplicité dont il n'y a pas à chercher les raisons, car, pour l'homme purement homme, il n'y a rien, ni en deçà, ni au-delà. Tel est précisément Denis Diderot, le fils du coutelier de Langres..." (J.Chevalier).
Depuis 1741, Diderot préparait la grande entreprise de sa vie et du siècle, le tableau des connaissances humaines. Lorsque le premier volume parut enfin en I751, Diderot avait trente- huit ans; il avait commencé à vingt-huit les travaux préliminaires, et en 1772, quand le prodigieux monument fut achevé, il en avait cinquante-neuf.
En 1746 le libraire Le Breton a confié à Diderot la direction de l'Encyclopédie, d'Alembert écrit le Discours préliminaire et Diderot le Prospectus qui paraîtra en 1750. Le privilège pour l'Encyclopédie,, accordé dès 1745, avait été scellé le 21 janvier 1746. Mais l'incarcération du directeur mettait l'œuvre en péril avant même qu'elle n'eût commencé de paraître, et, chose curieuse, le comte d'Argenson, à qui était dû l'emprisonnement, avait accepté la dédicace de l'Encyclopédie. Le philosophe fut relâché avant la fin du mois de septembre 1749, après une détention de cent jours. Dans une lettre du 30 septembre, il remercie Bernard du Châtelet et termine en le suppliant «de lui continuer les marques de sa bienveillance auprès de M. d'Argenson, car il en a besoin plus que jamais». La publication commença donc en 1751, très mal accueillie par le Journal de Trévoux. Diderot répondit par les deux lettres au Père Berthier. Par ailleurs, ce fut un grand succès, avec l'expression de sentiments assez mêlés. Pendant vingt ans, jusqu'en 1765, les travaux de l'Encyclopédie vont absorber une grande partie de l'activité de Diderot. Il rédige, corrige, révise une foule d'articles, stimule les collaborateurs....

Les Salons...
Au temps de la conception, l'école encyclopédique avait à Paris, comme point de ralliement, deux ou trois salons où se discutaient les moyens de mener l'entreprise à son terme. Le premier de ces salons pour le dévouement à la cause des sciences et des arts était celui du baron d'Holbach, tant au Grand-Val et que dans sa maison de la rue Royale. D'autres lieux de réunions s'étaient constitués, le motif qui rapprochait les participants était moins défini et plus mondain que philosophique. En premier, le salon de madame Geoffrin qui, à la mort de madame de Tencin, avait fondé chez elle deux dîners, l'un, le lundi, pour les artistes, parmi lesquels il faut citer les deux Vanloo, Carle et Michel, Vernet, Boucher, Latour, Lemoyne ; et l'autre, le mercredi, pour les gens de lettres où se rencontraient d'Alembert, Galiani, l'abbé Raynal, Morellet, Helvétius, Saint-Lambert, etc., et quelquefois Diderot, quand l'absence de Sophie Volland lui laissait du temps à consacrer à ses amis, ou lorsqu'il n'allait pas chez le baron. La plupart des habitués de madame Geoffrin étaient aussi reçus chez madame d'Holbach, et souvent les deux salons n'en faisaient qu'un, mais on ne trouvait pas chez elle la liberté philosophique que recherchaient les habitués du Grand-Val. D'Alembert, qui s'était toujours tenu sur la réserve à l'égard du baron, était quant à lui un des hôtes les plus assidus de madame Geoffrin. Enfin, vers l'année 1764, un autre salon s'ouvrit aux philosophes, celui de mademoiselle de Lespinasse qui, célèbre par le profond attachement que lui avait voué d'Alembert, "était, dit Marmontel dans ses Mémoires, la tête la plus vive, l'âme la plus ardente, l'imagination la plus inflammable qui ait existé depuis Sapho.." La marquise du Deffand, chez qui mademoiselle de Lespinasse avait trouvé un asile, était une des femmes qui, parmi les plus spirituelles de son temps, était aussi l'une de plus redoutables pour ses traits et qui ne craignait qu'un Voltaire. Lorsque mademoiselle de Lespinasse rompit avec elle, elle entraîna, avec d'Alembert, l'abbé Morellet, Condillac, Saint-Lambert, Marmontel, Turgot.. Autres lieux, la société du Bout du banc, qui se réunissait chez mademoiselle Quinault, et où allaient Duclos, d'Alembert, Voltaire quand il était à Paris; après son mariage avec mademoiselle Gurchod, le banquier Necker ouvrit, au Marais, un salon qui créa dans la suite, au sein du parti philosophique un certain antagonisme par suite de sa rivalité politique avec Turgot. Chez madame Necker, on voyait parfois Diderot et plus souvent Raynal, Saurin, Chastellux, Suard, Marmontel, Thomas, Bernard, Dorât, etc...
(Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), Lecture de la tragédie de "l'orphelin de la Chine" de Voltaire dans le salon de madame Geoffrin, 1755, Malmaison, RMN)
1749-1780 - Le salon du Baron d'Holbach
Si le salon n'a pas été à l'origine de l'Encyclopédie, pas moins de vingt-huit des rédacteurs des textes imprimés de l'Encyclopédie, soit environ un cinquième environ de ses 139 collaborateurs connus, furent reçus chez le baron d'Holbach à Paris ou à la campagne, de 1749 à l'été 1780, et ce cercle d'Holbach se retrouve dans l'esprit critique et audacieux de certains articles de Diderot, d'Holbach, Grimm, Le Roy, Marmontel, Morellet, Naigeon, Roux, et Saint-Lambert...
Le Baron d'Holbach avait régulièrement deux dîners par semaine, le dimanche et le jeudi : là se rassemblaient dix, douze, et jusqu'à quinze et vingt hommes de lettres, et gens du monde ou étrangers, qui aimaient et cultivaient même les arts de l'esprit. Une grosse chère, mais bonne, d'excellent café, beaucoup de disputes, jamais de querelles ; la simplicité des manières, qui sied à des hommes raisonnables et instruits, mais qui ne dégénérait point en grossièreté ; une gaieté vraie, sans être folle ... Tous les dimanches donc , il y avait grand dîner dans sa maison de la rue Royale, mais c'était le jeudi que se rencontraient chez lui les initiés de l'Encyclopédie.
Puis, à la belle saison, les intimes, comme Diderot, Grimm, Galiani, Georges Leroy, Saint-Lambert, etc., allaient passer, avec sa famille, quelques jours au Grand-Val. Devenu veuf de très-bonne heure, d'Holbach avait épousé la sœur de sa première femme, la charmante Caroline, connue pour la froide réception qu'elle fit à Rousseau; et n'ayant pu tomber d'accord avec madame d'Épinay pour l'acquisition du château de la Chevrette, il avait acheté le château du Grand-Val, situé près de la Marne, à la pointe de la presqu'île que forme cette rivière avant de se jeter dans la Seine : il le fit restaurer et embellir. C'est là qu'il demeurait une partie de l'été avec sa femme et sa belle-mère, madame d'Aine. Il n'est pas sans intérêt, de se représenter d'une façon précise ce séjour où se sont agitées les grandes questions qui, après avoir été élaborées au centre d'un petit groupe, ont fini par devenir plus tard le Credo de la masse des gens éclairés et par passer dans les faits. Quelque efficaces qu'aient été les résultats produits par l'Encyclopédie, les conversations de la maison d'Holbach ont exercé une influence plus grande sur la société contemporaine. La parole aura toujours, comme moyen de propagande, une importance bien autrement considérable que le livre, quoiqu'on en dise. Le grand mérite du baron d'Holbach a été de réunir des gens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais connus, de donner à leur réunion un but bien défini, et, en groupant ainsi tous ses esprits forts, de les amener à faire converger tous leurs efforts vers la même direction. Dans cette tâche, qu'il jugeait la plus utile qu'il pût s'imposer, il déploya une ardeur, une persévérance et un dévouement incomparables.
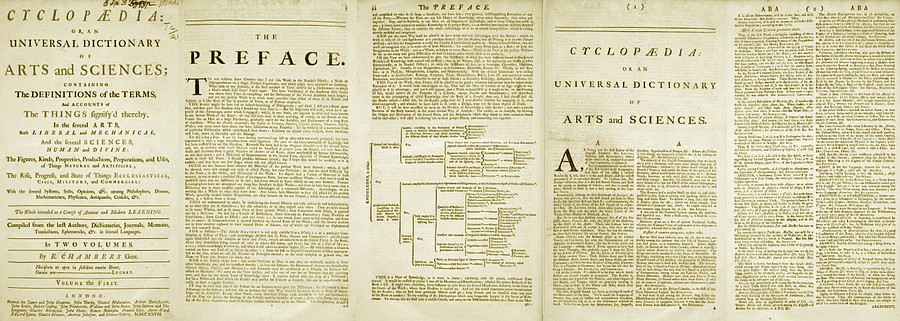
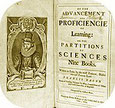
Inspirée par "Advancement of KnowIedge", de Francis Bacon, qui divisait la connaissance en trois branches, l'histoire, la philosophie et la poésie, le libraire-éditeur Le Breton, voulant publier un dictionnaire moderne, décide de faire traduire en français la "Cyclopedía or an universal dictionary of the arts and sciences compiled from the best authors", d'Ephraïm Chambers, éditée à Londres en 1727. Diderot accepte de réaliser ce projet et conçoit l'ouvrage comme un dictionnaire philosophique qui résumera les progrès de l'humanité. De simple adaptation de l'ouvrage anglais initial, l'oeuvre devient une oeuvre originale, inspirée du Dictionnaire historique et critique de Bayle (1697).
Diderot s'assure la collaboration du mathématicien d'Alembert et lance en 1750 le "Prospectus" qui expose l'objet de l'œuvre et attire de nombreuses souscriptions. Le premier volume paraît en 1751. Les sept volumes suivants seront publiés de 1752 à 1757, malgré de multiples difficultés (poursuites de collaborateurs, suppression de deux tomes en 1752) et des attaques contre d'Alembert et contre Helvétius, dont le livre "De l'Esprit" est condamné au feu en 1758, ce qui entraîne l'interdiction des tomes parus. Les tomes VIII à XVII paraîtront clandestinement en 1765. Diderot, bien que parfois découragé, réussit à écarter tous les obstacles. De nouveaux volumes de planches sont ajoutés en 1772. Des éditions plus commodes se répandent à l'étranger. Les éditeurs bénéficiant de l'appui de personnages haut placés, comme, par exemple, Madame de Pompadour, ils continuèrent à travailler en secret. Inutile de préciser l'énorme influence qu'eut cet ouvrage sur les idées politiques à l'origine de la Révolution française....

(d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, 2e partie)
"Les chefs-d'œuvre que les anciens nous avaient laissés dans presque tous les genres avaient été oubliés pendant douze siècles. Les principes des sciences et des arts étaient perdus, parce que le beau et le vrai qui semblent se montrer de toutes parts aux hommes, ne les frappent guère à moins qu'ils n'en soient avertis. Ce n'est pas que ces temps malheureux aient été plus stériles que d'autres en génies rares; la nature est toujours la même; mais que pouvaient faire ces grands hommes, semés de loin en loin comme ils le sont toujours, occupés d'objets différents, et abandonnés sans culture à leurs seules lumières? Les idées qu'on acquiert par la lecture et par la société sont le germe de presque toutes les découvertes. C'est un air que l'on respire sans y penser et auquel on doit la vie; et les hommes dont nous parlons étaient privés d'un tel secours...
Cependant la plupart des beaux esprits de ces temps ténébreux se faisaient appeler poètes ou philosophes. Que leur en coûtait-il en effet, pour usurper deux titres dont on se pare à si peu de frais, et qu'on se flatte toujours de ne guère devoir à des lumières empruntées? Ils croyaient qu'il était inutile de chercher les modèles de la poésie dans les ouvrages des Grecs et des Romains dont la langue ne se parlait plus; et ils prenaient pour la véritable philosophie des anciens une tradition barbare qui la défigurait. La poésie se réduisait pour eux à un mécanisme puéril : l'examen approfondi de la nature et la grande étude de l'homme étaient remplacés par mille questions frivoles sur des êtres abstraits et métaphysiques : questions dont la solution, bonne ou mauvaise, demandait souvent beaucoup de subtilité, et par conséquent un grand abus de l'esprit. Qu'on joigne à ce désordre l'état d'esclavage où presque toute l'Europe était plongée, les ravages de la superstition qui naît de l'ignorance et qui la reproduit à son tour : et l'on verra que rien ne manquait aux obstacles qui éloignaient le retour de la raison et du goût : car il n'y a que la liberté d'agir et de penser qui soit capable de produire de grandes choses, et elle n'a besoin que de lumières pour se préserver des excès." (d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, 2e partie).

L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est l'oeuvre qui cerne le mieux le mouvement des Lumières au sein de la culture française et illustre l'effort scientifique et philosophique du XVIIIe siècle. C'est le premier monument d'une civilisation technique qui ne fera plus désormais que se développer, il mettra vingt et un ans à paraître (1751-1772), et contiendra dix-sept volumes in-folio et onze volumes de planches..
L'Encyclopédie englobe des articles des plus importantes personnalités des Lumières en France, dont Voltaire, Rousseau et Montesquieu. Mais le projet n'aurait vraisemblablement jamais été mené à terme sans la ténacité d'un philosophe et écrivain, Denis Diderot (1713-1784), qui en devint coéditeur avec Jean d'Alembert (1717-1783) en 1751 et assuma une responsabilité éditoriale pendant vingt-cinq ans.
"On a pris l'esquisse des machines et des outils. On n'a rien omis de ce qui pouvait les montrer distinctement aux yeux. Dans le cas où une machine mérite des détails par l'importance de son usage et par la multitude de ses parties, on a passé du simple au composé. On a commencé par assembler dans une première figure autant d'éléments qu'on en pouvait apercevoir sans confusion. Dans une seconde figure, on voit les mêmes éléments avec quelques autres. C'est ainsi qu'on a formé successivement la machine la plus compliquée, sans aucun embarras ni pour l'esprit ni pour les yeux." (Discours Préliminaire)

Quand on parle de la philosophie encyclopédiste, on entend par là l'esprit général qui a animé l'Encyclopédie : esprit d'indépendance à l'égard de l'autorité, de la tradition et de la foi; confiance dans la raison et croyance au progrès; aspirations libérales, tendances humanitaires...
Mais, en réalité, tous les collaborateurs de l'Encyclopédie n'ont pas été animés par cet esprit : Diderot et d'Alembert ont dû souvent faire appel à des écrivains qui ne pensaient pas comme eux, ou qui tout au moins étaient beaucoup plus modérés, tel Duclos qui disait un jour en parlant de ses confrères, "Ils en feront tant qu'ils finiront par m'envoyer à confesse".
Parmi les collaborateurs de l'Encyclopédie, après Diderot, qui écrivit plus de mille articles sur les arts mécaniques, l'histoire de la philosophie, la morale, l'esthétique... (Art. Autorité, Aristotélisme, Beau, Encyclopédie, Epicurisme, Immortalité, etc...), et d'Alembert qui, outre un grand nombre d'articles de mathématiques et de physique générale, rédigea l'article Collège, critique de l'enseignement universitaire, et l'article Genève, il faut nommer au premier rang le chevalier Louis de Jaucourt, avec dix-sept mille deux cent soixante-six articles entre 1756 et 1759 touchant toutes sortes de thématiques politiques, historiques, de sciences physiques et naturelles. Pour la philosophie, Hévétius (1715-1771) et l'abbé de Condillac (1715-1780), pour la théologie, l’abbé Edme-François Mallet (1713-1755), l'abbé Morellet (1727-1819), auteur d'un "Petit écrit sur une matière intéressante, la tolérance" (1756), et l'abbé Yvon (art. Âme, Athée, Dieu), pour la chimie, le baron D'Holbach (1723-1789), pour l'histoire naturelle, Daubenton (1716-1799), l'un des collaborateurs de Buffon, pour la critique littéraire, Marmontel (1723-1799), pour la grammaire, César Chesneau Dumarsais (1676-1756), pour l'économie politique, Quesnay (1694-1774) et Turgot1727-1781), Urbain de Vandenesse, pour la partie médicale, Jean-Baptiste Le Roy pour l'horlogerie, etc, et Louis-Jacques Goussier qui dessinera près d’un tiers des 2885 planches entre 1747 et 1760..
Notons toutefois que parmi les grands écrivains, Montesquieu ne donna à l'Encyclopédie qu'un article, inachevé, sur le Goût, Voltaire se limita à des questions de littérature, Rousseau ne fournit que des études sur la musique et l'article Economie Politique, et Buffon ne put rédiger l'article Nature qu'on lui demandait...
1750-1751 - Le premier volume annoncé par le "Prospectus" de Diderot (octobre 1750) et précédé du Discours préliminaire de d'Alembert, paraît le 1er juillet 1751. Le Discours de d'Alembert comporte deux parties, une classification des connaissances humaines (le «Système figuré des Connaissances», d’après le chancelier Bacon), fondée sur la distinction des trois facultés, mémoire, raison, imagination (auxquelles correspondent l'histoire, la philosophie, les beaux-arts), et une histoire sommaire des sciences et des arts de la Renaissance au milieu du XVIIIe siècle....
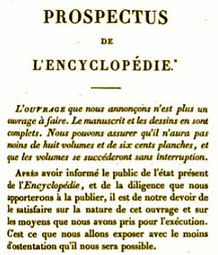
1750 - Le "Prospectus" de l'Encyclopédie
"L'ouvrage que nous annonçons n'est plus un ouvrage à faire. Le manuscrit et les dessins en sont complets. Nous pouvons assurer qu'il n'aura pas moins de huit volumes et de six cents planches, et que les volumes se succéderont sans interruption.
Après avoir informé le public de l'état présent de l'Encyclopédie, et de la diligence que nous apporterons à la publier, il est de notre devoir de le satisfaire sur la nature de cet ouvrage et sur les moyens que nous avons pris pour l'exécution. C'est ce que nous allons exposer avec le moins d'ostentation qu'il nous sera possible.
On ne peut disconvenir que, depuis le renouvellement des lettres parmi nous, on ne doive en partie aux dictionnaires les lumières générales qui se sont répandues dans la société , et ce germe de science qui dispose insensiblement les esprits à des connaissances plus profondes. Combien donc n'importait-il pas d'avoir en ce genre un livre qu'on put consulter sur toutes les matières, et qui servît autant à guider ceux qui se sentiraient le courage de travailler à l'instruction des autres , qu'à éclairer ceux qui ne s'instruisent que pour eux-mêmes !
C'est un avantage que nous nous sommes proposé ; mais ce n'est pas le seul. En réduisant sous la forme de dictionnaire tout ce qui concerné les sciences et les arts, il s'agissait encore de faire sentir les secours mutuels qu'ils se prêtent; d'user de ces secours, pour en rendre les principes plus sûrs, et leurs conséquences plus claires; d'indiquer les liaisons éloignées ou prochaines des êtres qui composent la Nature , et qui ont occupé les hommes; de 'montrer, par l'entrelacement des racines et par celui des branches, l'impossibilité de bien connaître quelques parties de ce tout, sans remonter ou descendre à beaucoup d'autres ; de former un tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles ; de présenter ces objets avec clarté ; de donner à chacun d'eux retendue convenable , et de vérifier, s'il était possible, notre épigraphe par notre succès :
Tantum series junctaraque pollet ,
Tantum de medio sumptis accedit honoris
HORAT. de Arte poet.v.249.
Jusqu'ici personne n'avait conçu un ouvrage aussi grand , ou du moins personne ne l'avait exécuté. Leibnitz, de tous les savants le plus capable d'en sentir les difficultés , désirait qu'on les surmontât. Cependant on avait des Encyclopédies; et Leibnitz ne l'ignorait pas lorsqu'il en demandait une.
La plupart de ces ouvrages parurent avant le siècle dernier, et ne furent pas tout-à-fait méprisés. On trouva que s'ils n'annonçaient pas beaucoup de génie y ils marquaient au moins du travail et des connaissances. Mais que serait-ce pour nous que ces Encyclopédies? Quel progrès n'a-t-on pas fait depuis dans les sciences et dans les arts ? Combien de vérités découvertes aujourd'hui qu'on n'entrevoyait pas alors? La vraie philosophie était au berceau; la géométrie de l'infini n'était pas encore ; la physique expérimentale se montrait à peine ; il n'y avait point de dialectique ; les lois de la saine critique étaient entièrement ignorées. Descartes, Boyle, Huyghens, Newton, Leibnitz, les Bernoulli , Locke , Bayle, Pascal , Corneille , Racine, Bourdaloue, Bossuet, etc., ou n'existaient pas, ou n'avaient pas écrit. L'esprit de recherche et d'émulation n animait pas les savants : un autre esprit, moins fécond peut-être , mais plus rare , celui de justesse et de méthode , ne s'était point soumis les différentes parties de la littérature ; et les académies , dont les travaux ont porté si loin les sciences et les arts, n'étaient pas instituées.
Si les découvertes des grands hommes et des compagnies savantes, dont nous venons de parler, offrirent dans la suite de puissants secours pour former un dictionnaire encyclopédique, il faut avouer aussi que l'augmentation prodigieuse des matières rendit, à d'autres égards, un tel ouvrage beaucoup plus difficile. Mais ce n'est point à nous a juger si les successeurs des premiers encyclopédistes ont été hardis ou présomptueux; et nous les laisserions tous jouir de leur réputation, sans en excepter Ephraïm Chambers, le plus connu d'entre eux , si nous n'avions des raisons particulières de peser le mérite de celui-ci.
L'Encyclopédie de Chambers , dont on a publié à Londres un si grand nombre d'éditions rapides ; cette Encyclopédie qu'on vient , de traduire tout récemment en italien, et qui, de notre aveu, mérite en Angleterre et chez l'étranger les honneurs qu'on lui rend , n'eût peut-être jamais été faite , si, avant qu'elle parût en anglais, nous n'avions eu, dans notre langue, des ouvrages où Chambers a puisé sans mesure et sans choix la plus grande partie des choses dont il a composé son dictionnaire. Qu'en auraient donc pensé nos Français, sur une traduction pure et simple? Il eût excité l'indignation des savants et le cri du public, à qui on n'eût présenté , sous un titre fastueux et nouveau , que des richesses qu'il possédait depuis longtemps.
Nous ne refusons point à cet auteur la justice qui lui est due. Il a bien senti le mérite de l'ordre encyclopédique ou de la chaîne , par laquelle on peut descendre sans interruption, des premiers principes d'une science ou d'un art, jusqu'à ses conséquences les plus éloignées, et remonter de ses conséquences les plus éloignées jusqu'à ses premiers principes ; passer imperceptiblement de cette science ou de cet art à un autre, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi , faire , sans s'égarer, le tour du monde littéraire. Nous convenons avec lui que le plan et le dessein de son dictionnaire sont excellents ; et que , si l'exécution en était portée à un certain degré de perfection , il contribuerait plus, lui seul, aux progrès de la vraie science, que la moitié des livres connus. Mais nous ne pouvons nous empêcher de voir combien il est demeuré loin de ce degré de perfection. En effet, conçoit-on que tout ce qui concerne les sciences et lés arts puisse être renfermé en deux volumes in-folio ? La nomenclature d'une matière aussi étendue en fournirait un elle seule , si elle était complète. Combien donc ne doit-il pas y avoir dans son ouvrage d'articles omis ou tronqués ?
Ce ne sont point ici des conjectures. La traduction entière du Chambers nous a passé sous les yeux ; et nous avons trouvé une multitude prodigieuse de choses à désirer dans les sciences; dans les arts libéraux, un mot où il fallait des pages , et tout à suppléer dans les arts mécaniques. Chambers a lu des livres , mais if n'a guère vu d'artistes ; cependant il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend que dans les ateliers. D'ailleurs il n'en est pas ici des omissions comme dans un autre ouvrage. L'Encyclopédie, à la rigueur, n'en permet aucune. Un article omis dans un dictionnaire commun , le rend seulement imparfait. Dans une Encyclopédie , il rompt l'enchaînement et nuit à la forme et au fond; et il a fallu tout l'art d'Ephraïm Chambers pour pallier ce défaut. Il n'est donc pas à présumer qu'un ouvrage aussi imparfait pour tout lecteur, et si peu neuf pour le lecteur français, eut trouvé beaucoup d'admirateurs parmi nous.
Mais sans nous étendre davantage sur les imperfections de l'Encyclopédie anglaise, nous annonçons que l'ouvrage de Chambers n'est point la base sur laquelle nous avons élevé; que nous avons refait un grand nombre de ses articles, et que nous n'avons employé presque aucun des autres, sans addition, correction ou retranchement; qu'il rentre simplement dans la classe des auteurs que nous ayons particulièrement consultés; et que la disposition générale est la seule chose qui soit commune entre notre ouvrage et le sien.
Nous avons senti , avec l'auteur anglais que le premier pas que nous avions à faire vers l'exécution raisonnée et bien entendue d'une Encyclopédie , c'était de former un arbre généalogique de toutes les sciences et de tous les arts qui marquât l'origine de chaque branche de nos connaissances, les liaisons qu'elles ont entre elles et avec la tige commune, et qui nous servit à rappeler les différents articles à leurs chefs. Ce n'était pas une chose facile. Il s'agissait de renfermer en une page le canevas d'un ouvrage qui ne se peut exécuter qu'en plusieurs volumes in-folio et qui doit contenir un jour toutes les connaissances des hommes...."
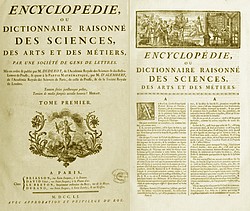
1751-1753 - Parution du premier volume de l'Encyclopédie en 1751, le 1er juillet...
(A - Azymites). Diderot avait trente- huit ans et en 1772, quand le monument fui achevé, il en aura cinquante-neuf. Il fut loué par les uns, critiqué et même chansonné par d'autres, on discuta de certaines approximations, on contesta l'importance donnée à Locke sur Descartes, mais il est vrai que la philosophie anglaise, Bacon, Hobbes, Newton, et surtout Locke, est alors d'une importance capitale pour certains de nos Encyclopédistes.
L'abbé Raynal, qui, à la lecture du prospectus, avait annoncé l'ouvrage à ses correspondants comme un chef-d'œuvre, constate, dès le tome premier, que l'Encyclopédie «a ses censeurs et ses partisans », et, selon lui, les uns et les autres ont raison. Il approuve l'esprit philosophique qui règne dans l'ouvrage et y blâme des inutilités et du verbiage. Les contemporains, même les plus hostiles à l'Encyclopédie, virent en elle autre chose qu'une œuvre de destruction, et ce ne sont pas seulement les tendances, mais les erreurs du Dictionnaire qu'ils prirent la peine de combattre avec un soin parfois minutieux. L'Encyclopédie, dès sa naissance, fut donc très librement jugée par les lecteurs sans parti pris et il y en avait de tels, même au dix-huitième siècle...
... Mais on profite de la collaboration de l'abbé de Prades à l'Encyclopédie pour l'interdire après le second volume, le 7 février 1752 (B - Cézimbra). L'abbé avait été condamné pour sa thèse en Sorbonne, "à la Jérusalem céleste", comme favorisant le matérialisme et renversant les fondements de la morale chrétienne. L'abbé, décrété de prise de corps, s'enfuit à Berlin et fut accueilli par Frédéric II. Mais tous les contemporains virent là-dessous la main des Jésuites, et la haine que leur portait d'Alembert contribua peut-être pour quelque chose à la résolution qu'il montra de conserver sa place et ses responsabilités à la direction de l'entreprise. La publication reprit en 1753 avec une préface au troisième volume et continua jusqu'au septième volume, donné en 1757. L'opposition persistait, manifestée surtout dans les petites feuilles et les pamphlets...

Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783)
On présente d'Alembert, l'homme qui dirigea avec Diderot l'Encyclopédie, au moins jusqu'en 1758, comme l'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du XVIIIe siècle, le chef de file du «parti philosophique», avec l'appui vigilant de Voltaire, auquel le lia une étroite amitié et avec qui il entretint une volumineuse correspondance, le penseur qui, dans les sciences comme en philosophie, incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes.
De fait, il n'a guère produit de système de pensée mais assuré un rôle essentiel dans la diffusion des idées nouvelles, qu'il savait présenter sans agressivité, et porter par son prestige de scientifique...
D'Alembert naquit de l'union du chevalier Destouches, général d'artillerie, et de Mme du Tencin, chanoinesse, sœur du futur cardinal-archevêque de Lyon. Aussitôt après sa naissance, il fut abandonné sur les marches de l'église Saint- Jean-Lerond, qui était le baptistère de Notre- Dame de Paris ; c'est là qu'il fut recueilli (17 novembre 1717) et c'est de là qu'il reçut le nom de Jean-Baptiste Lerond. Il fut élevé par sa nourrice, Mme Rousseau, qui passait pour sa mère. Il demeura auprès d'elle jusqu'à l'âge de cinquante ans, et même après qu'il fut allé vivre chez Mlle de Lespinasse. Le chevalier Destouches ne cessa pas de veiller sur lui et à sa mort, en 1726, lui valut une rente confortable. Le jeune Jean Lerond fut admis au collège des Quatre-Nations, à dix-huit ans il fut reçu bachelier es arts, sous le nom de Daremberg, que sa famille voulut lui imposer, et qu'il refusa d'adopter, préférant prendre celui de d'Alembert.
D'Alembert étudie le droit, puis la médecine, mais sa vocation le tourne définitivement vers les mathématiques. Des mémoires reconnus le font admettre, dès l'âge de vingt-quatre ans, à l'Académie des sciences. Dès lors, ses travaux se succèdent rapidement et étendent sa renommée. En moins de dix années, il donne l'essentiel de son œuvre scientifique, toute centrée sur la mécanique (Traité de dynamique, Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides, Théorie générale des vents, etc.). Son Traité de dynamique (1743) est fondé sur le « principe de d'Alembert », qui ramène la dynamique à la statique. En 1752, il établit les équations rigoureuses et générales du mouvement des fluides. Ses recherches de mécanique, d'acoustique et d'astronomie le conduisent à approfondir et à perfectionner l'outil analytique de son siècle. En 1768, il aura ainsi développé le calcul différentiel et intégral (calcul aux dérivées partielles), généralisé et étendu la mécanique newtonienne et ses applications.
En 1745, il est engagé avec Diderot par le libraire Le Breton pour traduire la Cyclopedia de Chambers.
D'Alembert se lie d'amitié avec Condillac et Rousseau, puis est promu codirecteur, aux côtés de Diderot, «pour la partie mathématique» de l'ouvrage devenu l'Encyclopédie. Il est l'auteur de plus de 1 600 articles et de la plupart des commentaires qui accompagnent les planches de mathématiques et de physique dans le cinquième volume des Planches.
Célébré par les académies, le voici amené à participer activement aux débats d'idées de son temps et découvert par les salons : lancé par Mme Geoffrin, il devient, dès la fin de l'année 1748, l'un des hôtes les plus assidus de Mme du Deffand. Désireux de plaire et jaloux de son repos, irritable mais généreux, défenseur du goût et ne dédaignant pas le calembour, d'Alembert apparaît comme un personnage ondoyant, inégal. De savant, il devient écrivain avec le fameux Discours préliminaire, dont la publication, le 1er juillet 1751, fut un événement. mais quelques années plus tard, sous la pression des protestations des Jésuites et de l'archevêque de Paris, des attaques personnelles de Fréron, de l'abbé de Saint-Cyr et du P. Tolomas, du scandale de l'article Genève et la polémique avec Rousseau, de la répression intellectuelle et policière inaugurée par la révocation du privilège accordé à De l'esprit d'Helvétius (10 août 1758) le déterminent à renoncer à seconder Diderot à partir de 1758.
La rupture de d'Alembert avec Diderot ne l'a pas totalement détaché des encyclopédistes.
Il entreprend ainsi de faire prévaloir à l'Académie française, où il a été appelé en 1754, les idées philosophiques, s'intéresse à d'autres domaines, fait paraître à Berlin en 1763 les deux premiers volumes de ses Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, qu'il devait enrichir jusqu'en 1783; en 1759, son Essai sur les éléments de philosophie fait venir de la sensation tous les «principes des connaissances humaines»; en 1765, il fait œuvre de polémiste dans son Éclaircissement sur la destruction des Jésuites (1765) puis se donne tout entier aux travaux de l'Académie, devient secrétaire perpétuel, à la mort de Duclos, en 1772. et meurt le 29 octobre 1783.
Il aura vécu entre sa petite chambre de la rue Michel-le-Comte, un séjour aux «Délices», chez Voltaire (1756), deux voyages auprès de Frédéric II (en 1755 à Wesel, en 1763 à Potsdam), une excursion en Provence en 1770, refusera de succéder à Maupertuis à la présidence de l'Académie de Berlin, déclinera en 1762, l'offre de Catherine II de diriger l'éducation de son fils, le grand-duc héritier...

1751 - "Discours préliminaire" de l'Encyclopédie.
Ce discours, un des manifestes du Siècle des Lumières, contient deux parties distinctes. D'AIembert écrit que l'ouvrage qu'il préface aura deux objets : "comme Encyclopédie il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines" et "comme Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, les principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance." C'est à ce double objet que correspondent les deux parties du Discours préliminaire..
Dans la première partie, d'Alembert fait donc l'histoire de la naissance des diverses branches du savoir humain, et aboutit à un tableau de nos connaissances. Dans la seconde partie, il fait une histoire des sciences, des lettres et des arts depuis la Renaissance, et comporte des pages consacrées aux grands philosophes qui, de Bacon à Leibnitz, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, ont marqué et déterminé les progrès de la philosophie.
Et «si nous n'avons pas placé, comme Bacon, ajoute d'Alembert, la raison après l'imagination, c'est que nous avons suivi, dans le système encyclopédique, l'ordre métaphysique des opérations de l'esprit, plutôt que l'ordre historique de ses progrès depuis la Renaissance des lettres, ordre que l'illustre chancelier d'Angleterre avait en vue jusqu'à un certain point, lorsqu'il faisait, comme il l'a dit, le cens et le dénombrement des connaissances humaines.» De plus, pour plusieurs sciences, D'Alembert a modifié, tantôt pour l'augmenter tantôt pour le réduire, le nombre des divisions de Bacon...
"L’Ouvrage dont nous donnons aujourd’hui le premier volume, a deux objets : comme Encyclopédie, il doit exposer autant qu’il est possible, l’ordre & l’enchaînement des connoissances humaines : comme Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers, il doit contenir sur chaque Science & sur chaque Art, soit libéral, soit méchanique, les principes généraux qui en sont la base, & les détails les plus essentiels, qui en font le corps & la substance. Ces deux points de vûe, d’Encyclopédie & de Dictionnaire raisonné, formeront donc le plan & la division de notre Discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l’un après l’autre, & rendre compte des moyens par lesquels on a tâché de satisfaire à ce double objet.
Pour peu qu’on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entr’elles, il est facile de s’appercevoir que les Sciences & les Arts se prêtent mutuellement des secours, & qu’il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s’il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de regles ou de notions générales, chaque Science ou chaque Art en particulier, il ne l’est pas moins de renfermer en un système qui soit un, les branches infiniment variées de la science humaine.
Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche, est d’examiner, qu’on nous permette ce terme, la généalogie & la filiation de nos connoissances, les causes qui ont dû les faire naître, & les caracteres qui les distinguent ; en un mot, de remonter jusqu’à l’origine & à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous tirerons de cet examen pour l’énumération encyclopédique des Sciences & des Arts, il ne sauroit être déplacé à la tête d’un ouvrage tel que celui-ci.
On peut diviser toutes nos connoissances en directes & en réfléchies. Les directes sont celles que nous recevons immédiatement sans aucune opération de notre volonté ; qui trouvant ouvertes, si on peut parler ainsi, toutes les portes de notre ame, y entrent sans résistance & sans effort. Les connoissances réfléchies sont celles que l’esprit acquiert en opérant sur les directes, en les unissant & en les combinant.
Toutes nos connoissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens ; d’où il s’ensuit que c’est à nos sensations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des premiers Philosophes a été long-tems regardé comme un axiome par les Scholastiques ; pour qu’ils lui fissent cet honneur il suffisoit qu’il fût ancien, & ils auroient défendu avec la même chaleur les formes substantielles ou les qualités occultes. Aussi cette vérité fut-elle traitée à la renaissance de la Philosophie, comme les opinions absurdes dont on auroit dû la distinguer ; on la proscrivit avec elles, parce que rien n’est si dangereux pour le vrai, & ne l’expose tant à être méconnu, que l’alliage ou le voisinage de l’erreur. Le système des idées innées, séduisant à plusieurs égards, & plus frappant peut-être parce qu’il étoit moins connu, a succédé à l’axiome des Scholastiques ; & après avoir long-tems regné, il conserve encore quelques partisans ; tant la vérité a de peine à reprendre sa place, quand les préjugés ou le sophisme l’en ont chassée. Enfin depuis assez peu de tems on convient presque généralement que les Anciens avoient raison ; & ce n’est pas la seule question sur laquelle nous commençons à nous rapprocher d’eux.
Rien n’est plus incontestable que l’existence de nos sensations ; ainsi, pour prouver qu’elles sont le principe de toutes nos connoissances, il suffit de démontrer qu’elles peuvent l’être : car en bonne Philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités reconnues, est préférable à ce qui n’est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. Pourquoi supposer que nous ayons d’avance des notions purement intellectuelles, si nous n’avons besoin pour les former, que de réfléchir sur nos sensations ? Le détail où nous allons entrer fera voir que ces notions n’ont point en effet d’autre origine.
La premiere chose que nos sensations nous apprennent, & qui même n’en est pas distinguée, c’est notre existence ; d’où il s’ensuit que nos premieres idées réfléchies doivent tomber sur nous, c’est-à-dire, sur ce principe pensant qui constitue notre nature, & qui n’est point différent de nous-mêmes. La seconde connoissance que nous devons à nos sensations, est l’existence des objets extérieurs, parmi lesquels notre propre corps doit être compris, puisqu’il nous est, pour ainsi dire, extérieur, même avant que nous ayons démêlé la nature du principe qui pense en nous. Ces objets innombrables produisent sur nous un effet si puissant, si continu, & qui nous unit tellement à eux, qu’après un premier instant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous sommes forcés d’en sortir par les sensations qui nous assiégent de toutes parts, & qui nous arrachent à la solitude où nous resterions sans elles. La multiplicité de ces sensations, l’accord que nous remarquons dans leur témoignage, les nuances que nous y observons, les affections involontaires qu’elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire qui préside à nos idées réfléchies, & qui n’opere que sur nos sensations même ; tout cela forme en nous un penchant insurmontable à assûrer l’existence des objets auxquels nous rapportons ces sensations, & qui nous paroissent en être la cause ; penchant que bien des Philosophes ont regardé comme l’ouvrage d’un Etre supérieur, & comme l’argument le plus convaincant de l’existence de ces objets. En effet, n’y ayant aucun rapport entre chaque sensation & l’objet qui l’occasionne, ou du moins auquel nous la rapportons, il ne paroît pas qu’on puisse trouver par le raisonnement de passage possible de l’un à l’autre : il n’y a qu’une espece d’instinct, plus sûr que la raison même, qui puisse nous forcer à franchir un si grand intervalle ; & cet instinct est si vif en nous, que quand on supposeroit pour un moment qu’il subsistât, pendant que les objets extérieurs seroient anéantis, ces mêmes objets reproduits tout-à-coup ne pourroient augmenter sa force. Jugeons donc sans balancer, que nos sensations ont en effet hors de nous la cause que nous leur supposons, puisque l’effet qui peut résulter de l’existence réelle de cette cause ne sauroit différer en aucune maniere de celui que nous éprouvons ; & n’imitons point ces Philosophes dont parle Montagne, qui interrogés sur le principe des actions humaines, cherchent encore s’il y a des hommes. Loin de vouloir répandre des nuages sur une vérité reconnue des Sceptiques même lorsqu’ils ne disputent pas, laissons aux Métaphysiciens éclairés le soin d’en développer le principe : c’est à eux à déterminer, s’il est possible, quelle gradation observe notre ame dans ce premier pas qu’elle fait hors d’elle-même, poussée pour ainsi dire, & retenue tout à la fois par une foule de perceptions, qui d’un côté l’entraînent vers les objets extérieurs, & qui de l’autre n’appartenant proprement qu’à elle, semblent lui circonscrire un espace étroit dont elles ne lui permettent pas de sortir.
De tous les objets qui nous affectent par leur présence, notre propre corps est celui dont l’existence nous frappe le plus, parce qu’elle nous appartient plus intimement : mais à peine sentons-nous l’existence de notre corps, que nous nous appercevons de l’attention qu’il exige de nous, pour écarter les dangers qui l’environnent. Sujet à mille besoins, & sensible au dernier point à l’action des corps extérieurs, il seroit bien-tôt détruit, si le soin de sa conservation ne nous occupoit. Ce n’est pas que tous les corps extérieurs nous fassent éprouver des sensations desagréables, quelques-uns semblent nous dédommager par le plaisir que leur action nous procure. Mais tel est le malheur de la condition humaine, que la douleur est en nous le sentiment le plus vif ; le plaisir nous touche moins qu’elle, & ne suffit presque jamais pour nous en consoler. En vain quelques Philosophes soutenoient, en retenant leurs cris au milieu des souffrances, que la douleur n’étoit point un mal : en vain quelques autres plaçoient le bonheur suprème dans la volupté, à laquelle ils ne laissoient pas de se refuser par la crainte de ses suites : tous auroient mieux connu notre nature, s’ils s’étoient contentés de borner à l’exemption de la douleur le souverain bien de la vie présente ; & de convenir que sans pouvoir atteindre à ce souverain bien, il nous étoit seulement permis d’en approcher plus ou moins, à proportion de nos soins & de notre vigilance. Des réflexions si naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même, & libre de préjugés, soit d’éducation, soit d’étude : elles seront la suite de la premiere impression qu’il recevra des objets ; & l’on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvemens de l’ame, précieux pour les vrais sages, & dignes d’être observés par eux, mais négligés ou rejettés par la Philosophie ordinaire, dont ils démentent presque toujours les principes.
La nécessité de garantir notre propre corps de la douleur & de la destruction, nous fait examiner parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles ou nuisibles, pour rechercher les uns & fuir les autres. Mais à peine commençons-nous à parcourir ces objets, que nous découvrons parmi eux un grand nombre d’êtres qui nous paroissent entierement semblables à nous, c’est-à-dire, dont la forme est toute pareille à la nôtre, & qui, autant que nous en pouvons juger au premier coup d’œil, semblent avoir les mêmes perceptions que nous : tout nous porte donc à penser qu’ils ont aussi les mêmes besoins que nous éprouvons, & par conséquent le même intérêt de les satisfaire ; d’où il résulte que nous devons trouver beaucoup d’avantage à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le principe & le soutien de cette union, & demande nécessairement l’invention des signes ; telle est l’origine de la formation des sociétés avec laquelle les langues ont dû naître.
Ce commerce que tant de motifs puissans nous engagent à former avec les autres hommes, augmente bientôt l’étendue de nos idées, & nous en fait naître de très-nouvelles pour nous, & de très éloignées, selon toute apparence, de celles que nous aurions eues par nous-mêmes sans un tel secours. C’est aux Philosophes à juger si cette communication réciproque, jointe à la ressemblance que nous appercevons entre nos sensations & celles de nos semblables, ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible que nous avons à supposer l’existence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans mon sujet, je remarquerai seulement que l’agrément & l’avantage que nous trouvons dans un pareil commerce, soit à faire part de nos idées aux autres hommes, soit à joindre les leurs aux nôtres, doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée, & à la rendre la plus utile pour nous qu’il est possible. Mais chaque membre de la société cherchant ainsi à augmenter pour lui-même l’utilité qu’il en retire, & ayant à combattre dans chacun des autres un empressement égal au sien, tous ne peuvent avoir la même part aux avantages, quoique tous y ayent le même droit. Un droit si légitime est donc bientôt enfreint par ce droit barbare d’inégalité, appellé loi du plus fort, dont l’usage semble nous confondre avec les animaux, & dont il est pourtant si difficile de ne pas abuser. Ainsi la force, donnée par la nature à certains hommes, & qu’ils ne devroient sans doute employer qu’au soutien & à la protection des foibles, est au contraire l’origine de l’oppression de ces derniers. Mais plus l’oppression est violente, plus ils la souffrent impatiemment, parce qu’ils sentent que rien de raisonnable n’a dû les y assujettir. De-là la notion de l’injuste, & par conséquent du bien & du mal moral, dont tant de Philosophes ont cherché le principe, & que le cri de la nature, qui retentit dans tout homme, fait entendre chez les Peuples même les plus sauvages. De-là aussi cette loi naturelle que nous trouvons au-dedans de nous, source des premieres lois que les hommes ont dû former : sans le secours même de ces lois elle est quelquefois assez forte, sinon pour anéantir l’oppression, au moins pour la contenir dans certaines bornes. C’est ainsi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos semblables, produit en nous la connoissance réfléchie des vertus opposées à ces vices ; connoissance précieuse, dont une union & une égalité parfaites nous auroient peut-être privés....."

D'Alembert va donc écrire à grands traits l'histoire des progrès de l'esprit humain, et traiter cette histoire en philosophe, c'est-à-dire qu'il a, en l'absence de témoignages impossibles à retrouver, raconté comment et quand les sciences ont dû, naître et engendrer d'autres sciences à leur suite...
Envisagées sous le premier point de vue, qui est le point de vue encyclopédique, les différentes sciences sont unies les unes aux autres par une chaine dont il faut retrouver chaque élément. Mais, pour mieux établir cette filiation encyclopédique des sciences entre elles, d'Alembert s'efforce d'abord de retrouver, dans le passé le plus lointain de l'humanité, l'origine même des sciences et leur filiation historique, c'est- à-dire les causes qui les ont fait naître les unes à la suite des autres et celles-ci à l'occasion de celles-là. Il y a plus : toute science n'étant qu'une combinaison des idées que nous nous faisons sur tels objets particuliers, si l'on veut pousser l'analyse jusqu'au bout et remonter à la source même de nos connaissances, il faut surprendre, pour ainsi dire, à leur naissance, les premières idées qui surgissent en nous et faire ainsi comme l'histoire ancienne de l'esprit humain. Et enfin, l'idée elle-même n'est pas le fait primitif de cette histoire, car l'idée vient de la sensation.
Que nous apprennent donc nos sensations? Notre existence d'abord, puisque nos sensations, c'est nous-mêmes ; en second lieu les corps, et, avant tout, le nôtre ; car, s'il est, comme tous les autres, extérieur à nous, il est aussi le plus voisin de nous-mêmes. Puis, et c'est la troisième conquête de l'esprit, la nécessité de conserver notre corps nous fait examiner, parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être ou utiles ou nuisibles, pour nous amener peu à peu à nous approprier les uns et à nous garder des autres. Faisons maintenant un pas de plus : parmi ces êtres qui nous sont extérieurs, nous en remarquons qui sont semblables à nous et nous en concluons qu'ils ont les mêmes besoins que nous et que, dès lors, nous avons intérêt, eux et nous, à nous unir et à nous entr'aider et c'est dans ce but que les hommes inventent le langage et la société.
Cette société est à peine formée, que les plus forts s'empressent d'opprimer les plus faibles : ceux-ci se demandent alors s'il y a à leur oppression une raison valable et, n'en trouvant aucune, ils protestent : ce cri de la nature, c'est le commencement de la morale, car c'est l'affirmation d'un droit naturel qui dormait au fond de nos consciences et qu'a subitement réveillé la première violence sans raison et, désormais sans justice.
Cependant le corps, menacé de toutes parts et par des ennemis de toute nature, nous ramène bientôt à lui-même et à la nécessité de lui chercher au dehors des auxiliaires qui l'aident, à vivre d'abord, puis à vivre commodément et nous voici sur le chemin des sciences salutaires et des arts utiles. Sur ce chemin-là, les hommes ont eu trois stades à parcourir. Dans le premier, ils ont étudié la nature et, essayant d'en tirer parti, ils ont inventé l'agriculture et la médecine : il fallait songer d'abord à se nourrir et à se conserver. Mais, après avoir combiné réellement les corps dont ils faisaient usage et avoir ainsi créé une physique toute empirique (telles, l'agriculture et la médecine des premiers âges), les hommes ont peu à peu combiné, et cette fois, dans leur esprit seul, les propriétés les plus intellectuelles des corps, par exemple l'étendue et le nombre, et c'est ainsi que, dans le second stade, la géométrie et l'arithmétique ont pris naissance. Enfin, après avoir décomposé les corps et détaché d'eux les idées que nous en avons, pour fonder, sur chacune de ces idées abstraites, des sciences différentes, revenant sur nos pas, nous avons refait peu à peu le monde physique en rendant aux corps les propriétés qui les composent réellement : nous leur restituons, par exemple, l'impénétrabilité et le mouvement et nous avons la mécanique; puis, examinant à la fois les distances et les mouvements des corps célestes, nous fondons l'astronomie, qui est l'application la plus sublime de la géométrie et de la mécanique réunies. Ainsi, notre corps et ses besoins à satisfaire, tel fut le point de départ de nos premières investigations qui aboutirent finalement aux propriétés les plus générales de la matière, la grandeur et l'étendue : toutes nos connaissances relatives aux corps remplissent l'entre-deux.
Toutefois ces connaissances, si elles sont peut-être les premières en date, ne sont pas longtemps les seules auxquelles s'applique l'esprit humain : de bonne heure, en effet, l'avantage que les hommes ont trouvé à étendre et à combiner leurs idées leur a appris l'utilité qu'il y aurait, pour eux, à réduire en art la manière même d'acquérir ces idées et de les communiquer aux autres et cet art fut la Logique ; puis, pour mieux communiquer aux autres ses pensées, on ne se borna pas à les ordonner logiquement : on voulut aussi les exprimer le plus agréablement possible et, pour cela, on perfectionna les langues et on leur donna des lois par des Grammaires bien faites. Mais logique et grammaire ne s'adressaient qu'à l'esprit pour lui faire comprendre des idées : les hommes voulurent aussi parler au cœur de leurs semblables et faire partager à ceux-ci leurs sentiments et leurs passions et le génie humain enfanta les prodiges de l'Éloquence.
Et voici encore un nouveau progrès : on ne vivait jusqu'ici qu'avec ses contemporains ; on voulut à la fois et vivre dans le passé et parler aux générations futures et, de cette noble ambition d'étendre nos connaissances et de prolonger notre activité au-delà du présent, naquit l'Histoire, laquelle s'assura aussitôt ses deux auxiliaires : la Chronologie, qui place les hommes dans le temps, et la Géographie, qui les distribue dans l'espace.
On remarquera que, jusqu'à ce moment, nous n'avons énuméré que les idées primitives, qui nous viennent directement des corps et les sciences qui en sont résultées. Mais il est une autre source d'idées non moins fécondes que les premières : ce sont celles que nous nous formons nous- mêmes en imaginant des êtres semblables à ceux-là mêmes d'où nous étaient venues ces idées primitives. Tantôt c'était la nature même que nous interrogions pour lui dérober ses secrets et les réponses que nous faisait directement la nature, interprétées par notre intelligence, devenaient peu à peu les sciences du corps et de l'esprit : maintenant, c'est la nature imitée, et transfigurée aussi par cette imitation, qui va devenir indirectement l'objet des différents arts : architecture, peinture, sculpture, poésie et musique, dont le but commun est de charmer l'esprit et les sens et d'embellir la vie humaine. El ainsi, tout part de l'homme et tout s'y ramène : créés par l'homme, sciences et arts n'ont d'autre but que de satisfaire aux besoins de son corps et aux caprices de son imagination (L.Ducros).

L'arbre généalogique des sciences humaines ...
A partir de cette histoire philosophique, d'Alembert va ensuite dresser, au seuil de l'Encyclopédie, le tableau proprement encyclopédique, systématique, des sciences et des arts, ou, comme il l'appelle encore, l'arbre généalogique des sciences humaines ...
"On pourrait former l'arbre de nos connaissances, en les divisant, soit en naturelles et en révélées, soit en utiles et agréables, soit en évidentes, certaines, probables et sensibles, soit en connaissances des choses et connaissances des signes, et ainsi à l'infini. Nous avons choisi une division qui nous a paru satisfaire tout à la fois le plus qu'il est possible à l'ordre encyclopédique de nos connaissances et à l'ordre généalogique. Nous devons cette division à un auteur célèbre dont nous parlerons dans la suite de cette préface : nous avons pourtant cru devoir faire quelques changements dont nous rendrons compte. Mais nous sommes trop convaincus de l'arbitraire qui régnera toujours dans une pareille division pour croire que notre système soit l'unique ou le meilleur ; il nous suffira que notre travail ne soit pas entièrement désapprouvé par les bons esprits. Nous ne voulons point ressembler à cette foule de naturalistes qu'un philosophe moderne a eu tant de raison de censurer, et qui, occupés sans cesse à diviser les productions de la nature en genres et en espèces, ont consumé dans ce travail un temps qu'ils auraient beaucoup mieux employé à l'étude de ces productions mêmes. Que dirait-on d'un architecte qui, ayant à élever un édifice immense, passerait toute sa vie à en tracer le plan ; ou d'un curieux qui, se proposant de parcourir un vaste palais, emploierait tout son temps à en observer l'entrée ?
Les objets dont notre âme s'occupe sont ou spirituels ou matériels, et notre âme s'occupe de ces objets ou par des idées directes ou par des idées réfléchies. Le système des connaissances directes ne peut consister que dans la collection purement passive et comme machinale de ces mêmes connaissances ; c'est ce qu'on appelle mémoire. La réflexion est de deux sortes, nous l'avons déjà observé : ou elle rai- sonne sur les objets des idées directes, ou elle les imite.
Ainsi la mémoire, la raison proprement dite, et l'imagination, sont les trois manières différentes dont notre âme opère sur les objets de ses pensées. Nous ne prenons point ici l'imagination pour la faculté qu'on a de se représenter les objets, parce que cette faculté n'est autre chose que la mémoire même des objets sensibles, mémoire qui serait dans un continuel exercice si elle n'était soulagée par l'invention des signes. Nous prenons l'imagination dans un sens plus noble et plus précis, pour le talent de créer en imitant.
Ces trois facultés forment d'abord les trois divisions générales de notre système et les trois objets généraux des connaissances humaines : l'histoire qui se rapporte à la mémoire ; la philosophie qui est le fruit de la raison ; et les beaux-arts que l'imagination fait naître. Si nous plaçons la raison avant l'imagination, cet ordre nous paraît bien fondé, et conforme au progrès naturel des opérations de l'esprit : l'imagination est une faculté créatrice ; et l'esprit, avant de songer à créer, commence par raisonner sur ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Un autre motif qui doit déterminer à placer la raison avant l'imagination, c'est que dans cette dernière faculté de l'âmei les deux autres se trouvent réunies jusqu'à un certain point, et que la raison s'y joint à la mémoire. L'esprit ne crée et n'imagine des objets qu'en tant qu'ils sont semblables à ceux qu'il a connus par des idées directes et par des sensations : plus il s'éloigne de ces objets, plus les êtres qu'il forme sont bizarres et peu agréables. Ainsi dans l'imitation de la nature, l'invention même est assujettie à certaines règles ; et ce sont ces règles qui forment principalement la partie philosophique des Beaux-Arts, jusqu'à présent assez imparfaite, parce qu'elle ne peut être l'ouvrage que du génie, et que le génie aime mieux créer que discuter..."
L'observateur se place au-dessus du vaste labyrinthe des connaissances humaines et, de là, tente d'embrasser d'un seul coup d'œil les sciences et les arts, et noter leurs points de rencontre ou de confluence. Mais quelle méthode suivre pour bien tracer cette carte immense et rapprocher les diverses contrées de ce pays intellectuel ? Deux moyens possibles, l'un, de distribuer les sciences suivant la complexité, de plus en plus grande, de leur objet; l'autre, de les classer suivant les différentes facultés de l'esprit que les différentes sciences mettent en jeu. Une seconde classification moins naturelle que la première, plus arbitraire, mais c'est celle-ci que D'Alembert choisit, comme l'avaient fait Diderot dans son Prospectus et Bacon lui-même dans son arbre généalogique, lequel avait servi de modèle et à Diderot et à d'Alembert. Notre esprit n'ayant, en somme, que trois facultés principales, la mémoire, la raison et l'imagination, en les nommant dans l'ordre même où ces facultés s'éveillent pour s'appliquer aux objets qu'étudie notre esprit. Tenant compte de l'ordre historique suivi dans sa première partie, d'Alembert rappelle que des objets nous avons d'abord des connaissances directes, c'est- à-dire fournies directement et uniquement par eux sans le concours de notre réflexion et la faculté qui reçoit et conserve ces connaissances est la mémoire ; quant à notre réflexion, elle s'attache aux objets, soit pour les comprendre, et elle s'appelle la raison, soit pour les imiter, et elle est alors l' imagination. Et, à mesure que s'exercent ces trois facultés, nous voyons naître à leur suite trois ordres différents de connaissances : l'histoire, qui est l'œuvre de la mémoire; la philosophie, qui est le fruit de la raison; les beaux-arts, qu'enfante l'imagination.
Ces trois ordres de connaissances forment les trois maîtresses branches qui partent du tronc commun, l'entendement humain; et, à leur tour, elles se subdivisent en plusieurs rameaux, suivant qu'elles s'appliquent aux êtres matériels ou spirituels qui sont de leur domaine. Ainsi, les êtres à étudier étant Dieu, l'homme et la nature, on a, pour l'histoire, les trois subdivisions suivantes : histoire sacrée, qui se rapporte à Dieu, histoire civile, qui étudie l'homme, histoire soit des arts, soit des usages que les hommes ont tirés des productions de la nature. Il en va de même des autres facultés, raison et imagination. Cette distribution de nos connaissances, suivant nos trois facultés, présente encore ce curieux avantage qu'elle pourrait nous fournir trois divisions parallèles du monde littéraire en érudits, philosophes et beaux esprits, puisque la mémoire est l'apanage des premiers, la raison est la faculté par excellence des seconds, tandis que les derniers brillent par l'imagination.
"... Enfin, si on examine le progrès de la raison dans ses opérations successives, on se convaincra encore qu'elle doit précéder l'imagination dans l'ordre de nos facultés, puisque la raison, par les dernières opérations qu'elle fait sur les objets, conduit en quelque sorte à l'imagination : car ces opérations ne consistent qu'à créer, pour ainsi dire, des êtres généraux , qui, séparés de leur sujet par abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens. Aussi la métaphysique et la géométrie sont, de toutes le sciences qui appartiennent à la raison celles où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux esprits détracteurs de la géométrie , ils ne se croient pas sans doute si près d'elle, et il n'y a peut- être que la métaphysique qui les en sépare. L'imagination, dans un géomètre qui crée, n'agit pas moins que dans un poète qui invente. Il est vrai qu'ils opèrent différemment sur leur objet : le premier le dépouille et l'analyse ; le second le compose et l'embellit. Il est encore vrai que cette manière différente d'opérer n'appartient qu'à différentes sortes d'esprits, et c'est pour cela que les talents du grand géomètre et du grand poète ne se trouveront peut-être jamais ensemble ; mais soit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un de l'autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands hommes de l'antiquité, Archimède est peut-être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère. J'espère qu'on pardonnera cette digression à un géomètre qui aime son art, mais qu'on n'accusera point d'être admirateur outré, et je reviens à mon sujet.
La distribution générale des êtres en spirituels et en matériels fournit la sous-division de trois branches générales. L'histoire et la philosophie s'occupent également de ces deux espèces d'êtres, et l'imagination ne travaille que d'après les êtres purement matériels : nouvelle raison pour la placer la dernière dans l'ordre de nos facultés. A la tête des êtres spirituels est Dieu, qui doit tenir le premier rang par sa nature et par le besoin que nous avons de le connaître ; au-dessus de cet Être suprême sont les esprits créés, dont la révélation nous apprend l'existence ; ensuite vient l'homme, qui, composé de deux principes, tient par son âme aux esprits, et par son corps au monde matériel ; et enfin ce vaste univers que nous appelons monde corporel ou la nature. Nous ignorons pourquoi l'auteur célèbre, qui nous sert de guide dans cette distribution, a placé la nature avant l'homme dans son système : il semble, au contraire, que tout engage à placer l'homme sur le passage qui sépare Dieu et les esprits d'avec les corps...."


On peut compléter cet extrait par le premier chapitre de l'Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines (tome l des Œuvres de D'Alembert, Paris, 1821, 5 vol. in-8")...
TABLEAU DE L'ESPRIT HUMAIN AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE
"Il semble que depuis trois cents ans, la nature ait destiné le milieu de chaque siècle à être l'époque d'une révolution dans l'esprit humain, La prise de Constantinople, au milieu du XVe siècle, a fait renaître les lettres en Occident. Le milieu du XVIe a vu changer rapidement la religion et le système d'une grande partie de l'Europe; les nouveaux dogmes des réformateurs, soutenus d'une part et combattus de l'autre avec cette chaleur que les intérêts de Dieu bien ou mal en- tendus peuvent seuls inspirer aux hommes, ont également forcé leurs partisans et leurs adversaires à s'instruire ; l'émulation animée par ce grand motif a multiplié les connaissances de tout genre ; et la lumière, née du sein de l'erreur et du trouble, s'est répandue sur les objets même qui étaient les plus étrangers à ces disputes. Enfin Descartes, au milieu du XVIIe siècle, a fondé une nouvelle philosophie, persécutée d'abord avec fureur, embrassée ensuite avec superstition, et réduite aujourd'hui à ce qu'elle contient d'utile et de vrai.
Pour peu qu'on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, les événements qui nous agitent, ou du moins qui nous occupent, nos mœurs, nos ouvrages, et jusqu'à nos entretiens, il est difficile de ne pas apercevoir qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées ; changement qui, par sa rapidité» semble nous en promettre un plus grand encore. C'est au temps à fixer l'objet, la nature et les limites de cette révolution, dont notre postérité connaîtra mieux que nous les inconvénients et les avantages.
Tout siècle qui pense bien ou mal, pourvu qu'il croie penser et qu'il pense autrement que le siècle qui l'a précédé, se pare du titre de philosophe ; comme on a souvent honoré du titre de sages ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire leurs contemporains. Notre siècle s'est donc appelé par excellence le siècle de la philosophie ; plusieurs écrivains lui en ont donné le nom, persuadés qu'il en rejaillirait quelque éclat sur eux ; d'autres lui ont refusé cette gloire dans l'impuissance de la partager.
Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses ; la géométrie, en reculant ses limites, a porté son flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaient le plus près d'elle ; le vrai système du monde a été connu, développé et perfectionné ; la même sagacité qui s'était assujetti les mouvements des corps célestes, s'est portée sur les corps qui nous environnent ; en appliquant la géométrie à l'étude de ces corps, ou en essayant de l'y appliquer, on a su apercevoir et fixer les avantages et les abus de cet emploi ; en un mot, depuis la terre jusqu'à Saturne, depuis l'histoire des cieux jusqu'à celle des insectes, la physique a changé de face. Avec elle, presque toutes les autres sciences ont pris une nouvelle forme, et elles le devaient en effet. Quelques réflexions vont nous en convaincre.
L'étude de la nature semble être, par elle-même, froide et tranquille, parce que la satisfaction qu'elle procure est un sentiment uniforme, continu et sans secousses, et que les plaisirs, pour être vifs, doivent être séparés par des inter- valles, et marqués par des accès. Néanmoins l'invention et l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espèce d'enthousiasme qui accompagne les découvertes, une certaine élévation d'idées que produit en nous le spectacle de l'univers, toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive ; cette fermentation agissant en tous sens par sa nature, s'est portée avec une espèce de violence sur tout ce qui s'est offert à elle, comme un fleuve qui a brisé ses digues. Or les hommes ne reviennent guère sur un objet qu'ils avaient négligé depuis longtemps, que pour réformer bien ou mal les idées qu'ils s'en étaient faites. Plus ils sont lents à secouer le joug de l'opinion, plus aussi, dès qu'ils l'ont brisé sur quelques points, ils sont portés à le briser sur tout le reste ; car ils fuient encore plus l'embarras d'examiner, qu'ils ne craignent de changer d'avis ; et dès qu'ils ont pris une fois la peine de revenir sur leurs pas, ils regardent et reçoivent un nouveau système d'idées comme une sorte de récompense de leur courage et de leur travail. Ainsi, depuis les principes des sciences profanes jusqu'aux fondements de la révélation, depuis la métaphysique jusqu'aux matières de goût, depuis la musique jusqu'à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu'aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu'à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu'aux lois arbitraires des nations, en un mot, depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéressent le plus faible- ment, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumière sur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de cette effervescence générale des esprits, comme l'effet du flux et du reflux de l'Océan est d'apporter sur le rivage quelques matières, et d'en éloigner les autres."

1752 - Arrêt du Conseil interdisant l'Encyclopédie, le 7 février 1752 : "Le roi, s'étant fait rendre compte de ce qui s'est passé au sujet d'un ouvrage appelé Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, dont il n'y a encore que deux volumes imprimés, S. M. a reconnu que, dans ces deux volumes, on a affecté d'insérer plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte et, sous des noms obscurs et équívoques, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des mœurs, de l'irreligion et de l'incrédulité. S. M., toujours attentive à ce qui touche l'ordre public et l'honneur de la religion, ordonne que les deux premiers volumes de l'ouvrage intitulé Encyclopédie... seront et demeureront supprimés."
L'arrêt du Conseil d'Etat supprime donc les deux premiers volumes et suspend la publication de l'ouvrage pendant dix-huit mois. Mais Les quatre volumes suivants paraissent sans encombre...
1753-1757 - L'Encyclopédie est réautorisée en 1753, de 1753 à 1757, publication paisible des sept premiers volumes... octobre 1753 (Cha- Consécration), octobre 1754 (Conseil - Dizier, Saint), novembre 1755 (Do - Esymnete), octobre 1756 (Et - Fne), et novembre 1757 (Foang- Gythium)...

1757-1759, crise terrible de trois années, pendant lesquelles la liberté de Diderot est dix fois menacée, et qui aboutit, le 8 mars 1759, au coup terrible de la révocation du privilège. D'Alembert va se retirer, une attitude discutable ....
Quels sont les adversaires des Encyclopédistes? Louis XV, qui n'aimait certes pas les philosophes, mais étant, comme a dit Voltaire, « indifférent à tout », il ne s'occupait pas d'eux : en quoi il avait tort, surtout aux yeux des philosophes, qui auraient attaché plus de prix à ses faveurs qu'à celles d'un Frédéric ou d'une Catherine. Mais Louis XV ne s'avisait pas de lutter de générosité avec Frédéric ni d'amabilité avec Catherine et quant aux lois et mesures qui entravait la libre expression et la propagande des doctrines philosophiques, elles n'étaient dans ses mains que des armes défensives. En dehors du roi, il y avait, à la Cour, un petit cercle qui se groupait autour de la reine et du dauphin, «le parti dévot d'un mot un roi était tout à ses plaisirs, une reine toute à ses dévotions, et un dauphin, aussi dévot qu'elle, mais plus intelligent et très instruit, mais qui vivait dans une sorte de retraite, sans crédit auprès des ministres, sans influence auprès de son père. À la tête du parti dévot était Jean-François Boyer, jadis moine de l'ordre des Théatins, puis évêque de Mirepoix et précepteur du dauphin ; ennemi des Jansénistes, c'est lui qui attira l'attention du roi sur les dangers que l'Encyclopédie faisait courir à la religion. Mais il fut peu aimé à la cout et mourut en 1755. Quant aux Courtisans, peu d'ennemis bien acharnés contre l'Encyclopédie.
Tout autrement redoutables furent ses adversaires du Clergé et du Parlement : «Nul ouvrage, dira Malesherbes que la providence, pour les Encyclopédistes, plaça à la direction de la librairie de 1750 à 1763, le temps qu'il fallut pour stabiliser leur ouvrage. Le clergé dénonça les ouvrages et anathématisera les auteurs, le Parlement brûlera les premiers et décrètera les seconds de prise de corps.
Le clergé? C'est que pour les Encyclopédistes, le clergé vivait des abus et des préjugés qu'ils combattaient. La sentinelle avancée de l'Église, la Sorbonne, de même qu'elle avait combattu Descartes au siècle passé, devait maintenant guerroyer avec plus d'acharnement encore contre des novateurs autrement dangereux et elle leur déclara la guerre dès les premiers volumes. Une Encyclopédie qui pourtant n'exposait et ne vulgarisait que des sciences cultivées au dix-huitième siècle et, particulièrement, les sciences physiques et naturelles; mais n'était-ce pas les progrès de ces mêmes sciences qui, au siècle dernier avaient, pour ainsi dire, conspiré, en même temps que le déisme anglais, contre les dogmes de la religion établie? La guerre fut implacable des deux côtés, parce que les ennemis étaient irréconciliables comme leurs principes. Mais vint un moment, vers 1760, où, les philosophes devinrent les maitres incontestés de l'opinion, mais jusque-là ils s'étaient contentés de "nettoyer", sans bâtir quoique ce soit. C'est ce qu'écrit Mme du Deffand un jour à Voltaire : "Vous détruisez toutes les erreurs ; mais que mettez-vous à la place ?"..
En 1770, surgira une oeuvre plus doctrinale que toutes les autres, qui détruit et prétend édifier et enseigner tout ce qui doit remplacer et la superstition et le despotisme, c'est tout un système nouveau du monde et de la société, c'est le Système de la nature, de d'Holbach..
Mais en fin de compte, le Clergé n'obtint que peu de choses à l'encontre des Encyclopédistes. De 1753, jusqu'à la fin de 1757, les auteurs de l'Encyclopédie ont joui d'une assez grande tranquillité. Le combat auquel semble se livrer parlementaires, jésuites et philosophes, prend parfois des allures de courses à la protection royale plus qu'à toute guerre d'idées.. Et le 10 mars 1760, les philosophes font définitivement la conquête de l'Académie...

1757, le septième volume, dont les 3500 souscripteurs attestent le succès grandissant de l'entreprise, déchaîne un nouvel orage, plus grave que le premier. C'est lui en effet qui contient l'article "Genève", de d'Alembert, occasion d'une rupture avec J.-J. Rousseau (Lettres sur les spectacles, mars 1758).
"On ne souffre point à Genève de comédie ; ce n'est pas qu'on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes ; mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Cependant, né serait-il pas possible de remédier à cet inconvénient, par des lois sévères et bien exécutées sur la conduite des comédiens? par ce moyen Genève aurait des spectacles et des mœurs, et jouirait de l'avantage des uns et des autres : ces représentations théâtrales formeraient le goût des citoyens, et leur donneraient une finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu'il est très difficile d'acquérir sans ce secours. La littérature en profiterait, sans que le libertinage fit des progrès, et Genève réunirait à la sagesse de Lacédémone la politesse d'Athènes, Une autre considération, digne d'une république si sage et si éclairée, devrait peut-être l'engager à permettre les spectacles. Le préjugé barbare contre la profession de comédien, l'espèce d'avilissement où nous avons mis ces hommes si nécessaires au progrès et au soutien des arts, est certainement une des principales causes qui contribuent au dérèglement que nous leur reprochons ; ils cherchent à se dédommager par les plaisirs, de l'estime que leur état ne peut obtenir. Parmi nous, un comédien qui a des mœurs est doublement respectable ; mais à peine lui en savons-nous gré. Le traitant qui insulte à l'indigence publique et qui s'en nourrit, le courtisan qui rampe et qui ne paie point ses dettes : voilà l'espèce d'hommes que nous honorons le plus. Si les comédiens étaient non seulement soufferts à Genève, mais contenus d'abord par des règlements sages, protégés ensuite, et même considérés dès qu'ils en seraient dignes, enfin absolument placés sur la même ligne que les autres citoyens, cette ville aurait bientôt l'avantage de posséder ce qu'on croit si rare, et ce qui ne l'est que par notre faute, une troupe de comédiens estimable. Ajoutons que cette troupe deviendrait bientôt la meilleure de l'Europe ; plusieurs personnes pleines de goût et de dispositions pour le théâtre, et qui craignent de se déshonorer parmi nous en s'y livrant, accourraient à Genève pour cultiver, non seulement sans honte, mais même avec estime, un talent si agréable et si peu commun. Le séjour de cette ville, que bien des Français regardent comme triste par la privation des spectacles, deviendrait alors le séjour des plaisirs honnêtes, comme il est celui de la philosophie et de la liberté..."

1758-1759 - En 1758, Rousseau se déclara offensé par l'article que d'Alembert avait écrit sur Genève, auquel il répondit par la Lettre sur les spectacles. Le livre d'Helvétius, "L'Esprit", servit, comme précédemment la thèse de l'abbé de Prades, de prétexte à une nouvelle condamnation de la publication de l'Encyclopédie. Un arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 1759 retirait le privilège, et un autre arrêt du 21 juillet ordonnait aux libraires de rendre aux souscripteurs la somme de soixante-douze livres. Cette fois, d'Alembert céde, ne pouvant compter, écrit-il à Voltaire, le 28 janvier 1758, sur M. de Malesherbes. « Si vous connaissiez M. de Malesherbes, si vous saviez combien il a peu de nerf et de consistance, vous seriez convaincu que nous ne pourrions compter sur rien avec lui, même après les promesses les plus positives. »
Et pourtant M. de Malesherbes prêtait à l'Encyclopédie l'appui le plus positif. Mais la question de l'argent est alors cruciale et sujet à bien des attitudes que l'on peut juger singulières, ainsi de celle de Diderot lui-même confirmée en détails dans une lettre à Sophie du 11 octobre 1759 ...
« Je vous ai promis le détail de ce qui s'est dit entre d' Alembert et moi ; le voici presque mot pour mot. I
l débuta par un exorde assez doux : c'était notre première entrevue depuis la mort de mon père et mon voyage de province. Il me parla de mon frère, de ma sœur, de mes arrangements domestiques, de ma petite fortune et de tout ce qui pouvait m'intéresser et me disposer à l'entendre favorablement ; puis il ajouta (car il en fallait bien venir à un objet auquel j'avais la malignité de me refuser) : « Cette absence a dû ralentir un peu votre travail. — Il est vrai, mais depuis deux mois, j'ai bien compensé le temps perdu, si c'est perdre le temps que d'assurer son sort à venir. — Vous êtes donc fort avancé ? — Mes articles de philosophie sont tous faits ; ce ne sont ni les moins difficiles, ni les plus courts ; et la plupart des autres sont ébauchés. — Je vois qu'il est temps que je m'y mette. — Quand vous voudrez. — Quand les libraires voudront. Je les ai vus, je leur ai fait des propositions raisonnables ; s'ils les acceptent, je me livre à l'Encyclopédie comme auparavant ; sinon, je m'acquitterai de mes engagements à la rigueur. L'ouvrage n'en sera pas mieux, mais ils n'auront rien de plus à me demander. — Quelque parti que vous preniez, j 'en serai content.
— Ma situation commence à devenir désagréable : on ne paye point ici nos pensions ; celles de Prusse sont arrêtées ; nous ne touchons plus de jetons à l'Académie française. Je n'ai d'ailleurs, comme vous savez, qu'un revenu fort modique ; je ne dois ni mon temps ni ma peine à personne, et je ne suis plus d'humeur à en faire présent à ces gens-là. — Je ne vous blâme pas ; il faut que chacun pense à soi. — Il reste encore six à sept volumes à faire. Ils me donnaient, je crois, 500 francs par volume lorsqu'on imprimait, il faut qu'ils me les continuent, c'est un millier d'écus qu'il leur en coûtera ; les voilà bien à plaindre ! mais ils peuvent compter qu'avant Pâques prochain le reste de ma besogne sera prêt. — Voilà ce que vous leur demandez ? — Oui, qu'en pensez-vous ?
— Je pense qu'au lieu de vous fâcher, comme vous fîtes, il y a six mois, quand nous nous assemblâmes, pour délibérer sur la continuation de l'ouvrage, si vous eussiez fait ces propositions aux libraires, ils les eussent acceptées sur-le- champ ; mais aujourd'hui qu'ils ont les plus fortes raisons d'être dégoûtés de vous, c'est autre chose. — Et quelles sont ces raisons ? — Vous me les demandez ? — Sans doute.
— Je vais donc vous les dire. Vous avez un traité avec les libraires ; vos honoraires sont stipulés, vous n'avez rien à exiger au delà. Si vous avez travaillé plus que vous ne deviez, c'est par intérêt pour l'ouvrage, c'est par amitié pour moi, c'est par égard pour vous-même : on ne paye point en argent ces motifs-là. Cependant, ils vous ont envoyé vingt louis à chaque volume ; c'est cent quarante louis que vous avez reçus et qui ne vous étaient pas dus. Vous projetez un voyage à Wesel, dans un temps où vous leur étiez nécessaire ici ; ils ne vous retiennent point ; au contraire, vous manquez d'argent, ils vous en offrent. Vous acceptez deux cents louis; vous oubliez cette dette pendant deux ou trois ans. Au bout de ce terme assez long, vous songez à vous acquitter. Que font-ils ? Ils vous remettent votre billet déchiré, et ils paraissent trop contents de vous avoir servi. Ce sont des procédés que cela, et vous êtes plus fait, vous , pour vous en souvenir, que pour les avoir.
Cependant vous quittez une entreprise à laquelle ils ont mis toute leur fortune ; une affaire de deux millions est une bagatelle qui ne mérite pas l'attention d'un philosophe comme vous. Vous débauchez leurs travailleurs, vous les jetez dans un monde d'embarras dont ils ne se tireront pas sitôt. Vous ne voyez que la petite satisfaction de faire parler de vous un moment. Ils sont dans la nécessité de s'adresser au public ; il faut voir comment ils vous ménagent et me sacrifient.
— C'est une injustice. — Il est vrai, mais ce n'est pas à vous à le leur reprocher. Ce n'est pas tout. Il vous vient en fantaisie de recueillir différents morceaux dans l'Encyclopédie ; rien n'est plus contraire à leurs intérêts ; ils vous le représentent, vous insistez, l'édition se fait , ils en avancent les frais, et vous en partagez le profit. Il semble qu'ils étaient en droit, après avoir payé deux fois votre ouvrage, de le regarder comme le leur. Cependant vous allez chercher un libraire au loin, et vous lui vendez pêle-mêle ce qui ne vous appartient pas. — Ils m'ont donné mille sujets de mécontentement.
— Quelle défaite. Il n'y a pas de petites choses entre amis. Tout se pèse, parce que l'amitié est un commerce de pureté et de délicatesse, mais les libraires sont-ils vos amis ? votre conduite avec eux est horrible. S'ils ne le sont pas, vous n'avez rien à leur reprocher. Savez-vous, d'Alembert, à qui il appartient de juger entre eux et vous ? Au public. S'ils faisaient un manifeste et qu'ils le prissent pour arbitre, croyez-vous qu'il prononçât en votre faveur ? Non, mon ami ; il laisserait de côté toutes les minuties, et vous seriez couvert de honte. — Quoi, Diderot, c'est vous qui prenez le parti des libraires !
— Les torts qu'ils ont avec moi ne m'empêchent point de voir ceux que vous avez avec eux. Après toute cette ostentation de fierté, convenez que le rôle que vous faites à présent est bien misérable. Quoi qu'il en soit, votre demande me paraît petite, mais juste. S'il n'était pas si tard, j'irais leur parler. Demain, je pars pour la campagne; je leur écrirai de là. A mon retour, vous saurez la réponse ; en attendant, travaillez toujours. S'ils vous refusent les mille écus dont il s'agit, moi je vous les offre.
— Vous vous moquez. Vous êtes-vous attendu que j'accepterais ? — Je ne sais, mais ils ne vous aviliraient pas de ma main. — Dites que je ne m'engage que pour ma partie. — Ils n'en veulent pas davantage, ni moi non plus. — Plus de préface. — Vous en voudriez faire par la suite que vous n'en seriez pas le maître. — Et pourquoi cela ? — C'est que les précédentes nous ont attiré toutes les haines dont nous sommes chargés. Qui est-ce qui n'y est pas insulté ?
— Je reverrai les épreuves à l'ordinaire, supposé que j'y sois. Maupertuis est mort. Les affaires du roi de Prusse ne sont pas désespérées. Il pourrait m'appeler. — On dit qu'il vous nomme à la présidence de son Académie. » II m'a écrit ; mais cela n'est pas fait. — Au temps comme au temps. Bonsoir. »
La conversation n'était point faite pour arranger les choses ; D'Alembert voulait de l'argent, Diderot lui en offre, agrémenté de reproches assez durs, d'autant qu'ils sont mérités. Ce ne fut pas la rupture, mais un éloignement qui ne connut que de rares retours....
1758 - La publication du livre "De l'esprit" d'Helvétius (juillet 1758), dénoncé comme étant un résumé des doctrines encyclopédistes, poursuivi et condamné au feu, porte à l'Encyclopédie le coup de grâce : le 8 mars 1759 le Conseil d'Etat non seulement supprime les volumes parus (on en était à la lettre H) mais encore retire le privilège du libraire. Diderot, abandonné par d'Alembert, esprit hardi mais caractère timoré, continue néanmoins la publication de l'ouvrage avec la permission tacite du gouvernement, qui se préoccupait des intérêts pécuniaires en jeu (plus d'un million était engagé dans l'affaire) et voulait empêcher 'l'œuvre de se poursuivre à l'étranger. Il est vrai qu'à mesure que l'Encyclopédie paraissait en France, des contrefaçons en étaient publiées à l'étranger, à Genève (en 28 vol., 1758-71), à Lucques, à Livournes. Ajoutons qu'au final le pouvoir royal alterna indulgence et sévérité au gré des influences religieuses et politiques (jésuites, jansénistes, pamphlétaires, Parlement) et les amis des philosophes finirent par l'emporter...
Diderot à Voltaire, le 19 février 1758, après la défection de D'Alembert :
"... Votre avis serait que nous quittassions tout à fait l'Encyclopédie ou que nous allassions la continuer en pays étranger, ou que nous obtinssions justice et liberté dans celui-ci. Voilà qui
est à merveille; mais le projet d'achever en pays étranger est une chimère. Ce sont les libraires qui ont traité avec nos collègues; les manuscrits qu'ils ont acquis ne nous appartiennent pas, et ils nous appartiendraient, qu'au défaut des planches nous n'en ferions aucun usage. Abandonner l'ouvrage, c'est tourner le dos sur la brèche, et faire ce que désirent les coquins qui nous persécutent. Si vous saviez avec quelle joie ils ont appris la désertion de d'Alembert et toutes les manœuvres qu'ils emploient pour l'empêcher de revenir! ... Un autre se réjouirait en secret de sa désertion: il y verrait de l'honneur, de l'argent et du repos à gagner. Pour moi, j'en suis désolé, et je ne négligerai rien pour le ramener. Voici le moment de lui montrer combien je lui suis attaché, et je ne manquerai ni à moi-même, ni à lui. Mais, pour Dieu, ne me croisez pas. Je sais tout ce que vous pouvez sur lui, et c'est inutilement que je lui prouverai qu'il a tort, si vous lui dites qu'il a raison. D'après tout cela, vous croirez que je tiens beaucoup à l'Encyclopédie, et vous vous tromperez. Mon cher maître, j'ai la quarantaine passée; je suis las de tracasseries. Je crie, depuis le matin jusqu'au soir: le repos, le repos, et il n'y a guère de jour que je ne sois tenté d'aller vivre obscur et mourir tranquille au fond de ma province. Il vient un temps où toutes les cendres sont mêlées. Alors que m'importera d'avoir été Voltaire ou Diderot, et que ce soient vos trois syllabes ou les trois miennes qui restent? Il faut travailler, il faut être utile, on doit compte de ses talents, etc... Etre utile aux hommes! Est-il bien sûr qu'on fasse autre chose que les amuser, et qu'il y ait grande différence entre le philosophe et le joueur de flûte? lls écoutent l'un et l'autre avec plaisir ou dédain, et demeurent ce qu'ils sont. Les Athéniens n'ont jamais été plus méchants qu'au temps de Socrate, et ils ne doivent peut-être à son existence qu'un crime de plus. Qu'il y ait là dedans plus d'humeur que de bon sens, je le veux; et je reviens à l'Encyclopédie. Les libraires sentent aussi bien que moi que d'Alembert n'est pas un homme facile à remplacer; mais ils ont trop d'intérêt au succès de leur ouvrage pour se refuser aux dépenses..."

1758, la politique de Choiseul - En octobre 1758, le duc de Choiseul fut nommé secrétaire d'État aux Affaires étrangères (il fut ensuite chargé aussi de la Guerre et de la Marine) ; officier général, puis ambassadeur, ce courtisan habile s'efforça de se concilier l'opinion publique. Dans la querelle qui opposait les jésuites aux Parlements de Paris et de province, favorables aux thèses gallicanes et aux jansénistes, Choiseul renonça a soutenir la Compagnie de Jésus, comme l'avait toujours fait dans le passé la monarchie française. A l'occasion de la banqueroute du père La Valette aux Antilles, le Parlement de Paris avait rendu un arrêt qui condamnait l'activité et les constitutions mêmes de l'ordre; Choiseul poussa le roi à sanctionner officiellement cet arrêt en 1764 et enfin à bannir les jésuites de France par un édit promulgué en 1767.
A l'extérieur, la guerre de Sept Ans avait commencé par quelques succès français, mais le génie militaire de Frédéric II avait retourné la situation a la suite de ses victoires de Rossbach et de Leuthen à la fin de 1757. Ni Richelieu ni Soubise n'étaient capables de mener des opérations efficaces contre l'armée prussienne. A son arrivée au pouvoir, Choiseul essaya d'éviter une extension de la guerre en Allemagne, mais les troupes françaises se contentèrent de lutter contre les troupes anglaises pour reprendre le Hanovre : elles n'y parviendront pas, en raison de l'incompétence des généraux jaloux les uns des autres.
Malgré les efforts de Choiseul sur le plan diplomatique - il réussit à grouper en un "pacte de famille" tous les Bourbons - la France dut accepter le traité de Paris qui cédait aux Anglais de nombreuses colonies françaises (10 février), et le 15 février 1763 le traité d'Hubertbourg rétablit le statu quo en Allemagne. Profondément ulcéré par cette conclusion désastreuse de sept années d'une guerre ruineuse, Choiseul fit un effort vigoureux pour rétablir la discipline, former des officiers expérimentés, perfectionner l'artillerie. Il réorganisa également la marine, créa de nouveaux arsenaux, augmenta le nombre des navires de guerre.
En 1766, à la mort du roi Stanislas, l'annexion de la Lorraine à la France se fit selon les traités antérieurs. Mais en 1768, l'annexion de la Corse, qui appartenait jusque-là en droit à la République de Gênes, fut la conséquence de l'action diplomatique habile et efficace du secrétaire d'État.
(Jacques Wilbault (1729-1816, Le duc de Choiseul, avec Mme de Brionne et l’Abbé Barthélemy, 1775, Getty Center, Los Angeles)

1760-1764
Diderot continua donc tout seul à diriger l'impression de l'Encyclopédie, soutenu par M. de Malesherbes, le duc de Richelieu, le lieutenant de police Sartine, Mme Geoffrin, Mme de Pompadour. La guerre de libelles continuait avec les ennemis des philosophes, qui sont aussi les ennemis de Voltaire, les Abraham Chaumeix, les Fréron, les Palissot. En 1760 parut la comédie des Philosophes. On sait comment Voltaire, dans les Mélanges surtout, a traité tous ces folliculaires ; Le Neveu de Rameau contient la vengeance de Diderot à l'égard de Palissot.
1762 - Objet d'un Décret de prise de corps en date du 9 juin 1762, Jean-Jacques Rousseau, l'auteur d'Emile, quitte Montmorency vers la Suisse, en évitant Genève, où son livre avait été brûlé, et lui-même décrété, le 18 juin, neuf jours après l'avoir été à Paris. Il avait résolu de s'établir à Yverdun, à la sollicitation de M. Roguin, lorsqu'il apprit que le sénat de Berne n'était pas disposé à le laisser en repos dans sa retraite. Genève et la France lui étant fermés, il se trouvait fort en peine pour trouver un refuge, quand madame Boy de la Tour lui pro posa d'aller s'établir dans une maison que possédait son fils, au village de Motiers, dans le Val-Travers, comté de Neufchâtel : «L'offre, dit-il, venait d'autant plus à propos, que, dans les États du roi de Prusse, je devais naturellement être à l'abri des persécutions, et qu'au moins, la religion n'y pouvait guère servir de prétexte.» Mais la publication des "Lettres de la Montagne", ayant produit à Genève une effervescence qui se propagea rapidement à Berne, à Neufchâtel, et jusqu'au Val-Travers, le ministre Montmolin conseilla à Jean-Jacques de s'abstenir de toute cérémonie publique... *En janvier 1766, Rousseau gagnait l'Angleterre, accompagné par Hume et soutenu par Walpole..
1763, la rébellion des Parlements - Les difficultés financières sont inextricables dans le royaume de France : le contrôleur général Silhouette, désigné par Choiseul, essaie en vain d'instituer un impôt sur la richesse que les privilégiés font vite échouer et il faut revenir aux désastreux expédients traditionnels : ventes d'offices et augmentation des impôts existants. Les parlements saisissent d'ailleurs tous les prétextes - mesures fiscales quelles qu'elles soient, projets de réforme de toute nature - pour protester et faire des remontrances, tout en prétendant défendre les sujets accablés. En 1763, le Parlement de Paris en vient à réclamer la convocation d'États généraux. Enfin une véritable révolte éclate à Rennes en r765; l'animosité qui opposait le procureur général La Chalotais et le duc d'Aiguillon, gouverneur de la province, adversaire des jésuites, aboutit à l'arrestation du procureur qui provoque la démission en masse du Parlement de Rennes, puis de tous les autres parlements. Louis XV fit lire une déclaration, où il affirmait son autorité, à la séance de "Flagellation" du 3 mars 1766, où il se trouvait en personne, mais il céda ensuite, en rappelant le duc d'Aiguillon. Le Parlement de Rennes inculpa ce dernier d'abus de pouvoir, mais le roi interdit le procès qui avait été porté devant le Parlement de Paris. Les parlementaires devaient réagir en se mettant en grève (décembre 1770). Ouvertement attaqué d'autre part par le parti dévot, privé de la protection de Mme de Pompadour morte en 1764, Choiseul se voit reprocher à la fois ses concessions et ses résistances, et se trouve définitivement disgracié en décembre 1770.

Le 12 novembre 1764, Diderot laisse éclater sa colère envers le libraire Le Breton qui avait en secret, après le bon à tirer, fait modifier, adoucir les épreuves de l'Encyclopédie...
«Tout le temps qu'il a travaillé à cet ouvrage, c'est-à-dire trente ans, écrit madame de Vandeul, il (mon père) n'a joui, pour ainsi dire, d'aucun repos ; il n'était jamais sûr la veille de pouvoir continuer le lendemain ; les libraires le désespéraient. Il venait de publier un volume dont il avait revu toutes les épreuves ; il a besoin de rechercher quelque chose, il trouve un article rogné, recousu, gâté, il ne sait comment cette faute a pu se commettre, il parcourt tout le volume, et trouve toute sa besogne altérée. C'était une correction de la façon de Le Breton. Effrayé de la hardiesse de ces idées, il avait imaginé, pour en adoucir l'effet, d'ôter et de supprimer tout ce qui paraissait trop fort à la faiblesse de sa tête. Mon père pensa en tomber malade ; il cria, s'emporta, il voulait abandonner l'ouvrage ; mais le temps, la bêtise, les ridicules excuses de ce libraire, qui craignait la Bastille plus que la foudre, parvinrent à le calmer, mais non à le consoler... »
Une lettre du philosophe à Le Breton du 12 novembre 1764 apporte quelques précisions :
«Ne m'en sachez nul gré, Monsieur, ce n'est pas pour vous que je reviens ; vous m'avez mis dans le cœur un poignard que votre vue ne peut qu'enfoncer davantage. Ce n'est pas non plus par attachement à l'ouvrage que je ne saurais que dédaigner dans l'état où il est. Vous ne me soupçonnerez pas, je crois, de céder à l'intérêt... Je me rends à la sollicitation de M. Briasson. Je ne puis me défendre d'une espèce de commisération pour vos associés qui n'entrent pour rien dans la trahison que vous m'avez faite... Vous m'avez trompé lâchement deux ans de suite ; vous avez massacré ou fait massacrer par une bête brute le travail de vingt honnêtes gens qui vous ont consacré leur temps, leurs talents et leurs veilles gratuitement, par amour du bien et de la vérité, et sur le seul espoir de voir paraître leurs idées et d'en recueillir quelque considération... On apprendra une atrocité dont il n'y a pas d'exemple depuis l'origine de la librairie. En effet, a-t-on jamais ouï parler de dix volumes in folio, clandestinement mutilés, tronqués, hachés, déshonorés par un imprimeur ? Votre syndicat sera marqué d'un trait qui, s'il n'est pas beau, est du moins unique... C'est alors que vous jugerez vainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu'il en arrive, je serai à couvert. On n'ignorera pas qu'il n'a été en mon pouvoir ni de pressentir ni d'empêcher le mal quand je l'aurais soupçonné ; on n'ignorera pas que j'ai menacé, crié, réclamé... J'en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J'en ai pleuré de rage en votre présence ; j'en ai pleuré de douleur chez moi ... »

1764, "ce serait une belle chose de voir son âme", c'est la publication et la condamnation du fameux Dictionnaire Philosophique portatif, La Raison par alphabet, d'un Voltaire qui se garde bien de s'en déclarer l'auteur : l'ouvrage est condamné à être «lacéré et brûlé» à Genève en septembre 1764, puis en en Hollande, puis à Berne. Le Parlement de Paris à son tour le condamne le 19 mars 1765, et Rome le met à L'Index. Et le 1er juillet 1766, l'exemplaire du livre de Voltaire que possédait le chevalier de La Barre est acheminé de Paris à Abbeville pour être cloué sur le torse de son propriétaire, et brûlé sur le même bûcher...
En 1765-1772, Diderot publie d'un coup en décembre 1765, les dix derniers volumes de texte (Vlll-XVII) et les cinq premières planches : volume 8 (H - Itzehoa), volume 9 (Ju - Mamira), volume 10 (Mammelle - Myva), volume 11 ( N - Parkinsone), volume 12 (Parlement - Potytric), volume 13 (Pomacies - Reggio) volume 14 (Reggio-Semyda), volume 15 (Sen-Tchupriki), volume 16 (Teanum-Vénerie), volume 17 (Vénérien - Zzuéné)
L'ouvrage, qui avait mis vingt et un ans à paraître (1751-1772), contenait donc dix-sept volumes in-folio et onze volumes de planches, auxquels s'ajoutèrent, en 1777, cinq volumes de suppléments qui ne sont pas de Diderot, et en 1780 deux volumes de tables composés par Panckoucke et Rey. L'entreprise a rapporté aux éditeurs plus de deux millions et à Diderot cent pistoles (mille francs) de rente...

1766 - En 1766, le péril devient pressant. C'est l'année où les parlementaires ont brûlé le chevalier de la Barre, à dix-huit ans. L'un d'eux a dit en plein Parlement, - et il faut livrer son nom à la postérité : c'est le conseiller Denis Pasquier, - qu'on a assez brûlé les livres des philosophes et qu'il serait temps de brûler les philosophes eux-mêmes. Voltaire, -qui écrira une "Relation de la mort du chevalier de La Barre à Monsieur le marquis de Beccaria, sous le pseudonyme de M. Cassen" et l'évoquera dans son article «Torture» de l'édition de 1769 -, conjure Diderot de fuir en Russie; voilà ce qu'il lui répond :
"Je sais bien que quand une bête féroce a trempé sa langue dans le sang humain, elle ne peut plus s'en passer; je sais bien que cette bête manque d'aliments, et que, n'ayant plus de jésuites à manger, elle va se jeter sur les philosophes. Je sais bien qu'elle a jeté les yeux sur moi et que je serai peut-être le premier qu'elle dévorera... Mais que voulez-vous que je fasse de l'existence, si je ne puis la conserver qu'en renonçant à tout ce qui me la rend chère? Et puis, je me lève tous les matins avec l'assurance que les méchants se sont amendés pendant la nuit, qu'il n'y a plus de fanatiques... Si j'avais le sort de Socrate, songez que ce n'est pas assez de mourir comme lui pour mériter de lui être comparé... Si nous ne concourons pas avec vous à écraser la bête, c'est que nous sommes sous sa griffe, et si, connaissant toute sa férocité, nous balançons à nous en éloigner, c'est par ces considérations dont le prestige est d'autant plus fort qu'on a l'âme plus honnête et plus sensible. Nos entours sont si doux, et c'est une perte si difficile à à parer !"

1766, Elie Fréron (1719-1776) fut un des ennemis acharnés des philosophes dans son journal l'Année littéraire, un défenseur zélé des idées monarchiques et religieuses..
"Il y a vingt ans que je hasardai mes premiers pas dans la carrière de la critique; et, depuis cette époque, je vous assure, Monsieur, que je ne me suis pas un instant repenti ni dégouté d''avoir embrassé ce genre. J'en vis dès lors tous les dangers; ils ne m'effrayèrent point; et je soutins d'un œil ferme la perspective peu riante des tracasseries, des injustices et des libelles : non par un sentiment d'indifférence ou de vanité, mais par la persuasion que le public ne prend pas des injures pour des raisons, ni des calomnies pour des faits; par le témoignage que j'étais sûr que mon cœur me rendrait toujours; enfin par la connaissance du caractère des ennemis que je me ferais infailliblement.
Je me suis donc attendu, Monsieur, et je m'attends encore à l'animosité, disons mieux, à la rage des prosateurs et des rimeurs du siècle. Je conviens cependant que je n'ai pas eu la sagacité de prévoir le sublime stoïcisme de quelques gens de lettres que j'ai nourris, que j'ai vêtus, à qui j'ai prêté de l'argent qu'ils ne me rendront jamais, dont j'ai corrigé des ouvrages qui leur ont donné la célébrité, et qui, par reconnaissance, ont écrit des horreurs contre moi. Au reste ce procédé si noble est, dit-on, dans la nature et particulièrement dans celle des poètes qui reçoivent tout ce qu'on fait pour eux comme un hommage que l'on doit à la transcendance de leur génie.
Mes ennemis, ni ceux que je croyais mes amis n'ont pu me nuire; mais je leur rends justice; ils n'ont rien épargné pour y réussir; ils m'ont servi avec un zèle, une activité, un feu, qui ne leur laisse aucun reproche à se faire. Jusqu'ici, j'ai détourné les traits éclatants ou clandestins de leur haine, tantôt déclarée, tantôt couverte; et ma barque, toute fragile qu'elle est, s'est sauvée du naufrage. M. de Voltaire lui-même, cet aigle impérieux, qui du haut du ciel est venu fondre sur un misérable roitelet, ne m'a pas fait la blessure la plus légère, le plus petit tort; je sens avec douleur combien il doit en être piqué, et je suis réellement fâché de ne lui avoir pas donné, pour le moins, la satisfaction de m'être pendu de désespoir, comme Lycambe: apparemment que les vers d'Archiloque avaient une certaine vertu strangulatoire que n'ont pas ceux de M. de Voltaire...
Je sais que je vivrais plus tranquille, si j'avais pu prendre sur moi d'admirer sans restriction les grands auteurs, mes contemporains, à l'exemple de quelques adroits journalistes. M. de Voltaire m'aurait écrit cent lettres de compliments, aussi flatteuses que celles qu`il adresse à tous les reptiles de notre Parnasse: il aurait annoncé à l'Europe que I'Année littéraire "est le premier des journaux". comme il l'a dit du Journal encyclopédique, parce qu'il y est loué chaque mois à toute outrance. Quelque chose de plus. Monsieur; vous ne vous en douteriez pas : je serais. oui. je serais au nombre des grands hommes de la nation. puisqu'il a dépendu de moi de coopérer à ce dictionnaire merveilleux qui renferme le dépôt de toutes les connaissances humaines. Un des libraires les plus intéressés au succès de cette vaste entreprise me proposa d'y travailler : je refusai ses offres; j'ai manqué, comme vous voyez, ma fortune, ma gloire et mon immortalité. Car vous n'ignorez pas que tous ceux qui ont prêté leurs mains à grossir la compilation de cet immense et docte répertoire, sont par la même de grands hommes. Avec ce mérite d'avance, je n'aurais eu qu'à louer l'Encyclopédie et Dieu sait quels éloges les Encyclopédistes m'auraient prodigués à leur tour. Mais ce protocole de louanges répugne à mon caractère, autant qu'il ennuie le public. J'ai ma façon de penser; elle sera du moins uniforme, et l'on ne me reprochera jamais d'avoir varié, comme tant d'autres écrivains qui, croyant s'apercevoir qu'une certaine secte prenait le dessus dans la littérature, sont devenus les lâches adulateurs de gens dont ils avaient été les critiques courageux..."

De 1767 jusqu'en 1768, d'Holbach livre aux libraires plus de vingt volumes, dont "L'Esprit du clergé", les "Prêtres démasqués", le "Militaire philosophe", l' "Imposture sacerdotale", les "Doutes sur la religion", la "Théologie portative". En 1768, Diderot écrivait à Sophie Volland : «Il pleut des bombes dans la maison du Seigneur ; je tremble toujours que quelqu'un de ces téméraires artilleurs ne s'en trouve mal. Ce sont les "Lettres philosophiques", traduites ou supposées traduites de l'anglais de Toland, ce sont les "Lettres à Eugénie", c'est la "Contagion sacrée", c'est l' "Examen des prophètes", c'est la "Vie de David ou de l'Homme selon le cœur de Dieu", ce sont mille diables déchaînés.» Voltaire ne se sent pas non plus très rassuré, dans son Dictionnaire philosophique, un article surtout, l'article "tyran", avait irrité contre lui le gouvernement, ministres et sous-ministres ne lui pardonnaient pas d'avoir dit: « .. qu'il valait mieux avoir affaire à une seule bête féroce qu'on pouvait éviter, qu'à une bande de petits tigres subalternes qu'on trouvait sans cesse entre ses jambes", et voilà pourquoi, dans l'opinion de Diderot, ce dictionnaire avait été brûlé lors de l'affaire la Barre...

1770, la réforme de Maupeou - Après la disgrâce de Choiseul, le duc d'Aiguillon est nommé ministre des Affaires étrangères et avec Maupeou, chancelier depuis 1768, et l'abbé Terray, contrôleur général depuis 1769, il forme le "Triumvirat" qui va gouverner la France jusqu'à la mort de Louis XV. Maupeou engage la lutte contre le Parlement, dont l'obstruction et les grèves menacent la royauté même et qui prétend constituer un corps unique. Lettres d'exil, expulsions, confiscations de charges se multiplient. Malgré l'opposition des princes du sang, Maupeou entreprend en 1771 sa "grande réforme" qui diminue l'étendue du Parlement de Paris et supprime la vénalité des offices et de la justice. Les résistances sont vives, les conflits nombreux, mais Louis XV, ulcéré d'une telle hostilité, a déclaré : "je ne changerai jamais".
L'opinion publique n'a aucune sympathie pour les magistrats, dont l'intolérance et la partialité ont été dénoncées vigoureusement par les philosophes, comme ce fut le cas, par exemple, dans l'affaire Calas. La réforme s'impose, les esprits s'apaisent peu à peu...
(Gravure satirique de René Nicolas de Maupeou, chancelier de France : Maupeou, nouveau Samson, ébranle les colonnes du temple de l'État).

1770 - L’Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines, dite Encyclopédie d'Yverdon - encyclopédie dirigée par Fortunato Bartolomeo De Felice et publiée entre 1770 et 1780 en Suisse, à Yverdon. D'esprit moins français et moins anti-religieux que celle de Diderot et de d'Alembert dont elle s'inspire, cette différence lui a valu l'appellation d’encyclopédie protestante, et lui assura une forte diffusion dans le Nord de l'Europe....

Paul Heinrich Dietrich, baron d'Holbach (1723-1789)
"L'homme est un être purement physique ; l'homme moral n'est que cet être physique considéré sous un certain point de vue" - D'Holbach est l'un des premiers représentants du matérialisme du XVIII° siècle. D'origine allemande, né à Edesheim, dans l'ancien Palatinat, Paul Heinrich Dietrich vint fort jeune à Paris, où il fit son éducation, devient Baron d'Holbach à la mort de son oncle et fit ses études à Leyde, en Hollande. Il rentre en France lors de la paix d'Aix-la-Chapelle, obtient la naturalisation française et devient avocat au Parlement de Paris, riche d'une fortune conséquente. Son intérêt pour la chimie et la minéralogie le fait traduire en français d'importants ouvrages latins ou allemands (1750-1754) et tenter une explication du monde globale à base de matière et de mouvement. Il rédige pour l'Encyclopédie à partir de 1751 des articles traitant de métallurgie, géologie, médecine, de minéralogie et de chimie. À partir de 1760, il commence à traduire et rédiger des ouvrages philosophiques, souvent sous un nom d’emprunt ou sous celui d’un mort (Jean-Baptiste de Mirabaud, secrétaire perpétuel de l’Académie, abbé Bernier, Boulanger, etc.) pour éviter les ennuis avec le pouvoir. Ses écrits sont en effet, sans être particulièrement originaux, nettement anticléricaux, antichrétiens et explicitement athées, matérialistes et fatalistes. Diderot est de ceux qui participeront à la rédaction de ces ouvrages : le Christianisme dévoilé (1761), la Théologie portative (1768), la Contagion sacrée ou Histoire naturelle de la superstition (1768), Essai sur les préjugés (1770), le Système de la nature (1770), le Bon Sens on Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles (1772), la Politique naturelle ou Discours sur les vrais principes du gouvernement (1773), Système social ou Principes naturels de la morale et de la politique (1773), la Morale universelle ou les Devoirs de l'homme fondés sur la nature (1776). D"Holbach mourra à quelques mois de la prise de la Bastille, alors qu’il est un des principaux acteurs du siècle des Lumières...
En 1770, de tous ces ouvrages le plus important est "le Système de la nature", on y retrouve "un écho intelligent" (G. Lanson) des idées qui s'échangeaient alors, négation de la métaphysique, souveraineté des lois physiques, déterminisme, évolution, progrès, nécessité et efficacité de l'expérience, réduction de la conscience morale à une disposition organique héréditaire que modifient les habitudes et les sensations ; en théorie poursuite de la jouissance, en pratique accomplissement du bien. Voltaire ne sera pas tendre : «Le Système de la nature est un ouvrage de ténèbres ; c'est une déclamation perpétuelle sur le mal physique et le mal moral. » Le clergé, dans son Assemblée de 1770, jeta un cri d'alarme et adressa un suprême appel à la fois au roi, aux évêques et à tous les fidèles du royaume. L'impiété menaçait tout le royaume. Le Parlement s'en saisit, Le Système de la Nature fut, avec bien d'autres livres, qu'avait condamné à être brûlé, ce qui en assura le succès...
D'Holbach, "Système de la Nature" (1770), première partie, chapitre premier.
DE LA NATURE
"Les hommes se tromperont toujours quand ils abandonneront l'expérience pour des systèmes enfantés par l'imagination. L'homme est l'ouvrage de la nature, il existe dans la nature, il est soumis à ses lois, il ne peut s'en affranchir, il ne peut même par la pensée en sortir ; c'est en vain que son esprit veut s'élancer au delà des bornes du monde visible, il est toujours forcé d'y rentrer. Pour un être formé par la nature et circonscrit par elle, il n'existe rien au delà du grand tout dont il fait partie et dont il éprouve les influences ; les êtres que l'on suppose au-dessus de la nature ou distingués d'elle-même seront toujours des chimères dont il ne nous sera jamais possible de nous former des idées véritables, non plus que du lieu qu'elles occupent et de leur façon d'agir. Il n'est et ne peut rien y avoir hors de l'enceinte qui renferme tous les êtres.
Que l'homme cesse donc de chercher hors du monde qu'il habite, des êtres qui lui procurent un bonheur que la nature lui refuse : qu'il étudie cette nature, qu'il apprenne ses lois, qu'il contemple son énergie et la façon immuable dont elle agit ; qu'il applique ses découvertes à sa propre félicité, et qu'il se soumette en silence à des lois auxquelles il ne peut se soustraire ; qu'il consente à ignorer les causes entourées pour lui d'un voile impénétrable ; qu'il subisse sans murmurer les arrêts d'une force universelle qui ne peut revenir sur ses pas, ou qui jamais ne peut s'écarter des règles que sou essence lui impose.
On a visiblement abusé de la distinction que l'on a faite si souvent de l'homme physique et de l'homme moral. L'homme est un être purement physique ; l'homme moral n'est que cet être physique considéré sous un certain point de vue, c'est-à-dire relativement à quelques-unes de ses façons d'agir, dues à son organisation particulière. Mais cette organisation n'est-elle pas l'ouvrage de la nature ? Les mouvements ou façons d'agir dont elle est susceptible ne sont-ils pas physiques ? Ses actions visibles ainsi que les mouvements invisibles excités dans son intérieur, qui viennent de sa volonté ou de sa pensée, sont également des effets naturels, des suites nécessaires de son mécanisme propre et des impulsions qu'il reçoit des êtres dont il est entouré.
Tout ce que l'esprit humain a successivement inventé pour changer ou perfectionner sa façon d'être et pour la rendre plus heureuse, ne fut jamais qu'une conséquence nécessaire de l'essence propre de l'homme et de celle des êtres qui agissent sur lui. Toutes nos institutions, nos réflexions, nos connaissances n'ont pour objet que de nous procurer un bonheur vers lequel notre propre nature nous force de tendre sans cesse. Tout ce que nous faisons ou pensons, tout ce que nous sommes et ce que nous ferons n'est jamais qu'une suite de ce que la nature universelle nous a faits ; toutes nos idées, nos volontés, nos actions, sont les effets nécessaires de l'essence et des qualités que cette nature a mises en nous, et des circonstances par lesquelles elle nous oblige de passer et d'être modifiés. En un mot, l'Art n'est que la nature agissante à l'aide des instruments qu'elle a faits.
La nature envoie l'homme nu et destitué de secours dans ce monde qui doit être son séjour ; bientôt il parvient à se vêtir de peau ; peu à peu nous le voyons filer l'or et la soie. Pour un être élevé au-dessus de notre globe, et qui du haut de l'atmosphère contemplerait l'espèce humaine avec tous ses progrès et changements, les hommes ne paraîtraient pas moins soumis aux lois de la nature lorsqu'ils errent tout nus dans les forêts pour y chercher péniblement leur nourriture, que lorsque, vivant dans les sociétés civilisées, c'est-à-dire enrichies d'un plus grand nombre d'expériences, et finissant par se plonger dans le luxe, ils inventent de jour en jour mille besoins nouveaux et découvrent mille moyens de les satisfaire.
Tous les pas que nous faisons pour modifier notre être ne peuvent être regardés que comme une longue suite de causes et d'effets, qui ne sont que les développements des premières impulsions que la nature nous a données. Le même animal, en vertu de son organisation, passe successivement de besoins simples à des besoins plus compliqués, mais qui n'en sont pas moins des suites de sa nature. C'est ainsi que le papillon dont nous admirons la beauté commence par être un oeuf inanimé, duquel la chaleur fait sortir un ver, qui devient chrysalide, et puis se change en un insecte ailé, que nous voyons s'orner des plus vives couleurs : parvenu à cette forme, il se reproduit et se propage ; enfin dépouillé de ses ornements, il est forcé de disparaître après avoir rempli la tâche que la nature lui imposait, ou décrit le cercle des changements qu'elle a tracés aux êtres de son espèce.
Nous voyons des changements et des progrès analogues dans tous les végétaux. C'est par une suite de la combinaison, du tissu, de l'énergie primitive donnés à l'aloès par la nature, que cette plante, insensiblement accrue et modifiée, produit au bout d'un grand nombre d'années des fleurs qui sont les annonces de sa mort.
Il en est de même de l'homme qui, dans tous ses progrès, dans toutes les variations qu'il éprouve, n'agit jamais que d'après les lois propres à son organisation et aux matières dont la nature l'a composé.
L'homme physique est l'homme agissant par l'impulsion de causes que nos sens nous font connaître ; l'homme moral est l'homme agissant par des causes physiques que nos préjugés nous empêchent de connaître. L'homme sauvage est un enfant dénué d'expérience, incapable de travailler à la félicité. L'homme policé est celui que l'expérience et la vie sociale mettent à portée de tirer parti de la nature pour son propre bonheur. L'homme de bien éclairé est l'homme dans sa maturité ou dans sa perfection. L'homme heureux est celui qui sait jouir des bienfaits de la nature ; l'homme malheureux est celui qui se trouve dans l'incapacité de profiter de ses bienfaits.
C'est donc à la physique et à l'expérience que l'homme doit recourir dans toutes ses recherches : ce sont elles qu'il doit consulter dans sa religion, dans sa morale, dans sa législation, dans son gouvernement politique, dans les sciences et dans les arts, dans les plaisirs, dans les peines. La nature agit par des lois simples, uniformes, invariables que l'expérience nous met à portée de connaître ; c'est par nos sens que nous sommes liés à la nature universelle, c'est par nos sens que nous pouvons la mettre en expérience et découvrir ses secrets ; dès que nous quittons l'expérience, nous tombons dans le vide ou notre imagination nous égare.
'Toutes les erreurs des hommes sont des erreurs de physique , ils ne se trompent jamais que lorsqu'ils négligent de remonter à la nature, de consulter ses règles, d'appeler l'expérience à leur secours. C'est ainsi que faute d'expériences ils se sont formé des idées imparfaites de la matière, de ses propriétés, de ses combinaisons, de ses forces, de sa façon d'agir ou de l'énergie qui résulte de son essence ; dès lors tout l'univers n'est devenu pour eux qu'une scène d'illusions. Ils ont ignoré la nature, ils ont méconnu ses lois, ils n'ont point vu les routes nécessaires qu'elle trace à tout ce qu'elle renferme. Que dis-je ! ils se sont méconnus eux-mêmes ; tous leurs systèmes, leurs conjectures, leurs raisonnements dont l'expérience fut bannie ne furent qu'un long tissu d'erreurs et d'absurdités.
Toute erreur est nuisible ; c'est pour s'être trompé que le genre humain s'est rendu malheureux. Faute de connaître la nature, il se forma des dieux, qui sont devenus les seuls objets de ses espérances et de ses craintes. Les hommes n'ont point senti que cette nature, dépourvue de bonté comme de malice, ne fait que suivre des lois nécessaires et immuables en produisant et détruisant des êtres, en faisant tantôt souffrir ceux qu'elle a rendus sensibles, en leur distribuant des biens et des maux, en les altérant sans cesse ; ils n'ont point vu que c'était dans la nature elle-même et dans ses propres forces que l'homme devait chercher ses besoins, des remèdes contre ses peines et des moyens de se rendre heureux ; ils ont attendu ces choses de quelques êtres imaginaires qu'ils ont supposés les auteurs de leurs plaisirs et de leurs infortunes.
D'où l'on voit que c'est à l'ignorance de la nature que sont dues ces puissances inconnues sous lesquelles le genre humain a si longtemps tremblé, et ces cultes superstitieux qui furent les sources de tous ses maux.
C'est faute de connaître sa propre nature, sa propre tendance, ses besoins et ses droits, que l'homme en société est tombé de la liberté dans l'esclavage ; il méconnut ou se crut forcé d'étouffer les désirs de son cœur, et de sacrifier son bien-être aux caprices de ses chefs ; il ignora le but de l'association et du gouvernement ; il se soumit sans réserve à des hommes comme lui, que les préjugés lui firent regarder comme des êtres d'un ordre supérieur, comme des dieux sur la terre ; ceux-ci profitèrent de son erreur pour l'asservir, le corrompre, le rendre vicieux et misérable. Ainsi c'est pour avoir ignoré sa propre nature que le genre humain tomba dans la servitude et fut mal gouverné.
C'est pour s'être méconnu lui-même et pour avoir ignoré les rapports nécessaires qui subsistent entre lui et les êtres de son espèce, que l'homme a méconnu ses devoirs envers les autres ; il ne sentit pas qu'ils étaient nécessaires à sa propre félicité. Il ne vit pas plus ce qu'il se devait à lui- même, les excès qu'il devait éviter pour se rendre solidement heureux, les passions auxquelles il devait résister ou se livrer pour son propre bonheur ; en un mot il ne connut point ses véritables intérêts. De là tous ses dérèglements, son intempérance, ses voluptés honteuses, et tous les vices auxquels il se livra aux dépens de sa conservation propre et de son bien-être durable. Ainsi c'est l'ignorance de la nature humaine, qui empêcha l'homme de s'éclairer sur la morale ; d'ailleurs les gouvernements dépravés auxquels il fut soumis l'empêchèrent toujours de la pratiquer quand même il l'aurait connue.
C'est encore faute d'étudier la nature et ses lois, de chercher à découvrir ses ressources et ses propriétés que l'homme croupit dans l'ignorance ou fait des pas si lents et si incertains pour améliorer sou sort. Sa paresse trouve son compte à se laisser guider par l'exemple, par la routine, par l'autorité plutôt que par l'expérience qui demande de l'activité, et par la raison qui exige de la réflexion. De là cette aversion que les hommes montrent pour tout ce qui leur paraît s'écarter des règles auxquelles ils sont accoutumés ; de là leur respect stupide et scrupuleux pour l'antiquité et pour les institutions les plus insensées de leurs pères ; de là les craintes qui les saisissent quand on leur propose les changements les plus avantageux ou les tentatives les plus probables. Voilà pourquoi nous voyons les nations languir dans une honteuse léthargie, gémir sous des abus transmis de siècles en siècles, et frémir de l'idée même de ce qui pourrait remédier à leurs maux. C'est par cette même inertie et par le défaut d'expériences, que la médecine, la physique, l'agriculture, en un mot toutes les sciences utiles font des progrès si peu sensibles et demeurent si longtemps dans les entraves de l'autorité : ceux qui professent ces sciences aiment mieux suivre les routes qui leur sont tracées que de s'en frayer de nouvelles ; ils préfèrent les délires de leur imagination et leurs conjectures gratuites, à des expériences laborieuses, qui seules seraient capables d'arracher à la nature ses secrets.
En un mot les hommes, soit par paresse, soit par crainte, ayant renoncé au témoignage de leurs sens, n'ont plus été guidés dans toutes leurs actions et leurs entreprises, que par l'imagination, l'enthousiasme, l'habitude, le préjugé et surtout par l'autorité, qui sut profiter de leur ignorance pour les tromper. Des systèmes imaginaires prirent la place de l'expérience, de la réflexion, de la raison : des âmes ébranlées par la terreur, et enivrées du merveilleux, ou engourdies par la paresse et guidées par la crédulité, que produit l'inexpérience, se créèrent des opinions ridicules ou adoptèrent sans examen toutes les chimères dont on voulut les repaître.
C'est ainsi que pour avoir méconnu la nature et ses voies, pour avoir dédaigné l'expérience, pour avoir méprisé la raison ; pour avoir désiré du merveilleux et du surnaturel ; enfin pour avoir tremblé, le genre humain est demeuré dans une longue enfance dont il a tant de peine à se tirer. Il n'eut que des hypothèses puériles dont il n'osa jamais examiner les fondements et les preuves ; il s'était accoutumé à les regarder comme sacrées, comme des vérités reconnues dont il ne lui était point permis de douter un instant ; son ignorance le rendit crédule ; sa curiosité lui fit avaler à longs traits le merveilleux ; le temps le confirma dans ses opinions et fit passer de races en races ses conjectures pour des réalités ; la force tyrannique le maintint dans ses notions devenues nécessaires pour asseirvir la société ; enfin la science des hommes en tout genre ne fut qu'un amas de mensonges, d'obscurités, de contradictions, entremêlé quel- quefois de faibles lueurs de vérité, fournies par la nature dont l'on ne put jamais totalement s'écarter, parce que la nécessité y ramena toujours.
Élevons-nous donc au-dessus du nuage du préjugé. Sortons de l'atmosphère épaisse qui nous entoure pour considérer les opinions des hommes et leurs systèmes divers. Défions-nous d'une imagination déréglée, prenons l'expérience pour guide, consultons la nature ; tâchons de puiser en elle-même des idées vraies sur les objets qu'elle renferme ; recourons à nos sens que l'on nous a faussement fait regarder comme suspects ; interrogeons la raison que l'on a honteusement calomniée et dégradée ; contemplons attentivement le monde visible, et voyons s'il ne suffit point pour nous faire juger des terres inconnues du monde intellectuel ; peut-être trouverons-nous que l'on n'a point eu de raisons pour les distinguer, et que c'est sans motifs que l'on a séparé deux empires qui sont également du domaine de la nature.
L'univers, ce vaste assemblage de tout ce qui existe, ne nous offre partout que de la matière et du mouvement : son ensemble ne nous montre qu'une chaîne immense et non interrompue de causes et d'effets : quelques-unes de ces causes nous sont connues parce qu'elles frappent immédiatement nos sens ; d'autres nous sont inconnues, parce qu'elles n'agissent sur nous que par des effets souvent très éloignés de leurs premières causes.
Des matières très variées et combinées d'une infinité de façons reçoivent et communiquent sans cesse des mouvements divers. Les différentes propriétés de ces matières, leurs différentes combinaisons, leurs façons d'agir si variées, qui en sont des suites nécessaires, constituent pour nous les essences des êtres ; et c'est de ces essences diversifiées que résultent les différents ordres, rangs ou systèmes, que ces êtres occupent, dont la somme totale fait ce que nous appelons la nature.
Ainsi la nature, dans la signification la plus étendue, est le grand tout qui résulte de l'assemblage des différentes matières, de leurs différentes combinaisons, et des différents mouvements que nous voyons dans l'univers. La nature, dans un sens moins étendu, ou considérée dans chaque être, est le tout qui résulte de l'essence, c'est-à-dire des propriétés, des combinaisons, des mouvements ou façons d'agir qui le distinguent des autres êtres. C'est ainsi que l'homme est un tout, résultant des combinaisons de certaines matières, douées de propriétés particulières dont l'arrangement se nomme organisation, et dont l'essence est de sentir, de penser, d'agir, en un mot de se mouvoir d'une façon qui le distingue des autres êtres avec lesquels il se compare : d'après cette comparaison, l'homme se range dans un ordre, un système, une classe à part, qui diffère de celle des animaux dans lesquels il ne voit pas les mêmes propriétés qui sont en lui. Les différents systèmes des êtres, ou si l'on veut, Ieurs natures particulières, dépendent du système général, du grand tout, de la nature universelle dont ils font partie, et à qui tout ce qui existe est nécessairement lié."

1772 - Achèvement de la parution des planches et fin de la publication de l'Encyclopédie.
La contrefaçon s'empara du livre et cinq ou six éditions parurent coup sur coup dans les diverses parties de l'Europe. Autant de lecteurs, autant de partisans, mais des lecteurs appartenant aux classes dominantes et qui recherchaient dans le Dictionnaire les articles qui renfermaient des idées nouvelles, des esprits déjà travaillés par des désirs et des besoins de réforme. "Ce qu'on y a recherché et ce qu'on y recherchera, disait Diderot à Lebreton dans sa fameuse lettre, c'est la philosophie ferme et hardie de quelques-uns de vos travailleurs". En 177 1, Louis XVI monte sur le trône appelle Turgot au ministère...

1774, la confusion des dernières années du roi Louis XV - Au point de vue financier, l'abbé Terray, qui ne manquait ni d'intelligence ni d'autorité, se débattait contre les dépenses excessives et essayait de faire face au déficit par les expédients habituels : emprunts forcés, réduction de rentes, arrêt des paiements de l'État, non sans provoquer de graves troubles. Il voulut diminuer la charge que les fermiers généraux imposaient à l'État, mais il ne pouvait lutter contre le roi et la cour qui bénéficiaient d'avantages personnels dans ce système désastreux pour le bien public. Rien n'atténua les pertes entraînées par la crise industrielle et les mauvaises récoltes. On lui reprocha finalement, ainsi qu'au roi, d'accaparer le blé par spéculation, alors qu'il espérait en faire baisser le prix. Des émeutes répétées marquèrent l'échec de sa politique. Enfin la politique étrangère provoqua de cruelles désillusions. Les Polonais, qui s'étaient révoltés contre la domination étrangère, furent écrasés. D'Aiguillon se montra incapable de rétablir la situation et le démembrement de la Pologne - alliée de longue date à la France - entre l'Autriche, la Prusse et la Russie ruina toutes les espérances que pouvait susciter encore la diplomatie de Louis XV; la France n'exerça plus aucune influence et l'opinion publique en fut profondément blessée. Les dernières années du règne furent pénibles : les ministres se heurtaient constamment, le roi était détesté et n'osait plus se montrer à Paris. A la fin d'avril 1774, il mourut de petite vérole et son cortège funèbre qui gagnait Saint-Denis à la nuit tombante fut salué par les cris joyeux et les sarcasmes des assistants...

1774-1792 - le règne de Louis XVI - Louis XVI, petit-fils et successeur de Louis XV, marié en 1770 à l'archiduchesse Marie-Antoinette, a vingt ans en 1774. Physiquement très puissant mais maladroit, timide, la parole difficile, négligé dans sa mise, il est au dire de la reine elle-même "un pauvre homme". Il ne manque pourtant ni de bon sens ni de connaissances, il est humain et honnête, mais le métier de roi ne lui convient pas du tout, et on ne le lui a jamais appris. Il ne s'intéresse qu'à la chasse et à la serrurerie et sa faiblesse de caractère est inquiétante. Pourtant son règne commence par une décision ferme et lucide: il renvoie d'Aiguillon, Maupeou et Terray, dont l'impopularité était grande, et nomme Maurepas ministre d'État. Ce dernier, homme intelligent et expérimenté, choisit comme ministre des affaires étrangères Vergennes, diplomate habile, comme contrôleur général des Finances Turgot, qui avait fort bien administré pendant treize ans l'intendance de Limoges et que les philosophes estimaient particulièrement, et complète son ministère par Malesherbes, Sartine et Saint-Germain, animés par un même souci de l'intérêt public.
(Gabriel François Doyen (1726–1806), Louis XVI reçoit à Reims les hommages des chevaliers du Saint-Esprit, 13 juin 1775, Palais de Versailles)
La tentative de redressement - Turgot, magistrat au Parlement de Paris, avait acquis une très complète formation d'économie politique, d'abord théorique en étudiant les physiocrates Quesnay, Gournay, Adam Smith, puis pratique, en développant l'activité économique du Limousin. Il voulut avant tout rétablir la situation des finances en réduisant toutes les dépenses - en particulier celles de la cour - et remplacer tous les impôts par une contribution unique dite "subvention territoriale", à laquelle seraient soumis tous les propriétaires. Il espérait que le développement des richesses accroîtrait naturellement le rendement de l'impôt et que la suppression des contraintes de toutes sortes (corvées, réquisitions, règles et réglementations) fournirait une impulsion efficace. Pour réaliser ce programme ambitieux, il souhaitait, entre la monarchie et le peuple, une entente qu'il imaginait facile à réaliser par l'intermédiaire d'une pyramide de municipalités aboutissant à une assemblée nationale.
Il écrivait notamment :
"Point de banqueroute;
Point d 'augmentation d 'impôts;
Point d'emprunts.
Tant que la finance sera continuellement aux expédients pour assurer les services, Votre Majesté sera toujours dans la dépendance des financíers et ceux-ci seront toujours les maîtres de faire manquer, par des manœuvres de place, les opérations les plus importantes. Il n'y aura aucune amélioration possible, ni dans les impositions pour soulager les contribuables, ni dans aucun arrangement relatif au gouvernement intérieur et à la législation. L'autorité ne sera jamais tranquille, parce qu'elle ne sera jamais chérie; et que les mécontentements et les inquiétudes des peuples sont toujours le moyen dont les intrigants et les malintentionnés se servent pour exciter des troubles. C'est donc surtout de l'économie que dépend la prospérité de votre règne, le calme dans l'intérieur, la considération au-dehors, le bonheur de la nation et le vôtre.
Je dois faire observer à Votre Majesté que j'entre en place dans une conjoncture fâcheuse, par les inquiétudes répandues sur les subsistances, inquiétudes fortifiées par la fermentation des esprits depuis quelques années, par la variation des principes des administrateurs, par quelques opérations imprudentes et surtout par une récolte qui paraît avoir été médiocre. Sur cette matière, comme sur beaucoup d'autres, je ne demande point à Votre Majesté d'adopter mes principes, sans les avoir examinés et discutés, soit par elle-même, soit par des personnes de confiance en sa présence; mais quand elle en aura reconnu la justice et la nécessité, je la supplie d'en maintenir l'exécution avec fermeté, sans se laisser effrayer par des clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelque système qu'on suive, quelque conduite qu'on tienne.
Voilà les points que Votre Majesté a bien voulu me permettre lui rappeler. Elle n'oubliera pas qu'en recevant la place de contrôleur général, j'ai senti tout le prix de la confiance dont elle m'honore; j'ai senti qu'elle me confiait le soin de ses peuples et, s'il m'est permis de le dire, le soin de faire aimer sa personne et son autorité.
Mais en même temps j'ai senti tout le danger auquel je m'exposais. J'ai prévu que je serais seul à combattre contre les abus de tout genre, contre les efforts de ceux qui gagnent à ces abus; contre la foule des préjugés qui s'opposent à toute réforme, et qui sont un moyen si puissant dans les mains des gens intéressés à éterniser le désordre. J'aurai à lutter même contre la bonté naturelle, contre la générosité de Votre Majesté et des personnes qui lui sont les plus chères. Je serai craint, haï même de la plus grande partie de la cour, et tout ce qui sollicite des grâces. On m'imputera tous les refus; on me peindra comme un homme dur, parce que j 'aurai représenté à Votre Majesté qu'elle ne doit pas enrichir même ceux qu 'elle aime, aux dépens de la subsistance de son peuple. Ce peuple auquel je me serai sacrifié est si aisé à tromper, que peut-être j'encourrai sa haine par les mesures mêmes que je prendrai pour le défendre contre la vexation. Je serai calomnié, et peut-être avec assez de vraisemblance pour m'ôter la confiance de Votre Majesté, dès que je ne pourrai espérer de lui être utile; mais son estime, la réputation d'intégrité, la bienveillance publique qui ont déterminé son choix en ma faveur, me sont plus chères que la vie et je cours le risque de les perdre, même en ne méritant à mes yeux aucun reproche.
Votre Majesté se souviendra que c'est sur la foi de ses promesses que je me charge d'un fardeau peut-être au-dessus de mes forces, que c'est à elle personnellement, à l'homme honnête, à l'homme juste et bon plutôt qu'au roi, que je m'abandonne.
J'ose lui répéter ici ce qu 'elle a bien voulu entendre et approuver. La bonté attendrissante avec laquelle elle a daigné presser mes mains dans les siennes, comme pour accepter mon dévouement, ne s'effacera jamais de mon souvenir. Elle soutiendra mon courage. Elle a
pour jamais lié mon bonheur personnel avec les intérêts, la gloire et le bonheur de Votre Majesté."

1774-1776 - Turgot (1727-1781) ne disposa que de deux ans pour accomplir cette oeuvre.
Dès 1774, un édit proclama la liberté du commerce des grains, abolissant la frontière des provinces; en janvier 1776, la corvée exigée des paysans fut supprimée et remplacée par une contribution que devaient payer tous les propriétaires; la même année, un autre édit libérait toutes les professions, supprimant les corporations, les jurés et les maîtres. Comme Turgot l'avait prévu, les courtisans se dressèrent contre lui; la reine se plaignit des économies qui la gênaient, le Parlement de Paris fit des remontrances, et le roi qui avait confiance en lui n'eut pas le courage de tenir tête à son entourage et à la reine. Le 13 mai 1776, il lui donna l'ordre d'abandonner ses fonctions; avec lui, disparurent Malesherbes, qui avait fait de louables efforts pour humaniser les prisons, adoucir la torture et améliorer la condition des protestants, et Saint-Germain qui avait discipliné l'armée, lutté contre le favoritisme, perfectionné le matériel.
1778-1781 - La crise financière et l'obstruction de la noblesse obligent Louis XVI à convoquer les États généraux, Necker, banquier genevois installé à à Paris, entre en scène...
«Nous avons fait un beau rêve, mais il a été court», écrivait Condorcet à Voltaire au lendemain de la retraite de Turgot : la royauté, désormais rebelle à l'opinion publique, n'allait plus s'appuyer que sur une noblesse impuissante et sur un clergé discrédité. C'en était fait de ce qui semblait s'annoncer comme «gouvernement des philosophes», qui devait réformer tous les abus et guérir tous les maux...

1776 - Le "Supplément" à l'Encyclopédie est le complément apporté à l'Encyclopédie par les libraires éditeurs Marc-Michel Rey et Charles-Joseph Panckoucke et le philosophe Jean-Baptiste-René Robinet entre 1776 et 1780. Il se compose de 4 volumes de texte, d'un volume de planches et de deux volumes de tables.
1784-1789 - Diderot meurt en 1784.
15000 exemplaires de l'Encyclopédie ont été vendus. La France d’après les Cahiers de 1789 révèle un Tiers-Etat monarchiste mais rejetant tout pouvoir arbitraire, suppliant «le roi de défendre la foi contre les atteintes de la nouvelle philosophie», ne réclamant ni l’abolition ni de la noblesse ni du clergé, et ne sachant pas définir un quelconque désir de «liberté».
Une seule réalité : affamés par des disettes successives, ils aspirent à de profondes réformes qui tardent à être menées, ainsi qu’à une plus grande unité législative préservant néanmoins une décentralisation propre à favoriser le développement des provinces, et donc de leur existence....
