- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), "De l'esprit" (1758), "De l'Homme" (1772) - Anne-Catherine de Ligneville Helvétius (1720-1780) - ...
Last update 10/10/2021

Fermier général, Helvétius, disciple de Condillac et de Locke, admirateur et correspondant de Hume, consacra toute sa fortune au soutien de la philosophie des Lumières et lui apporte son matérialisme, qui fait de l'homme le produit de l'éducation, et son ardent désir d'une refonte de la législation. Son ouvrage essentiel, "De l'esprit" (1758), matérialiste et antireligieux, fut condamné à être brûlé, et Helvétius dut se rétracter publiquement, mais cet ouvrage marqua profondément la pensée française au XVIIIe siècle ....
Nous ne donnons le nom d' "esprit" qu'à l'habitude des idées qui nous sont utiles, soit parce qu'instructives, soit parce qu'agréables. Toute idée qu'on nous présente a toujours quelques rapports avec notre état, nos passions, nos opinions. Et dans ces différents cas, nous prisons d'autant plus une idée que cette idée nous est plus utile. Il en résulte que nous n'estimons au fond que nous dans les autres. Il ne faut pas s'en indigner et crier que les hommes sont méchants; il faut seulement bien comprendre, afin d'en tirer parti, que l'intérêt est le ressort moral des êtres humains et que notre indignation n'y changerait rien. Tels sont les résultats auxquels conduit l'analyse de la nature humaine qu'en fait Helvétius : les sensations emplissent l'esprit de l'être humain dont l'entendement ne saurait rien tirer de son propre fond; l'intérêt et l'intérêt seul le guide dans ses actes et ses jugements. Et cet intérêt va de même expliquer aussi les jugements que portent les sociétés sur les actions de leurs membres ...


Conduit par le fastueux financier de la Popelinière chez Mme de Tencin pour lui lire sa tragédie d'Aristomène, Marmontel (Mémoires) trouva dans ce salon renommé "un auditoire respectable". Outre la maîtresse de maison, femme d'un esprit et d'un sens profonds, mais qui, avec son extérieur de simplicité, ressemblait à une ménagère, il y avait là Fontenelle, le grand homme du temps, d'une vieillesse toujours jeune, malgré son extrême surdité, d'un esprit aiguisé et qui excellait en mots piquants, en jolis contes instructifs, Marivaux, impatient de montrer sa finesse sagace, Mairan, le physicien, Astruc, le médecin, et le « jeune Helvétius». Sans doute, Marmontel ne fait pas allusion, par ces termes, à l'extrême jeunesse du séduisant fermier-général, mais il le distingue de son père. Helvétius est représenté comme un homme attentif et discret. Il « recueillait pour semer un jour », et c'est bien cette attitude qu'il garde dans le monde. Il est pensif et réservé, il enregistre les idées et lui-même a recommandé à plusieurs reprises «la chasse aux idées » qu'on a pu lui reprocher. Il écoute et ne s'applique pas particulièrement à briller. Aussi Grimm dira qu'il avait, comme homme privé, toutes sortes de qualités, mais que sa conversation n'était ni agréable ni brillante. Il réfléchit. Il ne se donne guère la peine d'improviser.
Dans le salon de Mme de Tencin, cependant, on est moins friand de l'idée que du trait, moins du fait que de l'anecdote ; la saillie mordante y obtient sans doute plus de succès que la vigueur d'un argument. L'ancienne religieuse, enrichie par les spéculations, dont la beauté et les aventures d'amour étaient célèbres, la mère de d'Alembert, soucieuse de reconnaître l'enfant devenu glorieux, réunissait dans sa "ménagerie" les savants comme les hommes de lettres. Et au XVIIIe siècle, où règne la curiosité, ils ne se distinguent guère. La conception nouvelle pour avoir droit de cité se dissimule sous la verve du causeur qui s'efforce de se faire écouter et applaudir. Les beaux-esprits y discutent, mais restent toujours de beaux-esprits ...
Mme de Tencin meurt en 1749, en pleine bataille philosophique, avant le grand mouvement de l'Encyclopédie. Jusqu'en 1750, la lutte pour l'émancipation intellectuelle se dessine. Ensuite, les philosophes pourront garder des habitudes de bel-esprit, mais leur ambition sera plus nette. Les revendications, même déguisées en saillies d'apparence frivole, se dégageront mieux des attitudes littéraires et mondaines. "L'Esprit des Lois" est de 1748, "La Lettre pour les aveugles" de 1749. Les événements se précipitent et leur signification s'accentue dans cette seconde période en même temps qu'une sorte de parti social s'organise. Avant 1750, on a Marivaux. Après 1750, Beaumarchais ...

Claude-Adrien Helvétius (1715-1771)
Helvétius, riche fermier général et protecteur des philosophes, disciple de Condillac: dans ses traités De l'Esprit (1758) et De l'Homme (1772), applique à la morale les conséquences extrêmes du sensualisme. L'étude réaliste de l'esprit humain le conduit à l'idée matérialiste, vivement combattue par les moralistes traditionnels, que notre intérêt seul dicte nos jugements et nos actions. Pour lui, la moralité n'est autre que la conformité à une législation bien faite ; il s'efforce donc de fonder sur le réalisme une morale efficace : c'est par une utilisation rationnelle de l'intérêt et des passions, et en premier lieu par une éducation appropriée, qu'on établira l'harmonie sociale entre individus.
Claude-Adrien Helvétius naquit à Paris en janvier 1715, fit ses études chez les Jésuites, puis se prépara à la carrière des finances à laquelle son père le destinait ; cette préparation ne l'empêchait pas de s'occuper de lettres et de philosophie, et de mener, par surcroit, une vie de plaisirs. Il avait seulement vingt-trois ans lorsque ses parents obtinrent pour lui une place de fermier général. Les revenus considérables (environ cent mille écus) que lui rapportait annuellement cette fonction furent employés par Helvétius partie au remboursement des fonds avancés au roi et que ses parents avaient dû emprunter, partie à "faire le bien", car il fut un discret et très « libéral » mécène ; partie enfin à s'assurer une existence opulente et riche en plaisirs. Helvétius était bien fait, avait un visage agréable et avait le don de
plaire aux femmes. En 1749 il acheta la charge de maitre d'hôtel de la reine Marie Leczinska. En 1751, il se démit de celle de fermier général et se maria. Il s'était de bonne heure, nous l'avons dit, adonné aux lettres et à la philosophie. Il fit des vers, une épître sur "l'Amour de l'étude", une autre "sur le Plaisir", une autre sur 'la Paresse de l'orgueil et de l'esprit", une autre sur "les Arts", qu'il soumit à plusieurs écrivains et notamment à Voltaire qui l'encourageait. Il écrivit ensuite une poésie en deux chants sur "le Bonheur".
(Portrait de Claude Adrien Helvétius, par Charles Amedee Philippe van Loo)
Les ouvrages d'Helvétius sont d'une lecture un peu déconcertante, l'auteur s'est peu soucié de leur composition, les digressions y sont nombreuses, malgré d'abondantes notes reléguées à la fin des chapitres. Les faits, les anecdotes, les réflexions fines y abondent et donnent à chaque page un intérêt nouveau. Helvétius, quand il n'écrivait pas, faisait « la chasse aux idées », soit par des lectures, soit par des conversations.
La partie principale de l' œuvre d'Helvétius, ce sont ses deux traités, le traité "De l'Esprit", qui parut en 1758 et le traité "De l'Homme" qui ne parut qu'en 1772, après la mort de l'auteur. Le livre "De l'Esprit", à son apparition, fit un bruit considérable. « Avec Hobbes et La Rochefoucauld, Helvétius enseigne que l'intérêt personnel doit être et est réellement l'unique mobile de nos actions. L'égoïsme transformé produit le monde moral, comme la sensation transformée produit le monde intellectuel, comme le mouvement transformé produit le monde matériel. La vraie morale n'est que la physique des mœurs. » Les théories soutenues dans ce livre de philosophie matérialiste soulevèrent de nombreuses indignations. Le Dauphin lui-même le dénonça à la reine. Le privilège qu'on avait accordé au livre fut retiré, la vente en fut interdite. Helvétius, surpris par une telle tempête, se rétracta. Il disait à la fin de sa rétractation : « Je n'ai voulu attaquer aucune des vérités du christianisme, que je professe sincèrement dans toute la rigueur de ses dogmes et de sa morale, et auquel je fais gloire de soumettre toutes mes pensées, toutes mes opinions et toutes les facultés de mon être, certain que tout ce qui n'est pas conforme à son esprit ne peut l'être à la vérité. Voilà mes véritables sentiments; j'ai vécu, je vivrai, je mourrai avec eux. »
Cependant il s'était promis de ne plus écrire ; mais l'orage passé, il reprit la plume et composa son traité "de l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation", qui est une suite "de l'Esprit" et dont la première édition française est de 1772. Helvétius mourut à Paris, le 26 décembre 1771. Bien que très lié avec les Encyclopédistes, et assidu aux réunions du baron d'Holbach, il ne collabora pas à l'Encyclopédie ...

C'est dans les premiers jours du mois d'août 1758 que parut le livre de L'Esprit, sans nom d'auteur, et à Paris chez Durand, libraire, rue du Foin, à une époque troublée. A l'extérieur, la France venait de subir l'humiliante défaite de Rosbach (1757) suivie de celle de Crevelt (19 juin 1758). L'absurde politique du gouvernement portait ses fruits amers. Si l'intervention en Allemagne était désastreuse, la ruine de la marine s'annonçait et l'ennemi s'emparait des colonies. Le Canada, malgré Montcalm (la capitulation de Louisbourg est du 27 juillet 1758), était perdu. A l'intérieur, Louis XV, par son lit de justice de 1756, avait prononcé la disgrâce du Parlement, que l'on considérait, en oubliant ses défauts, comme le dernier gardien des libertés publiques. Le 5 janvier 1757, Damiens frappa le roi d'un coup de canif pour l'engager, disait-il, à s'élever contre le refus des sacrements. La Déclaration Royale de 1757 portait à toutes les lignes la peine de mort contre les auteurs, éditeurs, colporteurs d'écrits hostiles à la religion. Les philosophes formaient un véritable parti, d'une audace ingénieuse et perfide et s'attachaient à la ruine des vieilles institutions monarchiques. Et, de fait, le livre de L'Esprit est bien, avant tout, un long et formidable réquisitoire contre le despotisme, contre la cour et le funeste esprit de cour, contre les crimes et les abus engendrés par l'absolutisme politique ou religieux. Tel est donc le caractère primordial de l'ouvrage : c'est une satire cruelle, implacable, des vices d'un système politique. L'admirateur de Fontenelle, l'élève de Voltaire a plus ou moins dissimulé son réquisitoire dans, une gerbe de pensées fines, malicieuses, pénétrantes, qui ne sont pas, du reste, la moindre partie de son œuvre.
Quelle est la nature de l'homme ? Quelles sont ses tendances fondamentales? Cette recherche s'impose. Ne peut-on l'entreprendre d'après les faits, d'après les gestes, d'après le langage qui est encore un signe, c'est-à-dire d'après ce qui est réel, et non d'après des textes obscurs de la théologie, d'après une mystérieuse révélation? Précisément, la transformation de la société, le bonheur de l'humanité ne peuvent exister sans la connaissance préalable et précise de l'homme en général. Telle est la tâche à laquelle l'auteur de L'Esprit s'est voué : "« Il pensa qu'avant d'examiner les législations et de les comparer entre elles, il fallait étudier l'homme lui-même et fonder sur sa propre nature l'édifice auquel il doit être soumis. Tel fut l'objet du livre de "L'Esprit", qui, postérieur à "L'Esprit des Lois" dans l'ordre des temps, le précède immédiatement dans l'ordre des idées" (Chastellux) ...
Mais la Cour et l'Église allaient condamner rapidement l'ouvrage. Quelques jours après sa mise en vente, le 10 août 1758, le Conseil d'État du roi révoquait les Lettres de Privilège obtenues pour son impression. « Sa Majesté, dit l'arrêt du Conseil, aurait reconnu que la licence qui règne dans cet ouvrage, et les maximes dangereuses qui y sont répandues, ne permettent pas de laisser subsister le dit privilège et de tolérer le débit et la distribution du livre. » En conséquence, la vente de l'Esprit était interdite « à peine de punition exemplaire ».Helvétius, au moment de faire imprimer son livre, avait bien pensé qu'il aurait des difficultés; il ne croyait pas qu'elles seraient si graves. Sur l'ordre du pape Clément XIII, les théologiens de l'Inquisition examinent le livre de l'Esprit et le déclarent « rempli de propositions impies, scandaleuses et hérétiques». Clément XIII fait défense de le lire ou de le garder, par une Lettre Apostolique datée du 31 janvier 1759. Quelques jours auparavant (le 23 janvier), l'ouvrage d'Helvétius avait été déféré au Parlement. Le 6 février, la Cour ordonna que l'Esprit fût lacéré et brûlé, et, le 10 février, cet arrêt fut exécuté par le bourreau. Helvétius n'avait plus à redouter que la détermination des docteurs de la Sorbonne. Elle fut connue le 9 avril 1759. La Faculté condamnait l'Esprit « comme un des ouvrage les plus détestables qui puissent jamais paraître », et ses censures furent présentées au roi sur l'ordre même de ce dernier. Helvétius dut se démettre de sa charge de maître d'hôtel de la Reine. Pendant que les Jésuites et les Jansénistes, l'Église et la Cour, le Parlement et la Faculté s'acharnaient sur "l'Esprit", le succès de ce dernier allait grandissant. Il était, en effet, traduit en plusieurs langues et eut, tant en France qu'à l'étranger, plus de cinquante éditions. L'autre grand ouvrage d'Helvétius, "De l'homme", ne parut qu'après sa mort, en 1772. Au plus fort de l'affaire, Helvétius s'était promis de ne plus écrire une seule ligne ...
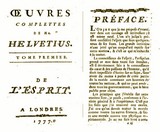
1758 - "De l'esprit"
Le problème qu’il se pose est le suivant : tout, dans l’esprit, provient de la sensibilité physique ; or, d’une part, la sensibilité physique est identique chez tous les hommes et même chez beaucoup d’animaux ; d’autre part, il y a une grande diversité d’esprits, différents par leur nature et leur valeur : comment pareille diversité peut‑elle naître d’un même point de départ ? Cette différence dérive immédiatement de la capacité, plus ou moins grande, de l’attention et de son orientation, qui élit tel ou tel objet ; or, cette capacité et cette direction sont uniquement en raison de la passion, et « l’on devient stupide dès qu’on cesse d’être passionné ». La passion elle‑même se ramène enfin à la recherche du plaisir et à la fuite de la douleur, c’est‑à‑dire à la sensibilité physique, qui se trouve donc être l’origine de la diversité des esprits ; quant à la valeur de l’esprit, elle ne consiste en rien qui lui soit intrinsèque, mais seulement dans l’estime qu’en font les autres hommes ; cette estime est mesurée à l’intérêt général des membres de la société dont on fait partie : l’avare met peut‑être, dans ses combinaisons, autant d’intelligence et d’esprit que le chef d’une armée victorieuse ; le second est bien supérieur au premier. C’est que chaque société, selon sa nature, le monde, la cour, les gens de lettres, confère la supériorité à un esprit qui, en changeant de milieu, perdra sa valeur, et, comme il est de l’intérêt personnel de chacun de se conformer à l’intérêt de la société dans laquelle il vit, cette société est l’inspiratrice des passions qui doivent produire les esprits qu’elle estime. C’est de là qu’Helvétius déduit le rôle social du philosophe : le philosophe ou le savant est le seul qui vise les intérêts de tous, les intérêts vraiment universels, et non pas ceux d’une société particulière : « ce sont les philosophes qui, de l’état sauvage, ont porté les sociétés au point de perfection où elles sont maintenant parvenues ». Les « préjugés » du sauvage (Helvétius entend par là des cérémonies telles que les sacrifices aux ancêtres ou l’offrande des prémices, celles que la sociologie du XIXe siècle considérera comme le symbole du lien social) sont imposés par l’intérêt particulier de la caste des prêtres.
"I. Principes - La sensibilité seule produit toutes nos idées.
On dispute tous les jours sur ce qu'on doit appeler "esprit"; chacun dit son mot; personne n'attache les mêmes idées à ce mot, et tout le monde parle sans s'entendre.
Pour pouvoir donner une idée juste et précise de ce mot "esprit", et des différentes acceptions dans lesquelles on le prend, il faut d'abord considérer l'esprit en lui-même.
Ou l'on regarde l'esprit comme l'effet de la faculté de penser (et l'esprit n'est, en ce sens, que l'assemblage des pensées d'un homme), ou on le considère comme la faculté même de penser.
Pour savoir ce que c'est que l'esprit, pris dans cette dernière signification, il faut connaître quelles sont les causes productrices de nos idées.
Nous avons en nous deux facultés, ou, si j'ose le dire, deux puissances passives dont l'existence est généralement et distinctement reconnue.
L'une est la faculté de recevoir les impressions différentes que font sur nous les objets extérieurs; on la nomme sensibilité physique.
L'autre est la faculté de conserver l'impression que ces objets ont faite sur nous : on l'appelle mémoire, et la mémoire n'est autre chose qu'une sensation continuée, mais affaiblie.
Ces facultés, que je regarde comme les causes productrices de nos pensées, et qui nous sont communes avec les animaux, ne nous fourniraient cependant qu'un très petit nombre d'idées, si elles n'étaient jointes en nous à une certaine organisation extérieure.
Si la nature, au lieu de mains et de doigts flexibles, eût terminé nos poignets par un pied de cheval, qui doute que les hommes, sans arts, sans habitations, sans défense contre les animaux, tout occupés du soin de pourvoir à leur nourriture et d'éviter les bêtes féroces, ne fussent encore errants dans les forêts comme des troupeaux fugitifs ?
Or, dans cette supposition, il est évident que la police n'eût, dans aucune société, été portée au degré de perfection où maintenant elle est parvenue. Il n'est aucune nation qui, en fait d'esprit, ne fût restée fort inférieure à certaines nations sauvages qui n'ont pas deux cents idées, deux cents mots pour exprimer leurs idées, et dont la langue, par conséquent, ne fût réduite, comme celle des animaux, à cinq ou six sons ou cris, si l'on retranchait de cette même langue les mots d'arcs, de flèches, de filets, etc., qui supposent l'usage de nos mains, d'où je conclus que, sans une certaine organisation extérieure, la sensibilité et la mémoire ne seraient en nous que des facultés stériles.
Maintenant il faut examiner si, par le secours de cette organisation, ces deux facultés ont réellement produit toutes nos pensées.
Avant d'entrer, à ce sujet, dans aucun examen, peut-être me demandera-t-on si ces deux facultés sont des modifications d'une substance spirituelle ou matérielle. Cette question, autrefois agitée par les philosophes, débattue par les anciens Pères, et renouvelée de nos jours, n'entre pas nécessairement dans le plan de mon ouvrage. Ce que j'ai à dire de l'esprit s'accorde également bien avec l'une et l'autre de ces hypothèses. J'observerai seulement à ce sujet que, si l'Église n'eût pas fixé notre croyance sur ce point, et qu'on dût, par les seules lumières de la raison, s'élever jusqu'à la connaissance du principe pensant, on ne pourrait s'empêcher de convenir que nulle opinion en ce genre n'est susceptible de démonstration; qu'on doit peser les raisons pour et contre, balancer les difficultés, se déterminer en faveur du plus grand nombre de vraisemblances, et, par conséquent, ne porter que des jugements provisoires. Il en serait de ce problème comme d'une infinité d'autres qu'on ne peut résoudre qu'à l'aide du calcul des probabilités. Je ne m'arrête donc pas davantage à cette question; je viens à mon sujet, et je dis que la sensibilité physique et la mémoire, ou, pour parler plus exactement, que la sensibilité seule produit toutes nos idées. En effet, la mémoire ne peut être qu'un des organes de la sensibilité physique : le principe qui sent en nous doit être nécessairement le principe qui se ressouvient; puisque se ressouvenir, comme je vais le prouver, n'est proprement que sentir.
Lorsque par une suite de mes idées, ou par l'ébranlement que certains sons causent dans l'organe de mon oreille, je me rappelle l'image d'un chêne, alors mes organes intérieurs doivent nécessairement se trouver à peu près dans la même situation où ils étaient à la vue de ce chêne. Or, cette situation des organes doit incontestablement produire une sensation : il est donc évident que se ressouvenir, c'est sentir.
Ce principe posé, je dis encore que c'est dans la capacité que nous avons d'apercevoir les ressemblances ou les différences, les convenances ou les disconvenances qu'ont entre eux les objets divers, que consistent toutes les opérations de l'esprit. Or, cette capacité n'est que la sensibilité physique même : tout se réduit donc à sentir. Pour nous assurer de cette vérité, considérons la nature...."
Discours I. De l’esprit en lui-même.
"L’objet de ce discours est de prouver que la sensibilité physique et la mémoire sont les causes productrices de toutes nos idées ; et que tous nos faux jugements sont l’effet ou de nos passions, ou de notre ignorance." - Chapitre premier. Exposition des principes. - Chapitre II. Des erreurs occasionnées par nos passions. - Chapitre III. De l’ignorance. On prouve, dans ce chapitre, que la seconde source de nos erreurs consiste dans l’ignorance des faits de la comparaison desquels dépend, en chaque genre, la justesse de nos décisions. - Chapitre IV. De l’abus des mots. Quelques exemples des erreurs occasionnées par l’ignorance de la vraie signification des mots. Il résulte de ce discours, que c’est dans nos passions et notre ignorance que sont les sources de nos erreurs ; que tous nos faux jugements sont l’effet de causes accidentelles qui ne supposent point, dans l’esprit, une faculté de juger distincte de la faculté de sentir.
Discours II. De l’esprit par rapport à la société.
"On se propose de prouver, dans ce discours, que le même intérêt qui préside au jugement que nous portons sur les actions, et nous les fait regarder comme vertueuses, vicieuses ou permises, selon qu’elles font utiles, nuisibles ou indifférentes au public, préside pareillement
au jugement que nous portons sur les idées ; et qu’ainsi, tant en matière de morale que d’esprit, c’est l’intérêt seul qui dicte tous nos jugements : vérité dont on ne peut apercevoir toute l’étendue qu’en considérant la probité et l’esprit relativement, 1) à un particulier, 2) à une petite société, 3) à une nation, 4) aux différents siècles et aux différents pays, et 5) à l’univers. - Chapitre I. Idée générale - Chapitre II. De la probité par rapport à un particulier. - Chapitre III. De l’esprit par rapport à un particulier. On prouve, par les faits, que nous n’estimons, dans les autres, que les idées que nous avons intérêt d’estimer. - Chapitre IV. De la nécessité où nous sommes de n’estimer que nous dans les autres. On prouve encore, dans ce chapitre, que nous sommes, par la paresse et la vanité, toujours forcés de proportionner notre estime pour les idées d’autrui, à l’analogie et à la conformité que ces idées ont avec les nôtres.
- Chapitre V. De la probité par rapport à une société particulière. L’objet de ce chapitre est de montrer que les sociétés particulières ne donnent le nom d’honnêtes qu’aux actions qui leur sont utiles : or l’intérêt de ces sociétés se trouvant souvent opposé à l’intérêt public, elles doivent souvent donner le nom d’honnêtes à des actions réellement nuisibles au public ; elles doivent donc, par l’éloge de ces actions, souvent séduire la probité des plus honnêtes gens, & les détourner, à leur insu, du chemin de la vertu. - Chapitre VI. Des moyens de s’assurer de sa vertu. On indique, en ce chapitre, comment on peut repousser les insinuations des sociétés particulières, résister à leurs séductions, & conserver une vertu inébranlable au choc de mille intérêts particuliers. - Chapitre VII. De l’esprit par rapport aux sociétés particulières. On fait voir que les sociétés pèsent à la même balance le mérite des idées & des actions des hommes. Or, l’intérêt de ces sociétés n’étant pas toujours conforme à l’intérêt général, on sent qu’elles doivent, en conséquence, porter, sur les mêmes objets, des jugements très différents de ceux du public. - Chapitre VIII. De la différence des jugements du public & de ceux des sociétés particulières. Conséquemment à la différence qui se trouve entre l’intérêt du public & celui des sociétés particulières, on prouve, dans ce chapitre, que ces sociétés doivent attacher une grande estime à ce qu’on appelle bon ton & le bel usage.
- Chapitre IX. Du bon ton & du bel usage. Le public ne peut avoir, pour ce bon ton & ce bel usage, la même estime que les sociétés particulières. - Chapitre X. Pourquoi l’homme admiré du public n’est pas toujours estimé des gens du monde. On prouve qu’à cet égard la différence des jugements du public & des sociétés particulières, tient à la différence de leurs intérêts. - Chapitre XI. De la probité par rapport au public. En conséquence des principes ci-devant établis, on fait voir que l’intérêt général préside au jugement que le public porte sur les actions des hommes. - Chapitre XII. De l’esprit par rapport au public. Il s’agit de prouver, dans ce chapitre, que l’estime du public pour les idées des hommes est toujours proportionnée à l’intérêt qu’il a de les estimer. - Chapitre XIII. De la probité par rapport aux siècles & aux peuples divers. L’objet qu’on se propose, dans ce chapitre, c’est de montrer que les peuples divers n’ont, dans tous les siècles & dans tous les pays, jamais accordé le nom de vertueuses qu’aux actions ou qui étaient, ou du moins qu’ils croyaient utiles au public. C’est pour jeter plus de jour sur cette matière, qu’on distingue, dans ce même chapitre, deux différentes espèces de vertus.
- Chapitre XIV. Des vertus de préjugé, & des vraies vertus. On entend, par vertus de préjugé, celles dont l’exacte observation ne contribue en rien au bonheur public ; &, par vraies vertus, celles dont la pratique assure la félicité des peuples. Conséquemment à ces deux différentes espèces de vertus, on distingue, dans ce même chapitre, deux différentes espèces de corruption de mœurs ; l’une religieuse, & l’autre politique : connaissance propre a répandre de nouvelles lumières fur la science de la morale. - Chapitre XV. De quelle utilité peut être à la morale la connaissance des principes établis dans les chapitres précédents. L’objet de ce chapitre est de prouver que c’est de la législation meilleure ou moins bonne que dépendent les vices ou les vertus des peuples ; & que la plupart des moralistes, dans la peinture qu’ils font des vices, paraissent moins inspirés par l’amour du bien public, que par les intérêts personnels, ou des haines particulières. - Chapitre XVI. Des moralistes hypocrites. Développement des principes précédents. - Chapitre XVII. Des avantages que pourraient procurer aux hommes les principes ci-dessus exposés. Ces principes donnent aux particuliers, aux peuples, & même aux législateurs, des idées plus nettes de la vertu, facilitent les réformes dans les lois, nous apprennent que la science de la morale n’est autre chose que la science même de la législation ; & nous fournissent enfin les moyens de rendre les peuples plus heureux & les empires plus durables.
- Chapitre XVIII. De l’esprit, considéré par rapport aux siècles & aux pays divers. Exposition de ce qu’on examine dans les chapitres suivants. - Chapitre XIX. Que l’estime pour les différents genres d’esprit est, dans chaque siècle, proportionnée à l’intérêt qu’on a de les estimer. - Chapitre XX. De l’esprit, considéré par rapport aux différents pays. Il s’agit, conformément au plan de ce discours, de montrer que l’intérêt est, chez tous les peuples, le dispensateur de l’estime accordée aux idées des hommes ; & que les nations, toujours fidèles à l’intérêt de leur vanité, n’estiment, dans les autres nations, que les idées analogues aux leurs. Chapitre XXI. Que le mépris respectif des nations tient à l’intérêt de leur vanité. Après avoir prouvé que les nations méprisent, dans les autres, les mœurs, les coutumes & les usages différents des leurs ; on ajoute que leur vanité leur fait encore regarder comme un don de la nature la supériorité que quelques-unes d’entre elles ont sur les autres : supériorité qu’elles ne doivent qu’à la constitution politique de leur état. Chapitre XXII. Pourquoi les nations mettent au rang des dons de la nature des qualités qu’elles ne doivent qu’à la forme de leur gouvernement. On fait voir, dans ce chapitre que la vanité commande aux nations comme aux particuliers ; que tout obéit à la loi de l’intérêt ; & que, si les nations, conséquemment à cet intérêt, n’ont point, pour la morale , l’estime qu’elles devraient avoir pour cette science, c’est que la morale, encore au berceau, semble n’avoir jusqu’à présent été d’aucune utilité à l’univers.
Chapitre XXIII. Des causes qui jusqu’à présent ont retardé les progrès de la morale. - Chapitre XXIV. Des moyens de perfectionner la morale. Chapitre XXV. De la probité par rapport à l’univers. Chapitre XXVI. De l’esprit par rapport à l’univers. L’objet de ce chapitre est de montrer qu’il est des idées utiles à l’univers ; & que les idées de cette espèce font les seules qui puissent nous faire obtenir l’estime des nations.
La conclusion générale de ce discours, c’est que l’intérêt, ainsi qu’on s’était proposé de le prouver, est l’unique dispensateur de l’estime & du mépris attachés aux actions et aux idées des hommes.
Chapitre XIII. De la probité, par rapport aux siècleset aux peuples divers.
"Dans tous les siècles et les pays divers, la probité ne peut être que l’habitude des actions utiles à sa nation. Quelque certaine que soit cette proposition, pour en faire sentir plus évidemment la vérité, je tâcherai de donner des idées nettes et précises de la vertu. Pour cet effet, j’exposerai les deux sentiments qui, sur ce sujet, ont jusqu’à présent partagé les moralistes.
Les uns soutiennent que nous avons de la vertu une idée absolue et indépendante des siècles et des gouvernements divers ; que la vertu est toujours une et toujours la même. Les autres soutiennent, au contraire, que chaque nation s’en forme une idée différente.
Les premiers apportent, en preuve de leurs opinions, les rêves ingénieux, mais inintelligibles, du Platonisme. La vertu, selon eux, n’est autre chose que l’idée même de l’ordre, de l’harmonie et d’un beau essentiel. Mais ce beau est un mystère dont ils ne peuvent donner d’idée précise : aussi n’établissent-ils point leur système sur la connaissance que l’histoire nous donne du cœur et de l’esprit humain.
Les seconds, et parmi eux Montaigne, avec des armes d’une trempe plus forte que des raisonnements, c’est-à-dire, avec des faits, attaquent l’opinion des premiers ; font voir qu’une action, vertueuse au nord, est vicieuse au midi ; et en concluent que l’idée de la vertu est purement arbitraire.
Telles sont les opinions de ces deux espèces de philosophes. Ceux-là, pour n’avoir pas consulté l’histoire, errent encore dans le dédale d’une métaphysique de mots : ceux-ci, pour n’avoir point assez profondément examiné les faits que l’histoire présente, ont pensé que le caprice seul décidait de la bonté ou de la méchanceté des actions humaines. Ces deux sectes de philosophes se sont également trompées ; mais l’une et l’autre auraient échappé à l’erreur, s’ils avaient considéré, d’un œil attentif, l’histoire du monde. Alors ils auraient senti que les siècles doivent nécessairement amener, dans le physique et le moral, des révolutions qui changent la face des empires ; que, dans les grands bouleversements, les intérêts d’un peuple éprouvent toujours de grands changements ; que les mêmes actions peuvent lui devenir successivement utiles et nuisibles, par conséquent prendre tour à tour le nom de vertueuses et de vicieuses.
Conséquemment à cette observation, s’ils eussent voulu se former de la vertu une idée purement abstraite et indépendante de la pratique, ils auraient reconnu que, par ce mot de vertu, l’on ne peut entendre que le désir du bonheur général ; que, par conséquent, le bien public est l’objet de la vertu, et que les actions qu’elle commande sont les moyens dont elle se sert pour remplir cet objet ; qu’ainsi l’idée de la vertu n’est point arbitraire ; que, dans les siècles et les pays divers, tous les hommes, du moins ceux qui vivent en société, ont dû s’en former la même idée ; et qu’enfin, si les peuples se la représentent sous des formes différentes, c’est qu’ils prennent pour la vertu même les divers moyens dont elle se sert pour remplir son objet. Cette définition de la vertu en donne, je pense, une idée nette, simple, et conforme à l’expérience ; conformité qui peut seule constater la vérité d’une opinion.
La pyramide de Vénus-Uranie, dont la cime se perdait dans les cieux, et dont la base était appuyée sur la terre, est l’emblème de tout système, qui s’écroule à mesure qu’on l’édifie, s’il ne porte sur la base inébranlable des faits et de l’expérience. C’est aussi sur des faits, c’est-à-dire, sur la folie et la bizarrerie jusqu’à présent inexplicables des lois et des usages divers, que j’établis la preuve de mon opinion.
Quelque stupides qu’on suppose les peuples, il est certain qu’éclairés par leurs intérêts ils n’ont point adopté sans motifs les coutumes ridicules qu’on trouve établies chez quelques-uns d’eux ; la bizarrerie de ces coutumes tient donc à la diversité des intérêts des peuples : en effet, s’ils ont toujours confusément entendu, par le mot de vertu, le désir du bonheur public ; s’ils n’ont, en conséquence, donné le nom d’honnêtes qu’aux actions utiles à la patrie ; et si l’idée d’utilité a toujours été secrètement associée à l’idée de vertu ; on peut assurer que les coutumes les plus ridicules, et même les plus cruelles, ont, comme je vais le montrer par quelques exemples, toujours eu pour fondement l’utilité réelle ou apparente du bien public...."
Discours III. Si l’esprit doit être considéré comme un don de la nature, ou comme un effet de l’éducation.
Pour résoudre ce problème ; on recherche, dans ce discours, si la nature a doué les hommes d’une égale aptitude à l’esprit, ou si elle a plus favorisé les uns que les autres ; & l’on examine si tous les hommes, communément bien organisés, n’auraient pas en eux la puissance physique de s’élever aux plus hautes idées, lorsqu’ils ont des motifs suffisants pour surmonter la peine de l’application. - Chapitre I . On fait voir, dans ce chapitre, que, si la nature a donné aux divers hommes d’inégales dispositions à l’esprit, c’est en dotant les uns, préférablement aux autres, d’un peu plus de finesse de sens, d’étendue de mémoire, & de capacité d’attention. La question réduite à ce point simple, on examine, dans les chapitres suivants, quelle influence a sur l’esprit des hommes la différence qu’à cet égard la nature a pu mettre entre eux. - Chapitre II. De la finesse des sens. - Chapitre III. De l’étendue de la mémoire. - Chapitre IV. De l’inégale capacité d’attention. - On prouve, dans ce chapitre, que la nature a doué tous les ; hommes, communément bien organisés, du degré d’attention nécessaire pour s’élever aux plus hautes idées : on observe ensuite que l’attention est une fatigue & une peine à laquelle on se soustrait toujours, si l’on n’est animé d’une passion propre à changer cette peine en plaisir ; qu’ainsi la question se réduit à savoir si tous les hommes sont, par leur nature, susceptibles de passions assez fortes pour les douer du degré d’attention auquel est attachée la supériorité de l’esprit.
C’est pour parvenir à cette connaissance, qu’on examine, dans le chapitre suivant, quelles font les forces qui nous meuvent. -Chapitre V. Des forces qui agissent sur notre âme. Ces forces se réduisent à deux : l’une, qui nous est communiquée par les passions fortes ; & l’autre, par la haine de l’ennui. Ce font les effets de cette dernière force qu’on examine dans ce chapitre.
- Chapitre VI. De la puissance des passions. - On prouve que ce font les passions qui nous portent aux actions héroïques, & nous élèvent aux plus grandes idées. Chapitre VII. De la supériorité d’esprit des gens passionnés sur les gens sensés. - Chapitre VIII. Que l’on devient stupide, dès qu’on cesse d’être passionné. Après avoir prouvé que ce font les passions qui nous arrachent à la paresse ou à l’inertie, & qui nous donnent de cette continuité d’attention nécessaire pour s’élever aux plus hautes idées ; il faut ensuite examiner si tous les hommes sont susceptibles de passions, & du degré de passion propre à nous douer de cette espèce d’attention. Pour le découvrir, il faut remonter jusqu’à leur origine.
- Chapitre IX. De l’origine des passions. L’objet de ce chapitre est de faire voir que toutes nos passions prennent leur source dans l’amour du plaisir, ou dans la crainte de la douleur, &, par conséquent, dans la sensibilité physique. On choisit, pour exemples en ce genre, les passions qui paraissent les plus indépendantes de cette sensibilité ; c’est-à-dire, l’avarice, l’ambition, l’orgueil & l’amitié. - Chapitre X. De l’avarice. - On prouve que cette passion est fondée sur l’amour du plaisir & la crainte de la douleur ; & l’on fait voir comment, en allumant en nous la soif des plaisirs, l’avarice peuvent toujours nous en priver.
- Chapitre XI. De L’ambition. Application des mêmes principes, qui prouvent que les mêmes motifs qui nous font désirer les richesses, nous font rechercher les grandeurs. - Chapitre XII. Si, dans la poursuite des grandeurs, L’on ne cherche qu’un moyen de se soustraire à la douleur ou de jouir des plaisirs physiques, pourquoi le plaisir échappe-t-il si souvent à l’ambitieux ? On répond à cette objection, & l’on prouve qu’à cet égard il en est de l’ambition comme de l’avarice. - Chapitre XIII. De l’orgueil. L’objet de ce chapitre est de montrer qu’on ne désire d’être estimable que pour être estimé ; & qu’on ne désire d’être estimé que pour jouir des avantages que l’estime procure : avantages qui se réduisent toujours à des plaisirs physiques. - Chapitre XIV. De l’amitié. Autre application des mêmes principes.
- Chapitre XV. Que la crainte des peines ou le désir des plaisirs physiques peuvent allumer en nous toutes sortes de passions. Après avoir prouvé, dans les chapitres précédents, que toutes nos passions tirent leur origine de la sensibilité physique ; pour confirmer cette vérité, on prouve, dans ce chapitre, que, par le secours des plaisirs physiques, les législateurs peuvent allumer dans les cœurs toutes fortes de passions. Mais, en convenant que tous les hommes sont susceptibles de passions, comme on pourrait supposer qu’ils ne font pas du moins susceptibles du degré de passion nécessaire pour les élever aux plus hautes idées, & qu’on pourrait apporter en exemple de cette opinion l’insensibilité de certaines nations aux passions de la gloire & de la vertu ; on prouve que l’indifférence de certaines nations, à cet égard, ne tient qu’à des causes accidentelles, telles que la forme différente des gouvernements.
- Chapitre XVI. A quelle cause on doit attribuer l’indifférence de certains peuples pour la vertu. Pour résoudre cette question, on examine, dans chaque homme, le mélange de ses vices & de ses vertus, le jeu de ses passions, l’idée qu’on doit attacher au mot vertueux ; & l’on découvre que ce n’est point à la nature, mais à la législation particulière de quelques empires, qu’on doit attribuer l’indifférence de certains peuples pour la vertu. C’est pour jeter plus de jour sur cette matière, que l’on considère, en particulier, & les gouvernements despotiques & les états libres, & enfin les différents effets que doit produire la forme différente de ces gouvernements. L’on commence par le despotisme ; &, pour en mieux connaître la nature, on examine quel motif allume dans l’homme le désir effréné du pouvoir arbitraire.
Chapitre XVII. Du désir que tous les hommes ont d’être despotes ; des moyens qu’ils emploient pour y parvenir, & du danger auquel le despotisme expose les rois. Chapitre XVIII. Principaux effets du despotisme. On prouve, dans ce chapitre, que les vizirs n’ont aucun intérêt de s’instruire, ni de supporter la censure ; que ces vizirs, tirés du corps des citoyens, n’ont, en entrant en place, aucuns principes de justice & d’administration ; & qu’ils ne peuvent se former des idées nettes de la vertu. - Chapitre XIX. Le mépris et l’avilissement où sont les peuples entretient l’ignorance des vizirs ; second effet du despotisme. - Chapitre XX. Du mépris de la vertu, & de la fausse estime qu’on affecte pour elle ; troisième effet du despotisme. On prouve que, dans les empires despotiques, on n’a réellement que du mépris pour la vertu, & qu’on n’en honore que le nom. - Chapitre XXI. Du renversement des empires fournis au pouvoir arbitraire ; quatrième effet du despotisme. Après avoir montré, dans l’abrutissement & la bassesse de la plupart des peuples soumis au pouvoir arbitraire la cause du renversement des empires despotiques, l’on conclut, de ce qu’on a dit sur cette matière, que c’est uniquement de la forme particulière des gouvernements que dépend l’indifférence de certains peuples pour la vertu : &, pour ne laisser rien à désirer fur ce sujet, l’on examine, dans les chapitres suivants, la cause des effets contraires.
Chapitre XXII. De l’amour de certains peuples pour la gloire & pour la vertu. On fait voir, dans ce chapitre, que cet amour pour la gloire & pour la vertu dépend, dans chaque empire, de l’adresse avec laquelle le législateur y unit l’intérêt particulier à l’intérêt général ; union plus facile à faire dans certains pays que dans d’autres. - Chapitre XXIII. Que les nations pauvres ont toujours été & plus avides de gloire, & plus fécondes en grands hommes que les nations opulentes. On prouve, dans ce chapitre, que la production des grands hommes est, dans tout pays, l’effet nécessaire des récompenses qu’on y assigne aux grands talents & aux grandes vertus ; & que les talents & les vertus ne sont, nulle part, aussi récompensés que dans les républiques pauvres & guerrières. - Chapitre XXIV. Preuve de cette vérité. Ce chapitre ne contient que la preuve de la proposition énoncée dans le chapitre précédent. On en tire cette conclusion : c’est qu’on peut appliquer a toute espèce de passions ce qu’on dit, dans ce même chapitre, de l’amour ou de l’indifférence de certains peuples pour la gloire & pour la vertu : d’où l’on conclut que ce n’est point à la nature qu’on doit attribuer ce degré inégal de passions, dont certains peuples paraissent susceptibles. On confirme cette vérité en prouvant, dans les chapitres suivants, que la force des passions des hommes est toujours proportionnée à la force des moyens employés pour les exciter. - Chapitre XXV. Du rapport exact entre la force des passions & la grandeur des récompenses qu’on leur propose pour objet. Après avoir fait voir l’exactitude de ce rapport, on examine à quel degré de vivacité on peut porter l’enthousiasme des passions.
- Chapitre XXVI. De quel degré de passion les hommes sont susceptibles. On prouve, dans ce chapitre, que les passions peuvent s’exalter en nous jusqu’à l’incroyable ; & que tous les hommes, par conséquent, sont susceptibles d’un degré de passion plus que suffisant pour les faire triompher de leur paresse, & les douer de la continuité d’attention à laquelle est attachée la supériorité d’esprit : qu’ainsi la grande inégalité d’esprit qu’on aperçoit entre les hommes dépend & de la différente éducation qu’ils reçoivent & de l’enchaînement inconnu des diverses circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés.
Dans les chapitres suivants, on examine si les faits se rapportent aux principes.
- Chapitre XXVII. Du rapport des faits avec les principes ci-dessus établis. Le premier objet de ce chapitre est de montrer que les nombreuses circonstances, dont le concours est absolument nécessaire pour former des hommes illustres, se trouvent si rarement réunies, qu’en supposant, dans tous les hommes, d’égales dispositions à l’esprit, les génies du premier ordre seraient encore aussi rares qu’ils le sont. On prouve de plus dans ce même chapitre, que c’est uniquement dans le moral qu’on doit chercher la véritable cause de
l’inégalité des, esprits ; qu’en vain on voudrait l’attribuer à la différente température des climats ; & qu’en vain l’on essaierait d’expliquer par le physique une infinité de phénomènes politiques qui s’expliquent très naturellement par les causes morales. Telles sont les conquêtes des peuples du nord, l’esclavage des orientaux, le génie allégorique de ces mêmes peuples ; & enfin la supériorité de certaines nations dans certains genres de sciences et d’arts.
Chapitre XXVIII. Des conquêtes des peuples du nord. Il s’agit, dans ce chapitre, de faire voir que c’est uniquement aux causes morales qu’on doit attribuer les conquêtes des septentrionaux. Chapitre XXIX. De l’esclavage, & du génie allégorique des orientaux. - Chapitre XXX. De la supériorité que certains peuples ont eue dans les divers genres de sciences ou d’arts. Les peuples qui se font le plus illustrés par les arts & les sciences, sont les peuples chez lesquels ces mêmes arts & ces mêmes sciences ont été le plus honorés : ce n’est donc point dans la différente température des climats, mais dans les causes morales, qu’on doit chercher la cause l’inégalité des esprits.
La conclusion générale de ce discours, c’est que tous les hommes, communément bien organisés, ont en eux la puissance physique de s’élever aux plus hautes idées ; & que la différence d’esprit qu’on remarque entre eux dépend des diverses circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés, & de l’éducation différente qu’ils reçoivent. Cette conclusion fait sentir toute l’importance de l’éducation.
"IV. Chapitre III. De l’esprit.
L’esprit n’est autre chose qu’un assemblage d’idées et de combinaisons nouvelles. Si l’on avait fait, en un genre, toutes les combinaisons possibles, l’on n’y pourrait plus porter ni invention ni esprit ; l’on pourrait être savant en ce genre, mais non pas spirituel. Il est donc évident que, s’il ne restait plus de découvertes à faire en aucun genre, alors tout serait science, et l’esprit serait impossible : on aurait remonté jusqu’aux premiers principes des choses. Une fois parvenus à des principes généraux et simples, la science des faits qui nous y auraient élevés ne serait plus qu’une science futile, et toutes les bibliothèques où ces faits sont renfermés deviendraient inutiles. Alors, de tous les matériaux de la politique et de la législation, c’est-à-dire de toutes les histoires, on aurait extrait, par exemple, le petit nombre de principes qui, propres à maintenir entre les hommes le plus d’égalité possible, donneraient un jour naissance à la meilleure forme de gouvernement. Il en serait de même de la physique et généralement de toutes les sciences. Alors l’esprit humain, épars dans une infinité d’ouvrages divers, serait, par une main habile, concentré dans un petit volume de principes ; à peu près comme les esprits des fleurs, qui couvrent de vastes plaines, sont, par l’art du chimiste, facilement concentrés dans un vase d’essence.
L’esprit humain, à la vérité, est en tout genre fort loin du terme que je suppose. Je conviens volontiers que nous ne serons pas sitôt réduits à la triste nécessité de n’être que savants ; et qu’enfin, grâce à l’ignorance humaine, il nous sera longtemps permis d’avoir de l’esprit.
L’esprit suppose donc toujours invention. Mais quelle différence, dira-t-on, entre cette espèce d’invention et celle qui nous fait obtenir le titre de génies ? Pour la découvrir, consultons le public.
En morale et en politique, il honorera, par exemple, du titre de génies et Machiavel et l’auteur de l’Esprit des lois, et ne donnera que le titre d’hommes de beaucoup d’esprit à la Rochefoucault et à la Bruyère. L’unique différence sensible qu’on remarque entre ces deux espèces d’hommes, c’est que les premiers traitent de matières plus importantes, lient plus de vérités entre elles, et forment un plus grand ensemble que les seconds. Or l’union d’un plus grand nombre de vérités suppose une plus grande quantité de combinaisons, et par conséquent un homme plus rare. D’ailleurs, le public aime à voir, du haut d’un principe, toutes les conséquences qu’on en peut tirer : il doit donc récompenser par un titre supérieur, tel que celui de génie, quiconque lui procure cet avantage, en réunissant une infinité de vérités sous le même point de vue. Telle est, dans le genre philosophique, la différence sensible entre le génie et l’esprit.
Dans les arts, où par le mot talent, on exprime ce que, dans les sciences, on désigne par le mot d’esprit, il semble que la différence soit à peu près la même. Quiconque ou se modèle sur les grands hommes qui l’ont déjà précédé dans la même carrière, ou ne les surpasse pas, ou n’a point fait un certain nombre de bons ouvrages, n’a pas assez combiné, n’a pas fait d’assez grands efforts d’esprit, ni donné assez de preuves d’invention pour mériter le titre de génie. En conséquence, on place dans la liste des hommes de talent les Regnard, les Vergier, les Campistron et les Fléchier ; lorsqu’on cite comme génies les Molière, les la Fontaine, les Corneille et les Bossuet. J’ajouterai même, à ce sujet, qu’on refuse quelquefois à l’auteur le titre qu’on accorde à l’ouvrage.
Un conte, une tragédie ont un grand succès : on peut dire, de ces ouvrages, qu’ils sont pleins de génie, sans oser quelquefois en accorder le titre à l’auteur. Pour l’obtenir, il faut ou, comme la Fontaine, avoir, si je l’ose dire, dans une infinité de petites pièces la monnaie d’un grand ouvrage ; ou, comme Corneille et Racine, avoir composé un certain nombre d’excellentes tragédies. Le poème épique est, dans la poésie, le seul ouvrage dont l’étendue
suppose une mesure d’attention et d’invention suffisante pour décorer un homme du titre de génie.
Il me reste, en finissant ce chapitre, deux observations à faire. La première, c’est qu’on ne désigne dans les arts par le nom d’esprit, que ceux qui, sans génie ni talent pour un genre, y transportent les beautés d’un autre genre : telles sont, par exemple, les comédies de M. de Fontenelle, qui, dénuées du génie et du talent comique, étincellent de quelques beautés philosophiques. La seconde, c’est que l’invention appartient tellement à l’esprit, qu’on n’a jusqu’à présent, par aucune des épithètes applicables au grand esprit, désigné ceux qui remplissent des emplois utiles, mais dont l’exercice n’exige point d’invention. Le même usage qui donne l’épithète de bon au juge, au financier, à l’arithméticien habile, nous permet d’appliquer l’épithète de sublime au poète, au législateur, au géomètre, à l’orateur. L’esprit suppose donc toujours invention. Cette invention, plus élevée dans le génie, embrasse d’ailleurs plus d’étendue de vue ; elle suppose par conséquent et plus de cette opiniâtreté qui triomphe de toutes les difficultés, et plus de cette hardiesse de caractère qui se fraye des routes nouvelles. Telle est la différence entre le génie et l’esprit, et l’idée générale qu’on doit attacher à ce mot esprit.
Cette différence établie, je dois observer que nous sommes forcés, par la disette de la langue, à prendre cette expression dans mille acceptions différentes, qu’on ne distingue entre elles que par les épithètes qu’on unit au mot esprit. Ces épithètes, toujours données par le lecteur ou le spectateur, sont toujours relatives à l’impression que fait sur lui certain genre d’idées.
Si l’on a tant de fois, et peut être sans succès, traité ce même sujet, c’est qu’on n’a point considéré l’esprit sous ce même point de vue ; c’est qu’on a pris pour des qualités réelles et distinctes les épithètes de fin, de fort, de lumineux, etc. qu’on joint au mot esprit ; c’est qu’enfin l’on n’a point regardé ces épithètes comme l’expression des effets différents que font sur nous, et les diverses espèces d’idées et les différentes manières de les rendre. C’est pour dissiper l’obscurité répandue sur ce sujet, que je vais, dans les chapitres suivants, tâcher de déterminer nettement les idées différentes qu’on doit attacher aux épithètes souvent unies au mot esprit...."
Discours IV. - Des différents noms donnés à l’esprit.
Pour donner une connaissance exacte de l’esprit & de sa nature on se propose, dans ce discours, d’attacher des idées nettes aux divers noms donnés à l’esprit. - Chapitre premier. Du génie. - Chapitre II. De l’imagination & du sentiment. - Chapitre III. De l’esprit. - Chapitre IV. De l’esprit fin, & de l’esprit fort. - Chapitre V. De l’esprit de lumière, de l’esprit étendu, de l’esprit pénétrant, & du goût. - Chapitre VI. Du bel esprit. - Chapitre VII. De l’esprit du siècle.
- Chapitre VIII. De l’esprit juste. - On prouve, dans ce chapitre, que, dans les questions compliquées, il ne suffit pas, pour bien voir, d’avoir l’esprit juste ; qu’il faudrait encore l’avoir étendu : qu’en général les hommes sont sujets à s’enorgueillir de la justesse de leur esprit, à donner à cette justesse la préférence sur le génie : qu’en conséquence, ils se disent supérieurs aux gens à talents ; croient, dans cet aveu, simplement se rendre justice ; & ne s’aperçoivent point qu’ils sont entraînés à cette erreur par une méprise de sentiment commune presque tous les hommes : méprise dont il est sans doute utile de faire apercevoir les causes.
Chapitre IX. Méprise de sentiment. - Ce chapitre n’est proprement que l’exposition des deux chapitres suivants. On y montre seulement combien il est difficile de se connaître soi-même. Chapitre X. Combien l’on est sujet à se méprendre sur les motifs qui nous déterminent. - Chapitre XI. Des conseils. Il s’agit d’examiner, dans ce chapitre, pourquoi l’on est si prodigue de conseils, si aveugle sur les motifs qui nous déterminent à les donner ; & dans quelles erreurs enfin l’ignorance où nous sommes de nous-mêmes à cet égard peut quelquefois précipiter les autres. On indique, à la fin de ce chapitre, quelques-uns des moyens propres à nous faciliter la connaissance de nous-mêmes. - Chapitre XII. Du bon sens. - Chapitre XIII. Esprit de conduite.
- Chapitre XIV. Des qualités exclusives de l’esprit & de l’âme. Après avoir essayé, dans les chapitres précédents, d’attacher des idées nettes à la plupart des noms donnés à l’esprit ; il est utile de connaître quels sont & les talents de l’esprit qui, de leur nature, doivent réciproquement s’exclure, & les talents que des habitudes contraires rendent pour ainsi dire inalliables. C’est l’objet qu’on se propose d’examiner dans ce chapitre & dans le chapitre suivant où l’on s’applique plus particulièrement à faire sentir toute l’injustice dont le public use, à cet égard, envers les hommes de génie. - Chapitre XV. De l’injustice du public à cet égard. On ne s’arrête, dans ce chapitre, à considérer les qualités qui doivent s’exclure réciproquement, que pour éclairer les hommes sur les moyens de tirer le meilleur parti possible de leur esprit.
Chapitre XVI. Méthode pour découvrir le genre d’étude auquel l’on est le plus propre. Cette méthode indiquée, il semble que le plan d’une excellente éducation devrait être la conclusion nécessaire de cet ouvrage : mais ce plan d’éducation, peut-être facile à tracer, serait, comme on le verra dans le chapitre suivant, d’une exécution très difficile. - Chapitre XVII. De l’éducation. On prouve, dans ce chapitre, qu’il serait sans doute très utile de perfectionner l’éducation publique ; mais qu’il n’est rien de plus difficile ; que nos mœurs actuelles s’opposent, en ce genre, à toute espèce de réforme ; que, dans les empires vastes & puissants, on n’a pas toujours un besoin urgent de grands hommes ; qu’en conséquence, le gouvernement ne peut arrêter longtemps ses regards fur cette partie de l’administration. On observe cependant, à cet égard, que dans les états monarchiques, tels que le nôtre, il ne serait pas impossible de donner le plan d’une excellente éducation ; mais que cette entreprise ferait absolument vaine dans des empires fournis au despotisme, tels que ceux de l’orient.
On ne peut aller plus loin qu’Helvétius dans la dépréciation des qualités internes et foncières de l’esprit. Le génie lui-même n’est tel que grâce à la valeur qu’il a pour la société ; ce sont les circonstances qui font la réputation des hommes d’État ; quant aux dons d’invention des savants ou des philosophes, il faut remarquer qu’il n’en est point sans précurseurs : ils ne sont que des continuateurs. C’est juste l’opposé des thèses de Vauvenargues.
L’esprit est à ce point tout dehors, tout dépendant des conditions extérieures, que l’éducation ne trouve devant elle aucune résistance et peut former des esprits à sa guise ; le traité De l’Homme (1772) est tout entier écrit (en partie contre l’Émile de Rousseau) pour montrer la puissance de l’instruction : il ne doute pas un moment que les passions de l’homme (et par conséquent l’esprit tout entier) ne dépendent en aucune façon de la nature et de l’organisation physiologique, mais sont dues aux circonstances de son éducation, c’est‑à‑dire, au fond, au système de sanctions qu’on lui a appliquées. On ne peut pousser plus loin l’idolâtrie de l’éducation, de la fabrication artificielle des esprits, et d’Holbach lui-même critique Helvétius pour n’avoir pas vu qu’il y a des « naturels rebelles, volatiles ou engourdis» que rien ne peut améliorer.
Ces livres suscitèrent une ardente polémique, dont les incidents n’intéressent pas l’histoire des doctrines ; au reste ils tombèrent vite dans l’oubli, et ils semblèrent surtout secs et ennuyeux...
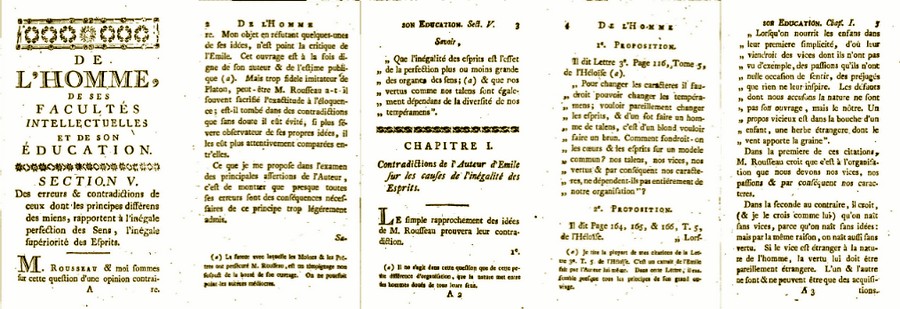

"De l’Homme" (1772), "de ses facultés intellectuelles et de son éducation"
Oeuvre posthume du philosophe Claude Helvétius, publiée en 1772 et dédiée à Catherine II de Russie. Elle comprend dix sections, chaque section étant subdivisée en un nombre variable de chapitres. Le but que se propose l`auteur est le même que celui qu'il a poursuivi dans son œuvre précédente "De l'esprit" : établir, par l`étude scientifique des faits individuels et sociaux, les lois nécessaires au bonheur des peuples.
L'idée de bonheur est essentielle dans le système général de notre auteur; c'est autour d`elle et par rapport à elle que s'organisent toute la pensée et les recherches du philosophe. Reprenant donc les idées précédemment exposées, pour les approfondir et parfois pour les corriger, Helvétius est amené à donner, ici, une importance particulière au problème religieux dans les rapports sociaux.
Les obstacles à une bonne éducation de l`homme sont à ses yeux : le gouvernement arbitraire, l`intérêt personnel des pouvoirs publics, et l'ignorance. En prévoyant la transformation de la France en une République fédérale, avec pleine liberté d'esprit et d'activité, l'auteur ébauche en quelque sorte un catéchisme du citoyen. dans lequel le bien public fait figure de loi suprême ; tout un système bien ordonné de récompenses et de punitions l'accompagne.
Le premier et le plus grand de tous les obstacles que dénonce Helvétius tient dans le fait que les intérêts du clergé se sont alliés à ceux de l`Etat, en vue de se maintenir au pouvoir, grâce à la "stupide crédulité des peuples". D'ailleurs, toutes les religions existantes sont condamnables : elles mettent un frein à l`usage de la raison et favorisent l'asservissement des hommes. Le paganisme, lui, était moins néfaste : étant sans dogme, il était tolérant, tant il est vrai que "tout dogme est un germe de discorde et de crime jeté contre les hommes". Quant au catholicisme, au "papisme" (pour employer l'expression de l`auteur), il est une forme inférieure et déchue des religions chrétiennes ; il n'a plus rien du christianisme de Jésus, et son ascétisme déforme la vie : en condamnant les passions, le catholicisme condamne à l`inaction. "Convaincus de l'utilité des passions, les anciens législateurs ne se proposaient point de les étouffer. Que trouver chez un peuple sans désir ? Sont-ce des commerçants -interroge Helvétius -, des capitaines, des soldats, des hommes de lettres, des ministres habiles? Non, mais des moines", répond-il avec quelque mépris.
Cependant, l'attaque dirigée contre le catholicisme l`est surtout contre sa morale, dans la mesure où elle est en constante et flagrante opposition avec le comportement réel et pratique de ses adeptes, à commencer par le plus grand d'entre eux. Partout, ce n`est qu`amour des richesses, fausseté et hypocrisie. Parlant des índulgences distribuées par la Curie romaine, et reprenant certains arguments qu'avaient fait valoir les partisans de la Réforme, Helvétius écrit, non sans indignation : "L`Eglise romaine ouvrit une banque entre le ciel et la terre, et fit, sous le nom d`indulgences, payer, argent comptant dans ce monde, des billets à ordre directement tirés sur le paradis".
Pour empêcher le catholicisme ou toute autre religion de nuire, Helvétius propose les mesures suivantes : séparer l'Eglise de I`Etat, à l`exemple de la Pennsylvanie ; favoriser la liberté des cultes (ou "diviser pour régner"); ou encore, solution plus radicale, réunir dans la même main le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, en faisant des prêtres de simples fonctionnaires d'Etat. Il rêve, en revanche, d'une religion universelle, fondée sur la véritable nature de l'homme et créée par le pouvoir législatif, et dont le seul dogme serait : « La volonté d'un Dieu juste et bon, c'est que les fils de la terre soient heureux et qu`ils jouissent de tous les plaisirs compatibles avec le bien public"; et l'unique précepte : Que les citoyens, "en cultivant leur raison", parviennent à la connaissance de "leurs devoirs envers la société [...] et de la meilleure législation possible".
Prolongement et développement de son traité sur "l`Esprit", "De l'homme" et de ses facultés intellectuelles se distingue de cet autre ouvrage par l'abondance de ses vues de détail, infiniment plus efficaces et opportunes. L'un et l'autre, cependant, renferment les mêmes paradoxes, témoignent de la même érudition, présupposent la même foi en l'homme et en ses capacités. Pour circonstanciées et importantes qu`elles soient, on ne pourrait réduire ce traité aux seules attaques contre l'Eglise et la religion qu'il contient : certes, la part critique et destructrice de ce livre, paru à une époque où rien n`était plus urgent que de tout remettre en question, ne saurait être minimisée : l'ouvrage d`Helvétius fut mis à l'Index dès 1774, et poursuivi des foudres de toute la réaction rassemblée.
Mais Helvétius ne se propose pas seulement de démolir, il entend aussi construire....
Partant d`une analyse concrète de la situation de l'être humain, dans la nature ainsi que dans la société, il tire une toute première conclusion que voici : « L'homme est disciple de tous les objets qui l'environnent, de toutes les positions où le hasard le place, enfin de tous les accidents qui lui arrivent".
Systématique dans ses postulats, Helvétius prend bien garde de ne jamais perdre le contact avec le réel. Analyste perspicace, il se préoccupe de perfectionner cette "science de l'éducation", qui doit mettre tout être humain sur le chemin du bonheur ; mais, dans le même temps, il a souci "de ne point resserrer les bornes de l'empire du hasard", autrement dit de la vie. Doué d'un sens aigu de la dialectique, il démontre que, "si l`homme naît sans autres besoins que ceux de la faim et de la soif", il change souvent, au cours de sa vie, "d`idées ou de passions", "sans changer pour autant d`organisation"; et, s'appuyant sur ces vérités premières, il entreprend, à partir de la IXe section de son œuvre, de décrire l'homme plus particulièrement dans la société : l`humanité étant toujours - l'expérience le prouve - le "produit ou de la crainte ou de l'éducation".
Helvétius, en partisan des "lumières", choisit délibérément et sans retour cette "éducation qui peut tout", selon la célèbre formule ouvrant le chapitre I de la Xe section. Les mesures prises par la Révolution française envers l'Eglise, ainsi que l'idée d'une religion laïque qui pourrait devenir en quelque sorte une religion d'Etat trouvent sans doute leur origine et leur première expression dans cette œuvre. Sur le plan proprement philosophique. on trouvera dans "De I'Homme et de ses facultés intellectuelles" les germes de cette morale utilitaire dont Bentham sera le théoricien, un Bentham qui devait écrire : "Ce que Bacon fit pour le monde physique; Helvétius le fit pour le monde moral...."

"LE VRAI SENS DU SYSTÈME DE LA NATURE", ouvrage posthume du philosophe Claude Helvétius, fut publié à Londres en 1774 ; l'auteur y traite en courts chapitres des thèmes majeurs de la philosophie du XVIIIe siècle. L'élégance de l'exposition, la succession des maximes les plus heureuses en font un TRAITE DE L'ATHEISME du meilleur ton. Pour être athée absolument, puisque tel est le vrai sens du système de la nature, on n`en sera pas moins moral, bien au contraire. L'homme néglige l`expérience pour se repaître de conjonctures; il faut donc ramener l'homme à la nature, lui rendre la raison chère.
L`homme est dans la nature - purement physique; il doit recourir à la physique dans toutes ses recherches. L`essence de la nature est d`agir ; il est vain de chercher l`origine de la nature et du mouvement : ils sont de toute éternité car, des qu'un corps a une certaine pesanteur, il doit tomber. C`est par le mouvement que tout ce qui existe se produit, s`étend, s`accroît et se détruit. La nature par ses combinaisons enfante des soleils. Toute cause produit un effet et il ne peut y avoir d`effet sans cause; la nécessité est la liaison infaillible et constante des causes avec leurs effets. L`homme est à chaque instant soumis à la nécessité. Toutes les facultés intellectuelles, qu`on attribue à l'âme, sont des modifications dues aux objets qui frappent les sens. La raison est la nature modifiée par l'expérience.
L`expérience nous apprend que les croyances religieuses furent la source véritable des maux du genre humain, l`homme ne songea point à rompre les lois qui en résultaient parce qu`on lui fit entendre que la stupidité, le renoncement à la raison, l`engourdissement de l'esprit, l`abjection de son âme étaient les moyens d'obtenir l'éternelle félicité. Et Helvétius fait apparaître les contradictions absurdes de la théologie. La preuve que l`idée de Dieu est une notion acquise, c`est qu`elle varie d'un siècle à l`autre, d'une contrée à l'autre, d'un homme à un autre. Tout est effet des combinaisons de la nature.
On est forcé d'imaginer une nouvelle vie, pour disculper la divinité des maux qu'elle nous fait éprouver dans celle-ci. Les idées de la divinité sont donc aussi inutiles que contraires à la saine morale.
La morale doit avoir pour base la nécessité des choses. Le raisonnement progresse logiquement, désinvolte et assuré; Helvétius note pourtant que souvent, en dépit de tous les raisonnements, des dispositions momentanées ramènent l`homme aux préjugés de l`enfance.
C'est surtout dans les maladies. aux approches de la mort. On tremble parce que la machine est affaiblie. Le cerveau est incapable d`accomplir ses fonctions; on déraisonne. Nos systèmes éprouvent les variations de notre corps. Et l'œuvre s'achève sur un abrégé du "Code de la Nature", catéchisme naturel qui recommande d'être heureux sans que nos plaisirs soient funestes à nos frères et, curieusement proche par là des prières enfantines, d'être juste, bon, indulgent, doux, reconnaissant, modeste, miséricordieux, retenu, tempéré, chaste, enfin d'être citoyen...

MADAME HELVÉTIUS (1720-1800)
Anne-Catherine de Ligneville Helvétius dite «Minette» appartenait à une famille noble apparentée à celle de la reine Marie-Antoinette. Elle était vive, gaie, spirituelle et d'une grande beauté. Elle épousa Claude Adrien Helvétius, fermier général, philosophe, philanthrope, poète à ses heures et par surcroit, fort bel homme. Le couple forma le ménage le plus uni de son siècle.
Rue Sainte-Anne, chapelle parisienne de l'Encyclopédie, les Helvétius recevaient Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, l'abbé Lefebvre de Laroche, Madame Necker, Julie de Lespinasse, Paul Henri Dietrich, baron d'Holbach; Bernard-Joseph Saurin, Jean-Antoine Caritat, marquis de Condorcet; Nicolas Bergasse, Anne Turgot, Emmanuel-Joseph Siéyès, Sébastien-Roch-Nicolas, dit Chamfort; Jacques-Antoine Manuel, l'abbé Ferdinand Galiani, Constantin-François Chasseboeuf, comte de Volney; Cesare Bonesana, marquis de Beccaria, Marmontel, André Morellet, Charles Pinot Duclos, Jean François de Saint-Lambert, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon et Fontenelle. Inspiré et stimulé par le contact de tous ces brillants libre-penseurs, Helvétius écrivit un ouvrage intitulé «De l'Esprit» qui fit scandale au point d'être officiellement brûlé sur le grand escalier du Parlement. «L'orage passe, les écrits restent» conclura Voltaire ...
Après la mort d'Helvétius (1771), l'on retrouvera «Minette» au 59, rue d'Auteuil, à Paris (Auteuil) où elle continuera à recevoir, entourée d'une vingtaine de superbes chats angoras, outre les précédents, les esprits forts du temps soit l'abbé Étienne Bonnot de Condillac, Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbe, Guillaume-François Thomas, abbé Raynal; Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Pierre Claude François Daunou, André Chénier, le poète Jean Antoine Roucher, Madame Roland et son mari Roland de la Platière, Thomas Jefferson, Napoléon Bonaparte, futur empereur; Dominique-Joseph Garat, le sculpteur Jean-Antoine Houdon, Georges, baron Cuvier; Alexandre Von Humboldt, Henri Beyle, dit Stendhal; Alfred de Vigny, le peintre François, baron Gérard; Prosper Mérimée, un soupirant, Anne Turgot; le compositeur Gioacchino Rossini, Charles-Joseph Panckouke, l'éditeur du «Mercure de France» et de l'Encyclopédie; l'imprimeur et libraire François-Ambroise Didot (le point typographique a pris son nom); l'inimitable bonhomme Franklin qui baptisera sa belle hôtesse du sobriquet de «Notre-Dame d'Auteuil» et Pierre Jean Georges Cabanis qui deviendra son protégé....
