- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

La Révolution française - De la monarchie constitutionnelle de 1791 à la réaction Thermidorienne et 1794 - Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794) - Georges Jacques Danton (1759-1794) - Camille Desmoulins (1760-1794) - Maximilien de Robespierre (1758-1794) - Jean-Paul Marat (1743-1793) - André Chénier (1762-1794) - ...
Last update 10/10/2021


LA CONSTITUANTE DE 1791..
D'octobre 1789 à septembre 1791, la Constituante va s'efforcer de résoudre la crise financière en confisquant les biens du clergé pris comme garantie des assignats, papier-monnaie qui doit permettre d'amortir la dette publique. Mais l'excessive quantité d'assignats mis en circulation provoqua très tôt leur dépréciation.
- Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale abolit les privilèges féodaux.
- Du 20 au 24 août 1789, l'Assemblée décrète la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Les 5 et 6 octobre 1789, le peuple de Paris marche sur Versailles et ramène la famille royale à Paris.
- le 14 juillet 1790 a lieu la fête de la Fédération.
- Le 20 juin 1791, le roi Louis XVI tente de s'enfuir mais est arrêté à la frontière...



Juin 1791 - La Fuite du roi à Varennes...
Effrayé par la mort de Mirabeau (avril 1791), son seul défenseur, Louis XVI quitta les Tuileries, le 20 juin 1791, par une nuit obscure et entend s'appuyer sur les souverains et les troupes étrangères pour reprendre son pouvoir. Mais il est arrêté a Varennes par le fils du maître de poste Drouet, reconduit à Paris et suspendu de ses fonctions royales. Une émotion immense s'empara de Paris, quand la nouvelle fut connue. Durant toute la journée du 21, l'Assemblée constituante prit une série de mesures destinées à ramener le calme et à assurer le fonctionnement régulier du pouvoir exécutif. Le soir du même jour, il y eut aux Jacobins une séance passionnée. Robespierre prit la parole.
Le discours qu'il improvisa ne nous est connu que par l'analyse qu'en publièrent les journaux. Voici comment Camille Desmoulins, dans le numéro 32 des Révolutions de France et de Brabant, rend compte de cette allocution brûlante et de l'enthousiasme qu'elle souleva :
"Ce n'est pas à moi que la fuite du premier fonctionnaire public devait paraître un événement désastreux. Ce jour pouvait être le plus beau de la révolution; il peut le devenir encore, et le gain de quarante millions d'entretien que coûtait l'individu royal serait le moindre des bienfaits de cette journée. Mais, pour cela, il faudrait prendre d'autres mesures que celles qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale, et je saisis un moment où la séance est levée pour vous parler de ces mesures qu'il me semble qu'il eût fallu prendre, et qu'il ne m'a pas été permis de proposer.
Le roi a saisi, pour déserter son poste, le moment où l'ouverture des assemblées primaires allait réveiller toutes les ambitions, toutes les espérances, tous les partis, et armer une moitié de la nation contre l'autre, par l'application du décret du marc d'argent, et par les distinctions ridicules établies entre les citoyens entiers, les demi-citoyens et les quarterons.
Il a choisi le moment où la première législature, à la fin de ses travaux, dont une partie est improuvée par l'opinion, voit, de cet œil dont on regarde un héritier, s'approcher la législature qui va la chasser et exercer le veto national en cassant une partie de ses actes.
Il a choisi le moment où des prêtres traîtres ont, par des mandements et des bulles, mûri le fanatisme et soulevé contre la Constitution tout ce que la philosophie a laissé d'idiots dans les quatre-vingt-trois départements.
Il a attendu le moment où l'empereur et le roi de Suède seraient arrivés à Bruxelles pour le recevoir, et où la France serait couverte de moissons; de sorte qu'avec une bande très peu considérable de brigands on put, la torche à la main, affamer la nation.
Mais ce ne sont point ces circonstances qui m'effraient. Que toute l'Europe se ligue contre nous, et l'Europe sera vaincue. Ce qui m'épouvante, moi, Messieurs, c'est cela même qui me parait rassurer tout le monde. Ici j'ai besoin qu'on m'entende jusqu'au bout. Ce qui m'épouvante, encore une fois, c'est précisément cela même qui parait rassurer tous les autres : c'est que, depuis ce matin, tous nos ennemis parlent le même langage que nous. Tout le monde est réuni; tous ont le même visage, et pourtant il est clair qu'un roi qui avait quarante millions de rente, qui disposait encore de toutes les places, qui avait encore la plus belle couronne de l'univers et la mieux affermie sur sa tète, n'a pu renoncer à tant d'avantages sans être sûr de les recouvrer. Or, ce ne peut pas être sur l'appui de Léopold et du roi de Suède, et sur l'armée d'outre-Rhin, qu'il fonde ses espérances : que tous les brigands d'Europe se liguent, et encore une fois ils seront vaincus. C'est donc au milieu de nous, c'est dans cette capitale que le roi fugitif a laissé les appuis sur lesquels il compte pour sa rentrée triomphante; autrement sa fuite serait trop insensée. Vous savez que trois millions d'hommes armés pour la liberté seraient invincibles : il a donc un parti puissant et de grandes intelligences au milieu de nous, et cependant regardez autour de vous, et partagez mon effroi en considérant que tous ont le même masque de patriotisme. Ce ne sont point des conjectures que je hasarde, ce sont des faits dont je suis certain : je vais tout vous révéler, et je défie ceux qui parleront après moi de me répondre.
« Vous connaissez le mémoire que Louis XVI a laissé en partant; vous avez pris garde comment il marque dans la Constitution les choses qui le blessent, et celles qui ont le bonheur de lui plaire. Lisez cette protestation du roi, et vous y saisirez tout le complot. Le roi va reparaître sur les frontières, aidé de Léopold, du roi de Suède, de d'Artois, de Condé, de tous les fugitifs et de tous les brigands dont la cause commune des rois aura grossi son armée : on grossira encore à ses yeux les forces de cette armée. Il paraîtra un manifeste paternel, tel que celui de l'empereur quand il a reconquis le Brabant. Le roi y dira encore, comme il a dit cent fois : Mon peuple peut toujours compter sur mon amour. Non seulement on y vantera les douceurs de la paix, mais celles même de la liberté. On proposera une transaction avec les émigrants, paix éternelle, amnistie, fraternité.
En même temps les chefs, et dans la capitale, et dans les départements, avec lesquels ce projet est concerté, peindront de leur côté les horreurs de la guerre civile. Pourquoi s'entr'égorger entre frères qui veulent être tous libres? Car Bender et Condé se diront plus patriotes que nous. Si, lorsque vous n'aviez point de moissons à préserver de l'incendie, ni d'armée ennemie sur vos frontières, le Comité de constitution vous a fait tolérer tant de décrets nationicides, balancerez-vous à céder aux insinuations de vos chefs, lorsqu'on ne vous demandera que des sacrifices d'abord très légers, pour amener une réconciliation générale ?
Je connais bien le caractère de la nation : des chefs qui ont pu vous faire voter des remerciements à Bouille pour la Saint-Barthélémy des patriotes de Nancy auront-ils de la peine à amener à une transaction, à un moyen terme, un peuple lassé, et qu'on a pris grand soin jusqu'ici de sevrer des douceurs de la liberté, pendant qu'on affectait d'en appesantir sur lui toutes les charges, et de lui faire sentir toutes les privations qu'impose le soin de la conserver? Et voyez comme tout se combine pour exécuter ce plan, et comme l'Assemblée nationale elle-même marche vers ce but avec un concert merveilleux.
« Louis XVI écrit à l'Assemblée nationale de sa main; il signe qu'il prend la fuite, et l'Assemblée, par un mensonge, bien lâche, puisqu'elle pouvait appeler les choses par leur nom au milieu de trois millions de baïonnettes; bien grossier, puisque le roi avait l'impudence d'écrire lui-même : "on ne m'enlève pas", je pars pour revenir vous subjuguer; bien perfide, puisque ce mensonge tendait à conserver au ci-devant roi sa qualité et le droit de venir nous dicter, les armes à la main, les décrets qui lui plairont : l'Assemblée nationale, dis-je, aujourd'hui dans vingt décrets, a affecté d'appeler la fuite du roi un enlèvement. On devine dans quelle vue.
« Voulez-vous d'autres preuves que l'Assemblée nationale trahit les intérêts de la nation? Quelles mesures a-t-elle prises ce matin ? Voici les principales..."



Dans les jours qui suivirent le retour de Varennes, l'Assemblée constituante examina la nouvelle situation créée par la fuite du roi. Après une longue enquête sur les circonstances mêmes de la fuite, les Comités conclurent en faisant retomber sur l'entourage du roi la responsabilité de l'événement, et mirent Louis XVI hors de cause.
C'était, en réalité, la question même de l'inviolabilité royale qui se trouvait posée. Le débat s'engagea, le 13 juillet, sur le rapport de Muguet de Nanthou. Petion en combattit les conclusions. La Rochefoucauld-Liancourt et Prugnon parlèrent, au contraire, en faveur de l'inviolabilité royale. Robespierre leur succéda. Ce fut dans la séance du 14 juillet qu'il prononça, sur cette question, le discours suivant: "... Le roi est inviolable ! Mais vous l'êtes aussi, vous ! Mais avez-vous étendu cette inviolabilité jusqu'à la faculté de commettre le crime? Et oserez-vous dire que les représentants du souverain ont des droits moins étendus pour leur sûreté individuelle que celui dont ils sont venus restreindre le pouvoir, celui à qui ils ont délégué, au nom de la nation, le pouvoir dont il est revêtu ? Le roi est inviolable ! Mais les peuples ne le sont-ils pas aussi? Le roi est inviolable par une fiction ; les peuples le sont par le droit sacré de la nature; et que faites-vous en couvrant le roi de l'égide de l'inviolabilité, si vous n'immolez l'inviolabilité des peuples à celle des rois? Il faut en convenir, on ne raisonne de cette manière que dans la cause des rois... "
Estampe de Carl de Vinck - "Arrestation du roi à Varennes le 22 juin 1791 : Paul le Blanc et Joseph Pontant avertis par le maitre de poste de Sainte Menehould, d'arrêter une voiture s'opposent à son passage et menacent de tirer si l'on veut resister.." - Estampe de Michel Hennin - "L' Egout royal (1791) - Fuite du Roi : Louis XVI déguisé en cuisinier, s'avance precede de la Reine, qui elle meme s'appuye sur le comte Fersen" - Estampe de Carl de Vinck - "Retour de la famille royale à Paris, le 25 juin 1791 : comme on craignoit que dans cette affluence, il n'arriva quelques malheurs on'avoit défendu la circulation des voitures, le roi et la famille royale, sont rentrés dans la capitale par les nouveaux boulvards extérieurs les Champs Elisées et les Thuileries, le peuple gardoit un profond silence, mais chaque citoyen abjurait pour jamais la servitude, aucun citoyen n'a cru devoir ôter son chapeau..."

La Fuite de Varennes, les cafés se font club ..
"La fuite à Varennes fit plus encore motionner et se déchaîner les cafés que le veto ne les avait fait discuter et argumenter ; et prévenant les temps futurs, le jugement du Roi commence déjà à s'instruire en ces milliers de cafés.
A peine née, la Révolution pousse les hommes les uns vers les autres, les assemble, frotte les idées contre les idées, les paroles contre les paroles, pour, de ces associations et de ces chocs, faire jaillir la flamme, l'éclair, la vérité, la justice. Un grand besoin de communications quotidiennes, une fraternité nouvelle, une pente à l'épanchement, à la manifestation, une curiosité et une impatience d'apprendre, mêlent les individus aux individus, et avec la gazette, qui devient le journal, et qui de chronique passe pouvoir, et de passe-temps le pain même de la France, les cafés grandissent et se font clubs; leurs tables sont tribunes, leurs habitués orateurs, leurs bruits motions. Puis l'été pluvieux de 1789 fait les cafés pleins.
Les cafés — qu'on disait tout à l'heure des manufactures d'esprit, tant bonnes que mauvaises — deviennent la presse parlée de la révolution. Les cafés ont un drapeau; et l'on juge de l'opinion d'un homme à Paris, dit Mlle Boudon, par le café dont il est l'habitué, « comme vous savez que l'on jugeait à Athènes qu'un citoyen professait les sentiments d'Aristote ou de Zenon, suivant qu'il fréquentait le Lycée ou le Portique - . » La milice nationale, dans tout l'attrait de sa nouveauté, tenant le Parisien hors de chez lui, et le faisant son maître pendant de grands jours, contribue encore à cette vogue et à cette fortune des cafés. Avec l'habit bleu, l'habitude du moka et du petit verre est prise; et les cafés, dont l'intérieur avait jusqu'alors été interdit aux femmes par l'usage, si bien que c'était un événement rare de voir une provinciale ou une étrangère prendre une bavaroise au dedans du café Foi, et non sous la lanterne , — les cafés s'ouvrent, avec la Révolution, aux femmes des miliciens qui ne veulent pas quitter leurs maris, ou que leurs maris ne veulent pas quitter, et à leur suite à toutes les autres femmes.
Écoutez toutes ces nouvelles dont les cafés retentissent bientôt, tous ces contes bleus gravement colportés. Le fameux on a le dos large et porte soupçons et billevesées : quand le Roi est à Saint-Cloud, «on creuse un canal de Saint-Cloud à la frontière, par où se sauvera la famille royale» ; quand le Roi est au Temple, «on fait fabriquer des masques ressemblant à Louis XVI et à ses conseils pour le faire évader » ; et lors de la guerre, chaque café a son stratégiste imaginatif ... Du côté de la rue des Bons-Enfants, c'est le café de Valois où se rassemblent les Feuillantins, où les fédérés font irruption et déchirent le Journal de Paris. — C'est, au coin de la rue de Montpensier, le café Mécanique, où le service se fait par les colonnes creuses des tables. Et Tanrès, le maître du café Mécanique, le successeur de Belle- ville, ne peut plus, comme en 1788, supprimer les gazettes quand ses tables sont remplies, les supprimer les dimanches pour activer la consommation, sans la laisser distraire par la lecture ; les gazettes sont plus essentielles que le moka même aux cafés de la Révolution. C'est à ce café que le propriétaire, voulant s'opposer à ce qu'on chante le Ça ira, reçoit un coup de sabre au bras, tandis que sa femme enceinte est à peu près éventrée . — Plus loin, c'est le café Corazza, où continue toutes les nuits la séance des Jacobins, entre Varlet, Destieux, Gusman, Proly, et les deux conventionnels Chabot et Collot d'Herbois, — café d'où sortiront les journées du 31 mai et du 27 juin..." (Goncourt)

"... Mais voici le pavillon du café de Foi, et, sous la galerie, le fameux café de Foi, le doyen des cafés du Palais-Royal, jadis ouvert dans la rue de Richelieu, et servant de passage pour descendre au jardin, établi au nouveau palais depuis la construction des nouveaux bâtiments. Tout à l'heure c'était le seul café qui eût le privilège d'avoir des tables et de servir dans le jardin 3 ; tout à l'heure c'était le café de bel air, le rendez-vous des vieux chevaliers de Saint-Louis, des vieux militaires, des financiers « à grosses perruques, à cannes à pomme d'or et à souliers carrés ». Dans le jardin, le café de Foi était un salon d'élégantes moquant les femmes qui passaient, et de badins chevaliers balançant le pied sur leur chaise penchée, jouant avec l'éventail de leurs belles. Au mois de juillet 1789, les sept arcades de Foi sont le portique de la Révolution. C'est monté sur une table du café de Foi, qu'un soudain orateur, un pistolet d'une main et de l'autre la nouvelle de l'exil de Necker, crie: Aux armes! C'est du café de Foi que part la bande qui va ouvrir les portes de l'Abbaye aux gardes françaises enfermés et à Richer-Sérisy détenu pour dettes. Pendant ces mois émus, le café de Foi est au Palais-Royal ce que le Palais-Royal est à Paris : une petite capitale d'agitation, dans le royaume de l'agitation; et contre ses boiseries aux précieuses sculptures se pressent tous les bouillants, les déchaînés, les impatients, les marquis de Sainte-Huruges, applaudis d'un public de rentiers, patriotes ardents depuis le décret de l'Assemblée nationale qui promet payement exact aux créanciers de l'État. C'est un comité d'éloquence publique ; là, un courrier apporte -tous les jours le bulletin des séances de l'assemblée dont on fait lecture dans les commentaires et les interruptions de chacun; là, descendent s'épurer «les superbes motions qui se rédigent au troisième étage ; là, on chasse honteusement tous les espions de l'ancienne police ; là, chaises, tables de marbre, tout est piédestal pour crier de plus haut; là, brochures, pamphlets politiques sont déclamés à haute voix; de là les ordres partent; de là les proscriptions sortent, qui jettent celui-ci au bassin, ou font bâtonner celui-là; là, le timide prend l'habitude d'un auditoire, et essaye une catilinaire.
Puis peu à peu ce café de Foi, berceau des grandes motions du Palais- Royal, devient monarchien et constitutionnel. Il a haussé le prix de ses glaces et les a mises à 20 sols, ce qui a fait d'abord un mécontentement, puis un épurement; et bientôt le royalisme l'investit, le gagne, l'emplit, et le café de Foi fait volte-face comme un tribun ; et bientôt, la voilà, cette rotonde encore retentissante des fureurs démocratiques du grand parleur Billard, de l'avocat Rosin, et du chanoine de Nantes, l'abbé de six pieds, toute peuplée de batailleurs, d'impertinents fleurdelisés sur tous les boutons, armés de gourdins, de cannes à dards, de bâtons plombés, lisant à leur tour tous les pamphlets de leur parti, et se découvrant chaque fois que le Roi est nommé.." (Goncourt)

17 juillet 1791 - Les républicains groupés dans le club des Cordeliers (fondé en 1790 par Danton, Marat et Desmoulins), beaucoup plus audacieux que les bourgeois révolutionnaires du club des Jacobins, ne parviennent pas à l'emporter face à la majorité modérée. Au lendemain de la fuite à Varennes, alors que les Jacobins et les patriotes plus modérés hésitent et se divisent, les Cordeliers lancent une pétition pour réclamer la république. Ils lancent la seconde pétition républicaine dont le dépôt sur l'autel de la patrie au Champ-de-Mars provoquera le massacre des patriotes par Bailly et La Fayette le 17 juillet 1791.

Estampe de Carl de Vinck - "Malheureuse journée du 17 juillet 1791 : des hommes, des femmes, des enfans ont été massacrés sur l'autel de la patrie au Champ de la Fédération.."

1791 - "L'Esprit de la Révolution et de la Constitution de La France"...
Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794), figure pleine de contradictions élevée au niveau du mythe en archange de la Terreur, exaltant plus encore que Robespierre la mystique de la guillotine, on a pu être fasciné par la brièveté fulgurante d'une carrière politique de deux ans qui se termine brusquement sur l'échafaud à vingt-sept ans (Portrait de Louis de Saint-Just, huile sur toile de Pierre-Paul Prud'hon, musée des beaux-arts de Lyon, 1793.
À la Convention, Saint-Just s'imposera comme l'un des principaux orateurs de la Montagne dès le procès de Louis XVI. « On ne peut point régner innocemment, affirme-t-il, le 13 novembre 1792. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » Il jouera un rôle important dans la rédaction de la Constitution de 1793 et dans la lutte qui oppose les Montagnards aux Girondins.
Son ouvrage, publié en 1791, est considéré comme le plus important des témoignages de l'esprit jacobin, de cet esprit qui anima la Révolution et cherchera, à travers la Terreur, à maintenir les principes doctrinaires des conventionnels. Comprenant que l'Europe, par la crise même de ses institutions, allait vers une révolution décisive, Saint-Just affirme que le despotisme ne peut arrêter le cours fatal de l'histoire ; les événements mêmes de la Révolution montrent qu'elle n`est pas liée à une circonstance momentanée, mais qu'elle a ses causes, son déroulement et sa fin. C'est pour cela que Saint-Just, en développant ses idées dans un traité méthodique, condamne ouvertement l'Ancien Régime, depuis les bavardages de la Cour jusqu`à l'illégalité des tribunaux. Il s`élève contre tous les abus symbolisés par l`infâme Bastille et souhaite farouchement l'établissement de la démocratie française. Au nom d`une austérité qui trouva dans la Rome républicaine le plus sublime des exemples. il entend combattre la maxime absurde de l'honneur héréditaire et encourager les jeunes gens et le peuple dans le respect et l'enthousiasme pour la communauté. Viennent ensuite des règles sur la position que doit prendre la société vis-à-vis des criminels et des peines à leur infliger. Le livre contient en outre quelques appréciations sur Desmoulins alors attaqué, sur Marat, Danton, Robespierre et Mirabeau.

Fin de l'Assemblée constituante (30 septembre 1791) & Constitution de 1791
L'Assemblée constituante se sépara le 30 septembre 1791, après avoir produits près de deux mille cinq cents décrets : avant de se séparer, elle rendit au roi les pouvoirs qu'elle lui avait enlevés trois mois auparavant et lui confia la garde de la Constitution.
La Constitution de 1791 remplaçait la monarchie absolue par une monarchie constitutionnelle. Elle proclama la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs, définit une France décentralisée, rendit les citoyens égaux devant la loi et devant l'impôt. Elle établissait une Chambre unique élue pour deux ans avec système électoral fondé sur la fortune : seuls les propriétaires, dont les biens semblent offrir une garantie d'indépendance, sont électeurs.
L'Assemblée constituante organisa la France nouvelle : elle supprima les droits féodaux et fit disparaître les dernières traces du servage. Les tailles, les dîmes, les gabelles furent abolies, les douanes intérieures supprimées. Elle supprimait les provinces et divisait la France en 83 départements. Elle réorganisa la justice et établit un tribunal criminel par département, un tribunal civil par district (arrondissement), un juge de paix dans chaque canton, un tribunal de cassation. Elle décidait quelles juges seraient élus pour dix ans par les citoyens. Elle assura la liberté de conscience et la liberté des cultes. Elle abolit le droit d'aînesse. Elle décida que les grades dans l`armée seraient attribués au mérite et non plus à la faveur et à la naissance. Elle établit le mariage civil. On a pu estimer que la Constituante alla trop loin dans ses réformes ecclésiastiques, alimentant le spectre de la guerre civile, et se trompa en décidant qu'aucun de ses membres ne ferait partie de la Législative....

Louis XVI est alors rétabli dans ses pouvoirs de roi constitutionnel et reconduit aux Tuileries; le 30 septembre 1791, l'Assemblée Constituante se sépare, "sa mission remplie et ses séances terminées"....
Le 14 septembre 1791, Louis XVI, en acceptant la Constitution du 3 septembre 1791, inaugure en France une monarchie constitutionnelle...
Parallèlement, le décret d'amnistie que La Fayette avait fait rendre par la Constituante en faveur des fugitifs eut pour résultat de provoquer la sortie en masse de tous les nobles en état de porter les armes, suivis par un certain nombre de bourgeois, l'émigration était devenue une véritable mode. Quant aux cours étrangères, elles commençait à s'inquiéter de la propagande révolutionnaire...
LA LEGISLATIVE
L'Assemblée législative ( 1er octobre 1791- 21 septembre 1792)
L'Assemblée législative se réunit le 1er octobre 1791 forte de 745 députés, mais l'Assemblée constituante ayant interdit à ses membres de faire partie de la nouvelle Assemblée, celle-ci se trouva composée, en grande majorité, de gens inconnus, sans passé politique, sans expérience des affaires, sans mandat précis de leurs électeurs. Alors que la noblesse et le clergé s'étaient désintéressés des élections, préférant intriguer contre la révolution, l'une à l'extérieur, l'autre dans les départements, contre la Révolution, les clubs, au contraire, placèrent leurs sociétaires. et tous considérant que la Révolution était loin d'être achevée. Trois partis se forment: les royalistes constitutionnels (Ramand, Bougnat, Vaublanc, Mathieu Dumas) qui s'appuyaient sur le club des Feuillants (où dominaient Barnave), les Girondins ( Brissot, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Isnard, Condorcet), la Montagne (Chabot, Bazire, Merlin de Thionville) qui s'appuie sur les Jacobins (Robespierre) et le club des Cordeliers (dirigé par Danton, Fabre d'Eglantine et Camille Desmoulins et qui professait des opinions encore plus exaltées que celles des Jacobins)....
C'est sous la Législative que les couches dites inférieures vont, grâce aux divisions des partis révolutionnaires, gagner en importance et se montrer particulièrement réceptives aux dénonciations souvent excessives de Marat...

2 et 11 janvier 1792 - Robespierre, Discours sur la guerre ..
Vers la fin de 1791, l'opinion publique et l'Assemblée législative poussaient Louis XVI à obliger divers souverains, notamment les électeurs de Mayence, de Trêves et de Cologne, à dissiper les rassemblements d'émigrés français qui s'étaient formés dans leurs États. Le 14 décembre, à la suite d'un message de l'Assemblée, le roi vint déclarer qu'il allait prendre les mesures nécessaires. Trois armées devaient être organisées, et leur commandement confié à Luckner, Rochambeau et Lafayette. Un enthousiasme général répondit à ces préparatifs de guerre. Seul, ou presque seul, Robespierre voyait avec défiance cette mobilisation militaire qui, sous prétexte de guerre étrangère, pouvait donner à la cour un formidable instrument d'oppression. Dès le 14 décembre au soir, il parlait en ce sens à la tribune des Jacobins. Le 18, il prononça, à la même tribune, au milieu d'un auditoire déjà prévenu en faveur de l'idée contraire, un discours d'une logique si forte, d'une éloquence si persuasive, que la Société des Jacobins en ordonna l'impression et l'envoi à toutes les Sociétés affiliées. "Je ne viens point, disait Robespierre, caresser l'opinion du moment ni flatter la puissance dominante; je ne viens point non plus prêcher une doctrine pusillanime, ni conseiller un lâche système de faiblesse et d'inertie; mais je viens dévoiler une trame profonde que je crois assez bien connaître. Je veux aussi la guerre, mais comme l'intérêt de la nation la veut : domptons nos ennemis intérieurs, et marchons ensuite contre nos ennemis étrangers, s'il en existe encore."
L'opinion de Robespierre ébranla les Jacobins. Quelques-uns, Danton, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, se rallièrent à sa thèse, que Brissot, au contraire, combattit avec fureur dans la séance du 30 décembre. Le 2 janvier 1792, Robespierre répliqua à Brissot dans un nouveau discours, où chaque argument de son adversaire était, pour ainsi dire, saisi mot à mot, et déchiré. La première partie de ce discours fut seule prononcée dans la séance du 2 janvier, la suite dans la séance du 11 janvier.
Désormais les Jacobins étaient conquis. L'enthousiasme des journaux fit écho à celui des Jacobins. Les Révolutions de Paris reproduisirent le texte complet des discours...
"Des deux opinions qui ont été balancées dans cette Assemblée, l'une a pour elle toutes les idées qui flattent l'imagination, toutes les espérances brillantes qui animent l'enthousiasme, et même un sentiment généreux soutien de tous les moyens que le gouvernement le plus actif et le plus puissant peut employer pour influer sur l'opinion; l'autre n'est appuyée que sur la froide raison et sur la triste vérité. Pour plaire, il faut défendre la première: pour être utile, il faut soutenir la seconde, avec la certitude de déplaire à tous ceux qui ont le pouvoir de nuire : c'est pour celle-ci que je me déclare.
Ferons-nous la guerre, ou ferons-nous la paix? Attaquerons-nous nos ennemis, ou les attendrons-nous dans nos foyers? Je crois que cet énoncé ne présente pas la question sous tous ses rapports et dans toute son étendue. Quel parti la nation et ses représentants doivent-ils prendre, dans les circonstances où nous sommes, à l'égard de nos ennemis intérieurs et extérieurs? Voilà le véritable point de vue sous lequel on doit l'envisager, si on veut l'embrasser tout entière, et la discuter avec toute l'exactitude qu'elle exige. Ce qui importe, par-dessus tout, quel que puisse être le fruit de nos efforts, c'est d'éclairer la nation sur ses véritables intérêts et sur ceux de ses ennemis; c'est de ne pas ôter à la liberté sa dernière ressource, en donnant le change à l'esprit public dans ces circonstances critiques. Je tâcherai de remplir cet objet en répondant principalement à l'opinion de M. Brissot.
Si des traits ingénieux, si la peinture brillante et prophétique des succès d'une guerre terminée par les embrassements fraternels de tous les peuples de l'Europe, sont des raisons suffisantes pour décider une question aussi sérieuse, je conviendrai que M. Brissot l'a parfaitement résolue; mais son discours m'a paru présenter un vice, qui n'est rien dans un discours académique, et qui est de quelque importance dans la plus grande de toutes les discussions politiques; c'est qu'il a sans cesse évité le point fondamental de la question, pour élever à côté tout son système sur une base absolument ruineuse.
Certes, j'aime tout autant que M. Brissot une guerre entreprise pour étendre le règne de la liberté, et je pourrais me livrer aussi au plaisir d'en raconter d'avance toutes les merveilles. Si j'étais maître des destinées de la France, si je pouvais, à mon gré, diriger ses forces et ses ressources, j'aurais envoyé, dès longtemps, une armée en Brabant, j'aurais secouru les Liégeois et brisé les fers des Bataves; ces expéditions sont fort de mon goût Je n'aurais point, il est vrai, déclaré la guerre à des sujets rebelles, je leur aurais ôté jusqu'à la volonté de se rassembler; je n'aurais pas permis à des ennemis plus formidables et plus près de nous de les protéger et de nous susciter au dedans des dangers plus sérieux.
Mais dans les circonstances où je trouve mon pays, je jette un regard inquiet autour de moi, et je me demande si la guerre que l'on fera sera celle que l'enthousiasme nous promet; je me demande qui la propose, comment, dans quelles circonstances, et pourquoi?
C'est là, c'est dans notre situation toute extraordinaire que réside toute la question. Vous en avez sans cesse détourné vos regards; mais j'ai prouvé, ce qui était clair pour tout le monde, que la proposition de la guerre actuelle était le résultat d'un projet formé dès longtemps par les ennemis intérieurs de notre liberté; je vous en ai montré le but; je vous ai indiqué les moyens d'exécution; d'autres vous ont prouvé qu'elle n'était qu'un piège visible : un orateur, membre de l'Assemblée constituante, vous a dit, à cet égard, des vérités de fait très importantes; il n'est personne qui n'ait aperçu ce piège, en songeant que c'était après avoir constamment protégé les émigrations et les émigrants rebelles, qu'on proposait de déclarer la guerre à leurs protecteurs, en même temps qu'on défendait encore les ennemis du dedans, confédérés avec eux.
Vous êtes convenu vous-même que la guerre plaisait aux émigrés, qu'elle plaisait au ministère, aux intrigants de la cour, à cette faction nombreuse, dont les chefs, trop connus, dirigent, depuis longtemps, toutes les démarches du pou- voir exécutif ; toutes les trompettes de l'aristocratie et du gouvernement en donnent à la fois le signal : enfin, quiconque pourrait croire que la conduite de la cour, depuis le commencement de cette révolution, n'a pas toujours été en opposition avec les principes de l'égalité et le respect pour les droits du peuple serait regardé comme un insensé, s'il était de bonne foi; quiconque pourrait dire que la cour propose une mesure aussi décisive que la guerre, sans la rapporter à son plan, ne donnerait pas une idée plus avantageuse de son jugement : or, pouvez-vous dire qu'il soit indifférent au bien de l'État, que l'entreprise de la guerre soit dirigée par l'amour de la liberté ou par l'esprit du despotisme, par la fidélité ou par la perfidie? Cependant qu'avez-vous répondu à tous ces faits décisifs? Qu'avez- vous dit pour dissiper tant de justes soupçons? Votre réponse à ce principe fondamental de toute cette discussion fait juger tout votre système...."
Profondément blessé d'avoir vu sa thèse sur la guerre s'écrouler aux Jacobins sous les arguments de Robespierre, Brissot prit dès lors une attitude haineuse et violente à l'égard de son contradicteur...

En avril 1792, Robespierre se décida à faire paraître un journal hebdomadaire, sous le titre "Le Défenseur de la Constitution". Les circonstances qui l'avaient amené à cette décision, son programme, son but, les idées qu'il allait défendre, il les exposa dans le Prospectus d'abord, ensuite dans le premier numéro. "..Tous les ennemis de la Constitution empruntent le nom et le langage du patriotisme pour semer l'erreur, la discorde et les faux principes; des écrivains prostituent leur plume vénale à cette odieuse entreprise. Ainsi l'opinion publique s'énerve et se désorganise; la volonté générale devient impuissante et nulle, et le patriotisme, sans système, sans concert, et sans objet déterminé, s'agite péniblement et sans fruit, ou seconde quelquefois, par une impétuosité aveugle, les funestes projets des ennemis de notre liberté.
Dans cette situation, un seul moyen nous reste de sauver la chose publique, c'est d'éclairer le zèle des bons citoyens pour le diriger vers un but commun. Les rallier tous aux principes de la Constitution et de l'intérêt général, mettre au grand jour les véritables causes de nos maux et en indiquer les remèdes, développer aux yeux de la nation les motifs, l'ensemble, les conséquences des opérations politiques qui influent sur le sort de l'État et de la liberté; analyser la conduite publique des personnages qui jouent les principaux rôles sur le théâtre de la révolution; citer au tribunal de l'opinion et de la vérité ceux qui échappent facilement au tribunal des lois et qui peuvent décider de la destinée de la France et de l'univers; voilà, sans doute, le plus grand service qu'un citoyen puisse rendre à la cause publique...."

Le 25 avril 1792, la guillotine débutait en public : un coupable de viol, nommé Pelletier, l'inaugura. Le 21 janvier 1790, l'Assemblée nationale avait décrété : Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, le criminel sera décapité. Vinrent les améliorations, la hache, d'abord façonnée en croissant, reçut une disposition oblique, et les rainures de bois où elle glissait, se renflant par le sang, furent garnies de cuivre. L'homme qui allait, cinquante, soixante fois en un jour, lâcher le bouton de la nouvelle machine, s'appelait Charles-Henri Sanson. Collenot d'Angremont inaugure, le 26 août 1792, la guillotine révolutionnaire...
Carl de Vinck: "Machine proposée à l'Assemblée nationale pour le supplice des criminels par Mr. Guillotin : Les exécutions se feront hors de la ville dans un endroit destiné a cet effet la machine sera environné de barrieres pour empecher le peuple d'approcher, l'interieur de ces barrieres sera gardé par des soldats portant les armes basses, et le signal de la mort sera donné au boureau par le confesseur dans l'instant de l'absolution... "

Le 23 septembre 1792, dernière parution de L'Ami du peuple, on y trouve plus qu'un testament de Marat, Le plan de la Révolution absolument manqué par le peuple, La dernière ressource des citoyens, L'Obstacles invincibles qui s'opposent parmi nous à rétablissement de la liberté, Les Français, de tous les peuples du monde, le moins fait pour être libre, La Révolution française toute en pantalonnades....
"Comment la liberté aurait-elle jamais pu s'établir parmi nous? à quelques scènes tragiques près, la Révolution n'a été qu'un tissu de pantalonnades.
Quel tableau grotesque à présenter aux nations étrangères, dont nous prétendons exciter l'admiration, si j'avais le temps d'en rassembler tous les traits ! En voici quelques-uns qui s'offrent à ma mémoire ; ils seraient plus que suffisants pour nous couvrir de confusion, si nous pouvions en sentir le ridicule.
Dans la nuit du 12 juillet 1789, on voyait la plèbe effrénée, de retour des Champs-Elysées, où elle avait porté en procession les bustes de Necker et d'Orléans, réunie à des soldats, se porter à la lueur des flambeaux aux guinguettes de la Courtille et des Porcherons, en revenir en dansant au son des tambours , se répandre dans le jardin du Palais-Royal, tomber de lassitude et s'y vautrer dans la fange.
Le jour suivant, on la vit, chaude de vin, dévaliser les boutiques des fourbisseurs, s'y armer de tout ce qui tombait sous sa main, parcourir les rues en chantant, se porter au monastère de Saint-Lazare, jeter les meubles par les croisées, faire voltiger le duvet des lits éventrés, se vêtir de robes de moines, mener en procession un chariot de grains, sur le siège duquel elle avait cloué un squelette en froc et en chapeau rabattu ; puis, trébuchant d'ivresse, on la vit transporter les reliques du monastère dans l'église des Récollets et les déposer dévotement sur le grand autel.
Pendant les quatre premiers mois qui suivirent la prise de la Bastille, on voyait les bataillons bourgeois, tout fers d'être en uniforme, singer l'air militaire, s'étudier à marcher avec grâce, se donner chaque jour en spectacle, accompagnés de nymphes vêtues de blancs, courir à la métropole, faire bénir leurs drapeaux, ou porter du pain bénit en procession, avec un appareil martial et au bruit d'une musique guerrière.
Trois semaines avant la première fête fédérative, on voyait tous les habitants de la capitale, endimanchés et confondus péle-mêle, remuer la terre, traîner la brouette, insulter aux aristocrates par des chansons grivoises, puis danser en chantant le refrain chéri : Ça ira, ça ira.
Mais c'est dans le sénat de la nation que se passent les parades les plus grotesques.
Depuis trois ans on y voit accourir de tous les coins du royaume des députations nombreuses, des citoyens qui viennent le féliciter sur ses immortels travaux, sur la sagesse des décrets qui les ont ruinés constitutionnellement, sur les douceurs de la liberté dont ils ne jouissent point, sur la prospérité de l'Etat, en proie à la fois à tous les fléaux de la discorde, de la misère, de la disette, de l'anarchie et des dissensions civiles.
Les pantalonnades jouées dans le sénat de la nation sont offertes chaque jour à l'admiration du peuple dans les papiers publics ..."
Oct. 1791 - juillet 1792 - L'Assemblée législative et la notion de "patrie en danger" ...
L'Assemblée législative, qui se réunit le 1er octobre 1791, comprend des députés nouveaux répartis entre les Feuillants (modérés et royalistes constitutionnels) à droite (263 sièges), les indépendants au centre (300) et les Jacobins à gauche (136). Les troubles continuent; le roi, qui espère que l'on renoncera à la Constitution, pratique la politique du pire.
A la fin de 1791, l'Assemblée prend des décrets contre les émigrés et les réfractaires, et en janvier 1792, elle adresse un ultimatum à l'Empereur d'Autriche Léopold Il : la guerre devient inévitable entre François II son successeur et le belliqueux ministère français; elle est déclarée le 20 avril 1792. On sait que le Roi a correspondu avec les autres souverains européens, menant une politique étrangère secrète, manipulant les factions révolutionnaires opposées les unes aux autres, et espérant que la défaite, prévisible, des armées françaises lui permettra de reprendre le pouvoir. Aussitôt, l'impopularité du roi s'accroît : une violente manifestation populaire le bloque et le menace aux Tuileries, mais ne réussit pas à lui faire retirer son veto aux décrets de l'Assemblée. Celle-ci proclame "la patrie en danger"...

Journée d'émeute du 20 juin 1792...
Face à l'opposition radicale du roi et de son entourage refusant tout compromis, notamment sur le plan religieux, les Girondins organisent un manifestation à Paris le jour anniversaire du serment du Jeu de Paume, et le peuple parisien envahit le palais des Tuileries. L'échec de cette journée et la détermination monarchiste consacrent l'échec des feuillants, défenseur de la Constitution de 1791, et les difficultés de positionnement des Girondins, républicains convaincus mais déchirés entre le respect de la Constitution et la crainte de l'insurrection populaire. Le 7 juillet, l’Assemblée apprend qu’une armée de 50 000 Prussiens marche vers la frontière....
« La patrie est en danger. » Le 22 juillet 1792, la municipalité de Paris fait solennellement proclamer : « La patrie est en danger ! » Les quatre grands spectacles de Paris ferment. Coups de canon, promenades militaires, municipaux en écharpe dans les carrefours, harangues, lectures à haute voix, tambours battants , — tout ce qui allume un peuple, toutes les images visibles de la guerre, de la gloire, le bruit, le fracas, le mouvement, la musique, le tréteau, tout est bon qui jettera aux bouches de la Victoire les foules enivrées. «La patrie est en danger !» Plus de foyer privé : la rue, large foyer où la nation se tient debout ! (Goncourt)...
Décret du 11 juillet 1792 -
"Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières : tous ceux qui ont horreur de la liberté s'arment contre notre constitution. Citoyens, la patrie est en danger. Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres : que leurs concitoyens maintiennent dans leurs foyers la sûreté des personnes et des propriétés; que les magistrats du peuple veillent attentivement; que tous, dans un courage calme, attribut de la véritable force, attendent pour agir le signal de la loi, et la patrie sera sauvée."
Tandis que les enrôlements se multiplient dans toute la France, le peuple de Paris est encouragé par les clubs et exalté par les groupes fédérés venus de province, dont l'un, venu de Marseille, entre dans la capitale en chantant l'hymne nouveau qu'on appellera la "Marseillaise"...
Estampe - "Fête commémorative du 14 juillet 1792 : l'Assemblée nationale et le Roi monteront sur l'autel de la patrie pour prêter le serment"..
Mais le 3 août, la Commune de Paris, par la voix de Pétion, réclame la déchéance de Louis XVI et la formation d'un conseil exécutif provisoire, en attendant la réunion d'une Convention nationale.



Journée du 10 Août 1792...& fondation de la République
Le peuple s'exaspère lorsque est diffusé le manifeste du duc de Brunswick, lieutenant de Frédéric II et chef des armées prussiennes, menaçant la ville de représailles si on touche au roi ou à la reine : dans la nuit du 9 ou 10 août, une commune insurrectionnelle se forme à l'Hôtel de Ville; le château des Tuileries est pris d'assaut, comme il avait été envahi le 20 juin. Deux mille Suisses qui composaient la garde du roi sont massacrés, Louis XVI se réfugie au sein de l'Assemblée nationale avec sa famille; il est alors enfermé par la Commune de Paris dans la prison du Temple.
A partir de cette date, Louis XVI ne règne plus...
la Législative, considérant que les maux de la patrie étaient parvenus à leur comble et qu'elle ne pouvait faire mieux que de recourir à la souveraineté du peuple, invite le peuple français à former une Convention nationale, et supprime, pour les élections à la nouvelle Assemblée, la distinction censitaire entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, et admet au vote «tout Français âgé de vingt-cinq ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail.»



Fondation de la République le 10 août 1792 - Estampe de Carl de Vinck : "Louis XVI et dernier est conduit au temple avec sa femme et ses enfans, à travers les huées et les imprécations d'un peuple immense." - Estampe de Carl de Vinck - "Siege du chateau des Tuilleries par les braves sans culottes et les intrépides Marseillois le 10 aout 1792."
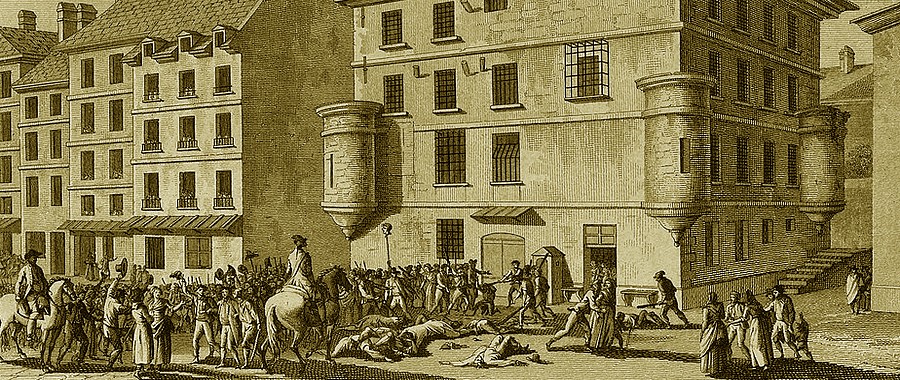

Massacres de Septembre 1792...
La guerre est déclarée à l'Autriche au mois d'avril 1792. La situation s'envenime aux frontières, l'ennemi envahit la France, Longwy est pris, Verdun s'ouvre. A la nouvelle de la prise de Verdun, la population parisienne se soulève, le 2 septembre, quelques centaines d'insurgés, poussés par Marat, envahissent les prisons et massacrent les royalistes qui y avaient été enfermés après le 10 août (Massacres des 2, 3, 4, 5 et 6 septembre 1792, Pierre Gabriel Berthault (1737–1831), Bibliothèque nationale)..
L'armée prussienne envahit à son tour la France par les défilés de l'Argonne. Dumouriez et Kellermann vont l'arrêter par la bataille de Valmy (20séptembre 1792).
Bataille de Valmy (20 septembre 1792). - La Prusse, encouragée par les premiers revers français, s'était jointe à l'Autriche; elle allait franchir les défilés de l'Argonne pour marcher sur Paris lorsque Dumouriez, qui avait remplacé La Fayette, fut chargé de l'arrêter. Le défilé de la Croix-aux-Bois, mal gardé, fut forcé. Dumouriez, se trouvant tourné sur sa gauche, se porta en toute hâte de Sedan à Saintes-Menehould et ordonna à Kellermann d'occuper avec ses volontaires le plateau de Valmy. Les Prussiens l'y attaquèrent et furent défaits...
Après Valmy, Dumouriez entre en Belgique et gagne la bataille de Jemmapes, le 6 novembre 1792. Sur le Rhin, Custine s'empare de Mayence et de Francfort; au sud, la France occupe la Savoie et le comté de Nice, enlevés au Piémont....
Fin de l'assemblée législative. - La canonnade de Valmy ramena la confiance et sauva la Révolution. Le lendemain de la bataille de Valmy, l'Assemblée législative fit place à la Convention....

Georges Jacques Danton (1759-1794)
Danton, né en 1759 à Arcis-sur-Aube, fils d'un procureur au bailliage, s'installe à Paris en 1785, est engagé chez un procureur, et peut, grâce à la dot de sa femme, Gabrielle Charpentier, fille du riche propriétaire du café du Parnasse, acheter une charge d'avocat au Conseil du roi (1787). Il sera ainsi tour à tour avocat au Conseil du roi, président du club des Cordeliers, qu'il fonda, membre de la Commune et du directoire du département de Paris (1791), ministre de la justice sous la Législative et membre du Conseil exécutif provisoire après le 10 août 1792. Il fut, en fait, le chef du gouvernement insurrectionnel, avant de devenir député de Paris à la Convention.
Il sut déployer une rare énergie pour défendre la patrie menacée. Après l'exécution des girondins il attaqua Robespierre et ses amis, et succomba dans cette lutte : condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, qu'il avait lui-même fait instituer, il fut exécuté le 5 avril 1791.
Son éloquence rappelle celle de Mirabeau, auquel il ressemblait d'ailleurs physiquement et auquel ses contemporains le comparaient (on l'appelait le "Mirabeau de la populace"). Tribun populaire, il s'abandonnait à son improvisation impétueuse, sans nul souci de l'art ni de la composition; aussi relève-t-on dans ses discours, qui du reste ne nous ont pas été
fidèlement transmis, de très nombreuses négligences.
(Portrait de Danton par Constance-Marie Charpentier, musée Carnavalet, 1792)
Paris ayant été divisé en soixante districts, Danton, électeur primaire pour les États généraux, reçoit la présidence du district de l'église des Cordeliers (1789), où il fréquente Camille Desmoulins et Marat. Il ne semble pas payer de sa personne lors de la prise de la Bastille, mais peu à peu son influence grandit. Danton est le principal fondateur, en avril 1790 de la Société des amis des Droits de l'Homme et du citoyen qui, par la suite, poussa sans cesse aux mesures extrêmes. Il mène campagne contre La Fayette et Bailly et déploie une grande activité, plaidant pour la liberté de la presse, pour la liberté d'association, s'occupant des problèmes de la subsistance de la capitale. Membre de la Commune (janvier 1790), puis membre du directoire du département de Paris (janvier 1791), il est, à cette époque, encore royaliste. Peut-être travaille-t-il pour le duc d'Orléans. On racontera d'autre part que la Cour, espérant provoquer des dissensions parmi ses adversaires, le paie.
Lors de la fuite du roi à Varennes (20 juin), ses opinions politiques se précisent : il demande la déchéance du roi et la proclamation de la république. Mais la famille royale ayant été ramenée à Paris, la Constituante invente la fiction de l'enlèvement du souverain : un groupe de républicains, venus surtout du club des Cordeliers (fondé l'année précédente par Danton) va porter au Champ-de-Mars une pétition réclamant l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif. Un incident provoque alors la « fusillade du Champ-de-Mars » (17 juillet) ; plusieurs manifestants sont abattus. Les responsables, comme Danton et Marat, doivent se cacher.
Après un séjour en Angleterre, Danton regagne Paris, où il est amnistié en septembre et élu, avec l'aide de la cour, qui pratique alors la politique du pire, substitut du procureur de la Commune (8 décembre). Il fréquente le club des Jacobins. S'il ne participe pas à la journée du 20 juin 1792, il travaille, la veille du 10 août, à la préparation de l'assaut contre les Tuileries. Sur ce point précis de la chute de la monarchie, l'importance de son rôle a beaucoup été discutée. On sait cependant qu'il trinque avec les Marseillais et les pousse à l'action. Dans la nuit, il est appelé à l'Hôtel de Ville et y donne ses directives. Il se vantera plus tard, devant le Tribunal révolutionnaire, d'avoir fait arrêter Mandat, le commandant de la garde nationale chargé de la défense des Tuileries. Jusqu'au soir, il demeure à son poste. Il y apprend la chute des Tuileries et les décrets de l'Assemblée : suspension du souverain, arrestation de la famille royale, convocation d'une Convention nationale. Il se voit nommé ministre de la Justice dans le Conseil exécutif provisoire.
Grâce à l'appui de la Commune de Paris, grâce aussi à l'effacement de ses collègues du ministère, Danton se trouve en fait maître du pouvoir exécutif, dont il use pour faire adopter la révolution du 10 août dans tout le pays et surtout pour stopper l'invasion étrangère. La guerre, déclarée à l'Autriche par le ministère girondin, a en effet très mal commencé : Verdun est menacé (la ville capitulera le 2 septembre). Dans un discours fameux (2 septembre), Danton va dresser la nation entière contre l'envahisseur. Il refuse d'abandonner Paris, organise l'enrôlement de volontaires, les réquisitions d'armes, l'arrestation de suspects. Son éloquence est à la mesure de son patriotisme : « Pour vaincre l'ennemi, s'écrie-t-il, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! ».
Le fils du député Thibaudeau laisse de lui à cette époque ce saisissant portrait : « Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l'irrégularité de ses traits, labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l'énergie et de l'audace dont son attitude et ses mouvements étaient empreints. » C'est alors que surviennent les massacres dans les prisons. Danton ne les a pas préparés, ni souhaités, mais il ne fait rien pour les arrêter.
Les électeurs de Paris portent le tumultueux orateur à la Convention le 5 septembre, juste derrière Robespierre. Optant pour la députation, il doit (21 septembre) abandonner son portefeuille de ministre. Il siège à gauche, avec la Montagne, mais désire l'union de tous les républicains face au danger extérieur et tend la main aux Girondins. Main refusée : le tribun débraillé, avide de jouissance, est en effet exécré par Mme Roland. À l'Assemblée, le 10 octobre, ses adversaires lui demandent des comptes de ses dépenses. La question est indiscrète : Danton serait bien en peine d'expliquer où passe l'argent qui lui coule entre les doigts. (Il semble probable qu'il ait payé Brunswick pour évacuer le territoire français après Valmy : si cela est exact, il ne pouvait rendre publique cette tractation.) Il se justifie d'ailleurs auprès de la Gironde : « S'il paraît surprenant qu'il ait été fait des dépenses extraordinaires, il faut se reporter aux circonstances dans lesquelles elles ont été faites : la patrie était en péril, nous étions comptables de la liberté, et nous avons rendu bon compte de cette liberté. »

La Convention (21 septembre 1792 - 26 octobre 1795)
- Le 23 juillet 1792, les fédérés des quatre-vingt-trois départements vinrent demander, à la barre de l'Assemblée législative, la suspension du roi et la convocation immédiate des assemblées primaires en vue d'élire «une Convention nationale pour prononcer sur certains articles prétendus constitutionnels».
- Troisième assemblée législative de la France depuis 1789, la Convention va se réunir le 20 septembre 1792 (dans la seconde pièce des grands appartements, au haut du grand escalier des Tuileries), deux grands partis vont tout à tour la dominer, les Girondins (Brissot, Gensonné, Vergniaud, Condorcet, Pétion, Barbaroux) puis les Montagnards ou jacobins (Robespierre, Danton, Collot-d'Herbois, Saint-Just, Tallien, Couthon, Marat). Elle siégera jusqu'au 26 octobre 1795 (4 brumaire an IV). Pétion fut élu président par 235 voix sur 253 volants; Condorcet, Brissot, Rabaut, Lasource, Vergniaud, Armand Camus, secrétaires. Mais ce n'est que le 10 mai 1793 qu'elle put s'installer, dans la salle de spectacles ou des Machines (Tuileries).
- On distingue globalement trois périodes successives...
La Convention, jusqu'au 2 juin 1793 ...
- Le 20 septembre 1792 - Le jour même de son installation, la Convention abolit la royauté, proclama la République et concentra en elle tous les pouvoirs de l'Etat.
- Le 17 janvier 1793, elle prononce contre Louis XVI, à la majorité de onze voix, la peine de mort sans sursis et sans appel;
- Le 1er février 1793, elle déclara la guerre à l'Angleterre, à la Hollande et à l'Espagne, et ordonna une levée de 300.000 hommes;
- Le 5 septembre 1793 , elle établit une armée révolutionnaire portant partout la terreur...
- Le 5 octobre 1793 , elle abolit l'ère vulgaire et décréta que l'ère des Français compterait de la fondation de la République, c'est-à-dire du 22 septembre 1792, et que le calendrier serait changé (Le Calendrier républicain)...
Août - La Convention et la chute de la royauté...
L'Assemblée s'incline, vote la suspension du roi, décide que le peuple entier élira une nouvelle Assemblée Constituante, la «Convention», marquant ainsi la fin de la monarchie constitutionnelle et l'instauration d'un régime nouveau.
Cependant, la gravité des événements militaires (prise de Longwy par les Prussiens le 23 août, investissement de Verdun le 30) entraînent des mesures de défense vigoureuses et de terribles massacres dans les prisons. Mais Dumouriez et Kellermann réussissent à remporter à Valmy, le 20 septembre 1792, une victoire dont l'importance matérielle était mince, mais dont la portée morale fut immense, comme l'a fort bien vu Gœthe.
"DE L'AUDACE!" - Le discours fut prononcé par Danton à l'Assemblée législative le 2 septembre 1792. Longwy avait été pris par les Prussiens le 22 août; et on venait d'apprendre le 1er septembre que Verdun était assiégé...
"Il est bien satisfaisant, Messieurs, pour les ministres d'un peuple libre d'avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre.
Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de nos ennemis. Vous savez que la garnison a juré d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une partie du peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements, et la troisième, avec des piques, défendra l'intérieur de nos villes.
Paris va seconder ces grands efforts. Les commissaires de la Commune vont proclamer d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens de s'armer et de marcher pour la défense de la patrie. C'est en ce moment, Messieurs, que l'Assemblée nationale va devenir un véritable comité de guerre. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple, en nommant des commissaires qui nous seconderaient dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort.
Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leurs mouvements; nous demandons qu'il soit envoyé des courriers dans tous les départements pour les avertir des décrets que vous aurez rendus. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, Messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée." (Danton.)

La Convention se réunit le 20 septembre 1792; elle comptait 749 membres. Deux grands partis y dominèrent tour à tour: les Girondins et les Montagnards. Les premiers furent ainsi nommés parce que leurs principaux chefs étaient des députés de la Gironde (Vergniaud, Guadet, Gensonné, Barbaroux, Condorcet); les seconds, parce qu'ils occupaient les sièges les plus élevés dans la Convention (Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, Couthon, Carnot, etc.) Les Girondins étaient plus éloquents et plus modérés, les Montagnards plus passionnés et plus énergiques. Les uns voulaient morceler la France en fédérations; les autres pensaient qu'il fallait donner pleine autorité au pouvoir central. La Convention, dès sa première séance, va abolir la royauté, sur la proposition d'un conventionnel obscur nommé Quinette, et proclamer la République..
Élue au suffrage universel, la Convention vota à l'unanimité des présents (300 sur 749) l'abolition de la royauté, le 21 septembre 1792, et la République fut proclamée le lendemain : "Il est décrété que tous les actes publics porteront dorénavant la date de l'an premier de la République française..." (Décret du 22 septembre 1792)
Le 21 septembre 1792, la Convention nationale prononce l'abolition de la royauté; et le 22 au matin, à l'heure où le soleil arrivait à l'équinoxe vrai d'automne en entrant dans le signe de la Balance, la république était proclamée dans tout Paris.
«L'égalité des jours et des nuits, dit l'Eleuthérophile Millin, — était marquée dans le ciel au moment même, où l'égalité civile et morale était proclamée par les représentants français » ; — et l'ère vulgaire, presque acceptée par les deux mondes, cette ère, entrée pour les usages politiques et civils dans les habitudes de la civilisation entière, on l'arrête au milieu du siècle qui marche, et le calendrier grégorien est remplacé par le calendrier républicain, inauguré le 22 septembre 1792, à neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin, mais qui ne date la révolution qu'au 22 septembre 1793.
« Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient, écrivait Fabre d'Églantine, comme un temps où nous avions vécu. Les préjugés du trône et de l'Église, les mensonges de l'un ou de l'autre souillaient chaque page du calendrier dont nous nous servions.» Le calendrier grégorien était le calendrier de la catholicité. Là était le crime; et les régénérateurs comprenaient que s'ils pouvaient appliquer le calcul décimal à la mesure du temps, introduire la décade, détruire le dimanche : la messe, cette consécration hebdomadaire des idées religieuses et monarchiques, n'ayant plus sa place dans le nouvel ordre des jours, disparaissait, sans qu'il leur en coûtât le labeur d'un effort ou l'odieux d'une persécution. Aussi le rapport de Fabre d'Églantine, qui veut faire du nouveau calendrier un enseignement d'économie rurale, un thermomètre de la température, un chronomètre plus juste pour les sciences et l'histoire, n'est au fond qu'un long et illogique plaidoyer contre l'ère sacerdotale...

Convention, séance du 25 septembre 1792, Danton, Sur les accusations de dictature..
"C'est un beau jour pour la nation, c'est un beau jour pour la République française, que celui qui amène entre nous une explication fraternelle. S'il y a des coupables, s'il existe un homme pervers qui veuille dominer despotiquement les représentants du peuple, sa tête tombera aussitôt qu'il sera démasqué. On parle de dictature, de triumvirat. Cette imputation ne doit pas être une imputation vague et indéterminée ; celui qui l'a faite doit la signer; je le ferai moi, cette imputation dût-elle faire tomber la tête de mon meilleur ami. Ce n'est pas la députation de Paris prise collectivement, qu'il faut inculper; je ne chercherai pas non plus à justifier chacun de ses membres, je ne suis responsable pour personne ; je ne vous parlerai donc que de moi.
Je suis prêt à vous retracer le tableau de ma vie publique. Depuis trois ans j'ai fait tout ce que j'ai cru devoir faire pour la liberté. Pendant la durée de mon ministère j'ai employé toute la vigueur de mon caractère, j'ai apporté dans le conseil toute l'activité et tout le zèle du citoyen embrasé de l'amour de son pays. S'il y a quelqu'un qui puisse m'accuser à cet égard, qu'il se lève, et qu'il parle. Il existe, il est vrai, dans la députation de Paris, un homme dont les opinions sont pour le parti républicain, ce qu'étaient celles de Royou pour le parti aristocratique; c'est Marat. Assez et trop longtemps l'on m'a accusé d'être l'auteur des écrits de cet homme.
J'invoque le témoignage du citoyen qui vous préside (Pétion). Il lut, votre président, la lettre menaçante qui m'a été adressée par ce citoyen ; il a été témoin d'une altercation qui a eu lieu entre lui et moi à la mairie. Mais j'attribue ces exagérations aux vexations que ce citoyen a éprouvées. Je crois que les souterrains dans lesquels il a été enfermé ont ulcéré son âme... Il est très-vrai que d'excellents citoyens ont pu être républicains par excès, il faut en convenir; mais n'accusons pas pour quelques individus exagérés une députation tout entière. Quant à moi, je n'appartiens pas à Paris ; je suis né dans un département vers lequel je tourne toujours mes regards avec un sentiment de plaisir ; mais aucun de nous n'appartient à tel ou tel département, il appartient à la France entière. Faisons donc tourner cette discussion au profit de l'intérêt public.
Il est incontestable qu'il faut une loi vigoureuse contre ceux qui voudraient détruire la liberté publique. Eh bien ! portons-la, cette loi, portons une loi qui prononce la peine de mort contre quiconque se déclarerait en faveur de la dictature ou du triumvirat; mais après avoir posé ces bases qui garantissent le règne de l'égalité, anéantissons cet esprit de parti qui nous perdrait. On prétend qu'il est parmi nous des hommes qui ont l'opinion de vouloir morceler la France; faisons disparaître ces idées absurdes, en prononçant la peine de mort contre leurs auteurs. La France doit être un tout indivisible. Elle doit avoir unité de représentation. Les citoyens de Marseille veulent donner la main aux citoyens de Dunkerque. Je demande donc la peine de mort contre quiconque voudrait détruire l'unité en France, et je propose de décréter que la Convention nationale pose pour base du gouvernement qu'elle va établir l'unité de représentation et d'exécution. Ce ne sera pas sans frémir que les Autrichiens apprendront cette sainte harmonie; alors, je vous jure, nos ennemis sont morts. (On applaudit)

Jean-Paul Marat (1743-1793) - Le fondateur de L'Ami du peuple est membre du Comité de surveillance de la Commune, député de Paris à la Convention. Montagnard extrémiste et presque isolé, il a voté la mort de Louis XVI, réclamé une dictature révolutionnaire et appelé les patriotes parisiens à l'action contre les Girondins. Ceux-ci le font décréter d'accusation, mais le Tribunal révolutionnaire l'acquitte sous les acclamations populaires (24 avril 1793).
Marat prend ainsi une part décisive à la chute des Girondins (2 juin 1793), mais il est assassiné par une de leurs admiratrices, Charlotte Corday (13 juillet 1793). Les « sans-culottes » voueront à sa mémoire un véritable culte ; son corps, transféré au Panthéon, en sera retiré après Thermidor.
"MARAT , L’AMI DU PEUPLE , A SES CONCITOYENS.
Il est notoire que les juges des tribunaux „ les administrateurs de districts et de départements , et les autres fonctionnaires publics, nommés par des corps électoraux, sont presque tous contre- révolutionnaires, tandis que les municipaux , nommés par les assemblées primaires , sont généralement bons patriotes. L’amour de la patrie aurait dû engager l’assemblée à conférer aux seules assemblées primaires le choix des députés à la Convention nationale. Elle l’eût fait, disent ses apologistes, si elle eût trouvé un mode d’exécution convenable. Mais rien n’était plus aisé : il ne s’agissait que de former, dans chaque département, un tableau des candidats les plus recommandables par leur civisme, après l’avoir épuré par la récusation motivée de bons citoyens ; puis de l’afficher dans chaque municipalité , pour en tirer le nombre de députés que doit fournir le département, en comptant la majorité des suffrages de chaque municipalité pour une voix. Par ce moyen, on aurait simplifié le jeu de la machine politique , et on aurait conservé aux citoyens l’exercice du droit d’élection immédiate , le plus précieux de leurs droits.
Des vues cachées et perfides ont déterminé les Brissot , les Condorcet , les Guadet , les Lacroix, les Lasource , les Vergniaud , les Ducos , et autres meneurs de l’Assemblée, à conserver les corps électoraux , malgré le vœu du peuple , afin de ménager aux ennemis de la patrie les moyens de porter à la Convention nationale des hommes dévoués à leurs principes , et de s’y faire porter eux-mêmes.
L’eût-on pensé ? Ces infâmes ont porté la scélératesse jusqu’à écrire, dans tous les départements , que l’Assemblée nationale est sous le couteau de la commune de Paris , dirigée par une trentaine de factieux , afin de faire choix de quelque ville gangrenée d’aristocratie pour siège de la Convention nationale, qu’ils se flattent de mener à leur gré.
C’est à vous, citoyens, à déjouer les menées des intrigants couverts d’un masque civique, en n’appelant aux fonctions électorales que des hommes éclairés et purs, connus par des actes notoires d’un patriotisme ardent et soutenu. Arrêtez donc préalablement que tout candidat déclinera les noms et qualités qu’il avait avant le 14 juillet 1789 , sous peine d’exclusion infamante ; puis repoussez avec inflexibilité tout homme ayant appartenu à quelque ordre privilégié , tout ex-noble , ex-robin , ex-financier ; tout homme ayant occupé quelque place dépendante de la cour , les banquiers , financiers et agioteurs , les procureurs, notaires, grippe-sous du palais, inspecteurs ou exempts de police ; tout homme connu par son incivisme depuis la Révolution , et surtout les électeurs de la Sainte-Chapelle , les membres du club feuillantin , les municipaux acolytes de Bailly ; les municipaux qui ont voté en 1792 pour la conservation du buste de Lafayette , tous les membres du département , tous les membres de l’état-major, tous les officiers fayétistes de l’armée parisienne , et tous les membres de l’Assemblée constituante qui ont protesté contre le décret sur les procédures des événements du 5 et du 6 octobre , tous ceux de l’Assemblée actuelle qui ont absous Mottier.
Citoyens, du bon choix de vos électeurs dépend le bon choix de vos députés à la Convention nationale , dont dépendent votre salut , le prompt établissement du règne de la justice et de la liberté, la paix et la félicité publiques , et l’anéantissement de l’esclavage chez tous les peuples du monde.
Tremblons de nous endormir, l'abîme est encore ouvert sous nos pieds. Les aristocrates se remontrent effrontément dans les sections et dans la commune; les endormeurs et les intrigants y cabalent; déjà ils ont commencé à réélire des commissaires et des juges de paix ; déjà les mouchards et coupe-jarrets soudoyés courent les rues pour y exciter des émeutes contre les meilleurs citoyens qu'ils traitent de factieux; déjà les conjurés tiennent des conciliabules ; déjà ils disent hautement que la journée du 10 n'a été qu'un coup de main qui peut être détruit par un autre coup de main, qu'ils se préparent à exécuter au premier jour.
Aujourd'hui que la famille Capet est gardée à vue , vous avez cru coupés tous les fils des trames des conspirateurs; ils sont renoués toutefois avec plus d’art que jamais dans des conciliabules secrets. Leur point de ralliement est l'indigne com- mission extraordinaire de l’Assemblée nationale; et c’est dans la majorité pourrie qui se montrait audacieusement contre-révolutionnaire avant la journée du 10, qu’est le foyer de toutes les nouvelles machinations. Leur projet est d’éloigner de Paris les fédérés et les gardes-françaises, ces braves défenseurs de la liberté , sous prétexte de former un camp à quelques lieues de la capitale , mais à l’effet de laisser le champ libre aux mauvais bataillons et aux brigands cachés dans nos murs. Que dis- je ? ils les envoient aux frontières , pour es faire égorger par des satellites allemands, et peut-être par les soldats de Luckner et de Biron , qu’ils maintiennent perfidement en place...."
Estampe de Michel Hennin, 1794 - "Marat a l'immortalité : le celebre ami du peuple est élevé à l'immortalité par le génie patriotique et par la République dont il fut le plus zélé fondateur. .."
5 novembre 1792 - Dès les premières séances de la Convention, la lutte s'engagea entre la Gironde et la Montagne. Ce fut d'abord une lutte d'hommes plutôt qu'une lutte de principes. Dans la séance du 29 octobre, Louvet attaqua Robespierre avec une extrême violence. C'était, au fond, toujours le même reproche, celui qu'avaient déjà formulé, aux Jacobins, Brissot et Guadet. Les Girondins ne pardonnaient pas à Robespierre la popularité qu'il avait acquise et l'influence dont il jouissait. Toute l'argumentation de Louvet tendit à montrer que cette popularité était une menace pour la liberté, que Robespierre marchait à la dictature, et que sa conduite politique devait faire l'objet d'un examen particulier, qu'il demandait à la Convention d'ordonner. La Convention vota l'impression de ce discours (Accusation contre Maximilien Robespierre, par J.-B. Louvet). Robespierre demanda «un délai pour examiner les inculpations dirigées contre lui et un jour fixe pour y répondre d'une manière satisfaisante et victorieuse». Ce fut le lundi, 5 novembre, que Robespierre répondit, devant la Convention, aux accusations de Louvet. Malgré l'hostilité systématique de la Gironde, qui disposait alors de la majorité de l'Assemblée, la justification de Robespierre fut si éclatante, si décisive, que la Convention, presque à l'unanimité, le vengea, par ses applaudissements, de la diatribe de son adversaire, et ordonna l'impression de son discours (Réponse de Maximilien Robespierre à l' accusation de J.-R. Louvet) . « Il n'est pas possible, écrivit Camille Desmoulins dans le numéro 25 des "Révolutions de France et de Brabant", d'humilier plus ses ennemis, et je ne crois pas que Louvet, attaché au carcan pendant une heure, eût pu souffrir davantage que pendant que Robespierre, du haut de la tribune,, chargeait cette tête chauve de cinquante pieds de fumier.... »
"Une accusation, sinon très redoutable, au moins très grave et très solennelle, a été intentée contre moi, devant la Convention nationale; j'y répondrai, parce que je ne dois pas consulter ce qui me convient le mieux à moi-même, mais ce que tout mandataire du peuple doit à l'intérêt public. J'y répondrai, parce qu'il faut qu'en un moment disparaisse le monstrueux ouvrage de la calomnie, si laborieusement élevé pendant plusieurs années, peut-être; parce qu'il faut bannir du sanctuaire des lois la haine et la vengeance, pour y rappeler les principes de la concorde. Citoyens, vous avez entendu l'immense plaidoyer de mon adversaire; vous l'avez même rendu public par la voie de l'impression ; vous trouverez sans doute équitable d'accorder à la défense la même attention que vous avez donnée à l'accusation.
De quoi suis-je accusé? D'avoir conspiré pour parvenir à la dictature, ou au triumvirat, ou au tribunat. L'opinion de mes adversaires ne paraît pas bien fixée sur ces points. Traduisons toutes ces idées romaines un peu disparates par le mot de pouvoir suprême, que mon accusateur a employé ailleurs.
Or. on conviendra d'abord que si un pareil projet était criminel, il était encore plus hardi; car, pour l'exécuter, il fallait non seulement renverser le trône, mais anéantir la législature, et surtout empêcher encore qu'elle ne fût remplacée par une Convention nationale; mais alors comment se fait-il que j'aie le premier, dans mes discours publics et dans mes écrits, appelé la Convention nationale, comme le seul remède des maux de la patrie?
Il est vrai que cette proposition même fut dénoncée comme incendiaire, par mes adversaires actuels; mais bientôt la révolution du 10 fit plus que la légitimer, elle la réalisa. Dirai-je que, pour arriver à la dictature, il ne suffisait pas de maîtriser Paris; qu'il fallait asservir les 82 autres départements? Où étaient mes trésors, où étaient mes armées? Où étaient les grandes places dont j'étais pourvu ? Toute la puissance résidait précisément dans les mains de mes adversaires. La moindre conséquence que je puisse tirer de tout ce que je viens de dire, c'est qu'avant que l'accusation pût acquérir un caractère de vraisemblance, il faudrait au moins qu'il fût préalablement démontré que j'étais complètement fou : encore ne vois-je pas ce que mes adversaires pourraient gagner à cette supposition; car alors il resterait à expliquer comment des hommes sensés auraient pu se donner la peine de composer tant de beaux discours, tant de belles affiches, de déployer tant de moyens, pour me présenter à la Convention nationale et à la France entière comme le plus redoutable de tous les conspirateurs.
Mais venons aux preuves positives. L'un des reproches les plus terribles que l'on m'ait faits, je ne le dissimule point, c'est le nom de Marat. Je vais donc commencer par vous dire quels ont été mes rapports avec lui. Je pourrai même faire ma profession de foi sur son compte, mais sans en dire ni plus de bien, ni plus de mal que j'en pense. Car je ne sais point trahir ma pensée, pour caresser l'opinion générale.
Au mois de janvier 1792, Marat vint me trouver; jusque-là, je n'avais eu avec lui aucune espèce de relations directes, ni indirectes. La conversation roula sur les affaires publiques, dont il me parla avec désespoir; je lui dis, moi, tout ce que les patriotes, même les plus ardents, pensaient de lui; à savoir qu'il avait mis lui-même un obstacle au bien que pouvaient produire les vérités utiles développées dans ses écrits, en s'obstinant à revenir éternellement sur certaines propositions absurdes et violentes, qui révoltaient les amis de la liberté autant que les parti sans de l'aristocratie.
Il défendit son opinion; je persistai dans la mienne, et je dois avouer qu'il trouva mes vues politiques tellement étroites, que, quelque temps après, lorsqu'il eut repris son journal, alors abandonné par lui depuis quelque temps, en rendant compte lui-même de la conversation dont je viens de parler, il écrivit en toutes lettres qu'il m'avait quitté parfaitement convaincu que je n'avais "ni les vues ni l'audace d'un homme d'Etat"; et, si les critiques de Marat pouvaient être des titres de faveur, je pourrais remettre encore sous vos yeux quelques-unes de ses feuilles publiées six semaines avant la dernière révolution, où il m'accusait de feuillantisme, parce que, dans un ouvrage périodique, je ne disais pas hautement qu'il fallait renverser la Constitution.
Depuis cette première et unique visite de Marat, je l'ai retrouvé à l'assemblée électorale; ici je retrouve aussi M . Louvet, qui m'accuse d'avoir désigné Marat pour député, d'avoir mal parlé de Priestley, enfin d'avoir dominé le corps électoral par l'intrigue et par l'effroi.
Aux déclamations les plus absurdes et les plus atroces, comme aux suppositions les plus romanesques et les plus hautement démenties par la notoriété publique, je ne réponds que par les faits : les voici....
... Vous avez adopté une méthode bien sûre et bien commode pour assurer votre domination, c'est de prodiguer les noms de scélérats et de monstres à vos adversaires, et de donner vos partisans pour les modèles du patriotisme; c'est de nous accabler à chaque instant du poids de nos vices et de celui de vos vertus; cependant à quoi se réduisent, au fond, tous vos griefs? La majorité des Jacobins rejetait vos opinions; elle avait tort sans doute. Le public ne vous était pas plus favorable; qu'en pouvez-vous conclure en votre faveur? Direz-vous que je lui prodiguais les trésors que je n'avais pas, pour faire triompher des principes gravés dans tous les cœurs? Je ne vous rappellerai pas qu'alors le seul objet de dissentiment qui nous divisait, c'était que vous défendiez indistinctement tous les actes des nouveaux ministres, et nous les principes; que vous paraissiez préférer le pouvoir, et nous l'égalité. Je me contenterai de vous observer qu'il résulte de vos plaintes mêmes que nous étions divisés d'opinion dès ce temps-là. Or, de quel droit voulez-vous faire servir la Convention nationale elle-même à venger les disgrâces de votre amour-propre ou de votre système ? Je ne chercherai point à vous rappeler aux sentiments des âmes républicaines, mais soyez au moins aussi généreux qu'un roi ..."
En cette fin d'année 1792, la France attend la prochaine mise en jugement de Louis XVI.
Danton, soucieux de sauver le monarque (peut-être a-t-il reçu de l'argent de la Cour par l'intermédiaire du feuillant Théodore de Lameth), a vainement cherché à éluder le procès. Mais, le jour du vote, il vote la mort, sans sursis.
Toutes ses préoccupations vont du reste aux problèmes extérieurs. Il souhaite donner la liberté aux pays opprimés par les « tyrans ». (« La nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie âpre de la Liberté. ») Il est chargé de « révolutionner » la Belgique (il s'y rendra quatre fois de décembre 1792 à mars 1793) et prône le grand principe des frontières naturelles. Son patriotisme ardent le pousse à préconiser les mesures énergiques qui sauveront le pays et la Révolution de l'invasion : levée de 300 000 hommes, établissement du tribunal et des comités révolutionnaires, institution du Comité de salut public dont il sera le chef (mars-avril 1793).
"MAJORITE ET MINORITÉ" - Discours prononcé par Robespierre à la Convention le 17 décembre 1792 à l'occasion du procès de Louis XVI : il s'agissait de savoir si le roi serait jugé par l`Assemblée ou si l'on ferait appel au peuple. Robespierre combattit cette dernière solution, soutenue au contraire par Vergniaud.
"Déjà pour éterniser la discorde et pour se rendre maître des délibérations, on a imaginé de distinguer l'Assemblée en majorité et en minorité, nouveau moyen d'outrager et de réduire au silence ceux qu'on désigne sous cette dernière dénomination.
Je ne connais point ici ni minorité ni majorité: la majorité est celle des bons citoyens; la majorité n'est point permanente, parce qu'elle n'appartient à aucun parti; elle se renouvelle à chaque délibération libre, parce qu'elle appartient à la cause publique et à l'éternelle raison ; et quand l'Assemblée reconnaît une erreur, comme il arrive quelquefois, la minorité devient alors majorité. La volonté générale ne se forme pas dans les conciliabules ténébreux, ni autour des tables ministérielles. La minorité a partout un droit éternel; c'est celui de faire entendre la voix de la vérité ou de ce qu'elle regarde comme tel.
La vertu fut toujours en minorité sur la terre. Sans cela la terre serait-elle peuplée de tyrans et d'esclaves. Hampden et Sidney étaient de la minorité, car ils expirèrent sur un échafaud; les Critias, les Anitus, les César, les Clodius étaient de la majorité; mais Socrate était de la minorité, car il avala la ciguë; Caton était de la minorité, car il déchira ses entrailles.
Je connais ici beaucoup d'hommes qui serviront, s'il le faut, la liberté à la manière de Sidney et de Hampden, et n'y en eût-il que cinquante... Cette seule pensée doit faire frémir tous ces lâches intrigants qui veulent égarer la majorité! En attendant cette époque, je demande au moins la priorité pour le tyran.
Unissons-nous pour sauver la patrie, et que cette délibération prenne enfin un caractère plus digne de nous et de la cause que nous défendons! Bannissons du moins tous ces déplorables incidents qui la déshonorent; ne mettons pas à nous persécuter plus de temps qu'il n'en faut pour juger Louis, et sachons apprécier le sujet de nos inquiétudes..." (Robespierre.)
Rappelons, pour comprendre les citations de Robespierre, que John Hampden (1595-1643), cousin de Cromwell, membre de la Chambre des Communes, refusa en 1656 de payer la taxe des vaisseaux arbitrairement établie par Charles Ier; son procès fut retentissant et au début de la guerre civile, il prit les armes, leva un régiment et périt dans une escarmouche au combat de Thames. - Algernon Sidney (1622-1682), ardent républicain, ennemi des Stuarts, refusa de servir le protectorat des deux Cromwell; nommé en 1678 membre de la Chambre des Communes, il soutint le bill d'exclusion contre le duc d'York; impliqué plus tard dans le complot de la Rye House, il fut condamné à mort par un jury que présidait le fameux Jeffreys. - Critias fut le plus célèbre des Trente Tyrans imposés aux Athéniens par les Spartiates après la prise de leur ville par Lysandre (404 av. J.-C.). - Anitus (ou plutôt Anytos) fut l'un des trois accusateurs de Socrate (les deux autres étaient Mélétos et Lycon) - Clodius fut le tribun qui fit exiler Cicéron et périt dans une rixe avec les esclaves de Milon (53 av. J.-C.)..
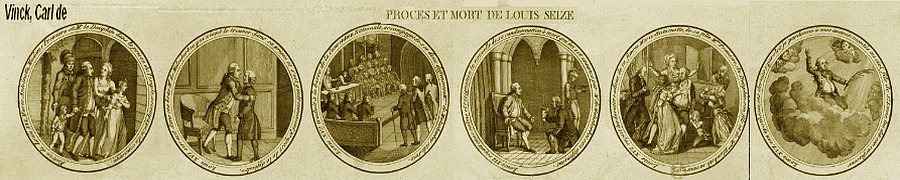
3 décembre 1792 - 21 janvier 1793, Procès et exécution de Louis XVI ...
La Convention débute le procès de Louis XVI. Il est défendu par Malesherbes, Tronchet et de Sèze. Reconnu coupable à une faible majorité d'avoir conspiré contre la Révolution, le roi est condamné à la peine de mort. Le 21 janvier 1793, à dix heures un quart du matin, Louis de Bourbon, XVIe du nom, né à Versailles le 23 août 1754, nommé Dauphin le 20 décembre 1765, Roi de France et de Navarre le 10 mai 1774, sacré et couronné à Reims le 11 juin 1776, est guillotiné sur la place de la Révolution. Sa mort courageuse fait oublier ses faiblesses passées en même temps qu'elle frappe de stupeur les élites européennes. La Révolution ne se stabilise pas pour autant, les luttes internes sont toujours considérables et aucun meneur politique ne réussit à imposer une légitimité durable...
Le 13 novembre 1792, le procès du roi, sa légitimité pose question, la Convention hésite, nombre de députés s'interroge, c'est alors que Saint-Just se présente à la tribune. Dès les premiers mots, c'est la royauté elle-même que Saint-Just rejette hors du droit commun. Le cas Capet disparaît. C'est la justification du régicide, l'apologie de Brutus, la proclamation de la loi martiale contre tous les tyrans du monde. «Juger un roi comme un citoyen. Ce mot étonnera la postérité froide. Juger, c'est appliquer la loi. Une loi est un rapport de Justice. Quel rapport de Justice y a-t-il donc entre l'humanité et les rois... ? » Et les mots tombent comme des coups de hache, dira Barère. «On ne peut régner innocemment,» poursuit-il ; tout roi est un rebelle et un usurpateur». L'impression fut énorme. Le discours, abondamment imprimé et distribué, consacra aussitôt la popularité de son auteur.
DISCOURS SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI PRONONCÉ PAR SAINT-JUST A LA CONVENTION
Ce discours, prononcé le 13 novembre 1792, marque les vrais débuts de Saint- Just à la Convention. Son succès fut immense et plaça d'emblée le jeune conventionnel au premier rang des orateurs révolutionnaires. Sans s'attarder à discuter les griefs accumulés contre le roi, Saint- Just n'en voit qu'un et n'en retient qu'un : c'est qu'il est le roi. Etre roi, c'est être coupable, et il trouve cette formule qui fera fortune et que la France entière adoptera : On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Cette théorie, assez nouvelle pour l'époque, séduit par sa hardiesse, et le discours de Saint- Just lui vaut une popularité immense, aussi bien à la Convention et aux Jacobins que dans le peuple. L'impression de son discours est votée par la Convention, et la plupart des départements, à leur tour, le font imprimer et le diffusent.
"J'entreprends, Citoyens, de prouver que le roi peut être jugé; que l'opinion de Morisson, qui conserve l'inviolabilité, et celle du comité, qui veut que le roi doit être jugé dans des principes qui ne tiennent ni de l'une ni de l'autre.
Le comité de législation, qui vous a parlé très sainement de la vaine inviolabilité du roi et des maximes de la justice éternelle, ne vous a point, ce me semble, développé toutes les conséquences de ces principes; en sorte que le projet de décret qu'il vous a présenté n'en dérive point, et perd, pour ainsi dire, leur sève. L'unique but du comité fut de vous persuader que le roi devait être jugé en simple citoyen; et moi, je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre, et que, n'étant plus rien dans le contrat qui unit les Français, les formes de la procédure ne sont point dans la loi civile, mais dans la loi du droit des gens.
Faute de ces distinctions, on est tombé dans des formes sans principes, qui conduiraient le roi à l'impunité, fixeraient trop longtemps les yeux sur lui, ou qui laisseraient sur son jugement une tache de sévérité injuste ou excessive. Je me suis souvent aperçu que de fausses mesures de prudence, les lenteurs, le recueillement, étaient ici de véritables imprudences; et après celle qui recule le moment de nous donner des lois, la plus funeste serait celle qui nous ferait temporiser avec le roi.
Un jour, peut-être, les hommes, aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales, s'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un tyran, où le peuple qui eut un tyran à juger l'éleva au rang de citoyen avant d'examiner ses crimes, songea plutôt à ce qu'on dirait de lui qu'à ce qu'il avait à faire, et d'un coupable de la dernière classe de l'humanité, je veux dire celle des oppresseurs, fit, pour ainsi dire, un martyr de son orgueil.
On s'étonnera un jour qu'au dix-huitième siècle on ait été moins avancé que du temps de César : là le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autres formalités que vingt-trois coups de poignard, et sans autre loi que la liberté de Rome. Et aujourd'hui l'on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple, pris en flagrant délit, la main dans le sang, la main dans le crime !
Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une République à fonder : ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d'un roi ne fonderont jamais une République. Parmi nous, la finesse des esprits et des caractères est un grand obstacle à la liberté; on embellit toutes les erreurs, et, le plus souvent, la vérité n'est que la séduction de notre goût.
Votre comité de législation vous en donne un exemple dans le rapport qui vous a été lu. Morisson vous en donne un plus frappant : à ses yeux, la liberté, la souveraineté des nations sont une chose de fait.
On a posé des principes; on a négligé leurs plus naturelles conséquences. Une certaine incertitude s'est montrée depuis le rapport.
Chacun rapproche le procès du roi de ses vues particulières; les uns semblent craindre de porter plus tard la peine de leur courage; les autres n'ont point renoncé à la monarchie; ceux-ci craignent un exemple de vertu qui serait un lien d'esprit public et d'unité dans la République; ceux-là n'ont point d'énergie. Les querelles, les perfidies, la malice, la colère, qui se déploient tour à tour, ou sont un frein ingénieux à l'essor de la vigueur combinée dont nous avons besoin, ou sont la marque de l'impuissance de l'esprit humain.
Nous devons donc avancer courageusement à notre but, et, si nous voulons une République, y marcher très sérieusement. Nous nous jugeons tous avec sévérité, je dirai même avec fureur; nous ne songeons qu'à modifier l'énergie du peuple et de la liberté, tandis qu'on accuse à peine l'ennemi commun et que tout le monde, ou rempli de faiblesse, ou engagé dans le crime, se regarde avant de frap- per le premier coup. Nous cherchons la liberté, et nous nous rendons esclaves l'un de l'autre î Nous cherchons la nature, et nous vivons armés comme des sauvages furieux ! Nous voulons la République, l'indépendance et l'unité, et nous nous divisons, et nous ménageons un tyran î
Citoyens, si le peuple romain, après six cents ans de vertu et de haine contre les rois; si la Grande- Bretagne, après Cromwell mort, vit renaître les rois, malgré son énergie, que ne doivent pas craindre parmi nous les bons amis de la liberté, en voyant la hache trembler dans nos mains, et un peuple dès le premier jour de sa liberté, respecter le souvenir de ses fers ! Quelle République voulez-vous établir au milieu de nos combats particuliers et de nos faiblesses communes ?
On semble chercher une loi qui permette de punir le roi; mais, dans la forme du gouvernement dont nous sortons, s'il y avait un homme inviolable, il l'était, en partant de ce sens, pour chaque citoyen; mais de peuple à roi, je ne connais: plus de rapport naturel.
Il se peut qu'une nation, stipulant les clauses du pacte social, environne ses magistrats d'un caractère capable de faire respecter tous les droits et d'obliger chacun; mais ce caractère étant au profit du peuple, et sans garantie contre le peuple, l'on ne peut jamais s'armer contre lui d'un caractère qu'il donne et retire à son gré.
Les citoyens se lient par le contrat; le souverain ne se lie pas; ou le prince n'aurait point de juge et serait un tyran.
Ainsi l'inviolabilité de Louis ne s'est point étendue au delà de son crime et de l'insurrection; ou, si on le jugeait inviolable après, si même on le met- tait à la question, il en résulterait, Citoyens, qu'il n'aurait pu être déchu, et qu'il aurait eu la faculté de nous opprimer sous la responsabilité du peuple.
Le pacte est un contrat entre les citoyens, et non point avec le gouvernement : on n'est pour rien dans un contrat où l'on ne s'est point obligé. Conséquemment, Louis, qui ne s'était pas obligé, ne peut pas être jugé civilement. Ce contrat était tellement oppressif, qu'il obligeait les citoyens, et non le roi : un tel contrat était nécessairement nul, car rien n'est légitime de ce qui manque de sanction dans la morale et dans la nature.
Outre ces motifs, qui, tous, vous portent à ne juger pas Louis comme citoyen, mais à le juger comme rebelle, de quel droit réclamerait-il, pour être jugé civilement, l'engagement que nous avons pris avec lui, lorsqu'il est clair qu'il a violé le seul qu'il avait pris envers nous, celui de nous conserver ? Quel serait cet acte dernier de la tyrannie que de prétendre être jugé par des lois qu'il a détruites ? Et, Citoyens, si nous lui accordions de le juger civilement, c'est-à-dire suivant les lois, c'est-à-dire en citoyen, à ce titre il nous jugerait, il jugerait le peuple même.
Pour moi, je ne vois point de milieu : cet homme doit régner ou mourir. Il vous prouvera que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour soutenir le dépôt qui lui était confié; car, en engageant avec lui cette discussion, vous ne lui pouvez demander compte de sa malignité cachée; il vous perdra dans le cercle vicieux que vous tracez vous-mêmes pour l'accuser.
Citoyens, ainsi les peuples opprimés au nom de leur volonté s'enchaînent indissolublement par le respect de leur propre orgueil, tandis que la morale et l'utilité devraient être l'unique règle des lois. Ainsi, par le prix qu'on met à ses erreurs, on s'amuse à les combattre, au lieu de marcher droit à la vérité.
Quelle procédure, quelle information voulez-vous faire des entreprises et des pernicieux desseins du roi ? D'abord, après avoir reconnu qu'il n'était point inviolable pour le souverain, et ensuite lorsque ses crimes sont partout écrits avec le sang du peuple, lorsque le sang de vos défenseurs a ruisselé, pour ainsi dire, jusqu'à vos pieds, et jusque sur cette image de Brutus, qu'on ne respecte pas le roi.
Il opprima une nation libre; il se déclara son ennemi; il abusa des lois : il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. Ne passa- t-il pas, avant le combat, les troupes en revue ? Ne prit-il pas la fuite au lieu de les empêcher de tirer ? Que fit-il pour arrêter la fureur de ses soldats ? L'on vous propose de le juger civilement, tandis que vous reconnaissez qu'il n'était pas citoyen, et qu'au lieu de conserver le peuple, il ne fit que sacrifier le peuple à lui-même.
Je dirai plus : c'est qu'une Constitution acceptée par un roi n'obligerait pas les citoyens; ils avaient, même avant son crime, le droit de le proscrire et de le chasser. Juger un roi comme un citoyen ! Ce mot étonnera la postérité froide. Juger, c'est appliquer la loi. Une loi est un rapport de justice : quel rapport de justice y a-t-il donc entre l'humanité et les rois ? Qu'y a-t-il de commun entre Louis et le peuple français, pour le ménager après sa trahison ?
Il est telle âme généreuse qui dirait, dans un autre temps, que le procès doit être fait à un roi, non point pour les crimes de son administration, mais pour celui d'avoir été roi, car rien au monde ne peut légitimer cette usurpation; et de quelque illusion, de quelques conventions que la royauté s'enveloppe, elle est un crime éternel, contre lequel tout homme a le droit de s'élever et de s'armer; elle est un de ces attentats que l'aveuglement même de tout un peuple ne saurait justifier. Ce peuple est criminel envers la nature par l'exemple qu'il a donné, et tous les hommes tiennent d'elle la mission secrète d'exterminer la domination en tout pays.
On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois mêmes traitaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité ? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell ? Et, certes, Cromwell n'était pas plus usurpateur que Charles I er ; car lorsqu'un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n'est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l'un que sur celle de l'autre.
Voilà les considérations qu'un peuple généreux et républicain ne doit pas oublier dans le jugement d'un roi.
On nous dit que le roi doit être jugé par un tribunal, comme les autres citoyens... Mais les tribunaux ne sont établis que pour les membres de la cité; et je ne conçois point par quel oubli des principes des institutions sociales un tribunal serait juge entre un roi et le souverain; comment un tribunal aurait la faculté de rendre un maître à la patrie, et de l'absoudre, et comment la volonté générale serait citée devant un tribunal.
On vous dira que le jugement sera ratifié par le peuple. Mais si le peuple ratifie le jugement, pour- quoi ne jugerait-il pas ? Si nous ne sentions point tout le faible de ces idées, quelque forme de gouvernement que nous adoptassions, nous serions esclaves; le souverain n'y serait jamais à sa place, ni le magistrat à la sienne, et le peuple serait sans garantie contre l'oppression.
Citoyens, le tribunal qui doit juger Louis n'est point un tribunal judiciaire : c'est un conseil, c'est le peuple, c'est vous; et les lois que nous avons à suivre sont celles du droit des gens.
C'est vous qui devez juger Louis; mais vous ne pouvez être à son égard une cour judiciaire, un juré, un accusateur; cette forme civile de jugement le rendrait injuste; et le roi, regardé comme citoyen, ne pourrait être jugé par les mêmes bouches qui l'accusent.
Louis est un étranger parmi nous; il n'était pas citoyen avant son crime; il ne pouvait voter; il ne pouvait porter les armes; il l'est encore moins depuis son crime.
Et par quel abus de la justice même en feriez- vous un citoyen, pour le condamner ? Aussitôt qu'un homme est coupable, il sort de la cité; et, point du tout, Louis y entrerait par son crime. Je vous dirai plus : c'est que si vous déclariez le roi simple citoyen, vous ne pourriez plus l'atteindre. De quel engagement de sa part lui parleriez-vous dans le présent ordre des choses ?
Citoyens, si vous êtes jaloux que l'Europe admire la justice de votre jugement, tels sont les principes qui le doivent déterminer; et ceux que le comité de législation vous propose seraient précisément un monument d'injustice. Les formes, dans le procès, sont de l'hypocrisie; on vous jugera selon vos principes.
Je ne perdrai jamais de vue que l'esprit avec lequel on jugera le roi sera le même que celui avec lequel on établira la République. La théorie de votre jugement sera celle de vos magistratures, et la mesure de votre philosophie, dans ce jugement, sera aussi la mesure de votre liberté dans la Constitution.
Je le répète, on ne peut point juger un roi selon les lois du pays, ou plutôt les lois de cité. Le rapporteur vous l'a bien dit; mais cette idée est morte trop tôt dans son âme; il en a perdu le fruit. Il n'y avait rien dans les lois de Numa pour juger Tarquin; rien dans les lois d'Angleterre pour juger Charles Ier : on les jugea selon le droit des gens; on repoussa la force par la force; on repoussa un étranger, un ennemi. Voilà ce qui légitima ces expéditions, et non point de vaines formalités, qui n'ont pour principe que le consentement du citoyen, par le contrat.
On ne me verra jamais opposer ma volonté particulière à la volonté de tous. Je voudrai ce que le peuple français, ou la majorité de ses représentants, voudra; mais comme ma volonté particulière est une portion de la loi qui n'est point encore faite, je m'explique ici ouvertement.
Il ne suffit pas de dire qu'il est dans l'ordre de la justice éternelle que la souveraineté soit indépendante de la forme actuelle de gouvernement, et d'en tirer cette conséquence, que le roi doit être jugé; il faut encore étendre la justice naturelle et le principe de la souveraineté jusqu'à l'esprit même dans lequel il convient de le juger.
Nous n'aurons point de République sans ces distinctions qui mettent toutes les parties de l'ordre social dans leur mouvement naturel, comme la nature crée la vie de la combinaison des éléments.
Tout ce que j'ai dit tend donc à vous prouver que Louis XVI doit être jugé comme un ennemi étranger. J'ajoute qu'il n'est pas nécessaire que son jugement à mort soit soumis à la sanction du peuple; car le peuple peut bien imposer des lois par sa volonté, parce que ces lois importent à son bon- heur; mais le peuple même ne pouvant effacer le crime de la tyrannie, le droit des hommes contre la tyrannie est personnel; et il n'est pas d'acte de la souveraineté qui puisse obliger véritablement un seul citoyen à lui pardonner.
C'est donc à vous de décider si Louis est l'ennemi du peuple français, s'il est étranger : si votre majorité venait à l'absoudre, ce serait alors que ce jugement devrait être sanctionné par le peuple; car si un seul citoyen ne pouvait être légitimement contraint par un acte de la souveraineté à pardonner au roi, à plus forte raison un acte de magistrature ne serait point obligatoire pour le souverain.
Mais hâtez-vous de juger le roi, car il n'est pas de citoyen qui n'ait sur lui le droit que Brutus avait sur César; vous ne pourriez pas plutôt punir cette action envers cet étranger que vous n'avez blâmé la mort de Léopold et de Gustave.
Louis était un autre Catilina; le meurtrier, comme le consul de Rome, jurerait qu'il a sauvé la patrie. Louis a combattu le peuple : il est vaincu. C'est un barbare, c'est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides; vous avez vu son armée; le traître n'était pas le roi des Français, c'était le roi de quelques conjurés. Il faisait des levées secrètes de troupes, avait des magistrats particuliers; il regardait les citoyens comme ses esclaves; il avait proscrit secrètement tous les gens de bien et de courage. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ-de-Mars, de Tournay, des Tuileries : quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal?
Il doit être jugé promptement : c'est le conseil de la sagesse et de la saine politique; c'est une espèce d'otage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié; on achètera bientôt des larmes; on fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même.
Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance, et tu pourras nous accuser de perfidie."
Estampe de Lasinio, Carlo, 1759-1838, Benazech, Charles, 1767-1794 - "Le Dernier moment de la vie du roy Louis XVI : encouragé par son confesseur Edgeworth a la vue de son supplice tandis que le général Santerre en presse l'exécution le 21 janvier 1793."




1793 - Première coalition - La condamnation de Louis XVI mit en armes presque toutes les monarchies de l'Europe. L'Angleterre, la Hollande et l'Espagne se joignirent à la Prusse et à l'Autriche. La Vendée et la Bretagne, restées royalistes, firent cause commune.
En avril 1793, Dumouriez trahit la Convention et passe la frontière. Girondins et dantonistes s'accusent réciproquement des responsabilités de cette défection. Mais Danton se dresse et crie à la calomnie : ainsi, il rompt définitivement avec la Gironde. Il laisse préparer les journées du 31 mai et du 2 juin, qui verront la chute des Girondins, mais il accueillera avec peine la nouvelle de leur exécution en octobre. Entre-temps, le tribun s'attire l'hostilité, d'abord sourde, des robespierristes (Marat et Saint-Just appellent le comité Danton « Comité de la perte publique »). On lui reproche de négocier avec l'envahisseur. Il se voit, en outre, attaqué à la Convention à propos de défaites vendéennes (le général Westermann, plusieurs fois mis en déroute, est un de ses amis). Lors du renouvellement du Comité, il n'est pas réélu (10 juillet 1793). Remarié en juin 1793, il est mis en congé par la Convention le 11 octobre. Sa grande erreur est alors de quitter Paris avec sa nouvelle épouse, Louise Gély (sa première femme est morte quelques mois plus tôt) : en son absence, Robespierre sape sa position.
Danton perd sa place dominante au club des Cordeliers, où son ancien ami Hébert répand des idées socialistes auxquelles lui, Danton, bourgeois et propriétaire, n'adhère pas. Il blâme les violences antireligieuses et déconseille l'exécution de Marie-Antoinette.

"Le Père Duchesne", le journal politique de Jacques-René Hébert (1757-1794) parut de 1790 à 1794, ainsi qu'une brochure intitulée "La Lanterne magique"....
Le nom de "Père Duchesne" fait référence à un personnage populaire, fétiche des ouvriers parisiens dont l'habitude était de récriminer bruyamment contre toutes les espèces d'abus. Tout d'abord plus attaché à l'idée de la Constitution qu'au mouvement proprement révolutionnaire, faisant entre 1790 et 1791 l'éloge du roi, de La Fayette et blâmant Marat et la Reine, ce fut à partir du numéro 59 que cette feuille se mit à vomir contre le roi, la reine et la famille royale, se déchaînant lors du procès du roi : « Grande joie du Père Duchesne de voir que la Convention a pris le mors aux dents et va faire essayer la cravate de Samson au cornard Capet. » Puis Hébert, après la mort de Louis XVI, après le 10 août, et surtout après le 31 main s'attaque violemment au parti des Girondins et ses furieuses sorties démagogiques ne tardèrent pas à faire de lui l'idole de la foule. Les gouvernants d'alors firent circuler le Père Duchesne avec profusion dans les départements.
Ce style ne plaît pas à tous et 24 mai 1793, Hébert est arrêté à la suite des attaques de la Gironde ; mais, sous la pression populaire, il est relâché peu après et c'est la Gironde qui est finalement vaincue le 2 juin. Après l'assassinat de Marat, il fut le révolutionnaire le plus ardent, le véritable symbole des revendications de la masse qui lisait son Père Duchesne. Il devient l'idole des sans-culottes que séduit son ton gouailleur et ses propos orduriers. Avec une violence extrême, Hébert s'en prit aux riches, aux fonctionnaires, aux prêtres, aux avocats. Il avait coutume de dire que les sans-culottes ne devaient compter que sur eux-mêmes et que le Christ était le premier sans-culotte qui ait combattu pour la liberté. Hébert prévoyait une époque d'union et de fraternité pour les purs révolutionnaires; et, se laissant emporter de manière inconsidérée dans le feu du discours, il lui arrivait souvent de prendre violemment à partie Danton et Desmoulins.
(1790) "Jugement de M.Necker rendu par le père Duchêne.
Mille noms d'un boulet ramé! quand j'entends tout un peuple se recrier contre toi, te reprocher des choses malheureusement trop justes, et que tu restes comme un jeanfoutre, sans rien dire; je crois, foutre, que c'est pour mieux nous trahir, bougre de tartuffe, sans délicatesse! ne crains pas que j'abuse de mes droits pour vomir contre toi des reproches honteux, et sans preuves de ma conviction; la vérité seule m'éclaire, et je vais dévoiler à tes yeux les pensées de mon ame, et les horreurs de la tienne. J'entends lancer contre toi les plus atroces imprécations, avec justice, sans doute; réponds donc aux proclamations que l'on te porte, d’avoir reçu des sommes considérables et de n'avoir pas satisfait les engagemens de l’Etat ; d’avoir prêté la main au plus affreux agiorage ; d'avoir disposé des sommes que les dons patriotiques et les quarts des revenus ont versés dans le trésor royal, pour fournir des armes contre nous. Et qu’enfin tu ne rends que des comptes en l'air, sans preuves authentiques de tes dépenses.
Moi , foutre , je ne suis, qu’un bougre , qui est plus borné qu un Cure de Vaugirard, et avec mon raisonnement de cheval , je trouve que c’est juste : comment les gens d’esprit peuvent le voir? ce n'est pas que je veuille te nuire; j’ai peine à croire tout cela, parce que je pense comme un pauvre Recureur de poêle, qui n’a jamais su que charger un canon et être honnête homme; mais, jour de Dieu! si tu es innocent , je veux que ma voix de tonnerre calcine les bougresses de langues calomnieuses , qui veulent arracher du cœur des bons enfans l’amour qu’ils ont conçu pour toi. Je te défendrai , et je te rendrai justice , si tu le mérites, ce qui me le fait espérer , c’est que j’entends depuis longtemps des bougres à poils folets reproéher aux gens en place des fautes qu’ils n’ont souvent pas commises ; et ne jamais faire leur éloge , ça me refout moi , quand je vois la partialité corrompre la plume d’un grand nombre d’écrivains.
La liberté doit être pour le bonheur de tous les hommes ; il est bien juste que celui qui est blâmé innocemment , recouvre la confiance publique par la justfication ; mais , foutre, ces bougres de citoyens aiment mieux écouter les bavardages d’une quantité prodigieuse de pamphlets fabuleux, remplis de phrases alarmantes, qui. donnent à leurs chefs, des torts que l’aristocratie fait naître. Ils ne voient pas que les ennemis du bien généra! profitent de leur foiblesse, pour tâcher de ralumer des feux, que le courage a entièrement éteint, ces pirates de la littétature ne rougissent pas de donner les noms de patriotisme et de civisme â leur torche- culs ; de jurer de leur vérité à la face de la terre et des cieux ; enfin , d’accuser des plus cruels forfaits ceux dont leur amour pour la patrie ont fait les plus grands sacrifices...
Allons, foutre , démanche toi, et ne reste pas engourdi avec îe calcul des assignats , il s’agit de ton procès. Plaide bougre ..."
Mais la violence de son ton finit par le perdre : l'accusation d'inceste lancée par lui au procès de Marie-Antoinette le discrédite non seulement aux yeux des modérés, mais à ceux aussi des membres du Comité de salut public qu'exaspèrent ses surenchères démagogiques et les pressions des «enragés» dans le domaine économique et social. Sur l 'accusation de l'impitoyable Saint-Just, dans la nuit du 13 au 14 mars 1794, Hébert est arrêté avec certains de ses partisans, dont le général Ronsin, sur ordre du Comité de salut public. Traduit devant le Tribunal révolutionnaire, il est condamné à mort et exécuté le 24 mars. Sa femme, fut condamnée à mort le 24 germinal an II (18 avril 1794), et exécutée le même jour....
Vers la dernière période de la Convention (1793-1795)...
Les Jacobins voulurent effrayer les adversaires de la Révolution. La France vécut sous le régime de la Terreur. Les Girondins furent les premières victimes, jugés trop modérés et trop partisans d'une république fédérative. Le tour de Danton et de Camille Desmoulins vint ensuite. Danton est une des grandes figures de la Révolution. A son tour, Robespierre était mis en accusation et exécuté, le 9 thermidor. Sa mort marque la fin de la Terreur. La Convention se retirera, le 26 octobre 1795...
"POUR SAUVER LA PATRIE" - Discours prononcé par Danton à la Convention le 10 mars 1793 à propos de la création d'un tribunal révolutionnaire destiné à juger les accusés politiques et à propos de l'établissement d'une taxe sur les riches...
"Faites donc partir vos commissaires; soutenez-les par votre énergie; qu'ils partent ce soir, cette nuit même; qu'ils disent à la classe opulente: ll faut que l'aristocratie de l'Europe, succombant sous nos efforts, paye notre dette, ou que vous la payiez; le peuple n'a que du sang; il le prodigue. Allons, misérables, prodiguez vos richesses. Voyez, citoyens, les belles destinées qui vous attendent. Quoi l vous avez une nation entière pour levier, la raison pour point d'appui, et vous n'avez pas encore bouleversé le monde!
ll faut pour cela du caractère, et la vérité est qu'on en a manqué. Je mets de côté toutes les passions; elles me sont toutes parfaitement étrangères, excepté celle du bien public. Dans des circonstances plus difficiles, quand l'ennemi était aux portes de Paris, j'ai dit à ceux qui gouvernaient alors: "Vos discussions sont misérables; je ne connais que l'ennemi. Vous qui me fatiguez de vos contestations particulières, au lieu de vous occuper du salut de la République, je vous répudie tous comme traîtres à la patrie. Je vous mets tous sur la même ligne." Je leur disais: "Eh! que m'importe ma réputation! Que la France soit libre, et que mon nom soit flétri ! Que m'importe d'être appelé buveur de sang! Eh bien, buvons le sang des ennemis de l'humanité, s'il le faut; combattons, conquérons la liberté!"... (Danton.)

Pierre Victurnien Vergniaud (1753-1793)
Né en 1758 à Limoges, Vergniaud fut le plus illustre orateur du parti girondin. Avocat au Parlement de Bordeaux, il fut élu député par cette ville à l'Assemblée législative et à la Convention. Ennemi acharné de la monarchie, il fut un des principaux auteurs de la déchéance de Louis XVI; mais, hostile aux violences, il lutta contre la Montagne et succomba avec son parti le 31 mai 1793 : arrêté le 2 juin, il fut guillotiné le 31 octobre.
Unissant à un caractère un peu nonchalant une grande facilité d'élocution, il se plaisait à développer copieusement, sans beaucoup de profondeur ni de précision, de simples lieux communs, et trop souvent il avait recours aux procédés ordinaires de la rhétorique, répétitions, périphrases, allégories, réminiscences gréco-latines. Mais sa parole, toujours élégante et correcte, savait à l'occasion s'échauffer, soit pour faire appel aux défenseurs de la patrie en danger, soit pour répondre aux accusateurs de son parti.
(1793) "Nous, DES MODERÉS!"
Robespierre, dans la séance de la Convention du 10 avril 1793, avait accusé de modérantisme le parti girondin, dont Vergniaud était le chef. Le 31 mai 1793 ce dernier défendit énergiquement devant la Convention sa propre conduite et celle de son parti..
"Robespierre nous accuse d'être devenus tout à coup des modérés, des Feuillants.
Nous, modérés! Je ne l'étais pas le 10 août, Robespierre, quand tu étais caché dans ta cave. Des modérés! Non, je ne le suis pas dans ce sens que je veuille éteindre l'énergie nationale.
Je sais que la liberté est toujours active comme la flamme, qu'elle est inconciliable avec ce calme parfait qui ne convient qu'à des esclaves. Si on n'eût voulu que nourrir ce feu sacré qui brûle dans mon cœur aussi ardemment que dans celui des hommes qui parlent sans cesse de l'impétuosité de leur caractère, de si grands dissentiments n'auraient pas éclaté dans cette assemblée.
Je sais aussi que, dans les temps révolutionnaires, il y aurait autant de folie à prétendre calmer à volonté l'effervescence du peuple qu'à commander aux flots de la mer d'être tranquilles quand ils sont battus par les vents. Mais c'est au législateur à prévenir autant qu'il peut les désastres de la tempête par de sages conseils; et si, sous prétexte de révolution, il faut, pour être patriote, se déclarer le protecteur du meurtre et du brigandage, je suis modéré.
Depuis l'abolition de la royauté, j'ai beaucoup entendu parler de révolution. Je me suis dit: il n'y en a plus que deux possibles, celle des propriétés ou la loi agraire, et celle qui nous ramènerait au despotisme. J'ai pris la ferme résolution de combattre l'une et l'autre, et tous les moyens indirects qui pourraient nous y conduire. Si c'est là être modéré, nous le sommes tous; car tous nous avons voté la peine de mort contre tout citoyen qui proposerait l'une ou l'autre...
Nous sommes des modérés ! Mais au profit de qui avons-nous montré cette grande modération? Au profit des émigrés? Nous avons adopté contre eux toutes les mesures de rigueur que commandaient également et la justice et l`intérêt national. Au profit des conspirateurs du dedans? Nous n'avons cessé d'appeler sur leurs têtes le glaive de la loi. Mais j'ai repoussé la loi qui menaçait de proscrire l'innocent comme le coupable. On parlait sans cesse de mesures terribles, de mesures révolutionnaires. Je les voulais aussi, ces mesures terribles, mais contre les seuls ennemis de la patrie. Je ne voulais pas qu'elles compromissent la sûreté des bons citoyens, parce que quelques scélérats auraient intérêt à les perdre; voulais des punitions et non des prescriptions. Quelques hommes ont paru faire consister leur patriotisme à tourmenter, à faire verser des larmes. J'aurais voulu qu'il ne fit que des heureux. La Convention est le centre autour duquel doivent se rallier tous les citoyens. Peut-être que leurs regards ne se fixent pas toujours sur elle sans inquiétude et sans effroi.
J'aurais voulu qu'elle fût le centre de toutes les affections et de toutes les espérances. On cherche à consommer la Révolution par la terreur; j'aurais voulu la consommer par l'amour. Enfin, je n'ai pas pensé que, semblables aux prêtres et aux farouches ministres de l'lnquisition, qui ne parlent de leur Dieu de miséricorde qu`au milieu des bûchers, nous dussions parler de liberté au milieu des poignards et des bourreaux..." (Vergniaud )

Le 24 avril 1793, Saint Just montait à la tribune de la Convention et prononçait un discours "Sur la Constitution", la Convention, qui succédait à la Constituante, avait comme premier mandat de donner à la France une constitution définitive, Condorcet fut chargé de présenter et de rédiger un projet, et Saint-Just intervint plus d'une fois...
"Tous les tyrans avaient les yeux sur nous, lorsque nous jugeâmes un de leurs pareils : aujourd'hui que, par un destin plus doux, vous méditez la liberté du monde, les peuples, qui sont les véritables grands de la terre, vont vous contempler à leur tour. Vous avez craint le jugement des hommes, quand vous fîtes périr un roi; cette cause n'intéressait que votre orgueil : celle que vous allez agiter est plus touchante; elle intéresse votre gloire : la constitution sera votre réponse et votre manifeste sur la terre.
Qu'il me soit permis de vous présenter quelques idées pratiques. Le droit public est très étendu dans les livres; ils ne nous apprennent rien sur l'application et sur ce qui nous convient. L'Europe vous demandera la paix, le jour que vous aurez donné une Constitution au peuple français. Le même jour, les divisions cesseront; les factions, accablées, ploieront sous le joug de la liberté; les citoyens retourneront à leurs ateliers, à leurs travaux, et la paix, régnant dans la République, fera trembler les rois.
Soit que vous fassiez la paix ou que vous fassiez la guerre, vous avez besoin d'un gouvernement vigoureux : un gouvernement faible et déréglé qui fait la guerre, ressemble à l'homme qui commet quelque excès avec un tempérament faible; car en cet état de délicatesse où nous sommes, si je puis parler ainsi, le peuple français a moins d'énergie contre la violence du despotisme étranger; les lois languissent, et la jalousie de la liberté a brisé ses armes.
Le temps est venu de sevrer cette liberté et de la fonder sur ses bases. La paix et l'abondance, la vertu publique, la victoire, tout est dans la vigueur des lois; hors des lois, tout est stérile et mort.
Tout peuple est propre à la vertu et propre à vaincre; on ne l'y force pas, on l'y conduit par la sagesse. Le Français est facile à gouverner; il lui faut une Constitution douce, sans qu'elle perde rien de sa rectitude. Ce peuple est vif et propre à la démocratie; mais il ne doit pas être trop lassé par l'embarras des affaires publiques; il doit être régi sans faiblesse, il doit l'être aussi sans contrainte.
En général, l'ordre ne résulte pas des mouvements qu'imprime la force. Rien n'est réglé que ce qui se meut par soi-même et obéit à sa propre harmonie; la force ne doit qu'écarter ce qui est étranger à cette harmonie. Ce principe est applicable surtout à la constitution naturelle des empires. Les lois ne repoussent que le mal; l'innocence et la vertu sont indépendantes sur la terre.
J'ai pensé que l'ordre social était dans la nature même des choses, et n'empruntait de l'esprit humain que le soin d'en mettre à leur place les éléments divers; qu'un peuple pouvait être gouverné sans être assujetti, sans être licencieux, et sans être opprimé; que l'homme naissait pour la paix et pour la liberté, et n'était malheureux et corrompu que par les lois insidieuses de la domination.
Alors j'imaginai que si l'on donnait à l'homme des lois selon la nature et son cœur, il cesserait d'être malheureux et corrompu.
Tous les arts ont produit leurs merveilles; l'art de gouverner n'a produit que des monstres ; c'est que nous avons cherché soigneusement nos plaisirs dans la nature, et nos principes dans notre orgueil.
Ainsi les peuples ont perdu leur liberté; ils la recouvreront lorsque les législateurs n'établiront que des rapports de justice entre les hommes, en sorte que, le mal étant comme étranger à leur intérêt, l'intérêt immuable et déterminé de chacun soit la justice. Cet ordre est plus facile qu'on ne pense à établir. L'ordre social précède l'ordre politique; l'origine de celui-ci fut la résistance à la conquête. Les hommes d'une même société sont en paix naturellement; la guerre n'est qu'entre les peuples, ou plutôt qu'entre ceux qui les dominent.
L'état social est le rapport des hommes entre eux; l'état politique est le rapport de peuple à peuple.
Si l'on fait quelque attention à ce principe, et qu'on veuille en faire l'application, on trouve que la principale force du gouvernement a des rapports extérieurs, et qu'au dedans, la justice naturelle entre les hommes étant considérée comme le principe de leur société, le gouvernement est plutôt un ressort d'harmonie que d'autorité.
Il est donc nécessaire de séparer dans le gouvernement l'énergie dont il a besoin pour résister à la force extérieure, des moyens plus simples dont il a besoin pour gouverner. L'origine de l'asservissement des peuples est la force complexe des gouvernements; ils usèrent contre les peuples de la même puissance dont ils s'étaient servis contre leurs ennemis. L'altération de l'âme humaine a fait naître d'autres idées; on supposa l'homme farouche et meurtrier dans la nature pour acquérir le droit de l'asservir. Ainsi, le principe de l'esclavage et du malheur de l'homme s'est consacré jusque dans son cœur : il s'est cru sauvage sur la foi des tyrans, et c'est par douceur qu'il a laissé supposer et dompter sa férocité. Les hommes n'ont été sauvages qu'au jugement des oppresseurs; ils n'étaient point farouches entre eux; mais ceux aujourd'hui qui font la guerre à la liberté ne nous trouvent-ils point féroces parce que notre courage a voulu secouer leur règne ?
Permettez-moi de développer mes idées; elles amènent ce pas où je dois conclure : je saurai les plier à l'ordre présent des choses, et je ne refuserai point à la loi la force dont elle a besoin en prenant l'homme tel qu'il est, mais je conçois un gouvernement vigoureux, et légitime : il ne faut point songer à la politique naturelle, et ce n'est point là mon idée. Mais je combats ce prétexte pris par les tyrans, de la violence naturelle de l'homme, pour le dominer. Et si l'homme eût été si farouche, le domine- raient-ils ? Et n'avons-nous pas tous une même nature ? Qui donc fut sage et fut policé le premier ? Quelle langue parla-t-il à des bêtes qui ne communiquaient point ? Et si elles communiquaient, l'ordre social n'avait-il pas précédé de longtemps l'ordre politique ? Montesquieu regarde comme un signe de stupidité l'épouvante d'un sauvage trouvé dans les bois : mais ce sauvage qu'il dit trembler et fuir en nous voyant, tremblerait-il et fuirait-il devant son espèce et sa langue ? Les bêtes féroces pourraient aussi nous croire des sauvages, lorsque nous tremblons et fuyons devant elles. Les hommes n'abandonnèrent point spontanément l'état social : ce fut par une longue altération qu'ils arrivèrent à cette politesse sauvage de l'invention des tyrans. Les anciens Francs, les anciens Germains, n'avaient presque point de magistrats : le peuple était prince et souverain ; mais quand les peuples perdirent le goût des assemblées pour négocier et conquérir, le prince se sépara du souverain, et le devint lui-même par usurpation.
Ici commence la vie politique.
On ne discerna plus alors l'état des citoyens; il ne fut plus question que de l'état du maître.
Si vous voulez rendre l'homme à la liberté, ne faites des lois que pour lui, ne l'accablez point sous le faix du pouvoir. Le temps présent est plein d'illusion; on croit que les oppresseurs ne renaîtront plus : il vint des oppresseurs après Lycurgue, qui détruisirent son ouvrage. Si Lycurgue avait institué des Conventions à Lacédémone pour conserver sa liberté, ces mêmes oppresseurs eussent étouffé ces Conventions. Minos avait, par les lois mêmes, prescrit l'insurrection; les Crétois n'en furent pas moins assujettis : la liberté d'un peuple est dans la force et la durée de sa Constitution, sa liberté périt toujours avec elle, parce qu'elle périt par des tyrans qui deviennent plus forts que la liberté même. Songez donc, Citoyens, à fortifier la Constitution contre ses pouvoirs et la corruption de ses principes. Toute sa faiblesse ne serait point au profit du peuple; elle tournerait contre lui-même au profit de l'usurpateur.
Vous avez décrété qu'une génération ne pouvait point enchaîner l'autre; mais les générations fluctuent entre elles; elles sont toutes en minorité, et sont trop faibles pour réclamer leurs droits. Il ne suffit point de décréter les droits des hommes; il se pourra qu'un tyran s'élève et s'arme même de ces droits contre le peuple; et celui de tous les peuples le plus opprimé sera celui qui, par une tyrannie pleine de douceur, le serait au nom de ses propres droits. Sous une tyrannie aussi sainte, ce peuple n'oserait plus rien sans crime pour sa liberté. Le crime adroit s'érigerait en une sorte de religion, et les fripons seraient dans l'arche sacrée. Nous n'avons point à craindre maintenant une violente domination : l'oppression sera plus dangereuse et plus délicate. Rien ne garantira le peuple qu'une constitution forte et durable, et que le gouvernement ne pourra ébranler.
Le législateur commande à l'avenir; il ne lui sert de rien d'être faible : c'est à lui de vouloir le bien et de le perpétuer; c'est à lui de rendre les hommes ce qu'il veut qu'ils soient : selon que les lois animent le corps social, inerte par lui-même, il en résulte les vertus ou les crimes, les bonnes mœurs ou la férocité. La vertu de Lacédémone était dans le cœur de Lycurgue, et l'inconstance des Crétois dans le cœur de Minos. Notre corruption dans la monarchie fut dans le cœur de tous ses rois : la corruption n'est point naturelle aux peuples.
Mais lorsqu'une révolution change tout à coup un peuple, et qu'en le prenant tel qu'il est on essaie de le réformer, il se faut ployer à ses faiblesses, et le soumettre avec discernement au génie de l'institution; il ne faut point faire qu'il convienne aux lois, il vaut mieux faire en sorte que les lois lui conviennent. Notre Constitution doit être propre au peuple français. Les mauvaises lois l'ont soumis longtemps au gouvernement d'un seul : c'est un végétal transplanté dans un autre hémisphère, qu'il faut que l'art aide à produire des fruits mûrs sous un climat nouveau.
Il faut dire un mot de la nature de la législation.
Il y a deux manières de l'envisager; elle gît en préceptes, elles gît en lois. La législation en préceptes n'est point durable; les préceptes sont les principes des lois; ils ne sont pas les lois. Lorsqu'on déplace de leur sens ces deux idées, les droits et les devoirs du peuple et du magistrat sont dénués de sanction. Les lois, qui doivent être des rapports, ne sont plus que des leçons isolées, auxquelles la violence, à défaut d'harmonie, oblige tôt ou tard de se conformer; et c'est ainsi que les principes de la liberté autorisent l'excès du pouvoir, faute de lois et d'application. Les droits de l'homme étaient dans la tête de Solon: il ne les écrivit point, mais il les consacra et les rendit pratiques.
On a paru penser que cet ordre pratique devait résulter de l'instruction et des mœurs; la science des mœurs est bien dans l'instruction; les mœurs mêmes résultent de la nature du gouvernement.
Sous la monarchie, les principes des mœurs étaient consacrés comme une politesse de l'esprit; et cependant tous ceux qui avaient appris ces principes sont aujourd'hui les ennemis du peuple et de la liberté. Aucune idée de justice n'atteignait le cœur. La tête pleine d'exemples de vertus, de traits de courage, de leçons et de vérités sublimes, on était un lâche, un méchant dans le monde; le savoir était la gentillesse du vice, et la vertu semblait être le luxe du crime.
Le gouvernement entraînait tout; tout allait se confondre dans l'idée du prince; l'Etat était rempli de professions criminelles et honorables; c'était pour elles que travaillait l'éducation. Dans une société pareille, où il ne fallait que des voleurs, des hommes faux, déterminés à tous les crimes, l'éducation qui consistait en préceptes était oubliée au moment même qu'on entrait dans le monde; elle ne servait qu'à raffiner l'esprit aux dépens du cœur : alors, pour être un homme de bien, il fallait fouler aux pieds la nature. La loi faisait un crime des penchants les plus purs. Le sentiment et l'amitié étaient des ridicules. Pour être sage, il fallait être un monstre. La prudence, dans l'âge mûr, était la défiance de ses semblables, le désespoir du bien, la persuasion que tout allait et devait aller mal; on ne vivait que pour tromper ou que pour l'être, et l'on regardait comme attachés à la nature humaine ces affreux travers qui ne dérivaient que du prince et de la nature du gouvernement.
La tyrannie déprave l'homme, et par une longue altération le rend à ses propres yeux incapable du bien. Otez la tyrannie du monde, vous y rétablirez la paix et la vertu. La tyrannie est intéressée à la mollesse du peuple; elle est intéressée aux crimes; elle est de moitié dans toutes les bassesses et les attentats; elle arma le fils contre le père par la loi civile, elle arme les morts contre les vivants; tout est pression et répression. C'est elle qui assassine sur un chemin par le bras d'un voleur; c'est elle qui corrompt les cœurs et les déprave sous le joug. Elle endort l'âme humaine. Si donc un pareil ordre de choses cesse, le peuple, qui n'a plus devant les yeux cet appareil du faste qui ne corrompt pas moins le pauvre que le riche par l'envie, le fait s'avilir par l'appât du gain, ou le pousse à de lâches professions, ou le séduit, le peuple alors se régénère et redevient lui-même.
De ce que je viens de dire, il dérive que la médiocrité de la personne qui gouverne est la source des mœurs et de la liberté dans un Etat; il faut que ceux qui sont dépositaires de vos lois soient con- damnés à la frugalité, afin que l'esprit et les goûts publics naissent de l'amour des lois et de la patrie. Le peuple doit respecter les magistrats; il ne doit ni les flatter ni les craindre, il ne doit point considérer les lois comme leur volonté, car bientôt les lois ne servent plus qu'à le réprimer au lieu de le conduire. Il ne suffit point de détourner l'attention du peuple de l'orgueil des magistrats pour l'appliquer aux lois; il faut que l'intérêt public occupe aussi sans cesse son activité, car le législateur doit faire en sorte que tout le peuple marche dans le sens et vers le but qu'il s'est proposé.
La corruption chez un peuple est le fruit de la paresse et du pouvoir; le principe des mœurs est que tout le monde travaille au profit de la patrie, et que personne ne soit asservi ni oisif. Une monarchie se soutient tant que la moitié du peuple travaille, et tant que l'autre moitié a de l'économie au lieu de vertu. La monarchie française a péri, parce que la classe riche a dégoûté l'autre du travail. Plus il y a de travail ou d'activité dans un Etat, plus cet Etat est affermi : aussi, la mesure de la liberté et des mœurs est-elle moindre dans le gouvernement d'un seul que dans celui de plusieurs, parce que dans le premier, le prince enrichit beaucoup de gens à rien faire, et que, dans le second, l'aristocratie répand moins de faveurs; et de même dans le gouvernement populaire, les mœurs s'établissent d'elles-mêmes, parce que le magistrat ne corrompt personne, que tout le monde y est libre et y travaille. Si vous voulez savoir combien de temps doit durer votre République, calculez la somme de travail que vous y pouvez introduire, et le degré de modestie compatible avec l'énergie du magistrat dans un grand domaine. Dans la Constitution qu'on vous a présentée, ceci soit dit sans offenser le mérite, que je ne sais ni outrager ni flatter, il y a peut-être plus de préceptes que de lois, plus de pouvoirs que d'harmonie, plus de mouvements que de démocratie. Elle est l'image sacrée de la liberté, elle n'est point la liberté même.
Voici son plan : une représentation fédérative qui fait les lois, un conseil représentatif qui les exécute. Une représentation générale, formée des représentations particulières de chacun des départements, n'est plus une représentation, mais un congrès : des ministres qui exécutent les lois ne peuvent point devenir un conseil; ce conseil est contre nature; les ministres exécutent en particulier ce qu'ils délibèrent en commun, et peuvent transiger sans cesse : ce conseil est le ministre de ses propres volontés; sa vigilance sur lui-même est illusoire. Un conseil et des ministres sont deux choses hétérogènes et séparées : si on les confond, le peuple doit chercher des dieux pour être ses ministres, car le conseil rend les ministres inviolables, et les ministres rendent le peuple sans garantie contre le conseil.
La mobilité de ce double caractère en fait une arme à deux tranchants : l'un menace la représentation, l'autre les citoyens; chaque ministre trouve dans le conseil des voix toujours prêtes à consacrer réciproquement l'injustice. L'autorité qui exécute gagne peu à peu dans le gouvernement le plus libre qu'on puisse imaginer; mais, si cette autorité délibère et exécute, elle est bientôt une indépendance.
Les tyrans divisent le peuple pour régner; divisez le pouvoir si vous voulez que la liberté règne à son tour ..."
6 avril 1793, Le Comité de salut public - Au début de janvier 1793, lorsque se précise la menace d'une guerre générale, la Convention crée dans son sein un Comité de défense générale. Ses membres étaient trop nombreux et la publicité des séances incompatible avec le secret nécessaire aux préparatifs militaires. La Commission de salut public, créée le 25 mars, ne réussit pas mieux. Le 6 avril, Isnard et Barère font élire un Comité de salut public de neuf membres, choisis par la Convention et délibérant en secret (les plus influents parmi ceux-ci sont Danton, Barère, Cambon, Treilhard). Dominé par la personnalité de Danton, il essaie vainement de faire face à cette situation. Le renouvellement du 10 juillet, en éliminant Danton, va donner naissance au « Grand Comité de l'an II » (1793-1794).

24 avril 1793 - Robespierre, Discours sur la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ...
Le 17 avril 1793, la Convention aborda la discussion du projet de Constitution. Après une brève intervention, le 19 avril, en faveur de la liberté de la presse. Robespierre prit la parole, dans la séance du 24, pour présenter quelques articles additionnels et un projet de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La première partie de ce discours a, pour l'étude des idées sociales de Robespierre, une importance capitale. S'attachant à définir et à préciser le droit de propriété, il exposa, pour la première fois devant une assemblée politique, les doctrines dont allaient s'inspirer, quelques années plus tard, Babeuf et son groupe, et, dans le cours du XIXe siècle, toutes les écoles socialistes. De même, la Déclaration des Droits présentée par Robespierre fut considérée comme la charte de la démocratie et comme le programme d'une transformation sociale. Elle présente, avec la Déclaration des Droits telle que l'avait rédigée l'Assemblée constituante, et même avec celle que rédigea la Convention, des différences profondes. Mais si elle ne fut pas incorporée à la Constitution de 1793, elle n'en devint pas moins, pour le peuple, une sorte d'évangile révolutionnaire. Elle fut imprimée, en 1793, en deux éditions, et souvent réimprimée depuis (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, proposée par Maximilien Robespierre, 24 avril 1793).
"... Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété ; il le faut d'autant plus, qu'il n'en est point que les préjugés et les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais. Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété ; il vous dira, en vous montrant cette longue bière, qu'il appelle un navire, où il a encaissé et ferré des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes propriétés, je les ai achetés tant par tête. Interrogez ce gentilhomme, qui a des terres et des vassaux, ou qui croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en a plus; il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables.
Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne ; ils vous diront que la plus sacrée de toutes les propriétés est, sans contredit, le droit héréditaire, dont ils ont joui de toute antiquité, d'opprimer, d'avilir et de pressurer légalement et monarchiquement les 25 millions d'hommes qui habitaient le territoire de la France sous leur bon plaisir.
Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte sur aucun principe de morale. Pourquoi votre Déclaration des Droits semble-t-elle présenter la même erreur? En définissant la liberté, le premier des biens de l'homme, le plus sacré des droits qu'il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu'elle avait pour borne les droits d'autrui ; pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale ; comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes? Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la propriété, et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime ; de manière que votre Déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes :
« Art. 1 er . La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi.
« Art. 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.
« Art. 3. 11 ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à là liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables.
« Art. 4. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral. »
Vous parlez aussi de l'impôt pour établir le principe incontestable qu'il ne peut émaner que de la volonté du peuple ou de ses représentants; mais vous oubliez une disposition que l'intérêt de l'humanité réclame. Vous oubliez de consacrer la base de l'impôt progressif. Or, en matière de contributions publiques, est-il un principe plus évidemment puisé dans la nature des choses et dans l'éternelle justice que celui qui impose aux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les avantages qu'ils retirent de la société. Je vous propose de le consigner dans un article conçu en ces termes :
« Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques; les autres doivent les supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune. »
Le comité a encore absolument oublié de rappeler les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes et toutes les nations, et leur droit à une mutuelle assistance...."
La Convention, du 2 juin 1793 au 9 thermidor an II (27 juillet 1794) ...
- Le 10 octobre 1793 (19 vendémiaire an II), elle établit le gouvernement révolutionnaire,
- Décrète d'accusation, outre une foule de particuliers, la reine Marie-Antoinette (16 octobre), puis vingt et un députés Girondins, parmi lesquels Brissot, Gensonné, Vergniaud (31 octobre), enfin (5 avril 1794) les chefs mêmes de la Révolution, Danton, Camille Desmoulins, ainsi que plusieurs membres du club des Cordeliers, qu'on ne trouvait plus assez exaltés
- Le 7 mai (18 floréal), Robespierre fait proclamer l'existence d'un Etre suprême;
- Le 27 juillet (9 thermidor), la Convention déclara hors la loi les deux Robespierre et leurs partisans les plus sanguinaires, et par là met un terme au règne de la Terreur.
La «dictature» de la Montagne, du 24 juin 1793 au 9 thermidor an II (27 juillet 1794), deuxième période de l'histoire de la Convention nationale dominée par les Montagnards après l'éviction des Girondins - Une vaste coalition se forma et la France fut envahie à nouveau; le recrutement de 200 000 hommes provoqua le soulèvement des Vendéens, qui n'avaient jamais admis la Constitution civile du clergé, et formèrent alors de nombreuses bandes armées. La Convention prit des mesures énergiques et créa des comités chargés de lutter contre les réfractaires : les Montagnards finirent par éliminer les Girondins en mai et juin, en faisant arrêter 31 d'entre eux. Il leur fallut alors lutter contre l'insurrection vendéenne qui s'était étendue notablement, contre l'insurrection girondine (ou "fédéraliste") puissante dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône, et contre les armées étrangères, qui envahissaient la France au Nord, au Nord-Est, au Sud-Est, et au Sud-Ouest.
Juillet 1793 - Marat prend une part décisive à la chute des Girondins (2 juin 1793), mais il est assassiné par une de leurs admiratrices, Charlotte Corday (13 juillet 1793, voir le célèbre tableau de Jacques-Louis David, ....
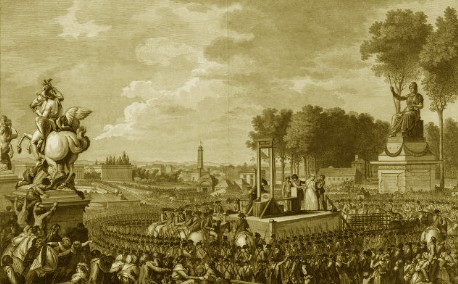


Juillet 1793 - Estampe de Tassaert, Jean Joseph François, 1765-1835, Caresme, Jacques Philippe, 1734-1796, Vinck, Carl de, 1859-19, Hennin, Michel, 1777-1863 - "1793, Dernières paroles de Joseph Chalier, révolutionnaire, jacobin, orateur honni par la bourgeoisie, dans les prisons de Lion : pourquoi pleurez-vous, la mort n'est rien pour celui dont les intentions sont droites et dont la conscience fut toujours pure... - Jeanne Gomart de Vaubernier, comtesse Dubarry, décapitée à Paris le 18 frimaire, an 2 (9 décembre 1793) à l'age de 42 ans" - Estampe de Marchand, Jacques, 1769-1845? - "Chalier, partant de sa prison : pour aller au supplice, adresse à son ami Bernascon, en présence des compagnons de son infortune, ces paroles remarquables : Ami, je connais ton coeur : tu as tout fait pour moi et pour la liberté, ne t'afflige point. Tu connais mes plus secrettes pensées, mon âme toute entiere t'a été developpée"...

27 juillet 1793 - Robespierre est devenu le personnage le plus représentatif de la Révolution. Estimant que le salut public exige un pouvoir dictatorial, il préconise l'établissement d'un gouvernement révolutionnaire.
Robespierre (1759-1794)
Robespierre, né en 1761 à Arras, fut avocat, puis député de sa ville natale aux Etats généraux, ou il se distingua par ses sentiments de haine monarchique. Son attitude rigide lui valut dans le peuple le surnom d' "Incorruptible". Député de Paris à la Convention et chef de la Montagne, membre du Comité de salut public, il fut l'instigateur principal du régime de la Terreur, et après la condamnation des dantonistes et des hébertistes il exerça une véritable dictature. En avril 1793, il a été l'un des principaux artisans de la création d'un Comité de salut public qu'il fait remanier après la chute des Girondins. Il y entre le 27 juillet et en devient le véritable chef. Laissant à ses collègues les tâches spécialisées, il consacre ses soins à la politique générale et n'accepte aucune mission hors Paris. Entouré de ses fidèles Georges Couthon (1755-1794) et Saint-Just, il est vraiment l'âme de la dictature montagnarde. Il a lui-même énuméré – non sans peut-être quelque exagération ! – toutes les tâches qui lui incombent : « Onze armées à diriger, le poids de l'Europe entière à porter, partout des traîtres à démasquer, des émissaires soudoyés par l'or des puissances étrangères à déjouer, des administrateurs infidèles à surveiller, tous les tyrans à combattre, toutes les conspirations à intimider, partout à aplanir les obstacles, telles sont mes fonctions » (25 septembre 1793).
Comme orateur, il manquait d'imagination et de spontanéité ; mais ses discours, soigneusement préparés, avaient de la logique. Figure mystérieuse, homme à la fois honnête et orgueilleusement convaincu, il prétend établir une égalité sociale, basée sur l'abolition de la pauvreté, par la "redistribution" des biens des suspects et l'organisation d'une "bienfaisance nationale" ; il fonde une religion révolutionnaire et patriotique, ayant pour principe l'existence de l' "Etre Suprême" et l'immortalité de l'âme et préside en son honneur une fête solennelle au Champ-de-Mars le 20 prairial (8 juin).
L'insurrection vendéenne de 1793 crée une situation nouvelle, un symbole dans la mémoire collective, alors que Montagnards et sans-culottes s'opposent aux Girondins, chaque groupe luttant pour sa survie politique qui passe par la dénonciation des autres comme opposants à la Révolution. La « levée des 300 000 hommes » que décide la Convention en février 1793 est destinée à renforcer les troupes combattant aux frontières va suscite de nombreuses insurrections dans des régions déjà réfractaires à la Révolution, comme la Bretagne ou l'Alsace. Les Conventionnels, notamment les Montagnards, engagent une forte répression. L'essentiel des armées vendéennes sera écrasé lors de la bataille de Cholet, le 17 octobre 1793. Mais cette guerre vendéenne ne cesse pas pour autant et persiste jusqu'en 1796, ses derniers soubresauts dateront de 1799 et de 1815...
5 septembre 1793 - Jean Billaud-Varenne (1756-1819) entre au Comité de salut public avec Collot d'Herbois (1750-1796), au soir de la tumultueuse séance à la Convention. Acteur raté, Collot d'Herbois sera un partisan de la Terreur, réprimera avec une farouche rigueur, en compagnie de Fouché, le soulèvement de Lyon et sera l'un des principaux artisans de la chute de Robespierre. Autre auteur dramatique manqué, professeur laïque au collège des oratoriens à Juilly, rédacteur de plusieurs brochures dénonçant la superstition et «le despotisme des ministres», Billaud-Varenne est, au début de la Révolution, un orateur écouté du club des Jacobins et l'un des premiers à développer des idées républicaines au moment de la fuite du roi en juin 1791. Membre de la Commune révolutionnaire de Paris, lors de l'insurrection du 10 août, élu par la capitale à la Convention avec les principaux chefs de la Montagne, Robespierre, Danton et Marat, il développe en 1793 ses idées sociales et politiques dans une brochure intitulée "Les Éléments du républicanisme", le programme des Montagnard. Il se prononce contre les hébertistes, puis contre Danton. Mais l'ascendant pris par Robespierre au sein du Comité de salut public finit par l'inquiéter et le 8 thermidor il s'exclame, «J'aime mieux que mon cadavre serve de trône à un ambitieux que de devenir par mon silence le complice de ses forfaits». La chute de Robespierre marquera pour lui une nouvelle étape de la Révolution mais deviendra l'une des cibles préférées de la réaction thermidorienne...
Loi des Suspects établie par la Convention le 17 septembre 1793....
Votée le 12 août 1793, en pleine Terreur dont elle devient le meilleur instrument, la loi des suspects voit son champ d'application s'élargir par le décret du 17 septembre, permettant l'arrestation immédiate, sans motif comme sans preuve, de tous ceux qui « n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution » ou de ceux qui « n'ayant rien fait contre la Liberté, n'ont rien fait pour elle ». Visant nobles, prêtres, émigrés et possédants, elle va s'étendre aux indifférents, insouciants, et, finalement, aux révolutionnaires eux-mêmes. Elle sera abrogée le 4 octobre 1795.

Camille Desmoulins
De tous les journalistes de la Révolution le plus remarquable fut Camille Desmoulins, né à Guise en 1760, mort sur l'échafaud le 5 avril 1794, le même jour que Fabre d'Églantine. Il s'était jeté dès le début dans le mouvement révolutionnaire et l'on se rappelle son intervention fameuse le 12 juillet 1789, quand il appela aux armes la foule assemblée dans le Jardin du Palais-Royal.
Député de Paris la la Convention, il sièges sur les bancs de la Montagne, et fut le secrétaire général de Danton, ministre de la justice. Lui qui devait plus tard dresser contre la Terreur de si éloquents réquisitoires, encouragea les premiers excès révolutionnaires et se flatta d'être "le procureur général de la Lanterne" : par son "Histoire des brissotíns" (1793) il contribua à envoyer à la mort les girondins. Quand il voulut prêcher la clémence, il était trop tard : il fut victime à son tour de la violence qu'il avait déchaînée, et ne montra pas devant la mort une âme très stoïque
"SUSPECTS" (Le Vieux Cordelier, n°3, Frimaire an II)
En faisant semblant de tracer le tableau du despotisme ombrageux des Césars, Camille Desmoulins flétrit, dans ces pages éloquentes et pleines de citations ou d'imitations de Tacite, le terrorisme révolutionnaire et, en particulier, la fameuse loi des Suspects établie par la Convention le 17 septembre 1793.
"Il y avait anciennement à Rome, dit Tacite, une loi qui spécifiait les crimes d'Etat et de lèse-majesté et portait peine capitale. Ces crimes de lèse-majesté, sous la république, se réduisaient à quatre sortes : si une armée avait été abandonnée en pays ennemi; si l'on avait excité des séditions; si les membres des corps constitués avaient mal administré les affaires ou les deniers publics; si la majesté du peuple romain avait été avilie. Les empereurs n'eurent besoin que de quelques articles additionnels à cette loi, pour envelopper les citoyens et les cités entières dans la proscription. Auguste fut le premier extendeur de cette loi de lèse-majesté en comprenant les écrits qu'il appelait contre-révolutionnaires. Bientôt les extensions n'eurent plus de bornes. Dès que les propos furent devenus des crimes d'Etat, il n'y eut plus qu'un simple pas à faire pour changer en crimes les simples regards, la tristesse, la compassion, les soupirs, le silence même.... Tout donnait de l'ombrage au tyran. Un citoyen avait-il de la popularité? C'était un rival du prince, qui pouvait susciter une guerre civile. Studia civium in se verteret, el si multi idem audeant, bellum esse (s'attirait-il la faveur du peuple, et beaucoup d'ambitieux suivaient-ils son exemple? C'était la guerre)? Suspect.
Fuyait-on au contraire la popularité, et se tenait-on au coin de son feu? Cette vie retirée vous avait fait remarquer, vous avez fait donner de la considération. Quanto metu occultior, tanto plus famae adeptus (plus dans sa pridence, il s'est tenu caché, plus il a acquis de prestige). Suspect.
Etiez-vous riche? ll y avait péril imminent que le peuple ne fût corrompu par vos largesses. Aurí vim atque opes Plauti, principi infensas (Beaucoup d'or et la puissance de Plautus, autant de menaces pour l'empereur). Suspect.
Étiez-vous pauvre? Comment donc! Invincible empereur, il faut surveiller de près cet homme. ll n'y a personne d'entreprenant comme celui qui n'a rien. Syllam inopem, unde praecipuam audaciam (la pauvreté de Sylla était la source principale de son aidace). Suspect.
Etiez-vous d'un caractère sombre, mélancolique, ou mis en négligé? Ce qui vous affligeait, c'est que les alfaires publiques allaient bien. Hominem publicis bonis maestum (un homme attristé du bonheur public). Suspect.
Si au contraire un citoyen se donnait du bon temps, il ne se divertlssait que parce que l'empereur avait eu cette attaque de goutte qui heureusement ne serait rien; il fallait lui faire sentir que S. M. était encore dans la vígueur de l'âge. Reddendam pro intempestiva licentia maestam et funebrem noctem qua sentiat vivere Vitellium et imperare(Pour pris de sa débauche intempestive, il mérite des nuits tristes et lugubres qui lui rappelleront que Vitelius vit encore et gouverne). Suspect.
Était-il vertueux et austère dans les mœurs? Bon! nouveau Brutus, qui prétendait par sa pâleur et sa perruque de jacobin faire la censure d'une cour aimable et bien frisée. Gliscere aemulos Brutorum vultus rigidi et tristis qui tibi lasciviam exprobent (on voit se multiplier les émules de Brutus, au viaage sévère et grave, vivant reproche de tes moeurs dissolues). Suspect...
Et tous ces suspects sous les empereurs n'en étaient pas quittes comme chez nous pour aller aux Irlandais ou à Sainte-Pélagie. Le prince leur envoyait l'idée de faire venir leur médecin, et de choisir, dans les vingt-quatre heures, le genre de mort qui leur plairait le plus. Missus centurio qui maturaret eum (on envoya un centurion pour le presser)..."
LE COMITÉ DE CLÉMENCE (Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier, n° IV, 30 frimaire an III)
Au risque de passer pour modéré et pour suspect, Camille Desmoulins demanda dans le 4e numéro de son Vieux Cordelier qu'on mît fin à l'effusion du sang par l'institution d'un Comité de clémence. Michelet raconta dans son Histoire de la Révolution l'émotion que causa dans Paris la publication de ce numéro, Quelques mois plus tard, il paya de sa vie cette courageuse proposition...
"Non, la liberté, descendue du ciel, ce n'est point une nymphe de l'Opéra, ce n'est point un bonnet rouge, une chemise sale ou des haillons. La liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est la déclaration des droits, c'est votre sublime Constitution! Voulez-vous que je la reconnaisse, que je tombe à ses pieds, que je verse tout mon sang pour elle? Ouvrez les prisons à ces deux cent mille citoyens que vous appelez suspects; car, dans la déclaration des droits, il n'y a point de maison de suspicion, il n'y a que des maisons d'arrêt. Le soupçon n'a point de prisons, mais l'accusateur public; il n'y a point de gens suspects, il n'y a que des prévenus de délits fixés par la loi. Et ne croyez pas que cette mesure serait funeste à la République. Ce serait la mesure la plus révolutionnaire que vous eussiez jamais prise. Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine! Mais y eut-il jamais plus grande folie? Pouvez-vous en faire périr un seul à l'échafaud, sans vous faire dix ennemis de sa famille ou de ses amis? Croyez-vous que ce soient ces femmes, ces vieillards, ces cacochymes, ces égoïstes, ces traînards de la Révolution, que vous enfermez, qui sont dangereux?
De vos ennemis, il n'est resté parmi vous que les lâches et les malades. Les braves et les forts ont émigré. lls ont péri à Lyon ou dans la Vendée ; tout le reste ne mérite pas votre colère...
Que de bénédictions s'élèveraient alors de toutes parts! Je pense bien différemment de ceux qui vous disent qu'il faut laisser la terreur à l'ordre du jour. Je suis certain, au contraire, que la liberté serait consolidée, et l'Europe vaincue, si vous aviez un Comité de Clémence" (Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier, n° IV)

Entré le 30 mai 1793 au Comité de salut public de Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794),
élu à 25 ans député à la Convention (septembre 1792), remarqué par son éloquence et la rigidité de ses principes, demandant l'exécution sans jugement du roi, et prônant une république égalitaire et vertueuse. Le jeune conventionnel possède le secret de ces formules brèves et saisissantes qui ne sont souvent que du Jean- Jacques Rousseau concentré. En voici quelques-unes qui participent à la fois du Credo et du Code: "La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans. Elle ne prendra point les armes pour asservir un peuple et l'opprimer. Elle ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. Les étrangers, la foi du commerce et des traités, l'hospitalité, la paix, la souveraineté des peuples sont choses sacrées. La patrie d'un peuple libre est ouverte à tous les hommes de la terre. Le peuple français vote la liberté du monde."
Entré le 30 mai 1793 au Comité de salut public, il est, comme Robespierre, partisan d'une République centralisatrice, égalitaire et vertueuse. Porte-parole du Comité devant la Convention, Saint-Just se charge de présenter plusieurs rapports, sur les Girondins, sur le gouvernement révolutionnaire, sur les Anglais, sur la confiscation des biens des suspects, sur l'arrestation d'Hérault de Séchelles, sur Danton, sur la police générale.
Au lendemain de la chute de la Gironde, il est celui qui dénonce comme danger menaçant la Révolution, la paralysie qu'engendre le développement excessif des administrations. C'est le célèbre discours du 10 octobre 1793, selon lequel la pesanteur bureaucratique entrave l'action de la République. «Les lois sont révolutionnaires ; ceux qui les exécutent ne le sont pas.... ». Après avoir dénoncé les fédéralistes girondins (juillet 1793), puis les factions hébertiste et dantoniste (mars-avril 1794). Il fait voter les décrets de ventôse (février-mars 1794) confisquant les biens des ennemis de la République pour les distribuer aux patriotes pauvres. Entraîné dans la chute de Robespierre, il est exécuté le 10 thermidor (28 juillet 1794). «Que la République soit pure ou qu'elle meure», pensait le jeune Saint-Just. Mais en sacrifiant Danton, Robespierre et Saint-Just allaient rendre possible la catastrophe de Thermidor : «Ils ne devinèrent pas, eux qui voulaient consolider la République, qu'abattre Danton, c'était enlever une des colonnes de l'édifice ; avec lui le triomphe de la République était assuré dans l'avenir; il en eût été la force; Robespierre, l'âme et la pensée; Saint-Just, la puissance d'organisation» (Ernest Hamel).
Octobre 1793 - Arrêtés à la suite des journées du 31 mai et du 2 juin 1793 pendant lesquelles la Convention fut tenue assiégée par les gardes nationaux dévoués à Marat, les principaux chefs girondins (Vergniaud, Brissot, Ducos, Fonfrède) sont condamnés par le tribunal révolutionnaire, où siège Fouquier-Tinville, qui fait office de ministère public, et exécutés le 31 octobre.
Une politique de "déchristianisation", comportant la substitution d'un calendrier révolutionnaire au calendrier traditionnel en octobre 1793, et la fermeture de nombreuses églises, fut appliquée malgré l'opposition de Robespierre. Le calendrier révolutionnaire, qui restera en vigueur treize ans, commençait à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre, et comprenait douze mois de trente jours dont les noms, dus à Fabre d'Eglantine, évoquaient les saisons : vendémíaire était le mois des vendanges, brumaire celui des brumes, frimaire celui des frimas, nivôse celui des neiges, pluviôse celui des pluies, ventôse celui des vents, germínal celui de la germination, floréal celui des fleurs, prairíal celui des prairies, messidor celui des moissons, thermidor celui de la chaleur, et fructidor celui des fruits. Les fêtes chrétiennes étaient abolies...
18 novembre 1793 - Robespierre, Rapport sur la situation politique de la République (27 brumaire an II)...
Robespierre était entré au Comité de salut public le 26 juillet 1793. Quelques mois après, il était chargé, par le Comité de présenter à la Convention une situation politique de la République et sur l'attitude des diverses puissances étrangères, un rapport complet, vaste tableau des répercussions de la Révolution française dans le monde et des luttes que la liberté devait soutenir pour s'affermir et triompher. Le plan diplomatique de l'Angleterre pour étouffer la Révolution et pour susciter contre la France toutes les nations de l'Europe ne pouvait en effet être déjoué que s'il était entièrement connu et mis en lumière. Robespierre exposa, dans tous ses détails, la politique extérieure du Comité de salut public et les dangers auxquels elle avait à faire face. Il donna lecture de son rapport dans la séance du 27 brumaire an II (18 novembre 1793). Ce rapport eut un retentissement immense, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, où il contribua à faire considérer Robespierre comme le grand homme d'État de la République. La Convention en ordonna l'impression et l'envoi aux départements. La plupart des journaux le reproduisirent, et l'un d'eux, "La Feuille du salut public", le fit précéder de ces commentaires : « Nos lecteurs nous sauront gré de leur donner, de préférence à tous autres articles, le rapport de Robespierre sur notre situation à l'égard des puissances étrangères. Dans un pays libre, c'est un devoir pour tous les hommes d'être instruits des affaires publiques, et rien ne peut contribuer davantage à cette instruction nécessaire qu'un rapport dans lequel la grandeur des idées, la profondeur de la politique s'unissent à la clarté des développements et à la précision du style. Qu'elle est sublime, l'éloquence républicaine! C'est celle de la vérité; ses accents éclairent et consolent l'ami de l'humanité, et portent l'effroi dans l'âme des tyrans, dont elle déjoue l'infâme machiavélisme. »
"La Révolution française a donné une secousse au monde. Les élans d'un grand peuple vers la liberté devaient déplaire aux rois qui l'entouraient. Mais il y avait loin de cette disposition secrète à la résolution périlleuse de déclarer la guerre au peuple français, et surtout à la ligue monstrueuse de tant de puissances essentiellement divisées d'intérêts.
Pour les réunir, il fallait la politique de deux cours dont l'influence dominait toutes les autres; pour les enhardir, il fallait l'alliance du roi même des Français, et les trahisons de toutes les factions qui le caressèrent et le menacèrent tour à tour pour régner sous son nom ou pour élever un autre tyran sur les débris de sa puissance.
Les temps qui devaient enfanter le plus grand des prodiges de la raison, devaient aussi être souillés par les derniers excès de la corruption humaine. Les crimes de la tyrannie accélérèrent les progrès de la liberté, et les progrès de la liberté multiplièrent les crimes de la tyrannie, en redoublant ses alarmes et ses fureurs. Il y a eu, entre le peuple et ses ennemis, une réaction continuelle, dont la violence progressive a opéré en peu d'années l'ouvrage de plusieurs siècles.
Il est connu aujourd'hui de tout le monde que la politique du cabinet de Londres contribua beaucoup à donner le premier branle à notre révolution. Ses projets étaient vastes ; il voulait, au milieu des orages politiques, conduire la France épuisée et démembrée à un changement de dynastie, et placer le duc d'York sur le trône de Louis XVI. Ce. projet devait être favorisé par les intrigues et par la puissance de la maison d'Orléans, dont le chef, ennemi de la cour de France, était depuis longtemps étroitement lié avec celle d'Angleterre...."
5 décembre 1793 - Ce n'était pas seulement par la violence militaire ou par les intrigues diplomatiques que les rois coalisés cherchaient à réduire la France. Ils jetaient en même temps contre elle des manifestes destinés à diviser l'opinion, à détourner de nous les puissances neutres et à représenter la France, aux yeux du monde, comme un foyer de désordre et d'anarchie. Devant ces attaque?, le Comité de salut public chargea Robespierre de rédiger et de présenter en son nom à la Convention un contre-manifeste qui fût une réponse de la République à la coalition des rois. Le 15 frimaire an II (5 décembre 1793), Robespierre donna lecture, à la tribune de la Convention, d'un court rapport suivi d'un projet de réponse. L'un et l'autre furent accueillis avec enthousiasme. L'Assemblée décréta leur impression, leur distribution, ainsi que leur traduction dans toutes les langues ...
25 décembre 1793 (5 nivôse an II), Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, fait au nom du Comité de salut public par Maximilien Robespierre...
La Constitution de 1793, bien qu'adoptée par la Convention, n'était pas mise en vigueur. Le 19 vendémiaire (10 octobre), Saint-Just avait présenté, au nom du Comité de salut public, un rapport où il demandait, en raison de l'état de guerre et de l'agitation permanente des factions de l'intérieur, que le gouvernement fût déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix. Les mesures proposées par Saint-Just furent décrétées; mais il restait encore à définir ce qu'était le gouvernement révolutionnaire, de quels principes il devait s'inspirer, vers quel but il devait tendre. C'est ce que Robespierre fut chargé par le Comité de salut public d'exposer à la Convention. Les diverses conclusions qu'il proposait furent adoptées au milieu des applaudissements de L'Assemblée..
".. Vaincre des Anglais et des traîtres est une chose facile à la valeur de nos soldats républicains ; il est une entreprise non moins importante et plus difficile: c'est de confondre par une énergie constante les intrigues éternelles de tous les ennemis de notre liberté, et de faire triompher les principes sur lesquels doit s'asseoir la prospérité publique.
Tels sont les premiers devoirs que vous avez imposés à votre Comité de salut public.
Nous allons développer d'abord les principes et la nécessité du gouvernement révolutionnaire; nous montrerons ensuite la cause qui tend à le paralyser dans sa naissance.
La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amené. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques, qui n'ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans, qui, contents d'abuser de leur puissance, s'occupent peu d'en rechercher la légitimité; aussi ce mot n'est-il pour l'aristocratie qu'un sujet de terreur ou un texte de calomnie ; pour les tyrans, qu'un scandale ; pour bien des gens, qu'une énigme; il faut l'expliquer à tous, pour rallier au moins les bons citoyens aux principes de l'intérêt public.
La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution.
Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder.
La révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis; la constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible.
Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé à déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour des dangers nouveaux et pressants.
Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile; et le gouvernement révolutionnaire, de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre l'abus de la puissance publique; sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent.
Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.
Ces notions suffisent pour expliquer l'origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires ; ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. S'ils invoquent l'exécution littérale des adages constitutionnels, ce n'est que pour les violer impunément. Ce sont de lâches assassins qui, pour égorger sans péril la République au berceau, s'efforcent de la garrotter avec des maximes vagues, dont ils savent bien se dégager eux-mêmes.
Le vaisseau constitutionnel n'a point été construit pour rester toujours dans le chantier; mais fallait-il le lancera la mer au fort de la tempête, et sous l'influence des vents contraires? C'est ce que voulaient les tyrans et les esclaves qui s'étaient opposés à sa construction ; mais le peuple français vous a ordonné d'attendre le retour du calme. Ses vœux unanimes, couvrant tout à coup les clameurs de l'aristocratie et du fédéralisme, vous ont commandé de le délivrer d'abord de tous ses ennemis.
Les temples des dieux ne sont pas faits pour servir d'asile aux sacrilèges qui viennent les profaner, ni la Constitution pour protéger les complots des tyrans qui cherchent à la détruire.
Si le gouvernement révolutionnaire doit être plus actif dans sa marche et plus libre dans ses mouvements que le gouvernement ordinaire, en est-il moins juste et moins légitime? Non. Il est appuyé sur la plus sainte de toutes les lois, le salut du peuple; sur le plus irréfragable de tous les titres, la nécessité.
Il a aussi ses règles, toutes puisées dans la justice et dans l'ordre public. Il n'a rien de commun avec l'anarchie, ni avec le désordre ; son but, au contraire, est de les réprimer, pour amener et pour affermir le règne des lois. Il n'a rien de commun avec l'arbitraire; ce ne sont point les passions particulières qui doivent le diriger, mais l'intérêt public.
Il doit se rapprocher des principes ordinaires et généraux, dans tous les cas où ils peuvent être rigoureusement appliqués sans compromettre la liberté publique. La me- sure de sa force doit être l'audace ou la perfidie des conspirateurs. Plus il est terrible aux méchants, plus il doit être favorable aux bons. Plus les circonstances lui imposent des rigueurs nécessaires, plus il doit s'abstenir des mesures qui gênent inutilement la liberté et qui froissent les intérêts privés, sans aucun avantage public.
Il doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l'excès : le modérantisme, qui est à la modération ce que l'impuissance est à la chasteté; et l'excès, qui ressemble à l'énergie comme l'hydropisie à la santé.
Les tyrans ont constamment cherché à nous faire reculer vers la servitude, parles routes du modérantisme ; quelque- fois aussi, ils ont voulu nous jeter dans l'extrémité opposée. Les deux extrêmes aboutissent au même point. Que l'on soit en deçà ou au delà du but, le but est également manqué. Rien ne ressemble plus à l'apôtre du fédéralisme que le prédicateur intempestif de la République une et universelle. L'ami des rois et le procureur général du genre humain s'entendent assez bien. Le fanatique couvert de scapulaires et le fanatique qui prêche l'athéisme ont entre eux beaucoup de rapports. Les barons démocrates sont les frères des marquis de Goblentz; et quelquefois les bonnets rouges sont plus voisins des talons rouges qu'on ne pourrait le penser.
Mais c'est ici que le gouvernement a besoin d'une extrême circonspection; car tous les ennemis de la liberté veillent pour tourner contre lui, non seulement ses fautes, mais même ses mesures les plus sages. Frappe-t-il sur ce qu'on appelle l'exagération? Ils cherchent à relever le modérantisme et l'aristocratie. S'il poursuit ces deux monstres, ils poussent de tout leur pouvoir à l'exagération. Il est dangereux de leur laisser les moyens d'égarer le zèle des bons citoyens; il est plus dangereux encore de décourager et de persécuter les bons citoyens qu'ils ont trompés. Par l'un de ces abus, la République risquerait d'expirer dans un mouvement convulsif; par l'autre, elle périrait infailliblement de langueur.
Que faut-il donc faire? Poursuivre les inventeurs coupables des systèmes perfides, protéger le patriotisme, même dans ses erreurs, éclairer les patriotes, et élever sans cesse le peuple à la hauteur de ses droits et de ses destinées.
Si vous n'adoptez cette règle, vous perdez tout.
S'il fallait choisir entre un excès de ferveur patriotique et le néant de l'incivisme, ou le marasme du modérantisme, il n'y aurait pas à balancer. Un corps vigoureux, tourmenté par une surabondance de sève, laisse plus de ressources qu'un cadavre...."
Décembre 1793 - les Montagnards transforment donc peu à peu la Convention en un véritable "gouvernement révolutionnaire", coordonnant en décembre 1793 l'action des Comités (de Salut public et de Sûreté générale), du Tribunal révolutionnaire et des Représentants en mission; ils prirent en outre des mesures militaires et économiques rigoureuses : levée en masse, loi du maximum taxant les objets de première nécessité, loi contre l'accaparement.
Enfin, ils "placèrent la Terreur à l'ordre du jour", pour "éliminer tous les opposants" qui pouvaient être arrêtés sans délai par application de la loi «des suspects» du 17 septembre. Le Tribunal révolutionnaire multiplia les condamnations à mort; la reine Marie-Antoinette, le duc d'Orléans, Mme Roland, inspiratrice des Girondins, furent exécutés...




Alarmé cependant par l'ampleur de la violence, André Chénier (1762-1794) publie dans le Journal de Paris, du 12 novembre 1791 au 26 juillet 1792, un "Avis au peuple français sur ses véritables ennemis, L'esprit de parti, Les Autels de la peur"", dans lequel il fustige les Jacobins et Girondins. Il en vient à collaborer à la défense de Louis XVI. Après l'exécution du roi, il se retire à Versailles, où désormais suspect, il vit plusieurs mois caché. Il est arrêté à Passy le 7 mars 1794. Enfermé dès lors dans la prison de Saint-Lazare, il y compose ses plus beaux vers, les "Iambes"... Ironie du sort, il est guillotiné deux jours avant la chute de Robespierre, le 25 juillet 1794.
La jeune Captive (les Elégies)
Incarcéré à Saint-Lazare, alors que Chénier attend la mort, le regard du poète se porte sur l'une de ses compagnes de captivité, la belle Aimée de Coigny, duchesse de Fleury, qui, par ailleurs, plus heureuse que lui, échappera à la guillotine. On a pu y voir un exercice littéraire à la mode du temps malgré le contexte dramatique...
« L'épi naissant mûrit de la faux respecté;
Sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été
Boit les doux présents de l'aurore ;
Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui,
Quoi que l'heure présente ait de trouble et d'ennui,
Je ne veux point mourir encore.
Qu'un stoïque aux yeux secs vole embrasser la mort :
Moi je pleure et j'espère. Au noir souffle du nord
Je plie et relève ma tête.
S'il est des jours amers, il en est de si doux !
Hélas! quel miel jamais n'a laissé de dégoûts?
Quelle mer n'a point de tempête?
L'illusion féconde habite dans mon sein.
D'une prison sur moi les murs pèsent en vain,
J'ai les ailes de l'espérance.
Échappée aux réseaux de l'oiseleur cruel,
Plus vive, plus heureuse, aux campagnes du ciel
Philomèle chante et s'élance.
Est-ce à moi de mourir? Tranquille je m'endors
Et tranquille je veille ; et ma veille aux remords
Ni mon sommeil ne sont en proie.
Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux ;
Sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux
Ranime presque de la joie.
Mon beau voyage encore est si loin de sa fin !
Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin
J'ai passé les premiers à peine.
Au banquet de la vie à peine commencé,
Un instant seulement mes lèvres ont pressé
La coupe en mes mains encor pleine.
Je ne suis qu'au printemps. Je veux voir la moisson,
Et comme le soleil, de saison en saison,
Je veux achever mon année.
Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin,
Je n'ai vu luire encor que les feux du matin,
Ie veux achever ma journée.
O mort! tu peux attendre ; éloigne, éloigne-toi;
Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi,
Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès encore a des asiles verts,
Les amours des baisers, les Muses des concerts;
Je ne veux point mourir encore
Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait, écoutant ces plaintes, cette ,voix,
Ces vœux d'une jeune captive ;
Et secouant le faix de mes jours languissants,
Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.
Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des loisirs studieux
Chercher quelle fut cette belle :
La grâce décorait son front et ses discours,
Et comme elle craindront de voir finir leurs jours
Ceux qui les passeront près d'elle.
Les derniers vers d'A. Chénier (Contre ses ennemis) ont dû être écrits quelques jours avant son exécution, puisqu'il eut le temps de les faire parvenir à sa famille. Mais son premier éditeur, Hyacinthe de Latouche, prétendit qu'il avait composé ce poème peu d'instants avant d'aller au supplice, et l'interrompit après le quinzième vers, pour laisser croire que l'appel du geôlier avait brusquement interrompu le poète. Les "Iambes" constitue la part de son oeuvre la plus personnelle, on y voit combien le poète aimait ardemment la liberté...
"Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphire
Animent la fin d'un beau jour,
Au pied de l'échafaud j'essaye encor ma lyre.
Peut-être est-ce bientôt mon tour.
Peut-être avant que l'heure en cercle promenée
Ait posé sur l'émail brillant,
Dans les soixante pas où sa route est bornée,
Son pied sonore et vigilant ;
Le sommeil du tombeau pressera ma paupière.
Avant que de ses deux moitiés
Ce vers que je commence ait atteint la dernière,
Peut-être en ces murs effrayés
Le messager de mort, noir recruteur des ombres,
Escorté d'infâmes soldats,
Ébranlant de mon nom ces longs corridors sombres
Où seul dans la foule à grands pas
J'erre, aiguisant ces dards persécuteurs du crime,
Du juste trop faibles soutiens,
Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime ;
Et chargeant mes bras de liens,
Me traîner, amassant en foule à mon passage
Mes tristes compagnons reclus,
Qui me connaissaient tous avant l'affreux message,
Mais qui ne me connaissent plus...
Vienne, vienne la mort ! - Que la mort me délivre
Ainsi donc mon cœur abattu
Cède au poids de ses maux? Non, non. Puissé-je vivre!
Ma vie importe à la vertu...
S'il est écrit aux cieux que jamais une épée
N'étincellera dans mes mains ;
Dans l'encre et l'amertume une autre arme trempée
Peut encor servir les humains.
Justice, Vérité, si ma main, si ma bouche,
Si mes pensers les plus secrets
Ne froncèrent jamais votre sourcil farouche,
Et si les infâmes progrès,
Si la risée atroce, ou, plus atroce injure,
L'encens de hideux scélérats
Ont pénétré vos cœurs d'une large blessure;
Sauvez-moi. Conservez un bras
Qui lance votre foudre, un amant qui vous venge.
Mourir sans vider mon carquois !
Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange
Ces bourreaux barbouilleurs de lois !
Ces vers cadavéreux de la France asservie,
Égorgée! O mon cher trésor,
O ma plume! fiel, bile, horreur, Dieux de ma vie!
Par vous seuls je respire encor...
Nul ne resterait donc pour attendrir l'histoire
Sur tant de justes massacrés?
Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire,
Pour que des brigands abhorrés
Frémissent aux portraits noirs de leur ressemblance,
Pour descendre jusqu'aux enfers
Nouer le triple fouet, le fouet de la vengeance
Déjà levé sur ces pervers?
Pour cracher sur leurs noms, pour chanter leur supplice?
Allons, étouffe tes clameurs;
Souffre, ô cœur gros de haine, affamé de justice.
Toi, Vertu, pleure si je meurs.
Chénier de son vivant n'aura publié que deux textes en vers, une ode, le Jeu de paume (1791), dédiée au peintre David et saluant le geste des états généraux, et un Hymne aux Suisses de Châteauvieux en 1792. Mais il laisse une masse de manuscrits. Ses œuvres sont partiellement publiées à partir de 1819 par H. de Latouche et les éditions se succèdent au cours du XIXe s. ...
Les travaux de la Convention durant l'an III (du 22 septembre 1794 au 22 septembre 1795) , un singulier chantier culturel...
La Convention est associée à la Terreur, mais mènera ses guerres avec succès, et réorganisera l'enseignement public en profondeur. Sur le rapport de Lakanal, il est décrété que l'enseignement primaire doit se doter en France d'une école par mille habitants (27 brumaire an III), l'enseignement secondaire voit établir une école centrale par trois cent mille habitants (7 ventôse an III), et globalement le 3 brumaire an IV, est rendu un grand décret d'ensemble sur l'organisation de l'instruction publique qui fixe trois ordres d'enseignement, écoles primaires, écoles centrales, écoles spéciales. Elle créera une Ecole centrale des travaux publics (7 vendémiaire an III), qui deviendra l'Ecole polytechnique; le 9 brumaire an III, elle établit les écoles normales; le 14 frimaire, des écoles de santé à Paris, Montpellier et Strasbourg; le 10 germinal, l'Ecole des langues orientales vivantes; le 7 messidor, le Bureau des longitudes; le 16 thermidor, le Conservatoire de musique. Le 30 vendémiaire an IV, elle fixera définitivement l'organisation de services publics. Ajoutons à cela, le Conservatoire des arts et métiers (19 vendémiaire an III); les Ecoles révolutionnaires de navigation et de canonnage maritime (11 nivôse an III), les Ecoles d'économie rurale vétérinaire à Lyon et à Versailles (29 germinal an III)...
La Convention fixe le nouveau système des poids et mesures (18 germinal an III), donne le nom de franc à l'unité monétaire et règle le titre et la fabrication de la monnaie d'argent et de la petite monnaie (28 thermidor an III). En matière religieuse, elle déclare que l'Etat ne salariait plus aucun culte; sépare les Eglises de l'Etat et réglemente l'exercice extérieur des cultes (dès l'an II (18 septembre 1794), le 3 ventôse, 11 prairial an III, et 7 vendémiaire an IV). En matière d'administration, elle rétablit les administrations départementales telles qu'elles existaient avant le 31 mai 1793 (28 germinal an III). Dans l'ordre économique et financier, en dehors des lois sur les assignats, elle supprime le maximum (4 nivôse an III), fixe les règles de la comptabilité (28 pluviôse an III), décrète le code hypothécaire (9 messidor an IlI), réglemente les patentes (4 thermidor an III). Dans l'ordre judiciaire, elle réorganise le tribunal de cassation (2 brumaire an IV) et le tribunal correctionnel de Paris (19 vendémiaire an IV), et décrétait le code des délits et des peines (3 brumaire an IV)....
Danton, séance du 6 février 1794 de la Convention - Sur l'abolition de l'esclavage...
"Représentants du peuple français, jusqu'ici nous n'avions décrété la liberté qu'en égoïstes et pour nous seuls. Mais aujourd'hui nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle.
Hier, lorsque le président donna le baiser fraternel aux députés de couleur, je vis le moment où la Convention devait décréter la liberté de nos frères. La séance était trop nombreuse. La Convention vient de faire son devoir. Mais après avoir accordé le bienfait de la liberté, il faut que nous en soyons pour ainsi dire les modérateurs. Renvoyons au comité de salut public et des colonies, pour combiner les moyens de rendre ce décret utile à l'humanité, sans aucun danger pour elle. Nous avions déshonoré notre gloire en tronquant nos travaux. Les grands principes développés par le vertueux Las Casas avaient été méconnus. Nous travaillons pour les générations futures, lançons la liberté dans les colonies, c'est aujourd'hui que l'Anglais est mort. [On applaudit.) En jetant la liberté dans le Nouveau Monde, elle y portera des fruits abondants, elle y poussera des racines profondes. En vain Pitt et ses complices voudront par des considérations politiques écarter la jouissance de ce bienfait, ils vont être entraînés dans le néant, la France va reprendre le rang et l'influence que lui assurent sou énergie, son sol et sa population. Nous jouirons nous-mêmes de notre générosité, mais nous ne retendrons point au delà des bornes de la sagesse. Nous abattrons les tyrans comme nous ayons écrasé les hommes perfides qui voulaient faire rétrograder la révolution. Ne perdons point notre énergie, lançons nos frégates, soyons sûrs des bénédictions de l'univers et de la postérité, et décrétons le renvoi des mesures à l'examen du comité..."
Au début de 1794, Danton s'oppose à la continuation de la Terreur.
Désapprouvant totalement la politique extrémiste des hébertistes, Danton, à son retour de province, voit dans leur chef l'homme à abattre. Il veut mettre un terme aux violences (« Je demande qu'on épargne le sang des hommes » ; « mieux vaut cent fois être guillotiné que guillotineur »). Sous son influence, Camille Desmoulins fonde le Vieux Cordelier, qui fait campagne pour la clémence...
26 février 1794 - Saint-Just présente au nom du Comité de salut public et du Comité de sûreté générale à la Convention nationale à la séance du 8 ventôse an II son rapport sur les personnes incarcérées. Un mouvement se manifestait, depuis quelques mois, contre les procédés terroristes instaurés par le Comité de Salut Public. Robespierre et Saint-Just, considérés comme tout-puissants dans ce Comité, étaient plus particulièrement visés. On leur imputait le redoublement d'activité du Tribunal révolutionnaire, les exécutions chaque jour plus nombreuses, les emprisonnements en masse et les traitements rigoureux imposés aux personnes incarcérées. A la tête de ce mouvement, de cette faction, connue sous le nom de «faction des Indulgents», se trouvaient Danton, Camille Desmoulins, Fabre dEglantine, etc.
Ces conventionnels, jusque-là amis de Robespierre et de Saint- Just, voulurent-ils, comme ils le disaient, un adoucissement des mesures de sévérité employées par le Comité ? Ou bien, faut-il croire avec Saint-Just et Robespierre, que Danton et ses amis s'étaient laissé gagner par les intrigues et les offres de l'étranger et qu'ils trahissaient désormais la République ?
"... Vous avez voulu une République; si vous ne vouliez point en même temps ce qui la constitue, elle ensevelirait le peuple sous ses débris. Ce qui constitue une République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. On se plaint des mesures révolutionnaires ! Mais nous sommes des modérés, en comparaison de tous les autres gouvernements.
En 1778, Louis XVI fit immoler huit mille personnes de tout âge, de tout sexe, dans Paris, dans la rue Mêlée et sur le Pont-Neuf. La cour renouvela ces scènes au Champ-de-Mars; la cour pendait dans les prisons; les noyés que l'on ramassait dans la Seine étaient ses victimes; il y avait quatre cent mille prisonniers; l'on pendait par an quinze mille contrebandiers; on rouait trois mille hommes; il y avait dans Paris plus de prisonniers qu'aujourd'hui.
Dans les temps de disette, les régiments marchaient contre le peuple. Parcourez l'Europe : il y a dans l'Europe quatre millions de prisonniers, dont vous n'entendez pas les cris, tandis que votre modération parricide laisse triompher tous les ennemis de votre gouvernement. Insensés que nous sommes, nous mettons un luxe métaphysique dans l'étalage de nos principes, et les rois, mille fois plus cruels que nous, dorment dans le crime.
Citoyens, par quelle illusion persuaderait-on que vous êtes inhumains ? Votre tribunal révolutionnaire a fait périr trois cents scélérats depuis un an : et l'Inquisition d'Espagne n'en a-t-elle pas fait plus ? et pour quelle cause, grand Dieu ! Et les tribunaux d'Angleterre n'ont-ils égorgé personne cette année ? Et Bender, qui faisait rôtir les enfants des Belges î Et les cachots de l'Allemagne, où le peuple est enterré, on ne vous en parle point ! Parle-t-on de clémence chez les rois d'Europe ? Non : ne vous laissez point amollir.
La Cour de Londres, qui craint la guerre, semble l'ennemie de la paix; elle affecte une contenance qui en impose au peuple anglais : mais si vous vous montrez rigides, si vous vous constituez l'Etat, et si le poids de votre politique écrase tous les partisans et comprime ses combinaisons, le lendemain du jour où elle aura paru la plus éloignée de la paix, la plus confiante dans sa force, la plus superbe dans ses prétentions, elle vous proposera la paix.
N'avez-vous point le droit de traiter les partisans de la tyrannie comme on traite ailleurs les partisans de la liberté ? Seriez-vous sages même, si vous en agissiez autrement ? On a tué Marat et banni Margarot, dont on a confisqué les biens : tous les tyrans en ont marqué leur joie; craindrions-nous de perdre leur estime en nous montrant aussi politiques qu'eux ?
Citoyens, on arrête en vain l'insurrection de l'esprit humain; elle dévorera la tyrannie; mais tout dépend de notre exemple et de la fermeté de nos mesures.
Apparemment il se trame quelque attentat, sur l'issue duquel les rois comptent, puisqu'ils se montrent insolents après leurs défaites. Peut-on supposer même qu'ils ont renoncé à leurs projets et à celui de nous perdre ? On ne peut le croire sans doute, à moins qu'on ne soit insensé. Supputez maintenant quels sont ceux qui trahissent, en pesant tout au poids du bon sens : sont-ce ceux qui vous donnent des conseils sévères, ou ceux qui vous en donnent d'indulgents ?
La monarchie, jalouse de son autorité, nageait dans le sang de trente générations; et vous balanceriez à vous montrer sévères contre une poignée de coupables ? Ceux qui demandent la liberté des aristocrates ne veulent point la République, et craignent pour eux.
C'est un signe éclatant de trahison que la pitié que l'on fait paraître pour le crime, dans une République qui ne peut être assise que sur l'inflexibilité. Je défie tous ceux qui parlent en faveur de l'aristocratie détenue de s'exposer à l'accusation publique dans un tribunal. La voix des criminels et des hommes tarés et corrompus peut-elle être comptée dans le jugement de leurs pareils?
Soit que les partisans de l'indulgence se ménagent quelque reconnaissance de la part de la tyrannie, si la République était subjuguée, soit qu'ils craignent qu'un degré de plus de chaleur et de sévérité dans l'opinion et dans les principes ne les consume, il est certain qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, conduit le dessein de nous faire rétrograder, ou de nous opprimer; et nous nous gouvernons comme si jamais nous n'avions été trahis, comme si nous ne pouvions plus l'être ! La confiance de nos ennemis nous avertit de nous préparer à tout, et d'être inflexibles.
La première loi de toutes les lois est la conservation de la République; et ce n'est point sous ce rapport que les questions les plus délicates sont souvent ici examinées. Des considérations secrètes entraînent les délibérations; la justice est toujours considérée sous le rapport de la faiblesse et d'une clémence cruelle, sans qu'on prenne la peine de juger si le parti que l'on propose entraîne la ruine de l'Etat. La justice n'est pas clémence; elle est sévérité.
Il est une secte politique dans la France qui joue tous les partis; elle marche à pas lents. Parlez- vous de la terreur, elle vous parle de clémence; devenez- vous cléments, elle vous vante la terreur; elle veut être heureuse et jouir; elle oppose la perfection au bien, la prudence à la sagesse.
Ainsi, dans un gouvernement où la morale n'est point rendue pratique par des institutions fortes qui rendent le vice difforme, la destinée publique change au gré du bel esprit et des passions dissimulées.
Eprouvons-nous des revers, les indulgents prophétisent des malheurs; sommes-nous vainqueurs, on en parle à peine. Dernièrement, on s'est moins occupé des victoires de la République que de quelques pamphlets; et tandis qu'on détourne le peuple des mâles objets, les auteurs des complots criminels respirent et s'enhardissent.
On distrait l'opinion des plus purs conseils, et le peuple français de sa gloire, pour l'appliquer à des querelles polémiques. Ainsi, Rome sur son déclin, Rome dégénérée, oubliant ses vertus, allait voir au cirque combattre des bêtes; et, tandis que le souvenir de tout ce qu'il y a de grand et de généreux parmi nous semble obscurci, les principes de la liberté publique peu à peu s'effacent, ceux du gouvernement se relâchent; et c'est ce que l'on veut pour accélérer notre perte. L'indulgence est pour les conspirateurs, et la rigueur est pour le peuple.
On semble ne compter pour rien le sang de deux cent mille patriotes répandu et oublié; on en a fait un mémoire; on est vertueux par écrit, il suffit; on s'exempte de probité; on s'est engraissé des dépouilles du peuple, on en regorge, et on l'insulte, et l'on marche en triomphe, traîné par le crime, pour lequel on prétend exciter votre compassion : car enfin on ne peut garder le silence sur l'impunité des plus grands coupables, qui veulent briser l'échafaud, parce qu'ils craignent d'y monter.
C'est le relâchement de ces maximes, dont l'âpreté nécessaire est chaque jour combattue, qui cause les malheurs publics; c'est lui qui fait disparaître l'abondance, et nous trouble de plus en plus, sous le prétexte de tranquillité. Chacun immole le bonheur public au sien; le pauvre pousse la charrue et défend la Révolution; beaucoup d'emplois sont pour des fripons enrichis par la liberté, et pour des comptables qui font la guerre à la justice.
C'est ce relâchement qui vous demande l'ouverture des prisons, et vous demande en même temps la misère, l'humiliation du peuple et d'autres Vendées. Au sortir des prisons, ils prendront les armes, n'en doutez pas. Si l'on eût arrêté, il y a un an, tous les royalistes, vous n'auriez point eu de guerre civile.
La même conjuration semble s'ourdir pour les sauver, qui s'ourdit autrefois pour sauver le roi. Je parle ici dans la sincérité de mon cœur; rien ne m'a paru jamais si sensible que ce rapprochement. La monarchie n'est point un roi, elle est le crime; la république n'est point un sénat, elle est la vertu. Quiconque ménage le crime veut rétablir la monarchie et immoler la liberté.
Et après que, par la noirceur d'une inertie hypocrite, on a altéré la prospérité et la force du gouvernement, on vient déclamer contre lui. Il me semble voir une immense chaîne autour du peuple français, dont les tyrans tiennent un bout et la faction des indulgents tient l'autre, pour nous serrer. On tourne en sophismes toutes les questions les plus simples, pour vous entraver : c'est ainsi que Vergniaud, vous voyant déterminés à donner une constitution à la République, mit tout le droit public en problèmes, et vous proposa une série de questions à résoudre, que l'on eût mis un siècle à discuter.
On imite parfaitement cette conduite, lorsqu'on vous propose d'examiner les détentions selon des principes de mollesse; par là, on vous embarrasse dans un luxe de sentiments faux, on sépare la législation et le sentiment du bien public. Et les fripons, et les tyrans, et les ennemis de la Patrie sont-ils donc à vos yeux dans la nature, ô vous qui réclamez en son nom pour eux ?
Notre but est de créer un ordre de choses tel qu'une pente universelle vers le bien s'établisse, tel que les factions se trouvent tout à coup lancées sur l'échafaud, tel qu'une mâle énergie incline l'esprit de la nation vers la justice, tel que nous obtenions dans l'intérieur le calme nécessaire pour fonder la félicité du peuple; car il n'y a, comme au temps de Brissot, que l'aristocratie et l'intrigue qui se remuent : les sociétés populaires ne sont point agitées, les armées sont paisibles, le peuple travaille; ce sont donc tous les ennemis qui s'agitent seuls, et qui s'agitent pour renverser la révolution.
Notre but est d'établir un gouvernement sincère, tel que le peuple soit heureux, tel enfin que. la sagesse et la Providence éternelle présidant seules à l'établissement de la République, elle ne soit plus chaque jour ébranlée par un forfait nouveau.
Les révolutions marchent de faiblesse en audace et de crime en vertu. Il ne faut point que l'on se flatte d'établir un solide empire sans difficultés; il faut faire une longue guerre à toutes les prétentions; et, comme l'intérêt humain est invincible, ce n'est guère que par le glaive que la liberté d'un peuple est fondée.
Il s'éleva, dans le commencement de la Révolution, des voix indulgentes en faveur de ceux qui la combattaient : cette indulgence, qui ménagea pour lors quelques coupables, a, depuis, coûté la vie à deux cent mille hommes dans la Vendée; cette indulgence nous a mis dans la nécessité de raser des villes; elle a exposé la Patrie à une ruine totale; et si, aujourd'hui, vous vous laissiez aller à la même faiblesse, elle vous coûterait un jour trente ans de guerre civile...."

"Jacques-René Hébert, Pierre-Gaspard Chaumette, François-Nicolas Vincent et Jean-Baptiste Gobel sont conduits en charrette à la guillotine le 24 ventôse an II (14 mars 1794)" - Pierre Gabriel Berthault (1737–1831) - Bibliothèque nationale de France.
Après la chute d'Hébert, en mars 1794, Robespierre se retourne contre Danton et Desmoulins : après les « ultras », il faut abattre les « ultras » révolutionnaires. Pour l'aider dans cette tâche, il a appelé à Paris Saint-Just, alors aux armées.
Danton a le tort d'être lié avec de douteux personnages, en particulier avec Fabre d'Eglantine, un fripon notoire compromis dans l'affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes. L'Incorruptible est heureux, à travers Fabre, d'attaquer son grand rival. Autour de lui, d'autres réclament la tête du tribun : « Nous viderons ce gros turbot farci », s'écrie le Montagnard Vadier.
Danton est averti du terrible rapport que Saint-Just prépare contre lui, mais il refuse de fuir : « On n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. » Le 30 mars 1794, Danton est arrêté comme ennemi de la République, ainsi que Desmoulins, Hérault de Séchelles et plusieurs autres. Seul Legendre essaie timidement, mais en vain, de le défendre à la Convention. À son procès, Danton n'a aucune peine à démentir les accusations portées contre lui. L'éloquence de ses dénégations est telle que l'assistance, d'abord hostile, commence à se retourner en sa faveur. Sur la demande de l'accusateur public, Fouquier-Tinville, Saint-Just obtient de la Convention un décret de mise hors la loi des accusés, qui seront ainsi jugés sans être entendus, et finalement condamnés à mort. Le 5 avril, Danton monte sur l'échafaud avec treize autres condamnés...
"Citoyens, écrit saint-Just dans son rapport "sur la conjuration de Fabre d'Eglantine, Danton, Philippeaux, Lacroix et Camille Desmoulins", la révolution est dans le peuple et non point dans la renommée de quelques personnages. Cette idée vraie est la source de la justice et de l'égalité dans un Etat libre; elle est la garantie du peuple contre les hommes artificieux qui s'érigent en quelque sorte en patriciens, par leur audace et leur impunité.
Il y a quelque chose de terrible dans l'amour sacré de la patrie; il est tellement exclusif qu'il immole tout sans pitié, sans frayeur, sans respect humain, à l'intérêt public; il précipite Manlius; il immole ses affections privées; il entraîne Régulus à Carthage, jette un Romain dans un abîme, et met Marat au Panthéon, victime de son dévouement.
Vos Comités de salut public et de sûreté générale, pleins de ce sentiment, m'ont chargé de vous demander justice au nom de la patrie, contre des hommes qui trahissent depuis longtemps la cause populaire., qui vous ont fait la guerre avec tous les conjurés, avec d'Orléans, avec Brissot, avec Hébert, avec Hérault et leurs complices, et conspirent en ce moment avec les rois ligués contre la République; qui ont favorisé le projet de vous détruire et de confondre le gouvernement républicain, ont été les défenseurs des traîtres et vos ennemis déclarés, et qui, pour échapper à la justice, prétendent que l'on vous attaque en eux. Ils ne témoignaient point cet intérêt pour vous, lorsqu'ils demandaient l'impunité de vos assassins et votre renouvellement, qui eût été suivi de votre perte et de celle de la liberté....
... Les mêmes hommes qui s'étaient efforcés, dès le commencement de la Révolution, de la borner à un changement de dynastie, se retrouvent encore à la tête de ces factions dont le but était de vous immoler.
C'est ici que la patience échappe au juste courroux de la vérité. Quoi ! quand toute l'Europe, excepté nous, qui sommes aveugles, est convaincue que Lacroix et Danton ont stipulé pour la royauté; quoi î quand les renseignements pris sur Fabre d'Eglantine, le complice de Danton, ne laissent plus de doute sur sa trahison; lorsque l'ambassadeur du peuple français en Suisse nous mande la consterna- tion des émigrés depuis la mise en jugement de Fabre, l'ami de Danton, nos yeux refuseraient encore de s'ouvrir !
Danton, tu répondras à la justice inévitable, inflexible. Voyons ta conduite passée, et montrons que depuis le premier jour, complice de tous les attentats, tu fus toujours contraire au parti de la liberté, et que tu conspirais avec Mirabeau, avec Dumouriez, avec Hébert, avec Hérault-Séchelles.
Danton, tu as servi la tyrannie : tu fus. il est vrai, opposé à Lafayette; mais Mirabeau, d'Orléans, Dumouriez, lui furent opposés de même. Oserais-tu nier avoir été vendu à ces trois hommes, les plus violents conspirateurs contre la liberté ? Ce fut par la protection de Mirabeau que tu fus nommé administrateur du département de Paris, dans le temps où l'assemblée électorale était décidément royaliste. Tous les amis de Mirabeau se vantaient hautement qu'ils t'avaient fermé la bouche. Aussi tant qu'a vécu ce personnage affreux, tu es resté presque muet. Dans ce temps-là tu reprochas à un patriote rigide, dans un repas, qu'il compromettait la bonne cause, en s'écartant du chemin où marchaient Barnave et Lameth, qui abandonnaient le parti populaire.
Dans les premiers éclairs de la Révolution, tu montras à la Cour un front menaçant; tu parlais contre elle avec véhémence. Mirabeau, qui méditait un changement de dynastie, sentit le prix de ton audace; il te saisit.
Tu t'écartas dès lors des principes sévères, et l'on n'entendit plus parler de toi jusqu'au massacre du Champ-de-Mars. Alors tu appuyas aux Jacobins la motion de Laclos, qui fut un prétexte funeste et payé par les ennemis du peuple pour déployer le drapeau rouge et essayer la tyrannie. Les patriotes, qui n'étaient pas initiés dans ce complot, avaient com- battu inutilement ton opinion sanguinaire.
Tu fus nommé rédacteur, avec Brissot, de la pétition du Champ-de-Mars, et vous échappâtes à la fureur de Lafayette, qui fit massacrer deux mille patriotes. Brissot erra, depuis, paisiblement dans Paris; et toi, tu fus couler d'heureux jours à Arcis-sur-Aube, si toutefois celui qui conspirait contre sa patrie pouvait, être heureux. Le calme de ta retraite à Arcis-sur-Aube se conçoit-il ? Toi, l'un des auteurs de la pétition, tandis que ceux qui l'avaient signée avaient été, les uns chargés de fers, les autres massacrés, Brissot et toi étiez-vous donc des objets de reconnaissance pour la tyrannie, puis- que vous n'étiez point pour elle des objets de haine et de terreur ?
Que dirai-je de ton lâche et constant abandon de la cause publique au milieu des crises, où tu prenais toujours le parti de la retraite ?
Mirabeau mort, tu conspiras avec les Lameth, et tu les soutins. Tu restas neutre pendant l'Assemblée législative, et tu te tus dans la lutte pénible des Jacobins avec Brissot et la faction de la Gironde. Tu appuyas d'abord leur opinion sur la guerre; pressé ensuite par les reproches des meilleurs citoyens, tu déclaras que tu observais les deux partis, et tu te renfermas dans le silence.
Lié avec Brissot au Champ-de-Mars, tu partageas ensuite sa tranquillité et ses opinions liberticides ; alors, livré entièrement à ce parti vainqueur, tu dis de ceux qui s'y refusaient que, puisqu'ils restaient seuls de leur avis sur la guerre, et que puisqu'ils se voulaient perdre, tes amis et toi deviez les abandonner à leur sort.
Mais quand tu vis l'orage du 10 août se préparer, tu te retiras encore à Arcis-sur-Aube. Déserteur des périls qui entouraient la liberté, les patriotes n'espéraient plus te revoir.
Cependant, pressé par la honte, par les reproches, et quand tu sus que la chute de la tyrannie était bien préparée et inévitable, tu revins à Paris le 9 août. Tu te couchas dans cette nuit terrible. Ta section, qui t'avait nommé son président, t'attendit longtemps; on t'arracha d'un repos honteux; tu présidas une heure; tu quittas le fauteuil à minuit, quand le tocsin sonnait; au même instant les satellites du tyran entrèrent et mirent la baïonnette sur le cœur de celui qui t'avait remplacé : toi, tu dormais !
Dans ce moment, que faisait Fabre, ton complice et ton ami ? Tu l'as dit toi-même : il parlementait avec la Cour pour la tromper. Mais la Cour pouvait-elle se fier à Fabre sans un gage certain de sa vénalité et sans des actes très évidents de sa haine pour le parti populaire ? Quiconque est l'ami d'un homme qui a parlementé avec la Cour est coupable de lâcheté. L'esprit a des erreurs; les erreurs de la conscience sont des crimes.
Mais qu'as-tu fait depuis pour nous prouver que Fabre, ton complice, et toi, aviez voulu tromper la Cour ? Votre conduite depuis a été celle de conjurés. Quand tu étais ministre, il s'agissait d'envoyer un ambassadeur à Londres pour resserrer l'alliance des deux peuples ; Noël, journaliste contre-révolutionnaire, fut offert par le ministre Lebrun; tu ne t'y opposas point ; on te le reprocha comme une faiblesse; tu répondis ; « Je sais que Noël ne vaut rien, mais je le fais accompagner par un de mes parents. » Quelle a été la suite de cette ambassade criminelle? La guerre concertée et les trahisons.
Ce fut toi qui fis nommer Fabre et d'Orléans à l'Assemblée électorale, où tu vantas le premier comme un homme très adroit, et où tu dis du second que, prince du sang, sa présence au milieu des représentants du peuple leur donnerait plus d'importance aux yeux de l'Europe. Chabot vota en faveur de Fabre et de d'Orléans. Tu enrichis Fabre pendant ton ministère. Fabre professait alors hautement le fédéralisme et disait qu'on diviserait la France en quatre parties.
Roland, partisan de la royauté, voulut passer la Loire pour chercher la Vendée; toi, rester à Paris, où était d'Orléans, et où tu favorisais Dumouriez. Tu donnas des ordres pour sauver Duport; il s'échappa au milieu d'une émeute concertée à Melun par tes émissaires, pour fouiller une voiture d'armes. Malouet et l'évêque d'Autun étaient souvent chez toi; tu les favorisas.
Le parti de Brissot accusa Marat; tu te déclaras son ennemi : tu t'isolas de la Montagne dans les dangers qu'elle courait. Tu te fis publiquement un mérite de n'avoir jamais dénoncé Gensonné, Guadet et Brissot; tu leur tendais sans cesse l'olivier, gage de ton alliance avec eux contre le peuple et les républicains sévères. La Gironde te fit une guerre feinte. Pour te forcer à te prononcer, elle te demanda des comptes; elle t'accusa d'ambition. Ton hypocrisie prévoyante concilia tout et sut se maintenir au milieu des partis, toujours prêt à dissimuler avec le plus fort, sans insulter au plus faible.
Dans les débats orageux, on s'indignait de ton absence et de ton silence; toi, tu parlais de la cam- pagne, des délices de la solitude et de la paresse : mais tu savais sortir de ton engourdissement pour défendre Dumouriez, Westermann, sa créature vantée, et les généraux ses complices...."
Le 5 avril 1794, Camille Desmoulins et Danton sont exécutés...
Le 31 mars 1794, Camille Desmoulins est arrêté : il veut, avec Danton et ceux qui le soutiennent, les indulgents, arrêter la Terreur, négocier la paix et ouvrir "les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects". Exclu des débats à la demande de Saint-Just, il est condamné à mort. Le 1er avril, il écrit une lettre déchirante à sa femme...
L'action de Robespierre - Robespierre dut lutter a l'assemblée même, à la fois contre les extrémistes de gauche ou Hébertistes (Hébert, rédacteur du Père Duchesne), et ceux de droite ou "Indulgents" qui, groupés autour de Danton, Desmoulins et Fabre d'Églantine, souhaitaient un apaisement de la Terreur : il fit arrêter et guillotiner les principaux Hébertistes, puis les Dantonistes. Parmi ces Dantonistes guillotinés le 5 avril de cette année, se trouvait Camille Desmoulins. Homme doux et clément, il fut une des nombreuses victimes du fanatisme aveugle de la Révolution qui ne sut pas épargner ceux-là même qui l'avaient aidée à naître : "comme Camille Desmoulins manquait de caractère, écrira saint Just, on se servit de son orgueil. Il attaqua en rhéteur le gouvernement révolutionnaire dans toutes ses conséquences; il parla effrontément en faveur des ennemis de la Révolution, proposa pour eux un comité de clémence; se montra très inclément pour le parti populaire; attaqua, comme Hébert et Vincent, les représentants du peuple dans les armées; comme Hébert, Vincent et Buzot, lui-même il les traita de proconsuls...". Quatre jours avant sa mort, Camille Desmoulins écrivait une lettre émouvante à sa femme Lucile (qui devait être guillotinée quelques jours après son mari pour avoir tenté de le faire évader) :
Camille Desmoulins en prison - Les adieux déchirants à sa femme.
Copie de ma lettre qui ne te sera peut-être point parvenue. 1er avril 1794...
"Le sommeil bienfaisant a suspendu mes maux: on n'a pas le sentiment de sa captivité, on est libre quand on dort. Le ciel a eu pitié de moi. ll n'y a qu'un moment, je te voyais en songe, je vous embrassais tour à tour, toi, Horace et Daronne, qui était à la maison; mais notre petit avait perdu un œil ou je voyais comme une taie : ma douleur de cet accident m'a réveillé.
Je me suis retrouvé dans un cachot: il faisait un peu de jour. Ne pouvant plus te voir, ô ma Lolotte, et vous entendre; car toi et ta mère vous me parliez, et Horace ne pensant point à son mal disait: papa, papa (ah! les cruels qui m'arrachent le plaisir d'entendre ces mots, et de te rendre heureuse, ce qui faisait toute mon ambition et ma seule conspiration), je me suis levé au moins pour te parler et t'écrire. Mais ouvrant ma fenêtre, la pensée de ma solitude, les affreux barreaux, les verrous qui me séparent de toi ont vaincu toute ma fermeté d'âme. J'ai fondu en larmes ou plutôt j'ai sangloté en criant dans mon tombeau: Lucile! Lucile! Ô ma chère Lucile l...
J'ai découvert une fente à mon appartement; j'ai appliqué mon oreille, j'ai entendu gémir; j'ai hasardé quelques paroles, j'ai entendu la voix d'un malade qui souffrait; il m'a demandé mon nom. Je le lui ai dit: "O mon Dieu! s'est-il écrié en retombant sur son lit, je suis Fabre d'Eglantine. Mais toi ici? la contre-révolution est donc faite?" Nous n'osons cependant nous parler, de peur que la haine ne nous envie cette faible consolation, et que, si on venait à nous entendre, nous ne fussions séparés et resserrés plus étroitement...
Dans ce moment les commissaires du tribunal révolutionnaire viennent de m'interroger. Ils m'ont fait cette question: si j'avais conspiré contre la république. Quelle dérision! et peut-on ainsi insulter au républicanisme le plus pur ! Je vois le sort qui m'attend. Adieu, ma Lucile, ma chère Lolotte, mon Lou; dis adieu à mon père, écris-lui, tu vois en moi un exemple de la barbarie et de l'ingratitude des hommes. Tu vois que mes craintes étaient fondées, que mes pressentiments furent toujours vrais.
Mes derniers moments ne te déshonoreront point. J'étais né pour te rendre heureuse, pour nous composer, avec ta mère et mon père, et quelques hommes selon notre cœur, un Otaïti. J'ai fait des songes de l'abbé de Saint-Pierre. J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée, je ne pouvais penser que les hommes fussent si injustes et si féroces. Comment croire que quelques plaisanteries dans mes écrits, contre des collègues qui m'avaient provoqué, effaceraient le souvenir de tant de services! Je ne me dissimule point que je meurs victime de ces plaisanteries et de mon amitié pour le malheureux Danton...
Vis pour mon Horace, parle-lui de moi, je ne le baiserai plus, il ne dira plus: adi, adi, il ne me rappellera plus par ses pleurs quand j'allais à la Convention. Ah! ma chère Lucile, avais-je raison de te dire tant de fois: Que ne suis-je avec toi dans une cabane, ignoré et pauvre?
Malgré mon supplice, je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, les faiblesses de l'humanité; et ce que j'ai eu de bon, mes vertus, mon amour de la patrie, sans doute ce Dieu le récompensera. Je te reverrai dans l'Elysée, ô Lucile, ô Annette. Bon et sensible comme je l'étais, la mort qui me délivre de la vue de tant de crimes, est-elle un si grand malheur?
Adieu, Loulou; adieu, mon bon soutien; adieu, ma vie, mon âme, ma divinité sur la terre. Je te laisse de bons amis, tout ce qu'il y a d'hommes vertueux et humains. Adieu, Lucile, ma Lucile! ma chère Lucile! Adieu, Horace, Annette, Adèle! Dis adieu à ton père, au mien, à ma mère, à ma famille. Je vois s'enfuir devant moi le rivage de la vie, je vois encore Lucile, je la vois ma bien-aimée! oui, te voilà! mes mains liées t'embrassent, mon cœur palpite encore pour toi, et ma tête séparée ouvre encore ses yeux mourants sur Lucile." 19 germínal. Ton Camille (Camille Desmoulins.)

7 mai 1794, Rapport fait au nom du Comité de salut public, par Maximilien Robespierre, sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fêtes nationales.
Séance du 18 floréal, l'an second de la République française une et indivisible. Les excès des hébertistes menaçaient d'aggraver d'une guerre religieuse les luttes politiques des factions. Dans les départements, certains représentants en mission se faisaient un titre de gloire de leur intolérance et de leur fanatisme antireligieux. Pour arrêter ces désordres, dont les conséquences pouvaient mettre en jeu l'existence même de la République, Robespierre et le Comité de salut public décidèrent de présenter à la Convention un rapport sur les idées religieuses et morales qui étaient liées aux principes républicains. Ce rapport, qui préparait et annonçait la fête à l'Être suprême, fut entendu dans la séance du 18 floréal (7 mai) et y souleva un enthousiasme qui se répercuta dans toute la France. Non seulement la Convention adopta par acclamation le décret qui lui était proposé, mais elle ordonna l'impression du rapport, ainsi que celle du plan de fête à l'Être suprême présenté par David...
"C'est dans la prospérité que les peuples, ainsi que les particuliers, doivent, pour ainsi dire, se recueillir pour écouter, dans le silence des passions, la voix de la sagesse. Le moment où le bruit de nos victoires retentit dans l'univers est donc celui où les législateurs de la République française doivent veiller, avec une nouvelle sollicitude, sur eux-mêmes et sur la patrie, et affermir les principes sur lesquels doivent reposer la stabilité et la félicité de la République.
Nous venons aujourd'hui soumettre à votre méditation des vérités profondes qui importent au bonheur des hommes, et vous proposer des mesures qui en découlent naturellement.
Le monde moral, beaucoup plus encore que le monde physique, semble plein de contrastes et d'énigmes. La nature nous dit que l'homme est né pour la liberté, et l'expérience des siècles nous montre l'homme esclave. Ses droits sont écrits dans son cœur, et son humiliation dans l'histoire. Le genre humain respecte Caton, et se courbe sous le joug de César. La postérité honore la vertu de Brutus ; mais elle ne la permet que dans l'histoire ancienne. Les siècles et la terre sont le partage du crime et de' la tyrannie; la liberté et la vertu se sont à peine reposées un instant sur quelques points du globe. Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses...
Ne dis pas cependant, ô Brutus, que la vertu est un fantôme! Et vous, fondateurs de la République française, gardez-vous de désespérer de l'humanité, ou de douter un moment du succès de votre grande entreprise!
Le monde a changé, il doit changer encore. Qu'y a-t-il de commun entre ce qui est et ce qui fut? Les nations civilisées ont succédé aux sauvages errants dans les déserts; les moissons fertiles ont pris la place des forêts antiques qui couvraient le globe. Un monde a paru au delà des bornes du monde; les habitants de la terre ont ajouté les mers à leur domaine immense ; l'homme a conquis la foudre et conjuré celle du ciel. Comparez le langage imparfait des hiéroglyphes avec les miracles de l'imprimerie; rapprochez le voyage des Argonautes de celui de La Pérouse ; mesurez la distance entre les observations astronomiques des mages de l'Asie et les découvertes de Newton, ou bien entre l'ébauche tracée par la main de Dibutade et les tableaux de David.
Tout a changé dans l'ordre physique; tout doit changer dans l'ordre moral et politique. La moitié de la révolution du monde est déjà faite; l'autre moitié doit s'accomplir.
La raison de l'homme ressemble encore au globe qu'il habite ; la moitié en est plongée dans les ténèbres, quand l'autre est éclairée. Les peuples de l'Europe ont fait des progrès étonnants dans ce qu'on appelle les arts et les sciences, et ils semblent dans l'ignorance des premières notions de la morale publique. Ils connaissent tout, excepté leurs droits et leurs devoirs.
D'où vient ce mélange de génie et de stupidité? De ce que. pour cherchera se rendre habile dans les arts, il ne faut que suive ses passions, tandis que, pour défendre ses droits et respecter ceux d'autrui, il faut les vaincre. Il en est une autre raison : , c'est que les rois qui font le destin de la terre ne craignent ni les grands géomètres, ni les grands peintres, ni les grands poètes, et qu'ils redoutent les philosophes rigides et les défenseurs de l'humanité.
Cependant le genre humain est dans un état violent qui ne peut être durable. La raison humaine marche depuis longtemps contre les trônes, à pas lents, et par des routes détournées, mais sûres. Le génie menace le despotisme alors même qu'il semble le caresser; il n'est plus guère défendu que par l'habitude et par la terreur, et surtout par l'appui que lui prête la ligue des riches et de tous les oppresseurs subalternes qu'épouvante le caractère imposant de la révolution française. ,
Le peuple français semble avoir devancé de deux mille ans le reste de l'espèce humaine ; on serait tenté même de le regarder, au milieu d'elle, comme une espèce différente. L'Europe est à genoux devant les ombres des tyrans que nous punissons.
En Europe, un laboureur, un artisan est un animal dressé pour les plaisirs d'un noble; en France, les nobles cherchent à se transformer en laboureurs et en artisans, et ne peuvent pas même obtenir cet honneur.
L'Europe ne conçoit pas qu'on puisse vivre sans rois, sans nobles;- et nous, que l'on puisse vivre avec eux.
L'Europe prodigue son sang pour river les chaînes de l'humanité, et nous pour les briser. Nos sublimes voisins entretiennent gravement l'univers de la santé du roi, de ses divertissements, de ses voyages; ils veulent absolument apprendre à la postérité à quelle heure il a dîné, à quel moment il est revenu de la chasse, quelle est la terre heureuse qui, à chaque instant du jour, eut l'honneur d'être foulée par ses pieds augustes, quels sont les noms des esclaves privilégiés qui ont paru en sa présence, au lever, au coucher du soleil.
Nous lui apprendrons, nous, les noms et les vertus des héros morts en combattant pour la liberté; nous lui apprendrons dans quelle terre les derniers satellites des tyrans ont mordu la poussière; nous lui apprendrons à quelle heure a sonné le trépas des oppresseurs du monde.
Oui, cette terre délicieuse que nous habitons, et que la nature caresse avec prédilection, est faite pour être le domaine de la liberté et du bonheur; ce peuple sensible et fier est vraiment né pour la gloire et pour la vertu. O ma patrie! si le destin m'avait fait naître dans une contrée étrangère et lointaine, j'aurais adressé au ciel des vœux continuels pour ta prospérité; j'aurais versé des larmes d'attendrissement au récit de tes combats et de tes vertus; mon âme attentive aurait suivi avec une inquiète ardeur tous les mouvements de ta glorieuse révolution ; j'aurais envié le sort de tes citoyens, j'aurais envié celui de tes représentants. Je suis Français, je suis l'un de tes représentants... peuple sublime! reçois .le sacrifice de tout mon être; heureux celui qui est né au milieu de toi! plus heureux celui qui peut mourir pour ton bonheur!
O vous, à qui il a confié ses intérêts et sa puissance, que ne pouvez-vous pas avec lui et pour lui! Oui. vous pouvez montrer au monde le spectacle nouveau de la démocratie affermie dans un vaste empire. Ceux qui, dans l'enfance du droit public, et du sein de la servitude, ont balbutié des maximes contraires, prévoyaient-ils les prodiges opérés depuis un an? Ce qui vous reste à faire est-il plus difficile que ce que vous avez fait? Quels sont les politiques qui peuvent vous servir de précepteurs ou de modèles ? Ne faut-il pas que vous fassiez précisément tout le contraire de ce qui a été fait avant vous? L'art de gouverner a été jusqu'à nos jours l'art de tromper et de corrompre les hommes : il ne doit être que celui de les éclairer et de les rendre meilleurs.
Il y a deux sortes d'égoïsme : l'un, vil, cruel, qui isole l'homme de ses semblables, qui cherche un bien-être exclusif acheté par la misère d'autrui; l'autre, généreux, bienfaisant, qui confond notre bonheur dans le bonheur de tous, qui attache notre gloire à celle de la patrie. Le premier fait les oppresseurs et les tyrans ; le second, les défenseurs de l'humanité. Suivons son impulsion salutaire : chérissons le repos acheté par de glorieux travaux : ne craignons point la mort qui les couronne, et nous consoliderons le bonheur de notre patrie et même le nôtre.
Le vice et la vertu font les destins de la terre : ce sont les deux génies opposés qui se la disputent. La source de l'un et de l'autre est dans les passions de l'homme. Selon la direction qui est donnée à ses passions, l'homme s'élève jusqu'aux cieux ou s'enfonce dans des abîmes fangeux. Or, le but de toutes les institutions sociales, c'est de les diriger vers la justice, qui est à la fois le bonheur public et le bonheur privé.
Le fondement unique de la société civile, c'est la morale ! Toutes les associations qui nous font la guerre reposent sur le crime : ce ne sont aux yeux de la vérité que des hordes de sauvages policés et de brigands disciplinés. A quoi se réduit donc cette science mystérieuse de la politique et de la législation? A mettre dans les lois et dans l'administration les vérités morales reléguées dans les livres des philosophes, et à appliquer à la conduite des peuples les notions triviales de probité que chacun est forcé d'adopter pour sa conduite privée, c'est-à-dire à employer autant d'habileté à faire régner la justice que les gouvernements en ont mis jusqu'ici à être injustes impunément ou avec bienséance....



De l'utilité de l'idée de l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme, selon Robespierre...
"Ne consultez que le bien de la patrie et les intérêts de l'humanité. Toute institution, toute doctrine qui console et qui élève les âmes doit être accueillie ; rejetez toutes celles qui tendent à les dégrader et à les corrompre. Ranimez, exaltez tous les sentiments généreux et toutes les grandes idées morales qu'on a voulu éteindre; rapprochez par le charme de l'amitié et par le lien de la vertu les hommes qu'on a voulu diviser. Qui donc t'a donné la mission d'annoncer au peuple que la Divinité n'existe pas, ô toi qui te passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne te passionnas jamais pour la patrie? Quel avantage trouves-tu à persuader à l'homme qu'une force aveugle préside à ses destinées et frappe au hasard le crime et la vertu, que son âme n'est qu'un souffle léger qui s'éteint aux portes du tombeau?
L'idée de son néant lui inspirera-t-elle des sentiments plus purs et plus élevés que celle de son immortalité? Lui inspirera-t-elle plus de respect pour ses semblables et pour lui-même, plus de dévouement pour la patrie, plus d'audace à braver la tyrannie, plus de mépris pour la mort ou pour la volupté? Vous qui regrettez un ami vertueux, vous aimez à penser que la plus belle partie de lui-même a échappé au trépas! Vous qui pleurez sur le cercueil d'un fils ou d'une épouse, êtes-vous consolé par celui qui vous dit qu'il ne reste plus d'eux qu'une vile poussière? Malheureux qui expirez sous les coups d'un assassin, votre dernier soupir est un appel à la justice éternelle! L'innocence sur l'échafaud fait pâlir le tyran sur son char de triomphe : aurait-elle cet ascendant, si le tombeau égalait l'oppresseur et l'opprimé? Malheureux sophiste! de quel droit viens-tu arracher à l'innocence le sceptre de la raison, pour le remettre dans les mains du crime, jeter un voile funèbre sur la nature, désespérer le malheur, réjouir le vice, attrister la vertu, dégrader l'humanité?
Plus un homme est doué de sensibilité et de génie, plus il s'attache aux idées qui agrandissent son être et qui élèvent son cœur; et la doctrine des hommes de cette trempe devient celle de l'univers. Eh! comment ces idées ne seraient-elles point des vérités? Je ne conçois pas du moins comment la nature aurait pu suggérer à l'homme des fictions plus utiles que toutes les réalités; et si l'existence de Dieu, si l'immortalité de l'âme n'étaient que des songes, elles seraient encore la plus belle de toutes les conceptions de l'esprit humain.
Je n'ai pas besoin d'observer qu'il ne s'agit pas ici de faire le procès à aucune opinion philosophique en particulier, ni de contester que tel philosophe peut être vertueux, quelles que soient ses opinions, et même en dépit d'elles, par la force d'un naturel heureux ou d'une raison supérieure. Il s'agit de considérer seulement l'athéisme comme national, et lié à un système de conspiration contre la République.
Eh! que vous importent à vous, législateurs, les hypothèses diverses par lesquelles certains philosophes expliquent les phénomènes de la nature? Vous pouvez abandonner tous ces objets à leurs disputes éternelles : ce n'est ni comme métaphysiciens, ni comme théologiens, que vous devez les envisager. Aux yeux du législateur, tout ce qui est utile au monde et bon dans la pratique, est la vérité. L'idée de l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la justice; elle est donc sociale et républicaine. La Nature a mis dans l'homme le sentiment du plaisir et de la douleur qui le force à fuir les objets physiques qui lui sont nuisibles, et à chercher ceux qui lui conviennent. Le chef-d'œuvre de la société serait de créer en lui, pour les choses morales, un instinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât à faire le bien et à éviter le mal; car la raison particulière de chaque homme, égarée par ses passions, n'est souvent qu'un sophiste qui plaide leur cause, et l'autorité de l'homme peut toujours être attaquée par l'amour-propre de l'homme. Or, ce qui produit ou remplace cet instinct pré- cieux, ce qui supplée à l'insuffisance de l'autorité humaine, c'est le sentiment religieux qu'imprime dans les âmes l'idée d'une sanction donnée aux préceptes de la morale par une puissance supérieure à l'homme. Aussi je ne sache pas qu'aucun législateur se soit jamais avisé de nationaliser l'athéisme; je sais que les plus sages mêmes d'entre eux se sont permis de mêler à la vérité quelques fictions, soit pour frapper l'imagination des peuples ignorants, soit pour les attacher plus fortement à leurs institutions. Lycurgue et Solon eurent recours à l'autorité des oracles; et Socrate lui-même, pour accréditer la vérité parmi ses concitoyens, se crut obligé de leur persuader qu'elle lui était inspirée par un génie familier.
Vous ne conclurez pas de là sans doute qu'il faille tromper les hommes pour les instruire, mais seulement que vous êtes heureux de vivre dans un siècle et dans un pays dont les lumières ne vous laissent d'autre tâche à remplir que de rappeler les hommes à la nature et à la vérité.
Vous vous garderez bien de briser le lien sacré qui les unit à l'auteur de leur être. Il suffit même que cette opinion ait régné chez un peuple, pour qu'il soit dangereux de la détruire. Car les motifs des devoirs et les bases de la moralité s'étant nécessairement liés à cette idée, l'effacer, c'est démoraliser le peuple. Il résulte du même principe qu'on ne doit jamais attaquer un culte établi qu'avec prudence et avec une certaine délicatesse, de peur qu'un changement subit et violent ne paraisse une atteinte portée à la morale, et une dispense de la probité même.
Au reste, celui qui peut remplacer la Divinité dans le système de la vie sociale est à mes yeux un prodige de génie ; celui qui, sans l'avoir remplacée, ne songe qu'à la bannir de l'esprit des hommes, me paraît un prodige de stupidité ou de perversité..."
Estampe de Legrand, Augustin Claude Simon, 1765-1815? - "Réception du décret du 18 floréal an II (7 mai 1794) instaurant la fête de l'Etre suprème : malheur à celui qui cherche à éteindre ce sublime entousiasme le patriotisme élève l'âme et féconde les talens. Offrons nos coeurs à l'Eternel et que nos chants hardis s'élancent vers le ciel : O Dieu puissant, Dieu magnanime..."
Mai 1794 - "INSTITUTION DE FÊTES NATIONALES" - Robespierre au nom du Comité de salut public souhaite donc que l'on instituât la fête A l'Être suprême et à la Nature, Au Genre humain, Au Peuple français, Aux bienfaiteurs de l'humanité, Aux Martyrs de la liberté, A la Liberté et à l'Égalité, A la République, A la liberté du monde, A l'amour de la patrie, A la haine des tyrans et des traîtres, A la Vérité, A la Justice, A la Pudeur, A la Gloire et à l'Immortalité, A l'Amitié, A la Frugalité, Au Courage, A la Bonne Foi, A l'Héroïsme, Au Désintéressement....
Et peu de temps après la fête de la Raison, il condamna solennellement l'athéisme et proclama "l'idée populaire d'un Grand Être qui veille sur l'innocence opprimée et punit le crime triomphant". C'est sur son initiative que la Convention institua le culte de l`Être Suprême...
"...Laissons les prêtres, et retournons à la divinité. Attachons la morale à des bases éternelles et sacrées; inspirons à l'homme ce respect religieux pour l'homme, ce sentiment profond de ses devoirs, qui est la seule garantie du bonheur social; nourrissons-le par toutes nos institutions : que l'éducation publique soit surtout dirigée vers ce but. Vous lui imprimerez sans doute un grand caractère, analogue à la nature de notre gouvernement et à la sublimité des destinées de la République. Vous sentirez la nécessité de la rendre commune et égale pour tous les Français. Il ne s'agit plus de former des messieurs, mais des citoyens : la patrie a seule droit d'élever ses enfants; elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles, ni aux préjugés des particuliers, aliments éternels de l'aristocratie et d'un fédéralisme domestique, qui rétrécit les âmes en les isolant, et détruit, avec l'égalité, tous les fondements de l'ordre social. Mais ce grand objet est étranger à la discussion actuelle.
II est cependant une sorte d'institution qui doit être considérée comme une partie essentielle de l'éducation publique, et qui appartient nécessairement au sujet de ce rapport : je veux parler des fêtes nationales.
Rassemblez les hommes, vous les rendrez meilleurs; car les hommes rassemblés cherchent à se plaire, et ils ne pourront se plaire que par les choses qui les rendent estimables. Donnez à leur réunion un grand motif moral et politique, et l'amour des choses honnêtes entrera avec le plaisir dans tous les cœurs, car les hommes ne se voient pas sans plaisir.
L'homme est le plus grand objet qui soit dans la nature, et le plus magnifique de tous les spectacles c'est celui d'un grand peuple assemblé. On ne parle jamais sans enthousiasme des fêtes nationales de la Grèce; cependant elles n`avaient guère pour objet que des jeux où brillaient la force des corps, l'adresse, ou tout au plus le talent des poètes et des orateurs; mais la Grèce était là; on voyait un spectacle plus grand que les jeux; c'étaient les spectateurs eux-mêmes, c'était le peuple vainqueur de l'Asie, que les vertus républicaines avaient élevé quelquefois au-dessus de l'humanité; on voyait les grands hommes qui avaient sauvé et illustré la patrie; les pères montraient à leurs fils Miltiade, Aristide, Épaminondas, Timoléon, dont la seule présence était une leçon vivante de magnanimité, de justice et de patriotisme.
Combien il serait facile au peuple français de donner à ses assemblées un objet plus étendu et un plus grand caractère! Un système de fêtes nationales bien entendu serait à la fois le plus doux lien de fraternité et le plus puissant moyen de régénération.
Ayez des fêtes générales et plus solennelles pour toute la république; ayez des fêtes particulières et pour chaque lieu, qui soient des jours de repos, et qui remplacent ce que les circonstances ont détruit.
Que toutes tendent à réveiller les sentiments généreux qui font le charme et l'ornement de la vie humaine, l'enthousiasme de la liberté, l'amour de la patrie, le respect des lois ; que la mémoire des tyrans et des traîtres y soit vouée à l'exécration; que celle des héros de la liberté et des bienfaiteurs de l'humanité y reçoive le juste tribut de la reconnaissance publique; qu'elles puisent leur intérêt et leur nom même dans les événements immortels de notre Révolution et dans les objets les plus sacrés et les plus chers au cœur de l'homme; qu'elles soient embellies et distinguées par les emblèmes analogues à leur objet particulier; invitons à nos fêtes et la nature et toutes les vertus; que toutes soient célébrées sous les auspices de l'Être Suprême; qu'elles lui soient consacrées; qu'elles s'ouvrent et qu'elles finissent par un hommage à sa puissance et à sa bonté?" (Robespierre)
J.-J. Rousseau, dont on sait que Robespierre s'inspira, avait écrit auparavant, "Quoi!, dans la Lettre à d'Alembert sur les spectacles, ne faut-il donc aucun spectacle dans une république? Au contraire, il en faut beaucoup... Quels seront les objets de ces spectacles? Qu'y montrera-t-on? Rien, si l'on veut. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux : donnez les spectateurs en spectacle; rendez-les acteurs eux-mêmes; faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis." Et ce fut d'ailleurs là une idée universellement admise pendant toute la période révolutionnaire. Dans les papiers de Mirabeau on a trouvé un projet de discours : Travail sur l'éducation publique, dont la 2° partie est intitulée: Des fêtes publiques, civiles et militaires. L'Assemblée constituante avait inscrit dans la constitution qu' "il serait établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir (le la Révolution française". A la Législative, Condorcet, dans son Plan d'Instructíon publique, signale la nécessité des fêtes nationales. La Convention, dès le début, décrète des fêtes en l'honneur des victoires des armées républicaines. Lakanal leur donne également une place importante dans son Projet d'éducation nationale. Par le décret du 18 floréal an Il, que fit adopter Robespierre, furent instituées quatre fêtes nationales annuelles. Et le décret du 3 brumaire an IV sur l'lnstruction publique en institua sept. Parmi les fêtes, qui furent célébrées pendant la période révolutionnaire, il faut surtout rappeler la fête de la Fédération (14 juillet 1790), la fête en l'honneur du transfert des cendres de Voltaire au Panthéon (11 juillet 1791), la féte de la Liberté (15 avril 1792) en l'honneur des soldats du régiment de Chateauvieux condamnés en 1790 pour leur rébellion, la fête de la Raison (20 brumaire an Il), la fête de l'Être Suprême (20 prairial an Il), la fête en l'honneur du transfert des cendres de J.-J. Rousseau au Panthéon (11 octobre 1791)...

Loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) accélérant la procédure du Tribunal révolutionnaire - L'attentat perpétré contre Collot d'Herbois suscite une vive émotion à la Convention et permet le vote de la terrible loi de Prairial qui accélère la procédure du Tribunal révolutionnaire. Un premier tribunal révolutionnaire, connu sous le titre de tribunal criminel extraordinaire, avait été institué le 17 août 1792. Supprimé en novembre 1792, ce tribunal fut reconstitué le 10 mars 1793, avec mission de connaître de tous les « attentats contre la République ». Il comprenait cinq juges, un accusateur public et douze jurés. L'accusateur public du tribunal reçut, par décret du 5 avril 1793, pouvoir de «faire arrêter, poursuivre et juger tout prévenu des dits crimes» sur une simple dénonciation. Puis les Montagnards reprochèrent au Tribunal révolutionnaire sa lenteur : jusqu'en septembre 1793, il n'avait examiné que deux cent soixante affaires et prononcé soixante-six condamnations à la peine capitale, l'accusateur public, Fouquier-Tinville, fut critiqué. Le rythme des procès s'accéléra à partir de septembre 1793 : cent soixante-dix-sept condamnations à mort furent prononcées entre octobre et décembre 1793 (Marie-Antoinette, les Girondins...). Puis l'on supprima tout interrogatoire de l'accusé avant l'audience publique, on renonça à l'audition de témoins, on écarta défenseurs et plaidoiries. Le Comité de sûreté générale pour discréditer Robespierre accéléra la procédure...
Du 10 juin au 27 juillet 1794, c'est la Grande Terreur ...
1376 exécutions, chiffre à mettre en parallèle avec le total des condamnations à mort prononcées par le Tribunal révolutionnaire (plus de deux mille cinq cents). Mais d'autres juridictions révolutionnaires existaient en dehors du tribunal de Paris et les représentants en mission furent autorisés par la loi du 22 nivôse an II (11 janv. 1794) à transformer les tribunaux criminels en tribunaux révolutionnaires, des tribunaux révolutionnaires et des commissions révolutionnaires furent instituées dans les départements pour juger les rebelles, on comptera 1665 condamnations à mort à Lyon, 392 à Arras, 302 à Orange, 299 à Bordeaux, 289 à Marseille. Donald Greer (The Incidence of the Terror, Cambridge, 1935) détaille la nature de la répression menée par le Tribunal révolutionnaire de Paris et les juridictions départementales : 31% d'ouvriers, 28% de paysans (en rapport avec l'insurrection de la Vendée), 25% de bourgeois, et seulement 9% de nobles et 7% de prêtres...

ROBESPIERRE, LE DISCOURS DU 8 THERMIDOR AN II (26 juillet 1794)
Robespierre, quitte les rivages de l'Être suprême et s'enferme progressivement dans une logique inéluctable qui conduira à sa perte, la haine qu'il suscite et la Terreur qu'il accentue se nourrissent l'une l'autre. Robespierre croit nécessaire de renforcer le régime de la Terreur par la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), qui entraîne un millier d'exécutions, dont celles du chimiste Lavoisier et du poète Chénier; ce durcissement provoque contre lui une conspiration où se regroupent autour de Fouché, Tallien, Barras, anciens représentants en mission, les modérés de la Plaine, les amis de Danton et les Girondins (à la Convention, les Girondins occupaient la droite, les Montagnards l'extrême gauche et la Plaine, appelée aussi le Marais, comprenait tous les modérés et les indécis).
Alors que depuis plusieurs semaines, Robespierre ne paraissait plus au Comité de salut public et tandis que ses ennemis ourdissaient contre lui la trame du complot thermidorien, ralliant les membres du côté droit, ceux de la Plaine, et les anciens amis de Danton, lui. enseveli dans une demi-retraite, ne cherchait ses moyens de défense que dans la force de la vérité. En messidor, l'agent national de la Commune de Paris, Payan, lui écrivait : « Prenez-y garde, les Bourbons et leurs complices s'enveloppent aujourd'hui d'un hypocrite silence, ils tâchent de se sauver à l'aide de l'obscurité où ils se plongent, et ils ont des scélérats qui les aident dans leurs perfides projets .»
De jour en jour, en effet, le complot s'étendait, s'affermissait, et il semble impossible que Robespierre n'en ait point prévu l'issue. Cette coalition de haines était formée d'éléments très divers. Les uns lui reprochaient la Terreur, d'autres au contraire lui reprochaient sa modération, d'autres encore cherchaient à venger sur lui leur parti abattu, la plupart enfin étaient las d'un régime austère qui n'était fondé que sur la vertu. Il y avait, aussi, parmi les membres du Comité de salut public, et parmi les plus ardents Montagnards, des hommes aveuglés, et qui, dès le lendemain du 9 thermidor, s'apercevront du crime auquel ils auront participé et s'accuseront d'avoir tué la République.
Ce fut donc au milieu d'une hostilité silencieuse, mais réelle, que Robespierre prononça à la Convention, dans la séance du 8 thermidor, le plus célèbre peut-être de tous ses discours. Telle était cependant la sincérité émouvante de cette éloquence que l'Assemblée ne put entendre Robespierre sans l'acclamer. L'impression du discours fut même votée, mais, la discussion s'étant engagée sur les accusations qui s'y trouvaient contenues, il fut, en dernière analyse, renvoyé à l'examen des Comités. C'était un échec pour Robespierre, et, dès ce moment, la chute fut certaine. Le soir, il lut son discours à la tribune des Jacobins. Mais les applaudissements enthousiastes qui l'accueillirent ne lui firent pas illusion, et on raconte qu'après avoir lu il ajouta : « Ce discours que vous venez d'entendre est mon testament de mort. Je l'ai vu aujourd'hui, la ligue des méchants est tellement forte que je ne puis espérer de lui échapper. Je succombe sans regret; je vous laisse ma mémoire; elle vous sera chère et vous la défendrez. »
Plus tard, le 30 thermidor an II, sur la demande de Bréard, la Convention ordonna l'impression du discours de Robespierre. Il fut « imprimé, dit Ernest Hamel, sur des brouillons trouvés chez Robespierre, brouillons couverts de ratures et de renvois, ce qui explique les répétitions qui s'y rencontrent ». Finalement battu à la Convention, Robespierre sera arrêté et aussitôt guillotiné avec ses partisans, le 10 thermidor an II (28 juillet 1794)....
"Que d'autres vous tracent des tableaux flatteurs; je viens vous dire des vérités utiles. Je ne viens point réaliser des terreurs ridicules répandues par la perfidie; mais je veux étouffer, s'il est possible, les flambeaux de la discorde par la seule force de la vérité. Je vais défendre devant vous votre autorité outragée et la liberté violée. Je me défendrai aussi moi-même; vous n'en serez point surpris; vous ne ressemblez point aux tyrans que vous combattez. Les cris de l'innocence outragée n'importunent point votre oreille, et vous n'ignorez pas que cette cause ne vous est point étrangère.
Les révolutions qui, jusqu'à nous, ont changé la face des empires, n'ont eu pour objet qu'un changement de dynastie, ou le passage du pouvoir d'un seul à celui de plusieurs La Révolution française est la première qui ait été fondée sur la théorie des droits de l'humanité, et sur les principes de la justice Les autres révolutions n'exigeaient que de l'ambition : la nôtre impose des vertus. L'ignorance et la force les ont absorbées dans un despotisme nouveau : la nôtre, émanée de la justice, ne peut se reposer que dans son sein.
La République, amenée insensiblement par la force des choses et par la lutte des amis de la liberté contre les conspirations toujours renaissantes, s'est glissée, pour ainsi dire, à travers toutes les factions; mais elle a trouvé leur puissance organisée autour d'elle, et tous les moyens d'influence dans leurs mains; aussi n'a-t-elle cessé d'être persécutée dès sa naissance, dans la personne de tous les hommes de bonne foi qui combattaient pour elle; c'est que, pour conserver l'avantage de leur position, les chefs des factions et leurs agents ont été forcés de se cacher sous la forme de la République. Précy à Lyon, et Brissot à Paris, criaient Vive la République! Tous les conjurés ont même adopté, avec plus d'empressement qu'aucun autre, toutes les formules, tous les mots de ralliement du patriotisme. L'Autrichien, dont le métier était de combattre la révolution; l'Orléanais, dont le rôle était de jouer le patriotisme, se trouvèrent sur la même ligne; et l'un et l'autre ne pouvaient plus être distingués du républicain.
Ils ne combattirent pas nos principes, ils les corrompirent; ils ne blasphémèrent point contre la révolution, ils tâchèrent de la déshonorer, sous le prétexte de la servir ; ils déclamèrent contre les tyrans, et conspirèrent pour la tyrannie; ils louèrent la République, et calomnièrent les Républicains. Les amis de la liberté cherchent à renverser la puissance des tyrans par la force de la vérité : les tyrans cherchent à détruire les défenseurs de la liberté par la calomnie; ils donnent le nom de tyrannie à l'ascendant même des principes de la vérité. Quand ce système a pu prévaloir, la liberté est perdue; il n'y a de légitime que la perfidie, et de criminel que la vertu ! ; car il est dans la nature même des choses qu'il existe une influence partout où il y a des hommes rassemblés, celle de la tyrannie ou celle de la raison. Lorsque celle-ci est proscrite comme un crime, la tyrannie règne; quand les bons citoyens sont condamnés au silence, il faut bien que les scélérats dominent.
Ici j'ai besoin d'épancher mon cœur; vous avez besoin aussi d'entendre la vérité. Ne croyez pas que je vienne ici intenter aucune accusation ; un soin plus pressant m'occupe, et je ne me charge pas des devoirs d'autrui : il est tant de dangers imminents que cet objet n'a plus qu'une importance secondaire. Je viens, s'il est possible, dissiper de cruelles erreurs; je viens étouffer les horribles ferments de discorde dont on veut embraser ce temple de la liberté et la République entière; je viens dévoiler des abus qui tendent à la ruine de la patrie, et que votre probité seule peut réprimer. Si je vous dis aussi quelque chose des persécutions dont je suis l'objet, vous ne m'en ferez point un crime; vous n'avez rien de commun avec les tyrans qui me poursuivent; les cris de l'innocence opprimée ne sont point étrangers à vos cœurs ; vous ne méprisez point la justice et l'humanité, et vous n'ignorez pas que ces trames ne sont point étrangères à votre cause et à celle de la patrie.
Eh! quel est donc le fondement de cet odieux système de terreur et de calomnies? A qui devons-nous être redoutables, ou des ennemis ou des amis de la République? Est-ce aux tyrans et aux fripons qu'il appartient de nous craindre, ou bien aux gens de bien et aux patriotes? Nous, redoutables aux patriotes ! nous qui les avons arrachés des mains de toutes les factions conjurées contre nous! nous qui tous les jours les disputons, pour ainsi dire, aux intrigants hypocrites qui osent les opprimer encore ! nous qui poursuivons les scélérats qui cherchent à prolonger leurs malheurs en nous trompant par d'inextricables impostures! Nous , redoutables à la Convention nationale ! Et que sommes-nous sans elle? Et qui a défendu la Convention nationale au péril de sa vie? Qui s'est dévoué pour sa conservation, quand des factions exécrables conspiraient sa ruine à la face de la France? Qui s'est dévoué pour sa gloire, quand les vils suppôts de la tyrannie prêchaient en son nom l'athéisme et l'immoralité; quand tant d'autres gardaient un silence criminel sur les forfaits de leurs complices, et semblaient attendre le signal du carnage pour se baigner dans le sang des représentants du peuple ; quand la vertu même se taisait, épouvantée de l'horrible ascendant qu'avait pris le crime audacieux? Et à qui étaient destinés les premiers coups des conjurés? Contre qui Simon conspirait-il au Luxembourg? Quelles étaient les victimes désignées par Chaumette et par Ronsin? Dans quels lieux la bande des assassins devait-elle marcher d'abord en ouvrant les prisons? Quels sont les objets des calomnies ot des attentats des tyrans armés contre la République? N'y a-t-il aucun poignard pour nous dans les cargaisons que l'Angleterre envoie à ses complices en France et à Paris? C'est nous qu'on assassine, et c'est nous que l'on peint redoutables! Et quels sont donc ces grands actes de sévérité que l'on nous reproche? Quelles ont été les victimes? Hébert, Ronsin, Chabot, Danton, Lacroix, Fabre d'Eglantine, et quelques autres complices. Est-ce leur punition qu'on nous reproche?
Aucun n'oserait les défendre. Mais si nous n'avons fait que dénoncer des monstres dont la mort a sauvé la Convention nationale et la République, qui peut craindre nos principes, qui peut nous accuser d'avance d'injustice et de tyrannie, si ce n'est ceux qui leur ressemblent?
Non, nous n'avons pas été trop sévères; j'en atteste la République qui respire; j'en atteste la représentation nationale, environnée du respect dû à la représentation d'un grand peuple; j'en atteste les patriotes qui gémissent encore dans les cachots que les scélérats leur ont ouverts; j'en atteste les nouveaux crimes des ennemis de notre liberté, et la coupable persévérance des tyrans ligués contre nous. On parle de notre rigueur, et la patrie nous reproche notre faiblesse.
Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes, et porté la terreur dans toutes les conditions? Ce sont les monstres que nous avons accusés.
Est-ce nous qui, oubliant les crimes de l'aristocratie, et protégeant les traîtres, avons déclaré la guerre aux citoyens paisibles, érigé en crimes ou des préjugés incurables ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la révolution redoutable au peuple même? Ce sont les monstres que nous avons accusés. Est-ce nous qui, recherchant des opinions anciennes, fruit de l'obsession des traîtres, avons promené le glaive sur la plus grande partie de la Convention nationale, demandions dans les sociétés populaires la tête de six cents représentants du peuple?
Ce sont les monstres que nous avons accusés. Aurait-on déjà oublié que nous nous sommes jetés entre eux et leurs perfides adversaires, dans un temps où on... ?
Vous connaissez la marche de vos ennemis. Ils ont attaqué la Convention nationale en masse ; ce projet a échoué. Ils ont attaqué le Comité de salut public; ce projet a échoué. Depuis quelque temps, ils déclarèrent la guerre à certains membres du Comité de salut public; ils semblent ne prétendre qu'à accabler un seul homme ; ils marchent toujours au même but. Que les tyrans de l'Europe osent proscrire un représentant du peuple français, c'est sans doute l'excès de l'insolence ; mais que des Français qui se disent républicains travaillent à exécuter l'arrêt de mort prononcé par les tyrans, c'est l'excès du scandale et de l'opprobre .
Est-il vrai que l'on ait colporté des listes odieuses où l'on désignait pour victimes un certain nombre de membres de la Convention et qu'on prétendait être l'ouvrage du Comité de salut public et ensuite le mien? Est-il vrai qu'on ait osé supposer des séances du Comité, des arrêtés rigoureux qui n'ont jamais existé, des arrestations non moins chimériques?
Est-il vrai qu'on ait cherché à persuader à un certain nombre de représentants irréprochables que leur perte était résolue; à tous ceux qui, par quel- que erreur, avaient payé un tribut inévitable h la fatalité des circonstances et k la faiblesse humaine, qu'ils étaient voués au sort des conjurés ?
Est-il vrai que l'imposture ait été répandue avec tant d'art et d'audace, qu'un grand nombre de membres n'osaient plus habiter la nuit leur domicile? Oui, les faits sont constants, et les preuves de ces deux manœuvres sont au Comité de salut public.
Vous pourriez nous en révéler beaucoup d'autres, vous, députés revenus d'une mission dans les départements; vous, suppléants appelés aux fonctions de représentants du peuple, vous pourriez nous dire ce que l'intrigue a fait pour vous tromper, pour vous aigrir, pour vous entraîner dans une coalition funeste.
Que disait-on, que faisait-on dans ces coteries suspectes, dans ces rassemblements nocturnes, dans ces repas où la perfidie distribuait aux convives les poisons de la haine et de la calomnie? Que voulaient-ils, les auteurs de ces machinations? Était-ce le salut de la patrie, la dignité et l'union de la Convention nationale? Qui étaient-ils ? Quels faits justifient l'horrible idée qu'on a voulu donner de nous? Quels hommes avaient été accusés par les Comités, si ce n'est les Chaumette, les Hébert, les Danton, les Chabot, les Lacroix ? Est-ce donc la mémoire des conjurés qu'on veut défendre? Est-ce la mort des con- jurés qu'on veut venger ?
Si on nous accuse d'avoir dénoncé quelques traîtres, qu'on accuse donc la Convention qui les a accusés; qu'on accuse la justice qui les a frappés; qu'on accuse le peuple qui a applaudi à leur châtiment. Quel est celui qui attente à la représentation nationale, de celui qui poursuit ses ennemis, ou de celui qui les protège ?
Et depuis quand la punition du crime épouvante-t-elle la vertu ?
Telle est cependant la base de ces projets de dictature et d'attentats contre la représentation nationale imputés d'abord au Comité de salut public en général. Par quelle fatalité cette grande accusation a-t elle été transportée tout à coup sur la tête d'un seul de ses membres?
Étrange projet d'un homme, d'engager la Convention nationale à s'égorger elle-même en détail de ses propres mains, pour lui frayer le chemin du pouvoir absolu ! Que d'autres aperçoivent le côté ridicule de ces inculpations, c'est à moi de n'en voir que l'atrocité. Vous rendrez au moins compte* à l'opinion publique de votre affreuse persévérance à poursuivre le projet d'égorger tous les amis de la patrie, monstres qui cherchez à me ravir l'estime de la Convention nationale, le prix le plus glorieux des travaux d'un mortel, que je n'ai ni usurpé et surpris, mais que j'ai été forcé de conquérir.
Paraître un objet de terreur aux yeux de ce qu'on révère et de ce qu'on aime, c'est pour un homme sensible et probe le plus affreux des supplices ; le lui faire subir, c'est le plus grand des forfaits. Mais, j'appelle toute votre indignation sur les manoeuvres atroces employées pour étayer ces extravagantes calomnies...."
"... Le cœur flétri par l'expérience de tant de trahisons, je crois à la nécessité d'appeler surtout la probité et tous les sentiments généreux au secours de la République. Je sens que partout où on rencontre un homme de bien, en quelque lieu qu'il soit assis, il faut lui tendre la main, et le serrer contre son cœur. Je crois à des circonstances fatales dans la révolution, qui n'ont rien de commun avec les desseins criminels; je crois à la détestable influence de l'intrigue, et surtout à la puissance sinistre de la calomnie. Je vois le monde peuplé de dupes et de fripons : mais le nombre des fripons est le plus petit : ce sont eux qu'il faut punir des crimes et des malheurs du monde. Je n'imputerai donc point les forfaits de Brissot et de la Gironde aux hommes de bonne foi qu'ils ont trompés quelquefois ; je n'imputerai point à tous ceux qui crurent à Danton les crimes de ce conspirateur; je n'imputerai point ceux d'Hébert aux citoyens dont le patriotisme sincère fut entraîné quelquefois au delà des exactes limites de la raison. Les conspirateurs ne seraient point des conspirateurs, s'ils n'avaient l'art de dissimuler assez habilement pour usurper pendant quelque temps la confiance des gens de bien : mais il est des signes certains auxquels on peut discerner les dupes des complices, et l'erreur du crime. Qui fera donc cette distinction? Le bon sens et la justice. Ah! combien le bon sens et la justice sont nécessaires dans les affaires humaines ! Les hommes pervers nous appellent des hommes de sang, parce que nous avons fait la guerre aux oppresseurs du monde. Nous serions donc humains, si nous étions réunis à leur ligue sacrilège pour égorger le peuple et pour perdre la patrie.
Au reste, s'il est des conspirateurs privilégiés, s'il est des ennemis inviolables de la République, je consens à m'imposer sur leur compte un éternel silence. J'ai rempli ma tâche (je ne me charge point de remplir les devoirs d'autrui; un soin plus pressant m'agite en ce moment); il s'agit de sauver la morale publique et les principes conservateurs de la liberté; il s'agit d'arracher à l'oppression tous les amis généreux de la patrie.
Ce sont eux qu'on accuse d'attenter à la représentation nationale! Et où donc chercheraient-ils un autre appui? Après avoir combattu tous vos ennemis, après s'être dévoués à la fureur de toutes les factions pour défendre et votre existence et votre dignité, où chercheraient-ils un asile s'ils ne le trouvaient pas dans votre sein?
Ils aspirent, dit-on, au pouvoir suprême; ils l'exercent déjà. La Convention nationale n'existe donc pas ! Le peuple français est donc anéanti! Stupides calomniateurs! vous êtes-vous aperçus que vos ridicules déclamations ne sont pas une injure faite à un individu, mais à une nation invincible, qui dompte et qui punit les rois? Pour moi, j'aurais une répugnance extrême à me défendre personnellement devant vous contre la plus lâche de toutes les tyrannies, si vous n'étiez pas convaincus que vous êtes les véritables objets des attaques de tous les ennemis de la République. Eh! que suis-je pour mériter leurs persécutions, si elles n'entraient dans le système général de leur conspiration contre la Convention nationale?
N'avez-vous pas remarqué que, pour vous isoler de la nation, ils ont publié à la face de l'univers que vous étiez des dictateurs régnant par la terreur, et désavoués par le vœu tacite des Français? N'ont- ils pas appelé nos armées les hordes conventionnelles] la révolution française, le jacobinisme? Et lorsqu'ils affectent de donner à un faible individu , en butte aux outrages de toutes les factions, une importance gigantesque et ridicule, quel peut être leur but, si ce n'est de vous diviser, de vous avilir, en niant votre existence même, semblables à l'impie qui nie l'existence de la divinité qu'il redoute ?
Cependant ce mot de dictature a des effets magiques; il flétrit la liberté; il avilit le gouvernement; il détruit la République; il dégrade toutes les institutions révolutionnaires, qu'on présente comme l'ouvrage d'un seul homme; il rend odieuse la justice nationale, qu'il présente comme instituée pour l'ambition d'un seul homme; il dirige sur un point toutes les haines et tous les poignards du fanatisme et de l'aristocratie...."
".. Ils m'appellent tyran. Si je l'étais, ils ramperaient à mes pieds, je les gorgerais d'or, je leur assurerais le droit de commettre tous les crimes, et ils seraient reconnaissants. Si je l'étais, les rois que nous avons vaincus, loin de me dénoncer (quel tendre intérêt ils prennent à notre liberté !) me prêteraient leur coupable appui; je transigerais avec eux. Dans leur détresse, qu'attendent-ils, si ce n'est le secours d'une faction protégée par eux, qui leur vende la gloire et la liberté de notre pays ? On arrive à la tyrannie par le secours des fripons; où courent ceux qui les combattent? Au tombeau et à l'immortalité.
Quel est le tyran qui me protège? Quelle est la faction à qui j'appartiens? C'est Vous-mêmes. Quelle est cette faction qui, depuis le commencement de la révolution, a terrassé les factions, a fait disparaître tant de traîtres accrédités? C'est vous, c'est le peuple, ce sont les principes. Voilà la faction à laquelle je suis voué, et contre laquelle tous les crimes sont ligués.
C'est vous qu'on persécute; c'est la patrie, ce sont tous les amis de la patrie. Je me défends encore. Combien d'autres ont été opprimés dans les ténèbres? Qui osera jamais servir la patrie, quand je suis obligé encore ici de répondre à de telles calomnies ? Ils citent comme la preuve d'un dessein ambitieux les effets les plus naturels du civisme et de la liberté; l'influence morale des anciens athlètes de la révolution est aujourd'hui assimilée par eux à la tyrannie.
Vous êtes, vous-mêmes, les plus lâches de tous les tyrans, vous qui calomniez la puissance de la vérité. Que prétendez-vous, vous qui voulez que la vérité soit sans force dans la bouche des représentants du peuple français ? La vérité, sans doute, a sa puissance; elle a sa colère, son despotisme; elle a des accents touchants, terribles, qui retentissent avec force dans les cœurs purs, comme dans les consciences coupables, et qu'il n'est pas plus donné au mensonge d'imiter qu'à Salmonée d'imiter les foudres du ciel : mais accusez-en la nature, accusez-en le peuple qui la sent et qui l'aime.
Il y a deux puissances sur la terre; celle de la raison est-elle celle de la tyrannie ; partout où l'une domine, l'antre en est bannie. Ceux qui dénoncent comme un crime la force morale de la raison cherchent donc à rappeler la tyrannie. Si vous ne voulez pas que les défenseurs des principes obtiennent quelque influence dans cette lutte difficile de la liberté contre l'intrigue, vous voulez donc que la victoire demeure à l'intrigue ? Si les représentants du peuple qui défendent sa cause ne peuvent pas obtenir impunément son estime, quelle sera la conséquence de ce système, si ce n'est qu'il n'est plus permis de servir le peuple, que la République est proscrite et la tyrannie rétablie? Et quelle tyrannie plus odieuse que celle qui punit le peuple dans la personne de ses défenseurs? Car la chose la plus libre qui soit dans le monde, même sous le règne du despotisme, n'est-ce pas l'amitié? Mais vous qui nous en faites un crime, en êtes-vous jaloux? Non ; vous ne prisez que l'or et les biens périssables que les tyrans pro- diguent à ceux qui les servent. Vous les servez, vous qui corrompez la morale publique et protégez tous les crimes : la garantie des conspirateurs est dans l'oubli des principes et dans la corruption ; celle des défenseurs de la liberté est toute dans la conscience publique. Vous les servez, vous qui, toujours en deçà ou au delà de la vérité, prêchez tour à tour la perfide modération de l'aristocratie, et tantôt la fureur des faux démocrates. Vous la servez, prédicateurs obstinés de l'athéisme et du vice. Vous voulez détruire la représentation, vous qui la dégradez par votre conduite, ou qui la troublez par vos intrigues. .."

28 juillet 1794 - Discours de Saint Just pour la défense de Robespierre.
Pendant la séance de la Convention du 8 thermidor, Robespierre et ses amis avaient senti qu'une lutte à mort était engagée contre eux. L'hostilité presque générale de l'Assemblée, même sur ces bancs de la Montagne où, jusque-là, se trouvaient leurs plus fermes soutiens, ne permettait plus de douter de l'issue du drame. Pendant que Robespierre parlait, des cris de : « A bas le tyran ! », s'étaient fait entendre et aucune voix amie ne s'était élevée pour protester. C'était la fin prochaine, l'accusation, l'échafaud. Néanmoins, Robespierre et Saint-Just résolurent de lutter jusqu'au bout, malgré la défection d'une partie du Comité de salut public. Chacun d'eux prépara un discours pendant la nuit.
Le lendemain 9 thermidor, dès le début de la séance, Saint-Just prit la parole. Mais le complot était bien ourdi; tous les conjurés étaient à leur poste, conduits par Tallien qui s était campé, par bravade, dans l'hémicycle, au pied de la tribune. A peine Saint-Just eut-il prononcé les premiers mots, l'orage se déchaîna, sauvage, mortel. Ne pouvant plus parler, il demeura néanmoins à la tribune, tranquille, méprisant, assistant à ce déchaînement furieux avec la même impassibilité que s'il s'était agi d'un autre. Au milieu du tumulte, il fut décrété d'accusation et il ne quitta l'Assemblée que pour être incarcéré au Luxembourg.
Le 28 juillet 1794 (10 thermidor an II), exécution de Robespierre. Il avait cru, en sacrifiant Danton, affermir son pouvoir et n'avoir plus à le partager; il n'avait réussi au contraire qu'à exciter la méfiance de ses partisans mêmes; vivement attaqué par Tallien à la tribune de la Convention, il succomba à son tour, le 9 Thermidor et monta sur l'échafaud.
Sa mort marqua la fin de la Terreur. Entraîné dans la chute de Robespierre, Saint-Just est de même exécuté le même jour.
Estampe de Carl de Vinck - 'Execution de Robespierre et de ses complices conspirateurs contre la liberté et l'egalité : vive la Convention nationale qui par son energie et surveillance a delivré la Republique de ses tyrans.."
La Convention, du 9 thermidor an II à la fin de la Convention ...
- Le 31 mai 1795 (12 prairial), elle supprime le tribunal révolutionnaire;
- Le 22 juillet (4 thermidor), elle conclut un traité de paix avec l'Espagne;
- Le 26 octobre (4 brumaire an IV), elle rend un décret d'amnistie pour tous les délits révolutionnaires, et déclara ses séances terminées.
... Avant de se séparer, elle rédigera la constitution dite de l'an III....
27 juillet 1794 au 26 octobre 1795 - Convention thermidorienne ou Réaction thermidorienne, troisième période de l’histoire de la Convention nationale et débouchant sur le Directoire....
Après la chute de Robespierre, s'oppose, une conjuration disparate au sein de la Convention nationale, les Montagnards de l'an III (Barère, Billaud-Varenne ou Collot d'Herbois), partisans du maintien du gouvernement révolutionnaire et une majorité plus modérée de l'assemblée (Tallien, Fréron, Sieyès, Cambacérès, Daunou ou Boissy d'Anglas). On assiste à un démantèlement progressif du gouvernement révolutionnaire, avec en 1795 la disparition du Comité du Salut public. Le 27 décembre 1794 (7 nivôse an III), une commission d'enquête est chargée d'examiner la conduite de Barère, de Collot d'Herbois, de Vadier et de Billaud-Varenne. Billaud et Collot sont déportés. L'hiver 1794-95 voit le peuple de subir une grave disette, la crise économique et financière menace avec la chute des cours des assignats. Une grande part des suspects emprisonnés sous la Terreur sont élargis, tandis que de nombreux militants révolutionnaires sont arrêtés. Une première "Terreur blanche" ou violente réaction antijacobine prend forme, la Convention doit faire face à une agitation royaliste à peine déguisée à Paris, et bientôt très violente dans le Sud-Est, des émeutes populaires de germinal (avril 1795) et prairial (mai 1795), des mouvements qui ne seront écrasés que par des interventions militaires, en particulier celle du général d'artillerie Bonaparte, appelé le 13 vendémiaire (5 octobre) par Barras pour défendre la Convention. Ce sont les dernières insurrections populaires avant la Révolution de 1830...
L'insurrection du 1er prairial an III (20 mai 1795) et l'assassinat du député Jean-Bertrand Féraud. Gravure de Duplessis-Bertaux et Helman d'après un dessin de Charles Monnet.
La France de 1795 est plus grande que celle de 1789, Avignon, la Savoie, Nice, les anciennes enclaves allemandes, l'évêché de Bâle, les ex-Pays-Bas autrichiens, un territoire national de plus libre de toute présence étrangère : la République compte environ 32 millions d'habitants, dont 28 millions sur le territoire de l'ancien royaume. Le bilan démographique des six dernières années, malgré l'émigration, malgré la guerre et la Terreur, est positif. Une population en grande majorité rurale, la population urbaine ne dépasse pas les 5 millions d'habitants, répartis dans trois grandes agglomérations, Paris (640 000), Toulouse (60 000), Strasbourg (50 000) ...
Le Directoire (1795-1799)
Fin de la Convention. - La Convention se retira le 26 octobre 1795.
Oct. 1795 - Le Directoire - Le 27 octobre 1795, en vertu de la nouvelle Constitution (celle du 5 fructidor an III, avec pour préambule la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795, et un nouveau code pénal, le Code des délits et des peines), «cinq Directeurs» entrent en fonction : aux prises avec les agitations royaliste et jacobine, manquant d'argent, disposant seulement d'un papier-monnaie déprécié, le Directoire dut se battre constamment. Il écrasa la Conspiration des Egaux, partisans d'un régime communiste prôné par Babeuf, en 1797; les royalistes, qui avaient remporté des succès notables aux élections de la même année, furent écartés par le coup d'Etat militaire du 18 fructidor an V (septembre 1797); en floréal an VI (mai 1798 ), c'est contre les Jacobins qu'il fallut réagir. Mais ce jeu de balance trop compliqué conduit l'opinion publique à souhaiter la présence au pouvoir d'un homme qui rétablirait la paix....
La société du Directoire n'est plus celle de l'Ancien Régime, les ordres privilégiés, clergé et noblesse, ont disparu, domine, disparate, une bourgeoisie, ceux qui possèdent de la terre ou des maisons, ceux qui ont placé leurs capitaux dans des banques étrangères, ceux qui se consacrent à l'industrie, au commerce ou à la banque, et une petite bourgeoisie en peine ascension, issue des artisans ou des commerçants. La fameuse «immoralité» du Directoire est celle de ces nouveaux riches et de leurs protecteurs politiques, Barras et Talleyrand, mais la majorité est à la solidité et à cette "décence", pilier de la nation française du XIXe siècle...

Estampe, Philippe-Auguste Hennequin (1795 ou 1796) - "Sous les traits d'un jeune homme ardent et plein de vigueur le Français régénéré par la Constitution, s'attache à elle : et vole au bonheur, tandis que le fanatisme aveugle, l'orgueil, et la féroce ignorance émoussent leurs traits contre son égide..."
En 1796, en Suisse, Joseph de Maistre (1753-1821), qui va mener une vie errante après l'invasion de la Savoie en 1792, publie son œuvre maîtresse, "Considérations sur la France". Parmi les théoriciens de la contre-révolution, c'est un courant théocratique s'incarnant en Joseph de Maistre et Louis de Bonald qui prend la suite de Burke, mort en 1797. Pour Maistre, le moteur de l'histoire est la Providence, elle a voulu châtier la France pour ses mauvaises mœurs mais la victoire de la contre-révolution est inéluctable. Louis de Bonald (1754-1840) fait, quant à lui, paraître dans le même temps, à Constance, sa "Théorie du pouvoir politique et religieux", résumée dans sa fameuse formule, «Dieu est l'auteur de tous les États, l'homme ne peut rien sur l'homme que par Dieu et ne doit rien à l'homme que pour Dieu.» L'abbé Barruel dans ses "Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme", publiés à Hambourg, en 1798, associera l'origine de la Révolution française à un vaste complot maçonnique...
Nov. 1799 - Du Consulat à l'Empire, l'avènement de Napoléon Ier ...
Le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), avec la complicité de son frère Lucien, de Sieyès, Ducos, Cambacérès et Talleyrand, Bonaparte, à qui la faiblesse du gouvernement a permis de tirer prestige et pouvoir de sa brillante campagne d'Italie (victoires de Milan, du pont d'Arcole, de Rivoli et traité de Campo-Formio par lequel Bonaparte avait obtenu pour la France les Pays-Bas, les îles Ioniennes et la rive gauche du Rhin) et de son audacieuse expédition d'Egypte, supprime le Directoire par un coup d'État militaire et politique, et le remplace par le triple Consulat : Sieyès - Ducos - Bonaparte.
C'est dans les termes suivants qu'il harangue les soldats pour justifier son coup d'Etat : "Soldats, l'amée s'est unie de cœur avec moi, comme je me suis uni de cœur avec elle, comme je me suis uni avec le corps législatif. La République serait bientôt détruite si les conseils ne prenaient des mesures fortes et décisives. Dans quel état j'ai laissé la France, et dans quel état je l'ai retrouvée! Je vous avais laissé la paix, et je retrouve la guerre! Je vous avais laissé des conquêtes, et l'ennemi presse vos frontières! J'ai laissé nos arsenaux garnis, et je n'ai pas retrouvé une arme! J'ai laissé les millions de l'Italie, et je retrouve partout des lois spoliatrices et la misère! Nos canons ont été vendus! Le vol a été érigé en système! Les ressources de l'État épuisées! On a eu recours à des moyens vexatoires, réprouvés par la justice et le bon sens! On a livré le soldat sans défense! Où sont-ils les braves, les cent mille camarades que j'ai laissés couverts de lauriers?..."
La Constitution de l'an VIII (décembre 1799), plébiscitée par le peuple en 1800 sous une apparence libérale (suffrage universel et assemblées partageant le pouvoir législatif avec le premier Consul), donne en fait la réalité du pouvoir à Bonaparte qui décide de la guerre et de la paix, choisit les ministres et nomme les fonctionnaires.
Il consolide sans tarder la société issue de la révolution par une administration centralisée, institue les préfets, réorganise les finances et la justice, établit et rédige lui-même le Code civil. Par ailleurs, en rétablissant de bons rapports entre l'Église et l'État (Concordat de juillet 1801), il se concilie l'influence encore puissante du clergé et assure la paix religieuse jusqu'en 1804. A l'extérieur, il réussit à vaincre les Autrichiens (bataille de, Marengo, 14 juin 1800 et traité de Lunéville, 9 février 1801) et à signer un accord de compromis avec l'Angleterre (Préliminaires de Londres, Ier octobre 1801 et paix d'Amiens le 25 mars 1802). Réélu Consul pour dix ans par le Sénat en mai 1802, Bonaparte se fait proclamer Consul a vie en août après un plébiscité triomphal; enfin, il devient Empereur des Français, après le vote du Tribunat, et se fait sacrer par le Pape, le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris....
"Senatus Consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804) - Titre Ier
Article I - Le gouvernement de la République est confiée un Empereur qui prend le titre d'Empereur des Français. La justice se rend au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.
Article 2 - Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est Empereur des Français." ...
