- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
2000s
Media Power
Media Power2 - "Master the Media: How Teaching Media Literacy Can Save Our Plugged-in World", Julie Smith (2015) - "The Media and Me : A Critical Media Literacy for Young People" (2022), Ben Boyington - Walter Lippman, "Public Opinion" (1922) - Neil Postman (1931-2003), "Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business" (1985) - "How to Watch TV News: Revised Edition", Neil Postman & Steve Powers (1991) - Shanto Iyengar & Donald Kinder, "News That Matters, Television and American Opinion" (1987) - Noam Chomsky & E. Herman, "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988) - John Zaller, "The Nature and Origins of Mass Opinion" (1992) - Joseph Cappella & Kathleen Hall Jamieson, "Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good" (1997) - Doris Graber, "Processing Politics : Learning from Television in the Internet Age " (2001) - Nick Couldry, "The Place of Media Power : Pilgrims and Witnesses of the Media Age" (2000) - "Media, Society, World : Social Theory and Digital Media Practice", Nick Couldry (2012) - Timothy Snyder , "On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century" (2017) - ...
LastUpdate 11/11/2024

Who on earth can you believe any more? - On se souvient d'un argumentaire ironique, "Le Journalisme sans peine", dans lequel Pierre Bourdieu ("Sur la télévision", 1996) analysait comment le champ journalistique, soumis à des logiques commerciales et politiques, produisait un conformisme médiatique, soulignant l’influence des ratings, de la publicité et des pressions politiques sur le traitement de l’information...
Bourdieu ironisait alors sur le fait que les journalistes, surtout à la télévision, reproduisaient des discours préfabriqués sans effort critique, privilégiant les "faits divers" (peu coûteux et spectaculaires) plutôt que l’analyse sociale, les sources officielles (hommes politiques, experts médiatiques) plutôt que des contre-avis, le sensationnalisme (pour capter l’audimat) au détriment de l’information rigoureuse. La télévision était alors décrite comme un outil de domination symbolique : elle ne se contente pas d’informer, elle fabrique une vision du monde conforme aux intérêts des dominants, imposant un agenda médiatique (ce dont on parle et ce qu’on tait), une hiérarchie des "experts" (ceux qui ont droit à la parole et ceux qu’on ignore), un formatage de la pensée (via le temps limité, le simplisme des débats).
Une thèse qui, une trentaine d'années plus tard, n'a pas perdu son actualité et sa virulence, si ce n'est une singulière mauvaise foi. L’autonomie perdue du journalisme, écrivait Bourdieu, dénonçant la dépendance des journalistes envers les annonceurs publicitaires (qui influencent le contenu), les pouvoirs politiques (via l’accès aux sources et la construction de certains prêts-à-porter intellectuels) et les contraintes techniques (rythme effréné, format court). Un journalisme "prêt-à-penser", qui évite les sujets complexes (économie, inégalités) au profit du spectacle. Qui évite tout simplement de trop penser et pour se faire de ne pas trop donner à penser ...

Mon objectif ici, écrivait Pierre Bourdieu, n'est pas le « pouvoir des journalistes » - et encore moins le journalisme en tant que « quatrième pouvoir » - mais plutôt l'emprise que les mécanismes d'un champ journalistique de plus en plus soumis aux exigences du marché (à travers les lecteurs et les annonceurs) exercent d'abord sur les journalistes (et sur les journalistes-intellectuels) et ensuite, en partie à travers eux, sur les différents champs de la production culturelle - le champ juridique, le champ littéraire, le champ artistique et le champ scientifique. Il s'agit donc d'examiner comment la pression structurelle exercée par le champ journalistique, lui-même dominé par la pression du marché, modifie plus ou moins profondément les rapports de force au sein des autres champs. Cette pression affecte ce qui est fait et produit dans ces domaines, avec des résultats très similaires dans ces mondes par ailleurs très différents. Il faut cependant éviter de tomber dans l'une ou l'autre des deux erreurs opposées : l'illusion du « jamais vu » et son pendant, le « toujours vu » ...
Bourdieu soulignait enfin qu’en France (et en Europe continentale), le journalisme est marqué par une connivence historique entre médias et élites politiques (plus qu’aux États-Unis, où la polarisation médiatique est plus visible) et un monopole des "grands intellectuels médiatiques" (ex : éditorialistes du Monde, du Figaro), qui excluent les voix critiques, mais ces grands intellectuels ont depuis ce début de siècle totalement disparus : restent, comme dans bien d'autres domaines, de très nombreux seconds rôles ...
MEDIA LITERACY - Compréhension critique des messages médiatiques, techniques de déconstruction médiatique - Au XXIe siècle, l’éducation aux médias est devenue tout aussi importante que la forme traditionnelle de l’alphabétisation...
En fait, c’est une compétence essentielle que tout le monde doit acquérir, c'est-à-dire acquérir non seulement la capacité d’accéder aux médias, mais de les analyser, de les évaluer et de créer éventuellement des médias. Les messages que nous transmettent la télévision, la radio, l’Internet, les journaux, les magazines, les livres, les panneaux publicitaires, les jeux vidéo, la musique et toutes les autres formes de médias, ne sont absolument pas "neutres".
En 1989, Elizabeth Thoman (1943-2016) a fondé le Center for Media Literacy (CML), une organisation basée à Los Angeles, qui est devenue une référence mondiale dans le domaine de l'éducation aux médias. Thoman considérait la "littératie médiatique" (media literacy) comme une compétence essentielle à l'ère de l'information : elle l'a défini comme « la capacité d'accéder, d'analyser, d'évaluer et de créer des messages médiatiques dans une variété de formes ». Et a travaillé à intégrer celle-ci dans les systèmes éducatifs pour que les citoyens puissent mieux naviguer dans un environnement médiatique complexe. Bien avant que ne s'impose l'ère des réseaux sociaux et des algorithmes, Thoman plaidait pour le développement de compétences critiques face aux médias afin de contrer les messages biaisés, les stéréotypes et la manipulation, aujourd'hui la désinformation, les fake news et la polarisation médiatique...

Elizabeth Thoman a codéveloppé ce qu'elle présente comme les cinq concepts fondamentaux de la "littératie médiatique" (Core Concepts of Media Literacy), qui sont encore largement utilisés aujourd'hui :
1) Tous les messages médiatiques ont fait l'objet d'une conception parfaitement réfléchie (All Media Messages Are Constructed).
2) Les médias utilisent des techniques créatives pour attirer l'attention (All Media Are Constructed Using Their Own Sets of Rules).
3) Différentes personnes interprètent les messages de manière différente (Different People Will Have Different Reactions to the Same Media Message)
4) Les médias ont des valeurs et des points de vue "intégrés" (Media Have “Embedded” Values and Points of View) - « il est important d’apprendre à 'lire' toutes sortes de messages médiatiques afin de découvrir les points de vue qui y sont intégrés. Ce n’est qu’alors que nous pourrons juger si nous acceptons ou rejetons ces messages, alors que nous négocions notre chemin chaque jour dans notre environnement de médiation. »
5) Les messages médiatiques servent souvent des objectifs commerciaux ou sociaux (Media Are Typically Produced by Businesses That Want to Earn Money).

"Media Literacy: A Reader's Guide" (1983) offre une introduction aux principes de la littératie médiatique. Il était destiné aux enseignants et éducateurs cherchant à intégrer l’analyse critique des médias dans leurs classes. "Media Literacy: A Compendium of Practical Strategies for Teachers" (1992) fut publié pour fournir des stratégies concrètes permettant d'intérer la "littératie médiatique" dans les programmes scolaires, et en 2003, l’équipe du Center for Media Literacy reprenait les concepts fondamentaux de Thoman dans "Five Key Questions That Can Change the World". Parmi les auteurs qui s'inscrivent dans cette continuité, citons Renee Hobbs, l’une des figures de proue contemporaines de la littératie médiatique et de l’éducation critique aux médias ("Media Literacy in Action: Questioning the Media", 2021); David Buckingham, qui défend la nécessité d'une éducation aux médias comme réponse aux défis posés par les médias numériques et les fake news ("The Media Education Manifesto", 2019); Sonia Livingstone ("The Class: Living and Learning in the Digital Age", 2016). L’UNESCO prolongera les thèmes de Thoman à l’échelle mondiale : "Media and Information Literacy Curriculum for Teachers" (2011), "Journalism, Fake News and Disinformation" (2018) ...

"Master the Media: How Teaching Media Literacy Can Save Our Plugged-in World", written by Julie Smith (2015) - L’enseignement de la maîtrise des médias peut-il vraiment changer le monde? Les chercheurs prédisaient qu’en 2015, le citoyen américain moyen passera plus de quinze heures par jour à écouter, lire, cliquer et regarder des médias. Sans aucun doute, la télévision, les films, la radio et la musique, l’Internet, les médias sociaux, les émissions de nouvelles, les livres et les magazines font partie de notre vie quotidienne. Et bien que certains prétendent que toute cette consommation des médias est préjudiciable à la société, la vérité est qu’elle n’a pas besoin de l’être. Les temps ont changé. La technologie nous connecte aujourd’hui de façon nouvelle et passionnante. Nous avons plus de choix et plus de contrôle que jamais sur ce que nous allons regarder, écouter et lire. Et, comme l’explique Julie Smith dans "Master the Media", ce contrôle vient avec un niveau accru de responsabilité pour penser de façon critique au contenu que nous consommons. Écrit pour aider les enseignants et les parents à éduquer la prochaine génération, "Master the Media" explique l’histoire, le but et les messages derrière les médias. Le but n’est pas de débrancher les enfants; c’est de les aider à faire des choix éclairés, à comprendre la différence entre la vérité et le mensonge, et à discerner la perception de la réalité. La pensée critique mène à des décisions plus intelligentes, et c’est pourquoi l’éducation aux médias peut sauver le monde.
Julie Smith est une formatrice expérimentée en littératie médiatique (media literacy) qui a enseigné à l’université, y compris à la Webster University. Elle est un ardent défenseur de l’intégration de la littératie médiatique dans les programmes scolaires afin d’aider les gens à naviguer dans les complexités des médias modernes. Ce livre est particulièrement pertinent dans l’ère actuelle des fausses nouvelles (fake news), des deepfakes (deepfakes) et du biais algorithmique (algorithmic bias), ce qui en fait une ressource précieuse pour les éducateurs, les parents et toute personne intéressée par la littératie médiatique.

"The Media and Me : A Critical Media Literacy for Young People" (2022) de Ben Boyington, Allison T. Butler et le Project Censored Fellows est un ouvrage référencé et destiné à aider les adolescents et les jeunes adultes à naviguer dans le paysage complexe des médias d’aujourd’hui, une stratégie fortement intégrée dans le monde anglo-saxon, mais que la France ignore, : doter les jeunes générations des outils nécessaires pour analyser, remettre en question et résister aux médias manipulateurs semblent pourtant essentiels ...
".. What Is Critical Thinking?
How do we know what is true about the world? As we spend more and more time on our screens, we are inundated with more and more media messages. What does all this information mean? Where does it come from? How do we know whether the things we see, hear, or read are real? What questions do we ask to verify information? Media citizens are able to answer these questions by thinking critically. In this chapter, we introduce key concepts for understanding what it means to think critically. Being critical means you ask basic questions, much as a detective would when trying to solve a crime.
By the way, being a critical thinker does not mean you have some magic potion for truth-seeking. Critical thinkers still struggle with evaluating information and even the best critical thinkers are sometimes fooled by the media’s messages. Critical thinkers do at least one distinct thing that sets them apart: they keep asking questions, even if (especially when!) they may stumble over the answers.
This chapter introduces some of the terms and definitions that will be used later in this book and that you may encounter in your daily lives. They’ll help you build a solid foundation for better understanding of both your media use and your interpersonal interactions...."
".. Qu’est-ce que la pensée critique?
Comment savons-nous ce qui est vrai sur le monde? Comme nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans, nous sommes inondés avec de plus en plus de messages des médias. Que signifient toutes ces informations? D’où viennent-elles? Comment savons-nous si les choses que nous voyons, entendons ou lisons sont réelles? Quelles questions posons-nous pour vérifier l’information? Les citoyens des médias sont en mesure de répondre à ces questions par la pensée critique. Dans ce chapitre, nous présentons des concepts clés pour comprendre ce que signifie la pensée critique. Être critique signifie poser des questions de base, tout comme un détective le ferait lorsqu’il tente de résoudre un crime.
Soit dit en passant, être un penseur critique ne signifie pas que vous avez une potion magique pour la recherche de la vérité. Les penseurs critiques ont encore du mal à évaluer l’information et même les meilleurs penseurs critiques sont parfois trompés par les messages des médias. Les penseurs critiques font au moins une chose distincte qui les distingue : ils continuent à poser des questions, même si (surtout quand!) ils peuvent trébucher sur les réponses.
Ce chapitre présente certains des termes et définitions qui seront utilisés plus tard dans ce livre et que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Ils vous aideront à établir une base solide pour mieux comprendre votre utilisation des médias et vos interactions interpersonnelles. ..."

« The real environment is altogether too big, too complex, and too fleeting for direct acquaintance. [...] We have to reconstruct it on a simpler model before we can manage with it. » (L’environnement réel est beaucoup trop vaste, complexe et fugace pour être appréhendé directement. Nous devons donc le reconstruire sur un modèle plus simple afin de pouvoir le gérer) ...
Walter Lippman, dans "Public Opinion" (1922), est l’un des premiers penseurs à avoir analysé de manière approfondie comment les médias influencent nos perceptions du monde, en créant ce qu'il appelle des « images mentales » (pictures in our heads).
À une époque où les médias de masse (notamment les journaux) deviennent omniprésents, Lippmann est préoccupé par la manière dont les citoyens accèdent à la réalité politique et sociale. Selon lui, la plupart des individus n’ont pas d’expérience directe de nombreux événements : ils dépendent donc largement des médias pour connaître le monde.
Lippmann introduit cette idée clé :
- Selon lui, nous ne percevons jamais le monde directement, mais toujours à travers des représentations médiatisées par la presse.
- Les médias créent et modèlent ainsi des images mentales simplifiées de la réalité.
- Ces images deviennent la base même de notre jugement politique et social, mais elles sont souvent incomplètes, biaisées ou trompeuses.
Les médias vont ainsi influencer nos perceptions selon un processus décrit en trois étapes :
(1) Sélection (les médias décident quels événements méritent d’être rapportés et lesquels sont ignorés), (2) Simplification (pour rendre compréhensibles des réalités complexes, les médias recourent à des raccourcis cognitifs, des stéréotypes ou des récits simplificateurs. Ce processus réduit la nuance et la complexité du réel), (3) Interprétation (les médias donnent aux événements une certaine interprétation, souvent influencée par leurs propres préjugés ou intérêts. Ce cadrage influence profondément la façon dont les citoyens perçoivent les enjeux politiques).
Selon Lippmann, ce phénomène a des conséquences majeures sur le fonctionnement démocratique. Il énonce déjà le risque d'ignorance rationnelle (les citoyens, faute d'accès direct aux réalités complexes, deviennent rationnellement ignorants et dépendent entièrement des images fournies par les médias), la réalité d'une manipulation potentielle (ceux qui contrôlent les médias peuvent aisément manipuler l’opinion publique en contrôlant les images mentales des citoyens), et donc en impact à une certaine critique du modèle classique de démocratie directe, où l’on présuppose un citoyen parfaitement informé.
Lippmann préfigure largement les théories modernes de la communication et son approche est à la base d'une tradition critique des médias qui sera développée plus tard par des auteurs tels que Noam Chomsky, Edward Herman (Manufacturing Consent, 1988), Marshall McLuhan (Understanding Media, 1964), ou encore Neil Postman.
On ne saurait oublier qu'l'heure d’internet et des réseaux sociaux, et d'un vide culturel grandissant, où la création d'images mentales biaisées est plus intense que jamais...

Neil Postman (1931-2003), professeur à l’Université de New York (NYU), où il a fondé le Department of Media Ecology, est l'un des premiers à avoir élaboré une critique de l’impact des médias sur la culture démocratique. "Teaching as a Subversive Activity" (1969), coécrit avec Charles Weingartner, introduit ses premières réflexions de Postman sur le rôle des médias dans la manière dont nous apprenons et enseignons : il y critique les méthodes éducatives traditionnelles et propose de nouvelles approches centrées sur la pensée critique, en tenant compte de l'impact des médias sur la façon dont les étudiants reçoivent et interprètent l'information.
"Amusing Ourselves to Death : Public Discourse in the Age of Show Business" (1985, "Se Divertir à en mourir") est son ouvrage de référence : une critique de la culture médiatique, en particulier de la télévision, qu'il accuse de transformer le discours public en un divertissement. Postman y développe l'idée que la télévision privilégie le spectacle et l'émotion au détriment de la pensée rationnelle et de la discussion éclairée. Il fera un parallèle entre la société moderne et les dystopies décrites dans "1984" (George Orwell) et "Le Meilleur des Mondes" (Aldous Huxley), affirmant que notre culture ressemble davantage à celle de Huxley, où le divertissement et le plaisir désengagent les citoyens.
Postman s'est opposé à l'idée que les technologies médiatiques seraient neutres : elles influencent profondément la manière dont nous pensons et vivons. Chaque média est une technologie de communication qui modifie l'écosystème dans lequel il opère. Il critiquera particulièrement la télévision et, plus tard, les ordinateurs, qu'il accusait de simplifier les discours publics et d’affaiblir la pensée critique. Il plaidait ainsi en réaction pour une éducation qui encouragerait cette dernière face aux médias et aux technologies, et qui formerait des citoyens capables d'analyser leur influence sur la société ...
Malgré quelques critiques légitimes sur son idéalisme nostalgique ou son déterminisme médiatique, l’analyse de Postman reste incontournable pour comprendre les défis actuels des sociétés médiatisées. Sa mise en garde contre le danger d’un « divertissement permanent » reste plus que jamais pertinente à l’époque contemporaine, où la démocratie elle-même semble menacée par une culture médiatique superficielle et plus insidieuse qu'on ne pourrait le penser ...

"How to Watch TV News: Revised Edition", Neil Postman & Steve Powers, 1991
Comment naviguer dans les médias en privilégiant un regard critique tant la télévision déforme les informations au point de les transformer en simple divertissement? Trente ans plus tard, un tel discours critique à l'encontre de la neutralité de la télévision traditionnelle a totalement été intégré, mais rapidement oublié : le spectateur sait qu'il sait beaucoup de choses, ne se fait aucune illusion ce qu'il voit et entend, mais à quoi bon tenter d'élaborer une réflexion critique quelconque, le spectacle est là, s'il est bon, on peut s'en contenter sans grand effort. La passivité, l'indifférence feront le reste ...
CHAPTER 1 - "Are You Watching Television, or Is Television Watching You?"
" The fact of the matter is that television not only delivers programs to your home, but, more important to the advertising community, it also delivers you to a sponsor..."
"People who watch news tend to be more attentive to what is on the screen. They tend to be better educated, albeit older, and have more money to spend than the audi-ences for other shows. They are, therefore, a prime target for advertisers trying to reach an affluent market. To reach that audience, sponsors are willing to pour money into well- produced commercials. These spots are often longer than most news stories and certainly cost more to produce. The commercials are fast paced, exciting, and colorful and, as a result, influence the way the news stories around them are produced.
Propelled by the energy of the “Madison Avenue shuffle,” the whole news program takes on a rhythm and pace designed to hold interest and build viewership. to hold interest and build viewership. More viewers, higher ratings, more advertising dollars, more profit, more similar programs to try to attract more viewers—ad infinitum.
« Les personnes qui regardent les informations ont tendance à être plus attentives à ce qui se passe à l'écran. Ils ont tendance à être mieux éduqués, quoique plus âgés, et ont plus d'argent à dépenser que le public d'autres émissions. Ils constituent donc une cible de choix pour les annonceurs qui cherchent à atteindre un marché aisé. Pour atteindre ce public, les sponsors sont prêts à investir de l'argent dans des spots publicitaires bien produits. Ces spots sont souvent plus longs que la plupart des reportages et coûtent certainement plus cher à produire. Les spots publicitaires sont rapides, excitants et colorés et, par conséquent, ils influencent la manière dont les reportages sont produits autour d'eux.
Propulsé par l'énergie du « Madison Avenue shuffle », l'ensemble du programme d'information adopte un rythme et une cadence conçus pour retenir l'intérêt et augmenter l'audience. pour retenir l'intérêt et augmenter l'audience. Plus de téléspectateurs, plus d'audience, plus d'argent pour la publicité, plus de profits, plus de programmes similaires pour essayer d'attirer plus de téléspectateurs - à l'infini.
While public service does play a role in deciding what news programs get on the air, the main factor is profit. In fact, while news operations used to be considered a nonprofit public service, in the new economics, news departments and pro-grams are expected to make money, and they do. CBS News spends about $500 million annually, and ABC and NBC each spend about $600 million. It’s estimated that in 2006 ABC made just under $100 million from commercials aired on the news alone. NBC News earns about $270 million; CBS, a bit more. Executives at ABC have been quoted as saying that while being number one in the ratings used to be worth an additional $30 million, it is no longer true. The new standard of success, ABC says, is how the demographic of the audience breaks down into age groups, with younger viewers favored by advertisers.
Si le service public joue un rôle dans le choix des programmes d'information diffusés, le principal facteur est le profit. En fait, alors que les opérations d'information étaient autrefois considérées comme un service public à but non lucratif, dans la nouvelle économie, les départements et les programmes d'information sont censés gagner de l'argent, et c'est ce qu'ils font. CBS News dépense environ 500 millions de dollars par an, et ABC et NBC environ 600 millions de dollars chacune. On estime qu'en 2006, ABC a gagné un peu moins de 100 millions de dollars grâce aux publicités diffusées dans les journaux télévisés. NBC News gagne environ 270 millions de dollars et CBS un peu plus. Des cadres d'ABC auraient déclaré que si le fait d'être numéro un dans l'audimat valait autrefois 30 millions de dollars supplémentaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le nouveau critère de réussite, selon ABC, est la répartition démographique de l'audience par tranches d'âge, les jeunes téléspectateurs étant privilégiés par les annonceurs.
Of course, some news professionals believe that news departments dedicated to good, solid journalism will bring credibility to the whole broadcast network or local station and that therefore profit should come second to educating the public for the common good. But news professionals aren’t usually as powerful as accountants. The idea is to make as much money as possible from news departments, sometimes to the detriment of truth and journalism.
Every broadcaster tries to determine how much programs are worth to the advertiser. But since they cannot go around to every home to find out what everyone is watching, broadcast- ers depend on ratings systems to measure audiences. Companies that do the surveys, such as Nielsen and Arbitron, use so-called scientific samples to find out how many people are watching each show. Nielsen not only measures how many people are watching each show but, since January 2006, esti-mates how many watch the show after recording it on a DVR (digital video recorder). In 2007, it started reporting the average audience for the commercials in a given show, including commercials seen, and not fast-forwarded, via DVR.
Bien sûr, certains professionnels de l'information pensent que les services d'information qui se consacrent à un journalisme de qualité et solide apporteront de la crédibilité à l'ensemble du réseau de radiodiffusion ou à la station locale et que, par conséquent, le profit devrait passer après l'éducation du public pour le bien commun. Mais les professionnels de l'information ne sont généralement pas aussi puissants que les comptables. L'idée est de faire le plus d'argent possible avec les services d'information, parfois au détriment de la vérité et du journalisme.
Chaque radiodiffuseur essaie de déterminer la valeur des programmes pour l'annonceur. Mais comme ils ne peuvent pas se rendre dans chaque foyer pour savoir ce que tout le monde regarde, les radiodiffuseurs dépendent des systèmes d'évaluation pour mesurer l'audience. Les sociétés qui réalisent les enquêtes, telles que Nielsen et Arbitron, utilisent des échantillons dits scientifiques pour déterminer combien de personnes regardent chaque émission. Nielsen ne se contente pas de mesurer le nombre de personnes qui regardent chaque émission mais, depuis janvier 2006, estime le nombre de personnes qui regardent l'émission après l'avoir enregistrée sur un DVR (enregistreur vidéo numérique). En 2007, Nielsen a commencé à communiquer l'audience moyenne des publicités d'une émission donnée, y compris les publicités vues et non visionnées en avance rapide via un enregistreur numérique.
In the Nielsen Media Research measurement system, a rating point represents 1,128,000 households or 1 percent of the nation’s estimated 112.8 million TV homes (homes with television sets). This share is the percentage of television sets being used, tuned to a given show. In September 2007, Nielsen announced that by 2011 it would be tripling the size of its National People Meter television ratings sample. To project national ratings, Nielsen now takes viewing information from twelve thousand U.S. households and thirty-five thousand people. That sample will increase to thirty-seven thousand homes and one hundred thousand people. Meanwhile, a large group of viewers may consist of a few thousand people. From time to time the sample may be exactly representational, but not always—not by a long shot. In one case, a blind fan living in the Bridgeport, Connecticut, area represented a hundred thousand people. He enjoyed listening to television; the shows with the most interesting soundtrack got his vote.
Dans le système de mesure de Nielsen Media Research, un point d'audience représente 1 128 000 foyers ou 1 % des 112,8 millions de foyers TV (foyers équipés d'un téléviseur) que compte le pays. Cette part correspond au pourcentage de téléviseurs utilisés, branchés sur une émission donnée. En septembre 2007, Nielsen a annoncé que d'ici 2011, elle triplerait la taille de son échantillon d'audiences télévisuelles National People Meter. Pour établir des projections d'audiences nationales, Nielsen prend actuellement des informations sur l'écoute de douze mille foyers américains et trente-cinq mille personnes. Cet échantillon passera à trente-sept mille foyers et cent mille personnes. Entre-temps, un grand groupe de téléspectateurs peut être composé de quelques milliers de personnes. De temps en temps, l'échantillon peut être exactement représentatif, mais pas toujours, loin s'en faut. Dans un cas, un fan aveugle vivant dans la région de Bridgeport, Connecticut, représentait une centaine de milliers de personnes. Il aimait écouter la télévision et votait pour les émissions dont la bande sonore était la plus intéressante.

"(...) Serious journalists and social critics have an answer, at least as far as news is concerned. It is this: when providing entertainment, the public’s preferences must be paramount. But news is different. There are things the public must know whether or not they “like” it. To understand what is happening in the world, and what it means, requires knowledge of historical, political, and social contexts, It is the task of journalists to provide people with such knowledge. News is not entertainment. It is a necessity in a democratic society. Therefore, TV news must give people what they need along with what they want. The solution is to present news in a form that will compel the attention of a large audience without subverting the goal of informing the public.
Les journalistes sérieux et les critiques sociaux ont une réponse, du moins en ce qui concerne les informations. Elle est la suivante : lorsqu'il s'agit de divertissement, les préférences du public doivent être primordiales. Mais l'information est différente. Il y a des choses que le public doit savoir, qu'il les « aime » ou non. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde et ce que cela signifie, il faut connaître les contextes historiques, politiques et sociaux. L'information n'est pas un divertissement. C'est une nécessité dans une société démocratique. Par conséquent, les journaux télévisés doivent donner aux gens ce dont ils ont besoin en même temps que ce qu'ils veulent. La solution consiste à présenter les informations sous une forme qui retiendra l'attention d'un large public sans compromettre l'objectif d'information du public.
But as things stand now, it is essential that any viewer understand the following when turning on a TV news show :
1. American television is an unsleeping money machine.
2. While journalists pursue newsworthy events, business- oriented management often makes decisions based on business considerations.
3. Many decisions about the form and content of news programs are made on the basis of information about the viewer, the purpose of which is to keep viewers watching so that they will be exposed to commercials.
This is, obviously, not all that can be said about news. If it were, we could end our book here. But anything else that can, and will, be said must be understood within the framework of TV news as a commercial enterprise."
Mais dans l'état actuel des choses, il est essentiel que tout téléspectateur comprenne ce qui suit lorsqu'il regarde un journal télévisé :
1. La télévision américaine est une machine à fric qui ne dort pas.
2. Alors que les journalistes s'intéressent aux événements dignes d'intérêt, les dirigeants d'entreprise prennent souvent des décisions fondées sur des considérations d'ordre commercial.
3. De nombreuses décisions concernant la forme et le contenu des programmes d'information sont prises sur la base d'informations concernant le téléspectateur, l'objectif étant de maintenir le téléspectateur à l'écoute afin qu'il soit exposé à la publicité.
Ce n'est évidemment pas tout ce que l'on peut dire sur l'information. Si c'était le cas, nous pourrions terminer notre livre ici. Mais tout ce qui peut être dit, et qui le sera, doit être compris dans le cadre de l'information télévisée en tant qu'entreprise commerciale.
(...)

Chapitre 1 : News as Entertainment
Thèse : La télévision privilégie le spectacle et l'émotion, ce qui conduit à un traitement superficiel des nouvelles. Les informations télévisées sont souvent formatées pour capter l’attention, au détriment de la complexité ou de la véracité.
Exemples : Les segments courts, les musiques dramatiques et les présentateurs charismatiques montrent que l’objectif principal des chaînes est de maintenir l’audience, et non d’éduquer.
Chapitre 2 : The Economics of Television News
Thèse : Les informations télévisées sont motivées par des considérations commerciales. Les chaînes de télévision dépendent de leurs sponsors publicitaires, ce qui influence directement le contenu des programmes.
Analyse : Les sujets traités (ou ignorés) sont souvent dictés par la peur de perdre des annonceurs ou de contrarier des intérêts économiques.
Chapitre 3 : What Is News?
Thèse : Ce qui est considéré comme "nouvelle" est souvent déterminé par sa capacité à capter l'attention, et non par sa pertinence ou son importance.
Analyse : Les chaînes choisissent des histoires sensationnelles ou visuelles, ignorant souvent des sujets complexes comme la politique étrangère ou les questions sociales profondes.
Chapitre 4 : The Role of Anchors and Journalists
Thèse : Les présentateurs et journalistes télévisés jouent un rôle clé dans la perception des nouvelles, mais leur image est souvent construite pour inspirer confiance, plutôt que pour refléter une expertise réelle.
Critique : Postman et Powers analysent comment l’apparence et le ton des présentateurs influencent le message plus que le contenu lui-même.
Chapitre 5 : Images vs. Words
Thèse : La domination des images dans les nouvelles télévisées réduit la capacité des téléspectateurs à réfléchir de manière critique. Les images évoquent des émotions instantanées, mais elles ne fournissent souvent pas assez de contexte ou de profondeur.
Exemple : Une image d’une catastrophe naturelle peut émouvoir, mais sans explication, elle ne permet pas de comprendre les causes ou les solutions possibles.
Chapitre 6 : The Problem of Time
Thèse : Les limitations de temps dans les bulletins d'information télévisés entraînent une simplification excessive des histoires complexes. Cette contrainte pousse également à un traitement fragmenté des sujets.
Exemple : Une question géopolitique complexe peut être réduite à un segment de 30 secondes, ce qui empêche les téléspectateurs de comprendre réellement les enjeux.
Chapitre 7 : Advertising and News
Thèse : La publicité influence directement le contenu des nouvelles. Les chaînes évitent de traiter certains sujets qui pourraient aliéner leurs annonceurs.
Critique : Postman et Powers montrent comment les nouvelles peuvent devenir des outils de promotion pour des produits ou des idées.
Chapitre 8 : How to Watch TV News
Thèse : Les téléspectateurs doivent adopter une approche critique et active face aux nouvelles télévisées, en posant des questions sur la source, le contexte et les motivations derrière chaque histoire.
Conseils pratiques :
Toujours vérifier les faits à travers plusieurs sources.
Se demander pourquoi certaines histoires sont diffusées et d'autres non.
Reconnaître les biais commerciaux et narratifs des chaînes.
L’avenir de l’information dépend de la capacité des citoyens à consommer les médias de manière critique. Si les téléspectateurs ne développent pas une pensée indépendante, ils risquent d’être manipulés par des intérêts commerciaux ou politiques...
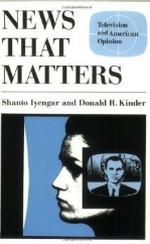
Shanto Iyengar & Donald Kinder, "News That Matters, Television and American Opinion" (1987)
Un livre pionnier en communication politique écrit par deux politologues et chercheurs américains renommés, spécialisés en communication politique, qui analyse l’influence des médias télévisés sur l’opinion publique américaine, à travers des expériences contrôlées. Les auteurs démontreront ainsi comment les journaux télévisés recadrent les priorités des citoyens et influencent leurs jugements.
Leur livre commun a marqué un tournant en mettant en évidence expérimentalement trois mécanismes clés :
- L’agenda-setting (les médias disent "à quoi penser").
- Le priming (ils influencent les critères d’évaluation des dirigeants).
- Le framing (ils façonnent l’interprétation des faits).
Utlisant dans leurs travaux une méthodologie innovante : contrairement aux études antérieures (souvent basées sur des sondages), ils ont utilisé des expériences contrôlées pour prouver la causalité entre exposition médiatique et changement d’opinion.
Shanto Iyengar est professeur à l’Université de Stanford et auteur de "Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues" (1991) et "Media Politics: A Citizen’s Guide" (2011). Donald R. Kinder est professeur émérite à l’Université du Michigan, spécialiste des émotions en politique, auteur de "Divided by Color: Racial Politics and Democratic Ideals" (1996) et "The End of Race? Obama, 2008, and Racial Politics in America", 2012).
Leurs travaux ont inspiré des générations de chercheurs en communication politique, dont Robert Entman (framing) ou Max McCombs (agenda-setting). Leur modèle a été adapté à l’ère numérique (réseaux sociaux, algorithmes). Et si certains leur reprochent une vision trop "passive" du public, négligeant l’interprétation active des audiences, leurs thèses expliquent des phénomènes actuels tels que la montée des fake news (priming émotionnel sur les réseaux sociaux), la polarisation politique (cadrage médiatique divergent sur Fox News vs CNN), l’influence des algorithmes (agenda-setting numérique via YouTube ou Facebook).
Leur analyse se concentre donc sur les principaux effets médiatiques suivants ...
1) L’ "agenda-setting" : Les médias dictent ce à quoi on pense (À quoi penser ?)
Une théorie majeure en communication politique, développée initialement par McCombs & Shaw (1972) et approfondie par Iyengar & Kinder (1987). Elle explique comment les médias influencent les priorités du public en déterminant quels sujets sont perçus comme importants.
Plus un thème est couvert par les médias, plus le public le considère comme prioritaire, indépendamment de sa réalité objective.
Les Deux Niveaux de l’Agenda-Setting
- Niveau 1 : L’agenda des sujets - Les médias sélectionnent et hiérarchisent l’information (ex. inflation > climat). Le public adopte cette hiérarchie comme sienne.
- Niveau 2 : L’agenda des attributs (McCombs, 1997) Les médias influencent aussi comment un sujet est perçu (ex. cadrer l’immigration comme "problème de sécurité" vs "droit humain").
Les Mécanismes Clés :
- Fréquence et saillance : Un sujet répété devient "important".
- Ommission : Ce qui n’est pas médiatisé n’existe pas pour le public.
- Interagenda : Les médias influencent aussi l’agenda politique (ex. les élus réagissent aux sujets médiatisés).
Parmi les exemples concrets, le cas du COVID-19 (en 2020, la couverture médiatique massive a fait de la pandémie la priorité n°1, reléguant d’autres enjeux tels que chômage et climat) et les citoyens ont exigé des mesures sanitaires, même sans expertise médicale. Aute exemple, l'environnement : le climat devient prioritaire quand les médias en parlent (ex. rapports du GIEC), puis retombe dans l’oubli.
L'effet n'est pas pour autant uniforme et son impact dépend de l’éducation, des croyances, et de l’expérience personnelle. Et parfois, c'est le public qui influence les médias (ex. mouvements sociaux comme #MeToo).
On peut noter toutefois que si les médias ignorent des crises (ex. inégalités), elles ne seront pas traitées, et que les partis politiques se hâtent d'adapter leurs discours aux sujets médiatisés.
La presse peut ne pas réussir la plupart du temps à dire aux gens quoi penser, a écrit Bernard Cohen (1963), précurseur de la théorie, mais elle réussit brillamment à leur dire à quoi penser.
2). Le "priming" : Les médias influencent comment on évalue les dirigeants (Sur quoi juger ?)
Le priming (ou "amorçage") est un concept clé en psychologie politique et en communication : il décrit comment les médias activent certains critères dans l'esprit du public, influençant ainsi la manière dont les citoyens évaluent les dirigeants, les politiques ou les enjeux sociaux. En exposant le public à certains thèmes (ex. l’inflation, la criminalité), les médias "amorcent" des critères spécifiques qui deviennent saillants lors des jugements politiques.
Trois mécanismes Clés sont identifiés :
- une activation cognitive : Un sujet médiatisé réactive des associations mentales (ex. "immigration" veut dire "insécurité").
- un effet de récence : Plus un thème est récent dans l’actualité, plus il pèse dans l’évaluation des dirigeants.
- la sélectivité : le priming ne fonctionnera que si le thème est perçu comme pertinent (ex. l’économie en période de crise).
Ainsi, en France, , la surmédiatisation des violences urbaines avant une élection peut avantager les discours sécuritaires.
On peut noter que le "priming" s’estompe si le thème disparaît des médias, que dans l’ère numérique, chacun peut être "amorcé" par des bulles différentes, et que les individus éduqués ou très politisés sont moins influençables.
3. Le "framing" : La présentation des faits change leur interprétation (Comment penser ?)
Le framing (ou "cadrage médiatique") est un concept central en sciences de la communication qui analyse comment la présentation d'une information influence sa perception et son interprétation par le public. Développé notamment par Robert Entman et inspiré des travaux d'Erving Goffman, ce concept complète l'agenda-setting et le priming dans l'étude des effets médiatiques. La manière dont un fait est raconté affecte davantage son interprétation que le fait lui-même : autrement dit, le même événement peut être perçu radicalement différemment selon son cadrage.
En terme de mécanismes clés, on peut distinguer la Sélection, ou le choix de certains aspects d'une réalité (et l'omission d'autres), la Mise en perspective (on va 'associer à des valeurs, émotions ou références culturelles), et les Effets proprement dits (influence sur les opinions, orientation des solutions envisagées).
Ainsi, si l'on aborde la "crise des migrants", suivant que l'on adopte un cadre sécuritaire, - "un Afflux migratoire menace l'ordre public" -, ou un cadre humanitaire, - "des familles fuyant la guerre" -, on suscitera soit un appel à des mesures restrictives, soit une réaction de compassion.
Autre exemple, la "Réforme des retraites" : dans un cadre de "justice générationnelle", "Les jeunes paient pour les boomers" invoque un soutien à la réforme, alors que dans celui dit de "régression sociale", une "Destruction des acquis" génère une mobilisation d'opposition.
Exemple bien connu relatif au "Changement climatique" : un cadre "catastrophe" type "Dernier avertissement pour la planète", suscitera anxiété et sentiment d'impuissance; un cadre type "opportunité" traduira "Transition créatrice d'emplois verts", soit un engagement positif.
La télévision ne se contente pas de montrer des événements ; elle leur donne un sens en les organisant en récits dotés de caractéristiques narratives précises ...
Lyengar et Kinder ont également abordés l'impact de certaines caractéristiques des reportages télévisés sur leur efficacité. Leur approche expérimentale permettra d'identifier plusieurs facteurs clés qui amplifient l’effet des médias sur l’opinion...
-1). La Répétition : plus un sujet est répété, plus il devient saillant dans l’esprit du public (renforcement de l’agenda-setting et du priming). Dans leurs expériences, les participants exposés à des reportages répétés sur la pollution la classaient comme priorité nationale, même sans changement objectif de la situation.
- 2). L’Ordre de Présentation : Les sujets placés en début de journal (ouverture) ont un impact plus fort que ceux en fin de programme. L’attention du public est maximale au début, et décroît avec le temps (effet de "fatigue cognitive").
- 3). Le Ton Émotionnel : les reportages utilisant des émotions négatives (peur, colère) marquent davantage les esprits. Un reportage sur la pauvreté avec des images d’enfants affamés influence plus l’opinion qu’une analyse statistique. Ce cadrage émotionnel (emotional framing) active des biais cognitifs et facilite la mémorisation.
- 4). La Personnalisation : focus toute sur des individus. Les histoires personnelles (ex. un chômeur racontant son parcours) sont plus persuasives que les données abstraites. Cela active l’empathie et rend les problèmes concrets (cadre épisodique vs thématique).
- 5). La Source perçue comme Crédible : Journalistes experts vs présentateurs. Les segments présentés par des correspondants spécialisés (ex. un envoyé à l’étranger) sont perçus comme plus fiables. Le public accordera plus de poids à leur contenu (renforcement du priming).
- 6). La Durée du Segment : un sujet traité pendant 3 minutes est perçu comme plus crucial qu’un sujet de 30 secondes. Les médias utilisent cette logique pour signaler implicitement leurs priorités éditoriales.
- 7). L’Interaction avec les Prédispositions du Public : l’impact d’un reportage est plus fort sur les publics pPeu politisés (moins de filtres critiques), sans expérience directe du sujet (ex. un téléspectateur urbain sur les questions agricoles).
Ces mécanismes ont le mérite d'expliquer la viralité des vidéos choc sur les réseaux sociaux (ex. guerre en Ukraine), l’efficacité des "storytelling" politiques (ex. discours politique émaillé de témoignages), les biais des JT ou la surreprésentation des faits divers (émotionnels) vs les sujets complexes (ex. réforme des retraites).

On peut rappeler ici l'ouvrage fondamental, incontournable, de Noam Chomsky & E. Herman, "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), qui analyse en profondeur le rôle joué par les médias dominants dans les démocraties occidentales, en particulier aux États-Unis. et démontre que les médias de masse ne fonctionnent pas comme un simple outil d’information neutre, mais participent activement à la construction du consentement public en faveur des intérêts des élites économiques et politiques dominantes. Selon eux, ce consentement n'est pas imposé par la force, mais « fabriqué » subtilement à travers une sélection et un cadrage spécifiques de l'information.
Les 5 filtres du modèle de propagande proposés sont les suivants :
- Propriété et profit (Ownership) : les grands médias appartiennent à de vastes entreprises ou conglomérats, soumis à la logique du profit. Cette structure favorise systématiquement les intérêts des propriétaires et des actionnaires, conditionnant les choix éditoriaux.
- Financement par la publicité (Advertising) : Les médias dépendent massivement des revenus publicitaires. Pour attirer ces revenus, les médias doivent éviter des contenus ou analyses risquant d'offenser les annonceurs ou les intérêts commerciaux.
- Sources institutionnelles (Sourcing) : Les médias dépendent fortement de sources officielles (gouvernement, entreprises, agences d’information) pour l’information, créant une proximité et un alignement structurel avec ces institutions dominantes. La diversité des sources alternatives est marginalisée.
- Pressions politiques (Flak) : Des pressions explicites sont exercées contre les médias jugés trop critiques (via critiques publiques, campagnes médiatiques, menaces économiques ou politiques). Ces pressions entraînent une auto-censure constante des médias pour éviter les controverses.
- L’idéologie dominante (Anti-communism / Fear Ideology) : À l'époque de la parution du livre (1988), le communisme constituait une « idéologie de la peur » utilisée pour discipliner les débats et marginaliser toute remise en question profonde du système dominant. Aujourd'hui, d'autres menaces (terrorisme, islamisme radical, et bien d'autres parfaitement utilisées, notamment en Europe) remplissent cette fonction idéologique.
L'une des conséquences est bien connue : toute remise en question radicale du statu quo est écartée, et dépeinte comme extrême ou non crédible. L'alignement de certains médias sur le pouvoir est symptomatique de cette réalité ...
Le conformisme journalistique, reflet du conformisme du mainstream politico-médiatique détenteur du pouvoir, phénomène transnational, mais avec des nuances propres à chaque système médiatique, est un insidieux poison de nos démocraties, au-delà des invectives réductrices désormais systématiquement utilisés à défaut d'argumentaires probants.
"La Fabrication du consentement" (Manufacturing Consent), de Noam Chomsky & Edward S. Herman, bien que centré sur les médias américains, est essentiel pour comprendre les mécanismes de propagande et d’autocensure dans les démocraties occidentales. La théorie du "modèle de propagande" s’applique aussi aux médias européens, où la concentration des propriétaires et la dépendance aux sources officielles favorisent un récit uniforme. "Les Nouveaux Chiens de garde", de Serge Halimi (1997, mis à jour régulièrement), est une critique acerbe du journalisme de connivence en France, où les médias dominants reproduisent les discours économiques et politiques dominants (Halimi démontre comment les journalistes mainstream sont souvent proches des élites politiques et économiques, limitant la pluralité des opinions).

John Zaller, "The Nature and Origins of Mass Opinion" (1992)
Une analyse théorique et empirique qui analyse comment les citoyens ordinaires forment leurs opinions politiques sous l'influence des médias, des élites politiques, et de leur propre connaissance ou intérêt politique. À travers son modèle « Receive-Accept-Sample » (RAS), Zaller propose une théorie cohérente et influente de la formation des attitudes politiques au sein de la population. L’ouvrage de Zaller a profondément influencé la recherche sur l’opinion publique.
Le modèle « Receive-Accept-Sample » (RAS) explique la formation des opinions politiques en trois étapes clés :
- "Receive" (Réception) : Les individus reçoivent des informations principalement via les médias et les élites politiques. L’exposition à ces messages dépend largement de leur niveau d’attention et d’intérêt politique.
- "Accept" (Acceptation) : La probabilité qu’un individu accepte ou rejette un message dépend de ses connaissances politiques préalables et de ses prédispositions idéologiques. Les individus les plus informés sont souvent les plus sélectifs, acceptant principalement les messages en accord avec leurs croyances antérieures.
- "Sample" (Échantillonnage) : Lorsque les individus doivent exprimer leur opinion (dans un sondage, par exemple), ils puisent dans un « échantillon » des messages récemment mémorisés. Ainsi, les opinions exprimées ne sont souvent ni fixes ni cohérentes, mais dépendent fortement du contexte immédiat et des messages auxquels les personnes ont récemment été exposées.
Le rôle central des élites politiques et médiatiques - Zaller affirme que l’opinion publique n’est pas le simple reflet d’opinions individuelles stables, mais le résultat d’une interaction dynamique entre :
- des élites politiques (partis, dirigeants, groupes d’intérêt), qui modèlent activement l’agenda médiatique et politique.
- des médias, qui diffusent les messages des élites au grand public en jouant le rôle d’intermédiaires influents.
- et des individus qui se révèlent largement dépendants des informations fournies par les élites politiques et médiatiques pour former leur jugement politique.
Contrairement aux auteurs (comme Converse) affirmant que les citoyens ordinaires manquent totalement de cohérence idéologique, Zaller propose une vision nuancée. Pour lui, les individus possèdent souvent des préférences ou des valeurs fondamentales relativement stables (ex. : orientation partisane). Toutefois, leurs attitudes précises sur des enjeux spécifiques sont instables, car elles sont sensibles aux informations les plus récentes et au contexte médiatique immédiat.
En conclusion, Zaller met en garde contre la fragilité démocratique que représente une opinion publique aussi dépendante du contexte médiatique et des élites politiques. Et ce constat a des implications majeures en matière de manipulation politique, notamment en périodes électorales ou de crise. Les individus les mieux informés sont paradoxalement les moins influençables, car ils filtrent efficacement les messages en fonction de leurs préférences. En revanche, ceux qui disposent de faibles connaissances politiques sont particulièrement vulnérables aux manipulations ou aux fluctuations médiatiques.

Joseph Cappella & Kathleen Hall Jamieson, "Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good" (1997)
Deux chercheurs de référence en communication politique, analysent ici comment la couverture médiatique négative et centrée sur la stratégie politique génère un climat de cynisme chez les citoyens envers le système politique et ses acteurs.
À travers une série d’études empiriques (analyses du contenu médiatique durant les campagnes électorales américaines (présidentielles de 1992 et 1996)et une réflexion approfondie sur le discours médiatique, les auteurs démontrent que ce cynisme croissant entraîne une diminution de la confiance politique, de l’engagement citoyen et, à terme, un affaiblissement des fondements démocratiques.
"Horse-race journalism" (Journalisme de compétition) - Les auteurs analysent comment les médias privilégient systématiquement la couverture des stratégies électorales (sondages, tactiques, lutte pour le pouvoir) plutôt que la discussion sérieuse sur les enjeux politiques et sociaux. Ce journalisme réduit la politique à une simple compétition de pouvoir. Le « horse-race journalism » s’est intensifié avec l’arrivée d’Internet et des chaînes d’information en continu.
Cappella et Jamieson avancent ainsi l’idée selon laquelle la presse contribue activement à la production d’un climat généralisé de "cynisme politique" en se concentrant excessivement sur les stratégies électorales (« horse-race journalism ») et les aspects tactiques des campagnes, au détriment des enjeux politiques substantiels. Ce traitement médiatique répétitif crée une « spirale » : Cynisme croissant du public / Baisse de la participation démocratique / Amplification du cynisme dans les médias ...

Doris Graber, "Processing Politics : Learning from Television in the Internet Age " (2001)
La politologue Doris Graber étudie comment les citoyens acquièrent, traitent et retiennent les informations politiques à travers les médias, principalement la télévision, mais également en tenant compte de l’émergence de l’Internet.
En combinant psychologie cognitive et science politique, son ouvrage repose sur l’idée centrale que les individus ne consomment pas passivement les messages médiatiques ; au contraire, ils adoptent des stratégies cognitives spécifiques pour sélectionner, organiser, mémoriser et utiliser l'information politique.
Graber développe l’idée que les individus traitent activement les informations politiques selon des mécanismes cognitifs précis : sélection sélective, catégorisation et schématisation mentale. Les citoyens ne retiennent pas toutes les informations reçues ; ils privilégient celles qui correspondent à leurs schémas mentaux préexistants (belief systems).
Graber souligne que malgré ses limites (format court, superficialité, sensationnalisme), la télévision demeure une source majeure et souvent efficace d’information politique. Elle affirme que la télévision aide les citoyens à construire rapidement des représentations cohérentes (même simplifiées) de la réalité politique, favorisant un apprentissage rapide, mais parfois partiel ou biaisé.
Graber est parmi les premiers chercheurs à prendre au sérieux l’impact potentiel d’Internet sur l’apprentissage politique (l'analyse de Graber est largement ancrée dans le contexte médiatique américain). Elle prédit que la diversité et la flexibilité offertes par Internet pourraient améliorer la qualité du traitement de l’information politique chez les citoyens, même si elle met en garde contre les risques de fragmentation et d’information excessive (optiimisme excessif?).
Graber utilise des recherches empiriques approfondies (enquêtes, expériences cognitives, analyse de contenu médiatique) pour démontrer comment les citoyens interagissent avec les informations politiques. Elle montre empiriquement que les individus utilisent souvent des stratégies de simplification cognitive (raccourcis mentaux, stéréotypes, catégorisation), surtout face à des informations complexes.
Graber conclut que la télévision et Internet fournissent une citoyenneté globalement informée, mais cette information est nécessairement simplifiée et sélective. L’ouvrage souligne l’importance cruciale d’éduquer les citoyens à un usage critique et informé des médias pour améliorer la qualité démocratique du débat public.

"Media and Society", James Curran et Jean Seaton (2018)
Un ouvrage, considéré comme un classique des études médiatiques. Curran et Seaton nous livrent un examen critique du rôle des médias dans la société moderne et insistent sur la nécessité de garantir leur indépendance et de leur assurer la plus grande diversité possible. Les médias sont par nature associés à la construction du pouvoir au sein de la société, ils participent tant à son maintien ou à son renforcement qu'à sa contestation, ne serait-ce que par leur influence sur la manière dont les informations sont perçues. Dans une société démocratique, le rôle fondamental des médias, en tant qu'ensemble d'outils pour informer les citoyens et permettre le débat public, fait consensus.
Mais un tel rôle est le plus souvent compromis ne serait-ce par la concentration des médias dans les mains de quelques grandes entreprises, ou les pressions financières, la publicité, les impératifs de rentabilité qui en viennent à dicter le plus souvent les priorités des rédactions, au détriment d'un journalisme axé sur l'intérêt public.
1) Les médias ne se contentent pas de refléter la culture : ils la produisent et la transforment activement. Les auteurs nous proposent une analyse des effets des médias de masse sur les normes culturelles et les valeurs, et s'ils peuvent servir parfois d'intermédiaires en faveur de voix plus marginalisées, ils peuvent tout autant reproduire bien des stéréotypes et perpétuer ainsi bien des inégalités sociales, politiques et économiques.
2) L’impact des médias sur les politiques publiques : Curran et Seaton mettent en lumière l’influence des médias sur l’agenda politique et la formation des politiques publiques. Ils montrent comment les décideurs politiques utilisent les médias pour manipuler l’opinion publique.
3) Le rôle des publics : L’ouvrage souligne le rôle actif des publics dans la consommation des médias. Les publics ne sont pas passifs ; ils interprètent, rejettent ou adoptent les messages médiatiques en fonction de leurs propres contextes sociaux et culturels.
Les problématiques des médias traditionnels ayant été posées, ils convient de s'interroger sur la transition numérique qui les affectent aujourd'hui. Curran et Seaton en viennent à analyser comment l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux redéfinit le rôle des médias traditionnels, comme la télévision, la radio et la presse écrite.

Le sociologue britannique Nick Couldry a étudié la philosophie, les sciences politiques et sociales à l'Université d'Oxford, avant de s'imposer dans les études des médias, la théorie sociale et les pratiques numériques, d'où son approche interdisciplinaire. Son étude des pratiques numériques à l'ère de la mondialisation se double d'une analyse des dynamiques entre médias et structures de pouvoir globales. ll est en 2024 professeur de médias, communications et théorie sociale au London School of Economics and Political Science (LSE). Ses travaux influencent les chercheurs et les militants, ou non militants, intéressés par les enjeux critiques des médias contemporains...
Couldry a développé une approche originale pour analyser les médias, la "théorie des médias comme pratiques" (media as practice theory) : il considère les médias non seulement comme des institutions ou des technologies, mais comme des éléments fondamentaux des pratiques sociales quotidiennes. Et c'est dans cette perspective qu'il élabore une critique des structures médiatiques : comment les médias modèlent les perceptions collectives, reproduisent les structures de pouvoir et renforcent les inégalités sociales.
Ainsi, "Media, Voice, Space and Power: Essays of Refraction" (2019), entreprend les relations complexes entre les médias, la voix, l'espace et le pouvoir dans la société contemporaine. "Media: Why It Matters" (2019) nous explique l'importance des médias dans la société moderne, en mettant en lumière leur influence sur la culture, la politique et les interactions sociales. "The Mediated Construction of Reality" (2016), coécrit avec Andreas Hepp, propose une approche phénoménologique et communicationnelle des phénomènes sociotechniques, en étudiant comment les médias reconstruisent notre perception de la réalité. "Media Consumption and Public Engagement: Beyond the Presumption of Attention" (2007), écrit en collaboration avec Sonia Livingstone et Tim Markham, se penche sur la consommation médiatique et l'engagement public, remettant en question les présomptions traditionnelles sur l'attention des audiences. "Listening Beyond the Echoes: Media, Ethics, and Agency in an Uncertain World" (2006) traite de l'éthique des médias et de l'importance de l'écoute active dans un monde incertain. ...

Nick Couldry, "The Place of Media Power : Pilgrims and Witnesses of the Media Age" (2000)
Couldry remet en question les approches traditionnelles des études médiatiques, notamment celles qui traitent les médias comme des outils neutres de transmission : les médias sont des institutions de pouvoir, qui influencent les pratiques culturelles quotidiennes, les croyances collectives et la construction de l’autorité.
Couldry en appelle, à partir de ce constat, à une prise de conscience critique des récits médiatiques et à une résistance face aux rituels et aux structures de pouvoir des médias traditionnels.
Les médias comme lieux de pouvoir : les médias ne se contentent pas de refléter la réalité, mais la reproduisent et la produisent activement. Ces médias jouent un rôle central dans la construction des hiérarchies culturelles et des récits dominants. Le concept de "place of media power" (lieu du pouvoir médiatique) permet d'élaborer une représentation de ces institutions, pratiques et symboles médiatiques qui se sont arrogés le droit de définir ce qui est légitime dans le discours public.
Une telle évidence n'est pas d'évidence : ces médias sont investis d’une autorité quasi-mystique dans la société moderne, ce que Couldry qualifie de "media ritual". Ces rituels, tels que les événements médiatisés ou la manière dont les médias présentent leurs narratifs, renforcent l'idée que les médias sont les arbitres de la vérité et de la réalité. Une "mythologie médiatique", qui va naturaliser le rôle central des médias dans la société sans remettre en question leur pouvoir.
Couldry introduit un autre concept, celui de "media pilgrimage", pélerinage singulier qui décrit ces pratiques sociales qui voient les individus se rendre dans des lieux associés aux médias, comme les studios de télévision ou les lieux où sont tournés des films emblématiques. Des pèlerinages qui symbolisent la manière dont les médias sont perçus comme des centres d'autorité culturelle et de légitimité.
Il faut de même s'interroger sur un des rôles incontournables que l'on attribue par définition aux médias, celui d'être des témoins objectifs de la réalité. Couldry critique cette idée, affirmant que ce rôle de témoin n'est jamais neutre et est toujours structuré par les hiérarchies de pouvoir et les objectifs économiques ou politiques des institutions médiatiques.
Enfin, Couldry analyse comment les individus sont aliénés par les récits médiatiques, qui ne reflètent pas nécessairement leur réalité quotidienne.
Un constat parfaitement étayé qui conduit à une distance critique envers les médias, globalement ressenti et bien que ces derniers continuent de dominer les discours publics. Prendre en compte le potentiel des médias alternatifs pour défier les récits dominants semble une ouverture ...

"Media, Society, World : Social Theory and Digital Media Practice", Nick Couldry (2012)
Couldry s'éloigne de la vision traditionnelle des médias comme simples canaux de transmission d'informations ou outils techniques, et adopte une approche centrée sur les pratiques sociales, suggérant que les médias sont mieux compris à travers ce que les gens font avec les médias plutôt qu'à travers leur contenu ou leurs structures techniques : les interactions traditionnelles sont remodelées ou remplacées par des interactions médiées, et le rôle des individus redéfinis dans un écosystème médiatique où il sont simultanément producteurs et consommateurs.
Pour Couldry, les médias ne sont plus une simple partie de la vie sociale mais constituent une structure fondamentale dans la société contemporaine : via le concept de mythe du centre, il nous explique que les médias créent une illusion d'un point central de la vie sociale où les significations se concentrent, et cette notion de centralité des médias dans la société va reconfigurer les perceptions du pouvoir et des relations sociales.
L'auteur examine ensuite comment les dynamiques de pouvoir sont reproduites et amplifiées par les médias numériques, et comment elles vont ainsi contribuer à des inégalités sociales.
Couldry critiquera dans cette perspectives les pratiques dominantes des grandes plateformes et leur impact sur la démocratie et les droits individuels.
Comment les médias connectent les individus dans un monde globalisé, permet de s'interroger sur les inégalités d'accès et les asymétries de pouvoir dans la production et la consommation médiatiques. Les médias participent à la construction de ce qu’il appelle un "imaginaire global", une perception partagée du monde façonnée par des narrations médiatiques dominantes.
Enfin, l'auteur analyse le rôle des médias numériques dans la constitution du soi contemporain : les pratiques médiatiques sont devenues partie intégrante de l'identité individuelle. Les réseaux sociaux et les pratiques de partage numérique sont particulièrement étudiés comme des formes de performance identitaire.

Dans "Media: Why It Matters" (2020, Polity Press), N. Couldry nous rappelle que les médias ne sont pas de simples outils de communication, mais des infrastructures de pouvoir qui façonnent nos réalités sociales, nos identités et nos inégalités.
Leur importance réside dans leur capacité à organiser symboliquement le monde, bien au-delà de leur fonction technique.
- Les médias comme « infrastructures de connexion » : ils relient les individus, mais ces connexions reproduisent ou amplifient des dynamiques de pouvoir existantes (classe, race, genre). Ainsi, par exemple, les plateformes numériques capitalisent sur nos interactions tout en naturalisant leur contrôle (cf. critique du data extractivism). On peut renvoyer à deux ouvrages collectifs de Couldry, "Data Grab: The new Colonialism of Big Tech and how to fight back" (2024) et "The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism (Culture and Economic Life, 2019).

- Le paradoxe du pouvoir médiatique ...
Plus les médias étendent leur emprise (via l’ubiquité numérique), plus ils deviennent invisibles comme structures de pouvoir.
Et cette invisibilité empêche une remise en question collective (ex. : l’acceptation sans critique des algorithmes).
Tout comme, il y a quelques décennies, les humains ont commencé à concevoir le monde physique comme un environnement - une écologie qu’ils pouvaient améliorer ou détériorer -, nous devons peut-être aujourd’hui, écrit Nick Couldry, développer une approche « environnementale » (voire écologique) pour penser les médias. ...
Les médias sont en effet des technologies permettant de transmettre et d'archiver ce que l’industrie médiatique appelle des « contenus » : des symboles, des images et des sons qui ont une signification. Le sens est une dimension essentielle de la vie humaine : un monde qui n’aurait ni signification ni sens pour nous serait un monde véritablement terrifiant. Ainsi, les médias, en véhiculant du sens, rendent nos vies vivables : en faisant circuler des significations d’un lieu à un autre, ils connectent des espaces et contribuent à construire des territoires. La connexion est la première manière dont les médias aident à construire les mondes dans lesquels nous vivons. Mais la façon dont ils le font est complexe.
Imaginons que nous ayons élaboré un moyen de connecter des personnes qui normalement ne se connaissent pas, et que cela les aide à découvrir ce qu’elles ont en commun ; supposons que cela fonctionne bien et que nous parvenions à transformer cette découverte en quelque chose de durable, c’est-à-dire que de plus en plus de personnes commencent à utiliser cette plateforme, en liant leur vie à cet espace de connexion. Multiplions cela des millions de fois, et nous aurons une idée de ce qui est devenu une caractéristique courante du XXIᵉ siècle.
Voici un paradoxe décisif concernant la manière dont les médias opèrent dans la société contemporaine : rien qu’en connectant de nombreuses personnes et en leur permettant de se lier entre elles, les médias finissent par acquérir une forme de pouvoir au sein de la société : ils déterminent la façon dont elle se construit, un pouvoir que les développeurs ne cherchaient pas nécessairement à avoir. Ce paradoxe a marqué toutes les technologies médiatiques des quatre derniers siècles, même si chaque époque, y compris la nôtre, doit faire face à une forme particulière de ce phénomène.
Aujourd’hui, le paradoxe du pouvoir médiatique découle de l’ampleur et de la vitesse avec lesquelles les médias connectent les personnes et les choses, ainsi que du lien complexe entre ces connexions et le tissu de notre vie. Nous avons déjà vu qu’il est difficile pour beaucoup de se passer des médias : cela révèle leur capacité à influencer le fonctionnement des sociétés et à avoir des implications concrètes — pour ceux que les plateformes connectent, pour ceux qui en sont exclus, et pour la plupart des gens qui se contentent d’utiliser ces connexions sans pouvoir en influencer l’organisation.
À l’ère contemporaine, il est pertinent de concevoir les médias non pas comme un simple outil isolé (télévision, radio, une plateforme numérique ou une application spécifique), mais comme des infrastructures interconnectées qui rendent possible un certain mode de vie. Je les appellerai infrastructures de connexion. Ce concept nous aide à distinguer ce qu’il y a de distinctif et d’universel dans le monde que les médias contribuent aujourd’hui à construire.
En tant qu’infrastructures de connexion, les médias ont dû, au fil du temps, surmonter plusieurs contraintes :
- Le besoin d’un support matériel capable de véhiculer du sens (pierre, papyrus, parchemin, papier, ou même l’air, comme dans le cas des torches) ;
- Le besoin de substances pour marquer ce support (outils pour le tailler, encre, feu) ;
- Et généralement, le besoin d’un moyen permettant au support de traverser l’espace (câbles de cuivre, ondes radio, mouvement d’un corps humain, chevaux ou même pigeons voyageurs).
(...)

- L’écologie des médias ...
Couldry propose une approche écologique pour analyser les médias compte tenu de leur Interdépendance (les médias forment un écosystème où chaque acte de communication a des répercussions systémiques, que l'on pense à la fameuse viralité des fausses nouvelles), et de leur fragilité (comme un environnement naturel, cet écosystème peut être détruit par la surcharge informationnelle ou la centralisation monopolistique, ainsi Google, Meta).
Les médias comme environnement ...
Tout ceci met en lumière une question centrale de ce chapitre : les médias, en nous connectant toujours davantage et de multiples façons, ne se contentent pas d’influencer les rapports de pouvoir – ils créent de nouveaux instruments de pouvoir, de nouveaux espaces de conflit et, peut-être, de coopération. Une idée très répandue – mais trompeuse – voudrait que ce que les médias offrent soit soit entièrement « bon », soit entièrement « mauvais ». Comment tirer des conclusions aussi tranchées quand les médias relient des milliards de personnes, leur permettant de faire presque tout ce qu’elles désirent ?
Les médias, un écosystème complexe
Les médias interconnectent nos mondes de manière complexe. Nous en prenons conscience lorsque nous considérons le réseau d’interrelations dans lequel nous vivons. Il y a tant de choses que nous faisons grâce aux médias – et que les médias nous permettent – qu’aujourd’hui, il faut les concevoir en termes d’environnement, un environnement essentiel à notre vie contemporaine.
Nous n’hésitons pas à parler d’« environnement » pour décrire les espaces où vivent d’autres espèces. En biologie ou en zoologie, nous ne parlons pas d’animaux isolés, ni même de sources de nourriture individuelles, mais bien d’écologies entières d’éléments en interaction – des écosystèmes qui, comme nous le savons hélas, peuvent être douloureusement fragiles.
Une approche écologique des médias
Penser les médias de manière écologique implique non seulement de réfléchir aux technologies que nous utilisons, mais aussi aux conséquences à long terme des médias sur nos relations humaines. Une caractéristique décisive de l’écologie médiatique contemporaine, qui la distingue des phases antérieures de son histoire, est son interactivité. Aujourd’hui, un simple ordinateur suffit pour envoyer et recevoir des messages depuis n’importe quel point du globe.
Grâce à Internet et à son architecture dite « end-to-end », en principe, chacun d’entre nous peut transmettre un message à toutes les destinations qu’il souhaite – et même compter sur d’autres pour le relayer. Cela signifie que nos usages d’Internet – nos choix quant aux images que nous partageons, aux liens que nous ouvrons – ne sont pas extérieurs à l’écologie des médias : ils en font pleinement partie.
Cependant, en nous connectant, les médias s’appuient sur des dynamiques de pouvoir préexistantes – celles qui façonnaient déjà les relations entre les personnes au travail, à l’école, dans les réseaux familiaux ou amicaux, les mouvements religieux, les associations politiques, ou encore entre classes sociales, genres, générations et races. À travers les connexions qu’ils rendent possibles, les médias contribuent à modeler le présent, mais toujours sur les fondations du passé. Et tout en donnant forme à des sociétés spécifiques, ils en proposent aussi des représentations particulières à leurs membres, qui peuvent ou non s’y reconnaître...

- Représentation vs. Réalité ..
On ne peut oublier que les médias ne reflètent pas le monde, mais le construisent à travers des récits dominants. Et cette construction va avantager certaines voix (élites politiques, entreprises) et en marginalise d’autres (mouvements sociaux, minorités)...
Ce qui polarise notre attention sur les médias, ce ne sont pas tant les connexions que les représentations. La réalité que les médias nous présentent hic et nunc nous excite : qu’il s’agisse d’un match diffusé en direct à la télévision ou d’un nouveau mannequin qui fait parler de lui. Nous ressentons le pouvoir des médias dans la colère que provoque en nous une image d’actualité, ou dans le désir de faire partie du monde que nous voyons dans un film.
La représentation est l’autre face de la connexion...
Les médias sont des infrastructures de connexion, mais ils sont aussi les significations qui circulent à travers ces infrastructures – des significations qui nous renvoient une image du monde. Comme toute représentation, elles peuvent être riches, ambiguës et générer des interprétations conflictuelles. Les médias sont donc à la fois :
- Infrastructure (le moyen technique),
- Signification (le message, pour reprendre les termes de Marshall McLuhan, le théoricien canadien des années 1960).
Comment les médias représentent-ils le monde ?
C’est la question que doivent garder en tête les stratèges de la communication politique et publicitaire. Il ne suffit pas d’atteindre les gens ou d’établir une connexion basique : il faut comprendre comment l’utiliser pour influencer les comportements. Représenter, c’est souvent persuader.
Les médias nous montrent un monde que nous ne pourrions autrement pas voir :
- Les animaux cachés dans une jungle lointaine ou au fond des océans,
- Le scandale d’un politicien ou d’une célébrité qui a mis des mois à éclater,
- Une cérémonie de signature réservée à la presse et aux grands dirigeants,
- Un défilé de mode destiné uniquement aux initiés.
Quand les médias nous montrent ces mondes éloignés, nous avons tendance à croire que nous y avons réellement accès. Mais cela revient à oublier le rôle des organisations médiatiques et de leurs professionnels dans la sélection des récits qui nous sont présentés.
Re-présentation : un terme clé
Parfois, pour revenir à la réalité et comprendre comment fonctionnent vraiment les médias, il est utile de remplacer le mot représentation par re-présentation (au sens de « présenter à nouveau »). Les médias nous présentent un monde pour susciter en nous une réaction – engagement, dégoût, fascination –, mais il ne s’agit jamais que d’une re-présentation, c’est-à-dire d’une version choisie par les médias de ce qu’ils ont eux-mêmes perçu, lu ou vu.
Derrière cette simple idée se cachent des bibliothèques entières d’études sur le travail des organisations médiatiques. Dans ce chapitre, nous resterons à un niveau abstrait pour dégager les aspects généraux de la représentation médiatique. Mais n’oublions jamais que, derrière ces processus, il y a des journalistes en chair et en os, des professionnels qui prennent des décisions dans des conditions de travail spécifiques :
- Choix éditoriaux, programmation, relations avec les annonceurs,
- Jugement sur la valeur d’une nouvelle ou l’opportunité de montrer telle ou telle image.
Enjeux politiques et démocratiques
La notion de re-présentation nous amène directement aux questions les plus complexes soulevées par les médias. Ce chapitre commence par montrer comment les représentations médiatiques transforment le monde, puis examine leur rôle en politique, notamment en démocratie. Enfin, nous aborderons les débats sur la représentation dans les médias sociaux – ces plateformes qui, en apparence, ne servent qu’à « connecter » les gens, mais qui, en réalité, re-présentent constamment le monde à leur manière.

Dans "On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century" (2017), l'historien Timothy Snyder aborde les médias comme un pilier crucial de la démocratie et un outil de résistance contre la tyrannie.
Snyder souligne que les dictatures du XXe siècle (nazisme, stalinisme) ont systématiquement détruit la presse libre pour imposer leur propagande. Les tyrans savent que contrôler l'information permet de manipuler la réalité et d'étouffer la pensée critique. Il met en garde contre la désinformation, une arme des régimes autoritaires pour semer la confusion et discréditer les faits : sans médias indépendants, les citoyens deviennent vulnérables, abandonner les faits, c’est abandonner la liberté ..
De même Snyder critique la dépendance aux réseaux sociaux et aux bulles informationnelles.
Il encourage à lire la presse papier (moins soumise au clic) et à privilégier des sources vérifiées.
Comment agir pour défendre les médias libres : entre autres, "soutenir le journalisme d’investigation" (et des médias indépendants), "sortir de sa zone de confort" en lisant des sources étrangères ou opposées à ses idées, "croire à la vérité" et refuser la complaisance envers les mensonges politiques.
Il rappelle que les régimes tyranniques distraient le public (par le spectacle ou la peur) pour détourner l’attention des abus de pouvoir. La passivité face aux médias de masse est un risque.
