- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

PAYSAGES - EUROPE DE L'OUEST - Western Europe ...
L’Europe est un continent composé de cinquante pays différents et qui peut-être divisée en régions : l'Europe de l'Ouest en est l'une d'entre elles, rassemblant une dizaine de pays, déroulant une région géographiquement variée, avec des montagnes majestueuses (Alpes, Pyrénées, etc.), des plaines agricoles fertiles (comme la vallée du Rhin), et une forte présence maritime (Atlantique, Manche, mer du Nord, Méditerranée). - Acteurs majeurs du commerce mondial, la plupart de ces pays font partie de l'Union européenne (UE), à l'exception du Royaume-Uni et de la Suisse. Son PIB global contribue significativement au PIB mondial (15-20 % du PIB mondial). Elle comprend il est vrai trois pays d'envergure au niveau mondial, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France ...
- Une Europe de l'Ouest que nous cantonnons ici au périmètre suivant : : Allemagne (84M), Belgique (11M8), France (67M), Royaume-Uni (67M), Pays-Bas (17M8), Irlande (5M3), Suisse (9M), Luxembourg, Monaco, Liechtenstein...
- Langues : région multilingue, avec une forte prévalence de la pratique de plusieurs langues, Allemand (90M), Anglais (400M), Néerlandais (23M), Français (80M), Irlandais (gaélique, 1M7), Gaélique écossais, Frison, Gallois, Breton, Occitan)...
- Villes: Berlin (3M8 millions), Hambourg (1M9), Munich (1M5), Paris (2M2), Marseille (870m), Londres (9M), Birmingham (1M1), Bruxelles (1M2), Amsterdam (900m), Dublin (1M3)..
- L'Allemagne, une organisation fédérale avec 16 Länder (régions), dotés d'une forte autonomie; la Belgique, un état fédéral divisé en trois régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) et trois communautés linguistiques (francophone, néerlandophone, germanophone); le Royaume-Uni, un modèle décentralisé avec des parlements autonomes en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord; les Pays-Bas, un état unitaire mais fortement décentralisé avec des provinces et des municipalités autonomes; face à ces différents modèles, le centralisme français que l'on présente encore comme un atout pour coordonner des projets nationaux majeurs, mais qui montre de plus en plus ses limites dans un contexte de mondialisation et d'inégalités territoriales croissantes...
- Les écrivains d'Europe de l'Ouest ont largement contribué à façonner la littérature mondiale et cette région, en incluant des pays majeurs comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, l'Italie et les pays scandinaves, représente environ 25 à 30 % de l'ensemble des nouveaux titres publiés dans le monde en terme de fiction, et entre 45 % et 50 % de la production mondiale pour la catégorie de non-fiction .. Une extraordinaire créativité qui semble progressivement se tarir depuis quelques décennies ...

Dans son ouvrage "Western Europe's Democratic Age: 1945–1968", Martin Conway analyse l'émergence, après la Seconde Guerre mondiale, d'un modèle stable et uniforme de démocratie parlementaire en Europe occidentale.
Il soutient que cette transformation démocratique résulte non seulement de la défaite du fascisme et du rejet du communisme, mais aussi de la collaboration entre élites, intellectuels et forces populaires. Ce consensus démocratique s'appuyait sur le suffrage universel et l'autorité étatique, tout en étant porté par des mouvements politiques, principalement chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, qui promouvaient des valeurs démocratiques.
Les années 1960 marque la fin de l'ère consensuelle de la démocratie parlementaire qui avait dominé après 1945, une décennie dont les événements vont préfigurer une période de plus grande polarisation et de défis pour les démocraties européennes, tout en révélant une évolution vers une politique plus diversifiée et contestée.
- Les hiérarchies traditionnelles de classe, de genre et de race, qui avaient jusqu'alors stabilisé l'ordre démocratique, deviennent la cible de critiques croissantes.
- Des mouvements de jeunesse, des féministes, des minorités ethniques et des intellectuels revendiquent une démocratie plus participative et inclusive.
- Les partis politiques dominants, tels que les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, perdent progressivement leur capacité à canaliser les aspirations populaires. La bureaucratisation des institutions démocratiques entraîne un désenchantement parmi les citoyens.
- Les anciennes puissances coloniales d’Europe occidentale (France, Royaume-Uni, Belgique, etc.) sont confrontées aux conséquences des luttes pour l’indépendance, qui remettent en question leurs identités nationales et leurs rôles mondiaux. Autant de bouleversements qui vont influencer également les débats sur l'immigration et le multiculturalisme.
- La période des Trente Glorieuses a produit une prospérité sans précédent, mais cette richesse croissante s’accompagne de revendications pour plus de libertés individuelles et une modernisation des valeurs sociales.
Conway analysera les événements de 1968, notamment les manifestations étudiantes, les grèves générales et les révoltes culturelles, comme un point culminant des tensions accumulées. Ces mouvements expriment une demande pour une démocratie plus participative et horizontale ..
(NDLR) En 2024, plus d'un demi-siècle plus tard, rien n'a véritablement évolué, nos baby-boomers triomphants, en pleine jouissance et sécurisation de leur monde, ont bloqués bien des initiatives ...

ECONOMIE - L'Europe de l'Ouest comprend certains des pays ayant des PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, comme le Luxembourg, la Suisse ou les Pays-Bas. Ces pays affichent des revenus moyens élevés et une répartition relativement équitable des richesses : les politiques fiscales et sociales réduisent efficacement les inégalités de revenus, notamment en Scandinavie, en Allemagne et aux Pays-Bas, ce qui n'est guère le cas dans les autres pays comme la France ...
On connaît les grandes forces et faiblesses des principaux pays composants l'Europe de l'Ouest (2024). L'Allemagne est toujours le moteur économique et l'"atelier" de l'Europe par ses exportations industrielle et son modèle de cogestion avec un taux de chômage relativement faible, une stabilité politique globale (malgré une montée des populisme et des défis sociaux); mais une dépendance au commerce extérieur, notamment vis-à-vis de la Chine, un vieillissement démographique préoccupant, des inégalités problématiques ouest-est. La France, un modèle étatique centralisé, un poids trop important de l'État dans l'économie (35% de l'emploi public), un chômage structurel élevé, des inégalités territoriales importantes, un endettement considérable résultat d'un "quoiqu'il en coûte" non maîtrisé, un modèle républicain incapable d'intégrer des diversités culturelles et un modèle de présidentialisme unique en Europe, mais désuet et conflictuel ; le Royaume-Uni du Post-Brexit en reconquête des marchés internationaux, un secteur financier dominant, mais une certaine fragmentation politique, des inégalités régionales et un risque de polarisation sociale ; la Belgique, avec une Flandre industrialisée face à une Wallonie en déclin économique relatif, des tensions communautaires autant politiques que culturelles, un secteur public généreux mais coûteux, avec une dette publique importante et une gouvernance complexe entre régions; les Pays-Bas, une économie libérale ouverte, une qualité de vie considérée comme élevée, mais avec une certane montée de la précarité, un consensus politique traditionnel, mais fragilisé par les tensions autour de l’immigration ...
Enfin, l'économie irlandaise, l'une des plus dynamiques d'Europe, souvent surnommée le "Tigre celtique" en raison de sa croissance rapide depuis les années 1990, de son attractivité pour les multinationales, de son dynamisme technologique, et de sa jeunesse démographique, souffre d'un PIB artificiellement gonflé par les profits des multinationales et de sa dépendance aux exportations...

CULTURE - La mondialisation est au coeur, comme dans tous les coins du monde, des évolutions qui semblent progressivement redéfinir le paysage culturel de l'Europe de l'Ouest, une mondialisation qui conduit à une profonde uniformisation des pratiques culturelles, si ce n'étaient les différences linguistiques qui restent encore des marqueurs d'identité nationale.
Face à des industries dites "créatives" (le cinéma, la musique la littérature) essentiellement anglophone, on peut observer que l'Allemagne y répond en offrant une alternative qui lui est propre et qui fonctionne, la Belgique et les Pays-Bas en assumant l'hybridité, des œuvres multilingues ou bilingues, et la France, une fois de plus, via des politiques de protection. Mais, désormais, dans cet environnement mondialisé, les langues influencent plus que jamais la diffusion des œuvres, un roman néerlandais ou flamand doit être traduit pour atteindre une audience internationale, ce qui limite son rayonnement par rapport à une œuvre directement publiée en anglais...
La culture allemande contemporaine semble désormais intégrer de plus en plus des récits des populations issues de l’immigration (notamment turques et syriennes) dans la littérature (Saša Stanišić), - comme le fit avant elle il y a déjà plusieurs décennies la France et le Royaume-Uni avec leurs anciennes colonies respectives -, le cinéma, et les arts visuels. Berlin, capitale culturelle européenne, est au cœur de la musique électronique mondiale et de l'art contemporain, un lieu de résidence pour de nombreux artistes internationaux. En terme de théâtre, des Institutions comme la Schaubühne continuent d’expérimenter des formes radicales, abordant des thèmes politiques et sociaux.
Le Royaume-Uni est dominé par des industries culturelles particulièrement puissantes, de nombreux artistes dominent aujourd'hui les scènes globales. Des universités comme Oxford et Cambridge continuent de jouer un rôle majeur dans les sciences humaines et artistiques, le volume et la qualité des publications qu'elles assument sont considérables. L’indépendance de l’Irlande, qui ne date que 1922, s'est accompagnée d'un certain regain du mouvement de la Renaissance celtique (Celtic Revival), qui cherchait à redécouvrir et à réaffirmer l'identité irlandaise face à l'oppression britannique (W.B. Yeats, Lady Gregory, et John Millington Synge, mythes celtiques et langue gaélique). Depuis la culture irlandaise, fortement enracinée dans les traditions nationalistes et catholiques, a évolué de manière significative, pour devenir notamment un acteur majeur dans l'industrie cinématographique mondiale. Sa diaspora, forte de plus de 70 millions de personnes d’origine irlandaise dans le monde, reste un élément clé de son identité.
La bande dessinée contemporaine reste, et ce n'est pas un cliché, un pilier culturel de la Belgique, mais les tensions entre Flandre et Wallonie semblent limiter toutes initiatives culturelles fédérales. Les Pays-Bas se positionnent à la pointe des arts conceptuels et numériques et ont su parfaitement utiliser la technologie pour accroître la renommée de leurs grands musées (Rijksmuseum, Van Gogh Museum), l'interaction avec le public étant le maître-mot de ces nouvelles stratégies. La France parvient à maintenir une renommée culturelle certaine via son passé d'une richesse exceptionnelle, ses institutions sont connues dans le monde entier (Festival de Cannes, musée du Louvre, musée d'Orsay) : mais on peut constater un certain essoufflement global de l'imagination qu'un savoir-faire technique ne parvient pas totalement à faire oublier à un public particulièrement demandeur en terme d'évènements...
Tous ces pays partagent tant un considérable désir de mise en scène de la part d'un public bénéficiant d'un bien-être important par rapport à d'autres parties du monde, que ce qu'on appelle une "globalisation culturelle accrue", grâce au numérique qui permet de réinventer ou de recycler du culturel une illusion de créativité suffisante : mais comme toujours, c'est bien le contenu qui vient à manquer, des enjeux suffisamment pensés pour en permettre une traduction culturelle (les questions écologiques, identitaires et mémorielles dominent, nous dit-on, le débat culturel, mais celui-ci reste, faute de réflexion suffisante, d'éducation et de concertation, relativement artificiel et superficiel). Au fond, vient à manquer, ici comme ailleurs, tout simplement, un soupçon de génie ou d'inventivité ...

Dans la plupart de ces pays, on n'ose véritablement parler encore d'un vaste sentiment de régression culturelle, voire politique, par rapport à l’influence globale et au renouvellement culturel marquant que connut le XXe siècle : une simple comparaison avec le siècle précédent suffit pour prendre conscience de cet écart, mais il est vrai que l'on pousse insensiblement les jeunes générations vers une sorte d'amnésie culturelle quand ce n'est de la distorsion et du détournement de sens...
En terme d'art, par exemple, le XXe a connu, en Europe de l'Ouest, plus d'une dizaine de mouvements révolutionnant l'histoire et un grand nombre de figures individuelles les transcendant, le tout dans une continuité créatrice se répondant les uns les autres (une liste qui peut paraître fastidieuse) ... le Fauvisme (1905-1910), Henri Matisse (La Joie de vivre, 1906), André Derain (Charing Cross Bridge, 1906) - Amedeo Modigliani (Jeanne Hébuterne, 1919) et l'Ecole de Paris - Le Cubisme (1907-1920), Pablo Picasso (Les Demoiselles d'Avignon, 1907), Georges Braque (Maisons à l'Estaque, 1908). - L'Expressionnisme (1905-1930), Die Brücke (Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde), Der Blaue Reiter (Wassily Kandinsky, Franz Marc). - Le Futurisme (1909-1918), Umberto Boccioni (Formes uniques de continuité dans l'espace, 1913), Giacomo Balla (Dynamisme d’un chien en laisse, 1912). - Dada (1916-1924), Marcel Duchamp (Fontaine, 1917), Hannah Höch (Cut with the Kitchen Knife, 1919). - Le Surréalisme (1924-1940), Salvador Dalí (La Persistance de la mémoire, 1931), René Magritte (Ceci n’est pas une pipe, 1929), Max Ernst (L'Eléphant Célèbes, 1921). - Le Bauhaus (1919-1933), Paul Klee, Wassily Kandinsky. - L'Art abstrait (1910-1950), le Constructivisme (Kazimir Malevitch, Carré noir sur fond blanc, 1915), De Stijl (Piet Mondrian, Composition avec rouge, jaune, bleu et noir, 1921). - Le Pop Art (1950-1970), Richard Hamilton (Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?, 1956), Eduardo Paolozzi. - L'Art informel et expressionnisme abstrait (1940-1960), Jean Dubuffet (Paysage avec un homme, 1944), Hans Hartung. - Les Nouveaux réalismes (1960-1970), Yves Klein (Anthropométries, 1960), Arman, César. - l'art change de nature, immatériel ou nouvelles approches dites narratives, nouvelle compréhension d'un art largement incompréhensible pour le public...
A partir du Conceptualisme (années 1960-1980), - Joseph Beuys (Comment expliquer les images à un lièvre mort, 1965) -, et du Postmodernisme (années 1970-2000), - Anselm Kiefer (Margarethe, 1981), Gerhard Richter -, les mouvements artistiques s'internationalisent, avec une forte influence européenne, et le Street art (Banksy, Royaume-Uni) atteint l’Europe de l’Ouest à la fin des années 1970 et au début des années 1980, porté par l’influence du graffiti américain ..
Un lent et progressif essoufflement d'une expression artistique foisonnante qui vient au XXIe siècle achever son parcours...
Il y a bel et bien RUPTURE et perte de sens, ou nouveau sens, nous dira-t-on. Le numérique redéfinit les frontières de l’art et transforme l’expérience des spectateurs en une interaction immersive, ou comme expérience collective et éphémère; il devient aussi un moyen de sensibilisation à la crise climatique, tout en explorant la relation entre l’homme et la nature (Art écologique et durabilité). Enfin l’art post-Internet, nous dit-on, interroge l’omniprésence des réseaux sociaux et des technologies dans nos vies quotidiennes. A cela s'ajoute l'art féministe et décolonial (Kara Walker et Lubaina Himid, Royaume-Uni), le Postmodernisme tardif et néo-expressionnisme (Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Allemagne), l'art immersif et monumental des installations temporaires transformant les paysages naturels (Christo et Jeanne-Claude, The Floating Piers, 2016). Diversification des pratiques ou remise en question des catégories traditionnelles, au fond peu importe, il y a fondamentalement, au final, une immense rupture dans la perception de ce qu'est l'art ...

Autre illustration de ce comparatif XXe/XXIe, celui d'une PENSEE CRITIQUE qui semble aujourd'hui une cause perdue. L'Europe de l'Ouest a joue un rôle fondamental dans l'histoire de la philosophie au XXᵉ siècle, elle fut le berceau de nombreux courants philosophiques majeurs, qui ont non seulement marqué la pensée occidentale, mais ont aussi eu une influence mondiale, des courants nourris par de nombreuses innovations en sociologie, psychanalyse, linguistique et critique littéraire, et qui reflètent les bouleversements politiques, sociaux et scientifiques de l'époque, tout en interrogeant des questions fondamentales sur l'existence, la connaissance, le pouvoir et la liberté. Deux guerres mondiales ont transformé la réflexion sur l'humanité, la violence et la responsabilité, la montée des idéologies (fascisme, communisme, libéralisme), les progrès scientifiques (relativité, physique quantique, psychanalyse), les changements sociaux, économiques et culturels (décolonisation, féminisme, individualisme) ont constitué une vaste gamme thématique qui a su trouver une à deux générations en capacité de repenser les notions les plus fondamentales de notre existence ...
La Phénoménologie, développée initialement en Allemagne par Edmund Husserl (Idées directrices pour une phénoménologie pure, 1913), la phénoménologie (comment les choses apparaissent à la conscience, notre rapport au monde); Martin Heidegger (Être et Temps, 1927), Maurice Merleau-Ponty (Phénoménologie de la perception, 1945) .. - L' Existentialisme (l'être humain condamné à être libre), Jean-Paul Sartre (L’Être et le Néant, 1943), Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe, 1949), Albert Camus (Le Mythe de Sisyphe, 1942).. - L'École de Francfort et la Théorie critique, l'Allemagne des années 1920, confrontée à la montée du fascisme et aux échecs du marxisme, Theodor Adorno et Max Horkheimer (La Dialectique de la Raison, 1947), Jürgen Habermas (Théorie de l'agir communicationnel, 1981), repenser la rationalité.. - Structuralisme et post-structuralisme, des structures sous-jacentes de la culture, du langage et du pouvoir, Claude Lévi-Strauss (Tristes Tropiques, 1955), "Séminaires", de Jacques Lacan (1953), philosophie du langage avec Roland Barthes (Le Degré zéro de l'écriture, 1953, étude des mécanismes de pouvoir et de contrôle social, Michel Foucault (Surveiller et punir, 1975), de la déconstruction, interrogeant les présupposés des textes philosophiques et littéraires, Jacques Derrida (De la grammatologie, 1967).. - Philosophie analytique, Ludwig Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus, 1921) et (Investigations philosophiques, 1953), Bertrand Russell (Principia Mathematica, 1910-1913, avec Whitehead), Karl Popper (La Logique de la découverte scientifique, 1934) ... - Postmodernisme, avec Jean-François Lyotard (1979) ... - Philosophie politique, critique des idéologies et défis posés par le totalitarisme, la démocratie et les droits humains, Hannah Arendt (Les Origines du totalitarisme, 1951), Raymond Aron (L’Opium des intellectuels, 1955) .. - Féminisme et études de genre, Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe, 1949), Julia Kristeva (Pouvoirs de l’horreur, 1980)..
- une synthèse succincte tant les sciences humaines (sociologie par exemple) dans leur globalité, notion aujourd'hui quasiment disparue, ont ouvert de chemins conceptuels que nous empruntons encore, faute de nouvelles intuitions ...
Au XXIe siècle, la philosophie en Europe de l’Ouest se trouve à la croisée des chemins. Elle a hérite des traditions du XXᵉ siècle tout en affrontant de nouveaux défis posés par un monde globalisé, technologique et en transformation rapide. Les frontières entre disciplines s'effacent, un dialogue croissant s'engage avec le reste d'un monde souvent oublié, les crises globales (climatiques, démocratiques, sanitaires), fournissent de nouvelles matières à penser, les auteurs de qualité ne manquent pas, mais la pensée reste fragmentée, hésitante, sans vision globale : au final, pour l'heure un sentiment, là aussi, d'une immense rupture dans la perception de ce qu'est la pensée critique ...

Au XXIe, le niveau de vie, la mise en scène médiatique continue de soi (et des autres) et l'illusion technologique (interactive, ludique, multisensorielle, à réalité et intelligence augmentées) compensent l'absence de réelle créativité, de mouvements artistiques (on parle de "tendances"), de figures marquantes (on parle de personnalités médiatiques), et tout simplement de pensée critique et de profondeur culturelle...
Moins d'ambition, moins de vision, moins d'interrogations, peu d'imagination, notre consommateur contemporain est en quête de stabilité de soi et d'expériences engageantes, interactives et participatives, dans les loisirs comme dans l'art. C'est qu'on s'ennuie ferme et que l'on a vite fait, du moins le croit-on, le "tour des choses" ... La diffusion rapide des tendances culturelles à travers les réseaux sociaux et médias a favorisé la propagation d'un concept, - il n'est pas nouveau mais son appropriation est massive -, celui d' IMMERSION, devenue une norme dans les produits culturels mondialisés et standardisés ...
De nouvelles thématiques culturelles que l'on dit refléter les enjeux majeurs de notre époque, apparaissent donc, et l'Europe de l'Ouest en est un des grands vecteurs de diffusion. La pensée artistique recycle le Vieux Monde à la lumière d' "enjeux mondiaux" qui désormais imprègnent la culture sous diverses formes. Dans les récits médiatiques et artistiques, on évite désormais d'évoquer des concepts d'existence, de liberté ou d'inégalité intolérable entre individus, des concepts qui semblent soit évident soit impossible à maîtriser faute de compétence ; mais on évoquera ceux de "transition écologique" et de "durabilité", auxquels viennent s'adjoindre le " genre", l' "ethnicité", les "représentations équitables" et l' "inclusion". Ces concepts ne sont guère matière à penser mais à vivre dans les entrelacements ludiques et festifs de la numérisation et de la virtualisation, sous forme de produits à consommer le plus rapidement possible, et à oublier ...
Certains critiques traduiront cette tendance par une formule qui se veut équilibrée : le XXIe siècle privilégie une littérature plus diversifiée, certes moins ambitieuse ou visionnaire, et si la densité d’écrivains majeurs semble moindre, cela peut être dû à des critères de perception plus qu’à une régression objective ... Il ne s'agit plus de tenter de penser les grandes problématiques de notre existence, tout semble avoir été déjà dit et foncièrement incompatible avec notre monde médiatisé à outrance, les récits seront davantage "introspectifs" et "universels" encapsulé dans une expérimentation formelle continue, à défaut de créativité stylistique ...


En Allemagne, le XXe siècle a été marqué par des figures littéraires, artistiques et philosophiques majeures. Au Naturalisme triomphant, vont succéder Modernisme et Expressionnisme, Dadaïsme et théâtre épique, entre autres mouvements dans un siècle qui sera marqué par d'immenses bouleversements (deux guerres mondiales, l'idéologie destructrice nazie)...
Thomas Mann, prix Nobel 1929; s'impose comme le plus important des romanciers germanophones dès la premiere moitié du XXe, avec "Buddenbrooks" (1901), "Der Zauberberg" (1924), "Det Tod in Venedig" (1912, récit d’une passion homoérotique entre un homme mûr et un jeune garçon, explorant le désir interdit et les tensions morales). Le sentiment est celui d'une culture européenne qu'emporte la Première mondiale. Autres écrivains de cette période, Rainer Maria Rilke ("Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", 1910, Sonette an Orpheus, 1923), solitude et angoisse existentielle, Ernst Jünger, avec "In Stahlgewittern" (1920) et "Auf den Marmorklippen" (1939), Stefan George, "Der Stern des Bundes" (1914), le dernier des romantiques, et Hermann Hesse ("Peter Camenzind", 1904, "Demian", 1919, 'Der Steppenwolf"), prix Nobel 1946 en quête d'idéaux humanistes...

La Première Guerre mondiale va transformer l’expression artistique et les bouleversements sociaux de la fin de l’Empire allemand et le début de la République de Weimar, favorisant des avant-gardes d'une extraordinaire créativité. L'Expressionnisme (1905-1920) va rejeter le réalisme pour explorer les émotions, les angoisses existentielles et les visions subjectives : des écrivains tels que Georg Trakl ("Grodek", "Sebastian im Traum"), Franz Kafka ("Die Verwandlung", "Der Prozess"), Gottfried Benn ("Morgue und andere Gedichte", 1912), Alfred Döblin ("Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine", 1918), ou des mouvements artistiques tels que "Die Brücke" ou "Der blaue Reiter", avec Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Emil Nolde. La "Nouvelle Objectivité" (Neue Sachlichkeit, 1920-1933), au regard satirique ou désabusé, compte des écrivains tels que Erich Kästner ("Fabian", "Die Geschichte eines Moralisten", 1931), Alfred Döblin ("Berlin Alexanderplatz", 1929, un roman moderniste décrivant la vie d’un ex-détenu dans le Berlin interlope, avec des thèmes comme la prostitution, la violence et la criminalité), Bertolt Brecht ("Die Dreigroschenoper", 1928, une critique des valeurs bourgeoises à travers des personnages amoraux, criminels, prostituées), Heinrich Mann ("Professor Unrat", 1905, "Der Untertan", 1918), mais surtout des peintres au trait acéré, Otto Dix ("Der Krieg", 1924), George Grosz ("Die Stützen der Gesellschaft", 1926), Christian Schad ("Operation", 1929)...

Exilliteratur (1933-1945) - Sous le régime nazi, de nombreux intellectuels fuient l’Allemagne et produisent une littérature de l’exil, souvent marquée par la critique du phénomène totalitaire : Thomas Mann ("Doktor Faustus", 1947), Anna Seghers ("Das siebte Kreuz", 1942), Stefan Zweig ("Die Welt von Gestern", 1942), Bertolt Brecht ("Mutter Courage und ihre Kinder", 1939, une déconstruction des mythes glorieux de la guerre), associés à des artistes d’avant-garde qui choisissent également de s’exiler : notamment des membres du mouvement Bauhaus (Walter Gropius, Paul Klee). Une littérature aux nouvelles ramifications intellectuelles : philosophique avec Theodor W. Adorno et Max Horkheimer ("Dialektik der Aufklärung", 1944), Walter Benjamin ("Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", 1936), artistique avec Ernst Barlach ("Der tote Tag", 1912) et Paul Klee ("Angelus Novus", 1920).....
Plus globalement, la diaspora allemande des années 1930-1940 constituera un phénomène majeur du XXᵉ siècle, transformant profondément les cultures et les savoirs des pays d’accueil tant s'imposeront comme décisifs les penseurs et scientifiques constituant celle-ci ...

La littérature de l'après-guerre ("Trümmerliteratur", 1945-1950) va refléter les traumatismes de la guerre et de l’Holocauste, la problématique de la culpabilité et de la reconstruction. En littérature, c'est l'époque de Heinrich Böll ("Wo warst du, Adam?", 1951), prix Nobel en 1972, de Wolfgang Borchert ("Draußen vor der Tür", 1947), et de Günter Eich ("Inventur", 1947). Nelly Sachs, poétesse juive de langue allemande et prix Nobel 1966 (partagé avec Shmuel Yosef Agnon) saura nous transmettre, avec une infinie émotion, le calvaire du peuple juif...

Après la guerre (1950-1980), dans une Allemagne scindée en deux, la littérature se divise entre un réalisme critique dans la RDA et une nouvelle subjectivité dans la RFA. L'Allemagne de l'Ouest compte alors parmi ses écrivains les plus reconnus, Günter Grass ("Die Blechtrommel", 1959, des comportements moralement ambigus sous le nazisme, mêlant satire et grotesque; "Katz und Maus", 1961), prix Nobel 1999, et Ingeborg Bachmann ("Malina", 1971, "Das dreißigste Jahr", 1961) ). Une littérature de l'Allemagne divisée, de ses contradictions et de ses divisions, émerge, Uwe Johnson en est le représentant le plus connu avec "Mutmaßungen über Jakob" (1959), "Jahrestage" (1970-1983), et Peter Schneider avec "Der Mauerspringer" (1982) considéré comme représentatif de la "Literatur der Mauer" : une division jugée absurde de Berlin, illustrée par des petites histoires poignantes ou absurdes...
En RDA, s'imposeront Christa Wolf ("Nachdenken über Christa T.", 1968), Heiner Müller ("Die Umsiedlerin", 1961), mais ici nous sommes dans un contexte fortement idéologique et où règne la censure (Christa Wolf, "Der geteilte Himmel", Le Ciel divisé, 1963).
Les années 1970, dites les "années de plomb" (Bleierne Zeit), associées des à événements liés à la Fraction Armée Rouge (Baader-Meinhof, attentats, enlèvements et affrontements avec l'État ) donneront naissance à une littérature (et des oeuvres cinématographiques : "Die Bleierne Zeit", de Margarethe von Trotta, 1981) qui vont ainsi constituer un espace privilégié pour interroger les tensions morales et politiques de cette époque troublée : Heinrich Böll ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1974) nous conte comment une jeune femme devient la cible des médias et des forces de l'ordre après avoir été associée, par erreur, à un terroriste. Stefan Aust, dans "Der Baader-Meinhof-Komplex" (1985) reconstitue le parcours de groupe terroriste, Bernward Vesper évoque, quant à lui, le conflit des générations vécus dans les années 1960 ("Die Reise", 1977).
La littérature allemande des années 1960-1970 développe ainsi une thématique particulièrement riche : l'engagement politique et ses dérives, le passage à la violence armée, le rôle des médias qui façonnent l'opinion publique et déshumanisent les individus, la réponse de l'État et ses mesures répressives à la limite de l'Etat de droit, les conflits générationnels, entre parents (souvent associée au nazisme) et enfants (souhaitant rompre avec ce passé), enfin la désillusion idéologique. Les écrivains mettront en évidence la fracture entre les idéaux révolutionnaires des années 1960 et leur échec pratique....

Dans les années 1980, on observe en RFA, une montée des mouvements pacifistes et écologistes, et en RDA, une littérature qui, si elle reste sous contrôle étatique, voit l'émergence d’écrivains qui interrogent les promesses non tenues du socialisme. "Die Rättin" (La Rate, 1986), de Günter Grass, est une dystopie dans laquelle une narratrice dialogue avec une rate, s'interrogeant sur les angoisses écologiques et les questions de survie humaine. "Frauen vor Flusslandschaft" (Femmes dans un paysage fluvial, 1985), de Heinrich Böll, est une critique des élites politiques et économiques de la RFA. "Amanda. Ein Hexenroman" (183), de Irmtraud Morgner, est une satire féministe de la société est-allemande, tandis que l'autrichienne Elfriede Jelinek influence toute la sphère germanophone avec "Die Klavierspielerin" (La Pianiste, 1983), la sexualité réprimée et la violence dans les relations familiales et sociales, c'est un tournant dans la littérature allemande... Enfin, en 1985, le singulier Patrick Süskind, marquera le monde littéraire avec "Le Parfum" (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders), un livre qui sera publié à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde : il nous raconte, dans la France du XVIIIe, l’histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un homme doté d’un sens de l’odorat extraordinaire, mais dépourvu d’odeur corporelle propre; Grenouille, obsédé par la création du parfum parfait, va commettre une série de meurtres pour capturer les essences de jeunes filles..

Après 1990,débute la période de post-réunification, émerge des questions relatives aux conséquences de la réunification, aux tensions Est-Ouest, avant de se fondre dans le courant de la globalisation et de la diversité culturelle avec des oeuvres très disparates ...
Dans "Heimsuchung" (2008), Jenny Erpenbeck se penche sur les transformations d'une maison en Allemagne à travers les époques, incluant la division et la réunification; dans "Gehen, ging, gegangen" (2015), s'interroge sur l'intégration en reliant expériences post-réunification et questions contemporaines d’immigration. "Helden wie wir" (1995), de Thomas Brussig, fait raconter la chute du Mur de Berlin par un fonctionnaire de la Stasi, tandis que "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" nous une vision humoristique et nostalgique de la vie en RDA. Christoph Hein, dans "Der Tangospieler" (1989) met en scène un professeur emprisonné en RDA pour avoir contesté le régime, et dans "Landnahme" (2004) s'attachera évolutions sociales qui suivent la réunification. Ce qui interroge ici, au-delà des thématiques relatives à la surveillance et au contrôle des individus , aux séparations familiales de part et d'autre de la frontière, ce sont les traces laissées par la division d'un pays, notamment les différences culturelles et économiques entre l’Est et l’Ouest ...
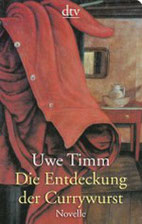
"Die Entdeckung der Currywurst" (1993, Uwe Timm, The Invention of Curried Sausage)
Uwe Timm est un écrivain allemand né le 30 mars 1940 à Hambour. dont l'œuvre est profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et ses conséquences sur les générations suivantes. Dans "Am Beispiel meines Bruders" (2003, L'Exemple de mon frère), un récit autobiographique, - dans lequel Uwe Timm enquête sur la vie et la mort de son frère aîné, Karl-Heinz, qui s'est engagé volontairement dans la Waffen-SS en 1943 à l'âge de 18 ans et est mort en Ukraine en 1943 -, l’auteur avait tenté de comprendre ce frère qu’il n’a presque pas connu: et plus encore, se demandait-il comment une jeunesse allemande pouvait-elle avoir été séduite par l’idéologie nazie, - tout en s'interrogeant sur le silence de ses parents après la guerre.
"La Découverte de la saucisse au curry", se porte sur un sujet provocant, la saucisse au curry, et symbole, apparemment inconséquent mais bien réel, de l'intégration culturelle dans l'Allemagne d'après-guerre. Un souvenir jailli de l'enfance d'Uwe Timm lorsqu'il mangeait de la saucisse au stand de fast-food de Lena Brücker. Celle-ci revendique le fait d'en être l'inventeur, mais avant de révéler tous les détails de sa découverte, est obligée de raconter son passé, ou du moins une version de celui-ci. Hambourg, avril 1945, la guerre touche à sa fin, l’Allemagne nazie est sur le point de s’effondrer. Au milieu des bombardements alliés qui réduisent Hambourg en ruines, des pénuries alimentaires et de la peur qui règnent, du chaos et de l’incertitude qui dominent le quotidien des civils, Lena tient un petit stand de restauration : et rencontre Hermann Bremer, un jeune soldat de la Wehrmacht en permission. Bremer, fatigué par la guerre, décide de déserter et se cache chez Lena qui prend soin de lui, tout en continuant son activité. Leur relation devient un havre de paix et d’intimité au milieu du chaos. Pendant plusieurs semaines, le monde extérieur semble disparaître pour eux. Mais la guerre est omniprésente, la chute de l’Allemagne est inévitable et Lena sait que Bremer ne pourra pas rester caché éternellement. Un jour, alors que Lena rentre chez elle, elle constate la disparition de Bremer mais ne semble pas savoir ce qui l'a provoquée. Après la fin de la guerre, Hambourg est ravagée et la population tente de survivre, Lena continue à tenir son stand, servant les rares clients qui ont encore de quoi payer. Un jour, elle reçoit une boîte de sauce tomate, un peu de curry et du poivre, produits rares à l’époque. Dans une tentative d’expérimentation culinaire, elle mélange ces ingrédients avec une saucisse grillée… et la currywurst est née, et le plat devient populaire ...
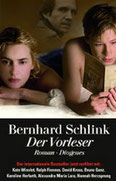
"Der Vorleser" (Le Liseur, The Reader), Bernhard Schlink (1995)
Un best-seller international, traduit en plus de 50 langues, et qui a remporté un grand succès notamment aux États-Unis et en Europe. Il a aussi été adapté au cinéma en 2008 sous le titre "The Reader", avec Kate Winslet et Ralph Fiennes.
Jusqu’où peut-on excuser l’ignorance et le silence ? Le poids du passé et la complexité morale d’aimer quelqu’un qui a commis l’indéfendable (Hanna est-elle une figure monstrueuse, ou simplement une femme ordinaire qui a obéi aux ordres ?). Bernhard Schlink (1944), lui-même professeur de droit et juge en activité, s'attaque aux questions éthiques complexes qui inévitablement surgissent après le traumatisme du génocide. Mais plutôt que de mettre l'accent sur les victimes, Schlink met en lumière les héritiers du nazisme (le personnage de Michael représente la génération d’après-guerre, qui tente de comprendre et de juger sans pour autant pouvoir effacer le poids du passé). "Le Liseur" demande à ses lecteurs de considérer jusqu'à quel point on peut tenir la génération d'après-guerre pour responsable des péchés de leurs pères et mères, et si pareilles atrocités peuvent être réparées. Est-ce que diaboliser les nazis vise à punir leur comportement, ou est-ce simplement à créer une fausse division entre eux et nous et nous délivrer de toute réflexion personnelle?
L’histoire se déroule en Allemagne de l’après-guerre, et suit la relation entre Michael Berg, un adolescent de 15 ans, et Hanna Schmitz, une femme de 36 ans. Le roman commence dans les années 1950, alors que Michael tombe malade en rentrant de l'école et est aidé par Hanna, une inconnue, conductrice de tramway. Lorsqu'il retourne la voir pour la remercier, naît rapidement, une relation passionnée dans laquelle Hanna impose un rituel particulier : avant chaque rapport, Michael doit lui lire à voix haute des classiques de la littérature. Cette liaison est marquée par l’intensité physique, la tendresse mais aussi une certaine domination exercée par Hanna, qui reste distante.
Un jour, sans prévenir, Hanna disparaît sans laisser de traces, laissant Michael déchiré et marqué à vie. Quelques années plus tard, alors qu’il est étudiant en droit, il assiste à un procès contre d’anciennes gardiennes SS… et découvre avec stupeur qu’Hanna est accusée de crimes de guerre. Elle est jugée pour avoir laissé périr des prisonnières juives enfermées dans une église en flammes sans ouvrir les portes.
Lors du procès, Hanna est présentée comme la principale responsable, bien qu’elle nie sa responsabilité directe. Elle refuse de se défendre correctement, et accepte même des accusations qui ne sont pas entièrement fondées. Michael comprend alors son secret : Hanna est analphabète (l’analphabétisme, forme d’aveuglement historique, que l’Allemagne elle-même aurait connu après la guerre?). Par honte, elle préfère ne pas révéler cette faiblesse et se condamne elle-même en signant des aveux qu’elle n’a pas écrits. Michael envoie des cassettes audio où il continue de lui lire des livres en prison, mais sans jamais écrire de lettres, ce qui empêche Hanna de répondre.
Après 18 ans d’incarcération, Hanna est libérée mais ne parvient pas à se réinsérer dans la société. Juste avant sa sortie, elle se suicide, laissant derrière elle un compte bancaire destiné à une association juive et un dernier livre que Michael lui avait lu. Le silence comme élément clé du roman : il enferme les personnages dans leur souffrance...

Au XXIe siècle, on évoquera la diversité accrue des voix et des genres, mais regrettera un affaiblissement du rôle de l'Allemagne sur la scène littéraire mondiale. Plusieurs auteurs ont émergé, tels que Herta Müller (prix Nobel en 2009), Daniel Kehlmann, dont le roman "Die Vermessung der Welt" (Les Arpenteurs du monde, 2005) a connu un succès international, Jenny Erpenbeck, qui explore les thèmes de la mémoire et de l’identité, Judith Schalansky, connue pour ses œuvres expérimentales comme "Atlas der abgelegenen Inseln".
La littérature du XXIe est aussi celle qui, en continuité avec son homologue autrichienne, maque un tournant en brisant de nombreux tabous : Charlotte Roche écrira avec "Feuchtgebiete" (Zones humides, 2008) un roman particulièrement controversé sur la sexualité féminine ...

Julia Franck, "Die Mittagsfrau" (2007, The Blindness of the Heart, La Femme de midi)
Le roman de Julia Franck (1970) fut un phénomène international qui s’est vendu à 850.000 exemplaires en Allemagne (Deutscher Buchpreis) et a été publié dans 35 pays. Le titre du roman fait référence à une vieille légende saxonne : une mystérieuse créature apparaît à l'heure la plus chaude de la journée, au moment de la moisson, et condamne à mort les êtres humains qu'elle rencontre, à moins qu'ils ne sachent répondre immédiatement à la question qu'elle leur pose. Une métaphore qui traduit le thème principal du roman et, partant, de la vie de son héroïne, dans la mesure où le lecteur assiste impuissant à la pétrification progressive des sentiments que peuvent induire la répression et le silence ...
Le roman s’ouvre sur une scène dramatique : en 1945, une femme nommée Helene abandonne son fils de sept ans, Peter, sur un quai de gare en Allemagne, sans explication. Ce moment brutal sert de point de départ pour comprendre ce qui l’a conduite à cet acte impensable. Le récit va retracer l’histoire de Helene, depuis son enfance dans une Allemagne en plein bouleversement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'une vie, qui couvre les deux guerres et la montée du national-socialisme, et coïncide avec une page importante de l'histoire de l'Allemagne.
Helene est née au début du XXe siècle dans une famille germano-souabe vivant à Bautzen, en Saxe. Son père est un pharmacien aimant mais souffrant de troubles mentaux, et sa mère est froide et distante. Après la mort de son père, Helene et sa sœur aînée Martha sont livrées à elles-mêmes, alors que leur mère sombre dans une profonde dépression. Helene et Martha partent à Berlin dans les années 1920, où Helene nourrit l’espoir de devenir médecin. Elle tombe amoureuse d’un jeune juif, Carl, un étudiant en philosophie assez charismatique , avec lequel elle envisage un avenir. Mais avec la montée du nazisme, Carl est arrêté et déporté, brisant à jamais les rêves d’Helene et la plongeant dans une forme d'amnésie. Son travail d'infirmière ne fait rien pour la sortir d'une apathie émotionnelle. Cet état second la conduit à épouser, sans désir, un sympathisant du régime nazi, Wilhelm, qui falsifie les papiers de la jeune femme pour cacher ses origines juives, et lui donne le prénom d'Alice. Elle devient mère malgré elle, subit une existence étouffante, perdant peu à peu son identité et sa volonté propre.
Elle est enfermée dans une vie domestique vide de sens, loin de ses ambitions et de son indépendance passée. La guerre s’achève en 1945, mais Helene est une femme brisée. Lors d’un voyage, elle abandonne Peter sur le quai d’une gare et disparaît de sa vie. Le roman ne donne pas d’explication claire, mais laisse entendre que cet acte est le résultat d’années de douleur, de résignation et de traumatismes.
Le prologue et l'épilogue nous font connaître le point de vue du fils d'HeIene, abandonné par sa mère au moment où elle fuit la Poméranie, à la fin de la guerre, pour retourner à Berlin. Peter représente les millions d'Allemands qui ont dû réapprendre à vivre après l'obscurantisme de la période nazie - l'absence physique de la mère symbolisant à l'évidence un passé inaccessible et réprimé.


Au Royaume-Uni, le XXe siècle fut un âge d'or pour la littérature britannique, marqué par des figures emblématiques et une densité créative incontestable.
Dès 1901, Arthur Conan Doyle publie "Le Chien de Baskerville", on passe du réalisme victorien au modernisme dans un siècle qui va se révéler particulièrement agité, George Bernard Shaw révolutionne le théâtre britannique ("Pygmalion", 1913), E.M. Forster débute une critique subtile de la société britannique, explorant les questions de classe, de race et de sexualité ("A Room with a View", 1908, "A Passage to India", 1924), Wilfred Owen transforme la poésie de guerre en dénonçant l'horreur et l’absurdité du conflit ("Memoirs of a Fox-Hunting Man", 1928), la pionnière du "stream of consciousness" et du mouvement moderniste, Virginia Woolf ("Mrs Dalloway", 1925, "To the Lighthouse", 1927), Wyndham Lewis, peintre, écrivain, et fondateur du mouvement Vorticiste, Ezra Pound (Hugh Selwyn Mauberley, 1920) , Duncan Grant et le groupe de Bloomsbury, James Joyce, bien que d'origine irlandaise, a publié son œuvre majeure "Ulysses" à Londres (1922), T.S. Eliot et sa poésie moderniste ("The Waste Land", 1922, prix Nobel en 1948), D.H. Lawrence (Women in Love, 1920), la "Reine du crime", Agatha Christie (Le Meurtre de Roger Ackroyd, 1926), le Gothic Revival et Dark Romanticism des années 1930-1960) avec Daphné Du Maurier (Rebecca, 1938), les romans de Graham Greene (The Power and the Glory, 1940) ou Evelyn Waugh (A Handful of Dust, 1934, explorant des dilemmes moraux et existentiels, George Orwell, avec ses œuvres dystopiques ("1984", "Animal Farm", 1949), le mouvement "Angry Young Men" des années 1950-1960, avec John Osborne, "Look Back in Anger" (1956), et Alan Sillitoe, "Saturday Night and Sunday Morning" (1958), , J.R.R. Tolkien (The Lord of the Rings, 1954–1955) et C.S. Lewis (The Chronicles of Narnia, 1949–1954) établissent les bases de la fantasy moderne, le POP ART (années 1950-1960, Richard Hamilton "Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?", 1956), le Postmodernisme (années 1960-1980) avec Angela Carter (The Bloody Chamber) et Martin Amis (Money), Anthony Burgess (A Clockwork Orange, 1962), Muriel Spark (The Prime of Miss Jean Brodie, 1961), Doris Lessing (The Golden Notebook, 1962), John Fowles (The Collector, 1963), un cetain Ian Fleming (qui lance James Bond, On Her Majesty's Secret Service, 1963), J.G. Ballard, un précurseur de la science-fiction dystopique (The Crystal World, 1966), Harold Pinter, le dramaturge clé des années 1960 (The Homecoming, 1965), le Punk et Post-Punk (années 1970-1980), Angela Carter, figure clé de la littérature féministe et postmoderne (The Bloody Chamber, 1979, Nights at the Circus (1984), Jeanette Winterson (Oranges Are Not the Only Fruit, 1985), ...
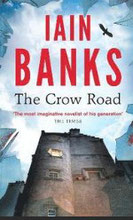
"The Crowd Road" (1993, Ian Banks)
Iain Banks (1954-2013), écrivain écossais connu pour ses romans de fiction, souvent sombres et expérimentaux, et de science-fiction (dont la célèbre série de la Culture ("Consider Phlebas", (1987), qui décrit une société post-capitaliste anarchiste et utopique, technologiquement avancée et dirigée par des IA bienveillantes). L'humour est noir et la critique sociale acerbe. Il est considéré comme l’un des plus grands écrivains écossais contemporains. Dans "The Wasp Factory" (1984, La Fabrique de guêpes), roman culte, Frank Cauldhame, un adolescent vivant sur une île isolée écossaise et sociopathe, invente des rituels macabres : il a déjà tué trois enfants dans son enfance et attend le retour de son frère Eric, récemment évadé d’un asile psychiatrique. Au fil du récit, la vérité sur sa propre identité bouleversera tout ce que le lecteur croyait savoir sur lui. - "The Bridge" (1986, Le Pont) est l'une des œuvres les plus complexes et philosophiques de Banks, dans lequel un homme tombe dans le coma après un accident de voiture : il se retrouve dans un monde étrange dominé par un pont infini, et rencontre des personnages absurdes et inquiétants, tandis que son identité se fragmente.
"The Crowd Road" commence par l'un des paragraphes les plus célèbres dela littérature moderne: "It was the day my grandmother exploded. I sat in the crematorium, listening to my Uncle Hamish quietly snoring in harmony to Bach’s Mass in B Minor, and I reflected that it always seemed to be death that drew me back to Gallanach" (Ce fut le jour où ma grand-mère explosa. J'étais assis dans le crématorium en train d'écouter mon oncle Hamish ronfler tranquillement en harmonie avec la Messe en si mineur de Bach, et je pensais que c'était toujours la mort qui me ramenait à Gallanach). "I looked at my father, sitting two rows away in the front line of seats in the cold, echoing chapel. His broad, greying-brown head was massive above his tweed jacket (a black arm-band was his concession to the solemnity of the occasion). His ears were moving in a slow, oscillatory manner, rather in the way John Wayne’s shoulders moved when he walked; my father was grinding his teeth. Probably he was annoyed that my grandmother had chosen religious music for her funeral ceremony. I didn’t think she had done it to upset him; doubtless she had simply liked the tune, and had not anticipated the effect its non-secular nature might have on her eldest son" (J'ai regardé mon père, assis deux rangées plus loin, dans la première ligne de sièges de la chapelle froide et sonore. Sa tête large et brune grisonnante était massive au-dessus de sa veste en tweed (un brassard noir était sa concession à la solennité de l'occasion). Ses oreilles bougeaient d'une manière lente et oscillante, un peu comme les épaules de John Wayne lorsqu'il marchait ; mon père grinçait des dents. Il était probablement contrarié que ma grand-mère ait choisi une musique religieuse pour sa cérémonie d'enterrement. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait pour le contrarier ; sans doute avait-elle simplement aimé l'air et n'avait-elle pas anticipé l'effet que sa nature non laïque pourrait avoir sur son fils aîné).
C'est Prentice McHoan, fils cadet d'une famille influente d'Écosse, qui parle et sa narration emplit la plus grande partie du livre, le reste étant conté à la troisième personne et retraçant la saga des familles McHoan,Watt et Urvíll. Quittant l'université de Glasgow, Prentice retourne au bercail,ou plutôt chez son oncle Hamish,après s'être fâché avec son père Kenneth, un intellectuel athée et sceptique, alors que lui-même est attiré par les mystères et les croyances spirituelles. Il est amoureux de Verity, mais cette relation est compliquée et non réciproque. Un autre de ses oncles, Rory, a disparu depuis huit ans et le mystère de son destin imprègne fortement le récit et l'obsède particulièrement.
Prentice endosse dès lors le rôle du détective faillible qui doit trouver un sens à tout ce qui est arrivé aux générations précédentes et rassembler toutes les pièces pour présenter une vérité unique. Le roman entrelace passé et présent, révélant progressivement les tensions, les secrets et les non-dits familiaux.
À mesure que Prentice retrace la vie de Rory, il découvre que son oncle travaillait sur un livre intitulé The Crow Road, qui explorait des événements étranges liés à leur famille. Il retrouve des notes et des brouillons, qui laissent penser que Rory avait découvert un secret important avant de disparaître. Plus il avance dans ses recherches, plus il se convainc que Rory n’est pas parti volontairement, mais qu’il a peut-être été victime d’un meurtre.
Parallèlement à cette enquête, Prentice vit des déceptions sentimentales et des questionnements existentiels. Il réalise que Verity ne l’aimera jamais, ce qui l’oblige à réévaluer ses sentiments et ses illusions romantiques. Il se rapproche progressivement d’Ashley, sa cousine, qui s’avère être son véritable amour. Prentice découvre finalement que Rory a été assassiné par son propre frère Fergus, qui l’a tué accidentellement, lors d’une dispute où Rory avait découvert des malversations financières. Il a dissimulé son corps, faisant croire à une disparition.
A la fin du livre, Prentice fait la paix avec son passé, accepte la perte de Rory et se réconcilie avec son père. Il comprend que le monde n’est ni totalement rationnel, ni totalement mystique, mais un mélange de coïncidences, de hasards et de choix humains. Il se construit enfin une identité, en trouvant l’amour avec Ashley et en acceptant les réalités du monde adulte.

"How Late it was, how late" (James Kelman, 1994)
"ll était si tard, si tard", un récit style "stream of consciousness", mais qui plonge dans les pensées chaotiques et répétitives de Sammy, un antihéros, violent, grossier, impulsif, mais aussi déterminé et au dialecte écossais prononcé, primé en 1994 par le prix Booker, non sans controverse. La critique sociale de la société britannique est féroce. Raconté du point de vue d'un chômeur de Glasgow, James Kelman (1946) conte l'histoire de Sammy Samuels, qui se réveille aveugle après avoir été battu par la police et lutte ensuite pour naviguer à travers le labyrinthe de la ville et de l'État-providence en essayant de réclamer des indemnités pour sa "dysfonction", tout en méditant sans cesse sur sa fâcheuse situation. Et dans cette administration hermétique qui fait preuve d'une autorité oppressive et arbitraire, c'est le langage lui-même qui pose problème. Et Sammy est à la fois le narrateur et l'objet de la narration, sujet et objet, une identité instable qui signale une crise dans l'idée de soi qu'a Sammy, un sens de l'aliénation qui s'amplifie par la répétition des mots, des actions et des événements ..
Sammy, un petit voleur impulsif, se réveille dans une ruelle après une grosse beuverie. Il se rappelle une bagarre avec des flics, mais ne sait plus ce qui s’est passé. Lorsqu’il tente de se lever et marcher, il réalise qu’il ne voit plus rien : il est devenu aveugle du jour au lendemain. Désorienté, Sammy se traîne jusqu’à chez lui et attend sa petite amie, Helen, mais elle a disparu. Il essaie d’appeler de l’aide, mais tout le monde l’ignore ou le méprise. Il finit par se faire arrêter et interroger par la police, qui le soupçonne d’avoir fait quelque chose d’illégal, mais il ne sait pas quoi. Livré à lui-même, Sammy essaie de comprendre ce que peut être sa nouvelle vie de non-voyant. Mais il ne trouve aucune aide médicale ni institutionnelle, les services sociaux l’ignorent, la police le harcèle, son ami Tam n’est d’aucune aide., et s'il tente de négocier avec la bureaucratie pour obtenir de l’aide, chacune de ses démarches se transforme en cauchemar administratif. Helen, semble-t-il, ne reviendra jamais, aussi se demande-t-il si elle l’a quitté ou si quelque chose lui est arrivé. Mais alors qu'il tente de s’adapter à sa cécité, il réalise que même avant, il ne voyait pas vraiment la vérité de sa condition. Il est et était prisonnier d’un cycle de violence, de pauvreté et d’oppression, et maintenant qu’il est aveugle, il n’a plus d’illusions sur le monde qui l’entoure. Il continue toutefois d'avancer, refusant de se laisser complètement écraser ...
James Kelman s'est distingué par plusieurs autres œuvres dont "A Disaffection" (1989), qui met en scène un enseignant de Glasgow en proie à une crise existentielle, "The Busconductor Hines" (1984), qui raconte la vie quotidienne d'un conducteur de bus à Glasgow ...

Au XXIe siècle, la littérature britannique contemporaine demeure influente, mais a évolué dans un contexte différent : les écrivains postcoloniaux comme Salman Rushdie (Midnight’s Children) et V.S. Naipaul (prix Nobel en 2001) ont redéfini tant la littérature britannique que mondiale, Kazuo Ishiguro (prix Nobel en 2017), bien qu’écrivain actif dès les années 1980, reste une figure phare du XXIe siècle avec des œuvres comme "Never Let Me Go", Hilary Mantel a renouvelé le genre historique avec sa trilogie "Wolf Hall", remportant deux Booker Prizes (2009, 2012). Des auteurs comme Zadie Smith (White Teeth), Ali Smith (Autumn), ou Ian McEwan (Atonement) sont acclamés pour leur exploration des thèmes contemporains tels que la diversité, le changement climatique, et la mémoire.
Le Royaume-Uni continue donc de produire des auteurs traduits et primés à l’international, mais ceux-ci sont moins dominants en tant que penseurs globaux par rapport à leurs prédécesseurs du XXe siècle. Et la compétition mondiale, notamment des États-Unis et de l’Asie, contribue à ce changement de perspective. A cela faut-il ajouter la montée en puissance de genres comme la fantasy (avec l’essor de J.K. Rowling) ou le thriller psychologique qui, certes, ne remplace pas l’innovation littéraire associée au XXe siècle, mais réjouit tant nos jeunes lecteurs ...

"Cloud Atlas" (David Mitchell, 2004)
Un roman postmoderne, science-fiction, roman historique, thriller et dystopie, pour un finaliste du Booker Prize 2004, best-seller international, et une adaptation cinématographique en 2012 réalisé par les Wachowski & Tom Tykwer, avec un casting impressionnant (Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent).
"Cloud Atlas" est un roman à structure complexe, composé de six récits entrelacés, chacun ayant un style et un genre différents, et l’histoire traverse plusieurs époques, allant du XIXe siècle à un futur post-apocalyptique (chaque histoire est coupée en deux, sauf la dernière, et les récits se succèdent en miroir). Donc six récits, six époques (chaque époque correspondant à une forme d’exploitation), et six styles littéraires différents (de Melleville à John Le Carré), avec des personnages principaux qui, dans chaque histoire, portent la même tache de naissance, suggérant qu’ils sont des réincarnations d’une même âme. L’histoire est un cycle de domination et de révolte montrant que non seulement le passé et le futur sont intrinsèquement liés, mais que le temps n’est pas linéaire, mais un réseau d’échos...
- Le Journal du Pacifique d’Adam Ewing (XIXe siècle, 1850) – Récit d’aventure maritime : Adam Ewing, un notaire américain, voyage dans le Pacifique Sud et découvre la brutalité du colonialisme et de l’esclavage.
- Lettres de Zedelghem (Belgique, 1931) – Roman épistolaire : Robert Frobisher, un musicien anglais talentueux mais sans le sou, devient l’assistant d’un vieux compositeur.
- Moissons de L’Ouest (Californie, 1970s) – Thriller politique : Luisa Rey, une journaliste, enquête sur une conspiration nucléaire.
- L’Horrible Calvaire de Timothy Cavendish (Londres, début des années 2000) – Comédie noire : Timothy Cavendish, un éditeur vieillissant, est enfermé dans une maison de retraite contre son gré.
- L’Orison de Sonmi-451 (Corée du Sud, futur dystopique) – Science-fiction : Sonmi-451, une clone (fabricant) créée pour servir dans un fast-food, prend conscience de son esclavage.
- La Révélation de Zachry (Hawaï, post-apocalypse) – Récit de survie primitif : après l’effondrement de la civilisation, Zachry, un berger, tente de survivre dans un monde redevenu tribal.
Un jeu littéraire est brillant et parfaitement maîtrisé, des liens entre des personnages disparates, l’imbrication de leurs destins et la dérive de leur âme à travers le temps comme des nuages dans le ciel ..

"Everything Is Illuminated" (Jonathan Safran Foer, 2002)
Un Best-seller, finaliste du Guardian First Book Award, dont l'adaptation cinématographique fut réalisée en 2005 par Liev Schreiber, avec Elijah Wood dans le rôle de Jonathan, et Eugene Hutz, dans celui d'Alex : mais aussi un premier roman et trois récits entrelacés, trois styles distincts, une comédie absurde et moderne (voyage en Ukraine), un pastiche de la littérature yiddish (histoire de Trachimbrod), une confession poignante sur la Shoah (récit du grand-père), une alternance parfaitement agencée entre humour et tragédie, faits véridiques et fantaisistes, qui s'interrogent sur la mémoire.
Jonathan, écrivain juif américain, arrive en Ukraine pour retrouver le village de Trachimbrod, où vivait son grand-père avant l’Holocauste. Il engage Alex Perchov, un jeune Ukrainien obsédé par la culture américaine, et le grand-père d’Alex, qui se prétend aveugle mais conduit la voiture. Accompagnés d’un chien errant nommé Sammy Davis Jr. Jr., et formant un duo improbable, ils traversent l’Ukraine rurale en quête du village disparu.
Une fresque historique nous conte l'histoire de ce village juif, une fresque peuplée de Juifs hassidiques et excentriques, décrite sur un ton onirique et surréaliste, inspirée de la littérature yiddish, qui remonte à 1791, avec la naissance d’un enfant sauvé d’une noyade miraculeuse, qui deviendra l’ancêtre de Jonathan, pour culminer en 1942, lorsqu’il est anéanti par les nazis, un événement central du roman.
Alex Perchov, d’abord comique avec son anglais approximatif, devient le personnage le plus profond du roman. Son grand-père, qui prétend détester les Juifs, cache un secret bouleversant : il a trahi un ami juif aux nazis pour survivre. Alex comprend que l’histoire de sa propre famille est liée à celle de Jonathan, et ne peut être ignorée. Jonathan cherche une vérité historique, mais découvre que les souvenirs sont fragmentés, incomplets, voire inventés, tandis qu'Alex, qui lui-même réécrit son passé, refusera d’accepter l’histoire de son grand-père jusqu’à la révélation finale... Jonathan apparaîtra comme un Américain détaché de ses racines, tandis qu’Alex, l'Ukrainien, découvrira la culpabilité de son propre peuple dans l’extermination des Juifs...
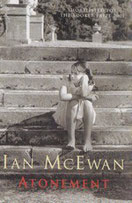
"Atonement" (Expiation, Ian McEwan, 2001)
Finaliste du Booker Prize 2001 et sujet d'adaptation cinématographique réalisée en 2007 par Joe Wright, avec Keira Knightley et James McAvoy, "Atonement" fut un des plus grands succès de McEwan : lui-même, maître du roman psychologique et observateur critique de la société britannique, est considéré comme l’un des meilleurs écrivains britanniques contemporains, aux côtés de Julian Barnes, Martin Amis et Kazuo Ishiguro. Parmi ses ouvrage, " Amsterdam", une critique acide de la politique et des médias britanniques, "Enduring Love" (1997), un thriller psychologique dans lequel un homme devient la cible d’un harceleur obsédé après un accident, "On Chesil Beach" (2007), un drame intime et psychologique qui raconte un couple de jeunes mariés dans les années 1960 face à la peur et l’incompréhension du désir sexuel; "The Children Act" (2014), dans lequel une juge doit décider si un adolescent témoin de Jéhovah doit recevoir une transfusion sanguine contre son gré; et "Machines Like Me" (2019), un roman d’anticipation et de réflexion sur l’intelligence artificielle ...
"Atonement" est structuré en trois parties principales et un épilogue ...
- Première partie, le drame de 1935 (Angleterre, manoir des Tallis) - Briony Tallis, une enfant de 13 ans, vit avec sa famille aristocratique dans une grande demeure anglaise. Elle observe une scène troublante entre sa sœur Cecilia et Robbie Turner, fils de domestique et protégé de la famille : Cecilia plonge presque nue dans une fontaine sous le regard de Robbie. Plus tard, Briony trouve une lettre obscène écrite par Robbie, puis assiste à une rencontre intime entre lui et Cecilia dans la bibliothèque. Lorsque la cousine de Briony, Lola, est violée dans le jardin, Briony accuse Robbie, convaincue à tort qu’il est coupable. Robbie est arrêté et emprisonné, brisant sa vie et celle de Cecilia, qui est la seule à croire en son innocence.
- Deuxième partie, Robbie pendant la Seconde Guerre mondiale (1940, France) - Cin ans plus tard, Robbie est libéré à condition de s’engager dans l’armée britannique. Il participe à la débâcle de Dunkerque, une scène de guerre intense où il lutte pour survivre et rejoindre Cecilia, qui l’attend en Angleterre. Il est hanté par son passé et par la fausse accusation qui l’a détruit.
- Troisième partie, la tentative d’expiation de Briony (Londres, 1940s) - Briony, maintenant adulte et infirmière pendant la guerre, comprend enfin l’ampleur de son erreur passée.
Elle veut avouer son mensonge à Robbie et Cecilia pour obtenir leur pardon. Elle découvre qu’ils vivent ensemble mais restent profondément blessés par son acte. Briony décide de rédiger un roman pour réparer le passé et révéler la vérité.
- Dernière partie, l'épilogue - Révélation, Robbie est mort à Dunkerque, et Cecilia a été tuée dans un bombardement en 1940. La rencontre entre Briony, Robbie et Cecilia n’a jamais eu lieu : tout cela était une invention de Briony, qui, en tant qu’écrivaine âgée, tente de leur offrir une fin heureuse à travers la fiction. Briony confesse que ce livre est son dernier acte d’expiation, même si cela ne changera pas la réalité.
On pensait suivre une histoire classique, mais nous découvrons que tout ne fut que manipulé par la narratrice ..
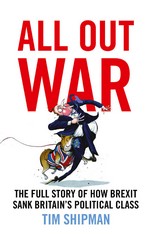
"All Out War: The Full Story of How Brexit Sank Britain’s Political Class (2016).
Tim Shipman, rédacteur en chef politique du Sunday Times (depuis 2021), après avoir été correspondant politique en chef pour The Sunday Times, est connu pour ses analyses approfondies des coulisses du pouvoir au Royaume-Uni, notamment sur le Brexit et les luttes internes au Parti conservateur. Il compte ainsi nombre de best-sellers sur la politique récente du Royaume-Unii. Si Shipman est souvent perçu comme proche des sources conservatrices, son travail se veut factuel. Ses livres sont cités comme des références par des politiciens de tous bords pour leur exhaustivité. Ses écrits aident à comprendre les réalités du pouvoir au Royaume-Uni, loin des discours officiels, ce qui seul nous importe ...
Son livre "All Out War" (2016) est considéré comme un texte clé pour saisir les dessous du Brexit. Une enquête magistrale sur la campagne du référendum de 2016 sur le Brexit, basée sur des centaines d’interviews exclusives avec les acteurs clés. Shipman y révèle les luttes de pouvoir, les erreurs stratégiques et les trahisons qui ont mené à la victoire du "Leave". A retenir,
- L’impréparation catastrophique du camp "Remain" : David Cameron, persuadé de gagner, a sous-estimé le risque du Brexit et refusé de diriger une campagne forte, laissant le "Remain" sans message clair. Les divisions internes (notamment entre Cameron et George Osborne) ont affaibli la stratégie, qui reposait trop sur des arguments économiques technocratiques, ignorés par l’électorat populaire. Jeremy Corbyn, leader travailliste, a saboté discrètement la campagne pro-UE par son manque d’engagement, reflétant son euroscepticisme historique.
- La machine "Leave" : chaos, génie et coups bas - Boris Johnson et Michael Gove ont hésité jusqu’au bout avant de rejoindre le camp "Leave", motivés par des ambitions personnelles autant que par des convictions. Dominic Cummings, stratège du "Vote Leave", a exploité les réseaux sociaux et la data pour cibler les électeurs marginalisés, avec des slogans chocs comme "Take Back Control" (Reprendre le contrôle) ou "£350 million a week for the NHS" (un chiffre controversé). La campagne a instrumentalisé l’immigration et la peur du déclin culturel, touchant un électorat ouvrier désillusionné.
- Le rôle des médias et des "outsiders" - Rupert Murdoch (propriétaire de The Sun) et Paul Dacre (Daily Mail) ont poussé pour le Brexit, influençant l’opinion publique. Nigel Farage (UKIP) et Arron Banks (millionnaire pro-Brexit) ont déstabilisé le débat avec des campagnes populistes, parfois mensongères (ex. : les affiches anti-immigration montrant des foules de migrants).
- L’après-référendum : un pays et des partis en lambeaux - La victoire du Brexit a détruit la carrière de Cameron (démission immédiate) et plongé les Tories dans une guerre civile durable. Le Labour, déjà divisé, a sombré dans la crise avec la mutation de Corbyn vers la gauche radicale, éloignant encore plus son électorat traditionnel.
Shipman montre que le référendum a révélé les fractures profondes du Royaume-Uni : générationnelles (jeunes vs. vieux), géographiques (villes vs. campagnes), et sociales (élites vs. classes populaires) : le Brexit était autant un rejet de la classe politique britannique qu’une révolte contre l’UE ...

"Fall Out: A Year of Political Mayhem" (2017)
La suite immédiate d’All Out War, couvrant l’année folle qui a suivi le référendum sur le Brexit (juin 2016 à juin 2017). Shipman y décrit comment le vote Leave a déchiré la classe politique britannique, plongeant le pays dans une crise institutionnelle sans précédent.
- L’implosion des Tories : guerre civile post-Brexit - Theresa May, Premier ministre par défaut : elle hérite du chaos après la démission de Cameron, sans mandat clair (elle était Remain). Son style rigide et secret l’isole rapidement, même dans son parti. - La montée des "Brexiteers" ultras : Boris Johnson (ministre des Affaires étrangères) et Michael Gove sabotent discrètement May, rêvant de la remplacer. Le groupe European Research Group (ERG) de Jacob Rees-Mogg devient une force rebelle intraitable.
- L’échec cuisant des élections de 2017 - La "stratégie" désastreuse de May : elle convoque des élections anticipées pour renforcer sa majorité, mais mène une campagne robotique ("strong and stable leadership"). Son programme (notamment sur le financement des soins) est mal préparé et impopulaire. - La résurrection inattendue de Corbyn : grâce à un manifeste travailliste radical (nationalisations, dépenses sociales) et une campagne énergique, il séduit les jeunes. - Résultat : May perd sa majorité, obligée de s’allier avec le DUP (parti nord-irlandais). May paie son manque de vision et son mépris pour la démocratie interne.
- Les coulisses des négociations avec l’UE - L’arrogance de Londres : les Britanniques sous-estiment Bruxelles, croyant pouvoir obtenir un accord favorable sans concessions. Michel Barnier tient bon sur les principes clés (libre circulation, "divorce bill"). Une UE plus forte qu’attendu, Bruxelles ne se démonte pas face aux divisions britanniques. - Le piège irlandais : la question de la frontière avec l’Irlande du Nord devient le problème insoluble qui hantera May jusqu’à sa chute.
- La société britannique fracturée - Un pays divisé : les jeunes vs. les vieux, les diplômés vs. les ouvriers, les métropoles vs. les campagnes. Le Brexit révèle une crise identitaire plus large (montée des tensions sociales, attaques xénophobes). - Médias et désinformation : les tabloïds (Daily Mail, The Sun) attisent les divisions, tandis que les réseaux sociaux amplifient la polarisation.
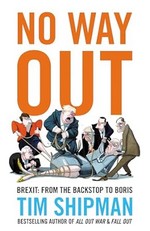
"No Way Out: Brexit: From the Backstop to Boris" (2024)
La suite indispensable d’All Out War, couvrant la période chaotique de 2017 à 2020, depuis l’échec de Theresa May jusqu’à la victoire écrasante de Boris Johnson. Shipman y révèle les intrigues, les trahisons et les calculs politiques qui ont façonné la seconde phase du Brexit.
- L’échec tragique de Theresa May (2017-2019) - Une Première ministre piégée : May hérite d’un Brexit ingérable après la démission de Cameron. Son manque de charisme et son isolement (notamment après la perte de sa majorité en 2017) la condamnent. Le piège du "backstop" : L’accord de May avec l’UE, incluant cette clause pour éviter une frontière dure en Irlande, lui aliène à la fois les Brexiteers et les DUP (ses alliés nord-irlandais). Trois défaites historiques à la Chambre des communes, un record humiliant. Puis la chute : Son propre parti la trahit (menée par Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg et le ERG), la forçant à démissionner en 2019.
- La montée de Boris Johnson : populisme et realpolitik - Stratégie brutale : Johnson écarte tous les modérés (expulsion de 21 députés Tory, dont Ken Clarke) pour imposer sa ligne "do or die" sur le Brexit. Jeu dangereux avec la démocratie : La suspension du Parlement ("prorogation") en 2019, jugée illégale par la Cour suprême, montre son mépris des institutions. Puis victoire écrasante en 2019 : Grâce à la promesse de "Get Brexit Done", il séduit l’électorat ouvrier du "Red Wall" (anciens bastions travaillistes) : le Brexit n’était plus une question de politique, c’était une guerre culturelle, et Johnson l’a comprise avant tout le monde ...
- Le rôle clé de Dominic Cummings : architecte du succès de Johnson : Cummings applique les mêmes méthodes qu’en 2016 (messages simples, ciblage des électeurs marginalisés). Guerre contre l’establishment : Il méprise les médias et la bureaucratie, mais ses excès (notamment pendant le scandale du "Barnard Castle") le mènent à sa perte.
- Les dessous de l’accord final avec l’UE : l’Irlande, point de blocage, Johnson abandonne en partie le backstop, mais accepte une frontière maritime qui isole l’Irlande du Nord, créant de nouvelles tensions. L’UE inflexible : Michel Barnier et Angela Merkel ne cèdent pas sur les principes du marché unique, forçant le Royaume-Uni à un Brexit dur.
Le livre montre comment le Brexit a réorganisé les clivages (ex. : le "Red Wall" passant des travaillistes aux Tories) et comment Johnson et Cummings ont sacrifié tout principe pour gagner, révélant le cynisme au cœur de la politique moderne.

"Out: How Brexit Got Done - and Four Prime Ministers Were Undone" (2024)
Dernier acte d’une saga politique qui complète "All Out War" et "No Way Out" en montrant l’échec à "réaliser les promesses" du Brexit. Pourquoi aucun leader n’a réussi à unir le pays après le Brexit ? Le Brexit a détruit quatre Premiers ministres, pas parce qu’ils l’ont mal géré, mais parce qu’il était ingérable ...
Un volet qui couvre la période 2020-2023, marquée par la finalisation du Brexit sous Boris Johnson, puis les chutes successives de quatre Premiers ministres (Johnson, Truss, Sunak, et en filigrane, May). On notera les points suivants,
- Boris Johnson, du triomphe à la chute (2020-2022) - "Get Brexit Done" : Johnson capitalise sur sa victoire écrasante de 2019 pour finaliser le retrait du Royaume-Uni de l’UE en janvier 2020, mais les détails du futur rapport commercial restent flous. - Covid et populisme : Son approche désinvolte ("herd immunity") puis les scandales des lockdown parties ("Partygate") érodent sa crédibilité. - Révolte du parti : Les mensonges répétés (sur Chris Pincher, sur le financement de sa rénovation) poussent les députés Tory à le forcer à démissionner en juillet 2022.
- Liz Truss : 49 jours de chaos (2022) - Ultra-Brexit radical : Truss incarne l’aile libertarienne du parti, promettant des baisses d’impôts massives et un rejet total de l’héritage de l’UE. - Le désastre économique : Son mini-budget provoque une crise des pensions et une chute de la livre, obligeant la Banque d’Angleterre à intervenir. - La chute la plus rapide de l’histoire : Lâchée par son parti, elle démissionne après sept semaines seulement.
- Rishi Sunak : stabilisation ou stagnation ? (2022-2024) - C'est l’anti-Truss : Sunak, ex-ministre des Finances, tente de rétablir la crédibilité économique, mais hérite d’un parti divisé et d’une économie en récession.
Brexit "fini" mais insatisfaisant : Les problèmes persistent (frontière nord-irlandaise, pénuries de main-d’œuvre), mais le débat s’essouffle. - Échec électoral annoncé ? Shipman suggère que les Tories, épuisés par une décennie de crises, pourraient perdre les élections de 2024.
Le Brexit, un processus sans fin : même après 2020, les négociations (sur l’Irlande du Nord, la pêche, les normes) empoisonnent toujours les relations UK-UE.
C'est aussi la fin du "conservatisme compétent" : le Parti Tory, miné par les guerres internes, a sacrifié sa réputation de stabilité.
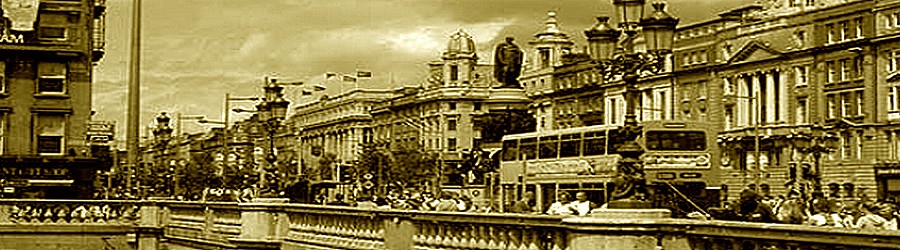

La société irlandaise, profondément catholique au XXe siècle et forte de son identité nationale, a produit certains des plus grands poètes, tel que W.B. Yeats (The Tower, 1928, The Winding Stair, 1933) et écrivains modernistes, comme James Joyce (Ulysses, 1922), Samuel Beckett (En attendant Godot, 1953), Flann O’Brien (At Swim-Two-Birds, 1939, The Third Policeman, écrit en 1939-1940, publié en 1967). La période des "Troubles ", période de conflit politique, ethnique et sectaire en Irlande du Nord (lutte pour fin de la domination britannique en Irlande du Nord et sa réunification à l'Irlande), qui a duré de la fin des années 1960 jusqu’aux Accords du Vendredi saint en 1998, a eu un impact profond sur la culture irlandaise, notamment en Irlande du Nord, mais aussi dans l'ensemble de l'île et parmi la diaspora irlandaise : Seamus Heaney, poète nord-irlandais et prix Nobel de littérature (1995), évoque violence et mémoire historique dans des poèmes comme "Punishment" (1975), Brian Friel, dramaturge, avec des pièces comme "Translations" (1980), traite des conflits culturels et linguistiques en Irlande, Anna Burns dans "Milkman" (2018), raconte la vie quotidienne durant cette période. Musique et cinéma ont joué un rôle important dans la narration et la contestation de cette époque, on pense à cet incontournable "Sunday Bloody Sunday" (1983) de U2, à "Bloody Sunday" (2002) de Paul Greengrass, qui reconstitue le massacre de 1972 à Derry, "In the Name of the Father" (1993), qui raconte l’histoire de Gerry Conlon, victime d’une erreur judiciaire liée aux attentats de l’IRA, "Hunger" (2008), réalisé par Steve McQueen, qui retrace la grève de la faim de Bobby Sands. La résolution de ce sanglant conflit a marqué le début d'une réflexion culturelle plus large sur l'identité irlandaise, qui s’est ouverte à la diversité et à la mondialisation tout en restant fidèle à ses racines.
Et au XXIe, dans une Irlande s'étant détachée du catholicisme et devenue plus cosmopolite (Dublin), ont émergé des écrivains explorant des thèmes variés, notamment l'immigration, l'identité de genre et la mondialisation, Sally Rooney (Normal People, 2018), Colm Tóibín (Brooklyn, 2009)...

"The Gathering" (2007, Anne Enright, Les Retrouvailles)
Anne Enríght (1962) a écrit trois romans "The Wig My Father Wore" (La Perruque de mon père, 1995), "What Are You Like?" (2000), et "The Pleasure of Eliza Lynch" (2002), avant de travailler à ce quatrième ouvrage qui lui vaudra en 2007 une récompense prestigieuse, le Man Booker Prize. Les Hegarty forment une grande famille, mais l'intrigue du roman s'articule autour du personnage de Veronica, encore très choquée parla mort de son frère Liam. Liam s'est noyé à Brighton, après avoir lutté pendant des années contre l'alcoolisme, et l'essentiel du roman est construit autour de retours en arrière à travers lesquels Veronica tente de trouver les motifs de ce suicide. Les souvenirs vont émerger de façon décousue. Le suicide de Liam commence peut-être, ou peut-être pas, par un incident survenu un été, alors que Veronica et son frère étaient en vacances chez leur grand-mère. L'explication pourrait avoir sa source dans le triangle amoureux auquel la grand-mère se trouve associée. C'est cette ambiguïté des "histoires mouvantes et des rêves éveillés" qu'Anne Enright traduit par une prose fluide, alliée à une étonnante capacité à faire passer la narration d'un personnage à un autre, marque d'une grande romancière ...
Au fil du roman, Veronica va comprendre que Liam a été abusé sexuellement dans son enfance par un ami de la famille, Lambert Nugent, alors qu’il vivait chez leur grand-mère Ada. Cet événement, longtemps refoulé par la famille, aurait contribué à l’autodestruction de Liam, qui sombre dans l’alcoolisme avant de se suicider. Veronica ressent une culpabilité écrasante de ne pas avoir compris plus tôt l’origine du mal-être de son frère.
Le paysage psychologique intérieur forme un contraste frappant avec les descriptions violemment corporelles, poésie et trivialité alternent, l'écriture est fragmentée, intense, les émotions surgissent brutalement. Et son humour noir contraste avec la douleur du récit, rendant certaines scènes encore plus percutantes. Chez Veronica, l'expérience du deuil passe par des émotions et des réactions physiques que la jeune femme évoque comme "un sentiment confus, à mi-chemin entre la diarrhée et les rapport sexuels, une douleur presque génitale". Les thèmes de I'amour et de la mort s'entremêlent au niveau même du corps, laissant une cicatrice qui persiste longtemps après que ceux que nous aimons nous ont quittés.
À travers ses souvenirs, Veronica va tenter de reconstruire une version cohérente de l’histoire familiale. Mais elle remet en question ses propres souvenirs : certaines scènes qu’elle raconte sont peut-être des reconstructions imaginaires plutôt que des faits réels. Elle s’interroge aussi sur l’héritage du catholicisme irlandais et sur la manière dont les secrets et la honte modèlent les individus : comme dans d’autres œuvres de la littérature irlandaise récente ("The Secret Scripture" de Sebastian Barry (2008), "Room" d’Emma Donoghue), Enright met en lumière les traumatismes cachés de l’Irlande. Mais peut-on vraiment comprendre le passé, ou sommes-nous condamnés à l’interpréter selon nos propres blessures ?
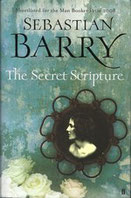
"The Secret Scripture", de Sebastian Barry (2008),
James Tait Black Memorial Prize 2008, dénonce le traitement des femmes en Irlande, en particulier sous l'Eglise catholique (les asiles psychiatriques servaient de prisons pour les femmes considérées comme "gênantes", et l’Église et l’État contrôlaient la sexualité féminine, avec l’appui des familles conservatrices). Le roman est un récit à deux voix, Roseanne et le docteur Grene, d'une part, les mémoires secrètes de Roseanne McNulty, une vieille femme de près de 100 ans, internée depuis des décennies dans un hôpital psychiatrique en Irlande; et d'autre part, le journal du docteur Grene, le psychiatre chargé d’évaluer si Roseanne peut être relogée à l’extérieur, alors que l’hôpital va être démoli. Se crée une tension entre ce que l’on croit savoir et ce qui est caché...
Roseanne raconte son enfance dans les années 1920 en Irlande, marquée par la montée des tensions entre catholiques et protestants. Son père, un protestant apprécié, est injustement accusé d’être un sympathisant britannique et est persécuté par l’Église catholique. Roseanne, belle et indépendante, attire l’attention de Padraic McNulty, un homme catholique issu d’une famille influente. Ils se marient, mais le mariage tourne à la tragédie. Après un mariage difficile, Roseanne est accusée à tort d’adultère par le père Gaunt, un prêtre influent. L’Église, avec l’aide de la belle-famille de Roseanne, fait annuler son mariage et la condamne à l’internement psychiatrique, alors qu’elle est simplement une femme indépendante. Dans un climat de puritanisme extrême, les femmes "gênantes" étaient souvent envoyées dans des institutions psychiatriques ou des couvents (Magdalene Laundries). Roseanne va ainsi passer plus de 60 ans enfermée, oubliée du monde.
Le docteur Grene, le psychiatre, intrigué par les contradictions entre les récits de Roseanne et les archives médicales, fouille dans le passé et découvre que les documents officiels mentent : Roseanne n’a jamais été folle, mais a été victime d’une société patriarcale et puritaine. Dans une dernière partie, il est révélé que Roseanne est en réalité sa propre mère biologique, ce qui change toute sa perception de son travail et de son propre passé.

"Room" d’Emma Donoghue (2010),
finaliste du Man Booker Prize 2010, Commonwealth Writers’ Prize, et objet d'une adaptation cinématographique réalisée par Lenny Abrahamson et primée (Oscar 2016 pour Brie Larson). L'expérience et la résistance à l'enfermement vues à travers les yeux d'un enfant : "Room" fait écho à de véritables affaires de séquestration (Natascha Kampusch, en Autriche, ou Jaycee Dugard aux États-Unis). Le narrateur est un garçon de 5 ans, Jack, qui vit enfermé dans une petite pièce avec sa mère, Ma. Pour lui cette pièce est tout son univers, il ne sait pas que le monde extérieur existe. Old Nick, leur ravisseur, leur apporte de la nourriture et des provisions, mais Ma refuse que Jack le voie. Ma invente des activités et une routine stricte pour donner un rythme à leur vie. Elle explique à Jack que Room est leur monde, mais protège son imagination en lui créant une réalité alternative. Mais elle cache son propre désespoir : enfermée depuis 7 ans, elle subit des abus sexuels de la part d’Old Nick. Quand Jack grandit, Ma comprend qu’elle ne pourra pas lui cacher la vérité éternellement.
Elle lui révèle que Room n’est pas le vrai monde, que les gens et les choses dehors existent vraiment. Jack refuse d’abord d’y croire, puis accepte peu à peu cette nouvelle réalité. Ma met en place un plan risqué, Jack doit se faire passer pour mort, Old Nick devra l’emmener hors de Room pour s’en débarrasser, une fois dehors, Jack devra s’enfuir et appeler à l’aide. Le plan fonctionne : et les deux protagonistes doivent désormais se réapproprier le monde, et c'est Ma qui rencontrera le plus de difficultés au fil de cette progressive reconstruction. Jack découvre la dure réalité, mais c’est aussi un roman sur l’amour maternel et la capacité d’adaptation humaine...


La littérature néerlandaise a connu au XXe siècle une période florissante, marquée par des auteurs de renom et des œuvres qui ont acquis une résonance internationale : Harry Mulisch ("De ontdekking van de hemel", 1992) est souvent considéré comme l’un des plus grands auteurs néerlandais du siècle, explorant des thèmes métaphysiques et historiques. Willem Frederik Hermans et Gerard Reve, constituant avec Mulisch le "grand trio", ont marqué la littérature d'après-guerre avec des récits intenses sur la Seconde Guerre mondiale et les tensions sociopolitiques. Hella S. Haasse, avec ses romans historiques comme "Heren van de thee" (1992), a offert une perspective originale sur le passé colonial. Les mouvements littéraires, tels que le Vijftigers en poésie, ont introduit une modernité et une expérimentation stylistique. Ces auteurs ont non seulement influencé la littérature néerlandaise mais ont aussi permis une reconnaissance internationale.

Willem Frederik Hermans (1921-1995) - Le pessimisme, le scepticisme, l'absurde et une vision désenchantée du monde pour ne pas dire nihiliste marquent son oeuvre. Critique féroce de la société néerlandaise et des intellectuels jusqu'au mépris, il choisira de s'exiler, quitte les Pays-Bas en 1972, s’installe d’abord à Paris, puis à Bruxelles, où il est resté jusqu’à sa mort en 1995. Son roman "La Chambre noire de Damoclès" (De donkere kamer van Damokles, 1958) est très critique envers l’héroïsme supposé des résistants néerlandais, et "Onder professoren" (Les Larmes du scorpion, 1975) dénonce l’hypocrisie du monde académique, ce qui lui vaut de nombreuses inimitiés.Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des plus grands écrivains néerlandais, malgré les controverses qui ont marqué sa carrière.
Dans "De donkere kamer van Damokles" (1958, The Darkroom of Damocles, La Chambre noire de Damoclès), son chef-d’œuvre, il mène une critique féroce de la glorification de la Résistance néerlandaise. Le protagoniste, Henri Osewoudt, est un personnage ambigu, pris dans une situation où le bien et le mal deviennent indiscernables. L'auteur le décrit comme est un jeune homme au physique enfantin, blond, imberbe et de petite taille. Il vit à Voorschoten, où il tient un bureau de tabac hérité de son père. Son existence est marquée par la passivité : il est vrai que sa mère a assassiné son père et est internée en hôpital psychiatrique. Il est marié à sa cousine Ria, mais leur relation est froide et sans amour.
Un jour, Henri rencontre Dorbeck, un homme qui lui ressemble comme un frère, mais en plus grand, plus fort et plus charismatique. Dorbeck lui confie des missions pour la Résistance, lui demandant de transmettre des messages et cacher des armes. Pour la première fois, Henri se sent important, croyant jouer un rôle actif contre l’Occupant. Mais Dorbeck existe-t-il vraiment ou est-ce une invention de son imagination?
Toujours est-il que Henri exécute plusieurs missions, il exécute un traître supposé, transmet des documents secrets et se déplacer clandestinement à travers le pays. Mais tout bascule à la Libération des Pays-Bas en 1945 : Henri est arrêté par la police et accusé de collaboration avec les nazis. Il ne peut pas prouver l’existence de Dorbeck : personne ne l’a jamais vu. Ses actes peuvent être interprétés aussi bien comme des actions de Résistance que comme des actes de collaboration. Est-il un héros mal compris ou un opportuniste ayant cru à une illusion ? Il est emprisonné, interrogé et tente désespérément de prouver son innocence, mais aucune preuve de Dorbeck n’existe et son propre passé trouble (sa mère criminelle, son absence de charisme) joue contre lui. Il perd pied psychologiquement ... Il parvient à s'évader, mais lorsqu’il tente de fuir, il est abattu par la police : nul ne saura si Dorbeck a réellement existé ...
La guerre est chaotique et personne au fond ne sait vraiment ce qui se passe, et les choix sont dictés par la peur et l’absurde...
"Nooit meer slapen" (1966, Au-delà du sommeil) – Alfred Issendorf, un jeune géologue néerlandais, part en expédition en Norvège pour chercher des traces de météorites, convaincu que cela lui apportera gloire et reconnaissance scientifique. Mais le voyage tourne au cauchemar, et il se retrouve perdu dans une nature impitoyable. Willem Frederik Hermans aborde une critique du rationalisme et de la quête scientifique : le héros cherche des preuves, mais ne trouve que le vide et l’absurde.
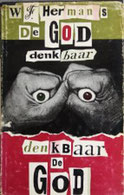
Dans "De God Denkbaar, Denkbaar de God" (1972, Le Donjon), un homme enfermé dans une forteresse sans fenêtres tente de comprendre et d’expliquer le monde avec les seuls concepts logiques qu’il possède. Un roman philosophique expérimental montrant l’incapacité de l’homme à comprendre le monde. Le titre néerlandais signifie "Dieu est pensable, pensable est Dieu", ce qui souligne le rôle central du concept de Dieu et de la rationalité dans l’histoire (Peut-on vraiment comprendre le monde à travers la pensée rationnelle ?).
Le protagoniste, un intellectuel anonyme, vit reclus dans une forteresse (le "Donjon"). Il passe son temps à écrire, réfléchir et analyser le monde, cherchant une vérité absolue à travers la logique. Mais il ne sait pas s’il est prisonnier ou s’il s’est enfermé lui-même. Le narrateur tente alors de prouver ou de réfuter l’existence de Dieu, mais chaque raisonnement le mène à une impasse. Il analyse le langage, la perception et la logique formelle, mais rien ne lui permet d’arriver à une conclusion définitive. Ses pensées deviennent de plus en plus abstraites et paranoïaques. Le narrateur est parfois visité par des figures mystérieuses, dont il ne sait pas si elles sont réelles ou imaginaires. Ces personnages incarnent différentes facettes de la connaissance, du doute et de la religion. Mais chaque dialogue le ramène à l’échec de la communication et du savoir humain. Finalement, le narrateur ne trouve aucune réponse à ses questions et reste prisonnier de son donjon intérieur, incapable de savoir s’il est un génie ou un fou. Le livre se terminera sans révélation ni conclusion, laissant le lecteur face à un abîme d’incertitudes...
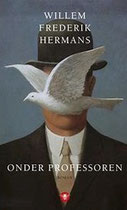
"Onder professoren" (1975, Les Larmes du scorpion"), une satire mordante, de Willem Frederik Hermans, du monde académique qui met en scène le professeur R. Z., enseignant dans une université néerlandaise, et qui découvre avec horreur la médiocrité de ses collègues. Le protagoniste, Rudolf "Rudi" Zeegers (R.Z.), est un professeur de littérature et de philosophie dans une université néerlandaise. Il est sarcastique, misanthrope et profondément méprisant envers ses collègues, qu’il considère comme incompétents et bornés. Il passe son temps à critiquer l’institution, dénonçant la corruption, l’incompétence et le manque de véritable pensée intellectuelle. L’université est dirigée par des bureaucrates sans culture, obsédés par les règlements et la politique interne plutôt que par le savoir. Les collègues de R.Z. sont des carriéristes, prêts à tout pour obtenir des promotions et du pouvoir. Les étudiants ne sont pas mieux : paresseux, insipides ou trop conformistes. R.Z. va se retrouver englué dans des querelles absurdes avec ses collègues, qui lui reprochent son cynisme et son arrogance. Il assiste à des conseils d’université grotesques, où des professeurs débattent de sujets insignifiants pendant des heures. Et s'il tente de défier le système, il se heurte à un mur d’absurdité bureaucratique. L’administration va multiplier les pressions, et R.Z. se retrouve piégé dans un système qui le dévore et le pousse à la démission ...
"Een wonderkind of een total loss" (1972, Un automne romain), - dont le personnage central, un jeune écrivain néerlandais se rend à Rome, espérant échapper à l’ennui et trouver l’inspiration, mais ne trouve que solitude et désillusion -, est un des romans les plus personnels d’Hermans, avec une réflexion sur l’échec et l’illusion littéraire.

"Au Pair" (1989), un des derniers grands romans de Willem Frederik Hermans. Comme dans beaucoup de ses œuvres, il met en scène un personnage perdu dans un monde hostile, où les certitudes s’effondrent et où l’individu se retrouve impuissant. Eurydice est une jeune femme de 22 ans, ambitieuse et cultivée, qui rêve d’une vie intellectuelle et d’indépendance. Elle accepte un emploi d’au pair dans une famille bourgeoise à Amsterdam, espérant gagner du temps pour écrire et réfléchir. Dès son arrivée, elle se rend compte que son rôle est bien plus servile que prévu. La famille qui l’emploie est composée d'un père distant et méprisant, qui se croit supérieur intellectuellement, d'une mère frustrée et névrosée, qui projette ses propres échecs sur Eurydice, d'un fils arrogant et manipulateur, qui joue avec ses sentiments. Peu à peu, Eurydice réalise qu’elle est enfermée dans une dynamique de pouvoir qu’elle ne contrôle pas. Eurydice tente de résister et de s’affirmer, mais chaque tentative se retourne contre elle.
Son ambition d’écrire un grand livre est constamment sabotée par son quotidien monotone et humiliant et en vient à se demander si elle n'est pas la victime d’un complot ou si elle exagère la situation. Finalement, Eurydice se rend compte qu’elle n’a aucun contrôle sur son destin.
Elle quitte la famille sans avoir accompli quoi que ce soit, totalement désillusionnée.
La dernière scène montre une femme brisée, qui comprend que son combat était voué à l’échec dès le début. Comme dans beaucoup de romans d’Hermans, la fin est une impasse existentielle ...
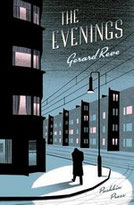
Gerard Reve (Gerard Kornelis van het Reve, 1923-2006), célèbre pour son style ironique et subversif, mélangeant réalisme, fantastique et provocation religieuse et sexuelle, a choqué les milieux conservateurs pour ses descriptions explicites d’homosexualité (tabou à l’époque) et son approche ironique du catholicisme, pour ne pas dire plus, où Dieu devient parfois un personnage sadique et ambigu. Cet écrivain inclassable fut l'un des écrivains les plus lus aux Pays-Bas. "De Avonden" (1947, The Evenings, Les Soirs) est sans doute l'un de ses romans les plus populaires : de la vie monotone et absurde d’un jeune homme à Amsterdam, confronté à l’ennui et à l’absurdité du quotidien. L’histoire se déroule en décembre 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le protagoniste, Frits van Egters, est un jeune homme de 23 ans, sans ambition ni direction. Il vit avec ses parents, qui sont ennuyeux, maladroits et souvent ridicules. Chaque soir, il cherche désespérément à fuir la banalité de sa vie. Frits rend visite à des amis, mais leurs discussions sont vides et déprimantes. Il fait des blagues cruelles, parle de vieillesse, de mort, de laideur, et semble se réjouir de l’échec des autres. Il observe ses parents avec mépris, mais n’a aucune ambition pour lui-même. Il se moque des autres, mais son propre vide intérieur le ronge. Les jours passent et rien ne change. Le dernier soir, il se mettra au lit en se disant qu'il a survécu encore un jour, et c’est déjà quelque chose. Le roman se terminera sans événement majeur, reflétant la stagnation existentielle du personnage.
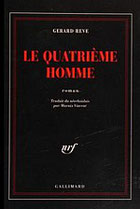
"De Vierde Man" (1981, The Fourth Man, Le Quatrième Homme), un mélange de thriller psychologique et de satire sociale écrit par Gerard Reve et dont l'adaptation cinématographique très populaire, réalisée par Paul Verhoeven (avec Jeroen Krabbé et Renée Soutendijk), accentuera la notoriété en y ajoutant un soupçon de tension érotique et mystique. Le protagoniste, Gerard, est un écrivain néerlandais alcoolique, sarcastique et cynique. Il accepte une invitation à animer une conférence littéraire dans une petite ville néerlandaise. Lors de son séjour, il rencontre Christine, une femme séduisante et mystérieuse. Bien qu’il soit homosexuel, il cède à son charme et entame une relation avec elle. Gerard emménage temporairement chez Christine, qui vit dans une maison élégante et inquiétante, mais peu à peu, il découvre des détails troublants sur son passé (elle a été mariée trois fois, ses trois maris sont morts dans des circonstances suspectes, elle possède des objets religieux inquiétants, notamment des icônes et des crucifix). Le voici sous l'emprise de rêves inquiétants qui le font craindre d'être la prochaine victime de Christine, comme tous les hommes qui l'ont précédés. D'autant qu'il découvre un nouveau secret : Christine a un nouvel amant, un jeune homme blond. Dans un moment de panique, Gerard s’enfuit de la maison, terrifié par sa propre vision du futur. La fin du roman reste ambiguë : Christine est-elle réellement une meurtrière, ou tout cela était-il un délire paranoïaque de Gerard ? Gerard n’est pas un héros typique, mais un intellectuel égocentrique, alcoolique et sarcastique, en qui le lecteur ne peut avoir totalement confiance ...

"Het Boek van Violet en Dood" (1996, The Book of Violet and Death, Le Livre du Royaume des Cieux) est considéré comme l’un des romans les plus audacieux et provocateurs de Reve : un récit sous forme de méditation spirituelle et sexuelle dans lequel l'auteur, qui s’est converti au catholicisme dans les années 1960, présente une vision très personnelle de la foi et de Dieu. ll décrit ses fantasmes homoérotiques de manière explicite, souvent liés à des visions mystiques, et invente un langage volontairement grotesque et excessif, où les désirs charnels deviennent des métaphores religieuses. À la fin du livre, le narrateur ne trouvera pas de réponse définitive à ses angoisses et conclura que Dieu existe peut-être, mais qu’Il est cruel et indifférent...
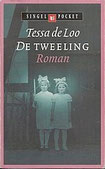
"De Tweeling" (1993, Tessa de Loo, Les Jumelles)
De son vrai nom Johanna Martina "Tessa" de Loo, Tessa de Loo est une écrivaine néerlandaise née en 1946 à Bussem, aux Pays-Bas, et l’une des romancières les plus populaires des Pays-Bas, connue pour ses récits profondément psychologiques, ses thèmes liés à l’histoire et aux traumatismes du passé. Elle a acquis une renommée internationale grâce à son roman "De tweeling" (The Twins), un best-seller, - plus de 1,5 million d’exemplaires vendus aux Pays-Bas et en Allemagne -, qui s'interroge sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur des sœurs jumelles séparées et élevées dans des camps opposés. Ce roman a été adapté en film en 2002, renforçant sa notoriété à l’étranger.
Les jumelles Anna et Lotte ont été séparées dans leur prime enfance, par la mort de leurs parents, puis par la maladie et les vendettas familiales et enfin par la Seconde Guerre mondiale.
Lotte a été envoyée aux Pays-Bas, où elle a grandi dans un environnement protégé, loin de la guerre. Anna est restée en Allemagne, élevée dans une famille stricte qui l’endoctrine progressivement dans l’idéologie nazie.
Dans les années 1930 et 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate, exacerbant les différences entre les deux sœurs : Lotte voit son entourage juif persécuté et rejoint la résistance néerlandaise, tandis qu' Anna, vivant sous le IIIe Reich, n’a d’autre choix que de suivre les ordres, bien qu’elle ne soit pas une fervente nazie. Le contraste entre leurs expériences est frappant : Lotte souffre de la guerre comme victime et témoin des crimes nazis, tandis qu'Anna souffre comme Allemande vivant dans un pays en guerre, mais perçue comme coupable par association. Anna tentera de se défendre : elle ne se sent pas responsable des crimes nazis, car elle était jeune et sans pouvoir. Lotte, au contraire, verra en elle une représentante de l’oppresseur.
Plus de 50 ans après la guerre, dans les années 1990, elles se retrouvent accidentellement, à l'âge de soixante-quatorze ans, dans un hôtel de remise en forme en Belgique. Cette rencontre inattendue provoque des émotions contraires chez les deux femmes. Anna, la sœur allemande, maltraitée dans son enfance par sa famille adoptive et qui a perdu, à cause de la guerre et des circonstances, tous ceux qui pouvaient l'ancrer et lui donner un sentiment d'appartenance, embrasse avec ferveur sa parente retrouvée. Lotte au contraire, élevée aux Pays-Bas, porte une haine tenace envers son ancienne patrie et accueille les avances de sa sœur avec suspicion et dédain. Leur dialogue devient une confrontation douloureuse sur leur passé. Lotte considère que les Allemands ont choisi leur camp et doivent porter la culpabilité collective. Anna, en revanche, rejette cette culpabilité collective, estimant qu’elle a aussi été victime du régime : elle représente la complexité du peuple allemand, tiraillé entre obéissance, peur et culpabilité post-guerre. Le débat met en lumière deux visions irréconciliables de l’Histoire et le roman se termine sur une tension non résolue : est-il possible de réconcilier ceux qui ont été victimes et ceux qui, même passivement, faisaient partie du système ?
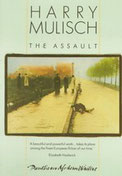
Harry Mulisch (1927-2010) est l’un des écrivains les plus importants des Pays-Bas, connu pour ses romans abordant l’histoire, la mémoire, la philosophie et l’Holocauste. Son œuvre est souvent comparée à celle de Günter Grass ou de Primo Levi, car elle mêle histoire et réflexion existentielle. Il fait partie du "Grote Drie" (Grand Trio) de la littérature néerlandaise avec Willem Frederik Hermans et Gerard Reve.
Son œuvre la plus connue, "L’Attentat" (De Aanslag, The Assault, 1982), Prix du Meilleur Livre Néerlandais (1985), a été adaptée en film par Fons Rademakers (Oscar 1987 du meilleur film étranger) : l'histoire d'un enfant dont la famille est exécutée par les nazis après un attentat contre un officier allemand...
C’est l’hiver de 1945, les derniers jours sombres de la Seconde Guerre mondiale dans la Hollande occupée. Un collaborateur nazi, tristement célèbre pour sa cruauté,Ploeg, est assassiné alors qu’il rentre chez lui à vélo. Les Allemands ripostent en brûlant la maison d’une famille innocente; seul . Anton Steenwijk, âgé de douze ans, survit : de fait, Ploeg a été abattu devant la maison des voisins, les Korteweg et ceux-ci, pour éviter les représailles, ont déplacé le cadavre devant la maison d’Anton, ce que celui-ci ignorera jusqu'au dénouement. Les nazis ripostent immédiatement, exécutent ses parents et son frère Peter, la maison est incendiée, Anton est emmené en détention puis placé chez son oncle et sa tante à Amsterdam...
Basé sur des événements réels, "The Assault" retrace les répercussions complexes de cet incident horrible sur la vie d’Anton qui se dérouler dans l'ombre de cette tragédie..
Il devient médecin, évite de penser au passé, préférant une vie rationnelle et stable, mais, au fil des années, des rencontres et des découvertes vont peu à peu lui révéler la vérité sur cette nuit de 1945. Le roman est structuré en cinq parties, correspondant à cinq moments clés de la vie d’Anton (1945, 1952, 1956, 1966, 1981)...
- 1952 – Première révélation : Anton rencontre Truus Coster, une ancienne résistante, qui lui apprend que l’attentat était un acte de résistance organisé. Elle était impliquée dans l’assassinat du nazi Ploeg, mais Anton ne comprend pas encore pourquoi le corps a été déplacé.
- 1956 – Deuxième révélation : Anton fait la connaissance du fils de Ploeg, qui défend la mémoire de son père. Ce fils considère les nazis comme des victimes, ce qui choque Anton. Une rencontre qui renforce sa confusion morale sur la distinctiin du bien et du mal.
- 1966 – Troisième révélation : Anton retrouve M. Korteweg, le voisin qui a déplacé le corps du nazi devant sa maison. Pourquoi ? Korteweg savait que les nazis exécuteraient la famille devant laquelle ils trouveraient le cadavre. Il a déplacé le corps pour protéger sa propre famille. Ce fut donc un choix désespéré pour sauver sa propre vie.
- 1981 – Dernière révélation : Lors d’un dernier échange avec un membre de la Résistance, Anton apprend que Truus Coster a été arrêtée et tuée juste après l’attentat. Il comprend enfin l’étendue du sacrifice des résistants et de la complexité des choix faits pendant la guerre.
La vérité est toujours fragmentaire, et le hasard et les choix des uns ont condamné les autres ...

"De Ontdekking van de Hemel" (Harry Mulisch, 1992, La Découverte du ciel, The Discovery of Heaven ) est l’un des plus grands romans néerlandais du XXe siècle, reconnu pour sa richesse thématique et son écriture brillante, un ton ironique et intellectuel qui le distingue des autres romans historiques ou religieux, et qui peut se lire tant comme une quête existentielle, que comme une critique de la société moderne. Mulisch entrelace des récits bibliques, des événements historiques et des théories scientifiques, et jongle avec les références à la Torah, à l’Holocauste et aux avancées en astronomie. Mulisch propose ainsi une vision du monde où Dieu a abandonné l’humanité, où l’homme n’a plus besoin de religion pour comprendre l’univers. Mais si les sciences (incarnées par Max) et la politique (Onno) se sont substituées à la foi, elles n’ont pas encore apporté de réponses définitives ...
L’histoire commence dans un royaume céleste, où des anges discutent du désordre du monde moderne. Dieu décide de reprendre les Tables de la Loi, qui ont été données à Moïse. Pour cela, un enfant spécial doit naître, destiné à accomplir cette mission. Deux hommes sont manipulés par ces anges pour concevoir cet enfant. Onno Quist et Max Delius sont les deux protagonistes principaux ...
Lorsque dans la nuit du 13 fevrier 1967, Max Delius prend en stop Onno Quist sur la route d’Amsterdam, il ne sait pas que cette rencontre changera le cours de son existence. En apparence, tout sépare les deux hommes: l’un est astronome, coureur de jupons, extraverti et jouisseur, obsédé par la compréhension de l’univers; l’autre spécialiste des langues anciennes indéchiffrables, plutot timide et solitaire. Tandis que Max est orphelin d’une mère juive déportée et d’un père collaborateur, Onno vient d’une grande famille de notables calvinistes. L’un sort tout juste du lit d’une de ses maîtresses, l’autre s’est échappé d’une pesante réunion de famille. Max et Onno deviennent pourtant inséparables : la dualité entre raison et spiritualité. Cette amitié est le fil conducteur d’un roman inclassable qui parvient à nous entrainer aussi bien dans un chasse-croisé amoureux sur fond de congrés révolutionnaire à Cuba, que dans les obsessions d’un adolescent surdoué, convaincu de pouvoir retrouver les Tables de la Loi. Mais Mulisch nous plonge également dans le passé trouble de la collaboration, décrit les arcanes de la politique et du pouvoir et met en scène avec un rare talent les jeux de l’amour et du sexe..
La naissance de Quinten, l’enfant du destin, en est le premier épisode. Les anges orchestrent la rencontre entre Onno et Ada Brons, une musicienne talentueuse. Ada tombe enceinte de Quinten, mais ne sait pas qui est le père (Onno ou Max). Un accident tragique laisse Ada dans le coma après l’accouchement. Quinten est élevé par Onno et la mère de Max, mais reste un enfant mystérieux et précoce (La naissance d’un messie moderne, créé par le hasard, ou le destin).
Le voyage initiatique de Quinten et la quête des Tables de la Loi : Quinten grandit avec un instinct naturel pour comprendre le monde, mais sans attaches émotionnelles. Lorsqu’il devient adulte, il ressent un appel inexpliqué à une mission qu’il ne comprend pas encore. Avec Onno, il part à Jérusalem, où se trouvent les Tables de la Loi, des Tables conservées dans un lieu secret, mais qui doivent être rendues à Dieu, car l’humanité n’a pas respecté le pacte. Quinten réussit sa mission, rend les Tables de la Loi aux anges, et disparaît mystérieusement. C'est le passage à une ère sans Dieu ...

La littérature néerlandaise du XXIe siècle est dite "diversifiée" et évolue dans un contexte plus fragmenté : Arnon Grunberg, souvent considéré comme le plus important écrivain contemporain, aborde des thèmes universels comme l’aliénation et l’identité avec une approche ironique et incisive. Tommy Wieringa, avec des œuvres comme "Dit zijn de namen" (2012), traite de thèmes actuels comme les migrations et l’identité. Ilja Leonard Pfeijffer, avec des romans tels que "Grand Hotel Europa" (2018), interroge la place de l’Europe et les effets du tourisme de masse. La montée en puissance de voix féminines et issues des diasporas, comme Marieke Lucas Rijneveld (prix International Booker en 2020 pour "The Discomfort of Evening"), reflète une littérature plus inclusive mais souvent moins universelle dans ses thématiques. La visibilité internationale reste limitée comparée à celle des auteurs du XXe siècle comme Mulisch ou Hermans, bien que certains contemporains soient traduits. Les débats autour de l’impact de la mondialisation et du déclin de la lecture parmi les jeunes occupent une place importante dans l’évaluation actuelle de la littérature néerlandaise.


La littérature belge du XXe siècle a produit des figures majeures, que l'on pense au poète et dramturge symboliste Maurice Maeterlinck, associé à la scène littéraire française et prix Nobel en 1911. Dans sa version néerlandophone, on peut évoquer Hugo Claus, auteur monumental ("Het verdriet van België", 1983), questionnant l’identité flamande et les complexités de l’histoire belge. Louis Paul Boon, avec des œuvres comme "Mijn kleine oorlog" (1947), mêle narration sociale et introspection. Le mouvement expérimental des années 1960, notamment avec des poètes tels que Paul Snoek, a introduit des innovations stylistiques notables. Dans sa version francophone, c'est l'incomparable Georges Simenon, auteur de romans tant policiers que "noirs", qui a marqué la littérature mondiale définitivement la littérature mondiale. Marguerite Yourcenar, bien que souvent associée à la France, puise ses origines en Belgique et apporte une profondeur historique à la littérature. Michel de Ghelderode, avec son théâtre expressionniste, a influencé la scène littéraire et théâtrale belge. Ces figures incarnent une période de reconnaissance internationale pour la littérature belge, avec des styles variés et des contributions profondes à des débats universels...
Au XXIe siècle, la littérature belge contemporaine évolue dans un contexte différent, marqué par ce qu'on appelle, encore et toujours, une "fragmentation" accrue. Version néerlandophone, Stefan Hertmans, avec des romans tels que "Oorlog en terpentijn" (2013), revisite l’histoire et la mémoire avec un style introspectif, Tom Lanoye, dramaturge et romancier, continue d’explorer les tensions politiques et sociales, notamment dans "Kartonnen dozen". Lize Spit, une voix montante, a connu un succès retentissant avec "Het smelt" (2016), une œuvre explorant les traumatismes individuels et collectifs. Version francophone, Amélie Nothomb, internationalement reconnue, reste ancrée dans le paysage belge avec ses récits uniques et prolifiques. Jean-Philippe Toussaint, écrivain et réalisateur, explore des thèmes minimalistes avec une esthétique singulière. Caroline Lamarche, lauréate de nombreux prix, interroge des thématiques contemporaines avec une sensibilité poétique. Au final, si des auteurs comme Stefan Hertmans ou Amélie Nothomb maintiennent une certaine visibilité, celle-ci reste plus limitée par rapport aux figures du XXe siècle comme Hugo Claus ou Simenon. Et le traitement des thématiques contemporaines (identité, mémoire, environnement) est souvent perçu comme moins ambitieux ou moins universel que les grandes réflexions historiques ou sociales du XXe siècle...

"Margot en de engeien" (1997, Kristien Hemmerechts)
Kristien Hemmerechts est une écrivaine belge flamande née le 27 août 1955 à Bruxelles. Elle est connue pour ses romans, essais et nouvelles, qui explorent des thèmes psychologiques, féministes et sociétaux. Le réalisme magique ou le postmodernisme ne séduisent pas tous les auteurs, bienheureusement : ici l'exploration des relations humaines et de la vie émotionnelle dans le contexte de la réalité quotidienne semble encore pouvoir nourrir, avec talent, des oeuvres littéraires. Et c'est dans la tradition du roman psychologique flamand, que Kristien Hemmerechts publiera en 2013 "De Melkblauwe Jurk" (Bleu de lait), dans lequel une femme, Clara, élevée dans une famille stricte et dysfonctionnelle, où l’amour et l’attention étaient rares, revisite son passé et ses traumatismes familiaux. - "Taal zonder mij" (1998) est récit autobiographique et littéraire, émouvant, dans lequel Hemmerechts raconte la mort de son mari, l’écrivain Herman de Coninck, en 1997. - "De vrouw die de honden eten gaf" (2014, La Femme qui nourrissait les chiens), inspiré de faits réels, basé sur Michelle Martin, l’ex-femme du criminel belge Marc Dutroux, s'interroge sur la psychologie d’une femme sous emprise, mais aussi sur les limites de la responsabilité et du pardon.
"Margot en de engelen" (Margot et les anges), le récit émouvant et intime d'une femme hantée par ses choix et ses absences. Alternant présent et flashbacks, elle va tenter de reconstruire progressivement son histoire personnelle et ses blessures invisibles. Margot mène en effet une existence routinière et distante, travaillant dans une bibliothèque. Elle ressent un vide profond, accentué par l’absence de ses enfants, partis vivre avec leur père après son divorce. Elle s’accroche à des souvenirs fragmentés, notamment ceux de sa maternité et de ses relations passées. Une douleur silencieuse mais omniprésente la pousse à s’interroger sur son propre rôle de mère : Margot n’a pas la garde de ses enfants, un fait qui la tourmente et l’isole du monde. Des visions d’anges viennent hanter sa solitude, manifestation de son inconscient, ou signe d’un déséquilibre mental grandissant? Margot revient alors sur ses histoires d’amour passées, cherchant à comprendre ce qui a mal tourné. Elle repense à ses anciennes relations, notamment avec le père de ses enfants, qu’elle a aimé mais dont elle s’est détachée progressivement. Elle réalise que son incapacité à s’ouvrir pleinement aux autres l’a souvent conduite à l’échec amoureux et familial. A la fin du roman, Margot ne retrouve pas miraculeusement ses enfants, ni un amour salvateur. Cependant, elle semblera commencer à accepter son passé et sa solitude, à faire la paix avec ses regrets et ses choix. Les anges, autrefois une manifestation de son malaise, deviennent un symbole d’apaisement et d’acceptation de soi. ...

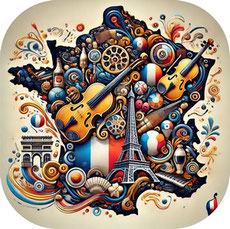
Le XXe siècle fut une période d’influence mondiale pour la littérature française, avec des auteurs et mouvements majeurs. Parmi les auteurs, qu'il suffise de citer les noms, et oeuvres associées, suivants, la plupart ayant transcendé les frontières françaises...
Les années 1900-1910 en France sont marquées par un tournant littéraire majeur. Les écrivains de cette période, héritiers du symbolisme, du naturalisme ou du romantisme fin-de-siècle, imaginent de nouvelles formes et thématiques qui annoncent l'avant-garde du XXe siècle, une imagination totalement épuisée au XXIe siècle ...
Emile Zola meurt en 1902 mais son influence reste majeure grâce à la série des Rougon-Macquart (terminée en 1893) : apparaissent "L’Immoraliste" (1902), récit d’une quête d’émancipation individuelle face aux conventions sociales, et "La Porte étroite" (1909), réflexion sur le sacrifice et le désir, deux oeuvres d'André Gide qui inaugurent un siècle littéraire exceptionnel. - En 1900, Colette a donné "Claudine à l’école", puis "La Vagabonde" (1910), une voix féminine unique, célébrant l’émancipation et l’introspection. Suivent, notamment, "L’Île des Pingouins" (1908) d'Anatole France, Prix Nobel en 1921, en 1912, Claudel (L'Annonce faite à Marie), 1913, Apollinaire (Alcools), Barrès (La colline inspirée), 1919, Proust (A l'ombre des jeunes filles), 1922, Roger Martin du Gard (Les Thibault), 1922, Valéry (Charmes), 1924, Breton (Manifeste du surréalisme), 1927, Mauriac (Thérèse Desqueyroux), 1930, Malraux (La Condition humaine), 1932, Céline (Voyage au bout de la nuit), Romains (Les Hommes de bonne volonté), Mauriac (Noeud de Vipères), 1935, Giraudoux (La guerre de Troie n'aura pas lieu), 1936, Bernanos (Journal d'un curé de campagne), 1938, Sarte (La Nausée), 1939, Gide (Journal, 1889-1939), Arthaud (Le théâtre et son double), Nathalie Sarraute (Tropismes), 1942, Camus (L'étranger, prix Nobel en 1957), Montherlant (La reine morte), 1943, Sartre (L'Être et ne Néant), 1944, Anouilh (Antigone), 1946, Prévert (Paroles), 1947, Genet (Les Bonnes), Vian (L'écume des jours), 1950, Ionesco (La cantatrice chauve), 1951, Gracq (Le rivage des Syrtes), 1953, Beckett (En attendant Godot, prix Nobel en 1969), Alain Robbe-Grillet (Les Gommes), 1954, Sagan (Bonjour Tristesse), 1957, Butor (La modification), St John Perse (Amers), 1958, Duras (Moderato cantabile), Simone de Beauvoir (Mémoires d'une jeune fille rangée), 1959, Sarraute (Le Planétarium), 1961, Ponge (Le grand recueil), 1963, Robbe-Grillet (Pour un nouveau roman), 1968, Yourcener (L'œuvre au noir), 1971, Tourier (Le roi des Aulnes), 1975, Modiano (Villa triste), 1978, Perec (La vie mode d'emploi), 1983, Sollers (Femmes)...
ET parmi les mouvements artistiques et littéraires, Fauvisme (1905-1910), Cubisme (1907-1920), Surréalisme (années 1920-1940), Existentialisme (1940-1950), Abstraction lyrique (années 1940-1950), Nouveau Roman (1950-1970) ... La France était alors perçue comme un centre de créativité littéraire mondiale et Paris un creuset artistique sans équivalent ...

Au XXIe siècle, on peut considérer que la littérature française reste influente, mais il s'agit de celle des siècles passés, de nombreuses universités japonaises, par exemple, notamment à Tokyo, Kyoto, et Osaka, proposent des cursus approfondis sur la littérature française, avec des colloques réguliers, mais on en reste à Proust, Hugo, Zola, Camus, ou Duras. Les courants existentialistes et poststructuralistes français (Sartre, Foucault, Derrida) ont eu de même un impact majeur sur les universités américaines, en particulier dans les départements de philosophie et de littérature. La reconnaissance internationale ne dépasse plus guère le XXe siècle. Reste quelques phénomènes médiatiques parfaitement entretenus, Michel Houellebecq, qui aborde lui-même le déclin occidental dans des œuvres comme "Les Particules élémentaires" (1998). Sinon la France littéraire du XXIe siècle s'auto-célèbre, sans véritable auteur marquant et surtout sans grande imagination, les auteurs se racontent, comme ailleurs, on parle de diversité de genres et de styles, mais bienheureusement il existe encore et toujours un lectorat important en attente, en désir de quelques étincelles.


Le cinéma, a-t-on oublié, est de création récente, une aventure qui saisit tout le XXe siècle. Un siècle qui verra le cinéma européen, et notamment celui de l'Europe de l'Ouest, dominait de nombreux aspects de l'industrie et de la production mondiale, un cinéma d'auteurs, un lieu d’avant-garde et d’innovation, distinct de l’approche hollywoodienne...
- À partir de 1895, le cinéma muet se développe rapidement dans toute l’Europe, en France, grâce aux frères Lumière et à Georges Méliès (Le Voyage dans la Lune, 1902), en Allemagne, les premiers films muets apparaissent dans les années 1900, avec des pionniers comme Oskar Messter, au Royaume-Uni, les premières projections ont lieu dès 1896, notamment avec des œuvres de Robert W. Paul et de G.A. Smith.
- L'Expressionnisme allemand (1920s), avec des films comme Metropolis (Fritz Lang) et Nosferatu (F.W. Murnau). Si l’Allemagne a révolutionné l’esthétique cinématographique, la montée du nazisme, l’exil de nombreux réalisateurs et acteurs (Fritz Lang, Marlene Dietrich) et la censure artistique interrompront brutalement cet élan ...
- Le cinéma parlant commence à s’imposer en Europe à partir de 1929..
- Dans les années 1930, le cinéma parlant s’impose rapidement en France, avec des films comme "Sous les toits de Paris" (1930) de René Clair...
- L'après-guerre et la montée du réalisme poétique (1940-1950) en France, avec Marcel Carné (Les Enfants du paradis, 1945), Robert Bresson (Journal d'un curé de campagne, 1951) ..
- Le Néoréalisme italien (1940-50s) : Réalisateurs comme Vittorio De Sica (Ladri di biciclette, 1948) et Roberto Rossellini ont mis en lumière les réalités sociales de l’après-guerre...
- Les studios Ealing et les comédies britanniques (1940-1950), avec "Kind Hearts and Coronets" (Noblesse oblige, 1949) ou "The Ladykillers" (Tueurs de dames, 1955)...
- Le réalisme social des années 1950-1960 (Kitchen Sink Drama), avec "Saturday Night and Sunday Morning" (1960) de Karel Reisz et "A Taste of Honey" (1961) de Tony Richardson.
- Le Free Cinema (1956-1959), avec Lindsay Anderson (Every Day Except Christmas, 1957) ou Karel Reisz (We Are the Lambeth Boys, 1959).
- La Nouvelle Vague française (1950-60s), avec Jean-Luc Godard (À bout de souffle, 1960), François Truffaut (Les 400 Coups, 1959), Agnès Varda (Cléo de 5 à 7, 1962) ..
- En France, un cinéma d'auteurs et d'acteurs particulièrement populaires, des scénaristes de talent, un public pour un public largement acquis, 100 à 150 films sont produits par an dans les années 1950-1980, on notera un pic dans les années 1950 avec environ 400 millions d'entrées par an et un début de déclin dans les années 1970 à environ 170 millions, avant une légère reprise dans les années 1990.
- Le Nouveau Cinéma Allemand (1960-1980), avec Rainer Werner Fassbinder (Le Mariage de Maria Braun, 1979), Wim Wenders (Les Ailes du désir, 1987), Werner Herzog (Aguirre, la colère de Dieu, 1972), Volker Schlöndorff (Le Tambour , 1979, Palme d’Or à Cannes).
- Le Swinging London et les films d’avant-garde (1960-1970), avec "Blow-Up" (1966) de Michelangelo Antonioni. ou "Performance" (1970) de Nicolas Roeg ..
- Un cinéma d'auteur engagé dans la France des années 1970, avec Costa-Gavras (Z, 1969 ; L’Aveu, 1970), Chris Marker (La Jetée, 1962 ; Sans Soleil, 1983), Marguerite Duras (India Song, 1975)..
- Le renouveau du cinéma britannique (1980-1990) en pleines tensions sociales, avec "My Beautiful Laundrette" (1985) de Stephen Frears, "The Crying Game" (1992) de Neil Jordan.
- Le cinéma d'auteur des années 1980-1990, en France, avec Maurice Pialat (À nos amours, 1983), Leos Carax (Les Amants du Pont-Neuf, 1991), Claire Denis (Chocolat, 1988) ..
- des réalisateurs influents, Ingmar Bergman (Suède), Federico Fellini (Italie), Andrei Tarkovski (URSS) et Luis Buñuel (Espagne) ont produit des œuvres universellement reconnues ..
- des Festivals européens comme Cannes, Venise et Berlin ont renforcé la place du cinéma européen comme référence internationale (un cinéma spécifique tourné vers les festivals internationaux existent désormais dans nombre de pays).
- et l'émergence de nouvelles plateformes de financement, soutenant le cinéma indépendant, tel que "Trainspotting" (1996) de Danny Boyle ou "Billy Elliot" (2000) de Stephen Daldry...

Au XXIe siècle, les évolutions technologiques on conduit à la digitalisation des tournages et de la postproduction, à l'utilisation massive des effets spéciaux et au développement des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime, qui influencent désormais fortement la production auxquelles l'adhésion du public, notamment jeune, est une réalité ...
- Globalement, le cinéma européen reste actif (Pedro Almodóvar (Espagne),Ruben Östlund (Suède), lauréat de la Palme d’or pour "The Square" (2017), "Triangle of Sadness" (2022), Yorgos Lanthimos (Grèce), "The Favourite" (2018)), mais son rôle dans le paysage cinématographique mondial a évolué.
- Les Festivals sont toujours influents, et supports médiatiques incontournables (Cannes, Berlin et Venise), le financement européen toujours présent dans nombre de co-productions internationales, mais la part de marché des films européens dans leurs propres pays a diminué.
Le plus souvent, la production européenne dépend davantage de subventions publiques et de co-productions, limitant son audace commerciale : quant aux acteurs, la période des "monstres sacrés" est révolue, le second rôle s'est généralisé, et pour le contenu, les grands scénaristes se font rares, on recycle beaucoup, et pourtant la production cinématographique en Europe ne cesse d'augmenter ...
Plus de 100.000 films ont sans doute été produits en Europe au XXe siècle, et l'écrasante majorité de ceux-ci ne sont pas accessibles à nos contemporains, les télévisions recyclent toujours les même catalogues, peut-on encore parler de culture cinématographique au XXIe siècle ?
