- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
Political Notes - Extermination
Primo Levi, "Si questo è un uomo" (Si c'est u n homme, If This Is a Man, 1958) - Timothy Snyder, "Black Earth: The Holocaust as History and Warning" (2015) - "The Destruction of the European Jews", Raul Hilberg (1961- ...
Last update: 06/06/2018

En droit international, l'extermination de populations s'appelle un "génocide" (plus précisément, l'extermination est qualifiée de génocide si la population en question est ciblée sur la base de considérations de nationalité, d’ethnie, de race ou de religion) et est poursuivie comme crime contre l'humanité : il s'agit donc, mot à mot, d'un processus destiné à faire disparaître de notre planète Terre, à à détruire physiquement tous les membres d'une population vivante, végétale, animale ou humaine. Mais cette définition ne suffit pas à épuiser l'horreur d'un terme qui s'enracine au plus profond de notre histoire humaine, au sens premier il s'agissait de faire disparaître, d'expulser au sens biblique, puis par extension il s'agira de faire périr. Mais fondamentalement, toute extermination suppose des hommes et femmes exterminées et des hommes et femmes "exterminants", des exterminants qui peuvent être actifs ou passifs : sans exterminants, pas d'exterminés, logique peut-être naïve dans sa simplicité et sa crudité, mais réalité bien concrète de notre histoire humaine et que l'on tend à oublier... Tout glossaire politique possède un arsenal de termes et d'outils destinés à trancher dans toute collectivité humaine, directement ou indirectement, séparant de fait les êtres humains, fractionnant liens et attachements, ségrégation, apartheid, colonialisme, nationalisme, populisme, on s'attache à la notion, on retient le visage ou la parole de celui qui subit ou se soumet, - c'est déjà un moindre mal -, on peut même se risquer à faire un procès de la soumission elle-même, mais encore et toujours on passe sous silence, silence de notre pensée, silence de nos actions, celui et ceux qui mettent en oeuvre le principe de partition, d'expulsion, d'extermination, et pourquoi?... Sans exterminateurs pas d'exterminés....

La prise de conscience de cette capacité d'extermination sur notre planète Terre est apparue avec la Shoah, une extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre cinq et six millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale (Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, 1985). Elle fut la plus brutale, l'une des plus sanguinaire, et si quelque mauvaise conscience a pu ici et là émerger, il faut avouer que très rapidement en perpétuer le souvenir, si nécessaire soit-il, a permis, avec toute cette ambiguïté permanente qui qui caractérise notre condition humaine, de s'affranchir de interrogation plus approfondie. Il ne reste donc qu'à livrer témoignage de la parole des exterminés pour espérer peut-être épuiser les sinistres vocations ou simples participations des exterminateurs de toute nature qui peuplent potentiellement notre univers...
Il s'agit bien du lien entre les êtres humains qui est ici en question, la confiance de l'un en l'autre, l'empathie de l'un à l'autre, et toute l'ambiguïté de notre condition sociale réside en ce simple fait qu'il faut se détacher , à un moment ou un autre, du groupe et se penser en tant qu'individu pour exister, puis il faut savoir faire ce retour vers l'autre pour ne pas sombrer tant individuellement que collectivement, au-delà des races et des religions, des langues et des cultures ...
It is indeed the link between human beings which is in question here, the trust of one in the other, the empathy of one to the other, and all the ambiguity of our social condition lies in the simple fact that we must detach ourselves, at one time or another, from the group and think of ourselves as individuals in order to exist, then we must know how to make this return to the other so as not to sink as individually as well as collectively, beyond races and religions, languages and cultures...
Es, en efecto, el vínculo entre los seres humanos lo que se cuestiona aquí, la confianza del uno en el otro, la empatía del uno con el otro, y toda la ambigüedad de nuestra condición social reside en el simple hecho de que debemos separarnos, en un momento u otro, del grupo y pensar en nosotros mismos como individuos para existir, entonces debemos saber cómo hacer que este retorno al otro para no hundirse tanto individual como colectivamente, más allá de las razas y religiones, los idiomas y las culturas...
"Peut-être ai-je trouvé un soutien dans mon intérêt jamais démenti pour l’âme humaine, et dans la volonté non seulement de survivre […] mais de survivre dans le but précis de raconter des choses auxquelles nous avions assisté et que nous avions subies. Enfin, ce qui a peut-être également joué, c’est la volonté que j’ai tenacement conservée, même aux heures les plus sombres, de toujours voir, en mes camarades et en moi-même, des hommes et non des choses, et d’éviter ainsi cette humiliation, cette démoralisation totales qui pour beaucoup aboutissaient au naufrage spirituel."
Et Primo Levi, de rappeler...
(Se questo è un uomo)
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
(Si c'est un homme, Primo Levi)
"Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
Considérez si c'est un homme
Que celui qui peine dans la boue,
Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c'est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux
Et jusqu'à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver.
Noubliez pas que cela fut,
Non, ne l'oubliez pas:
Gravez ces mots dans votre coeur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous."
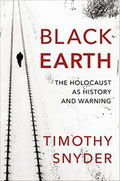
Timothy Snyder, "Black Earth: The Holocaust as History and Warning" (2015)
L'historien américain Timothy Snyder propose une relecture radicale de la Shoah, en la replaçant dans le cadre géopolitique de l’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine, pays baltes). Sa thèse principale est sans équivoque, l’Holocauste ne fut seulement un projet nazi, mais un crime rendu possible par l’effondrement des États....
Les nazis ont ciblé des territoires où l’État avait été détruit (Pologne en 1939, URSS après 1941). Et sans protection juridique, les Juifs sont devenus des "hommes superflus" (concept repris d’Hannah Arendt). On voit ainsi l’importance de l’Europe de l’Est : 90% des victimes juives vivaient dans ces zones. Les massacres de masse (ex. : Babi Yar en Ukraine) y ont été facilités par la collaboration locale et le vide politique. C'est à une véritable critique de l’historiographie traditionnelle que se livre l'historien ; Snyder rejette l’idée que la Shoah était uniquement un plan bureaucratique allemand (contre Raul Hilberg).Il au contraire souligne le rôle des initiatives locales (pogroms, dénonciations).
Après avoir, dans l'introduction intitulée « Hitler's World », évoqué la vision du monde d'Adolf Hitler et les fondements idéologiques qui ont conduit à l'Holocauste (l'existence humaine comme une lutte perpétuelle entre races pour la survie, rejetant les concepts de moralité, de religion et d'éthique comme des obstacles à cette lutte naturelle; et les Juifs non pas simplement comme une race inférieure, mais comme une « contre-race » menaçant l'ordre naturel : il leur attribuait l'introduction d'idées telles que la loi, la morale et la conscience, qui, selon lui, affaiblissaient la pureté et la force des races supérieures), Snyder approfondit l'idée centrale du nazisme, le besoin vital pour l’Allemagne d’obtenir un Lebensraum, ou « espace vital », principalement à l’Est de l’Europe, en particulier en Ukraine, perçue comme un grenier à blé idéal pour nourrir le peuple allemand. Cela impliquait l’élimination des populations locales, surtout les Slaves et les Juifs, qui devaient être expulsés, asservis ou exterminés. La conquête de l’Est et l’extermination des Juifs n’étaient pas des conséquences de la guerre, mais ses objectifs fondamentaux. Snyder insiste sur le fait que pour comprendre l’Holocauste, il faut d’abord comprendre cette logique expansionniste raciale.
Dans le cadre de cette obsession nazie pour l'espace vital" (Lebensraum), Hitler considérait la Pologne et l'URSS comme des territoires à conquérir. Le pacte Molotov-Ribbentrop (1939) a permis à Hitler d'envahir la Pologne sans crainte d'une intervention soviétique et Snyder de souligner que Staline, en collaborant avec Hitler, a accéléré la désintégration de l'État polonais, créant des zones de non-droit propices aux massacres. La Pologne occupée est ainsi devenue un terrain d'expérimentation pour les méthodes génocidaires : destruction des élites polonaises (exécutions massives, camps de concentration), ghettoïsation des Juifs (ex. le ghetto de Varsovie). Snyder montre que la désorganisation volontaire des institutions polonaises a facilité la Shoah. Staline pensait pouvoir manipuler Hitler, mais le pacte était une fragile alliance de convenance. L'invasion nazie de l'URSS en 1941 (Opération Barbarossa) a marqué la fin de cette collaboration et étendu la zone de terreur.
Dans les années 1930, certains nazis (comme Adolf Eichmann) ont vu le sionisme comme une solution pratique pour se débarrasser des Juifs d'Europe. Des accords comme l'Accord Haavara (1933) ont permis à des Juifs allemands d'émigrer en Palestine en échange du transfert de leurs biens. Snyder souligne que cette politique n'était pas une forme de "tolérance", mais une expulsion calculée, compatible avec l'antisémitisme nazi. Mais les limites de l'immigration juive en Palestine (opposition britannique, résistance arabe) ont rendu cette solution impossible à grande échelle. Après 1941, la conquête nazie de l'Europe de l'Est a changé la donne : les Juifs n'étaient plus des "exilés à expulser" mais des victimes à éliminer sur place. La Palestine perd alors toute pertinence dans les plans nazis, remplacée par les centres de mise à mort (Auschwitz, Treblinka, etc.). Un chapitre qui montre que la destruction des Juifs n'était pas inévitable mais résulte d'un enchaînement de décisions et d'échecs.
La théorie hitlérienne du "parasitisme juif" considérait les Juifs comme dépendants des États pour survivre. Dès 1939, les nazis ont liquidé l'État polonais : exécutions de fonctionnaires, suppression des lois : les 3 millions de Juifs polonais se sont retrouvés sans protection légale, livrés aux ghettos puis aux camps. Après 1941, l'invasion nazie de l'URSS a suivi le même schéma avec les massacres des cadres soviétiques, l'encouragement aux pogroms locaux (ex. Ukraine). Snyder cite le district de Lviv où 80% des Juifs furent tués en 6 mois, grâce au vide institutionnel. Le Danemark, où l'État resta intact, a pu sauver 99% de ses Juifs (fuite organisée vers la Suède en 1943).
La méthode nazie de destruction systématique des structures étatiques dans les territoires conquis s'est alors imposée comme condition préalable au génocide. Cette logique explique pourquoi la Shoah a été plus meurtrière en Europe de l'Est (Pologne, URSS) où les États furent démantelés et pourquoi les Juifs ont mieux survécu en Europe de l'Ouest (France, Danemark) où des institutions résistaient.
On remarquera au passage, une digression par rapport à l'ouvrage étudié, que les nostalgiques de Vichy, en France, aiment à souligner que 75% des Juifs de France aurait survécu (contre 25% aux Pays-Bas, par exemple) et que Philippe Pétain et son gouvernement auraient "protégé" des Juifs français en freinant les déportations : les faits incontestables montrent que Vichy fut acteur de la persécution : lois antisémites autonomes (sans ordre allemand), collaboration active aux déportations, 44 000 Juifs déportés depuis la France, majoritairement grâce à l'appareil administratif et policier de Vichy. Robert Paxton (La France de Vichy, 1973) a suffisamment montré que Vichy avait devanché les demandes allemandes en matière antisémite...
Le chapitre suivant, "Double Occupation", démontre comment les occupations successives par l'URSS et l'Allemagne nazie (1939-1941) en Europe de l'Est (Pologne orientale, Pays baltes, Ukraine occidentale) ont détruit les structures étatiques et sociales, créant les conditions propices à la Shoah. L'occupation soviétique (1939-1941) "prépare le terrain" après le pacte germano-soviétique (1939), annexe l'Est de la Pologne, les Pays baltes et une partie de la Roumanie, conduisant à des déportations de masse (1,5 million de Polonais, Juifs et autres vers le Goulag) et à l'élimination des élites locales (exécutions, comme le massacre de Katyń en 1940).Et à partir de 1941, l'Allemagne nazie n'a plus qu'à exploiter le chaos. En quelques mois, 1,5 million de Juifs sont assassinés par balles en Europe de l’Est. Synder montre que la Shoah n’était pas seulement un projet idéologique nazi, mais aussi le résultat d’un effondrement politique orchestré par deux régimes totalitaires...
Dans le chapitre "The Greater Evil", l'auteur évoque l'idéologie nazie de la "lutte totale", où Hitler considérait le bolchevisme comme un mal pire que la mort elle-même, justifiant ainsi l'extermination des Juifs comme une nécessité existentielle. Le communisme n'était pas une simple idéologie politique, mais une conspiration juive visant à détruire la civilisation aryenne (dès les années 1920). Et les massacres de masse en URSS (Babyn Yar, Ponary) vont précèder les camps d'extermination (Auschwitz). À l'origine (1940-1941), camp de concentration pour exploiter la main-d'œuvre esclave (notamment polonaise), à partir de 1942, Auschwitz devient un outil majeur de la "Solution finale", avec l'ajout de chambres à gaz et de fours crématoires.
Et en 1944, alors que l'Allemagne a désespérément besoin de travailleurs, les nazis gazent des Juifs hongrois capables de travailler, les nazis industrialisent la mort au nom d'une logique génocidaire qui va accélérer la défaite nazie (The Auschwitz Paradox). La Shoah n'était pas un "projet rationnel", mais un délire idéologique qui a précipité l'effondrement du IIIe Reich. La résistance juive fut un véritable défi à la logique nazie, et certains ont choisi le bien malgré tout, prouvant que la barbarie n'était pas inévitable...
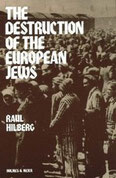
"The Destruction of the European Jews", Raul Hilberg (1961)
"The Destruction of the European Jews" (Raul Hilberg) et "Black Earth" (Timothy Snyder) rejettent tous deux l’idée que la Shoah était seulement le résultat de la folie d’Hitler, le premier décrit la bureaucratie nazie comme moteur de l’extermination (procédures administratives, trains, camps), et le second ajoute la géopolitique de l’effondrement étatique comme facteur clé. En terme de conclusion et d'avertissement pour le présent, Hilberg mettra en garde contre l’obéissance bureaucratique aveugle et Snyder alertera sur les dangers de la déliquescence étatique ...
Historien américain, survivant de l’Holocauste et pionnier des études sur la Shoah, Raul Hilberg livre, après des années de recherche, un ouvrage monumental (1 300 pages dans sa version définitive) qui constitue est la première étude exhaustive du génocide juif par les nazis. Hilberg y analyse la Shoah comme un processus administratif et bureaucratique. Hilberg affine son travail jusqu’en 2003 (3ᵉ édition). Ce n'est pas une histoire des victimes que nous livre l'historien , mais une anatomie des bourreaux, et ce ,'est pas la folie qui explique la Shoah, mais un système ...
On ne peut que revenir constamment sur ce mécanisme de l'horreur, la machine exterminatrice nazie a fonctionné grâce à des procédures administratives banales, appliquées avec une efficacité meurtrière. Hilberg démontre que la destruction des Juifs d’Europe n’a pas été le fruit du hasard ou de la seule folie d’Hitler, mais le résultat d’un mécanisme bureaucratique rationalisé, impliquant des milliers de fonctionnaires allemands et collaborateurs.
Hilberg identifie un processus en trois étapes, graduel et systémique :
- les Définition et exclusion (1933–1939) : les Lois de Nuremberg (1935), exclusion économique, stigmatisation. Et création d’une catégorie administrative : "le Juif".
- la Concentration et expropriation (1939–1941) : les Ghettos en Pologne, le pillage des biens juifs, et le rôle clé des administrations fiscales et des banques.
- l'Extermination (1941–1945), des fusillades massives (Einsatzgruppen) puis des centres de mise à mort (Chelmno, Treblinka, Auschwitz). Et l'iImplication des chemins de fer allemands (Reichsbahn) pour les déportations.
Derrière cet effroyable processus, quatre piliers bureaucratiques, quatre types d’institutions qui ont collaboré, l'Administration civile (Ministères, SS, Gestapo), l'Armée (Wehrmacht complice à l’Est), des Entreprises (IG Farben pour le Zyklon B, Siemens), et des Collaborateurs locaux (polices auxiliaires en Ukraine, Lituanie, etc.)
Hilberg insiste sur le rôle des fonctionnaires ordinaires, obéissant à des ordres sans nécessairement haïr les Juifs. Adolf Eichmann, l'organisateur logistique, nous fut décrit comme un "bureaucrate zélé".
Controversé, Hilberg analyse la réaction juive comme marquée par la soumission, due à une tradition de négociation avec les persécuteurs (diaspora) et l'impossibilité de croire réellement à l’extermination totale. Hannah Arendt (Eichmann à Jérusalem, 1963) soulignera que la résistance était impossible à grande échelle (isolement, terreur nazie, manque d’armes) et distinguera entre "passivité" et "survie stratégique". Yehuda Bauer ("Rethinking the Holocaust", 2001) critiquera le terme "passivité" préférant parler de "stratégies de survie" (cacher des enfants, fuir, falsifier des papiers) ; comme preuves de résistances actives, il citera les révoltes des ghettos (Varsovie, 1943,avril-mai, la première insurrection urbaine en Europe occupée ; Białystok), les partisans juifs dans les forêts (Abba Kovner en Lituanie), les sabotages dans les camps (Sobibor, Treblinka). Dans les éditions révisées (1985, 2003), Hilberg nuancera sa position ...

Browning, Christopher, "Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland" (1992)
Christopher Browning étudie le Police Battalion 101, une unité de réservistes allemands ordinaires, pour comprendre comment des hommes "normaux" ont pu devenir des meurtriers de masse durant la Shoah. Sa conclusion : la majorité n’étaient pas des nazis fanatiques ou atteints de quelque pathologie, mais des citoyens moyens (des réservistes âgés de 30 à 50 ans, issus de la classe ouvrière ou petite-bourgeoise de Hambourg) transformés en bourreaux par la pression du groupe, l’obéissance à l’autorité et la routinisation de la violence.
L'auteur nous montre les étapes de leur transformation en bourreaux : celle-ci débute par une mission, le massacre de Józefów (13 juillet 1942), et l'ordre d'exécuter 1 500 Juifs du ghetto de Józefów (Pologne) en une journée. Le commandant (le major Trapp) offrra la possibilité de se désengager sans sanction : seulement 12 hommes sur 500 refuseront. L'argument (mensonger) eszt celui de la "nécessité militaire" et le mécanisme mis en oeuvre, celui de la conformité.
Après Józefów, les massacres continuent (Łomazy, Serokomla, etc.), mais avec certaines adaptations (moins de contact visuel, exécutions à distance, fosses communes, et division du travail, certains policiers se spécialisant dans la traque, d’autres dans les tirs. Il s participeront aux déportations vers Treblinka. Puis c'est l'escalade de la brutalité, le passage aux "actions de nettoyage", la participation aux "Fêtes des moissons" (massacres liés aux récoltes, comme à Talcyn), la banalisation. Browning entend montrer que n’importe quelle société peut produire des génocidaires dans un contexte institutionnel pervers ...

"Treblinka", Jean-François Steiner, préface de Simone de Beauvoir
"Ne parvenant pas à faire émigrer tous les Juifs dont ils voulaient débarrasser leur empire, les bâtisseurs du "Reich de mille ans" se résolurent à les exterminer. L'invasion de l'URSS en juin 1941 donna au problème ses véritables dimensions. Dans les territoires occupés par la Wehrmacht, en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, dans les Etats Baltes, vivait une population juive de plusieurs millions d'hommes et de femmes. En conséquence, le Reichsführer S.S. Heinrich Himmler donna l'ordre de "traiter" les terres nouvelles conquises par le Troisième Reich dans son expansion vers l'Est. L'opération devait se dérouler en deux phases. Premier temps: regroupement des Juifs dans un certain nombre de ghettos. Deuxième temps: liquidation progressive des ghettos ainsi créés. D'après les "techniciens", les Juifs, race inférieure, devaient se laisser massacrer sans résistance. La perfection du système nazi excluait la moindre possibilité d'une révolte. Ainsi commença le temps du ghetto, première étape de la "solution finale". Le regroupement des Juifs ne posa pratiquement aucun problème. L'antisémitisme des populations autochtones était tel que les Juifs acceptèrent même, souvent, cette opération avec soulagement. Vilna, pour les Lituaniens, c'était leur capitale. Pour les Juifs, c'était la "Jérusalem de Lituanie", la Jérusalem de l'exil. Elle était célèbre pour ses éditions du Talmud de Babylone; on y parlait l'hébreu le plus pur; on y venait de France et d'Amérique étudier avec ses rabbis. Grand centre spirituel, Vilna était renommée dans le monde juif tout entier. Mais cette célébrité avait eu beau traverser les mers, elle ne dépassait pas les limites du quartier juif. Pour les Polonais et les Lituaniens qui habitaient à Vilna, les docteurs barbus portant payess et kaftans n'étaient que des sales Juifs qu'on brûlait, battait et lynchait au hasard des pogroms. A l'exception de quelques rapports personnels, avec les siècles, les pogroms saisonniers étaient devenus le seul contact entre les deux communautés..."
"Pourquoi les Juifs se sont-ils laissé mener à l'abattoir comme des moutons?" se sont demandé avec indignation les jeunes sabras d'Israël au moment du procès Eichman. En Europe aussi, beaucoup de Juifs de la jeune génération, n'ayant pas connu le nazisme, s'interrogent. Le fait est que, dans l'univers concentrationnaire, tous les peuples ont eu le même comportement : une mise en condition, soigneusement élaborée par les S.S. assurait la soumission des condamnés. En 1947, dans "Les Jours de notre mort", Rousset écrivait : "Le triomphe des S.S. exige que la victime torturée se laisse mener à la potence sans protester, qu'elle se renie et s'abandonne au point de cesser d'affirmer son identité... Il n'est rien de plus terrible que ces processions d'êtres humains allant à la mort comme des mannequins." Parmi les prisonniers russes, les communistes inscrits, les commissaires politiques étaient mis à part et voués à une extermination rapide : malgré leur préparation idéologique et militaire, ils mirent leur courage à mourir, mais aucune résistance ne leur fut possible. Ce genre d'explication n'a pas suffi à J.-F.Steiner. Il éprouvait dans le malaise sa condition de Juif. Tous les récits qu'il avait lui présentaient les millions de Juifs morts dans les camps - parmi lesquels se trouvaient son père et une grande partie de sa famille - comme de pitoyables victimes : n'auraient-ils pas dû refuser ce rôle? La gêne avec laquelle certains faits étaient évoqués, l'oubli dont on essayait de les couvrir laissaient supposer que rien ne saurait les excuser : étaient-ils réellement inexcusables? Steiner a décidé de les regarder en face : d'aller jusqu'au bout de la honte ou de s'en guérir. Ce courage lui vaudra, j'en fais le pari, d'être taxé d'antisémitisme par ceux dont le silence, la prudence, les dérobades ont jeté le trouble dans des coeurs. Et pourtant il a eu raison de faire confiance à la vérité, il a gagné : l'histoire de Treblinka, reconstituée à travers des témoignages écrits et des conversations avec des survivants du camp, lui a rendu sa fierté.
A Treblinka était installé un "Sonderkommando", composé à l'origine de Juifs de Varsovie dont une grande partie fut massacrée et remplacée par de nouveaux venus; au nombre d'environ un millier, sous les ordres des Allemands et encadrés par des gardes ukrainiens, ils exécutaient le travail d'extermination et de récupération en vue duquel le camp avait été aménagé. Un grand nombre préfèrent mourir, soit en refusant de tenter leur chance au cours des séances de sélection, soit par le suicide. Mais comment les autres ont-ils pu consentir à payer ce prix pour survivre? La collusion avec les Allemands des notables juifs constituant les Judenraten est un fait connu qui se comprend aisément; en tous temps et tous pays - à de rares exceptions près - les notables collaborent avec les vainqueurs : affaire de classe. Mais à Treblinka - encore que certains Juifs fussent moins maltraités que d'autres - la distinction de classe ne jouait pas; ni entre les hommes du kommando et ceux qui débarquaient sur le quai de la gare pour être conduits de là aux chambres à gaz. Alors? Faut-il évoquer, comme on le fait dans certains livres de classe distribués aux enfants israéliens, une "mentalité de ghetto"? ou bien un atavisme de résignation, le mystère de l'âme juive et autres fadaises? Le livre de Steiner fait justice de cette psychologie à quatre sous en décrivant avec exactitude comment les choses se sont passées.
Dans le monde de la rareté qui est le nôtre, les ensembles d'individus qui vivent dans la dispersion une condition commune - Sartre appelle ces ensembles des "séries" -, ont des conduites où ils se font ennemis les uns des autres et par là ennemis d'eux-mêmes. Dans une panique par exemple, les gens se piétinent, s'étouffent, s'entretuent, amplifiant ou même créant de toutes pièces un désastre qu'une évacuation rationnelle des lieux aurait contenu ou évité. Ainsi dans les spéculations, les embouteillages. Tant que les ouvriers sont demeurés isolés au sein de leur classe, les employeurs ont eu toute facilité pour les exploiter : chacun voyait dans l'autre un concurrent prêt à accepter un salaire de famine pour se faire embaucher et il essayait de vendre sa force de travail à un prix encore plus bas. Pour que des revendications deviennent possibles, il a fallu que se forment des groupes où chaque individu considérait au contraire l'autre comme le même que soi. L'habileté des Allemands a été de "sérialiser" les Juifs et d'empêcher le passage des séries à des groupes. Dans le ghetto de Vilna - et dans tous ce fut la même tactique - les S.S. divisèrent la population en parias et privilégiés : seuls les premiers supportaient les rafles; mais la seconde catégorie était de nouveau divisée jusqu'à la liquidation finale. Il y eut tout de même une ébauche de résistance, mais facilement écrasée. Elle ne débouchait sur aucun espoir; même si elle avait gagné tout le ghetto, des bombardements en auraient eu raison; et cela explique aussi qu'elle n'ait rallié qu'un petit nombre de gens.
Ce furent aussi des conduites sérielles que suscitèrent les "techniciens" quand ils procédèrent aux premières sélections. Tous les hommes qui souhaitent survivre, considérant la masse dont ils faisaient partie, se disaient : "Si je refuse, il y en aura d'autres pour exécuter ce travail à ma place, et je mourrai donc pour rien." Et en effet, l'énorme matériel humain dont disposaient les Allemands ne pouvait être constitué uniquement par des héros. Prévoyant la soumission des autres, chacun se résignait à se soumettre comme eux. Ce piège n'aurait pu être déjoué que si d'avance des consignes de résistance avaient été données et que chacun eût été persuadé de leur observance par tous. Tel n'était pas le cas, pour quantité de raisons, et d'abord parce que la situation était d'une si terrifiante nouveauté que pendant longtemps personne ne voulut croire à sa réalité : mis brutalement en face d'elle, les Juifs étaient plongés dans un désarroi analogue à celui qui crée les paniques et ils n'avaient aucun moyen de coordonner leurs conduites. Il leur arrivait d'essayer, timidement. Les "techniciens" organisaient des épreuves éliminatoires : des courses sur le ventre, ou à quatre pattes. Trois quarts des concurrents auraient la vie sauve : les premiers arrivés; le dernier quart serait abattu. Pendant un moment personne ne bougeait; les coups de fouet pleuvaient; les concurrents savaient que s'ils s'entêtaient ils seraient tous massacrés; quelques-uns se décidaient à prendre lde départ: aussitôt, tous suivaient.
Ce que n'ont pas compris les jeunes sabras d'Israël, c'est que l'héroïsme n'est pas donné d'abord; depuis l'enfance toute leur éducation tend à le leur inculquer sous la forme du courage militaire. Les hommes de Treblinka étaient des civils que rien n'avait préparés à affronter une mort violente, et le plus souvent atroce. Comme pendant les premiers mois les équipes étaient liquidées et remplacées sur un rythme très rapide, ils n'avaient pas le temps d'inventer des formes de résistance. Le miracle est que certain d'entre eux y soient tout de même parvenus et qu'ils aient réussi à rallier tous les prisonniers. Après la descente tragique que, sans rien escamoter, Steiner raconte dans la première partie du livre, il nous faut assister à une extraordinaire remontée.
Le processus en est tout juste l'inverse de celui de l'abdication. S'il suffit de quelques lâches pour que la série entière se conduise lâchement, dès qu'apparaît un groupe, il suffit de quelques héros pour que les gens, reprenant confiance les uns dans les autres, comment à oser. La solidarité se marqua d'abord par l'effort de quelques-uns pour empêcher les suicides. Puis par l'organisation - dans des conditions terriblement dangereuses - d'un réseau d'évasion, destiné moins à sauver des vies qu'à découvrir au monde l'affreuse vérité de Treblinka..." (Préface Simone de Beauvoir, Fayard, 1966)

"... Il se fit prendre bêtement, en glissant une liasse dans sa poche pendant qu'il triait des vêtements. "Lalka" conclut qu'il se préparait à fuir et décida de faire un exemple. Pour la première fois, il tenait un coupable vivant; il voulut en profiter. On dressa une potence au milieu de la cour et Langner, déjà meurtri par les coups de fouets qu'il venait de recevoir, y fut pendu par les pieds. C'était le matin, un convoi s'écoulait lentement vers les chambres à gaz, les ouvriers des kommandos de tri qui avaient cessé le travail reçurent l'ordre de continuer. Seul un garde ukrainien resta près de la potence à faire se balancer Langner à coups de fouet. Au milieu de l'après-midi, lorsque le dernier Juif du dernier convoi, dûment dévêtu et fouillé, s'engagea dans le "chemin du ciel", l'ensemble des prisonniers fut regroupé sur la place de triage et disposé en colonne. Là-bas, au milieu de l'esplanade, Langner se balançait en gémissant, suppliant le garde de l'achever. Après un quart d'heure de maniement de casquettes, et lorsque les rangs furent impeccablement alignés, "Lalka", ménageant toujours ses effets, parut. "Juifs! commença-t-il, désignant Langner. Ce Juif va mourir! Un Juif qui meurt, ce n'est pas rare à Treblinka. Je dirais même qu'en général ils y viennent pour cela. Mais celui-là qui est pendu là-bas ne mourra pas comme les autres. Vous avez pu remarquer le soin que nous prenons de faire mourir nos Juifs le plus proprement possible. Eh bien, nous allons prendre le même soin pour faire mourir celui-là le plus lentement possible."
"Lalka" parlait lentement, laissant de grands silences entre chaque phrase. Et pendant ces silences, les gémissements de Langner parvenaient jusqu'aux prisonniers qui devaient écouter, immobiles au garde-à-vous. "Juifs ! reprit "Lalka". Vous avez peur de mourir, c'est une chose bien connue et qui, personnellement, m'a toujours étonné. J'avoue franchement que je n'ai jamais bien compris cet attachement fanatique à la vie. (Nouveau silence, nouveaux gémissements qui montent et se brisent, entrecoupés de supplications dont les mots parviennent avec une extraordinaire netteté jusqu'aux prisonniers qui ne peuvent que réciter dans leur coeur le Kaddish pour leur frère qui va mourir.) Je ne l'ai jamais compris; d'autant plus qu'il est souvent plus difficile, plus pénible, plus douloureux de vivre que de mourir. Ainsi, lui dit-il en relevant le bras vers Langner, écoutez-le! Que demande-t-il? De mourir. Qu'implore-t-il de son gardien? Qu'il le tue. Il vient enfin de découvrir la sagesse. Il est malheureusement trop tard pour lui. Mais puisse son exemple vous servir de leçon. Vous aurez l'après-midi pour méditer sur les inconvénients de vouloir nous fausser compagnie, car je doute qu'il meure avant ce soir."
Quand "Lalka" eut fini son discours, il fit défiler les prisonniers devant Langner, au pas et en chantant l'hymne de Treblinka, puis il les renvoya au travail. Cet après-midi dura une éternité. Personne ne disait mot. Le silence était tel que les gémissements de Langner s'entendaient de tous les points de l'immense cour. Quand il appelait sa mère, chacun pensait à la sienne. Quand il suppliait qu'on le tue, chacun aurait voulu mourir. L'agonie de Langner, c'était leur agonie à tous, ses plaintes étaient leurs plaintes, sa douleur était la leur. Ils auraient voulu fuir pour ne plus les entendre, se boucher les oreilles, devenir sourds, pourvu qu'ils n'entendent plus, pourvu qu'ils ne voient plus le corps déchiqueté de leur frère qui frémissait encore à chaque coup de fouet. Malgré eux, ils le regardaient à la dérobée, sanguinolent, mutilé, informe. Ils voyaient le sang s'égoutter lentement de ses cheveux, comme d'une bête écorchée, de grands lambeaux de peau qui pendaient, découvrant une chair nue dont le rouge éclatait. Soudain, il poussa un grand cri qui glaça les prisonniers et les gardes et tous pensèrent qu'enfin il allait mourir. Mais aussitôt les prisonniers l'entendirent qui les appelait en yiddish; "Yiddelech! Yiddelech! Juifs, Juifs mes frères! (Un silence et de nouveau la voix qui semblait venir de nulle part). Révoltez-vous! Révoltez-vous! N'écoutez pas leurs promesses, vous serez tous tués. Il ne peuvent pas vous laisser sortir d'ici après ce que vous avez vu. Même s'ils voulaient vous épargner, ils seraient obligés de vous tuer, car le monde ne leur pardonnera jamais ce qu'ils sont en train de faire et ils le savent. Révoltez-vous! Vengez vos pères et vos frères, vengez-vous, sauvez l'honneur d'Israël! Puisque de toute façon vous êtes condamnés, mourrez en combattant! Vive Israël, vive le peuple juif!"
Les gardes et les Allemands, stupéfaits, avaient d'abord écouté sans comprendre, mais lorsque Langner avait dit: "Vive Israël!", ils avaient réalisé que ce devait être un appel à la résistance. "Lalka" s'était précipité arrachant le fusil d'un garde au passage. Quand il arriva sur Langner, il vit que son corps était agité de violents soubresauts. Rendu furieux par ce discours qu'il n'avait pas compris mais dont il soupçonnait le sens, il brandit son fusil par le canon et l'abattit sur la tête de Langner.
La baraque, ce soir-là, bourdonna longtemps de murmures passionnés. Tous sentaient que Langner avait raison et que la seule issue était la révolte. C'était soudain apparu comme une révélation. Effectivement ils étaient condamnés, effectivement ils n'avaient rien à perdre. De toute façon, ils le savaient, ils allaient mourir. Mais comment se révolter? Où trouver ne serait-ce qu'un bâton? Qui pouvait les organiser pour qu'ils se lancent tous en même temps sur leurs bourreaux? Par petits groupes, les prisonniers, qui se méfiaient des mouchards, discutaient des possibilités d'un soulèvement. Personne ne croyait qu'il puisse être victorieux, mais beaucoup étaient prêts à mourir, même s'il n'y avait aucune chance. Depuis l'invasion allemande, ils étaient tombés de renoncements en renoncements jusqu'à un état d'esclavage physique et moral peut-être inédit dans l'histoire des relations entre les hommes. Au cours de cette descente vertigineuse, rien ne semblait devoir les arrêter. C'était comme si un sort leur avait été jeté qui les empêchait de se ressaisir. Une sorte de fatalité les faisait tomber dans tous les pièges que leur tendaient les "techniciens"....."

Primo Levi, "Si questo è un uomo" (Si c'est un homme, If This Is a Man, 1958)
Né à Turin, d'une famille juive peu pratiquante, Primo Levi (1919-1987) s'engage dans la Giustizia e Liberta (organisation antifasciste) en 1943 et se fait arrêter le 13 décembre de la même année, à l'âge de 24 ans, par la milice fasciste : il est interné au camp de Carpi-Fossoli, tout près de la frontière autrichienne, puis en février 1944, le camp passe en mains des nazis et c'est alors la déportation vers Auschwitz. Il sera libéré le 27 janvier 1945, date de la libération du camp par les soviétiques, et son premier livre, "Si c'est un homme", entend témoigner et faire réagir à la réalité de ce que fut la déportation, la déportation vécue, mais l'indifférence et l'oubli sont des réalités redoutables et Primo Levi il se jettera dans la cage d'escalier de son immeuble le 11 avril 1987.. Entre autres ouvrages : "La tregua" (Mémoires, The Truce, 1963), "Il sistema periodico" (Le Système périodique, The Periodic Table, 1975)...
"... C'est dans ces dures conditions, face contre terre, que bien des hommes de notre temps ont vécu, mais chacun d'une vie relativement courte; aussi pourra-t-on se demander si l'on doit prendre en considération un épisode aussi exceptionnel de la condition humaine, et s'il est bon d'en conserver le souvenir.
Eh bien, nous avons l'intime conviction que la réponse est oui. Nous sommes persuadés en effet qu'aucune expérience humaine n'est dénuée de sens ni indigne d'analyse, et que bien au contraire l'univers particulier que nous décrivons ici peut servir à mettre en évidence des valeurs fondamentales, sinon toujours positives. Nous voudrions faire observer à quel point le Lager (le camp) a été, aussi et à bien des égards, une gigantesque expérience biologique et sociale. Enfermez des milliers d'individus entre des barbelés, sans distincion d'âge, de condition sociale, d'origine, de langue, de culture et de moeurs, et soumettez-les à un mode de vie uniforme, contrôlable, identique pour tous et inférieur à tous les besoins : vous aurez là ce qu'il peut y avoir de plus rigoureux comme champ d'expérimentation, pour déterminer ce qu'il y a d'inné et ce qu'il y a d'acquis dans le comportement de l'homme confronté à la lutte pour la vie. Non que nous nous rendions à la conclusion un peu simpliste selon laquelle l'homme serait foncièrement brutal, égoïste et obtus dès lors que son comportement est affranchi des superstructures du monde civilisé, en vertu de quoi le Häftling ("Häftling : j’ai appris que je suis un Häftling . Mon nom est 174 517") ne serait que l'homme sans inhibitions. Nous pensons plutôt qu'on ne peut rien conclure à ce sujet, sinon que sous la pression harcelante des besoins et des souffrances physiques, bien des habitudes et bien des instincts sociaux disparaissent.
Un fait, en revanche nous paraît digne d'attention : il existe chez les hommes deux catégories particulièrement bien distinctes, que j'appelerai métaphoriquement les élus et les damnés. Les autres couples de contraires (comme par exemple les bons et les méchants, les sages et les fous, les courageux et les lâches, les chanceux et les malchanceux) sont beaucoup moins nets, plus artificiels semble-t-il, et surtout ils se prêtent à toute une série de gradations intermédiaires plus complexes et plus nombreuses.
Cette distinction est beaucoup moins évidente dans la vie courante, où il est rare qu'un homme se perde, car en général l'homme n'est pas seul et son destin, avec ses hauts et ses bas, reste lié à celui des êtres qui l'entourent. Aussi est-il exceptionnel qu'un individu grandisse indéfiniment en puissance ou qu'il s'enfonce inexorablement de défaite en défaite, jusqu'à la ruine totale. D'autre part, chacun possède habituellement de telles ressources spirituelles, physiques, et même pécuniaires, que les probabilités d'un naufrage, d'une incapacité de faire face à la vie, s'en trouvent encore diminuées. Il s'y ajoute aussi l'action modératrice exercée par la loi, et par le sens moral qui opère comme une loi intérieure; on s'accorde en effet à reconnaître qu'un pays est d'autant plus évolués que les lois qui empêchent le misérable d'être trop misérable et le puissant trop puissant y sont plus sages et plus efficaces.
Mais au Lager il en va tout autrement : ici, la lutte pour la vie est implacable car chacun est désespérément et férocement seul... On a parfois l'impression qu'il émane de l'histoire et de la vie une loi féroce que l'on pourrait énoncer ainsi: "Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n'a rien." Au Lager, où l'homme est seul et où la lutte pour la vie se réduit à son mécanisme primordial, la loi inique est ouvertement en vigueur et unanimement reconnue..."
