- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- Welty
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Heller - Toole
- Naipaul
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Gaddis
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Rawls
- Zinoviev
- Satir
- Kôno
- Beattie - Phillips
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
Political Notes - NeoLiberalism
Friedrich Hayek (1899-1992), "The Road to Serfdom" (1944) - Milton Friedman (1912-2006), "Capitalism and Freedom" (1962) - Ludwig von Mises (1881-1973),
"Human Action: A Treatise on Economics" (1949) - Gary Becker (1930-2014), "Human Capital" (1964) - Thomas Biebricher, "The Political Theory of Neoliberalism" (2019) - Noam Chomsky, "Profit Over
People: Neoliberalism and Global Order" (1999) - David Harvey, "A Brief History of Neoliberalism" (2005) - Wendy Brown, "Undoing the Demos: Neoliberalism’s Revolution" (2015) - David Harvey, "A
Brief History of Neoliberalism" (2005) - George Monbiot & Peter Hutchison, "Invisible Doctrine: The Secret History of Neoliberalism" (2024) - Naomi Klein, "The Shock Doctrine" (2007) -
Quinn Slobodian, "Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism" (2018) - Alan McGuire, "From Behind the Curtain: Neoliberalism and Ideology" (2024) - ...
Last update: 11/11/2023

S'il est une leçon que nous livre les différents auteurs que nous allons parcourir, c'est que le "néolibéralisme", une théorie politique invisible qui gouverne ce monde, n'est pas ce laissez-faire que l'on veut bien nous faire croire, par simplification médiatique, mais une reconstruction de la société via le pouvoir de l'État. C'est lui qui remplace les citoyens par des consommateurs et la politique par de la technocratie, et ouvre les allées du pouvoir à des élites économiques qui n'en demandaient pas tant ..
Le néolibéralisme est la doctrine économique et politique qui structure l’économie mondiale depuis les années 1980 : pourtant, dans les pays démocratiques, il est très rare que des candidats ou des partis se présentent explicitement sous l'étiquette de "néo-libéral". En revanche, de nombreux mouvements (libéraux, conservateurs, centristes pro-européens) en reprennent les idées sous d’autres appellations ...
À l'origine, le néolibéralisme désigne un courant économique qui promeut la libre concurrence, la dérégulation, les privatisations et la réduction du rôle de l'État. Dans les années 1930-1940, le terme "néolibéralisme" a été utilisé de manière positive par des intellectuels comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman pour désigner une refonte du libéralisme classique. Depuis les partis évitent les étiquettes trop clivantes (beaucoup de démocraties sont prises dans une triple dynamique néolibéralisme - populisme - technocratie via des partis et des candidats qui se gardent bien de se présenter sous de telles étiquettes) et même les formations libérales préfèrent mettre en avant des valeurs comme "la liberté", "l'innovation" ou "l'emploi" plutôt qu'une doctrine économique précise : et notamment celle d'une doctrine qui, à travers la financiarisation et la globalisation des échanges, privatise, dérégule, mondialise et réprime; et qui semble avoir pour résultats des riches qui s’enrichissent, des inégalités qui explosent, une démocratie qui recule, une planète qui brûle pour le profit...
Et pourtant, si elle est de plus en plus contestée, notamment après la crise de 2008, la montée des inégalités et les défis climatiques, cette doctrine reste hégémonique. Les partis de droite ou centristes mélangent souvent libéralisme économique avec des positions conservatrices (sur les mœurs, l'immigration) ou nationalistes, ce qui semble l'éloigner du pur néolibéralisme et induire encore plus en erreur les citoyens-électeurs que nous sommes censés être ...
On ne doit pas oublier que ce NEOLIBERALISME-ci n'est pas un simple modèle économique "naturel", mais un système politique construit et maintenu par des institutions, des rapports de force et des idéologies; et que les dernières crises économiques n’ont guère mis fin à l’ère néolibérale : bien au contraire, nous assistons à un libéralisme autoritaire dont le règne ne fait que commencer...
1. Un État fort…
Contrairement au mythe du "moins d'État", le néolibéralisme a besoin d'un Etat fort au service du marché, un État garant de la propriété privée (police, justice pour protéger les contrats), générateur de subventions aux entreprises (ex: aides publiques aux banques en 2008), de lois anti-syndicales (pour casser les grèves, comme les lois Thatcher au Royaume-Uni). On l'a dit, le paradoxe, le néolibéralisme qui déteste l’État social, adore l’État gendarme.
2. La financiarisation de l’économie
Soit des banques centrales indépendantes (BCE, Fed) qui priorisent la stabilité financière sur l’emploi, des marchés financiers dérégulés (spéculation sur les dettes, les matières premières, l’immobilier), une monnaie dominante (le dollar comme outil de pression géopolitique).
3. Des institutions internationales coercitives
FMI et Banque mondiale imposent des plans d’austérité en échange de prêts. OMC et traités de libre-échange (ALENA, TAFTA) interdisent les protections sociales ou écologiques si elles "freinent le commerce". Des tribunaux d’arbitrage privés (ISDS) permettent aux multinationales de poursuivre les États. ainsi l'Équateur fut condamné à payer 2,8 milliards à Chevron pour avoir voulu taxer les profits pétroliers.
4. Une idéologie dominante (la "pensée unique")
Des Médias concentrés (Murdoch, Bolloré, Bezos) qui relaient le discours pro-marché, des Ecoles économiques hégémoniques (théorie du ruissellement, "main invisible"). Un véritables culte de l’expertise technocratique ("Les marchés ont toujours raison"). Pour certains dirigeants, sans compétence ou imagination politique, le néolibéralisme se présente comme une loi naturelle, "Il n’y a pas d’alternative", ce n'est même pas un choix politique qui puisse être discuté.
5. La précarité comme outil de contrôle
Réduire le chômage tout en préservant un chômage structurel : une armée de réserve de travailleurs pauvres fait pression sur les salaires. L'accroissement de la dette des ménages (étudiants, crédits immobiliers) emporte une certaine docilité. La flexibilité du travail (Uberisation) permet de détruit les solidarités de classe. On accepte des jobs mal payés par peur de tomber plus bas, ou l'on agitera l'obligation morale de les accepter pour bénéficier d'une reconnaissance dite sociale.
6. L’exploitation des périphéries globales
Délocalisations et profit maximum garanti via les bas salaires (Bangladesh, ateliers chinois). Accaparement des ressources (pétrole africain, terres sud-américaines). Monnaies faibles : le néolibéralisme a besoin de pays stables mais sous-développés (Mexique, Maroc). Apple ne profite-t-il pas du travail quasi-esclavagiste chez Foxconn.
7. . La destruction des alternatives
Répressions des mouvements sociaux (grèves, indigènes, écologistes). Criminalisation du communisme/socialisme (propagande anti-Cuba, anti-Venezuela). Récupération des contre-cultures (le "woke" commercialisé par Netflix). Il faut liquider l’imaginaire anticapitaliste.
8. Le néolibéralisme a besoin des classes moyennes pour survivre…
Les classes moyennes ne sont pas naturellement néolibérales, mais elles sont souvent abusées par le système en place. Elles en bénéficient parfois partiellement, mais subissent aussi ses effets négatifs, souvent sans en avoir une conscience claire. Leur adhésion (ou résignation) dépend de plusieurs facteurs : économie, culture, contexte géopolitique et illusions entretenues par le discours dominant.

À court terme, les classes moyennes votent souvent pour des politiques qui les appauvrissent : la fameuse séduction par le discours méritocratique ...
- L’illusion de l’ascension sociale par le marché
Le néolibéralisme vend le rêve de l’individu entrepreneur ("self-made man", start-up, investisseur immobilier). Les classes moyennes supérieures (cadres, professions libérales) croient pouvoir profiter de la financiarisation (actions, crédits, Airbnb). L’explosion des plateformes d’investissement (Robinhood, PEA en France) pousse à la "démocratisation" de la spéculation.
- Le consumérisme comme marqueur social
La consommation (voitures, technologies, voyages) devient un substitut au progrès social. Le crédit facile masque la stagnation des salaires. L’endettement des ménages pour maintenir un niveau de vie (États-Unis, Royaume-Uni).
- La peur du déclassement
Les classes moyennes craignent plus les pauvres que les riches (l'extraordinaire discours sécuritaire et le vote pour la baisse des impôts).
- L’influence médiatique et culturelle
Les médias dominants (détenus par des milliardaires) promeuvent le mérite individuel et la flexibilité. La "success culture" (podcasts entrepreneuriaux, influenceurs finance) normalise la précarité ("side hustles", auto-entrepreneuriat).
A moyen terme, les classes moyennes subissent une précarisation rampante, le coût de la vie et un appauvrissement relatif, une certaine désillusion chez les jeunes générations (les millennials et la Gen Z sont les premières générations plus pauvres que leurs parents) et remettent en cause le mythe de la méritocratie (phénomène "quiet quitting", anticapitalisme sur TikTok).
Pourquoi soutenir un système qui vous détruit?
- "Just-world fallacy" ("Si je réussis, c’est grâce à mon mérite ; si j’échoue, c’est ma faute").
- Optimisme illusoire ("Un jour, je serai riche").
- Manque de conscience de classe : les classes moyennes ne se perçoivent pas comme exploitées (contrairement aux ouvriers).
- Divisions politiques : les partis néolibéraux (Macron) captent leur vote en jouant sur la peur des extrêmes (gauche radicale ou droite populiste). Et encore et toujours cette profonde absence d'une alternative crédible et des raisons suffisantes pour une mobilisation conséquente ..
- Les réseaux sociaux peuvent briser le narratif dominant (débats sur les inégalités, #AntiWork), mais le poids de l'inertie et de l'indifférence est colossal, et le manque de culture politique semble effectivement plus marqué au XXIe siècle dans de nombreuses démocraties.
Les citoyens sont moins exposés à une information politique approfondie (déclin de la presse traditionnelle, montée des infotainment, superficialité des thématiques), moins de culture générale politique, mais plus de militantisme ciblé (causes LGBT+, écologie radicale, complotisme). La politique devient une opinion personnelle plutôt qu’un engagement construit...
Les auteurs,
Le néolibéralisme se distingue du libéralisme classique (Adam Smith) par son insistance sur la nécessité d'un cadre institutionnel fort pour garantir le libre marché, plutôt que sur un laissez-faire pur. Il s'est imposé à partir des années 1970-1980 avec les politiques de Margaret Thatcher (Royaume-Uni) et Ronald Reagan (États-Unis), ainsi que les réformes des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, OMC)....

Friedrich Hayek (1899-1992), "The Road to Serfdom" (La Route de la servitude, 1944) est au fondement intellectuel du néolibéralisme.
Il fut écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, Hayek y avertit que l’interventionnisme étatique mène inévitablement au totalitarisme, comme en URSS ou dans l’Allemagne nazie. Toute tentative de planification centrale (socialisme, État-providence étendu) réduit les libertés individuelles. Les prix sont des signaux qui guident l’économie mieux qu’un planificateur central. La concurrence permet l’adaptation spontanée des acteurs économiques. Les socialistes modérés croient pouvoir contrôler démocratiquement l’économie, mais cela exige tôt ou tard une centralisation du pouvoir. Hayek cite l’exemple de l’Allemagne de Weimar, où les sociaux-démocrates ont involontairement pavé la voie au nazisme en étendant l’État. La vraie liberté vient de l’absence de coercition étatique, pas de "droits sociaux". Les politiques redistributives (impôts progressifs, services publics universels) limitent les choix individuels. Défense d’un État minimal et d’un État de droit strict, rejet de toutes politiques sociales, car elles déforment le marché. Pour Hayek, le socialisme mène au despotisme ; pour Marx, le capitalisme y mène aussi. Et Hayek croit que l’État est toujours un danger ; Keynes pense qu’il peut corriger le marché...

Milton Friedman (1912-2006), "Capitalism and Freedom" (Capitalisme et liberté, 1962), la Bible des libertariens et de Reagan/Thatcher et l'ouvrage qui justifie les privatisations, la dérégulation et la mondialisation.
Le marché libre est la condition de la liberté politique et l’État doit être minimal. Sa thèse centrale est que le capitalisme de marché libre est le seul système compatible avec la démocratie, car il limite le pouvoir de l’État et protège les choix individuels. Toute planification étatique mène au totalitarisme (il cite Hayek et "La Route de la servitude"). e rôle de l’État doit être minimal, les seules fonctions légitimes de l’État sont la Défense nationale, la Protection des droits individuels (police, justice), la Régulation des "externalités négatives" (ex. : pollution) : tout le reste (éducation, santé, retraites) devrait être privatisé. La Critique de l’État-providence est radicale : les programmes sociaux (aide aux pauvres, sécurité sociale) créent de la dépendance et sont inefficaces, il faut remplacer l’aide publique par une "impôt négatif" (revenu universel minimal), moins bureaucratique. L’école publique est un monopole inefficace. Les syndicats faussent le marché du travail et créent du chômage. Le salaire minimum augmente le chômage des jeunes et des moins qualifiés. Enfin, libre-échange et dérégulation : il faut abolir les barrières douanières, le protectionnisme appauvrit tout le monde...
Friedman croit au marché autorégulé, Keynes à l’intervention de l’État. Pour Friedman, les inégalités sont naturelles ; pour Piketty, elles sont dangereuses...

Ludwig von Mises (1881-1973), "Human Action: A Treatise on Economics" (1949) est l’œuvre majeure de von Mises et l’un des textes fondateurs de l’école autrichienne d’économie. Il a inspiré Milton Friedman, Hayek, et les libertariens (comme Murray Rothbard) et défend une vision radicale du libéralisme classique et une critique féroce de l’interventionnisme étatique. En effet, dit-il, l’économie ne repose pas sur des modèles mathématiques abstraits, mais sur l’étude des choix individuels (la "praxéologie"). Tout être humain agit en fonction de ses préférences subjectives et de la recherche de son intérêt.
Le marché est alors vu comme processus spontané, un ordre émergent, non planifié, qui résulte des interactions libres des individus. Les prix sont des signaux informationnels essentiels, qui guident l’allocation des ressources. L’État ne peut pas améliorer ce marché. Sans propriété privée et prix de marché, aucune rationalité économique n’est possible (thèse développée dès 1920 dans "Le Calcul économique en régime socialiste")...

Gary Becker (1930-2014), "Human Capital" (1964)
Gary Becker (prix Nobel d'économie 1992) est une figure majeure de l'école de Chicago et un pionnier de l'application des outils économiques à des domaines traditionnellement non économiques (sociologie, démographie, criminologie). "Human Capital" (Le Capital humain) est un ouvrage fondateur qui a révolutionné l'étude de l'éducation, de la formation et des inégalités. Vu sous un certain angle, non polémique, le "capital humain" est ici considéré comme un investissement comme un autre : il désigne l'ensemble des compétences, connaissances et santé d'un individu, qui augmentent sa productivité et ses revenus. Ce qui implique que l'éducation n'est plus une simple consommation, mais un investissement rationnel, comparable à l'achat d’une machine pour une entreprise.
Cet ouvrage est plus qu'on ne pense un pilier intellectuel du néolibéralisme : il incarne en effet, et sans que cela ne semble d'évidence, l'extension de la logique marchande à des domaines traditionnellement non économiques, en l'occurrence l'extension du marché à la vie humaine. Le Néolibéralisme a bien pour projet de transformer toute activité humaine (éducation, santé, famille) en un calcul coût-bénéfice, géré par des logiques de marché. Et les inégalités sont ainsi justifiées par des choix rationnels (moins d'études, salaires moindres) et les différences de salaire s’expliquent en partie par les écarts d’investissement en capital humain : jeunesse (investissemt massif), âge mûr (récupèrent leurs gains et pic de revenus), vieillesse (décroissance, obsolescence des compétences). Justifiant tout par des calculs coûts-bénéfices, sa grille fut reprise par les institutions (Banque mondiale) pour évaluer l’efficacité des systèmes éducatifs. L’approche de Becker a été utilisée pour justifier la privatisation de l’éducation...

"The Triumph of Broken Promises: The End of the Cold War and the Rise of Neoliberalism", by Fritz Bartel (2022). -
Fritz Bartel propose une relecture originale des années 1970–1990, en liant la fin de la Guerre froide à l'ascension du néolibéralisme. Bartel, historien spécialiste des relations internationales, remet en cause les récits traditionnels pour montrer comment les crises économiques et géopolitiques ont accéléré l'adoption de réformes néolibérales, malgré les promesses antérieures de compromis sociaux.
La faillite des promesses keynésiennes : Bartel démontre que le néolibéralisme s'est imposé non par idéologie pure, mais par l'échec des modèles économiques antérieurs à répondre aux chocs des années 1970. L'impuissance des dirigeants : que ce soit à l'Ouest (Carter, Mitterrand) ou à l'Est (Gorbatchev), les leaders sont contraints d'abandonner leurs promesses sociales face aux réalités économiques...
Contrairement à l'idée d'une "victoire du libéralisme", Bartel montre que la fin de la Guerre froide est un effondrement mutuel des systèmes :
- À l'Est : L'URSS s'effondre car elle ne peut plus subventionner son empire face à la crise économique (guerre en Afghanistan, chute des prix du pétrole).
- À l'Ouest : Les États-Unis et l'Europe renoncent à leurs engagements sociaux pour maintenir leur compétitivité face à la globalisation.
- Rôle des institutions : Le FMI et la Banque mondiale imposent des ajustements structurels (privatisations, austérité) aux pays endettés, y compris aux ex-communistes.
Contre la thèse du "marché triomphant" (Fukuyama), Bartel souligne que le néolibéralisme émerge dans la panique. Et contre l'idée d'un complot néolibéral (Harvey), il insiste sur le rôle des contraintes matérielles (dette, inflation) plus que des seuls think tanks...
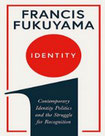
Francis Fukuyama, dans "La Fin de l’histoire et le dernier homme" (1992), défendait l'idée le libéralisme économique et politique est l’aboutissement de l’Histoire : une défense controversée de la mondialisation libérale, une position qu'il a depuis nuancée.
La chute de l’URSS marquait selon lui la victoire idéologique du libéralisme (démocratie & économie de marché). La mondialisation libérale est inévitable et constitue l’horizon indépassable des sociétés. Les conflits futurs ne seront plus idéologiques, mais culturels (d’où son concept de "choc des civilisations", repris et détourné par Huntington). mais les crises financières (1997, 2008), le terrorisme, l’essor des autocraties (Chine, Russie) ont remis en cause cette vision. Il a d'autre part sous-estimer la résistance des modèles non libéraux (islamisme, capitalisme d’État chinois).
Depuis les années 2000, Fukuyama nous le verrons reconnaître des limites de la mondialisation : dans "Political Order and Political Decay" (2014), il admet que le libéralisme peut générer des inégalités destructrices et une crise de la démocratie. Il critique le néolibéralisme extrême (dérégulation, austérité) qu’il juge responsable du populisme (Trump, Brexit). Et plaide pour un libéralisme modéré, avec un État capable de réguler le marché et de maintenir la cohésion sociale (inspiré par le modèle scandinave). mais son héritage "fin de l’Histoire" est encore invoqué pour justifier la mondialisation, malgré ses nuances ultérieures. Le libéralisme doit se réformer pour survivre, dit-il ...
Dans "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment" (2018), Francis Fukuyama explorera la montée des politiques identitaires et leur impact sur les démocraties libérales. Loin de sa thèse optimiste de "La Fin de l'Histoire", il analyse ici les fractures qui menacent la stabilité des sociétés occidentales. Fukuyama s’inspire de Hegel pour montrer que les humains recherchent avant tout la dignité et la reconnaissance de leur identité. Le libéralisme promettait une société où les individus seraient égaux abstraitement (droits formels), mais a sous-estimé le besoin d’appartenance concrète (ethnicité, religion, genre). En niant les identités collectives, il a provoqué une réaction violente (populismes nationalistes, extrêmes droites). Il attaque tout autant les politiques identitaires "progressistes" qui, en fragmentant la société en micro-identités (race, genre, orientation), elle affaiblit les luttes universelles (comme la justice sociale). Il en appelle dès lors à un nouveau contrat social qui concilie universalisme et respect des différences ...

"The Political Theory of Neoliberalism (Currencies: New Thinking for Financial Times), 2019, de Thomas Biebricher, se présente comme une analyse philosophique et politique rigoureuse du néolibéralisme, non pas simplement comme un système économique, mais comme un projet politique cohérent aux racines intellectuelles profondes.
Thomas Biebricher est chercheur associé à l'Institut für Sozialforschung (Institut de recherche sociale, héritier de l'École de Francfort) : dans "The Political Theory of Neoliberalism" (2019), il a montré comment l' "ordolibéralisme" (école de Fribourg) a structuré l'UE via la primauté donnée aux règles juridiques sur les décisions démocratiques et une austérité érigée en vertu morale. A noter ses "Contributions" à "The Oxford Handbook of Neoliberalism" (2018).
Publié dans la série Currencies (Stanford University Press), qui se concentre sur les interventions critiques en économie politique, "The Political Theory of Neoliberalism" se distingue par sa déconstruction systématique des fondements théoriques du néolibéralisme et de ses implications pour la démocratie.

Le néolibéralisme est bien une théorie politique ..
Biebricher remet en question la réduction courante du néolibéralisme à "marchés libres + austérité", arguant qu'il s'agit d'un ordre politique normatif qui redéfinit :
- L'objectif central du néolibéralisme n'est pas l'abolition complète du rôle de l'État, mais sa reconfiguration politique, visant à instaurer une gouvernance capable d'assurer les conditions optimales pour le marché.
- Le néolibéralisme porte une vision normative claire sur la forme de gouvernement, notamment en cherchant à discipliner démocratiquement les choix politiques afin de les aligner sur une rationalité économique précise.
- Le rôle de l'État est traité non pas un "gardien nocturne" passif, mais comme un architecte actif de la société de marché (par ex., la création de sujets compétitifs via les réformes éducatives).
- La liberté est redéfinie comme auto-optimisation entrepreneuriale (par ex., les chauffeurs Uber comme "agents libres", masquant la précarité).
- La démocratie se voit subordonnée à la logique de marché (par ex., l'indépendance des banques centrales retirant la politique monétaire du débat public).

Généalogie intellectuelle - L'ouvrage s'articule autour de l'étude des perspectives de six figures majeures du néolibéralisme ...
Walter Eucken (1891–1950), le Fondateur de l'ordolibéralisme (École de Fribourg), Wilhelm Röpke (1899–1966), Alexander Rüstow (1885–1963), l'inventeur du terme "néolibéralisme" (Colloque Lippmann, 1938), Friedrich Hayek (1899–1992), Milton Friedman (1912–2006), l'apôtre du monétarisme et de la dérégulation, et James Buchanan (1919–2013), le fondateur de la théorie des choix publics (Public Choice), prix Nobel d'économie en 1986.
En analysant leurs conceptions respectives de l'État, de la démocratie, de la science et de la politique, Biebricher met en lumière les hétérogénéités au sein de la pensée néolibérale. Il distingue notamment les approches ordolibérales allemandes, qui insistent sur un cadre institutionnel fort pour encadrer le marché, des approches anglo-saxonnes plus axées sur la limitation de l'intervention étatique.
De là les grandes lignes théoriques du néolibéralisme :
- L'ordolibéralisme (École allemande) : Prône un "État fort" pour imposer la concurrence (par ex., les lois antitrust de l'UE).
- L'École de Chicago (Friedman, Becker) : Étend la logique de marché à toute la vie (par ex., la théorie du capital humain).
- L'École autrichienne (Hayek) : L'ordre spontané comme supérieur à la planification démocratique.
En explorant les théories politiques d'auteurs tels que Hayek, Friedman ou Buchanan, Biebricher révèle les profondes réflexions du néolibéralisme sur des questions fondamentalement politiques telles que :
- La place de la démocratie dans une économie libérale.
- Le cadre constitutionnel nécessaire pour protéger l'ordre économique.
- L'articulation du pouvoir étatique avec les impératifs économiques du marché

Le néolibéralisme limite donc intentionnellement le champ d’action démocratique, créant une situation où les entreprises deviennent de facto incontrôlables politiquement, non par accident, mais par construction. Cette gouvernementalité néolibérale s'étend à l'ensemble de la société et au-delà, et peut être appréhendée par ces différentes composantes ...
1. Redéfinition de l’État et limitation du politique
Biebricher souligne que le néolibéralisme ne cherche pas à abolir l’État mais à le réorganiser radicalement afin qu'il favorise systématiquement le marché. Ainsi, le rôle politique de l’État est volontairement restreint, et ses mécanismes de régulation démocratique sont affaiblis, laissant une liberté accrue aux entreprises.
2. Institutionnalisation des contraintes économiques
Le néolibéralisme impose aux démocraties des contraintes économiques strictes (« constitutionnalisme économique » selon Buchanan, notamment), réduisant la capacité des gouvernements élus à réguler les grandes entreprises. Cela conduit à une politique où la démocratie est bridée par des règles et des traités (par exemple ceux de l'Union Européenne ou des accords internationaux), laissant peu de marge aux citoyens pour influencer les politiques économiques.
3. Privatisation de la décision politique
Pour Biebricher, le néolibéralisme transfère progressivement la prise de décision vers des sphères technocratiques ou privées, réduisant les espaces démocratiques où les citoyens pourraient contester le pouvoir des entreprises. Ce processus affaiblit la légitimité démocratique tout en renforçant indirectement l'autorité économique des entreprises.
4. Dépolitisation systématique
Le néolibéralisme réussit aussi en dépolitisant systématiquement les enjeux économiques majeurs, les présentant comme techniques ou naturels plutôt que comme relevant du débat politique. Cette dépolitisation empêche les citoyens de remettre en question les pratiques des grandes entreprises ou les politiques qui les soutiennent, conduisant ainsi à l’échec démocratique.
5. Émergence d’un libéralisme autoritaire
Biebricher introduit la notion de « libéralisme autoritaire », décrivant comment le néolibéralisme, loin d’être fragilisé par les crises économiques récentes, évolue vers des formes autoritaires qui limitent davantage l’action démocratique. Dans ce contexte, le pouvoir politique s’oriente vers la défense du marché, parfois même contre les citoyens eux-mêmes, aggravant l’incapacité des démocraties à contenir les pouvoirs économiques privés.

6. Et enfin, plus impactant encore, Thomas Biebricher, s'inspirant largement des analyses foucaldiennes, insiste sur la façon dont le néolibéralisme ne se limite pas à une transformation politique et institutionnelle, mais produit également un type particulier de sujet politique.
Pour Michel Foucault, le néolibéralisme était avant tout une manière de gouverner les conduites individuelles, bien plus subtile que la simple coercition par l’État. Et le néolibéralisme, selon Biebricher, produit des individus qui s'autogouvernent selon des logiques économiques intériorisées, devenant ainsi des « entrepreneurs d’eux-mêmes ».
- L’individu comme entrepreneur de soi :
Dans la logique néolibérale analysée par Biebricher, les individus sont constamment poussés à se percevoir comme des acteurs rationnels en compétition permanente, cherchant à maximiser leur capital humain, leurs performances, leur employabilité et leur compétitivité. Cette vision transforme les citoyens en sujets économiques, préoccupés par leur propre rentabilité et responsabilité individuelle, affaiblissant ainsi la conscience collective et la solidarité sociale.
- Conséquences politiques de cette subjectivation :
Cette subjectivation néolibérale explique en partie pourquoi les démocraties échouent à contrôler le pouvoir des entreprises : les sujets politiques ainsi produits ne se voient plus comme membres actifs d'une communauté démocratique, mais comme des consommateurs ou investisseurs qui acceptent implicitement les règles du jeu définies par les entreprises. Les citoyens, intériorisant la logique de concurrence et d’efficacité marchande, deviennent moins enclins à remettre en cause l’ordre établi ou à exiger une régulation politique des grandes entreprises.
- Dépolitisation et discipline intériorisée :
Biebricher souligne comment la subjectivation néolibérale mène aussi à une forme profonde de dépolitisation. Les individus voient les problèmes économiques comme des questions personnelles (manque de compétences, mauvaises décisions individuelles) plutôt que comme des enjeux structurels ou politiques, rendant toute mobilisation politique collective plus difficile.
Inspiré par Foucault, Biebricher explique ainsi que le néolibéralisme n'est pas seulement un modèle économique ou un projet politique classique, mais aussi une stratégie de pouvoir particulièrement efficace parce qu'elle ne s’impose pas seulement par les institutions, mais par la production même de subjectivités adaptées à ses objectifs.

Dans la dernière partie du livre, Biebricher appliquera son analyse théorique aux réformes néolibérales de l'Union européenne, qu'il considère comme un laboratoire avancé du projet néolibéral.
Biebricher soutient que l'UE incarne la vision ordolibérale (école allemande) du néolibéralisme ne serait-ce qu'à travers certaines caractéristiques de sa pratique,
- Primauté de la concurrence : Les traités (ex. : Traité de Lisbonne) élèvent la "libre concurrence" au rang de principe constitutionnel, limitant les politiques économiques alternatives.
- Dépolitisation institutionnelle : La BCE, la Commission et la CJUE agissent comme des gardiennes technocratiques des règles de marché, isolées des pressions démocratiques (ex. : l'austérité imposée à la Grèce en 2015 malgré le rejet par référendum).
La gouvernance économique européenne se révèle un véritable dispositif biopolitique ...
- Pacte de stabilité et gouvernance par les nombres : Les critères de Maastricht (déficit < 3 %, dette < 60 % du PIB) transforment les États en "entreprises" évaluées sur leur performance financière.
- Réformes structurelles : Les plans de sauvetage (FESF, MES) imposent des privatisations et une flexibilisation du travail, naturalisées comme "nécessités techniques".
... dans lequel la démocratie est mise à mal ..
Biebricher identifie un déficit démocratique structurel :
- un Parlement européen impuissant : les grandes orientations économiques échappent à son contrôle (décidées par l'Eurogroupe non élu).
- une véritable constitutionnalisation de l'austérité : Les règles budgétaires (TSCG) verrouillent les choix politiques, même en cas de changement de majorité.
- et la fameuse exception allemande : L'ordolibéralisme allemand domine l'UE, imposant sa phobie de l'inflation et son fétichisme de la discipline budgétaire.
Les crises répétées fonctionnent comme des révélateurs : La crise de l'euro (2010) et le Covid (2020) ont exposé les tensions entre solidarité et logique de marché, poussant à des ajustements (ex. : plan de relance européen) sans remise en cause du cadre néolibéral. La montée des populismes est désormais un risque endémique. Le Brexit ou les succès de l'extrême droite en Europe sont en partie des réactions à cette "démocratie sans choix".
Peut-on réformer l'UE ? Biebricher est pessimiste car les alternatives sont marginalisées (les propositions de taxation des riches, de mutualisation des dettes ou de green new deal européen butent sur les veto des traités) et l'on constate une fuite en avant technocratique (que l'on pense à la réponse aux crises (ex. : union bancaire) renforçant les mécanismes néolibéraux plutôt que de les dépasser).
L'UE est moins une union de peuples qu'une union de marchés - une machine à produire de la dépolitisation sous couvert d'intégration, c'est ce que l'on serait tenter de conclure. Contrairement à Jürgen Habermas qui pense (espère) que l'UE pourrait évoluer vers une "démocratie transnationale", Biebricher rejoint la thèse de Wolfgang Streeck sur l'UE comme "État consolidant le capitalisme post-démocratique"...

Quinn Slobodian, "Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism" (2018)
Une belle histoire intellectuelle, convaincante, du capitalisme contemporain. Slobodian propose une relecture originale de l’histoire du néolibéralisme, en montrant qu’il ne s’agit pas simplement d’une doctrine de "marché libre", mais d’un projet politique visant à encadrer la mondialisation pour protéger le capitalisme des excès de la démocratie et des États-nations.
L'auteur a véritablement changé la façon dont on perçoit le néolibéralisme, non pas comme un "retrait de l’État", mais comme un réagencement du pouvoir.
Son lien avec le néoconservatisme est de même affirmé : il montre comment le néolibéralisme a souvent établi une convergence ente libre-échange et autoritarisme (Chine aujourd’hui).
Historien et universitaire canadien, Quinn Slobodian, professeur d’histoire internationale à l’Université Wellesley (Massachusetts, États-Unis),proche des approches critiques de l’économie politique (David Harvey, Wendy Brown), fut inspiré par Michel Foucault (Naissance de la biopolitique) et Karl Polanyi (La Grande Transformation).
Le néolibéralisme n’est pas un "laisser-faire", mais un système de règles globales ..
Contrairement à l’idée reçue, les néolibéraux (Hayek, Friedman, etc.) ne croyaient pas en un marché totalement dérégulé, mais en un ordre juridique international protégeant le capital des interférences politiques (taxes, nationalisations, etc.). Leur objectif était d' "Immuniser" l’économie contre la démocratie, en plaçant les règles commerciales et monétaires hors de portée des gouvernements élus.
L’origine impériale du néolibéralisme - Slobodian montre que les penseurs néolibéraux (comme Wilhelm Röpke ou Ludwig von Mises) étaient marqués par l’effondrement des empires européens après 1918. Un projet, remplacer les empires par un système économique mondial où les investisseurs et les entreprises seraient protégés des souverainetés nationales. Slobodian aide à comprendre les conflits actuels entre États et marchés (Brexit, guerre commerciale USA-Chine).
Les institutions internationales comme outils néolibéraux - Le GATT (ancêtre de l’OMC), le FMI et la Banque mondiale ont été conçus pour limiter le pouvoir des États et imposer des règles favorables au capital. C'est ainsi par exemple que les tribunaux d’arbitrage internationaux permettent aux multinationales de poursuivre les États qui menacent leurs profits.
Une "démocratie encadrée" - Les néolibéraux étaient souvent sceptiques envers la démocratie, car elle permet aux majorités de voter pour des taxes ou des nationalisations. D'où cette solution qui a fait école, de déléguer les décisions économiques à des technocrates (banques centrales indépendantes, traités de libre-échange). On voit de même que la question du néolibéralisme dépasser le débat "plus ou moins d’État" : Slobodian montre que le néolibéralisme utilise l’État pour servir le capital.
Le néolibéralisme comme "conservatisme global" - Slobodian décrit le néolibéralisme comme une réaction contre les mouvements anticoloniaux et socialistes des années 1960-70. Ainsi le Chili de Pinochet a appliqué des réformes néolibérales pour bloquer toute redistribution après Allende.
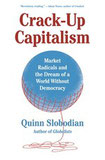
Dans "Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy" (2023), analysant les zones franches économiques (Dubai, Shenzhen, Singapour) comme des laboratoires du capitalisme ultralibéral, l'historien Quinn Slobodian nous montre comment des ultracapitalistes cherchent à dissocier le capitalisme de la démocratie en créant des zones économiques spéciales échappant au contrôle des États-nations. Ces zones, telles que les ports francs, les paradis fiscaux et les enclaves privées, bénéficient de régulations allégées et d'une fiscalité avantageuse, permettant aux entreprises d'opérer sans les contraintes démocratiques traditionnelles. Le néolibéralisme contemporain cherche tout simplement à fragmenter les territoires pour échapper aux régulations.
Slobodian retrace l'évolution de ces idées en suivant des figures emblématiques comme Milton Friedman et Peter Thiel, qui ont cherché à créer des espaces où le marché est roi, sans intervention démocratique. L'ouvrage analyse des exemples historiques et contemporains, de Hong Kong dans les années 1970 à des projets plus récents de "charter cities" et de "seasteading". En examinant la prolifération de ces zones d'exception, Slobodian invite à réfléchir aux implications d'un monde où le pouvoir économique échappe de plus en plus au contrôle démocratique.
Critique du capitalisme globalisé, il analyse plus qu’il ne prescrit des alternatives et sait montrer avec subtilité comment les idées néolibérales ont été mises en pratique via des traités internationaux (cf. l’OMC comme outil pour limiter la souveraineté des États), comment certains penseurs (comme Röpke) ont voulu préserver l’ordre économique occidental après la décolonisation, et cobien les néolibéraux, d'une grande méfiantes envers les masses, ont promu des technocraties non élues (banques centrales indépendantes, tribunaux d’arbitrage) pour structurer le monde ..

Un certain consensus économique post-1980 ...
L’effacement droite-gauche favorise un consensus néolibéral (disparition de tout contre-pouvoir idéologique fort).
Après l’effondrement du communisme et la social-démocratie convertie au marché (ex. : Blair, Schröder), la plupart des partis dominants (de centre-gauche à centre-droit) ont adopté des politiques pro-marché (dérégulation, libre-échange, privatisations).
La Fin des alternatives crédibles ...
Sans opposition forte entre une gauche keynésienne et une droite libérale, les gouvernements appliquent souvent des politiques économiquement libérales, même sous des étiquettes différentes (ex. : Macron en France, les travaillistes de Starmer au Royaume-Uni).
L'Influence des élites économiques ...
Les partis traditionnels, coupés des classes populaires, sont plus sensibles aux lobbys financiers et aux institutions internationales (UE, FMI, OCDE) qui promeuvent des réformes néolibérales.
Conséquences
- Les démocraties se polarisent entre technocrates néolibéraux et populistes anti-système.
- Le débat politique se réduit à des oppositions simplistes (mondialistes vs nationalistes, experts vs peuple) plutôt qu’à des choix économiques clairs.
- Le "désenchantement démocratique" : sans véritable imagination politique, de part le monde, on tend à appliquer des politiques similaires quel que soit le parti au pouvoir.
- La "montée du populisme", une alternative non pour gouverner mais pour accompagner la montée des inégalités et la colère des perdants de la mondialisation, et consolider paradoxalement la vertu d'un néo-libéralisme "autoritaire": face au populisme, les élites se réfugient dans la technocratie, ce qui nourrit encore plus le rejet des "élites".

Le néolibéralisme, comme courant économique et politique, a inspiré de nombreuses expériences marquantes à travers le monde depuis les années 1970, avec des résultats contrastés selon les contextes politiques et sociaux : le plus souvent des succès économiques pour certains pays (Chili, UK, Chine sur le PIB), mais au prix d'inégalités accrues et de crises sociales...
David Harvey, avec "Brève histoire du néolibéralisme" (A Brief History of Neoliberalism, 2005) nous livre une analyse historique de l’essor du néolibéralisme depuis les années 1970, avec ses conséquences (inégalités, financiarisation) : un texte clé pour comprendre sa dimension géopolitique...

1. Le Chili sous Augusto Pinochet (1973-1990)
Réformes : Inspirées par les "Chicago Boys" (économistes formés par Milton Friedman), le Chili a été un laboratoire précoce du néolibéralisme avec des privatisations massives, une libéralisation financière et une réduction des dépenses sociales.
Conséquences : Croissance économique inégale, augmentation des inégalités et répression politique. (Cf. "The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism", by Sebastian Edwards, 2023)

2. Le Royaume-Uni sous Margaret Thatcher (1979-1990)
Thatcherisme : Privatisations (British Telecom, British Gas), affaiblissement des syndicats (grève des mineurs en 1984-1985), dérégulation financière et réduction de l'État-providence. Héritage : Transformation profonde de l'économie britannique, mais creusement des inégalités.

3. Les États-Unis sous Ronald Reagan (1981-1989)
Reaganomics : Baisse massive des impôts (notamment pour les riches et les entreprises), dérégulation (secteur financier, énergie), et augmentation des dépenses militaires. Effets : Boom boursier, mais explosion de la dette publique et inégalités accrues. L'héritage de Reagan, c'est aussi l'affaiblissement des syndicats (licenciements massifs dans l’industrie) et un certain déclin de la classe moyenne. Des s politiques qui ont durablement structuré l’économie américaine. Les années 1990-2000 ont vu l’apogée du consensus néolibéral (Bill Clinton (1993-2001), malgré son étiquette de démocrate, a poursuivi la dérégulation (abrogation du Glass-Steagall Act en 1999, favorisant la finance spéculative). George W. Bush (2001-2009) a accélération les baisses d’impôts pour les riches, et a connu des la guerres coûteuses (Irak) et crise des subprimes (2008), marquant l'échec flagrant du laissez-faire. Le néolibéralisme triomphe donc , quoique la crise de 2008 le discrédite partiellement. On a qualifié les années Obama (2009-2017) de néolibéralisme tempéré (relance keynésienne (American Recovery Act, 2009) pour sauver l’économie après 2008; Obamacare (réforme de santé), intervention de l’État, mais sans remettre en cause le système privé. Mais on n'a observé aucun retour à une régulation forte (Wall Street reste puissante). Un néolibéralisme moins dogmatique, mais toujours dominant. Avec Trump (2017-2021) s'amorce une opposition entre nationalisme économique vs. Néolibéralisme et un populisme de droite critique des délocalisations (guerre commerciale avec la Chine). Le néolibéralisme se maintient avec une nouvelle baisse massive des impôts pour les riches (2017). Biden (2021-2025)semble se prononcer pour un retour de l’État ou un néolibéralisme réformé (American Rescue Plan, 2021, Infrastructure Bill et Inflation Reduction Act (2022), des investissements étatiques dans les énergies vertes, les infrastructures. Un néolibéralisme plus "social", mais sans rupture radicale.

4. La Nouvelle-Zélande dans les années 1980-1990
Réformes radicales : Sous les gouvernements travailliste (Lange) puis national (Ruth Richardson), libéralisation brutale de l'économie, réforme du marché du travail et privatisations.
Bilan : Efficacité économique contestée, avec un coût social élevé.

5. L'Argentine sous Carlos Menem (1989-1999)
Politiques : Privatisations massives (YPF, chemins de fer), dollarisation de l'économie et ouverture aux marchés internationaux.
Résultat : Croissance initiale suivie d'une crise économique majeure en 2001.

6. La Russie post-soviétique (années 1990)
Thérapie de choc : Sous Boris Eltsine et les conseillers occidentaux (Jeffrey Sachs), privatisations rapides ("capitalisme de copinage"), libéralisation des prix.
Conséquences : Appauvrissement massif, montée des oligarques et instabilité économique.

7. La Chine post-Mao (à partir des années 1980)
Capitalisme autoritaire : Libéralisation économique contrôlée (zones économiques spéciales, ouverture aux investissements étrangers) tout en gardant un régime politique autoritaire.
Résultat : Croissance spectaculaire, mais inégalités et corruption.

8. L'Europe est fortement influencée par le néolibéralisme, bien que cette influence soit inégale selon les pays et les périodes et que certaines tensions existent.
Plusieurs éléments montrent cette empreinte, notamment dans les politiques économiques de l'Union européenne (UE) et des États membres.
1. Les politiques économiques de l’UE : libéralisation et austérité
Marché unique et libre circulation : L’UE repose sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, ce qui favorise une logique de concurrence et de dérégulation. - Règles budgétaires strictes (Pacte de stabilité, critères de Maastricht) : Limitation des déficits publics à 3% du PIB et de la dette à 60% du PIB, ce qui restreint les dépenses sociales et keynésiennes. - Politiques d’austérité post-2008 : En Grèce, Espagne, Portugal et Irlande, la Troïka (UE, BCE, FMI) a imposé des coupes budgétaires, des privatisations et des réformes du marché du travail en échange des plans de sauvetage.
2. La domination de l’ordo-libéralisme allemand
L’Allemagne influence fortement l’UE avec une approche ordo-libérale (marché libre, mais avec des règles strictes pour éviter les déficits). Cela se traduit par une rigueur budgétaire, une modération salariale et une priorité à la compétitivité, au détriment parfois des pays du Sud (Grèce, Italie, Espagne).
3. Privatisations et dérégulation sectorielle
Privatisations des années 1980-2000 : France (France Télécom, EDF partiellement), Royaume-Uni (Thatcher), Allemagne (Deutsche Bahn, Post). Libéralisation des services publics (énergie, transports, poste) sous pression des règles de concurrence européenne.
4. Flexibilisation du marché du travail
Réformes pour faciliter les licenciements (lois Hartz en Allemagne, loi Travail en France). Développement des emplois précaires (CDD, intérim, auto-entrepreneuriat).
5. Influence des lobbies et des multinationales
Le Corporate Europe Observatory dénonce l’influence des grands groupes (pharmacie, énergie, finance) sur les directives européennes. Exemple : TTIP (Partenariat transatlantique, abandonné) aurait favorisé les entreprises au détriment des normes sociales et environnementales.
Certains pays résistent partiellement, France (retraites, services publics encore forts, mais réformes libérales sous Macron), Pays nordiques (modèle social-démocrate, mais avec ouverture au marché), Grèce et Espagne (mouvements anti-austérité comme Syriza ou Podemos).

Dans le monde, certains pays résistent plus fortement au néolibéralisme que d’autres, soit en raison de leur modèle économique alternatif, de leur histoire politique, ou de mouvements sociaux opposés aux réformes libérales.
Ainsi des pays d'Amérique latine avec des gouvernements de gauche ou progressistes ( le Venezuela sous Hugo Chávez puis Nicolás Maduro, la Bolivie, sous Evo Morales,
Cuba, malgré des réformes économiques partielles, certains pays asiatiques avec des modèles étatistes ou protectionnistes (la Chine, bien qu’intégrée dans l’économie mondiale, conserve un contrôle étatique fort sur les secteurs stratégiques), des pays européens avec des traditions sociales-démocrates ou protectionnistes (la France, malgré des réformes libérales, un État-providence fort, des services publics importants et une tradition de régulation économique), certains pays africains réfractaires aux ajustements structurels (l'Afrique du Sud, dans une certaine mesure). Au Moyen et Proche-Orient, les pays les plus réfractaires sont ceux qui disposent de ressources (Algérie, Iran) ou d’un système politique anti-occidental (Syrie). À l’inverse, les monarchies du Golfe et certains régimes pro-occidentaux (Jordanie, Maroc) ont davantage adopté des réformes néolibérales, mais sous contrôle étatique. La résistance populaire (Tunisie, Égypte) reste un frein majeur.
Mais au final, très peu de pays échappent totalement au néolibéralisme aujourd'hui. La pression du FMI (le pouvoir structurel du FMI et de la dette), de la Banque mondiale, la domination du commerce mondialisé des, les accords de libre-échange et de la mondialisation financière rendent presque impossible une rupture complète avec ce modèle.
Cependant, certains États résistent plus que d'autres, en adaptant le néolibéralisme à leurs spécificités ou en maintenant des contre-modèles partiels. Les États-Unis et l’UE imposent des sanctions (Venezuela, Iran) ou des accords commerciaux (Maroc, Jordanie) qui limitent les alternatives : les pays qui résistent (Cuba, Corée du Nord) sont isolés économiquement. Enfin, on l'oublie, mais les classes dirigeantes profitent souvent des privatisations et de la financiarisation ..

Le néolibéralisme n’est pas incontournable, mais il est difficile à contourner sans subir de lourdes sanctions économiques. Seuls les pays disposant de ressources stratégiques (pétrole, gaz) ou acceptant l’isolement (Corée du Nord) peuvent s’en écarter significativement. Pour les autres, la lutte se joue désormais dans l’atténuation de ses effets (protection sociale, régulations) plutôt que dans son rejet pur et simple, via le retour du protectionnisme ou des modèles de welfare state social-démocrate (Scandinavie, mais sous pression)...
Philip Mirowski, dans "Never Let a Serious Crisis Go to Waste" (2013) montre comment le néolibéralisme a survécu à la crise de 2008 en se réinventant...
La résistance au néolibéralisme s’enracine dans une critique profonde de ses conséquences économiques, sociales, politiques et environnementales ...
1. Inégalités économiques accrues
Concentration des richesses : Le néolibéralisme favorise les plus riches (baisses d’impôts sur le capital, paradis fiscaux) et précarise les classes populaires. Les 1% les plus riches ont capté 38% de la croissance mondiale depuis 1980 (Oxfam). Démantèlement des services publics, privatisations des hôpitaux, écoles, transports, entraînent des inégalités d’accès.
2. Une Démocratie affaiblie
On oppose pouvoir des multinationales et pouvoir citoyen, les accords de libre-échange (TAFTA, CETA) permettent aux entreprises de poursuivre les États (tribunaux d’arbitrage privés). Des ajustements structurels sont imposés par le FMI et la Banque mondiale dictant leurs politiques aux pays endettés, sans débat démocratique.
3. Destruction des protections sociales
La Flexibilisation accrue du travail : la fameuse montée des CDD, l'auto-entrepreneuriat, l'ubérisation, sources d'insécurité économique. Le recul des syndicats, l'affaiblissement des négociations collectives (ex: lois travail en France sous Macron).
4. Des Crises financières à répétition
la dérégulation bancaire a entraîné les crises des subprimes (2008), krachs boursiers. La spéculation sur les dettes publiques : les marchés financiers étranglent les États (la Grèce en 2015).
5. Exploitation environnementale
Logique court-termiste : les multinationales exploitent les ressources (déforestation, énergies fossiles) sans régulation. Marchandisation de la nature : Brevets sur les semences, accaparement des terres.
6. Uniformisation culturelle
Domination des géants du numérique (Google, Amazon, Netflix) sur les cultures locales.
Standardisation des modes de vie : Fast-food, consommation de masse, effacement des alternatives.

Thomas Piketty, économiste français connu pour ses travaux sur les inégalités, défend la thèse que néolibéralisme n’est pas une "loi naturelle", mais une construction politique qui sert une minorité.
Dans "Le Capital au XXIe siècle" (2013), il avait montré que depuis les années 1980 (ère Reagan-Thatcher), le néolibéralisme avait conduit à
- une concentration extrême des richesses : les 1 % les plus riches captent une part croissante des revenus et du patrimoine.
- un affaiblissement de la progressivité fiscale : La baisse des impôts sur les hauts revenus et les capitaux (ex. : réductions d’impôts aux États-Unis, flat tax en Europe de l’Est) a favorisé les plus aisés.
- la financiarisation de l’économie : Le capital (actions, immobilier, héritages) rapporte plus que le travail, creusant les écarts.
Dans "Capital et Idéologie" (2019), Piketty étendra sa critique du néolibéralisme en montrant que les élites économiques dominent le politique, via le lobbying, les paradis fiscaux et la capture des médias; que la mondialisation néolibérale a dépossédé les États : Les politiques sociales et fiscales sont contraintes par la concurrence fiscale et les marchés financiers; que la montée des populismes est une des conséquences, les inégalités nourrissent le ressentiment et les votes protestataires (Trump, Brexit, extrêmes droites).
Piketty ne prédit pas l’effondrement du capitalisme, mais plaide pour sa régulation et mise sur des réformes institutionnelles plutôt que sur des mouvements de masse. Non, le marché ne s’autorégule pas et la croissance ne "ruisselle" pas.
"Une brève histoire de l’égalité" (2021), une synthèse de ses propositions. Pour dépasser le néolibéralisme, Piketty défend un impôt progressif mondial sur le capital (jusqu’à 90 % pour les ultra-riches), un socialisme participatif (des salariés co-décisionnaires dans les entreprises), un héritage redistribué sous forme de capital de départ pour tous et une refonte de la gouvernance européenne (un parlement transnational, une taxe carbone aux frontières).
Wendy Brown nous montrera en 2015 comment cette rationalité néolibérale représente une révolution anthropologique profonde, bien au-delà d’une simple transformation économique. C'est un processus qui « défait » littéralement la démocratie (undoing the demos), la remplaçant par une logique technocratique, individualiste et dépolitisée qui menace non seulement les institutions démocratiques, mais la possibilité même d'une existence démocratique authentique...

Naomi Klein, "The Shock Doctrine" (2007, La Stratégie du choc, La montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud, 2008)
Naomi Klein (1970) est une journaliste d’investigation, essayiste, militante altermondialiste et universitaire canadienne, surtout connue pour ses critiques virulentes du capitalisme néolibéral, de la mondialisation économique et des politiques de choc, ainsi que pour son engagement en faveur de la justice climatique et sociale. Son premier livre, "No Logo" (1999), est devenu une référence du mouvement anti-mondialisation : elle y dénonçait l’exploitation des travailleurs par les multinationales (comme Nike, McDonald’s) et la marchandisation de la culture et a inspiré les mouvements altermondialistes des années 2000. Elle soutient des mouvements comme "Occupy Wall Street", "Extinction Rebellion" et "Sunrise Movement"...
Naomi Klein développe ici la thèse que le néolibéralisme, tel que promu par Milton Friedman et l’école de Chicago, ne s’est pas imposé démocratiquement mais par la contrainte, souvent à la suite de catastrophes, réelles ou orchestrées — qu’elles soient naturelles, économiques, militaires ou terroristes. Ces moments de "choc" seraient exploités pour imposer des politiques de privatisation radicale, de déréglementation, et de réduction de l'État social.
Le livre s’ouvre sur une analyse du Dr Ewen Cameron, psychiatre financé par la CIA dans les années 1950, qui utilisait l’électrochoc et la privation sensorielle pour "reprogrammer" des patients. Klein y voit une métaphore du traitement des sociétés : créer un choc, détruire les repères, puis reconstruire selon les dogmes du marché libre.
Suivent des Études de cas majeures :
- Chili (1973) : Après le coup d’État contre Salvador Allende, la dictature de Pinochet applique les recommandations de l’École de Chicago. Les privatisations sont massives, les droits syndicaux supprimés. Klein y voit le prototype du "capitalisme du choc".
- Argentine (1976) : La junte militaire impose également des politiques économiques ultralibérales dans un climat de terreur.
- Pologne (années 1980-1990) : Après l'effondrement du communisme, les réformes du marché sont imposées rapidement malgré l’opposition du syndicat Solidarnosc.
- Russie (1991) : Sous la direction de Boris Eltsine, le "big bang" économique appauvrit des millions de Russes tout en enrichissant une oligarchie.
- Irak (2003) : Après l’invasion américaine, Paul Bremer impose une libéralisation extrême de l’économie, allant jusqu’à écrire un nouveau code commercial, le tout sous occupation militaire.
- Ouragan Katrina (2005) : La catastrophe naturelle est selon Klein utilisée pour privatiser l’éducation publique à la Nouvelle-Orléans, remplaçant les écoles publiques par des charter schools.
- Tsunami en Asie (2004) : Des régions côtières touristiques ont été reprises par des promoteurs après la catastrophe, en excluant les populations locales.
L’idée que les chocs (désastres) servent de moments pour imposer des politiques impopulaires (doctrine du choc) est puissante, et bien documentée. The New York Times saluera l’enquête mais critiquera le ton militant et accusatoire, tandis que The Guardian le présentera comme un livre “important, engagé, courageux” qui fait écho au "Capitalisme et schizophrénie" de Deleuze et Guattari, mais avec une approche plus journalistique ...
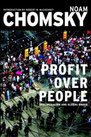
"Profit Over People: Neoliberalism and Global Order" (1999), une charge de Noam Chomsky contre l'hypocrisie du néolibéralisme, démontrant comment il sert une oligarchie tout en détruisant la solidarité sociale. Chomsky y défend une vision plus égalitaire et participative de l'économie. Le néolibéralisme n'est pas un phénomène naturel, mais un système politique et économique imposé par les élites (multinationales, institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale, et gouvernements complices) pour maximiser leurs profits et leur pouvoir. Il le décrit comme une forme de "capitalisme de copinage" (crony capitalism).
Selon Chomsky, le néolibéralisme réduit la démocratie en transférant le pouvoir des citoyens vers des entités non élues (marchés, entreprises). Les politiques néolibérales (dérégulation, privatisations, austérité) sont souvent mises en œuvre sans débat public, au profit d'une minorité.
Chomsky dénonce l'aggravation des inégalités : le néolibéralisme enrichit les plus riches tout en précarisant les travailleurs et en sapant les protections sociales. Il souligne que la mondialisation néolibérale profite aux investisseurs, pas aux populations.
Contrairement au discours néolibéral (qui prône un État minimal), Chomsky montre que l'État intervient massivement pour servir les intérêts des entreprises (subventions, sauvetages bancaires, lois anti-syndicales). Exemple : les États-Unis, malgré leur rhétorique "libre-marché", ont une économie fortement subventionnée.
Il analyse comment les médias et l'idéologie dominante présentent le néolibéralisme comme inévitable, en marginalisant les alternatives. Cette "fabrique du consentement" (concept qu'il a développé avec Edward Herman) sert à légitimer l'ordre économique actuel.

Wendy Brown, "Undoing the Demos: Neoliberalism’s Revolution" (2015)
Neoliberal rationality - ubiquitous today in statecraft and the workplace, in jurisprudence, education, and culture - remakes everything and everyone in the image of homo oeconomicus. - La rationalité néolibérale - omniprésente aujourd'hui dans la gestion de l'État et sur le lieu de travail, dans la jurisprudence, l'éducation et la culture - refait tout et tout le monde à l'image de l'homo oeconomicus. Les pratiques démocratiques libérales risquent de ne pas survivre à ces transformations...
Selon Brown, le néolibéralisme ne doit pas seulement être compris comme une doctrine économique ou un ensemble de politiques favorisant le marché, mais comme une logique politique totalisante qui redéfinit entièrement ce que signifie être un citoyen, une société, ou même un être humain. L'argument principal de Brown est que la rationalité néolibérale transforme radicalement la démocratie, en effaçant progressivement la sphère politique autonome au profit d'une logique purement économique centrée sur le marché et l'individu comme acteur rationnel qui maximise constamment son capital humain ...
Wendy Brown (1955) est une politologue et philosophe américaine contemporaine, professeure à l’Institute for Advanced Study (Princeton) et à Berkeley, figure majeure de la théorie politique critique. Dans "Défaire le dèmos", elle se livre à une analyse incisive de la manière dont le néolibéralisme corrode les fondements de la démocratie.
Héritière des traditions marxiste (via Foucault) et féministe, elle travaille sur les liens entre économie, pouvoir et démocratie et on compte parmi ses autres ouvrages majeurs, "Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics" (2005), qui analyse les limites de la pensée politique moderne, en examinant comment des concepts comme la souveraineté, la démocratie et la justice sont remis en question dans un monde globalisé : Brown s'intéresse aux tensions entre théorie critique et pratique politique, en analysant notamment les travaux de Foucault, Nietzsche et Habermas.
Dans "In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West" (2019), Brown analyse comment le néolibéralisme, au-delà d'une simple doctrine économique, a détruit les fondements démocratiques des sociétés occidentales, ouvrant la voie à des régimes autoritaires et réactionnaires (comme Trump, Bolsonaro ou le Brexit). Elle montre comment la rationalité néolibérale a sapé les institutions publiques, exacerbé les inégalités et alimenté des mouvements antidémocratiques. Dans "Walled States, Waning Sovereignty" (2010, édition anglaise ; version française en 2009), elle étudie la prolifération des murs frontaliers (comme celui entre les États-Unis et le Mexique ou en Israël/Palestine) comme symptôme du déclin de la souveraineté étatique dans un monde globalisé. Elle argue que ces murs sont des réactions symboliques à la perte de contrôle des États-nations face aux flux transnationaux (capital, migrants, données), reflétant une nostalgie de la souveraineté plutôt qu'une réelle capacité à la restaurer....

" In a century heavy with political ironies, there may have been none greater than this: at the end of the Cold War, as mainstream pundits hailed democracy’s global triumph, a new form of governmental reason was being unleashed in the euro-Atlantic world that would inaugurate democracy’s conceptual unmooring and substantive disembowelment. Within thirty years, Western democracy would grow gaunt, ghostly, its future increasingly hedged and improbable. More than merely saturating the meaning or content of democracy with market values, neoliberalism assaults the principles, practices, cultures, subjects, and institutions of democracy understood as rule by the people. And more than merely cutting away the flesh of liberal democracy, neoliberalism also cauterizes democracy’s more radical expressions, those erupting episodically across euro-Atlantic modernity and contending for its future with more robust versions of freedom, equality, and popular rule than democracy’s liberal iteration is capable of featuring.
The claim that neoliberalism is profoundly destructive to the fiber and future of democracy in any form is premised on an understanding of neoliberalism as something other than a set of economic policies, an ideology, or a resetting of the relation between state and economy. Rather, as a normative order of reason developed over three decades into a widely and deeply disseminated governing rationality, neoliberalism transmogrifies every human domain and endeavor, along with humans themselves, according to a specific image of the economic. All conduct is economic conduct; all spheres of existence are framed and measured by economic terms and metrics, even when those spheres are not directly monetized. In neoliberal reason and in domains governed by it, we are only and everywhere homo oeconomicus, which itself has a historically specific form. Far from Adam smith’s creature propelled by the natural urge to “truck, barter, and exchange,” today’s homo oeconomicus is an intensely constructed and governed bit of human capital tasked with improving and leveraging its competitive positioning and with enhancing its (monetary and nonmonetary) portfolio value across all of its endeavors and venues. These are also the mandates, and hence the orientations, contouring the projects of neoliberalized states, large corporations, small businesses, nonprofits, schools, consultancies, museums, countries, scholars, performers, public agencies, students, websites, athletes, sports teams, graduate programs, health providers, banks, and global legal and financial institutions.
» Au cours d'un siècle riche en ironies politiques, il n'y en a peut-être pas eu de plus grande : à la fin de la guerre froide, alors que les grands pontes saluaient le triomphe mondial de la démocratie, une nouvelle forme de raison gouvernementale se déchaînait dans le monde euro-atlantique, inaugurant le démaillotage conceptuel et l'éviscération substantielle de la démocratie. En l'espace de trente ans, la démocratie occidentale deviendrait décharnée, fantomatique, son avenir de plus en plus flou et improbable. Plus qu'une simple saturation du sens ou du contenu de la démocratie par les valeurs du marché, le néolibéralisme s'attaque aux principes, aux pratiques, aux cultures, aux sujets et aux institutions de la démocratie comprise comme le gouvernement par le peuple. Et plus que de simplement couper la chair de la démocratie libérale, le néolibéralisme cautérise également les expressions plus radicales de la démocratie, celles qui éclatent épisodiquement à travers la modernité euro-atlantique et qui luttent pour son avenir avec des versions plus robustes de la liberté, de l'égalité et de la règle populaire que l'itération libérale de la démocratie n'est capable de présenter.
L'affirmation selon laquelle le néolibéralisme est profondément destructeur pour la fibre et l'avenir de la démocratie sous toutes ses formes repose sur une compréhension du néolibéralisme comme étant autre chose qu'un ensemble de politiques économiques, une idéologie ou une réinitialisation de la relation entre l'État et l'économie. En tant qu'ordre normatif de la raison développé au cours de trois décennies pour devenir une rationalité de gouvernement largement et profondément diffusée, le néolibéralisme transforme tous les domaines et toutes les activités humaines, ainsi que les êtres humains eux-mêmes, selon une image spécifique de l'économie. Toute conduite est une conduite économique ; toutes les sphères de l'existence sont encadrées et mesurées par des termes et des mesures économiques, même lorsque ces sphères ne sont pas directement monétisées. Dans la raison néolibérale et dans les domaines qu'elle régit, nous sommes uniquement et partout des homo oeconomicus, qui ont eux-mêmes une forme historiquement spécifique. Loin de la créature d'Adam Smith propulsée par le besoin naturel de « camionner, troquer et échanger », l'homo oeconomicus d'aujourd'hui est une partie du capital humain intensément construite et gouvernée, chargée d'améliorer et de tirer parti de son positionnement concurrentiel et d'accroître la valeur (monétaire et non monétaire) de son portefeuille dans toutes ses activités et dans tous ses lieux de travail. Ce sont également les mandats, et donc les orientations, qui définissent les projets des États néolibéralisés, des grandes entreprises, des petites entreprises, des organisations à but non lucratif, des écoles, des cabinets de conseil, des musées, des pays, des universitaires, des artistes, des agences publiques, des étudiants, des sites web, des athlètes, des équipes sportives, des programmes d'études supérieures, des prestataires de soins de santé, des banques et des institutions juridiques et financières mondiales.

"What happens when the precepts and principles of democracy are remade by this order of reason and governance? When the commitment to individual and collective self-rule and the institutions supporting it are overwhelmed and then displaced by the encomium to enhance capital value, competitive positioning, and credit ratings? What happens when the practices and principles of speech, deliberation, law, popular sovereignty, participation, education, public goods, and shared power entailed in rule by the people are submitted to economization? These are the questions animating this book.
To pose these questions is already to challenge commonplace notions that democracy is the permanent achievement of the West and therefore cannot be lost; that it consists only of rights, civil liberties, and elections; that it is secured by constitutions combined with unhindered markets; or that it is reducible to a political system maximizing individual freedom in a context of state-provisioned order and security.
Que se passe-t-il lorsque les préceptes et les principes de la démocratie sont refondus par cet ordre de la raison et de la gouvernance ? Lorsque l'engagement en faveur de l'autonomie individuelle et collective et les institutions qui la soutiennent sont submergés puis évincés par l'éloge de l'augmentation de la valeur du capital, du positionnement concurrentiel et des notations de crédit ? Que se passe-t-il lorsque les pratiques et les principes de la parole, de la délibération, du droit, de la souveraineté populaire, de la participation, de l'éducation, des biens publics et du pouvoir partagé qu'implique le gouvernement par le peuple sont soumis à l'économisation ? Telles sont les questions qui animent ce livre.
Poser ces questions, c'est déjà remettre en question les idées reçues selon lesquelles la démocratie est l'acquis permanent de l'Occident et ne peut donc pas être perdue ; qu'elle consiste uniquement en droits, libertés civiles et élections ; qu'elle est garantie par des constitutions combinées à des marchés sans entraves ; ou qu'elle est réductible à un système politique maximisant la liberté individuelle dans un contexte d'ordre et de sécurité assurés par l'État.
"These questions also challenge the Western liberal democratic conceit that humans have a natural and persistent desire for democracy. They presume instead that democratic self-rule must be consciously valued, cultured, and tended by a people seeking to practice it and that it must vigilantly resist myriad economic, social, and political forces threatening to deform or encroach upon it. They presume the need to educate the many for democracy, a task that grows as the powers and problems to be addressed increase in complexity. Finally, these questions presume that the promise of shared rule by the people is worth the candle, both an end in itself and a potential, though uncertain, means to other possible goods, ranging from human thriving to planetary sustainability. Hardly the only salient political value, and far from insurance against dark trajectories, democracy may yet be more vital to a livable future than is generally acknowledged within Left programs centered on global governance, rule by experts, human rights, anarchism, or undemocratic versions of communism. none of these contestable presumptions have divine, natural, or philosophical foundations, and none can be established through abstract reasoning or empirical evidence. They are convictions animated by attachment, scholarly contemplation of history and the present, and argument, nothing more..."
« Ces questions remettent également en question le concept démocratique libéral occidental selon lequel les êtres humains ont un désir naturel et persistant de démocratie. Elles supposent au contraire que l'autonomie démocratique doit être consciemment valorisée, cultivée et entretenue par un peuple qui cherche à la pratiquer et qu'elle doit résister avec vigilance à une myriade de forces économiques, sociales et politiques qui menacent de la déformer ou d'empiéter sur elle. Elles supposent la nécessité d'éduquer le plus grand nombre à la démocratie, une tâche qui s'accroît au fur et à mesure que les pouvoirs et les problèmes à traiter se complexifient. Enfin, ces questions supposent que la promesse d'un gouvernement partagé par le peuple en vaut la chandelle, à la fois comme une fin en soi et comme un moyen potentiel, bien qu'incertain, d'atteindre d'autres biens possibles, allant de l'épanouissement de l'homme à la durabilité de la planète. La démocratie, qui n'est pas la seule valeur politique importante et qui est loin d'être une assurance contre les trajectoires sombres, est peut-être plus vitale pour un avenir vivable que ne le reconnaissent généralement les programmes de la gauche centrés sur la gouvernance mondiale, le règne des experts, les droits de l'homme, l'anarchisme ou les versions non démocratiques du communisme. Ce sont des convictions animées par l'attachement, la contemplation érudite de l'histoire et du présent, et l'argumentation, rien de plus... »
Dismantling Democracy - " This book is a theoretical consideration of the ways that neoliberalism, a peculiar form of reason that configures all aspects of existence in economic terms, is quietly undoing basic elements of democracy. " - Wendy Brown introduit la thèse fondamentale selon laquelle le néolibéralisme ne se limite pas à la dérégulation économique, mais constitue une véritable révolution politique et anthropologique ...

"What is the connection between neoliberalism’s hollowing out of contemporary liberal democracy and its imperiling of more radical democratic imaginaries? Liberal democratic practices and institutions almost always fall short of their promise and at times cruelly invert it, yet liberal democratic principles hold, and hold out, ideals of both freedom and equality universally shared and of political rule by and for the people. Most other formulations of democracy share these ideals, interpreting them differently and often seeking to realize them more substantively than liberalism’s formalism, privatism, individualism, and relative complacency about capitalism makes possible. However if, as this book suggests, neoliberal reason is evacuating these ideals and desires from actually existing liberal democracies, from what platform would more ambitious democratic projects be launched? How would the desire for more or better democracy be kindled from the ash heap of its bourgeois form? Why would peoples want or seek democracy in the absence of even its vaporous liberal democratic instantiation?
And what in dedemocratized subjects and subjectivities would yearn for this political regime, a yearning that is neither primordial nor cultured by this historical condition? These questions are reminders that the problem of what kinds of peoples and cultures would seek or build democracy, far from being one mainly pertinent to the non-West, is of driving importance in the contemporary West. Democracy can be undone, hollowed out from within, not only overthrown or stymied by antidemocrats And desire for democracy is neither given nor uncorruptible; indeed, even democratic theorists such as Rousseau and Mill acknowledge the difficulty of crafting democratic spirits from the material of european modernity..."
"Quel est le lien entre l'affaiblissement de la démocratie libérale contemporaine par le néolibéralisme et la mise en péril d'imaginaires démocratiques plus radicaux ? Les pratiques et les institutions démocratiques libérales sont presque toujours en deçà de leurs promesses et les inversent parfois cruellement. Pourtant, les principes démocratiques libéraux soutiennent et maintiennent les idéaux de liberté et d'égalité universellement partagés et de gouvernement politique par et pour le peuple. La plupart des autres formulations de la démocratie partagent ces idéaux, en les interprétant différemment et en cherchant souvent à les réaliser de manière plus substantielle que ne le permettent le formalisme, le privatisme, l'individualisme et la relative complaisance du libéralisme à l'égard du capitalisme. Cependant, si, comme le suggère ce livre, la raison néolibérale évacue ces idéaux et ces désirs des démocraties libérales existantes, à partir de quelle plate-forme des projets démocratiques plus ambitieux pourraient-ils être lancés ? Comment le désir d'une plus grande ou d'une meilleure démocratie pourrait-il être ravivé à partir du tas de cendres de sa forme bourgeoise ? Pourquoi les peuples voudraient-ils ou rechercheraient-ils la démocratie en l'absence de son instanciation démocratique libérale, même vaporeuse ?
Et qu'est-ce qui, dans les sujets et les subjectivités dédémocratisés, aspirerait à ce régime politique, une aspiration qui n'est ni primordiale ni cultivée par cette condition historique ? Ces questions nous rappellent que le problème de savoir quels types de peuples et de cultures chercheraient ou construiraient la démocratie, loin de concerner principalement le non-Occident, est d'une importance capitale dans l'Occident contemporain. La démocratie peut être défaite, vidée de l'intérieur, et pas seulement renversée ou entravée par des antidémocrates. Le désir de démocratie n'est ni donné ni irréprochable ; en effet, même des théoriciens de la démocratie tels que Rousseau et Mill reconnaissent la difficulté de créer des esprits démocratiques à partir du matériau de la modernité européenne.
"neoliberal rationality"
Wendy Brown propose le concept clé de la « rationalité néolibérale », une logique omniprésente qui façonne tous les domaines de l’existence (individuelle, collective, politique, éthique). Un concept forgé principalement à partir d'une lecture critique et approfondie des conférences de Michel Foucault intitulées "Naissance de la biopolitique" (The Birth of Biopolitics, 1978-1979). À travers cette approche foucaldienne, elle propose une analyse selon laquelle le néolibéralisme n’est ni simplement une politique économique, ni seulement une idéologie, mais une véritable rationalité politique totalisante, une manière spécifique de penser et d’organiser le monde.
Pour Brown, le point de départ essentiel est Foucault, en particulier sa définition du néolibéralisme non comme simple doctrine économique, mais comme un mode de gouvernementalité, une manière spécifique d'exercer le pouvoir et de produire les subjectivités. Elle insiste sur la démarche de Foucault, qui ne se concentre pas seulement sur les institutions ou les politiques économiques, mais sur les discours, les pratiques et les rationalités de gouvernance qui structurent profondément les conduites individuelles et collectives. C'est ainsi prend forme une nouvelle interprétation du néolibéralisme, plus qu’une simple privatisation ou dérégulation, il devient une « grammaire normative » qui s’impose aux individus et aux institutions. Et Brown prolonge cette lecture foucaldienne en affirmant explicitement que la rationalité néolibérale dépasse largement l'économie. Elle colonise tous les aspects de la vie, remodelant les sphères politiques, sociales, culturelles, et éthiques selon des critères économiques de concurrence et d’investissement personnel.
Brown dégage ainsi plusieurs caractéristiques centrales à la rationalité néolibérale :
- Universalité de la concurrence : le principe de la concurrence pénètre chaque domaine de l’existence, transformant les individus en entrepreneurs de soi, constamment évalués par leur performance économique. L’individu est amené à concevoir chaque aspect de sa vie (éducation, santé, loisirs, relations interpersonnelles) comme un investissement qui doit être rentable.
- La figure de l’Homo Oeconomicus généralisée : Brown approfondit la réflexion foucaldienne sur l’« homo oeconomicus », qui n’est plus simplement une figure économique, mais une subjectivité généralisée : chaque citoyen devient entrepreneur de lui-même, évaluant rationnellement ses choix en termes de coûts et de bénéfices personnels.
- "Capital humain" comme paradigme : le concept foucaldien de « capital humain » joue un rôle central chez Brown. Le néolibéralisme restructure l’identité même de l’individu, désormais conçu comme une unité de capital humain à maximiser en permanence. Cette logique implique une responsabilisation extrême des individus face à leurs réussites et échecs personnels.

Est ensuite abordée la logique de diffusion de la rationalité néolibérale : comment cette rationalité se diffuse à travers différents mécanismes sociétaux et institutionnels :
- Diffusion institutionnelle et sociale : la rationalité néolibérale s’inscrit profondément dans les politiques publiques (éducation, santé, protection sociale, justice), les reconfigurant systématiquement selon la logique du marché. L'État lui-même se transforme, passant d'un rôle de garant du bien commun à un gestionnaire technocratique qui optimise économiquement les individus et les groupes sociaux.
- Intériorisation individuelle : la diffusion la plus puissante selon Brown est cependant intérieure et subjective. Les individus intériorisent la rationalité néolibérale jusqu’à devenir eux-mêmes ses relais et défenseurs. L’intériorisation produit une auto-régulation où chacun se perçoit responsable de sa propre employabilité, de son état de santé, de sa réputation et de son efficacité économique globale.
Érosion de la dimension éthique et politique : Brown souligne particulièrement que cette diffusion détruit progressivement la distinction traditionnelle entre économie, politique et morale. Tout devient économie. Les notions mêmes de citoyenneté, de participation démocratique, et d'engagement moral sont réduites à des calculs de rentabilité individuelle.

Les conséquences ..
Selon Brown, cette rationalité néolibérale et sa logique de diffusion ont des conséquences anthropologiques et démocratiques dramatiques :
- Dépolitisation radicale : elle constate une disparition progressive de l’espace public en tant que lieu autonome de délibération politique, remplacé par une gouvernance technocratique fondée sur des critères économiques.
- Réduction anthropologique : l’être humain cesse progressivement d’être conçu comme un citoyen capable d'action collective et solidaire pour devenir exclusivement un individu rationnel, auto-entrepreneur et concurrentiel.
- Fragmentation et individualisation accrue : la société perd ses dimensions collectives et solidaires au profit d'une atomisation où les relations humaines elles-mêmes deviennent des transactions économiques.

Neoliberalism and the Undoing of Democracy - Brown explique comment le néolibéralisme reconfigure profondément la démocratie, déplaçant l'accent d'une gouvernance par le peuple à une gestion technocratique des marchés. Le modèle du marché concurrence désormais celui de l'espace public, remplaçant les citoyens par des « investisseurs » dans tous les aspects de la vie publique et privée.
Foucault’s Birth of Biopolitics Lectures: Charting Neoliberal Political Rationality - Brown s'appuie largement sur les analyses de Michel Foucault, notamment ses conférences sur la biopolitique, pour décrire le néolibéralisme comme une « rationalité politique » plutôt que comme une simple idéologie économique. La gouvernance néolibérale, selon elle, gère des individus et des populations en optimisant leur « capital humain » et en généralisant la concurrence.
Homo Politicus and Homo Oeconomicus - Brown approfondit l'opposition entre deux figures conceptuelles : l’homo politicus (citoyen participant à la délibération démocratique, engagé dans des processus collectifs d'élaboration du bien commun) et l’homo oeconomicus (individu compétitif centré sur l’optimisation de son propre capital humain). Le néolibéralisme opère une substitution du second au premier, dissolvant la notion même d’intérêt général.
Law and Legal Reason - Comment la logique néolibérale restructure la sphère juridique, réduisant progressivement la loi à un outil de facilitation du marché. La gouvernance devient gestionnaire et technocratique ; les droits eux-mêmes sont redéfinis comme des investissements à protéger plutôt que comme des protections démocratiques fondamentales.
Educating Human Capital - Brown analyse particulièrement le champ de l’éducation : les universités deviennent des entreprises compétitives, les étudiants des entrepreneurs en capital humain, et le savoir lui-même une marchandise. La formation citoyenne est marginalisée, voire détruite, au profit d’une logique de rentabilité immédiate.
Responsibilizing Individuals and Communities - Brown discute comment les individus et les collectivités deviennent responsables de leur succès ou échec économique et social sous la gouvernance néolibérale. L'État se retire des responsabilités collectives, transférant aux individus la charge entière de leur réussite personnelle et professionnelle, intensifiant l'isolement et la culpabilité individuelle en cas d’échec.
Sacrificial Citizenship: Neoliberalism and the Erosion of Democracy - L'auteure explore le phénomène de la « citoyenneté sacrificielle » : les citoyens acceptent de sacrifier les biens publics, la solidarité sociale, et même les libertés politiques pour garantir leur survie économique individuelle. La démocratie s'érode ainsi de l'intérieur, car les individus abandonnent volontairement l'idéal démocratique au profit de logiques utilitaristes et individualistes.
Dans la conclusion, Wendy Brown insiste sur le danger mortel que représente le néolibéralisme pour la démocratie, non seulement en raison des inégalités économiques croissantes, mais parce qu’il supprime progressivement la possibilité même d’une citoyenneté démocratique active et consciente. Elle appelle à une prise de conscience et à une réaffirmation urgente des valeurs démocratiques et de l’engagement politique collectif pour contrer cette tendance destructrice.

George Monbiot & Peter Hutchison, "Invisible Doctrine: The Secret History of Neoliberalism" (2024)
Neoliberalism is the dominant ideology of our time. It shapes us in countless ways, yet most of us struggle to articulate what it is. Worse, we have been persuaded to accept this extreme creed as a kind of natural law. In "Invisible Doctrine", journalist George Monbiot and filmmaker Peter Hutchison shatter this myth. -
Le néolibéralisme est l'idéologie dominante de notre époque. Le néolibéralisme est l'idéologie dominante de notre époque. Il nous façonne d'innombrables façons, mais la plupart d'entre nous peinent à formuler ce qu'il est. Pire encore, nous avons été persuadés d'accepter ce credo extrême comme une sorte de loi naturelle.
Dans "Invisible Doctrine", le journaliste George Monbiot et le cinéaste Peter Hutchison brisent ce mythe. Ils montrent comment une philosophie marginale des années 1930, qui prônait la concurrence comme caractéristique essentielle de l'humanité, a été systématiquement détournée par un groupe d'élites fortunées, déterminées à préserver leur fortune et leur pouvoir. Les groupes de réflexion, les entreprises, les médias, les départements universitaires et les politiciens ont tous été déployés pour promouvoir l'idée que les gens sont des consommateurs plutôt que des citoyens. L'un des effets les plus pernicieux a été de faire en sorte que nos différentes crises - des catastrophes climatiques aux krachs économiques, de la dégradation des services publics à la pauvreté endémique des enfants - ne soient pas liées entre elles.
En réalité, elles ont toutes été exacerbées par la « doctrine invisible », qui subordonne la démocratie au pouvoir de l'argent. ("La Doctrine invisible. L'Histoire secrète du néolibéralisme (et comment il en est arrivé à contrôler nos vies", édition du Faubourg). On se doute que le livre n'eut aucune influence sur la ligne de démarcation idéologique qui sépare détracteurs et partisans du néolibéralisme (The Economist a qualifié le livre de "simpliste", lui reprochant de faire du néolibéralisme un bouc émissaire unique et de négliger ses aspects positifs (réduction de la pauvreté mondiale, innovations technologiques) : mais pour ceux qui hésitent encore entre les deux visions, le style est accessible, les exemples concrets, et il montre parfaitement comment le néolibéralisme a été exporté via le FMI, l’OMC ou l’UE ...
"THE ANONYMOUS IDEOLOGY - Imagine that the people of the Soviet Union had never heard of Communism. That’s more or less where we find ourselves today. The dominant ideology of our times—which affects nearly every aspect of our lives- for most of us has no name. If you mention it, people are likely either to tune out or to respond with a bewildered shrug: “What do you mean? What’s that?” Even those who have heard the word struggle to define it.
Its anonymity is both a symptom and a cause of its power. It has caused or contributed to most of the crises that now confront us: rising inequality; rampant child poverty; epidemic diseases of despair; off-shoring and the erosion of the tax base; the slow degradation of healthcare, education, and other public services; the crumbling of infrastructure; democratic backsliding; the 2008 financial crash; the rise of modern-day demagogues, such as Viktor Orbán, Narendra Modi, Donald Trump, Boris Johnson, and Jair Bolsonaro; our ecological crises and environmental disasters.
We respond to these predicaments as if they occur in isolation. Crisis after crisis unfolds, yet we fail to understand their common roots. We fail to recognize that all these disasters either arise from or are exacerbated by the same coherent ideology—an ideology that has, or at least had, a name. Neoliberalism. Do you know what it is?
So pervasive has neoliberalism become that we no longer even recognize it as an ideology. We see it as a kind of “natural law,” like Darwinian selection, thermodynamics, or even gravity—an immutable fact, a nonnegotiable reality. What greater power can there be than to operate namelessly?
But neoliberalism is neither inevitable nor immutable. On the contrary, it was conceived and fostered as a deliberate means of changing the nature of power..."
« L'IDEOLOGIE ANONYME - Imaginez que les habitants de l'Union soviétique n'aient jamais entendu parler du communisme. C'est plus ou moins la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'idéologie dominante de notre époque - qui affecte presque tous les aspects de notre vie - n'a pas de nom pour la plupart d'entre nous. Si vous l'évoquez, les gens risquent de ne pas y prêter attention ou de répondre par un haussement d'épaules perplexe : « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que c'est ? » Même ceux qui ont entendu le mot ont du mal à le définir.
Son anonymat est à la fois un symptôme et une cause de son pouvoir. Il a causé ou contribué à la plupart des crises auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés : la montée des inégalités, la pauvreté endémique des enfants, les maladies épidémiques du désespoir, les délocalisations et l'érosion de l'assiette fiscale, la lente dégradation des soins de santé, de l'éducation et des autres services publics, l'effondrement des infrastructures, le recul démocratique, le krach financier de 2008, la montée des démagogues des temps modernes, tels que Viktor Orbán, Narendra Modi, Donald Trump, Boris Johnson et Jair Bolsonaro, nos crises écologiques et nos catastrophes environnementales.
Nous réagissons à ces situations difficiles comme si elles étaient isolées. Les crises se succèdent, mais nous ne comprenons pas leurs racines communes. Nous ne parvenons pas à reconnaître que tous ces désastres découlent d'une même idéologie cohérente ou sont exacerbés par elle - une idéologie qui a, ou du moins qui avait, un nom. Le néolibéralisme. Savez-vous de quoi il s'agit ?
Le néolibéralisme est devenu tellement omniprésent que nous ne le reconnaissons même plus comme une idéologie. Nous le considérons comme une sorte de « loi naturelle », comme la sélection darwinienne, la thermodynamique ou même la gravité - un fait immuable, une réalité non négociable. Quel plus grand pouvoir peut-il y avoir que celui d'opérer sans nom ?
Mais le néolibéralisme n'est ni inévitable ni immuable. Au contraire, il a été conçu et encouragé comme un moyen délibéré de changer la nature du pouvoir... »
1. Les origines secrètes du néolibéralisme
Contrairement à l’idée reçue, le néolibéralisme ne s’est pas imposé naturellement, mais fut le résultat d’un projet intellectuel et politique concerté, porté par des think tanks (comme la Société du Mont-Pèlerin, fondée par Friedrich Hayek et Milton Friedman). Le rôle des milliardaires semble d'évidence : des figures comme les frères Koch (États-Unis) ou Antony Fisher (fondateur de l’Institute of Economic Affairs) ont financé des réseaux pour diffuser l’idéologie néolibérale. L'affaire fut menée comme une contre-révolution idéologique, une réaction au keynésianisme et à l’État-providence après 1945, visant à restaurer le pouvoir des élites économiques.
2. Comment le néolibéralisme est devenu "invisible"
néolibéralisme a réussi à faire passer ses principes (dérégulation, privatisation, austérité) pour des lois naturelles plutôt que des choix politiques. Des détournements de langage furent amplement utilisés et relayés médiatiquement, des termes comme "liberté", "efficacité" ou "réforme" masquent une réalité, celle de l’accroissement des inégalités et le démantèlement des services publics. Hollywood, les médias et même l’éducation ont su promouvoir une vision individualiste, effaçant toute alternative collective.
"CITIZENS OF NOWHERE - he oligarch’s interests lie offshore, in tax havens and secrecy regimes. Paradoxically, these interests are served by politicians promoting a nationalist and nativist agenda. The politicians who thunder about “patriotism,” “sovereignty,” and the “defense of our borders” are always the first to sell their own countries down the river. It’s no coincidence that the newspapers and television stations endlessly fulminating about immigrants and sovereignty tend to be owned by billionaire tax exiles living overseas. As economic life has been offshored, so has political life. The rules created to prevent foreign money from funding domestic elections have, in large part, collapsed. Now, “action committees” and other aggregators of finance use shell companies to hide the true sources of their funds.
Campaigns created by hidden interests—of which the work of Cambridge Analytica (a company whose microtargeting of voters with false claims about the European Union may have helped to swing the small margin of the Brexit vote) is a prime example—spend dark money to mislead domestic electorates. At the same time, power is drained from the nation state—its ability to collect taxes, defend workers, and regulate capital contracts. As the academics Reijer Hendrikse and Rodrigo Fernandez argue, offshore finance involves “the rampant unbundling and commercialization of state sovereignty,” and the shifting of power into a secretive, extraterritorial legal space, beyond the control of any state. In this offshore world, they contend, “financialized and hypermobile global capital effectively is the state.”
« CITOYENS DE NULLE PART - Les intérêts des oligarques se trouvent à l'étranger, dans les paradis fiscaux et les régimes secrets. Paradoxalement, ces intérêts sont servis par des politiciens qui promeuvent un programme nationaliste et nativiste. Les politiciens qui parlent de « patriotisme », de « souveraineté » et de « défense de nos frontières » sont toujours les premiers à vendre leur propre pays. Ce n'est pas une coïncidence si les journaux et les chaînes de télévision qui fulminent sans cesse au sujet des immigrants et de la souveraineté appartiennent généralement à des exilés fiscaux milliardaires vivant à l'étranger. La vie économique a été délocalisée, tout comme la vie politique. Les règles créées pour empêcher l'argent étranger de financer les élections nationales se sont, en grande partie, effondrées. Aujourd'hui, les « comités d'action » et autres agrégateurs de fonds utilisent des sociétés écrans pour dissimuler les véritables sources de leurs fonds. Les campagnes créées par des intérêts cachés - dont le travail de Cambridge Analytica (une entreprise dont le microciblage des électeurs avec de fausses affirmations sur l'Union européenne pourrait avoir contribué à faire basculer la faible marge du vote du Brexit) est un excellent exemple - dépensent de l'argent noir pour induire en erreur les électeurs nationaux.
Dans le même temps, l'État-nation perd de son pouvoir - sa capacité à collecter des impôts, à défendre les travailleurs et à réglementer les contrats de capitaux. Comme l'affirment les universitaires Reijer Hendrikse et Rodrigo Fernandez, la finance offshore implique « la dissociation et la commercialisation rampantes de la souveraineté de l'État » et le déplacement du pouvoir dans un espace juridique secret et extraterritorial, au-delà des frontières de l'État.
"Globalization is not solely a neoliberal project, but it has been both shaped and accelerated by neoliberalism. Although political power has moved offshore, the means of holding it to account have not. Democracy stops at the national border, but the operations of the World Bank, the International Monetary Fund, the bodies regulating transnational trade, and the offshore arbitration systems circle the globe. As they have gained increasing power over the life of many nations, the interests of citizens— and the democratic means by which they can be heard—have been displaced by the “soft” form of “liberal dictatorship” that Hayek favored. “Patriotic” politicians, such as the former British prime minister Theresa May, accuse those who care about the rights of people beyond national borders, as opposed to their own narrow domestic interests, of being “citizens of nowhere.” But the real citizens of nowhere are the billionaires who fund these “patriots.” However far offshore such oligarchs travel, it is never far enough. Peter Thiel poured money into the Seasteading Institute, founded by Milton Friedman’s grandson, which planned to build artificial islands in the middle of the ocean, where the very rich could escape from the constraints of taxation, regulation, trade unions, and all the other “encumbrances” they encountered.
But the ventures that the institute inspired sank after some of the investors began asking inconvenient questions: who will feed us, service our homes, clean our clothes, and supply the other goods and services we demand? Such is the force of the oligarchs’ fantasy of detaching themselves from an ungrateful world that they managed to forget they are utterly dependent on the labor of others.
This pipe dream owes much to Ayn Rand’s novels "Atlas Shrugged" and "The Fountainhead", which are the fictional mirrors of "The Constitution of Liberty", and the favorite texts of billionaires and teenage misanthropes. The Randian fantasy of a billionaires’ strike against democratic controls, which would lead to the collapse of the world they order, teaching the ungrateful plebs to show some gratitude to their lords and masters, is a perfectinversion of reality. Working people don’t need billionaires to run their lives, but the billionaires sure as hell need workers.
La mondialisation n'est pas uniquement un projet néolibéral, mais elle a été façonnée et accélérée par le néolibéralisme. Si le pouvoir politique s'est délocalisé, les moyens de lui demander des comptes n'ont pas changé. La démocratie s'arrête aux frontières nationales, mais les opérations de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des organismes de régulation du commerce transnational et des systèmes d'arbitrage offshore font le tour du monde. Alors qu'ils ont acquis un pouvoir croissant sur la vie de nombreuses nations, les intérêts des citoyens - et les moyens démocratiques par lesquels ils peuvent être entendus - ont été remplacés par la forme « douce » de « dictature libérale » préconisée par Hayek. Les politiciens « patriotiques », comme l'ancienne première ministre britannique Theresa May, accusent ceux qui se préoccupent des droits des personnes au-delà des frontières nationales, par opposition à leurs propres intérêts nationaux étroits, d'être des « citoyens de nulle part ». Mais les véritables citoyens de nulle part sont les milliardaires qui financent ces « patriotes ». Quelle que soit la distance parcourue par ces oligarques, elle n'est jamais suffisante. Peter Thiel a versé de l'argent au Seasteading Institute, fondé par le petit-fils de Milton Friedman, qui prévoyait de construire des îles artificielles au milieu de l'océan, où les très riches pourraient échapper aux contraintes de la fiscalité, de la réglementation, des syndicats et de tous les autres « encombrements » qu'ils rencontrent. Mais les entreprises inspirées par l'institut ont sombré lorsque certains investisseurs ont commencé à poser des questions gênantes : qui nous nourrira, entretiendra nos maisons, nettoiera nos vêtements et fournira les autres biens et services que nous demandons ? Le fantasme des oligarques de se détacher d'un monde ingrat est si fort qu'ils ont réussi à oublier qu'ils sont totalement dépendants du travail des autres...."
3. Les conséquences catastrophiques
Une Démocratie qui s'est vidée de son sens : les gouvernements deviennent des gestionnaires du marché, tandis que les multinationales et les banques dictent les politiques. Quant à la crise écologique, le néolibéralisme encourage la surconsommation et bloque toute régulation environnementale sérieuse. On assiste de même à une précarisation généralisée , les thématiques bien connues de flexibilité du travail, affaiblissement des syndicats, de montée de la pauvreté malgré la croissance, et de montée des extrêmes ..
4. Quelles tactiques de résistance et alternatives possibles
Il est nécessaire de démasquer l’idéologie et de révéler que le néolibéralisme est une construction humaine, pas une fatalité. Il faut repolitiser l’économie , remettre en question les dogmes comme "l’équilibre budgétaire" ou "la concurrence libre et non faussée". Et reconstruire les "communs", défendre les services publics, les coopératives et les biens collectifs, associer mouvements sociaux, écologistes et syndicats pour un "New Deal" progressiste. Un tentative d'appel à la révolte intellectuelle : le néolibéralisme n’est pas invincible – il a été imposé par une minorité et peut être démantelé ...
